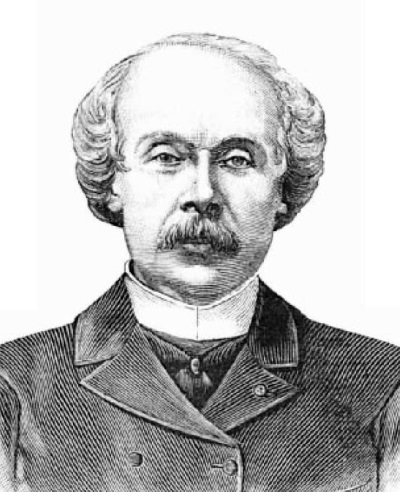L’Aïeule (Adolphe D’ENNERY - Charles-Edmond CHOJECKI)
Drame en cinq actes et six tableaux.
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Ambigu-Comique, le 17 octobre 1863.
Personnages
LE DUC
LE COMMANDEUR
GASTON DE MONTMARCY
BIASSOU
UN INTENDANT
DEUX DOMESTIQUES
TROIS MAGISTRATS
LA DOUAIRIÈRE
LA DUCHESSE
JEANNE
BLANCHE
GERMAINE
PAYSANS
PAYSANNES
La scène se passe en province.
ACTE I
Une salle de vieux château. Deux portes vitrées au fond donnant sur un parc. Portes à droite et à gauche.
Scène première
BIASSOU, GERMAINE
GERMAINE, apercevant Biassou qui apparaît par la porte du fond.
Vous ici, mon parrain ! c’est-il Dieu possible ?
BIASSOU, tenant sous le bras un panier recouvert d’un morceau de toile.
Et pourquoi que je n’y viendrions point ? l’étrangère a-t-elle donné l’ordre de mettre à la porte les anciens serviteurs du château ?...
GERMAINE.
Non, mais depuis l’accident qu’est arrivé à madame la duchesse quéques-uns disent, tout bas, que c’est vous qui y avez jeté un sort.
BIASSOU.
Moi... si j’y avions jeté un sort, Germaine, l’étrangère ne s’en seriont point relevée ; ce n’est même point elle, à ce qui paraît, qu’a été blessée.
GERMAINE.
C’est vrai ! quand son cheval, qui s’était emporté, allait lui briser les jambes, ou peut-être bien lui écraser la tête contre les arbres de la forêt, le jeune voisin du château de la Roche-Barjon, qui accompagnait madame la duchesse, a sauté à la bride du cheval, il s’est laissé traîner et fouler par lui, mais tout de même il a fini par arrêter la bête. Quand les piqueux sont arrivés, le jeune homme avait la tête et la poitrine en sang.
BIASSOU.
Ce que le sort fait est bien fait, de quoi qu’il se mêlait ce M. de Montmarcy ?
GERMAINE.
La duchesse allait peut-être mourir.
BIASSOU.
Pas tout entière, il serait encore resté sa fille, celle qui tient la place d’notre véritable maîtresse.
GERMAINE.
Parrain, m’est avis que vous laissez trop paraître votre haine.
BIASSOU.
Bah !
GERMAINE.
On ne sait que trop déjà que nous tenons pour madame la marquise douairière, pour sa fille la défunte, et pour l’orpheline qu’elle nous a laissée.
BIASSOU.
Après ?... j’ sommes t’y les maîtres de ne pas en vouloir à la seconde femme de M. le duc et à son enfant qui s’en est venue couper l’herbe sous le pied de not’ demoiselle ? Chacun pour les siens dans ce bas monde ! Qu’elle prenne garde à elle la belle demoiselle, je connais une herbe qui se cueille au déclin de la lune, et j’ sais une conjuration qui se dit la veille de la Chandeleur, qui n’ont jamais manqué leus effets.
GERMAINE.
Y en a-t-il aussi quéques-unes de bienfaisantes, parrain, de vos conjurations ?
BIASSOU.
S’il y en a ?... Pas plus tard qu’à ce matin, comme le coq chantait, j’en ons prononcé une sur la tête d’un agneau qui venait de naître... À c’te heure, c’est un porte-bonheur !
GERMAINE.
Un porte-bonheur !
BIASSOU.
Le v’là dans ce panier, je l’apporte à not’ jeune maîtresse.
GERMAINE, regardant dans le panier.
Un petit agneau tout blanc !... Elle ne va pas tarder avenir, vite, plaçons le panier sur la table de sa chambre.
Elle prend le panier et entre dans la chambre à droite.
BIASSOU.
Penche un peu le panier, ne crains point dé gêner l’agneau, faut qu’elle l’entende bêler devant que de l’avoir vu, pour que le charme soye complet.
GERMAINE, reparaissant.
C’est fait.
Elle ferme la porte et regarde par la serrure.
La voilà qui rentre chez elle.
BIASSOU, gravement.
Le blanchet a-t-il chanté ?...
GERMAINE.
Non... si... je l’entends qui crie...
BIASSOU.
Et notre demoiselle ?
GERMAINE.
Elle court auprès de lui, elle découvre le panier...
BIASSOU.
Bien ça... c’est un bon pronostice, comme on dit.
GERMAINE.
Elle prend le blanchet dans ses bras.
BIASSOU.
Bon encore !... c’est longue vie et prospérité.
GERMAINE.
Elle le couvre de baisers.
BIASSOU, regardant.
Confusion de ses envieux et triomphe sur ses ennemis...
Se frottant les mains.
Ça va bien !...
Ils redescendent en scène.
L’ bon Dieu a béni ma conjuration.
Scène II
BIASSOU, GERMAINE, JEANNE
JEANNE, entrant.
Mais qui est-ce qui l’a placé là ?
BIASSOU.
C’est moi, not’ demoiselle !
JEANNE.
Biassou ! J’aurais dû vous deviner !... il n’y à que vous pour penser ainsi toujours à moi.
BIASSOU.
Faites excuse, not’ demoiselle ! je n’ons pensé qu’à l’agnelet. La pauvre petiot venait de perdre sa mère et je me sommes dit comme ça : Portons l’orphelin à l’orpheline, l’un et l’autre ne se feront point de mal.
JEANNE.
Oui, père Biassou, vous ne l’oubliez pas, l’orpheline ; vous l’aimez comme vous avez aimé ma mère, et je vous le rends bien de tout mon cœur !...
BIASSOU.
En avez-vous de ces bonnes paroles pour le pauvre monde !... c’est comme du miel !... Mais au château, tous tant qu’ils sont, ils devraient être à deux genoux devant vous.
GERMAINE.
Anciennement c’était comme ça, mais aujourd’hui...
JEANNE.
Aujourd’hui tout le monde est parfait pour moi.
BIASSOU.
Est-ce bien vrai ça, not’ demoiselle ?... les bons n’aiment point à se plaindre, même quand ils ont le droit de le faire.
Scène III
BIASSOU, GERMAINE, JEANNE, LA DOUAIRIÈRE
LA DOUAIRIÈRE.
Bien parlé, Biassou, les bons n’aiment point à se plaindre. Les âmes fières souffrent en silence.
BIASSOU, troublé et voulant s’en aller.
Pardon, madame la marquise, si j’osons nous présenter... C’est mademoiselle Jeanne qu’a ben voulu...
LA DOUAIRIÈRE.
Restez !... restez !... il ne me déplaît pas de vous voir, Biassou. Tous les miens sont morts, ma génération a disparu. Il me semble parfois que je suis la seule que Dieu ait oubliée sur cette terre, et vous êtes pour moi la preuve vivante du contraire. Si je ne me trompe, Biassou, il n’y a que quelques arbres du parc, qui soient ici plus anciens que nous deux.
BIASSOU.
Peut-être ben, ma’me la marquise.
LA DOUAIRIÈRE.
Les vieux ont raison de se laisser mourir. C’est une malédiction quand ils survivent aux jeunes.
JEANNE.
Grand’mère, mais quand ils sont aimés, bien aimés par leurs petits-enfants, ils trouvent de quoi se consoler un peu, n’est-ce pas ?
LA DOUAIRIÈRE.
Il faudrait pour cela que leurs petits-enfants fussent heureux, qu’ils eussent tout ce qui leur appartient, et lorsqu’ils n’ont plus de mère, que leur père leur gardât tout son cœur.
Elle s’assied dans un fauteuil et tire son tricot de laine.
Avancez, Biassou... êtes-vous venu nous demander quelque chose ?...
JEANNE.
Au contraire, grand’mère, il m’a apporté un joli petit agneau...
LA DOUAIRIÈRE.
C’est bien !... Lui, ne fait pas comme les autres ! il t’apporte l’agneau et il ne garde pas pour lui le reste du troupeau.
BIASSOU.
Je le gardons pour ma’me la marquise, et j’ons soin de son bien ; il est vrai que j’nous mettons deux à la besogne.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah ! vous avez pris un aide...
BIASSOU.
Toujours le même !... mon chien... Goliath ! qui m’attend là dehors
On entend les aboiements d’un chien.
et qui s’impatientont un brin, à ce que je crois...
LE COMMANDEUR, au dehors.
Holà ! quelqu’un ! veux-tu te taire, animal !
LA DOUAIRIÈRE, sans tourner la tête.
Que se-passe-t-il ?
JEANNE, allant au fond.
Ah ! mon Dieu ! c’est notre cousin, le commandeur, qui est aux prises avec Goliath ; mais courez donc, Biassou !...
BIASSOU.
N’ craignez point pour Goliath, mam’zelle, il a d’bons crocs, allez.
JEANNE.
Mais il va dévorer le commandeur, allez donc !
LA DOUAIRIÈRE.
Allez, Biassou !
GERMAINE.
Venez, parrain.
BIASSOU, sortant.
J’y vas, ma’me la marquise... Ho ! là !... tout beau, Goliath... tout beau !...
Ils sortent.
JEANNE.
Ah ! c’est finit... voici le commandeur... dans quel étal cela a dû le mettre... lui qui craint tant les émotions, n’est-ce pas, grand’mère ?
Scène IV
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, LE COMMANDEUR
LE COMMANDEUR, entrant très calme et l’épée à la main.
Le vilain animal !...je crois, Dieu me damne, qu’il m’a faussé mon épée.
JEANNE.
Que vous arrive-t-il donc, mon cousin ?
LE COMMANDEUR.
À moi ? rien, ma cousine, absolument rien.
LA DOUAIRIÈRE.
Cependant ce bruit que nous venons d’entendre ?
LE COMMANDEUR.
C’était les aboiements d’un énorme chien qui voulait me barrer le passage... comme je tenais à entrer ici, et qu’il tenait à ce que je n’y entrasse pas, il me montrait deux superbes rangées de crocs et prenait son élan pour me sauter à la gorge...
JEANNE.
Ah ! mon Dieu !
LE COMMANDEUR.
Vous savez combien je suis ennemi de toute émotion, celle dont j’étais menacé n’avait rien d’agréable ; aussi, fis-je un pas en arrière pour dégager mon épée du fourreau, et comme l’animal furieux bondissait sur moi, j’entrai délicatement l’épée sous son épaule gauche, dans le cinquième espace intercostal, et lui traversai le cœur.
JEANNE.
Ah ! ce pauvre Goliath !
LE COMMANDEUR.
Je vous remercie, cousine, de ces affectueuses paroles à propos du danger auquel je viens d’échapper.
LA DOUAIRIÈRE.
Mon neveu, d’où vous est venue, je vous prie, cotte horreur de toute émotion ?...
LE COMMANDEUR.
Hélas ! madame, d’un désir insatiable de m’instruira.
JEANNE.
Vraiment ?
LE COMMANDEUR.
J’ai appris l’anatomie, la physique, la chimie, la médecine, mais c’est surtout la médecine et l’anatomie qui m’ont perdu. J’ai étudié jusqu’aux nerfs les plus délicats, jusqu’aux fibres les plus déliées de notre corps. Je me suis rendu compte de l’influence de nos pensées sur le mouvement du sang, sur la tension des nerfs... et j’en ai conclu que toute émotion, joyeuse ou triste, agit sur l’organisme d’une façon déplorable et le met en péril ; qu’enfin si l’on connaissait toute la fragilité de la machine humaine ; si l’on savait combien de fois, par minute, on se met soi-même en danger de mort, on n’oserait accomplir aucun acte de la vie, on hésiterait à se promener quand on est au repos, à s’asseoir lorsqu’on est debout, à se lever quand on est assis, on ne boirait qu’avec terreur, on ne mangerait qu’avec angoisse, on s’abstiendrait du chant, du rire, de la danse, de l’amour, de tout enfin, et... du reste.
LA DOUAIRIÈRE.
Cette terreur qui vous tient ainsi est un châtiment, mon neveu ; vous avez oublié que la science est faite pour les gens de peu ou de rien, et vous en avez été puni.
JEANNE.
Puni !... mais, grand’mère, le commandeur est cité comme un des plus habiles médecins de France.
LA DOUAIRIÈRE.
À quoi sert cette réputation ? il n’a pas, je suppose, la pensée d’exercer.
LE COMMANDEUR.
Jamais ! Assister aux souffrances d’un malade, aux lamentations de la famille ! que le ciel me préserve de pareilles émotions !
JEANNE.
Même si cette famille était la vôtre ? s’il s’agissait de vos enfants ?
LE COMMANDEUR.
Mos enfants, je n’en veux pas ! Le ménage ! ah ! ah !... voilà une source intarissable d’émotions ! et de quelles émotions, grand Dieu !
LA DOUAIRIÈRE.
Il y a des maris heureux, monsieur le commandeur.
LE COMMANDEUR.
Certainement, madame la marquise, il y a des maris très heureux... ceux qui deviennent veufs, par exemple...
JEANNE.
Veufs...
LE COMMANDEUR.
Il y en a d’autres encore dont il convient de ne pas parler devant vous, cousine. Ils ne sont pas veufs, ceux-là... leurs femmes non plus ne sont pas veuves ; au contraire... ça ne les empêche pas d’être généralement heureux et d’acquérir de l’embonpoint... mais ils jouissent d’un bonheur que je n’envie guère...
LA DOUAIRIÈRE.
Mon neveu, vous prétendiez ne mettre jamais au service d’autrui vos merveilleuses connaissances en médecine ? Il y a cependant M. de Montmarcy, le héros, le sauveur de madame la duchesse à qui vous avez donné vos soins.
JEANNE.
Par exception !... et il l’a sauvé...
LE COMMANDEUR.
Par exception aussi, n’est-ce pas ?...
JEANNE.
J’allais le dire !
LA DOUAIRIÈRE.
Et madame la duchesse elle-même...
LE COMMANDEUR.
Votre belle-fille ?...
LA DOUAIRIÈRE, avec hauteur.
La seconde femme de mon gendre.
LE COMMANDEUR.
Je l’ai soignée aussi, cela est vrai.
LA DOUAIRIÈRE.
Mais avec moins de succès... Depuis cet accident qui n’a été funeste, cependant, qu’à M. de Montmarcy, un changement étrange s’est opéré en elle. Sa vie s’écoule presque tout entière dans l’isolement, elle l’emploie à griffonner comme faisait mademoiselle de Scudéri, et lorsque, par hasard, elle daigne se montrer à nous, c’est le front penché, l’air rêveur et distrait... Il n’y a pas lieu de vous glorifier beaucoup de cette cure et de votre dévouement à cette personne.
LE COMMANDEUR.
Permettez, ma tante, outre que, par tempérament, je suis peu dévoué de ma nature, vous savez que je ne le suis pas du tout à cette... personne, comme vous l’appelez. Que diable ! je suis des vôtres, je suis un Montbazon, moi, et je déclare que je haïrais de tout mon cœur cette seconde femme de mon cousin, cette étrangère qu’il a amenée dans la famille, si la haine ne me paraissait aussi nuisible à la santé que l’amour, l’amitié et toutes les soties affections de ce genre.
JEANNE.
Mon cousin, est-ce que la duchesse est malade ?
LA DOUAIRIÈRE, avec ironie.
Non... c’est quelque souffrance morale, c’est son âme qui est atteinte. Eh ! tenez, la voilà qui vient de ce côté ; voyez si je m’abuse !
La duchesse entre sans les voir et vient s’asseoir à l’avant-scène.
Scène V
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, LE COMMANDEUR, LA DUCHESSE
LE COMMANDEUR.
Oui, oui, de la préoccupation, de la rêverie... rien ne lui échappe à cette excellente douairière... c’est une sollicitude tout à fait maternelle.
LA DUCHESSE, à elle-même.
Il y a trois jours qu’il n’est venu ici... tant mieux ! Je voudrais ne le revoir jamais... ah ! je voudrais surtout... ne l’avoir jamais rencontré.
LE COMMANDEUR.
Madame la duchesse !...
LA DUCHESSE, jetant un petit cri.
Ah !
Se remettant.
Pardon, monsieur le commandeur, je ne vous avais pas vu... Veuillez m’excuser aussi, madame la marquise...
LA DOUAIRIÈRE, avec une froideur très marquée.
Votre servante, madame.
LA DUCHESSE, avec contrainte.
J’espère que votre santé est satisfaisante, madame.
LA DOUAIRIÈRE, même ton.
Vous êtes mille fois trop bonne, madame.
LE COMMANDEUR, à part.
Touchante sympathie de famille... elles s’adorent, ces deux femmes-là.
LA DUCHESSE, avec affection.
Bonjour, ma chère Jeanne.
JEANNE, l’embrassant.
Bonjour, madame la duchesse.
LA DOUAIRIÈRE, avec dépit et très vivement.
Jeanne... j’ai oublié mon éventail...
JEANNE, allant à elle.
Votre éventail ! mais le voilà, grand’mère, il est à votre bras.
LA DOUAIRIÈRE.
C’est bien.
JEANNE.
Mon cousin, donnez-nous donc des nouvelles de votre malade...
LA DUCHESSE, un peu troublée.
De... son malade ?
JEANNE.
Mais oui, de M. de Montmarcy.
LE COMMANDEUR.
Il va bien... tout à fait bien... je voulais même l’emmener à Paris.
LA DUCHESSE, vivement.
Ah !...
Se remettant.
Je le croyais parti... Combien donc y a-t-il de jours que nous ne l’avons vu, Jeanne ?
JEANNE.
Il y a trois jours, madame la duchesse, et j’en suis très fâchée... C’est un brave jeune homme que j’aime bien, puisqu’il vous a sauvée...
Elle va près de la duchesse.
LA DUCHESSE, lui prenant la main.
Excellent cœur !
Elle va pour l’embrasser sur le front.
LA DOUAIRIÈRE, vivement.
Jeanne !...
La duchesse s’arrête.
ôtez-moi ces fleurs... leur odeur m’incommode.
JEANNE, allant à la table.
Leur odeur, grand’mère ? mais il n’y a que des marguerites. Ça ne sent rien du tout.
UN DOMESTIQUE, annonçant.
M. le chevalier de Montmarcy.
LA DUCHESSE, à part.
Lui !...
LE COMMANDEUR, à part.
La duchesse s’est troublée.
Scène VI
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, LE COMMANDEUR, GASTON
GASTON, saluant.
Mesdames...
JEANNE.
Arrivez donc, monsieur Gaston...
LA DUCHESSE.
Le commandeur nous disait à l’instant que vous aviez l’intention de nous quitter.
GASTON.
Je devais en effet partir, madame la duchesse, mais mon départ est ajourné.
LA DUCHESSE.
Ah ! tant mieux... Vous avez encore besoin de ménagements, de soins, de repos... n’est-il-pas vrai, commandeur ?...
LE COMMANDEUR.
Certainement !... Les soins, les ménagements et le repos... c’est toujours indispensable, même à ceux qui se portent le mieux.
LA DOUAIRIÈRE.
Ainsi, vous restez, monsieur...
GASTON.
Par ordre de mon père, madame la marquise.
LA DUCHESSE.
De votre père...
GASTON.
Bientôt, m’écrit-il, aujourd’hui peut-être, j’aurai l’explication de cet ordre qu’il me donne.
LA DUCHESSE, à part.
Aujourd’hui... et c’est aujourd’hui aussi que mon mari doit... C’est étrange...
LA DOUAIRIÈRE.
Votre père est un Montmarcy. Ces Montmarcy-là appartiennent-ils à la noblesse d’épée ?
GASTON.
Mon père porte une épée comme tout le monde, madame ; mais c’est plutôt pour lui une affaire de mode, car il n’est pas homme de guerre ; il est fermier général.
LE COMMANDEUR.
Et avec ça millionnaire... je ne sais combien de fois.
LA DOUAIRIÈRE.
Et ami très intime de monsieur le duc...
JEANNE.
De mon père.
GASTON.
Oui, madame, il a cet honneur.
LA DOUAIRIÈRE.
Et ce plaisir, vous pourriez ajouter ; car à Paris, lorsqu’on est ami de M. le duc, on n’a pas, à ce qu’il paraît, le temps de s’ennuyer.
LA DUCHESSE, indiquant Jeanne du regard.
Oh ! madame, de grâce...
LA DOUAIRIÈRE.
Suis-je dans l’erreur, madame ?... Au fait, nous pouvons ignorer l’une et l’autre quelle est au juste sa vie. M. le duc nous gâte peu par la fréquence et la longueur de ses apparitions au château, et je ne pense pas non plus qu’il emploie ses matinées à vous donner de ses nouvelles...
LA DUCHESSE.
Permettez-moi, madame, de vous désabuser. M. le duc m’écrit. Hier soir, encore, j’ai reçu de lui une lettre. Il m’annonce son arrivée pour aujourd’hui ou demain au plus tard.
GASTON.
Le duc... ici ?...
LA DUCHESSE, l’observant.
Oui...
LE COMMANDEUR, à part.
Le jeune homme semble ému à son tour.
GASTON, à part.
Mon sort va se décider.
JEANNE.
Mon père nous arrive ! quel bonheur !...
LA DOUAIRIÈRE.
Compte-t-il cette fois et par exception, passer quelques jours avec sa fille ?...
LA DUCHESSE.
Vous savez, madame, que les Visites de M. le duc au château ne sont jamais de longue durée. Arrivé aujourd’hui, il repartira demain, sans cloute.
LA DOUAIRIÈRE.
Jadis, il demeurait volontiers à son foyer conjugal ; mais alors...
LA DUCHESSE, avec amertume.
Alors, je n’étais pas sa femme, n’est-ce pas, madame ?
LA DOUAIRIÈRE, sèchement.
Cela est vrai, madame.
JEANNE, vivement.
Mon père sera si heureux.au milieu de nous ! nous lâcherons de le retenir.
LE COMMANDEUR.
Comment donc !... mais il sera enchanté.
À part.
On s’aime tant dans sa famille
GASTON, absorbé.
Il faut que je prenne un parti aujourd’hui même.
Scène VII
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, LE COMMANDEUR, GASTON, GERMAINE
GERMAINE.
Madame, le carrosse de M. le duc a déjà descendu la grande avenue, il s’approche de la grille.
LA DUCHESSE, à part.
Mon mari !...
JEANNE.
Mon père !...
À la duchesse.
Courons vite.
LA DUCHESSE.
Venez, Jeanne...
LA DOUAIRIÈRE.
Jeanne... j’ai besoin de votre bras... Allez, allez, nous vous suivons.
GASTON, s’approchant de la duchesse et lui offrant son bras.
Madame la duchesse...
LA DUCHESSE, s’arrêtant et feignant de ne l’avoir pas entendu.
Venez donc, commandeur...
Elle lui prend le bras. Ils sortent tous les trois par le fond. La douairière et Jeanne les suivent. Arrivée près de la porte, la douairière s’arrête et relient Jeanne d’un geste impérieux.
LA DOUAIRIÈRE.
Reste !
Scène VIII
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE
JEANNE.
Grand’mère, ne voulez-vous pas que j’aille au-devant de mon père...
LA DOUAIRIÈRE.
Je ne veux pas que tu t’exposes à voir ses regards tomber d’abord sur l’étrangère ; je ne veux pas que l’on le prouve une fois de plus que dans cette maison tu occupes la dernière place, toi, à qui tout devrait appartenir.
JEANNE.
Mais si vous saviez comme la duchesse est bonne pour votre Jeanne. Elle ne mérite pas la froideur que vous lui témoignez.
LA DOUAIRIÈRE.
De la froideur ! ce n’est pas cela ! je la hais, cette femme, elle et sa fille ! Sans elle, tu n’aurais pas été comme une étrangère sous le toit qui t’a vue naître... Orpheline, aussi bien de ton père vivant que de ta mère morte, voilà ce qu’elles ont fait de toi ! Comprends-tu maintenant pourquoi j’achève ma vie dans la haine, dans la douleur et dans les larmes ?
JEANNE.
Grand’mère, je vous aime bien, vous m’aimez aussi, j’en suis sûre, et pourtant vous me rendez malheureuse...
LA DOUAIRIÈRE.
Tais-toi ! les voici !...
Entrée du duc, de la duchesse, du commandeur.
Scène IX
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, LE DUC, LA DUCHESSE, LE COMMANDEUR
LE DUC, à la douairière.
Madame la marquise, j’en veux à tout ce monde d’avoir couru à ma rencontre... C’est à vous d’abord que j’aurais dû présenter mes respectueux hommages.
LA DOUAIRIÈRE.
Monsieur le duc, votre premier regard appartient à votre fille, et je n’ai pas plus que personne le droit de l’en priver.
LE DUC.
À merveille ! Maintenant que nous avons tous reçu notre petite leçon, permettez-moi de vous baiser la main.
Il la lui baise cérémonieusement, puis, se redressant et avec gaieté.
Et toi, ma Jeanne, viens m’embrasser...
JEANNE, l’embrassant.
Que je suis heureuse de vous voir, et !que je vous aime !
LE DUC.
J’y compte bien ! ce sont ceux que l’on voit le plus rarement qu’on a plus de plaisir à retrouver, et j’ose dire qu’à ce compte-là, si quelqu’un a eu jusqu’ici le droit d’être adoré de sa famille... c’est bien certainement ton excellent père, ma fille.
LA DUCHESSE.
Que dites-vous là, monsieur le duc ?
LE DUC.
La vérité, et vous le savez bien, duchesse.
JEANNE.
Méchant ! je vous défends de calomnier mon père !... il est ce qu’il veut être, entendez-vous, monsieur ; ce qu’il fait, il a le droit de le faire, et c’est toujours bien, toujours juste, toujours bon, puisque c’est le plus charmant et le meilleur des pères.
LE DUC, ému.
Chère fille bien-aimée !... Et toutes ces douces paroles, toute cette pieuse tendresse, à moi, à moi, l’émule, le compagnon de Richelieu, à moi, l’habitué de l’Œil-de-Bœuf !... J’en suis tout ému, et je crois, Dieu me damne, qu’un peu plus, je... Viens, viens m’embrasser, tu es un ange !...
Il l’embrasse.
LE COMMANDEUR, à part.
Oh ! oh ! les tendresses, les émotions de famille... je vais prendre un peu l’air, moi.
Le duc le retient par le bras.
LE DUC.
Où vas-tu donc, cousin ?...
Montrant Jeanne.
Quel excellent petit cœur...
LA DOUAIRIÈRE.
C’est le cœur de sa mère, monsieur le duc.
LE DUC.
Oui, madame la marquise, oui, le cœur de sa mère, c’est-à-dire l’indulgence, la bonté, la tendresse même, le modèle de toutes les vertus...
À la duchesse.
que j’ai retrouvées en vous, duchesse.
LA DUCHESSE.
Je vous remercie de vouloir bien le dire, monsieur le duc.
LA DOUAIRIÈRE.
Cette fois, monsieur le duc, Jeanne gardera-t-elle son père quelques jours auprès d’elle ?
LE DUC.
Aujourd’hui, madame, je ménage à Jeanne, à la duchesse et à vous-même, une grande surprise.
TOUS.
Une surprise...
LE DUC.
Et à toi aussi, commandeur.
LE COMMANDEUR.
Oh ! je ne les aime pas ! Petite ou grande, il y a toujours une émotion dans une surprise.
LA DUCHESSE.
De quoi s’agit-il donc, monsieur le duc ?
LE DUC.
M’y voici : quand je vous ai quittées, il y a quelque temps, j’étais... ce que vous supposez que je suis encore, un gentilhomme incapable de vivre loin de l’éclat du soleil, c’est-à-dire, loin du trône, loin de la cour. Eh bien, aujourd’hui je vous reviens entièrement transformé ; je n’ai plus qu’un seul désir, un seul rêve : les charmes de la campagne, la sérénité d’une existence de famille, la douce vie du foyer conjugal... bref, je ne retourne plus à Versailles, je m’établis ici, je reste parmi vous.
LA DUCHESSE, à part.
Il reste !
JEANNE.
Vous ne nous quitterez plus, quel bonheur !
LE COMMANDEUR, qui la regarde.
La belle duchesse n’a pas l’air enchantée.
LE DUC
Cela le rend donc bien heureuse ?
JEANNE.
Oui, certes...
LE DUC, à la duchesse qui a tenu la tète baissée.
Et vous, duchesse ?
LA DUCHESSE.
Moi... monsieur le duc... je suis...
LE DUC.
Vous êtes... ?
LA DUCHESSE.
Pardonnez-moi, monsieur le duc, j’étais si loin de m’attendre...
Avec un peu d’amertume.
Vous m’avez si peu habituée au plaisir de vous garder ici...
LE DUC.
Que la nouvelle vous en attriste un peu ?...
LA DUCHESSE.
Oh ! pouvez-vous croire...
LE DUC.
Non, vous êtes fort joyeuse de mon retour, c’est convenu.
Changeant de ton.
Par bonheur, je tiens en réserve une autre surprise... irrésistible, celle-là !... Jeanne !
JEANNE.
Mon père ?
LE DUC, bas.
Cours à la maison du garde, à l’entrée du parc... tu trouveras quelqu’un qui t’y attend.
JEANNE.
Moi...
LE DUC, bas.
Quelqu’un que tu seras heureuse de voir... dépêche-toi... et pas un mot à personne.
JEANNE, bas.
J’y cours...
Elle sort.
LA DOUAIRIÈRE.
Nous direz-vous, monsieur le duc, par quel prodige s’est opérée en vous cette heureuse transformation ?
LE DUC.
Le prodige ? Il s’est opéré à la mort du roi Louis XV et grâce à l’avènement de S. A. R. Monseigneur le Dauphin.
LE COMMANDEUR.
Comment ?
LE DUC.
J’étais un homme de l’ancienne cour, moi, amoureux de la vie de Paris, de toutes ses séductions, de tous ses enivrements... amoureux de l’éclat éblouissant de Versailles, avec ses fêtes, ses splendeurs...
LE COMMANDEUR.
Et le reste !...
LE DUC.
Mais tout cela est bien changé depuis le nouveau règne... Ils ont détrôné le plaisir, et ils ont mis la philosophie à sa place... Au lieu de carrousels, de ballets et de fêtes, on ne parle que réformes, économies, justice. Et chose qui vous paraîtra bien plus bizarre encore, une respectable institution qui permettait de mettre à l’ombre et sans bruit les importuns qui gênaient l’État ou qui déplaisaient à ses grands dignitaires ; en un mot, les lettres de cachet, ces bonnes et vénérables lettres de cachet, tombent en discrédit : on les attaque, on les maudit, on les condamne, et je ne serais pas étonné qu’on les supprimât tout à fait.
LA DOUAIRIÈRE.
Mais ce que vous nous annoncez là, serait la fin du monde !
LE DUC.
Eh ! mon Dieu oui, madame la marquise ! c’est la fin du monde, du vieux monde... et c’est peut-être en même temps l’aurore d’un monde nouveau. L’ancien s’est endormi dans une longue orgie qui, ma foi, avait bien son charme. Mais lorsqu’on se réveilla, un spectacle étrange frappa les regards. Rien n’était plus à sa place. La noblesse énervée, ruinée, n’existait plus que de nom ! Les parlements luttaient pour le maintien de leurs privilèges, et la justice, abandonnée par eux, tombait en oubli ! Quelques financiers de bas étage accaparaient toute la richesse ; quant au reste du pays, il mourait littéralement de misère et de faim !... bref, nous pouvons en convenir, entre nous, la situation laissait un peu à désirer.
I.A DOUAIRIÈRE.
Je ne suis pas d’hier, monsieur le duc, j’ai toujours vu ça, et les enfants de nos enfants verront encore la même chose.
LE DUC.
Les philosophes prétendent le contraire, madame... À les entendre, un avenir splendide va bientôt s’ouvrir devant la France. La noblesse vaudra autant par son mérite que par sa naissance. La bourgeoisie se révélera comme une force productive immense ; l’oisiveté deviendra une honte, et la misère sera domptée par le travail. Mais, pour cela, il faut que personne n’épargne ni peines, ni sacrifices, sinon le succès aura lieu quand même... mais c’est l’inconnu qui se chargera de le réaliser.
LA DOUAIRIÈRE.
L’inconnu !... lequel ?
LE DUC.
Celui qui jusqu’ici n’a pas de nom, madame !
LA DOUAIRIÈRE.
Qui cela ?
LE DUC.
Le peuple !...
LA DOUAIRIÈRE.
En effet, le nom m’échappe. Je connais les paysans qui cultivent, les artisans qui travaillent, la foule qui, à de certains moments, se compose de tout cela, mais le peuple... je ne le connais pas.
LE DUC.
C’est parce qu’on ne le connaît pas, madame, que l’on ignore peut-être tout ce qu’il renferme dans son sein ?... Qui sait si les fils de ceux que vous voyez labourer, ou faire œuvre de leurs mains, ne deviendront pas un jour d’illustres savants, de célèbres généraux, des administrateurs, des magistrats hors ligne ? Qui sait si ce n’est pas là qu’un jour la France ira chercher toute sa force et toute sa gloire ?
LA DUCHESSE.
Si les choses se passent ainsi, je comprends que vous ayez quitté Paris.
LE DUC.
Ce n’est pas tout à fait de moi-même que je m’y suis décidé.
TOUS.
Comment ?
LE DUC.
Le roi compte un peu parmi les philosophes ; Sa Majesté met elle-même la main à l’œuvre. Elle s’occupe de tout et de tous... si bien qu’un beau matin, mon tour est venu. Le roi a d’abord insisté sur son intention de relever la noblesse qui avait beaucoup souffert...
LA DOUAIRIÈRE.
Beaucoup dépensé, vous voulez dire ?
LE COMMANDEUR.
Et souffert ensuite de n’avoir plus rien à dépenser.
LE DUC.
Le roi a ajouté : « Duc, votre maison a rendu de trop grands services à la France, pour qu’on la laisse s’éteindre dans la personne de son dernier représentant. Nous voulons qu’une de vos filles hérite de votre nom et de votre duché-pairie, avec le droit de les transmettre à son futur époux ; nous vous offrons ainsi pour votre enfant une belle dot contre laquelle l’esprit économe de M. de Turgot n’aura rien à dire. »
LA DUCHESSE.
La faveur royale, cette fois-ci, ne comblera pas des ingrats.
LA DOUAIRIÈRE, vivement.
Vous parlez de ma petite-fille, madame, car j’espère que c’est en son nom que l’acte a été enregistré.
LE DUC.
Jeanne n’est-elle pas l’aînée ? Je n’aurais eu garde d’agir autrement !
LA DOUAIRIÈRE.
Monsieur le duc, voilà une bonne nouvelle ; je me félicite d’avoir vécu assez longtemps pour l’apprendre. Tenez, je vous dirai un mot que je n’ai pas prononcé depuis plus de vingt ans : Je suis heureuse, et je vous rends grâces !
LE DUC.
Votre bonheur, madame, sera plus complet lorsque je vous aurai appris que notre jeune héritière est à la veille de son mariage.
LA DOUAIRIÈRE.
Vous avez choisi pour ma petite-fille un mari... sans m’en prévenir ?
LE DUC.
Ce n’est pas moi qui l’ai choisi.
LA DOUAIRIÈRE.
Qui donc ?
LE DUC.
Le roi !
LA DOUAIRIÈRE.
Je m’incline, monsieur le duc, devant la volonté royale, et vous prie de vouloir bien me nommer votre futur gendre.
LE DUC.
Je ferai mieux, je vais vous le présenter, car il est ici.
TOUS.
Ici !...
LA DUCHESSE, troublée.
Ici... vous l’y avez donc amené ?
LE DUC.
Non... un ordre de son père a dû, au contraire, l’y retenir.
LA DUCHESSE, avec une émotion violente.
Lui ! mais c’est donc ?...
LE COMMANDEUR, avec intention.
Je crois que nous avons deviné, madame la duchesse...
LA DUCHESSE, très haut et essayant de sourire.
Ah ! vous pensez, comme moi, que c’est de M. de Montmarcy qu’il s’agit ?
LA DOUAIRIÈRE.
M. de Montmarcy.
LE DUC.
De lui-même, et la lettre que je lui ai remise, à mon arrivée, a dû lui faire connaître la volonté du roi.
Scène X
LA DOUAIRIÈRE, LE DUC, LA DUCHESSE, LE COMMANDEUR, GASTON, pâle et une lettre à la main
GASTON, avec émotion.
Monsieur le duc... mon père me fait part dans cette lettre d’un projet... formé par vous et par lui...
LE DUC.
Ce projet, mon cher Gaston, ce n’est ni moi ni votre père qui l’avons conçu... c’est le roi lui-même qui daigne ordonner ce mariage.
GASTON, altéré.
Le roi !...
LE DUC.
Sa Majesté a promis de signer au contrat...
LE COMMANDEUR, à part.
Et le vieux Montmarcy échange ses millions contre un titre ; c’est toujours la même histoire !...
Le duc cause à part avec la douairière.
LA DUCHESSE, bas à Gaston.
Je vous félicite, monsieur, du bonheur qui vous arrive.
GASTON, de même.
Ce mariage est impossible, madame.
LA DUCHESSE.
Impossible !... pourquoi ?...
GASTON.
Parce que... j’en aime une autre.
LA DUCHESSE, avec émotion.
Une autre !
GASTON.
Ah ! madame, je n’ai d’espoir qu’en vous.
LA DUCHESSE, tremblante.
Silence !... on vous regarde...
LE DUC.
Madame la duchesse, la nouvelle de mon séjour prolongé au château, n’a peut-être pas causé toute la joie qu’en espérait ma vanité... Permettez-moi de vous annoncer une autre nouvelle qui sera certainement plus heureuse.
LA DUCHESSE.
Une autre...
LE DUC.
Vous m’avez souvent demandé de retirer votre fille du couvent et de vous la rendre...
GASTON, à part.
Que dit-il ?... Blanche !...
LA DUCHESSE, troublée.
Ma fille !... Oui, monsieur... seule, isolée, j’aurais été heureuse de l’avoir auprès de moi... cette enfant eût été la consolation de ma vie, elle eût été mon bonheur, mon refuge... Vous me l’avez refusée bien longtemps...
Avec amertume.
trop longtemps, monsieur le duc...
LE DUC.
Les convenances exigent qu’une fille de noble souche passe ses premières années au couvent ; mais le temps de vos épreuves est fini, et je vous rends votre enfant.
LA DUCHESSE.
Vous me la rendez !...
LA DOUAIRIÈRE, à part.
Elle revient !
LE COMMANDEUR.
Allons, bon !... scène de maternité, cris de joie, émotions violentes !... décidément j’ai envie de m’en aller.
LE DUC.
Aujourd’hui, dans un instant, Blanche sera ici.
GASTON, à part.
Ici !...
LA DUCHESSE, avec joie.
Je vais la revoir, elle, ma fille !... je vais la couvrir de mes baisers et de mes larmes !...
LE COMMANDEUR, à part.
Nous y voilà.
Au duc.
Bonsoir...
LE DUC.
Reste donc...
LA DUCHESSE, à part.
La revoir !... mais suis-je bien assurée de ne pas rougir devant elle ?
LE DUC.
Eh bien, cette nouvelle-là sera-t-elle plus-heureuse que l’autre ?...
LA DUCHESSE, avec douleur.
Ah ! monsieur, ce n’est pas aujourd’hui, ce n’est pas à présent qu’il eût fallu me la rendre...
LE DUC.
Ce n’est pas à présent !... que voulez-vous dire, madame ?
LA DUCHESSE.
Je dis...
Avec contrainte.
Je dis qu’après tant d’années écoulées... son cœur a bien pu m’oublier... qu’il ne se souviendra plus peut-être de ces tendres paroles et de ces douces caresses échangées autrefois entre elle et sa mère... je dis que c’est presque une étrangère que je vais retrouver en elle...
LE DUC.
Une étrangère !... pour vous !... Blanche !...
Scène XI
LA DOUAIRIÈRE, LE DUC, LA DUCHESSE, LE COMMANDEUR, GASTON, JEANNE et BLANCHE
Elles arrivent en se tenant par la main.
JEANNE.
Tiens, Blanche, voilà ta mère.
BLANCHE.
Ma mère !...
Elle court à elle.
LA DUCHESSE.
Blanche !... comme la voilà grande et belle !...
BLANCHE.
Si tu savais combien je suis heureuse de te revoir.
Apercevant Gaston.
Ah !...
Gaston lui fait signe de garder le silence.
LA DUCHESSE.
Qu’as-tu donc ?...
BLANCHE, regardant Gaston.
Oui, oui, je suis bien heureuse...
LA DOUAIRIÈRE, qui les a observés tous les deux.
Ah ! ah ! les deux jeunes gens se connaissent...
LA DUCHESSE.
Ah ! pourquoi ai-je été si longtemps séparée de toi...
LE DUC, au commandeur.
Vois donc, ces traits altérés, ce visage inquiet... elle ne semble pas plus heureuse de retrouver sa fille qu’elle ne l’était en me revoyant moi-même.
LE COMMANDEUR.
C’est une joie... contenue...
LE DUC.
Hélas ! je ne reconnais plus mon foyer domestique.
LE COMMANDEUR.
Peut-être a-t-il profité de ta trop longue absence pour s’éteindre un peu.
LE DUC, s’animant.
Eh bien... je tâcherai de le rallumer.
LE COMMANDEUR, à part.
Il faudra diablement souffler, cousin !
GASTON, qui s’est approché de Blanche et lui parlant bas.
Blanche, un malheur nous menace...
BLANCHE, bas.
Un malheur !... lequel ?...
GASTON, bas.
Silence !...
LA DOUAIRIÈRE.
Ils se sont parlé tout bas.
CRIS, au dehors.
Vive monsieur le duc !
Scène XII
LA DOUAIRIÈRE, LE DUC, LA DUCHESSE, LE COMMANDEUR, GASTON, JEANNE, BLANCHE, GERMAINE, BIASSOU
LA DUCHESSE, relevant la tête.
Qu’y a-t-il donc ?
GERMAINE.
C’est tous les tenanciers de monsieur le duc, toute la population du village qui s’en venont souhaiter la bienvenue à leur seigneur.
LE DUC.
Les braves cœurs !
BIASSOU.
Et qui m’ont choisi comme le plus ancien pour porter la parole devant monsieur le duc.
LE DUC.
Venez, madame, ne les faisons pas attendre, c’est si bon de se trouver au milieu des gens qui vous aiment.
Il lui donne le bras.
LA DOUAIRIÈRE.
Voulez-vous, pour cette fois, me tenir lieu de Jeanne, mademoiselle ?
BLANCHE.
De grand cœur, madame...
Elle lui offre son bras. Tout le monde se dirige vers le fond.
LA DOUAIRIÈRE, restée la dernière.
Monsieur de Montmarcy, offrez le bras à ma petite-fille !
À Blanche, en lui indiquant Gaston qui donne le bras à Jeanne.
Voilà un jeune homme qui me paraît être né sous une étoile heureuse... il sera duc et pair.
BLANCHE.
Comment cela, madame ?...
LA DOUAIRIÈRE.
Le roi lui transmet le titre de la famille, et votre père lui donne sa fille aînée en mariage.
BLANCHE, émue.
Jeanne !... il épouse Jeanne ?... lui, Gaston...
LA DOUAIRIÈRE.
Elle pâlit... oh ! si elle l’aime !
Haut.
Venez, mon enfant, venez.
Sortie générale.
ACTE II
Parc et jardin avec bosquets et charmilles dans le style de Lenôtre. Musique au lever du rideau ; on aperçoit au fond une foule de paysans et de paysannes qui terminent une ronde on criant : Vive monsieur le duc !
Scène première
LES PAYSANS, LE DUC, LE COMMANDEUR, L’INTENDANT
LES PAYSANS.
Vive monsieur le duc !
LE DUC.
Allez, mes amis, buvez, chantez, dansez autant qu’il vous plaira : aujourd’hui, le parc et la cave vous appartiennent.
LES PAYSANS.
Vive monsieur le duc !
LE DUC.
Non, non... Criez : Vive madame la duchesse... C’est en son honneur que je donne cette fête.
TOUS.
Vive madame la duchesse !
Les paysans s’éloignent.
LE DUC.
Très bien. Maintenant, monsieur l’intendant, approchez.
L’INTENDANT.
Je suis aux ordres de monsieur le duc.
LE DUC.
Ceux que j’ai donnés sont-ils exécutés ? Les étoffes destinées à madame la duchesse sont-elles arrivées ?
L’INTENDANT.
Oui, monsieur le duc.
LE DUC.
Le joaillier a-t-il apporté ses plus brillantes parures ?
L’INTENDANT.
Il sera ici aujourd’hui.
LE DUC.
C’est bien ! occupez-vous des violons, de la sérénade. Allez, monsieur l’intendant.
Il salue et sort.
Eh bien, commandeur, crois-tu que je réussirai ?
LE COMMANDEUR.
À te ruiner tout à fait ?... Tu me parais en assez bon chemin.
LE DUC.
Il s’agit bien de ma fortune ! Comment ! tu ne vois pas que je suis lancé à la poursuite d’un projet qui absorbe toutes mes facultés ? Tu n’as pas deviné que moi, Honoré-Armand de Cossé-Massignac, chevalier de l’ordre, duc et pair héréditaire, j’entreprends une conquête cent fois plus difficile que n’eût été pour le maréchal de Saxe la conquête d’une province, ou d’un royaume...Tu n’as pas compris enfin que je me suis mis en tête de reconquérir le cœur de ma femme ?...
LE COMMANDEUR, froidement.
Ah !
LE DUC.
Tu dis ?
LE COMMANDEUR, hésitant.
Mais, tu dois avoir des chances de succès... Est-ce que la duchesse ne t’aimait pas autrefois ?
LE DUC.
Au contraire, elle m’adorait.
LE COMMANDEUR.
Eh bien !...
LE DUC.
Eh bien, c’est précisément ce qui rend la tâche plus difficile.
LE COMMANDEUR.
Je né comprends pas.
LE DUC.
Le cœur d’une femme est semblable au terrain que cultivent nos fermiers ; la même plante n’y réussit pas deux fois de suite.
LE COMMANDEUR.
Oui, oui, je sais cela, quand une terre a donné du froment, on le remplace d’ordinaire par de la luzerne... tu as été le froment, toi.
LE DUC.
Voilà !
LE COMMANDEUR, à part.
Et la luzerne est en train de germer.
LE DUC.
Ah ! les amours éteintes se rallument difficilement.
LE COMMANDEUR.
Alors tu ne réussiras pas.
LE DUC.
Merci, voilà comme cela t’émeut, toi.
LE COMMANDEUR.
D’abord, mon cher, je tâche de m’émouvoir le moins possible, ensuite je ne comprends rien à l’amour.
LE DUC.
Eh ! ce n’est pas de l’amour, c’est du bonheur qu’il s’agit.
LE COMMANDEUR.
Fort bien ! tu as consacré tes beaux jours de printemps et d’été aux joyeuses orgies de Versailles, et tu leur as dit : Donnez-moi l’ivresse et le plaisir. Aujourd’hui, tu apportes à ta femme tes froides journées d’automne et d’hiver, et tu lui dis : Donnez-moi le bonheur ! Mais tu ne fais pas de mauvais placements, toi !...
LE DUC.
Oui, tout cela est vrai, je le reconnais ; mais c’est l’histoire de bien des maris, ce sera peut-être un jour la tienne.
LE COMMANDEUR.
La mienne ! d’abord pour se marier, il faut aimer !
LE DUC.
Heu !... heu ! pas toujours !
LE COMMANDEUR.
Ah !
LE DUC.
D’ailleurs, qui te dit que tu ne seras jamais amoureux !
LE COMMANDEUR.
Moi !... amoureux !... moi, qui pratique l’horreur de toutes les émotions joyeuses ou tristes !... mais l’amour, c’est le mélange des joies les plus vives et des désespoirs les plus violents, c’est-à-dire tout ce qui bouleverse les nerfs, tout ce qui brûle le sang, tout ce qui use la vie. L’amour ! c’est la jalousie qui dévore, qui rend fou... et qui tue... c’est le sombre désespoir qui torture, qui déchire... et qui tue.
LE DUC.
Allons donc, c’est aussi...
LE COMMANDEUR.
C’est aussi le bonheur le plus enivrant, n’est-ce pas ? ce sont les délirantes extases, les brûlantes félicités qui exaltent, qui transportent et qui tuent... Ça tue toujours, l’amour.
LE DUC.
Tu es fou !
LE COMMANDEUR.
Ah ! qu’on me trouve une façon nouvelle d’aimer, un amour sans peines et sans joies, sans rires et sans larmes, un bon petit amour, bien doux, bien calme, bien anodin, ce sera peut-être mon affaire, et peut-être y goûterai-je un peu ; mais jusque-là, votre serviteur de tout mon cœur, je laisse l’amour où je l’ai relégué, au rang des épidémies les plus funestes, parmi les affections chroniques, endémiques et malfaisantes.
LE DUC.
Tu es un très grand philosophe, cousin, permets-moi, cependant de te donner un tout petit conseil.
LE COMMANDEUR.
Parle !
LE DUC.
Méfie-toi du premier regard qu’une femme brune... ou blonde, belle... ou laide attachera sur toi.
LE COMMANDEUR.
Pourquoi ?
LE DUC.
Parce que, si elle le veut bien, tu en deviendras fou en un instant.
LE COMMANDEUR, riant.
Moi... ah ! ah ! ah !
LE DUC.
C’est comme je te le dis ; ce jour-là, interroge ton pouls, docteur, tu trouveras cent vingt pulsations par minute et ton cœur battra la général ?... Sur ce, au revoir, je vais tâcher de reconquérir ma femme.
LE COMMANDEUR.
Au revoir, cousin, au revoir !
Le duc sort.
Scène II
LE COMMANDEUR, puis JEANNE
LE COMMANDEUR.
Il est charmant, avec sa prédiction. Pauvre ami !... si je me mettais en tête de t’en faire une à mon tour... Elle serait plus infaillible que la tienne, et si j’en juge par les symptômes que j’ai remarqués, ce ne sera pas chose facile pour toi que de reconquérir le cœur de madame la duchesse... la luzerne a étouffé le blé.
JEANNE.
Ah ! je suis heureuse de vous trouver, mon cousin, c’est vous que je cherchais.
LE COMMANDEUR.
Moi, cousine ?
JEANNE.
Oui, j’ai bien des choses à vous dire ; d’abord, qu’un grand malheur menace notre maison.
LE COMMANDEUR.
Un malheur !... Oh ! comme ça se rencontre ! il faut justement que je retourne à Paris !
JEANNE.
Vous voulez partir ?
LE COMMANDEUR.
Oui...
JEANNE.
Est-ce ainsi que vous aimez les gens de votre famille ?
LE COMMANDEUR.
Mais sans doute, cousine, si je ne les aimais pas, l’aspect de leur chagrin me serait indifférent et je resterais volontiers... C’est parce qu’ils me sont chers que je n’ai pas la force de supporter la vue de leur douleur... et que je m’en vais...
JEANNE.
Ah !... ce n’est pas votre cœur qui parle ainsi...
LE COMMANDEUR.
Mais je vous assure, cousine...
JEANNE.
Taisez-vous !
LE COMMANDEUR.
Hein ?... comment... que je...
JEANNE.
Je ne veux pas que vous parliez de vous-même, comme vous le faites... vous êtes notre parent, notre ami, et je ne veux pas que sous prétexte d’une sensibilité nerveuse et ridicule, vous vous fassiez passer pour un méchant homme.
LE COMMANDEUR.
Permettez, chère petite cousine, permettez... je...
JEANNE.
Du tout, je ne permets pas, monsieur, je ne permets pas !
LE COMMANDEUR.
Ah !
JEANNE.
Savez-vous bien où vous conduiraient ces beaux raisonnements sur la fragilité de l’organisme, et ce parti pris d’éviter toutes les émotions... Eh bien, cela vous mènerait tout droit à devenir un égoïste, monsieur, un homme qui n’aime rien... qui n’est l’ami de personne... et que personne ne peut aimer.
LE COMMANDEUR, hésitant.
Mais... cousine... c’est précisément là-dessus... que je compte.
JEANNE.
Ah ! vous voulez...
Lui passant le bras sous le sien.
Vous voulez que personne ne vous aime !...
LE COMMANDEUR.
Oui...
JEANNE.
Pas même votre petite Jeanne que vous faisiez danser autrefois dans vos bras et que vous embrassiez si tendrement quand elle vous souriait ! Vous ne vous en souvenez donc plus, monsieur ?
LE COMMANDEUR.
Si fait, je m’en souviens ! je l’appelais ma belle petite Jeanneton.
JEANNE.
Votre bonne petite Jeanneton...
LE COMMANDEUR.
Du tout... belle petite Jeanneton... Elle l’était déjà presque autant... qu’aujourd’hui.
JEANNE, relevant la tête et le regardant.
Vous me trouvez donc jolie ?
LE COMMANDEUR.
Si je vous trouve jolie ?... jolie comme un am...
Se dégageant doucement.
Ah çà, qu’est-ce que j’ai donc, moi ?
JEANNE.
Eh bien, votre petite Jeanneton, on veut la marier.
LE COMMANDEUR.
Un beau mariage, un jeune homme charmant, millionnaire...
JEANNE.
Et qui en aime une autre.
LE COMMANDEUR, effrayé.
Une autre !... vous avez surpris ce secret !...
JEANNE.
Oui, il aime ma sœur Blanche.
LE COMMANDEUR, s’oubliant.
Elle aussi !...
JEANNE.
Comment !... elle aussi !
LE COMMANDEUR.
Non, pardon, je veux dire...
À part.
Mais il est donc amoureux de tout le monde, ce gaillard-là ?
JEANNE.
Ils se connaissent depuis longtemps ! Eh bien, me félicitez-vous encore ? un fiancé que je n’aime pas, qui adore ma sœur et qui en est aimé, ne voyez-vous pas qu’il y a là le malheur de trois personnes, et que, pour moi, il vaudrait mieux mourir que consentir à ce mariage ?
LE COMMANDEUR.
Mourir !... par exemple !... ne dites donc pas de ces choses-là... ma petite Jeanneton.
JEANNE, avec câlinerie.
Cela vous ferait donc de la peine, si je mourais !...
LE COMMANDEUR.
Dites un profond chagrin... Vous, si bonne, si charmante si... Tenez rien que cette pensée-là...
À part.
Allons, bon, est-ce que je vais m’émouvoir, à présent ?
JEANNE.
Ah ! vous voyez que vous êtes bon, très bon, monsieur. M. que vous méritez que l’on vous aime.
LE COMMANDEUR.
Non, non, non, je désire n’être aimé de personne.
JEANNE.
Et si je voulais vous aimer, moi ?... Ah !
LE COMMANDEUR.
Vous !
JEANNE.
Est-ce que vous pourriez m’en empêcher ?...
Avec douceur.
Est-ce que vous auriez seulement le courage de le vouloir ?... voyons... dites, dites...
LE COMMANDEUR.
Eh bien... je...
JEANNE, souriant.
Mais, osez donc le dire, monsieur.
LE COMMANDEUR.
Eh bien !... ma foi... Non, là, je ne le pourrais pas !...
JEANNE.
Ah !
LE COMMANDEUR, hors de lui.
Mais qu’est-ce que je sens donc là, moi ? Mais oui, voilà mon pouls qui s’agite, et mon cœur qui bat la générale... juste ce que disait le duc, il n’y a qu’un instant... ah !... mais ; ah ! mais... ah ! mais...
Il marche à grands pas.
C’est de l’émotion, une véritable émotion !...
JEANNE.
Comment, vous vous éloignez de moi...
LE COMMANDEUR, s’éloignant encore.
Non, non, au contraire... je...
JEANNE.
Mais si, vous vous éloignez !
LE COMMANDEUR.
Voyons, cousine, qu’est-ce que vous me voulez ? qu’est-ce que vous aviez à me demander ?
JEANNE.
Je veux que vous empêchiez mon mariage avec M. de Montmarcy.
LE COMMANDEUR.
Allons donc !
JEANNE.
Il n’y a que vous qui puissiez tenir tète à mon père, à là duchesse et à ma grand’mère !
LE COMMANDEUR.
Moi, miséricorde !
JEANNE.
Il n’y a que vous qui puissiez leur faire entendre raison, et leur prouver que M. Gaston doit être le mari de ma sœur et non pas le mien.
LE COMMANDEUR.
Mais songez donc, cousine, aux scènes de colère, d’emportement... je n’ai aucune habitude de ces choses-là, moi.
JEANNE.
Vous les affronterez, pour votre petite Jeanneton, qui le veut, monsieur.
LE COMMANDEUR.
Non.
JEANNE.
Qui le désire !
LE COMMANDEUR.
Non...
JEANNE, s’appuyant sur le bras du commandeur.
Qui vous en prie... !
LE COMMANDEUR.
Non... oui là, oui... allons bon ! j’ai cédé !
JEANNE.
Voici ma grand’mère, je vous laisse avec elle, commencez, je me sauve... Au revoir, cousin... je compte sur vous... au revoir...
Elle sort.
LE COMMANDEUR.
La douairière !... Jeanne !... Jeanne !... belle commission qu’elle me donne là... elle était si charmante que je n’ai pas pu refuser... Ma foi, c’est décidé, je vais tenir tête à la marquise !
Scène III
LE COMMANDEUR, LA DOUAIRIÈRE, GERMAINE
LA DOUAIRIÈRE.
Je suis aise de vous voir, commandeur, je vous cherchais.
LE COMMANDEUR, à part.
Elle aussi ? il paraît que-je suis très recherché, aujourd’hui.
Haut.
Madame la marquise...
LA DOUAIRIÈRE.
J’ai besoin de vos bons offices auprès du duc et de la duchesse.
LE COMMANDEUR.
De quoi s’agit-il, je vous en prie ?
LA DOUAIRIÈRE.
Du mariage de Jeanne.
LE COMMANDEUR.
De son mariage... j’ai justement à vous dire à ce sujet...
LA DOUAIRIÈRE.
Tout à l’heure, laissez-moi achever.
LE COMMANDEUR, à part.
Soit ! mais j’y reviendrai !
LA DOUAIRIÈRE.
Ce mariage, c’est la fortune, c’est le bonheur de Jeanne.
LE COMMANDEUR.
Sa fortune, oui ; mais quant à son bonheur...
LA DOUAIRIÈRE, d’un air impérieux.
C’est le bonheur de Jeanne.
LE COMMANDEUR, s’inclinant.
C’est son bonheur, madame la marquise.
LA DOUAIRIÈRE.
Très bien.
LE COMMANDEUR.
Quoiqu’il ne soit pas tout à fait certain que les jeunes gens soient fort épris l’un de l’autre.
LA DOUAIRIÈRE.
Quand l’amour ne vient pas avant le mariage, il vient après !
LE COMMANDEUR.
À moins qu’il ne vienne pas du tout.
LA DOUAIRIÈRE, fièrement.
Il viendra, monsieur.
LE COMMANDEUR.
Du moment que madame la marquise l’ordonne... il viendra... certainement.
LA DOUAIRIÈRE.
Le jeune homme apporte une grande fortune, ma petite fille lui transmet, en échange, le titre de duc et pair ; c’est lui qui sera son obligé, mais je veux que ce mariage s’accomplisse sans retard. Dites cela de ma part au duc et à la duchesse.
LE COMMANDEUR, à part.
Diable, mais ce n’est pas tout à fait ce que j’ai promis de faire.
LA DOUAIRIÈRE.
Dites leur que j’ai porté bravement jusqu’ici la responsabilité du bonheur de ma petite-fille, mais que je suis bien vieille et que je n’ai pas le temps d’attendre. Allez, mon neveu ; je puis compter sur vous ?
LE COMMANDEUR.
Sur... sur moi ?...
LA DOUAIRIÈRE.
Je m’en rapporte à vous.
LE COMMANDEUR.
C’est convenu, madame la marquise ; vous ne sauriez croire avec quelle exactitude j’accomplis toujours les commissions dont on me charge !
Il s’incline et s’éloigne.
LA DOUAIRIÈRE.
Allez !
Le rappelant.
À propos, vous aviez quelque chose à me dire ?
LE COMMANDEUR.
Oh ! cela n’en vaut plus la peine, madame la marquise, nous ne serions peut-être pas entièrement d’accord...
LA DOUAIRIÈRE.
Allez donc, mon neveu !
LE COMMANDEUR.
J’y vais, madame la marquise !
À part.
Ma cousine Jeanne sera*bien contente de moi.
Il sort.
Scène IV
LA DOUAIRIÈRE, GERMAINE, puis BIASSOU
GERMAINE.
Tenez, parrain, v’là ma’me la marquise.
LA DOUAIRIÈRE, s’asseyant.
Vous avez quelque chose à m’apprendre, Biassou.
BIASSOU.
M’est avis que quand on est en repos avec Dieu et avec sa conscience, il suffit de réciter sa prière l’ malin, mais qu’il faut être en méfiance d’ ceux-là qui restant des heures entières à l’église quand il n’y a plus personne dedans.
LA DOUAIRIÈRE.
Ce qui signifie... ?
BIASSOU.
Que la duchesse n’est point encore sortie de la chapelle et y a plus de trois heures qu’elle y est entrée.
GERMAINE.
Et ça ne serait pas encore assez si c’était pour demander pardon à Dieu d’avoir pris la place de notre défunte.
BIASSOU.
Je disons encore que la nuit, ceux qui n’ont rien à se reprocher se reposent, tandis que ceux qui demeurent éveillés, méditent de mauvaises choses, et que la lumière ne s’est éteinte qu’au grand jour dans la chambre de madame la duchesse et qu’on la voyait à travers le rideau, qui n’ cessait point d’ griffonner.
LA DOUAIRIÈRE.
Oui, ses confessions qu’elle écrit... Je paierais un bon prix pour les voir.
BIASSOU.
Ça peut se faire pour rien !
GERMAINE.
Comment ça, parrain ?
BIASSOU, bas à Germaine.
Sa chambre donne sur le jardin et les fenêtres restant ouvertes des soirées entières... faudra voir, Germaine, faudra voir !
LA DOUAIRIÈRE, se levant.
Que m’importe, après tout, ce qu’elle pense cette femme ! Le sort de Jeanne sera bientôt assuré ; les choses sont trop avancées, pour qu’il soit au pouvoir de personne de les faire reculer.
BIASSOU.
Alors pourquoi qu’ils n’annoncent point à tous ceux du pays et des alentours, qui ont accouru à c’te fête, que not’ demoiselle va épouser le jeune voisin ?
GERMAINE.
C’est vrai ça, le pays tout entier le saurait, et il n’y aurait plus moyen de s’en dédire.
LA DOUAIRIÈRE.
L’idée est peut-être bonne.
GERMAINE.
V’là madame la duchesse.
LA DOUAIRIÈRE.
C’est bien...
Scène V
LA DOUAIRIÈRE, GERMAINE, BIASSOU, LA DUCHESSE, qui entre et salue la douairière
LA DOUAIRIÈRE.
Savez-vous où je me rends de ce pas, madame ?
LA DUCHESSE, étonnée.
Où... vous vous rendez ?...
LA DOUAIRIÈRE.
Je vais demander pour vous les bénédictions de tous ces braves gens qui sont là-bas.
LA DUCHESSE.
Pour moi ?
LA DOUAIRIÈRE, avec douceur.
Oui, madame, pour vous, qui n’avez soulevé aucune objection lorsqu’il s’est agi de doter mon enfant du titre de la famille ; enfin, madame la duchesse, je vais annoncer publiquement le prochain mariage de Jeanne et de M. de Montmarcy.
LA DUCHESSE, vivement.
Leur mariage !... vous allez publier...
LA DOUAIRIÈRE, froidement.
La volonté du roi, et la nôtre ! Au revoir, madame.
La duchesse atterrée s’incline, la douairière sort suivie de Biassou et de Germaine.
BIASSOU, bas à Germaine.
As-tu vu sa pâleur ?
GERMAINE.
Oui, faut encore veiller sur l’enfant.
BIASSOU.
On veillera.
Ils sortent.
Scène VI
LA DUCHESSE, seule
Elle va annoncer publiquement cette union... Que va-t-il se passer quand ils sauront que ce brillant mariage, il le refuse, lui !... Et s’ils apprenaient la raison pour laquelle il sacrifie une grande position et son bonheur peut-être !... qu’arriverait-il, mon Dieu !... Ah ! pourquoi l’ai-je rencontré sur mon chemin ?... Que faire maintenant ? que devenir ?... Ma bouche prie, m’es yeux se lèvent vers le ciel et mon âme est ailleurs !... Lutter, lutter toujours !... Oui... mais la lutte demande un courage à toute épreuve ou bien un appui... et je suis seule... isolée !... et quand mon cœur déborde, je n’ai pour confidentes que ces pages écrites dans mes veilles sans fin !...je n’ose me confesser qu’a moi-même.
Entrée du duc.
Mon mari !...
Scène VII
LE DUC, LA DUCHESSE
LA DUCHESSE, après un léger trouble.
Ah ! vous voilà de retour, monsieur le duc. Il m’a semblé avoir vu ce matin, devant le perron, vos chevaux et votre piqueur.
LE DUC.
Oui, j’ai visité le parc à votre intention.
LA DUCHESSE, froidement.
À mon intention ?
LE DUC.
Le parc et le château sont dans un état déplorable d’abandon et de tristesse. Nous allons changer tout cela. Bientôt vous verrez arriver de Paris une armée d’ouvriers, d’artistes, qui, sous la conduite d’un architecte habile, se mettront immédiatement à l’œuvre, car je veux que tout ce qui vous entoure, respire la joie et le bonheur.
LA DUCHESSE, avec étonnement.
Comment ?... Ah ! pardon, j’oubliais que vous vous fixez ici.
LE DUC.
Vous vous trompez, madame, c’est pour vous seule, que je veux opérer cette transformation.
LA DUCHESSE.
Pour moi, à quoi bon tant de peines, monsieur... dans quel but ?
LE DUC.
Dans quel but ? je vais vous le dire franchement. Je n’ai perdu le souvenir d’aucun de mes torts, d’aucune de mes fautes ; mais le droit de grâce est au-dessus du droit de justice, et c’est à votre cœur que je m’adresse, c’est de lui, qu’à force de soins, de prévenances, de sacrifices même, je voudrais obtenir l’oubli du passé.
LA DUCHESSE.
Monsieur le duc, le pardon dépend de notre volonté, Dieu seul donne l’oubli ; je vous pardonne, c’est tout ce que je puis faire.
LE DUC.
Oh ! ne prononcez pas sans appel, nous ne sommes pas encore au déclin de la vie ; pourquoi dirions-nous au bonheur un éternel adieu ? Comprenez-moi bien, Henriette, ce que je vous demande, ce n’est pas la tendresse des premières années ; je l’ai dédaignée et j’en suis puni, c’est justice ; mais au-dessus de l’affection conjugale, il est un autre amour plus sacré, plus divin, c’est l’amour paternel... Oh ! laissez-le moi, celui-là, et souffrez que nos cœurs trop longtemps séparés se rapprochent et s’unissent dans cette pure et sainte affection... Oh ! vous verrez, Henriette, j’aimerai si bien noire enfant, qu’un jour, vous pardonnerez au père les fautes de l’époux.
LA DUCHESSE.
Vous me demandez de jeter un voile sur le passé, monsieur, et vous me parlez de bonheur avenir... vous en parlez comme si je n’avais eu que quelques jours de tristesse et de larmes ; niais il-y a quinze ans que je souffre !... quinze ans... pendant lesquels mes mains suppliantes se sont vainement tendues vers vous. Je l’ai souvent invoquée cette sainte bénédiction reçue aux pieds de l’autel, je l’ai vainement imploré ce retour vers nos premières années ! Nulle voix ne répondait à la mienne, nulle compassion à mes larmes ; j’étais abandonnée, seule, toujours seule en face de ce spectre vivant, la mère de votre première femme, cette ennemie mortelle, dont le regard haineux, implacable, me redisait sans cesse : « Étrangère, tu as volé la place de celle qui n’est plus, et ton enfant dépouille l’enfant de la morte ! » Il y a eu bien des jours où le courage m’abandonnait ; je vous appelais à mon aide, et vous ne veniez pas ; je voulais puiser de la force dans les caresses de ma fille, et vous me l’aviez enlevée ! Aujourd’hui, vous voilà de retour, mais le secours vient trop tard ; vous me rendez ma fille, mais mon cœur s’est desséché dans l’abandon, mes yeux ont tant pleuré qu’ils la reconnaissent à peine.
LE DUC.
Henriette, vos paroles n’ajouteront rien aux reproches que je m’adresse : oui, j’ai délaissé le foyer conjugal et à mon retour, je ne dois pas m’étonner de le voir désert ; oui, j’ai été bien coupable, et vous me voyez repentant, soumis d’avance à toutes les épreuves de l’expiation. Mais, permettez-moi d’espérer que je ne suis pas condamné sans retour.
LA DUCHESSE.
J’avais seize ans quand vous m’avez épousée, monsieur ; puis-je espérer moi-même de les revoir un jour ?
LE DUC, avec douleur.
Madame !
Voyant entrer Blanche et parlant bas à la duchesse.
Tenez, Henriette, les voilà vos seize ans. Dieu vous les rend en elle c’est en leurs enfants que les mères renaissent et se sentent revivre.
Scène VIII
LE DUC, LA DUCHESSE, BLANCHE
BLANCHE.
Ma mère...
LE DUC.
Viens, Blanche.
Montrant la duchesse.
Aime-la bien, ma fille, son cœur a trop longtemps souffert de notre absence à tous deux ; efforce-toi de lui rendre tout ce qu’elle a perdu... efforce-toi surtout de lui donner l’oubli...
À part.
Toujours froide, toujours impassible !... Ah ! plus rien pour le père, plus rien pour l’enfant.
Il sort, Blanche le regarde s’éloigner avec étonnement. La duchesse qui s’est tenue immobile, tombe accablée dans un fauteuil.
Scène IX
LA DUCHESSE, BLANCHE
BLANCHE, à genoux auprès de sa mère et lui baisant les mains en pleurant.
Ma mère, tu es malheureuse...
LA DUCHESSE.
Moi ?... non... Qui le fait penser cela, Blanche ?
BLANCHE.
Oh ! ne cherche pas à retenir tes larmes devant moi... À qui donc confierai-je mes chagrins si je ne suis plus qu’une étrangère pour toi ?
LA DUCHESSE.
Tes chagrins !...
La regardant en face.
Oui, tu souffres... tu as pleuré, beaucoup pleuré !... Voyons, ma fille, parle-moi, dis-moi ce que tu as.
BLANCHE.
Je n’ose pas, manière...
LA DUCHESSE.
À moi !... allons donc !... il faut tout me dire. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, entends-tu... Il ne me manquerait plus que cela ! elle... elle aussi ! ma fille, ma fille bien-aimée ! Ah ! oui, je sens combien je l’aime à présent que je la vois souffrir ! Et je doutais de mon affection pour elle !... je disais que mes yeux la reconnaîtraient à peine ! J’étais folle ! Ce n’est pas avec ses yeux, c’est avec son cœur qu’une mère reconnaît son enfant.
BLANCHE.
Oh ! que tu es bonne !
Elle l’embrasse.
Ah ! si tu savais... si j’osais te dire...
Elle se cache la tête dans son sein.
LA DUCHESSE, lui relevant la tête et la regardant.
Blanche !... Blanche ! tu aimes quelqu’un...
BLANCHE, honteuse à mi-voix.
Oui.
LA DUCHESSE.
Et tu as peur de m’avouer... pauvre enfant !... attends, ma fille...
Elle lui met la tête sur son cœur.
Viens là, tu oseras parler maintenant, n’est-ce pas ?
BLANCHE.
Je crois que oui, maman.
LA DUCHESSE.
D’ailleurs... je vais t’aider : tu avais une amie au couvent, n’est-ce pas ?
BLANCHE.
Oui.
LA DUCHESSE.
Cette amie avait un parent, un cousin... un frère...
BLANCHE.
Un frère ! oui. Ah ! c’est étonnant comme tu devines.
LA DUCHESSE.
Il venait souvent la voir ?
BLANCHE.
Très souvent.
LA DUCHESSE.
Et tu accompagnais fréquemment ton amie au parloir ?
BLANCHE.
Toutes les fois.
LA DUCHESSE.
C’est un jeune homme, aimable, joli garçon...
BLANCHE.
Charmant !... Mais comme tu devines, maman !
LA DUCHESSE.
Et tu crois qu’il t’aime ?
BLANCHE.
J’en suis sûre.
LA DUCHESSE.
Est-il de bonne maison ? Comment se nomme-t-il ?
BLANCHE.
Tu le connais.
LA DUCHESSE.
Tant mieux !... dis-moi son nom ?
BLANCHE.
Il est ici...
LA DUCHESSE.
Ici ?
BLANCHE.
Oui, c’est M. Gaston de Montmarcy.
LA DUCHESSE, hors d’elle-même.
M. de Montmarcy !...
BLANCHE.
Lui-même !
LA DUCHESSE.
M. Gaston de Montmarcy !... C’est impossible !... tu rêves ! tu es insensée !... Blanche ! je t’en supplie, dis-moi la vérité !...
BLANCHE, tremblante.
Mais je vous la dis tout entière.
LA DUCHESSE.
C’est impossible, te dis-je ! Gaston ne peut pas t’aimer, il ne t’aime pas, il ne t’aimera jamais.
BLANCHE.
Et moi, je vous jure, maman, que je suis certaine du contraire.
LA DUCHESSE.
Tu en es sure !... il te l’a dit ?
BLANCHE.
Oui !
LA DUCHESSE.
Alors, c’est autrefois, il y a longtemps, puisqu’il y a trois mois qu’il a quitté Paris, puisque depuis trois mois il n’a pas bougé de ce pays.
BLANCHE.
C’est vrai, il y a trois mois.
LA DUCHESSE,
Ah ! pauvre enfant !... il lui disait cela... Et, depuis, ton image, s’est effacée de sa mémoire, ton souvenir a disparu de son cœur.
BLANCHE.
Oh ! vous le jugez mal, Gaston est un honnête homme ; depuis trois mois il n’a pas cessé d’écrire un seul jour à sa sœur, et c’est de moi que parlaient toutes ses lettres.
LA DUCHESSE.
Comment... lorsqu’il était ici, près de moi...
BLANCHE,
Oh ! ne l’accusez pas, je suis seule coupable. Je lui avais conseillé de s’établir d’abord chez lui... dans votre voisinage.
LA DUCHESSE, altérée.
Ah ! c’est foi, qui... lui as...
BLANCHE.
Vous le savez... il n’est pas de grande noblesse... il n’osait pas prétendre à une alliance avec nous... et un jour... je lui ai dit : « Rassurez-vous... Dieu m’a donné pour mère, un ange de tendresse... Elle ne recherchera qu’une seule condition dans mon mariage, c’est le bonheur de son enfant ; faites-vous connaître d’elle, gagnez son affection, son estime, et elle nous protégera !... »
LA DUCHESSE, à part.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
BLANCHE, continuant.
« Et quand elle aura appris que mon bonheur dépend de notre union, pour l’assurer, il n’est pas d’efforts, il n’est pas de sacrifices dont elle ne soit capable ! Oh ! il n’y a pas au monde deux mères comme la mienne !... vous le verrez !... »
LA DUCHESSE, à part.
Chacune de ses paroles me brûle, me rend folle.
BLANCHE, continuant.
« Vous serez, lui ai-je dit, frappé du charme de son esprit, mais c’est le jour où vous pourrez connaître son cœur, que vous vous trouverez en face d’une sainte !... Toutefois, faites bien attention ! D’autres ne cachent pas avec autant de soin leurs défauts, que ma mère ne dissimule ses qualités. Il n’y a que moi qui la connaisse, aussi faut-il voir combien je l’aime !... »
LA DUCHESSE.
Oh ! tais-toi, Blanche ! par pitié, tais-toi...
Elle s’affaisse sur un banc, Blanche se met à genoux devant elle et continue.
BLANCHE.
Et il m’a avoué depuis que j’avais raison. Il m’a même reproché de ne pas lui en avoir dit assez. Tiens, maman, je te ferai voir la lettre qu’il m’a écrite après qu’il a eu le bonheur de te sauver la vie. C’est la plus belle de toutes. Et tu veux que je ne l’aime pas, lui, qui m’a sauvé ma mère !... allons donc !... mais je l’adore !...
LA DUCHESSE, atterrée.
Ainsi lorsqu’il venait habiter près d’ici ?...
BLANCHE.
C’était pour se rapprocher de ma mère...
LA DUCHESSE.
Les soins, les attentions, dont il m’entourait ?
BLANCHE.
C’était pour plaire à ma mère.
LA DUCHESSE.
Et lorsqu’il se montrait joyeux d’une blessure reçue en me sauvant... c’était... parce qu’il me savait ta mère.
BLANCHE.
Oui !
LA DUCHESSE, à part.
Oh ! malheureuse folle que j’étais ! malheureuse ! malheureuse !
Elle sanglote et se cache la figure dans ses mains.
BLANCHE.
Tu pleures !... je suis donc bien coupable, maman ?
LA DUCHESSE.
Toi, pauvre enfant...
Se relevant.
C’est fini, ce n’est plus rien... c’est fini, Blanche.
BLANCHE.
Maman !
LA DUCHESSE.
Attends... embrasse-moi... embrasse-moi... Bien... À présent je suis forte... à présent !... je suis mère... Tu l’aimes réellement, n’est-ce pas ?
BLANCHE.
Oui, maman.
LA DUCHESSE.
Et si l’on vous séparait ?
BLANCHE.
J’en mourrais...
LA DUCHESSE.
Oui, pauvre enfant, tu serais sans force contre la lutte, le désespoir te tuerait ! Et je ne te sauverais pas...
BLANCHE.
Ma bonne mère !...
LA DUCHESSE.
Bonne !... qu’en sais-tu ?... Est-ce parce qu’autrefois je me réjouissais de tous les bonheurs que me donnait ton enfance ? Est-ce parce que mon cœur s’ouvrait toutes les fois que tu m’appelais de tes petites mains, de ton sourire et de tes caresses ?... Mais je n’ai encore rien fait pour toi... je ne t’ai encore rien donné en échange de tout ce que j’ai reçu de ta tendresse ! C’est maintenant qu’il faut être bonne mère ! Je le serai ! oui, je ferai bravement mon devoir, et je me sens fière, je me sens immense du cette volonté d’assurer ton bonheur, il me semble qu’un voile qui couvrait mes yeux se déchire, que je lis mieux dans mon cœur ! Oui, je pressentais que Dieu les destinait l’un à l’autre ! C’est un fils que j’aimais en Gaston, et c’est toi qui me réconcilies avec moi-même, c’est par toi que je relève la tête et que je me dis heureuse... Blanche, embrasse-moi encore, ma fille !...
Blanche dans les bras de la duchesse ; au fond apparaissent le duc et le commandeur.
Scène X
LA DUCHESSE, BLANCHE, LE DUC, LE COMMANDEUR
LE DUC, qui observe l’attitude de sa femme et de sa fille ; à part, au commandeur.
L’enfant est plus heureuse que le père !
LE COMMANDEUR.
Allons, du courage, et surtout, pas d’attendrissement.
LE DUC.
Je viens vous faire mes adieux, madame.
BLANCHE.
Vos adieux ?...
LA DUCHESSE.
Vous ne partirez pas, monsieur le duc.
BLANCHE.
À la bonne heure.
LE DUC.
Comment ?
LA DUCHESSE.
Vous ne partirez pas, car c’est moi, maintenant, qui vous demande l’oubli du passé ?
LE DUC, bas.
Ah ! c’est elle qui a gagné ma cause.
Haut.
Blanche, tu es la bonne fée de la maison.
BLANCHE.
Moi ?...
LA DUCHESSE.
Vous ne vous trompez pas, monsieur le duc, nous lui devons beaucoup l’un et l’autre et c’est pour cela que vous ne me refuserez pas d’assurer son bonheur.
LE DUC.
Son bonheur !... Parlez, et tout ce qui dépendra de moi, sur ma foi de gentilhomme, je suis prêt à le faire !
LA DUCHESSE.
Eh bien, monsieur le duc !...
BLANCHE, bas, voyant entrer la douairière avec Jeanne.
La marquise, maman.
Scène XI
LA DUCHESSE, BLANCHE, LE DUC, LE COMMANDEUR, LA DOUAIRIÈRE, JEANNE
LA DUCHESSE.
Qu’elle soit la bienvenue, c’est une grave explication que je désire, et il convient qu’elle ait lieu en présence de madame la marquise.
LA DOUAIRIÈRE.
Une... explication ?
LE COMMANDEUR.
Une... grave explication... oh ! cela sent l’orage ici !...
JEANNE, bas.
Vous allez nous aider.
LE COMMANDEUR, bas.
Je m’y préparais justement.
LE DUC.
Maintenant, madame la duchesse, veuillez nous dire...
LA DOUAIRIÈRE.
Oui ! de quoi s’agit-il ?
LA DUCHESSE.
Vous allez le savoir. – Commandeur ?
LE COMMANDEUR.
Madame la duchesse !
LA DUCHESSE.
Faites appeler, je vous prie, M. de Montmarcy.
LE COMMANDEUR.
J’y vole, madame, ouf !... j’en réchappe.
JEANNE, bas.
Et revenez.
LE COMMANDEUR.
Mais...
JEANNE, bas.
Revenez vite, je le veux, monsieur.
LE COMMANDEUR.
C’était mon intention !
Il sort.
LA DOUAIRIÈRE.
Enfin, madame ?...
LA DUCHESSE.
M’y voici, madame la marquise ; un mariage a été projeté entre Jeanne et M. de Montmarcy.
LA DOUAIRIÈRE.
Dites : ordonné par le roi lui-même.
LA DUCHESSE.
Jeanne n’aime pas M. de Montmarcy.
LA DOUAIRIÈRE.
En vérité ?...
LA DUCHESSE.
Est-ce vrai, Jeanne ?
JEANNE.
Oh ! c’est bien vrai, madame.
LA DOUAIRIÈRE.
Passons !
LA DUCHESSE.
Quelle que soit la grâce, la beauté de Jeanne, M. de Montmarcy ne l’aime pas.
LA DOUAIRIÈRE.
Les mariages d’amour sont-ils les plus fortunés ? Nous en connaissons vous et moi, madame, qui sont peu faits pour en inspirer le goût. N’est-ce pas votre avis, M. le duc ? Et que prononcez-vous ?
LE DUC.
Pour me prononcer, madame, j’attends d’être mieux informé que je le suis.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah !
LA DUCHESSE.
Songez-y, madame, cette union ferait le malheur de Jeanne.
LA DOUAIRIÈRE, avec hauteur.
Qui vous rend, je vous prie, si soucieuse du bonheur de ma petite-fille ?
LA DUCHESSE, relevant la tête.
Eh bien !... c’est que... Lui !...
Scène XII
LA DUCHESSE, BLANCHE, LE DUC, LA DOUAIRIÈRE, JEANNE, LE COMMANDEUR, GASTON, puis BIASSOU et GERMAINE
LE COMMANDEUR.
Je vous amène M. Gaston.
GASTON, s’inclinant.
Madame la duchesse a daigné me faire appeler ?
LA DOUAIRIÈRE.
Eh bien, madame, vous disiez...
LA DUCHESSE.
Je disais que le mariage de Jeanne avec M. Gaston de Montmarcy... est impossible.
TOUS.
Impossible !
JEANNE.
Très bien !
LA DOUAIRIÈRE.
Ce n’est pas uniquement, je suppose, parce qu’ils ne s’aiment pas encore ?
LA DUCHESSE, émue.
C’est surtout, parce que M. de Montmarcy... en aime une autre... et qu’il en est aimé.
LA DOUAIRIÈRE, avec ironie.
Et cette autre, madame, pourriez-vous la nommer ? C’est...
LA DUCHESSE.
C’est ma fille, madame.
LE DUC.
Blanche !
LE COMMANDEUR, bas.
J’allais te l’apprendre !...
LA DUCHESSE.
Répondez, M. de Montmarcy... Est-il vrai que ce soit elle... que vous aimiez ?...
GASTON.
Cela est vrai, madame, et je puis sans hésiter le déclarer ici, puisque je sais que mademoiselle Jeanne regarderait comme un malheur un mariage entre elle et moi.
JEANNE.
Un grand malheur, monsieur.
LA DOUAIRIÈRE.
Silence !
Biassou paraît avec Germaine derrière un bosquet.
GERMAINE.
Que se passe-t-il donc ici ?
LA DOUAIRIÈRE.
Ah ! je vois, je comprends enfin le but de cette précieuse sollicitude pour le bonheur de ma petite-fille. M. le duc, il s’agit de ruiner votre fille aînée au profit de la plus jeune.
LE DUC.
Que dites-vous, madame ?
LA DUCHESSE.
Oh ! madame !
LA DOUAIRIÈRE.
M. de Montmarcy, pour que vous entriez dans la famille de M. le duc, votre père n’exigera-t-il pas qu’en échange de l’immense fortune qu’il vous donne, votre femme vous apporte en dot ce duché-pairie que le roi permet de transmettre.
GASTON.
Je crois, hélas ! madame, que mon père l’exigera.
LA DOUAIRIÈRE, au duc.
Eh bien, monsieur, n’est-ce pas la ruine de Jeanne que l’on médite, de cette enfant qui n’a plus sa mère pour la défendre ?
LE DUC.
Madame, chacune de vos paroles est une injure pour moi, comme, pour la duchesse. Si vous méconnaissez son désintéressément et la noblesse de son âme, est-ce que je ne suis pas là, moi ? Est-ce que je n’ai pas le même cœur pour chacune de mes filles ?
LA DOUAIRIÈRE.
Et que décidez-vous enfin, monsieur ?
LE DUC.
Le roi veut qu’un riche mariage relève notre maison, et permet que dans ce but, l’une de mes filles transmette à son mari, le titre qui devait s’éteindre avec moi. Eh bien, périsse l’éclat de cette maison, s’il faut le payer du bonheur de mes enfants.
LA DOUAIRIÈRE, avec colère.
M. le duc !
LE DUC.
Ah ! vous ne me demandez pas, vous, de sacrifier l’une à l’autre ; votre implacable orgueil veut les sacrifier toutes les deux, et je ne le permettrai pas.
LA DOUAIRIÈRE, même jeu.
M. le duc !
LE DUC.
Je ne le permettrai pas, madame. Ma fille, au nom de celle qui n’est plus, c’est la vérité que je te demande, Jeanne, est-ce sans arrière-pensée, que tu refuses ce mariage ?
JEANNE.
Sans arrière-pensée, oui, mon père.
LE DUC.
Est-ce sans regret que tu renonces à ce titre que devait porter ton mari ?
JEANNE.
Qu’est-ce qu’un titre au prix du malheur de Blanche ! Ce malheur nous tuerait l’une et l’autre.
LE DUC.
C’est bien, je puis prononcer maintenant,
LA DUCHESSE.
Parlez, monsieur, parlez !
LA DOUAIRIÈRE, avec colère.
Prenez garde à ce que vous allez dire !
LE DUC.
Demain, monsieur de Montmarcy, vous irez solliciter de Sa Majesté, son agrément a votre mariage avec ma fille Blanche.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah !
BLANCHE.
Mon père !...
LA DOUAIRIÈRE, hors d’elle-même.
Son... son mariage... Ainsi... elle... ma fille... ruinée, dépouillée... et j’ai vécu jusqu’à ce jour... pour être témoin de... non... non... je... je...
Tombant dans un fauteuil.
Ah ! je meurs ! je meurs !
LE DUC.
Vite, du secours, du secours !
BIASSOU.
Est-ce qu’ils nous l’auront tuée ?...
JEANNE.
Grand’mère...
LA DUCHESSE, s’élançant vers elle.
Madame...
LE COMMANDEUR.
Laissez... elle respire mieux... elle revient à elle.
BLANCHE.
Oui, elle rouvre les yeux !
La douairière les regarde avec égarement. Blanche s’agenouille devant elle.
Oh ! madame... madame... c’est moi qui suis cause... Au nom du ciel, pardonnez-moi !
JEANNE.
Pardonnez-nous, grand’mère, dites que vous nous pardonnez ?
BLANCHE.
Ou du moins, tendez-nous votre main, en signe de pardon !
LA DOUAIRIÈRE.
Ma... main... à vous...
Elle secoue la tête.
JEANNE, suppliant.
Grand’mère !
LA DOUAIRIÈRE.
Je ne peux pas...
D’une voix brisée.
Je ne peux pas.
TOUS.
Comment ?
LA DUCHESSE.
Que dit-elle ?
LE COMMANDEUR, lui prenant une main qu’il laisse retomber.
Madame la marquise ?...
LE DUC.
Eh bien ?
LE COMMANDEUR, bas.
Le corps paralysé...
LE DUC.
Est-elle donc condamnée ?
LE COMMANDEUR.
À la mort, non... à l’immobilité, oui.
GERMAINE.
Y a plus que nous pour défendre l’orpheline...
BIASSOU.
N’importe !... ce mariage-là ne se fera point.
ACTE III
Premier Tableau
Une vaste chambre, meublée dans un goût antique. Au fond, une grande porte vitrée donnant sur le parc. À droite, un lit à colonnes torses et à grands rideaux. Sur le devant de la scène, à gauche, une table chargée de papiers et de fioles. La douairière, immobile, assise dans un grand fauteuil. Germaine debout, appuyée sur le dos du fauteuil. Au moment où le rideau vient de se lever, on voit Biassou qui entre par une petite porte pratiquée au fond à gauche.
Scène première
LA DOUAIRIÈRE, GERMAINE, BIASSOU
GERMAINE.
Que nous apportez-vous là, parrain ?
BIASSOU.
Ça vient du plus haut d’la montagne ; les plantes que je cherchais ne se trouvent point partout.
GERMAINE.
Et vous êtes certain de leur effet, parrain ?
BIASSOU.
J’ vas te dire, chacune séparément n’a point de pouvoir ; mais quand elles sont réunies ensemble, c’est bien autre chose. Faut les arranger par petites touffes et les suspendre au pied du lit. Tant plus la personne est malade, tant plus que les plantes sèchent vite ; elles attirent à elles tout le mal et elles en meurent, tandis que le malade renaît, refleurit, et revient à la santé.
GERMAINE.
Ah ! si vous rendez à madame la marquise l’usage de ses bras et de ses jambes, tout le monde vous devra une fière récompense, parrain.
BIASSOU.
Je n’en voulons de personne ; le bien de not’ maîtresse, c’est tout ce que je souhaitons. Pour les autres, pour le duc et les tiens, je n’ons que de la haine dans le cœur.
LA DOUAIRIÈRE.
Biassou !...
BIASSOU.
Et une forte haine encore. L’ bon Dieu m’est témoin que je ne ferions point de peine à un vermisseau, ma’me la marquise ; mais à ceux qu’ont dépouillé not’ demoiselle, je leur z’y envoie une triple malédiction de dessus la tête ! oui !... malédiction sur lui et sur l’étrangère, malédiction implacable sur leur enfant... et que la volonté du ciel soit faite.
LA DOUAIRIÈRE.
Ne nous chargeons pas de faire leur procès aux méchants. Le ciel s’en occupera mieux que nous.
GERMAINE.
Tout mal porte son fruit. Leur fille n’est déjà plus fraîche et rose comme autrefois.
BIASSOU, riant.
Eh ! eh ! c’est vrai ! je l’ons rencontrée dans la saulée, toute maladive et pâlotte. Elle n’est plus vaillante comme devant.
Bas.
Ça marche, ça marche.
GERMAINE, bas.
Est-ce que c’est déjà l’effet qui se produit, parrain ?
BIASSOU.
Ça se peut bien, ma fille.
LA DOUAIRIÈRE.
Qui sait... peut-être ces gens-là ne se croient-ils pas coupables ?
BIASSOU.
Excusez, ma’me la marquise, pour faire chanter leu chanson à not’ demoiselle, pour qu’elle ait consenti au renoncement de son bien, faut d’abord qu’ils y aient jeté un sort ; oui, ils y ont jeté un sort !
GERMAINE.
Oui, un sort ; mon parrain s’y connaît, lui.
LA DOUAIRIÈRE.
Folie que tous vos sortilèges ! On s’est adressé au cœur de Jeanne ! Elle n’a pas su refuser le sacrifice, et elle le subit vaillamment, ainsi qu’il convient à une fille de sa race... D’ailleurs, ce qui est fait est fait, n’en parlons plus.
BIASSOU.
Bien des pardons, ma’me la marquise, mais je ne sommes pas aussi endurants que vous, nous autres, et je rendons le mal pour le mal ; je voulons que ma’me la marquise puisse tenir bientôt le fil de leurs intrigues, et, avant demain, j’apporterons à ma’me la marquise ce grimoire que griffonne toutes les nuits la duchesse.
LA DOUAIRIÈRE.
Ses confessions !... C’est inutile, Biassou.
BIASSOU.
Oh ! que non pas.
LA DOUAIRIÈRE.
À quoi bon savoir ce que pense cette femme ? J’aime mieux oublier. Germaine, ouvre-moi ce livre !
Germaine dispose sur un pupitre un gros in-4° ancien.
GERMAINE.
Voilà, madame la marquise.
BIASSOU, bas à Germaine.
Oublier ! la voilà donc retournée, elle aussi !... On dirait qu’elle ne leurs en veut plus et qu’elle abandonne not’ demoiselle... Si celle-là n’a plus d’haine dans le cœur, sur qui donc compter, mon bon Dieu ?
GERMAINE, bas.
Depuis sa maladie, je n’ai pas entendu sortir de sa bouche une seule plainte.
BIASSOU, bas.
En ce cas, il ne faut plus s’en fier que sur nous-mêmes... et je n’y fais point grâce, moi, à la fille de l’étrangère. As-tu préparé ce que je t’ons demandé ?
GERMAINE.
Oui, et ça n’a pas été sans peine.
BIASSOU, bas.
Ce soir, tu m’apporteras ça chez moi.
GERMAINE.
C’est dit, parrain.
BIASSOU.
Eh ! eh ! tu les détestes bien, toi, pas vrai ?
GERMAINE.
De toute la force de mon âme, parrain.
BIASSOU.
Tu ne leurs-y pardonneras jamais ?
GERMAINE.
Jamais, parrain.
BIASSOU.
C’est bien, t’est-une bonne fille, embrasse-moi, m’ n’enfant.
Il la baise au front.
Scène II
LA DOUAIRIÈRE, GERMAINE, BIASSOU, LE COMMANDEUR
LE COMMANDEUR.
Madame la marquise veut-elle me recevoir ?
GERMAINE.
M. le commandeur.
BIASSOU.
L’meutrier de mon pauv’ Goliath.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah ! c’est vous, mon neveu ?
LE COMMMANDEUR.
Je viens m’informer de l’état de votre santé, ma chère tante.
LA DOUAIRIÈRE.
Est-ce en qualité de docteur ?
LE COMMANDEUR.
Mais... oui, chère tante.
LA DOUAIRIÈRE.
Alors, c’est peine perdue.
LE COMMANDEUR.
Que voulez-vous dire ?
LA DOUAIRIÈRE.
Vous savez bien que cette paralysie, qui lient cloués mes bras et mes jambes, gagnera bientôt le cœur, ou le cerveau, et que vous n’y pouvez rien.
LE COMMANDEUR.
Il y a quelque temps, je vous ai cru presque guérie !
LA DOUAIRIÈRE.
Moi !
LE COMMANDEUR.
Permettez, madame la marquise, il y a certains remèdes peu connus...
LA DOUAIRIÈRE.
Dos remèdes mystérieux... comme ceux de Biassou...
BIASSOU.
Pour ce qui est des miens, ma’me la marquise, je ne les troquerions point contre ceux de tous les médecins de la terre.
LE COMMANDEUR, riant.
Voyez-vous cela !
BIASSOU.
Mais que non, da... Quoique c’est que vous y commandez à ma’me la marquise ?... Un tas de fusions et de coquetions, que vous y faites boire, comme si que le mal était dans les estomacs !... Moi ! au contraire, c’est avec les simples du bon Dieu que je veux la guérir.
LE COMMANDEUR, riant.
Les simples du bon Dieu !... et les paroles sacramentelles, n’est-ce pas ?
BIASSOU.
Vous n’y croyez point, vous, aux simples du bon Dieu ?
LE COMMANDEUR.
Pas encore...
BIASSON.
Vous ne croyez point non plus aux paroles ?...
LE COMMANDEUR.
Sacramentelles ?... Pas davantage, mon pauvre Biassou.
BIASSOU.
Eli bien, sauf vot’ respect, monsieur le commandeur, si vous dites que ça ne peut pas guérir, c’est que vous n’avez point de religion.
LE COMMANDEUR.
En vérité !
BIASSOU.
Non, vous n’en avez point et je n’en voulons pour preuve que l’assassinat de mon pauv’ Goliath.
LE COMMANDEUR.
Ah ! c’était à toi...
BIASSOU.
Un pauvre innocent animal...
LE COMMANDEUR.
Qui voulait me dévorer.
BIASSOU.
Vous n’avez point eu pitié de lui, vous l’avez tué comme un...
LE COMMANDEUR.
Comme un chien, c’est vrai.
BIASSOU.
C’est une méchante action, monsieur le commandeur.
LA DOUAIRIÈRE.
Biassou !
LE COMMANDEUR.
Laissez, laissez ma tante, il m’amuse !
LA DOUAIRIÈRE.
Retirez-vous, Biassou, et toi aussi, Germaine.
GERMAINE.
On s’en va, madame la marquise.
BIASSOU.
On s’en va ; mais on verra bientôt ce que peut le père Biassou, tant pour le bien des uns que pour le mal des autres.
Biassou et Germaine vont pour sortir, ils s’arrêtent en voyant entrer Joanne et Blanche.
Scène III
LA DOUAIRIÈRE, GERMAINE, BIASSOU, LE COMMANDEUR, JEANNE, BLANCHE
LA DOUAIRIÈRE.
Qui vient là ?
JEANNE.
C’est nous, grand’mère.
LA DOUAIRIÈRE.
Jeanne ?
JEANNE.
Et ma sœur.
LA DOUAIRIÈRE.
Ta... ta sœur...
BLANCHE.
Je vous apporte des fleurs, madame la marquise.
LA DOUAIRIÈRE.
Des fleurs...
BIASSOU, bas.
Regarde voir comme elle est changée !
GERMAINE, bas.
C’est vrai.
LA DOUAIRIÈRE.
Vous les avez cueillies un peu trop tôt, mademoiselle.
BLANCHE.
Pourquoi donc, madame la marquise ?
LA DOUAIRIÈRE.
Encore quelques jours, et c’est sur une tombe qu’on les eût déposées.
JEANNE.
Que dites-vous ?
BLANCHE.
Sur... sur... une tombe !
Portant la main à son cœur.
Ah ! madame, vous ne savez pas le mai que vous me faites en parlant ainsi.
JEANNE.
Qu’as-tu donc, ma sœur ?
LE COMMANDEUR.
En effet, cette pâleur !... On dirait que vous vous soutenez avec peine.
JEANNE.
Blanche !
Elle la prend dans ses bras.
BIASSOU, bas en montrant Blanche.
Le doigt du destin l’a touchée, ça marche, ça marche !
Ils sortent.
LE COMMANDEUR.
Eh bien, cousine ?
BLANCHE.
Ce n’est rien ; pardonnez-moi de vous avoir inquiétés, mais depuis quelques jours, il se passe en moi une chose... que je ne puis définir... Mon âme est triste, abattue, comme si elle pressentait un grand malheur... Mon corps a parfois d’étranges tressaillements qui m’agitent, me bouleversent comme s’ils étaient les avant-coureurs d’une cruelle souffrance ; parfois aussi, le sang de mes veines se glace tout à coup et cesse de circuler ; mon cœur s’arrête, il ne bat plus ; un voile couvre mes yeux, la pensée m’abandonne, et pendant une seconde, je suis véritablement morte.
TOUS.
Morte !
LE COMMANDEUR.
C’est en effet bien étrange !
BLANCHE.
Oh ! ne parlez pas de cela devant ma mère, je le lui cache, avec soin comme je vous l’aurais caché à tous, si les paroles de madame la marquise, si l’image de ces fleurs déposées bientôt sur une tombe, n’avaient réveillé en moi ce lugubre pressentiment et ne m’avaient frappée de cette douloureuse commotion... que je sens encore-là, au cœur.
LA DOUAIRIÈRE.
Vous vous trompez, mon enfant, c’est de ma tombe et non de la vôtre que je parlais ; allez, ne craignez rien, vous êtes heureuse, vous êtes trop jeune pour la mort.
LE COMMANDEUR.
Certainement, grand’tante a raison. Vous avez dix-huit ans à peine ! D’ailleurs, j’ai un principe, moi, je soutiens qu’il n’y a que ceux qui le veulent bien qui meurent.
BLANCHE, souriant.
Rien que ceux qui le veulent,
LE COMMANDEUR.
Mais oui, seulement il arrive parfois que l’on est si malade, si malade, qu’on n’a plus la force de vouloir, et alors, ma foi...
JEANNE.
En voilà assez, je ne veux pas que l’on parle de ces vilaines choses. Quant à toi, Blanche, pour que tu n’aies plus de ces mauvaises pensées, je ne te quitte pas d’un instant, jusqu’au retour de ton fiancé. Lui de retour, je suis sûre que tu n’auras plus besoin de moi pour t’empêcher d’être triste.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah ! M. de Montmarcy est parti ?
JEANNE.
Oui ; mon père lui a remis des lettres...
LA DOUAIRIÈRE.
Je sais... je sais... il est allé supplier le roi de ratifier l’abandon que tu as fait de ton droit d’aînesse...
JEANNE, avec reproche.
Grand’mère !...
LA DOUAIRIÈRE.
A-t-on changé d’avis ? n’est-ce plus de cela qu’il s’agit ?
BLANCHE.
Pardonnez-moi, madame la marquise, c’est toujours le généreux abandon de Jeanne qui appelle M. de Montmarcy à Versailles, et c’est aussi, je crois, le motif qui fait désirer à ma mère un instant d’entretien avec vous.
LA DOUAIRIÈRE, relevant la tête avec colère.
Elle !... me voir !... non... non... je ne veux...
JEANNE, joignant les mains.
Grand’mère !...
LA DOUAIRIÈRE, la regardant.
Je la... verrai... plus tard.
JEANNE, avec tendresse.
Bientôt ?... bientôt, n’est-ce pas ?
LA DOUAIRIÈRE, la regardant toujours.
Bien... tôt... soit.
JEANNE.
Tout de suite même.
La douairière secoué la tête.
Tout de suite ! je t’aimerai tant !
LA DOUAIRIÈRE, à Jeanne.
Tout de suite ! mademoiselle... Je suis aux ordres de madame la duchesse, c’est-à-dire aux tiens, méchante fille.
BLANCHE.
Merci, madame la marquise, je vais la prévenir.
Elle va pour sortir vivement et s’arrête en jetant un petit cri et en portant la main a son cœur.
JEANNE.
Blanche !
BLANCHE, essayant de sourire.
Ce n’est rien... j’ai voulu courir et... cette douleur... ah !
Respirant.
Me voilà tout à fait remise.
Elle sort.
LE COMMANDEUR, à part.
Quels étranges symptômes...
JEANNE.
Mais qu’est-ce qu’elle a ?
LE COMMANDEUR.
Oh ! rien ! ce ne sera rien !
JEANNE, qui a accompagné Blanche, revenant auprès de la douairière.
Grand’mère, je suis contente de vous.
LA DOUAIRIÈRE.
Embrasse-moi donc alors... Tu sais bien que je ne peux pas aller te prendre dans mes bras.
JEANNE.
Vous avez été sage et je vous aime bien.
Elle l’embrasse.
LE COMMANDEUR.
Ah ! ma tante, quelle adorable femme, quel trésor, quel ange que ma cous...
JEANNE.
Qu’est-ce que vous avez donc ? Eh bien, et les émotions !...
LE COMMANDEUR.
Tiens, c’est vrai, je m’oubliais, moi !
Parlant avec le plus grand calme.
N’est-ce pas ma tante, que ma cousine est un ange ?
LA DOUAIRIÈRE.
Un ange condamné au purgatoire, à la pauvreté, c’est-à-dire au célibat.
LE COMMANDEUR.
D’abord, ma tante, le célibat n’est pas le purgatoire ; célibat, m’a dit un grand philosophe, est un composé de trois mots : Ciel ici-bas... on en a fait célibat ! Quant au mariage, pourquoi ma cousine y renoncerait-elle ?
LA DOUAIRIÈRE.
Pouvez-vous me dire quelle dot elle aura, maintenant qu’ils lui ont pris ce titre qui valait trois dots à lui seul ? Pouvez-vous me dire de quoi se compose sa légitime à elle ? Si quelque gentilhomme l’épousait, avec ce que Jeanne lui apporterait, ils n’iraient pas loin.
LE COMMANDEUR.
C’est-à-dire qu’ils ne bougeraient même pas.
JEANNE.
Grand’mère, je suis fière du sacrifice que j’ai fait, j’en suis heureuse et partant, plus riche que tous les millionnaires du monde.
LE COMMANDEUR, avec feu.
Superbe ! adorable ! admirable ! vous êtes sublime, oui, vous êtes sublime !
JEANNE.
Prenez donc garde, cousin, voilà encore que vous vous Oubliez.
LE COMMANDEUR, agité.
Tiens, c’est vrai, je me...
Avec force.
Bah ! ça m’est égal !... si je veux m’émouvoir, moi ! si je suis las de vivre comme une plante ou comme un polype, si je veux aimer ce qui est bon, si je veux admirer ce qui est bien, si je veux adorer ce qui est beau, est-ce que je n’en ai pas le droit, par hasard ?
JEANNE.
Si fait, mon cousin.
LE COMMANDEUR.
Eh bien, alors je vous dis que vous êtes ce que le ciel a fait de meilleur, de plus charmant et de plus adorable ! Je vous dis que pour qu’un gentilhomme osât vous marchander, il faudrait qu’il n’eût ni cœur ni âme ; je vous dis que la véritable noblesse peut s’enquérir des vertus et du blason, mais qu’elle ne calcule pas les écus ; je vous dis qu’elle estime le cœur plus haut que la fortune et que de ce côté-là, cousine, vous êtes la plus riche héritière de France ! Voilà ce que je vous dis, moi ! fâchez-vous si vous voulez !
JEANNE.
Vous voyez bien, grand’mère, voilà votre Jeanne toute mariée.
LE COMMANDEUR.
Certainement.
JEANNE.
Cousin, vous serez mon premier garçon d’honneur.
LE COMMANDEUR.
Certainement... Pas du tout, cherchez-en un autre !...
LA DOUAIRIÈRE.
J’entends monter... C’est elle, sans doute.
JEANNE.
Tu vas encore être bonne, n’est-ce pas ?
LA DOUAIRIÈRE.
Je suis... résignée.
Scène IV
LA DOUAIRIÈRE, LE COMMANDEUR, JEANNE, LA DUCHESSE, BLANCHE
LA DUCHESSE.
Blanche vous a dit, madame la marquise, le vif désir que j’avais de vous entretenir.
LA DOUAIRIÈRE.
Elle me l’a dit madame, et je suis prête à vous entendre.
Elle lui fait signe de s’asseoir.
LA DUCHESSE.
Ce n’est pas sans émotion que j’aborde le sujet dont je veux vous parler. Il s’agit du généreux sacrifice de Jeanne en faveur de ma fille... et je crains de raviver une souffrance...
LA DOUAIRIÈRE.
Rassurez-vous, madame, tout le mal que devait me faire la ruine de mon enfant est accompli ; vous pouvez donc parler à votre aise.
LA DUCHESSE.
C’est pour racheter un peu du mal que nous vous avons causé, madame, c’est pour réparer autant que faire se peut la ruine de Jeanne que je vous supplie de m’entendre !
La douairière lui fait signe de parler.
Madame la marquise, la fortune de notre maison n’est pas aussi complètement perdue qu’on le pense ; si quelques prodigalités de mon mari, et surtout celles de son père ont presque entièrement englouti ce que le duc devait posséder de son chef, il n’en est pas de même de la dot que J’ai reçue de ma famille. Cette dot de cinq cent mille livres est demeurée intacte.
LA DOUAIRIÈRE.
Je vous en félicite, madame, mais je ne comprends pas...
LA DUCHESSE.
Madame la marquise, Jeanne s’est montrée pour ma fille, la plus généreuse, la meilleure des sœurs...
BLANCHE.
Oh ! oui, la meilleure, la plus...
Elle prend la main de Jeanne e t s’arrête de parler comme quelqu’un qui souffre.
JEANNE, bas.
Comme ta main est froide.
BLANCHE, bas.
Tais-toi !
LA DUCHESSE.
La grâce que je viens vous demander, c’est de me permettra à moi, de me figurer que Jeanne est ma fille aussi bien que Blanche ; mon cœur je vous le jure, les entourera toutes deux d’une égale tendresse.
LA DOUAIRIÈRE.
Libre à vous, madame ; je n’ai pas le droit d’empêcher qu’on aime ma petite-fille.
LE COMMANDEUR.
Je le crois bien !
JEANNE, bas.
Voyez donc comme Blanche pâlit encore.
BLANCHE, bas.
Non... non... tais-toi, te dis-je !
LA DUCHESSE.
Puisque vous ne me défendez pas de l’aimer à l’égal de Blanche, permettez-moi aussi, madame, de la doter comme ma propre fille.
LA DOUAIRIÈRE, avec une colère contenue.
Vous !
LA DUCHESSE.
Permettez-moi de lui donner la moitié de cette fortune.
LA DOUAIRIÈRE, avec force.
Jamais, jamais, madame !
JEANNE, suppliante.
Grand’mère !
LA DOUAIRIÈRE, se calmant tout à fait.
Pardonnez-moi ce moment d’émotion, madame, je m’étais promis de demeurer calme. Je le serai pour vous dire qu’un sacrifice pareil à celui de ma Jeanne ne se paye pas.
LA DUCHESSE.
Oh ! madame !
LA DOUAIRIÈRE.
Ne se paye pas avec de l’argent. Je ne m’inquiète pas de son avenir, madame ; il est encore en France des refuges où les jeunes filles nobles peuvent trouver un abri digne d’elles contre les peines et les déceptions de ce monde.
LA DUCHESSE.
Jeanne n’a pas de vocation pour le couvent, madame...
LE COMMANDEUR.
Pour le couvent ? pas la moindre vocation !
LA DUCHESSE.
Nous la contraindrons à faire un bon mariage, elle sera heureuse avec nous.
LE COMMANDEUR.
Parfaitement heureuse avec m... avec nous.
LA DUCHESSE.
N’est-ce pas, Jeanne, que vous ne voudriez nous abandonner ?...
Elle l’embrasse.
JEANNE.
Je serais bien ingrate, si j’osais seulement y penser... vous quitter...
Allant à Blanche.
abandonner ma...
La voyant chanceler.
Ah ! mon Dieu !...
BLANCHE, bas.
Emmène-moi... je souffre... je souffre cruellement.
Le commandeur inquiet s’approche d’elle.
LA DUCHESSE.
Blanche !
BLANCHE, luttant pour cacher sa souffrance.
Ma mère ?
LA DUCHESSE.
Aide-moi à convaincre madame la marquise... prie-la d’accepter pour ta sœur...
BLANCHE, d’une voix tremblante tandis que le commandeur et Jeanne la regardent avec anxiété.
Oui... je vous prie... je vous... conjure... madame la marquise... je vous conjure avec des larmes, des... Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
LA DUCHESSE, hors d’elle-même.
Qu’as-tu donc ?
BLANCHE.
Ah ! je souffre... je souffre... ma mère.
LA DUCHESSE.
Blanche, mon enfant.
JEANNE.
Ma sœur !...
BLANCHE.
Ah ! ma mère, je souffre horriblement !... Mais je ne veux pas mourir... Maman, je ne veux pas mourir !...
LA DUCHESSE.
Mourir ! toi... ma fille !
LE COMMANDEUR.
Attendez !...
Il s’empresse auprès de Blanche.
LA DUCHESSE.
Ma fille, ma fille bien-aimée !
BLANCHE, lui faisant signe de la main.
Ne crains rien !
La duchesse s’agenouille entre elle et la douairière.
LA DOUAIRIÈRE, bas.
Le malheur est entré dans cette maison, madame ; fasse le ciel que je sois sa seule victime !
À ce moment, Biassou paraît au fond et regarde ce qui se passe.
Deuxième Tableau
Une partie très couverte du parc, bosquets et berceaux dans le style de Lenôtre. À gauche, sur le devant, un pavillon attenant au château dont l’architecture se perd dans la coulisse. Une large fenêtre ouverte, en face le public, permet de voir ce qui se passe à l’intérieur du pavillon. Au milieu de la pièce, un bureau-secrétaire bien exposé aux regards du public.
Scène première
LE COMMANDEUR, seul
J’ai voulu m’éloigner du monde, me retirer dans ce château, pour y vivre calme et paisible, à l’abri de toutes les émotions violentes, et j’ai joliment réussi ! Me voilà trois malades sur les bras. La marquise, que je croyais guérie, est plus paralysée que jamais. Après Gaston, voici venir cette pauvre Blanche. Que faire ? J’ai horreur de voir souffrir les gens, mais je ne peux pas m’en aller d’ici sans inhumanité, il faut donc absolument que je la guérisse... Mais comment ? Quel traitement opposer au mal ? Je vois les effets, mais je ne puis pas comprendre les causes... ou plutôt, je crains de les deviner... car... si mes soupçons allaient se justifier !... Non ! non !... ce serait horrible !...
Il tire de sa poche un livre dans la lecture duquel il a l’air de s’absorber complètement.
Oh ! cette vérité !... je finirai par la trouver !...
Entrée de la duchesse.
Scène II
LE COMMANDEUR, LA DUCHESSE
LA DUCHESSE, touchant le commandeur à l’épaule.
Eh bien, que pensez-vous ? d’où lui est venue cette crise ?... Elle paraît accablée de fatigue... son sommeil est agité...
LE COMMANDEUR.
Laissons-lui prendre quelques heures de repos : nous verrons après...
LA DUCHESSE.
Nous verrons ?... répondez !... Son état vous inspire-t-i1 de graves inquiétudes ?... Parlez... parlez, de grâce ! oh ! j’ai du courage et je veux tout savoir !...
LE COMMANDEUR.
J’ai presque la conviction que la crise ne se reproduira plus.
LA DUCHESSE...
Mais alors, vous devez savoir ce qui l’a amenée ?
LE COMMANDEUR.
Des doutes... des conjectures !... Oh ! nous trouverons le moyen de la soustraire au danger.
LA DUCHESSE.
La soustraire au danger ?... Oh ! vous voyez bien que vous tremblez pour elle.
LE COMMANDEUR.
Non, je vous affirme qu’elle est... en ce moment hors de péril.
Après un temps.
Je vais auprès d’elle, ayez du courage... Bientôt, je l’espère, je répondrai tout à fait de la chère enfant.
LA DUCHESSE.
Allez ! allez !... je vous attends.
Sortie du commandeur.
Scène III
LA DUCHESSE, seule
Ma pauvre Blanche !... comme pour ne pas m’inquiéter, elle dissimulait ses souffrances !... elle me souriait ; et quand la douleur devenait trop forte, elle se serrait contre mon cœur, elle me cachait son visage !... Mais qu’ai-je donc fait pour être ainsi punie dans mon enfant ?... J’ai eu un moment de folie, d’égarement !... mais à la vue de ma fille, je me suis arrêtée au bord de l’abîme !... Je suis redevenue mère. J’ai étouffé, anéanti, jusqu’au dernier souvenir de mes folles chimères...
Elle s’arrête.
Mais non !... Il en reste encore !... Ces pages qui recevaient mes confidences coupables, elles sont là, et toute entière à ma fille, je n’ai pas songé à les détruire, à les brûler. Oh ! c’est cela peut-être qui me porte malheur !... Allons ! vite ! que tout disparaisse à jamais.
Elle s’élance dans le pavillon, ouvre son bureau et en tire une liasse de papiers qu’elle se met à parcourir. En ce moment, l’on aperçoit Biassou qui apparaît caché à moitié par la feuillue et observe la duchesse.
Scène IV
LA DUCHESSE, BIASSOU
BIASSOU, à part.
Oh ! faut voir à s’emparer de ces papiers !... Elle est là !... Germaine m’aviont pourtant ben dit qu’ils étaient tous auprès de la malade.
Il se dissimule dans le fossé.
LA DUCHESSE.
Oui, je veux que, dans un instant, il n’en reste aucune trace.
BIASSOU.
Faudra guetter un autre moment.
Il disparaît.
LA DUCHESSE, l’œil fixé sur ses papiers.
Se peut-il que ce soit moi qui l’aie écrit... qui l’aie pensé ?...
Lisant.
« Lutter !... toujours lutter !... je suis à bout de mes forces ! Oui ! je sens que je l’aime de toutes les aspirations de mon âme ! je sens que s’il allait en aimer une autre... ce serait un arrêt de mort ou pour moi ou pour... » Oh !
Elle laisse tomber le papier et se couvre de ses mains le visage. On entend les mots : madame la duchesse... prononcés par la voix de Jeanne.
LA DUCHESSE, se redressant et écoutant.
C’est la voix de Jeanne ! Non ! j’ai encore du temps pour ce qui me reste à faire.
Elle feuillette ses papiers, la voix de Jeanne se fait de nouveau entendre.
Mais si !... je ne me trompe pas !... c’est bien elle, c’est Jeanne qui m’appelle !...
Elle remet les papiers dans le tiroir.
Mon Dieu ! est-ce que Blanche... ?
Entrée vive de Jeanne. Au moment où la duchesse s’élance du pavillon, la tête de Biassou apparaît de nouveau au milieu du fourré ; la porte du pavillon s’est refermée.
Scène V
LA DUCHESSE, JEANNE, dans le parc
JEANNE, vivement.
Venez, madame ; Blanche s’est réveillée, elle vous demande.
LA DUCHESSE.
J’y cours !
Avec angoisse.
Est-ce qu’elle souffre davantage ?
JEANNE.
Non, elle est encore bien faible, mais il me semble qu’elle va mieux.
LA DUCHESSE.
Chère Jeanne !... tu n’as que de bonnes paroles à me dire.
Elle sort vivement.
JEANNE.
Oui, de bonnes paroles... pour diminuer ses craintes, mais je ne suis pas plus rassurée pour cela. Tout à l’heure, quand il observait ma pauvre Blanche, quand il interrogeait son livre de médecine, le commandeur paraissait bouleversé. Mais quelle est donc cette horrible maladie.
Voyant entrer le duc.
Ah ! mon père !
Scène VI
JEANNE, LE DUC, BIASSOU
LE DUC.
Jeanne, l’état de ta sœur m’inquiète, je veux une consultation.
BIASSOU, reparaissant sur le devant du pavillon et regardant à l’intérieur.
Plus personne !
JEANNE.
Une consultation ?...
BIASSOU.
Entrons voir.
Il escalade la fenêtre du pavillon.
LE DUC.
Je vais faire appeler le docteur Didier... Envoie-moi François, il partira à cheval et portera la lettre que je vais écrire là à l’instant.
JEANNE.
J’y vais, mon père.
Elle sort.
BIASSOU.
C’est là-dedans qu’elle les a cachés !
Il force le tiroir.
Faudra ben que ça s’ouvre !
LE DUC.
Oui, je veux qu’il vienne !...
BIASSOU, qui a ouvert le meuble.
V’là les papiers !... c’est m’ n’affaire.
Il prend les papiers et les cache sons son habit.
LE DUC.
Quand bien même sa présence ne devrait servir qu’à rassurer ma femme.
Il pénètre vivement dans le pavillon, et aperçoit Biassou.
Scène VII
LE DUC, BIASSOU
LE DUC.
Un homme !... Biassou ! que fais-tu là, misérable ?
BIASSOU, d’une voix pateline.
N’ vous emportez point, mon bon seigneur.
LE DUC.
Serait-ce pour voler que tu t’es introduit chez madame la duchesse ?
BIASSOU.
Pour voler, bonté du ciel !... moi.
Feignant de pleurer.
Un vieux serviteur de soixante-dix-sept ans qu’a gardé vos bestiaux avec honneur et probité, qui n’aurions jamais pris pour lui une goutte du lait de vos vaches, ni un brin de la toison de vos moutons, se voir accusé de soustraction et s’entendre traiter de voleu par son doux seigneur !... Ah ! c’est ben pénible, mon bon Dieu ! oui, c’est ben pénible à mon âge.
Il pleure.
LE DUC.
Trêve de jérémiades ; réponds, comment es-tu entré-là ?
BIASSOU.
J’ croyais que la porte étions close, j’ sommes entré par la fenêtre... Faut ben entrer par quèque part, mon doux maître
LE DUC.
Pourquoi y entrais-tu ?
BIASSOU.
Dame ! mon bon seigneur...
LE DUC, le secouant.
Mais réponds donc...
Biassou laisse tomber les papiers.
Qu’est-ce que cela ?
BIASSOU.
Ça... c’est... c’est ce que j’étions venu chercher, mon doux maître...
LE DUC.
Des papiers !... pourquoi venais-tu les voler ?
BIASSOU.
Les emprunter, monseigneur...
LE DUC.
Réponds donc.
BIASSOU.
Dame ! monsieur le duc, les malades avont quelquefois des lubies, qu’il n’est point bon de contrarier ; cela pourrait leurs-y faire du mal.
LE DUC.
Les malades !... Quel rapport y a-t-il entre ces papiers et ma fille ?
BIASSOU.
Faites excuse, monsieur le duc, y a encore au château, une autre personne qui ne va guère bien ; c’est notre maîtresse, madame la marquise.
LE DUC.
Madame la marquise t’a ordonné de lui apporter ces papiers ?
BIASSOU.
Quasiment !... mais point tout à fait, mon doux seigneur. Un jour, j’entendis qu’elle disait comme ça qu’elle serait ben aise de jeter l’œil dessus... et alors je me suis dit à mon à part, qu’il fallait y procurer ce petit plaisir-là. Elle n’en a pas déjà tant, la pauvre chère dame du bon Dieu.
LE DUC.
Va-t’en, et ne reparais jamais à mes yeux, si non, tu apprendras à tes dépens que le droit de haute et basse justice appartient encore au seigneur de ce château.
BIASSOU.
Je m’en y va, mon doux maître charitable ; que le bon Dieu vous conserve la santé et qui vous accorde ses bénédictions sur la terre et dans le ciel ! qu’il vous préserve...
Le duc le suit et le fait disparaître par un geste menaçant.
Scène VIII
LE DUC, seul
Pour quelle raison la douairière veut-elle s’emparer de ces papiers ?... Elle, l’ennemie implacable de la duchesse ! Ce n’est pas une vaine curiosité qui la pousse. C’est donc une arme !... une arme contre nous... contre ma femme !... voyons !...
Il parcourt les papiers.
Non... je me trompais... Des notes écrites par la duchesse... l’emploi de son temps... la tristesse de sa vie... l’isolement... l’abandon... et puis... son... son amour... son amour !... oui !...
Lisant.
« Je sens que la passion envahit mon cœur, que j’aime cet homme ! »
Parlé.
Un amour coupable !... un amour adultère ? une honte qui n’est même plus un secret puisque la marquise voulait en avoir la preuve !... Voyons encore...
Il continue à lire.
« Je l’aime de toutes les aspirations de mon âme !... je sens que s’il allait en aimer une autre ce serait un arrêt de mort pour moi ou pour cette autre !... »
Parlé.
Son nom ! Le nom du misérable !
Il parcourt vivement les feuillets.
Celui de son futur gendre, ce n’est pas cela. Ah ! le récit de cet accident de cheval !...
Il lit.
« Quel courage, quelle âme noble et dévouée, comme il paraît heureux de cette blessure reçue en me sauvant !... comme je l’aime ! lui ! Gaston !... »
Parlé d’une voix sombre.
Oh ! la malheureuse !... rivale de sa fille !...Quel horrible abîme s’ouvre devant moi ! Je comprends tout maintenant ! son embarras à mon arrivée... son trouble à la première vue de sa fille ; sa froideur, son aversion pour Blanche, sa haine qu’elle a réussi à dissimuler ensuite !... Mais pourquoi ? dans quel but me demandait-elle de les unir ?... quelle arrière-pensée, quel projet coupable cachait donc ce mariage ?...
Entrée du commandeur.
Scène IX
LE DUC, LE COMMANDEUR
LE COMMANDEUR, entrant très ému.
Armand, je quitte à l’instant ta fille...
LE DUC.
Viens-tu m’annoncer un nouveau malheur ?
LE COMMANDEUR.
Non, l’état de Blanche n’a pas empiré... mais je connais maintenant, je suis certain, entends-tu, je suis certain de connaître la cause de cette crise et des souffrances qui l’ont précédée.
LE DUC.
La cause ? Parle !
COMMANDEUR.
Eh bien... C’est...
Il regarde autour de lui.
LE DUC.
C’est... Parle donc ?
LE COMMANDEUR.
Eh bien !... c’est le poison !
LE DUC, épouvanté.
Le... le poison !... On veut assassiner ma fille ?
LE COMMANDEUR.
Je crois avoir triomphé des tentatives qui ont eu lieu jusqu’à ce jour, mais il faut qu’elles ne puissent pas se renouveler, il faut découvrir la main criminelle qui attente à la vie de Blanche.
LE DUC, hors de lui.
La main criminelle... oui... Oh ! toutes les douleurs, toutes les tortures à la fois.
LE COMMANDEUR.
Allons, du courage, et songeons à empêcher que le crime ne se renouvelle ; l’antidote pourrait ne plus agir.
LE DUC.
Recommencer le crime ? Mais qui ? As-tu des présomptions... Soupçonnes-tu quelqu’un ?
LE COMMANDEUR.
Le poison est l’arme des faibles... Si Blanche n’était pas ici, dans le sein de sa famille, je dirais qu’il y a près d’elle une femme qui la hait...
LE DUC.
Une femme ?
LE COMMANDEUR.
Et qui veut la tuer.
LE DUC.
Une femme qui la hait !...
Regardant le manuscrit avec terreur.
« Je sens que s’il en aimait une autre... ce serait un arrêt de mort pour moi... ou pour cette... autre...
Avec force.
Non, non, ce n’est pas vrai, c’est impossible, impossible, te dis-je, un crime aussi infâme ! Allons donc, est-ce que la terre peut porter de pareils monstres ?
LE COMMANDEUR.
De qui parles-tu ?
LE DUC, avec désespoir.
Mais je parle de... je ne sais plus, je deviens fou ! Oh ! mon Dieu ! on attente à la vie de ma fille, et celle qu’il me faudrait soupçonner, ce serait elle !...
LE COMMANDEUR.
Mais qui donc ?
LE DUC, avec force.
Non, on trahit les devoirs les plus sacrés, on foule aux pieds les serments les plus saints, on se couvre d’infamie, on médite les crimes les plus odieux, les plus lâches, mais on n’assassine pas son enfant !...
LE COMMANDEUR, avec force.
Son enfant... mais c’est donc...
LE DUC, voyant paraître la duchesse.
Elle ! tais-toi, malheureux, tais-toi !
LE COMMANDEUR.
Sa mère !
LA DUCHESSE, entrant.
Blanche paraît moins faible !
LE DUC, bas.
Je te dis que cela est faux ; laisse-moi seul avec elle... Et, sur la vie ! pas un mot à personne, entends-tu ? pas un mot.
LE COMMANDEUR.
À personne !
Il sort.
Scène X
LE DUC, LA DUCHESSE
LA DUCHESSE.
Elle a voulu se lever... elle va... Mais que vous arrive-t-il, mon ami ? D’où vient cette pâleur ?d’où vient que vous me regardez ainsi ? Il y a de la colère, de la menace dans votre regard ! Qu’avez-vous donc ?
LE DUC, lui montrant les papiers.
Ce que j’ai, madame !... Vous avez pris soin de le dénoncer vous-même !
LA DUCHESSE.
Oh ! il sait tout !... il sait tout !
Elle se cache la figure dans ses deux mains.
LE DUC, d’une voix tremblante.
Pourquoi cacher votre visage ? Est-ce la honte qui vous rend muette ! Est-ce le remords que trahissent vos regards ?
LA DUCHESSE, tombant à ses pieds.
Pitié, Armand ! vous ne me jugerez jamais aussi sévèrement que je me suis jugée moi-même !
LE DUC.
Elle l’avoue ! elle l’avoue ! Ah ! tenez ! je vous en supplie ! appelez à votre secours l’hypocrisie, le mensonge, les faux serments ! vous réussirez peut-être à me glisser dans le cœur un rayon de doute ! Je ne veux pas de cette horrible vérité.
LA DUCHESSE.
Non, je ne chercherai pas à étouffer la réprobation de ma propre conscience. Et quand bien même, dans un élan de générosité, vous m’accorderiez le pardon et l’oubli, moi, la première, je ne me pardonnerais pas ! je n’oublierai jamais !
LE DUC.
Le pardon !... l’oubli !... pour un pareil crime ! mais vous seriez sur votre lit de mort, brisée et repentante, que je ne saurais vous promettre ni pardon, ni oubli.
LA DUCHESSE.
Vous êtes un juge sévère, mais la pitié pour le coupable n’est pas un droit ; c’est une grâce !
LE DUC.
Pas de grâce pour l’épouse, pas de pitié pour la mère, pas de miséricorde pour la femme qui a oublié ces deux titres sacrés.
LA DUCHESSE.
Pas de pitié... pour la mère ! Mais de quel crime m’accusez-vous donc ?
LE DUC.
De quel crime ? Dieu n’a pas permis qu’il s’accomplit tout entier. Blanche est sauvée, madame.
LA DUCHESSE.
Blanche ? pourquoi me parlez-vous d’elle ?
LE DUC.
Oui, elle est sauvée, mais quelques gouttes de plus et le poison la tuait !
LA DUCHESSE.
Le poison !... que dites-vous là ?... ma fille empoisonnée !...
LE DUC.
L’infâme tentative a échoué !
LA DUCHESSE.
Ma fille empoisonnée, et vous me parlez de crime ? Oui... vous m’en parliez à moi... à moi... comme si...
Elle s’arrête.
Voyons !... ma tête se perd !... Pas de pitié pour la femme ! je le comprends... mais pas de pitié pour la mère, disiez-vous !... mais alors, c’est donc sur moi que vous osiez jeter vos soupçons !... Non !... cela n’est pas possible !... Répondez !
LE DUC, lui montrant les papiers.
Relisez vos propres paroles... madame ! « C’est un arrêt de mort pour moi... ou pour... »
LA DUCHESSE.
Oh ! c’est infâme !... Mais quel homme êtes-vous donc pour avoir conçu cet abominable soupçon ?... Que s’est-il passé dans votre cœur ? quel démon s’est emparé de votre âme lorsque vous vous êtes dit : « Cette femme à qui, pendant dix-huit ans, je n’ai rien eu à reprocher, cette femme que le monde entoure de son respect, c’est un monstre odieux ! Elle tue son enfant ! »
LE DUC.
Je n’ai rien à vous reprocher ?...
LA DUCHESSE.
Non ! rien ! Coupable vis-à-vis de moi-même, je suis innocente devant vous !... Le jour où vous m’avez épousée, je vous ai donné tout mon amour. Je ne vivais qu’en vous et par vous ! Vous m’avez abandonnée, délaissée ; vous m’avez livrée à l’isolement et au désespoir ! Un jour, ma solitude s’est rompue. J’entends des paroles d’intérêt, de sympathie ; un sentiment naît en moi ! un sentiment coupable, oui, je l’avoue ! Je le combats de toutes mes forces, je lutte, je cherche un conseil, un refuge, un appui... Personne !... Oh ! je me trompe ! Dieu veillait sur moi !... Il m’envoie ma fille et la lumière pénètre dans mon âme et je suis sauvée ! Mais je ne me suis pas pardonné moi-même d’avoir laissé mon cœur un instant ouvert à une coupable pensée !... J’accepte d’avance toutes les expiations, je les appelle sur ma tête... Quant à vous, monsieur, rien ne vous autorise à condamner l’épouse et je vous défends d’outrager en moi la mère !
LE DUC.
Mais ces pages tracées par vous ne vous accusent-elles pas ? Votre amour s’y exhale en menaces de mort contre votre rivale.
LA DUCHESSE.
Lisez-les donc jusqu’à la fin, ces pages que vous avez surprises !... Vous y avez trouvé les traces du combat, vous y trouverez aussi les preuves de la victoire !
LE DUC.
Quelles preuves ? dites, parlez !
LA DUCHESSE.
Tenez, voici le jour où j’ai retrouvé ma fille, le jour où son cœur s’est ouvert à moi !
LE DUC.
Après ? après ?
LA DUCHESSE.
Voici la rivale frémissante, éperdue !
LE DUC.
Après ?
LA DUCHESSE.
La voilà qui faiblit, qui chancelle, qui pleure...
LE DUC, avec force.
Et voici que la mère se réveille et triomphe !... Henriette, ne songeons plus qu’à Blanche ! Unissons-nous pour préserver du danger qui la menace, la tête chérie de notre enfant !
LA DUCHESSE.
Cherchez l’assassin, et punissez-le, voilà votre tâche ; quant à ma fille ! je ne la laisse à personne, pas même à vous ! À partir de ce jour, elle n’aura plus d’autres soins que les miens ; je m’installe à son chevet, je ne la quitte plus d’un instant !... Qu’on vienne donc me la prendre !... elle est à moi, elle m’appartient, entendez-vous, et j’en réponds devant Dieu !
Scène XI
LE DUC, LA DUCHESSE, BLANCHE
LE DUC.
Henriette !... la voici...
LA DUCHESSE, courant à elle et la prenant dans ses bras.
Ah ! ma fille !... ma fille !...
Elle la couvre de baisers et de larmes.
BLANCHE.
Qu’as-tu donc, des larmes ! pourquoi pleures-tu ?... N’es-tu pas joyeuse de me voir debout.
LA DUCHESSE.
Oui, oui, je suis heureuse, je suis bien heureuse, va !
Bas.
Oh ! ces traits pâlis par la souffrance, ces yeux rougis par les larmes, c’était...
LE DUC, bas.
Silence, Henriette !
Scène XII
LE DUC, LA DUCHESSE, BLANCHE, LE COMMANDEUR
LA DUCHESSE.
Commandeur, à l’avenir, nous serons deux à veiller sur elle, à lui prodiguer des soins...
Avec énergie.
Mais nous.ne serons que nous deux, car c’est moi qui réponds de sa vie.
ACTE IV
Une grande chambre servant d’habitation à une jeune fille. Au fond à droite, un lit avec de grands rideaux en mousseline. Un sofa en faro du lit. Entre le lit et le sofa une grande fenêtre. Portes à droite, à gauche et au fond.
Scène première
LE COMMANDEUR, JEANNE
JEANNE, continuant.
...Et la consultation que vous avez eue avec le docteur Didier n’a servi qu’à confirmer vos soupçons...
LE COMMANDEUR.
À moi, elle ne m’a servi à rien. Avant cette consultation, j’avais déjà la certitude.
JEANNE, vivement.
La certitude !...
LE COMMANDEUR.
Une tentative d’empoisonnement ne peut être amenée que par trois causes : le suicide, le crime ou le hasard.
JEANNE.
Le suicide !... mais il serait fou de supposer que ma pauvre Blanche eût voulu se tuer, elle, si gaie, si heureuse de vivre...
LE COMMANDEUR.
Reste le hasard ou le crime... le hasard, vous n’y croyez guère ; il faut donc que ce soit...
JEANNE.
Le crime !... Oh ! ce serait horrible !... mais qui supposez vous capable ?...
LE COMMANDEUR.
Je ne sais, je n’accuse personne ; mais ce que je puis vous affirmer, c’est que depuis les mesures prises par madame la duchesse, malgré sa persistance inébranlable à la vouloir soigner seule...
JEANNE.
Achevez...
LE COMMANDEUR.
Non... J’ai tort de vous parler de ces terribles mystères... mais... vous avez une manière de m’interroger qui fait que je ne sais pas vous résister.
JEANNE.
Achevez, mon cousin.
LE COMMANDEUR.
Non !
JEANNE.
Je veux, tout savoir, entendez-vous, je le veux.
LE COMMANDEUR.
Eh bien, depuis les précautions sans nombre de... de madame la duchesse, les tentatives se sont modifiées, mais elles ne se sont jamais arrêtées.
JEANNE, épouvantée.
Jamais ! que dites-vous là ?...
LE COMMANDEUR.
Je vous le jure !
JEANNE.
On attente toujours à la vie de ma sœur !
LE COMMANDEUR.
Ah ! si vous saviez quelle lutte incessante d’investigations et de ruses je soutiens, depuis près d’un mois contre l’assassin !... si vous saviez comme il verse à petites doses ce poison dont il espère qu’on ne trouvera pas les traces ; comme j’en observe, moi, l’apparition ou le progrès ; comme je le combats, comme je le terrasse, comme je l’anéantis un jour, pour le voir reparaître, le lendemain, plus terrible et plus menaçant que jamais ! si vous saviez avec quelles angoisses j’interroge le visage pâle et amaigri de ma chère petite malade ; mais avec quel désespoir aussi, je vois ensuite sa pauvre tête penchée vers la terre et ses mains tremblantes qui gardent à peine assez de force pour essuyer une larme... ces jours-là, je m’accuse, je me crois coupable de sa souffrance puisque je ne sais pas l’en préserver, et si elle devait s’éteindre dans nos bras... Ah ! je crois... eh bien !... je crois que j’en deviendrais fou de désespoir et de remords...
Il pleure.
JEANNE.
Non... non... elle ne mourra pas.
Lui prenant une main qu’il tient devant ses yeux.
Et vous, mon ami, cessez de vous accuser vous-même ; n’êtes-vous pas le meilleur des hommes ?...
LE COMMANDEUR.
Moi !... allons donc.
JEANNE.
Oui, le meilleur... puisque malgré votre répulsion pour tout ce qui peut émouvoir, vous nous aimez tant que vous voilà, comme moi, tout en larmes.
LE COMMANDEUR.
Ah ! bah ! mes larmes à moi, ça ne signifie rien.
JEANNE.
Comment ?...
LE COMMANDEUR.
Je les ai économisées pendant tant d’années qu’il est tout simple qu’elles coulent facilement aujourd’hui.
JEANNE.
Oui, mon ami, vous êtes bon ! vous êtes véritablement bon !
Scène II
LE COMMANDEUR, JEANNE, GASTON, BLANCHE
GASTON, donnant le bras à Blanche.
Docteur, vous avez ordonné le grand air à votre malade, et nous allons, madame la duchesse et moi, la conduire en carrosse jusque dans la forêt.
BLANCHE.
Est-il déjà temps de partir ?... j’avais encore bien des choses à vous dire.
JEANNE.
Voilà plus d’une heure que vous causez ensemble.
GASTON.
C’est vrai, je contais à mademoiselle Blanche les détails de mon voyage à Paris.
BLANCHE.
Une heure ?... Ah ! je ne m’en étais pas aperçue...
GASTON.
Merci... quoique je ne m’y trompe pas... C’est surtout au récit de ce voyage que je suis redevable de vos gracieuses paroles. Mon arrivée à Paris, l’accueil bienveillant du roi, le bonheur de mon père qui vous aime déjà comme si vous étiez sa fille, tout cela a passé devant moi comme un rêve, que j’étais pressé de voir finir, parce qu’il me retenait loin d’ici... loin de ce château où vous souffriez !...
BLANCHE.
Oh ! tranquillisez-vous ; maintenant, je vais tout à fait bien.
JEANNE.
Tout à fait, n’est-ce pas ?
BLANCHE.
Oui, chère petite sœur !
JEANNE.
Ah ! s’il suffisait d’être aimée pour recouvrer la santé !...
BLANCHE.
Il y a longtemps que tu m’aurais guérie à toi seule ?...
JEANNE.
Je le crois.
GASTON.
Sa maladie a donc été bien grave, commandeur.
LE COMMANDEUR.
Oui, non... c’est-à-dire...
JEANNE, vivement.
Elle a beaucoup souffert.
BLANCHE.
Eh bien !... ce n’est pas de ces moments de crise qui dépassaient la mesure de mes forces que je me souviens avec les plus terribles angoisses. Il y a eu autre chose qui m’a fait souffrir bien davantage et que jusqu’ici je n’ai avoué à personne...
GASTON.
Quoi donc ?...
BLANCHE.
J’ai eu des nuits qui me font encore frémir quand je me les rappelle...
LE COMMANDEUR, attentif.
Ah ! dites-nous donc cela ?...
JEANNE.
Oui, parle, ma sœur !
BLANCHE.
Parfois, quand tout reposait autour de moi, je croyais entrevoir une forme humaine se dresser à mon chevet, se pencher au-dessus de ma tête ; je sentais sur mon visage un souffle qui me glaçait de terreur ; je voyais étinceler, dans l’ombre, deux yeux qui me regardaient d’un air menaçant ; puis, le spectre s’éloignait lentement, ses pas effleuraient à peine le sol, et avant de disparaître, je le voyais attachant une dernière fois sur moi ce regard de colère et de haine qui me remplissait d’épouvante. Un froid mortel me saisissait alors ; j’aurais voulu crier, la voix me manquait, je perdais connaissance, et lorsque je revenais à moi j’étais dans les bras de ma mère que mon premier mouvement faisait accourir à mon chevet.
LE COMMANDEUR.
Votre mère !...
Froidement.
C’était peut-être elle, que vous aviez vue quelques instants avant...
BLANCHE.
Elle !...
LE COMMANDEUR.
Qui venait sans doute s’assurer de votre sommeil.
BLANCHE.
Ma mère ne me regarde qu’avec tendresse, et je vous ai dit qu’il y avait de la menace, de la haine, dans ce regard qui s’attachait sur moi.
GASTON.
Voilà qui est étrange.
LE COMMANDEUR, à part.
Oui... bien étrange...
Haut.
Bah ! surexcitation nerveuse, trouble cérébral !... Cousine, il faut oublier ces choses. Rien que d’en parler, cela vous a donné de l’émotion... vous voilà toute tremblante.
Il lui prend la main.
et le pouls est un peu agité.
JEANNE prend sur le guéridon une théière, verse de la tisane dans une tasse et la présente à Blanche.
Tiens, Blanche, ça te calmera.
BLANCHE.
Merci.
Elle boit un peu.
C’est singulier... je... Vous avez raison, docteur, je me sens moins bien.
LE COMMANDEUR.
Mais non... voici au contraire l’agitation qui cesse et votre pouls qui se calme... qui se calme...
Bas.
singulièrement.
BLANCHE.
J’ai soif... je sens de nouveau ce feu qui me brûle...
Elle reprend la tasse et boit encore une gorgée.
LE COMMANDEUR, à part.
Il semble qu’il va cesser de battre tout à fait...et c’est depuis qu’elle a bu !...
Blanche va de nouveau porter la tasse à ses lèvres ; le commandeur lui retient le bras.
Non !... non !... plus de cette tisane !...
BLANCHE.
Pourquoi ?
LE COMMANDEUR.
Je ne veux...
Se remettant.
Je désire vous en prescrire une autre.
JEANNE, bas.
Qu’est-ce donc ?
LE COMMANDEUR, bas.
Les mêmes symptômes.
JEANNE, réprimant un cri.
Ah !
LE COMMANDEUR, bas.
Silence !...
Haut.
Vite un verre d’eau.
JEANNE.
Attendez !...
Elle sort vivement.
LE COMMANDEUR.
Gardez-vous de rien prendre avant que je vous aie apporté le breuvage que je vous préparerai moi-même.
BLANCHE.
Oui, mon cousin, mais j’ai bien soif !...
JEANNE, apportant une carafe, et un verre.
Tenez.
LE COMMANDEUR, il verse un verre d’eau dans lequel il met quelques gouttes d’un flacon.
Buvez ceci.
Blanche boit.
Comment vous trouvez-vous, maintenant ?
BLANCHE, souriant.
Oh ! cela passe ! ce n’est rien ! je suis une peureuse... Que voulez-vous ? C’est si bon de se sentir aimée comme je le suis que cela donne peur de mourir.
LE COMMANDEUR, à part.
Pauvre enfant !... Oh ! j’examinerai le contenu de cette théière !...
GASTON.
Ah ! le carrosse est au bas du perron... Le duc et la duchesse nous attendent...
LE COMMANDEUR.
Allez, ma cousine... l’air vous fera du bien.
BLANCHE.
Venez-vous avec nous, commandeur ?
LE COMMANDEUR,
Non... j’ai... j’ai une expérience importante à faire...
BLANCHE, lui prenant le bras.
Vous m’accompagnerez, du moins, jusqu’à la voiture.
LE COMMANDEUR.
Soit !
À part.
Mais je reviendrai.
JEANNE, absorbée.
Les mêmes symptômes, a-t-il dit !
GASTON.
Venez-vous, mademoiselle Jeanne ? Mademoiselle Jeanne ?
JEANNE.
Oui, oui, me voici.
Ils sortent tous les quatre. Au moment où la, porte se ferme sur eux, une autre porte s’entr’ouvre du coté opposé et laisse voir Germaine.
Scène III
GERMAINE, puis BIASSOU
GERMAINE, parlant à la cantonade.
Ils sont tous partis... venez, mon parrain !...
Entrée de Biassou. Toute la scène suivante doit être jouée avec mystère et h voix basse.
BIASSOU, après avoir regardé.
Plus personne !
Il sort de son sac un paquet enveloppé dans du papier.
Tiens voir un brin...
Il lui remet un rouleau et un autre paquet.
À c’t’ heure, à la besogne, ma fille, c’est pour not’ Jeanne que j’ vons travailler.
Scène IV
GERMAINE, BIASSOU, LE COMMANDEUR
LE COMMANDEUR, stupéfait à la vue de Germaine et de Biassou.
Germaine ici... avec le vieux berger ?...
GERMAINE.
Monsieur le commandeur !
BIASSOU.
L’commandeu !...
LE COMMANDEUR, à part.
Jour de Dieu !... je crois que je tiens les coupables !...
Haut.
Que faites-vous ici... ensemble ! chez mademoiselle Blanche ?
GERMAINE.
Nous, monsieur le commandeur ?
BIASSOU.
J’sommes venus, ma filleule et moi... J’sommes venus pour...
LE COMMANDEUR.
Comment se fait-il que vous cherchiez votre réponse ? Ne savez-vous pas ce qui vous amène ?...
BIASSOU.
Oh ! que si fait... monsieur le commandeu... ce qui nous amenons... mon doux seigneur...
LE COMMANDEUR.
Oh ! pas de flagorneries ! La vérité, je veux la vérité tout entière, ou sinon, misérable !...
BIASSOU.
N’ touchez point... et puis que vous l’voulez, eh bien, eh bien !... j’vons vous dire la vérité.
GERMAINE.
Parrain ?
BIASSOU, avec énergie.
J’ons dit que je parlerions et faut que je parle... Si j’sommes ici, monseigneur, c’est rapport à not’ demoiselle à nous, qui n’est point heureuse et qu’on a dépoillée de tout son bien... de son titre... de sa fortune.
GERMAINE.
Voire même de son fiancé...
LE COMMANDEUR.
Après ?...
BIASSOU.
Mam’zelle Jeanne c’est quasiment not’ enfant à nous !... j’ l’ons vu naître ; quand tout lui manquait à la fois, j’avons voulu détourner la malechance de dessus sa tête.
LE COMMANDEUR.
Et je sais ce que vous avez fait pour arriver à ce but.
GERMAINE.
Vous, monsieur le commandeur !
LE COMMANDEUR, avec autorité.
Je le sais.
BIASSOU.
Que neni, monseigneur, vous ne le savez point...Ces choses-là n’sont connues que des anciens du pays et j’ vas vous les narrer comme j’ l’ons promis.
LE COMMANDEUR.
Soit, parlez !...
BIASSOU.
Eh ben, j’ons, dans le temps, apporté à not’ demoiselle une vierge de Saint-Aignan qui y a toujours porté bonheur. Et depuis qu’elle l’a cédée à la cadette, la bonne chance l’a abandonnée... Je venions d’abord reprendre l’image que voici et en mettre une autre à la place. Après ça, et avec l’aide de saint Michel que j’invoquerons la veille de la pleine lune au Mont-aux-Genêts, et, après que j’aurions caché ici un paquet de germandrée avec une petite branche de houx, j’étions ben assuré d’faire désaimer mam’zelle Blanche et d’rendre à not’ demoiselle son titre, sa fortune et le cœur d’ son fiancé qu’on y a pris. V’là tout ce que j’étions venu faire ici, monseigneur !
LE COMMANDEUR.
Allons donc ! croyez-vous que je serai dupe de vos misérables pratiques de sorcellerie ?
GERMAINE.
Mais... je vous jure, monseigneur...
LE COMMANDEUR.
Point de serments !... des preuves !... Voyons !... Qu’est-ce que tout cela ?
Il ouvre les paquets.
GERMAINE.
Ça monseigneur... c’est l’image de la Vierge de Saint-Aignan.
LE COMMANDEUR, étonné.
Oui... Et ceci ?...
BIASSOU.
C’est la germandrée, et la petite branche de houx... et pus rien !
LE COMMANDEUR.
Soit !... Mais vous aviez un autre but en vous introduisant ici ?
GERMAINE.
Nous, monseigneur ? Oh ! je vous le jure...
LE COMMANDEUR.
C’est faux !
BIASSOU.
Aussi vrai que j’désirons que l’bon Dieu nous assiste à not’ dernière heure !...
LE COMMANDEUR, avec colère.
Mensonge ! mensonge infâme !... La vérité !... je vais vous la dire... Vous conspirez la mort de la fille de madame la duchesse !... Vous êtes des assassins !...
BIASSOU, se redressant.
Des assassins !...
GERMAINE.
Nous, bonté du ciel !...
LE COMMANDEUR.
Blanche a failli mourir... ses jours sont encore en danger.
BIASSOU.
Les jeunes meurent aussi ben que les vieux, quand l’bon Dieu a marqué l’heure.
LE COMMANDEUR.
Blanche a failli mourir à la suite d’une tentative criminelle, et le coupable, c’est l’un de vous deux.
GERMAINE.
Nous ?
BIASSOU.
L’coupable... vous dites que c’est l’un...
Saisissant le bras de Germaine et lui parlant à part.
Germaine... est-ce que t’as commis ce crime-là ?... Réponds.
GERMAINE, bas.
Sur ma vie, j’vous jure que non.
BIASSOU.
Sur la mémoire d’ta mère ?
GERMAINE.
Sur sa mémoire, j’vous jure que non.
BIASSOU.
Monseigneur... r’gardez-moi ben en face, vous n’lirez pas l’mensonge dans mes yeux, et si vous n’craignez point de toucher c’te rude main qu’a travaillé pendant plus de soixante ans, prenez-la, monseigneur, pour voir si elle tremblera comme celle d’un assassin... Vous voulez tout savoir ! eh ben, j’vous dirons tout. Oui, j’n’ons que de la haine pour M. le duc, parce qu’au lieu d’ n’exister que pour son enfant, il a cherché ailleurs l’bonheur de sa vie ; j’ons de la haine pour la duchesse, parce qu’elle s’en est venue se poser là, où n’y avait de place que pour une tombe ! J’ons de la haine pour leur enfant, parce que sans elle, not’ orpheline auriont été riche et heureuse ! Enfin, j’vous haïssons vous-même, parce que vous m’avez tué mon pauvre chien ! Pour nous r’venger d’vous tous, j’pouvons brûler des cierges, dire des neuvaines et invoquer les saints, parce que si j’nous trompons, si je sommes dans not’ tort, Dieu et les saints restont maîtres de ne point nous écouter ; mais s’faire justice soi-même, vouloir tuer une jeune fille, c’est l’pus lâche des crimes, monseigneur ! C’est pour l’compte d’nos seigneurs, après tout, que j’ons de la haine dans l’âme et ce n’est point l’dévouement qu’on ressent pour ses maîtres, ce n’est point l’amour qu’on a pour leur enfant, qui fait d’un serviteur fidèle et dévoué un misérable et un assassin...
LE COMMAMDEUR, avec intention.
Soit !... je me trompais peut-être... Le trouble, l’émotion où je vous vois plaident en votre faveur, et... je ne demanderais pas mieux que de croire à votre innocence.
GERMAINE.
Oh ! ne doutez pas de nous, monseigneur.
BIASSOU, ému.
Non, monseigneur, n’en doutez point... et si j’ons été coupable eh faisant les conjurations que je vous ont dites, j’ n’en sommes que trop puni par le soupçon que ça vous a donné d’nous... Des... assassins... nous !... Ah !... tenez, à c’t’ heure que j’n’ons plus ni révolte, ni colère... rien que c’te pensée-là...
Tombant assis.
J’crois qu’j’en pleurerions, monseigneur, oui, oui... j’crois ben... qu’ j’en pleurons déjà... de honte et de chagrin !
Il pleure.
GERMAINE.
Parrain...
LE COMMANDEUR.
Allons, calmez-vous... et... tenez... pour vous remettre...
Allant au guéridon où se trouve la théière.
Germaine.
GERMAINE.
Monseigneur !...
LE COMMANDEUR.
Faites-lui boire un peu de cette tisane... Le... voulez-vous ?
GERMAINE.
Oui, monseigneur...
LE COMMANDEUR, versant à boire.
Elle n’a pas hésité !
Haut.
C’est celle quia été préparée pour... mademoiselle Blanche ; donnez-la-lui, Germaine,
Il lui donne la tasse.
GERMAINE.
Oui, monsieur le commandeur, oui...
Elle présente la tasse à Biassou qui la prend. Le commandeur s’approche vivement de lui.
BIASSOU, se disposant à boire.
Merci, monseigneur... Vous ne m’accuserez plus... pas vrai ?...
LE COMMANDEUR, lui mettant la main sur le bras.
Je commence à douter.
BIASSOU.
Ah ! faut nous croire, faut nous croire tout à fait, monseigneur.
Il va pour boire.
LE COMMANDEUR, lui arrêtant le bras.
Je vous crois ! Je vous crois... Quelqu’un !...
Il prend vivement la tasse.
Partez, partez vite ; que personne ne sache que vous avez pénétré ici...
GERMAINE.
Personne !
BIASSOU.
C’est donc que vous nous pardonnez, monseigneur ?...
LE COMMANDEUR.
Oui, mais allez, allez !...
Il les fait sortir.
Si pourtant ce n’est pas lui, il faut donc que ce soit...
Scène V
LE COMMANDEUR, LE DUC
LE COMMANDEUR, voyant entrer le duc.
Ah ! c’est toi ! Vous êtes déjà de retour de cette promenade ?
LE DUC.
Oui ! Blanche, qui, en montant en voiture ne paraissait pas du tout souffrante, s’est tout à coup trouvée mal...
LE COMMANDEUR.
Ce qui vous a obligés de la ramener au château ?
LE DUC.
Je l’ai laissée avec sa mère... en bas... au salon...
LE COMMANDEUR.
C’est bien !... nous sommes seuls, causons un instant.
LE DUC
Qu’as-tu à me dire ?
LE COMMANDEUR.
Je t’ai signalé, il y a près d’un mois, le crime que l’on tentait de commettre sur ta fille. Je ne t’ai désigné aucun coupable, c’est toi qui as soupçonné... une personne... à laquelle, le jour même, tu confiais la vie de ton enfant... Est-ce bien vrai, réponds ?...
LE DUC.
C’est vrai ; où veux-tu en venir ?
LE COMMANDEUR.
Je veux te rappeler que cette personne, qui n’a plus permis qu’aucune autre approchât la malade, t’a répondu de la vie de ta fille.
LE DUC
Eh bien ?...
LE COMMANDEUR.
Eh bien !... approche...
Il prend la tasse, tire de sa poche une fiole et fait au duc signe de regarder ce qu’il va faire.
Cette tisane est destinée à la fille... C’est la duchesse qui l’a préparée... Ceci
Il montre le flacon.
est un antidote et un réactif, tout à la fois ; je vais en verser quelques gouttes dans ce breuvage ; s’il est inoffensif aucun changement ne se manifestera ; s’il est empoisonné, au contraire, tu le verras se décomposer et changer de couleur.
Le commandeur accomplit en même temps son opération.
LE DUC, avec éclat.
Miséricorde !...
LE COMMANDEUR.
Tu vois, le poison recommence !
LE DUC.
Mon Dieu !... mon Dieu !...
Il se jette sur une chaise et se voile le visage. Le commandeur sonne, atterré.
Que faire !... que devenir ?...
LE COMMANDEUR, donnant à un domestique qui entre la théière et la tasse.
Georges, porte ceci chez moi... enferme-le soigneusement dans ma chambre et que personne n’y puisse entrer... Tu m’as bien compris ?
LE DOMESTIQUE.
Oui, monsieur le commandeur.
LE DUC.
Suis-je donc condamné à la voir mourir... là... sous mes yeux ?...
LE COMMANDEUR.
Ah ! l’attaque est habile, et nos moyens de défense peuvent devenir insuffisants.
LE DUC.
Au nom du ciel, conseille-moi... Je ne puis pourtant pas la laisser tuer.
La duchesse entre.
Scène VI
LE COMMANDEUR, LE DUC, LA DUCHESSE
LA DUCHESSE.
Qu’ya-t-il ?
LE DUC, hors de lui-même.
Il y a, que je vous ai confié ma fille, que vous m’avez répondu d’elle ; il y a que je suis coupable de vous l’avoir confiée, que je suis un insensé d’avoir cru à vos promesses !...
LA DUCHESSE.
Mais expliquez-vous donc ?
LE DUC.
Tiens, parle-lui, toi ; dis-lui, ce qui se passe, le crime nouveau que tu viens de dévoiler à mes yeux...
LA DUCHESSE.
Le crime ?... Ah ! parlez !... Je veux tout savoir.
LE COMMANDEUR.
Eh bien, madame, je lui ai démontré l’art infernal avec lequel une main mystérieuse n’a pas cessé de distiller le poison à votre fille...
LA DUCHESSE.
Le poison !... encore !... toujours !... Il y a donc un démon sous ce toit maudit ?... Mais je ne la quitte jamais, ma fille... ses repas, ses boissons, c’est moi qui les lui prépare !... mes jours se passent à l’entourer de soins, mes nuits à veiller, à pleurer auprès d’elle... Que faut-il encore que je fasse ? Je suis à bout de forces et de moyens ! Comment lutter contre cette main invisible qui vous arrache le cœur, qui vous ravit votre enfant de vos bras.
LE DUC.
Eh bien !... les forces ne me feront pas défaut, à moi !... Les moyens ?... J’ai ai un tout trouvé... infaillible !...
LA DUCHESSE.
Lequel... dites... dites-le donc ?
LE DUC.
Entre cet ennemi et sa victime, je mettrai l’espace !... Je prends ma fille, je l’emmène, au loin... Que m’importent la France, l’Europe !... pourvu que je sauve mon enfant !... Et je la sauverai !... je la sauverai !...
LA DUCHESSE.
Oui... vous avez raison... l’éloignement... la fuite... je n’avais pas songé à cela ! moi... Parmi des inconnus, nous ne trouverons pas d’ennemis qui en veuillent à. sa vie... Notre monde à nous, c’est notre fille ! Notre bonheur ! notre vie, c’est la vie de Blanche !... Oui, oui !... il faut partir bien vite...
LE DUC
Je pars aujourd’hui même... je pars avec elle...
LA DUCHESSE.
Vous... partez !... Eh bien, et moi ?
LE DUC.
Je ne laisse ma fille à personne... m’avez-vous dit, il y a un mois !... Eh bien, je vous réponds à mon tour : Blanche n’aura plus d’autres soins que les miens ; je ne la quitte pas d’un instant, je veillerai sur sa vie et j’y veillerai seul.
LA DUCHESSE, au commandeur.
Seul !... seul !... est-ce vous... qui lui avez conseillé cela ?...
LE COMMANDEUR, ému.
Moi... madame... je...
LA DUCHESSE, au duc.
Vous voulez m’enlever ma fille ?... vous voulez me séparer d’elle !... Ah ! je vous en défie... Vous auriez l’audace de l’arracher de mes bras ?... Allons donc ! vous me tuerez plutôt !...
LE DUC.
Vous obéirez, madame, je le veux !...
LA DUCHESSE.
Je me croirais dénaturée, infâme si je vous obéissais !... D’ailleurs, où trouverais-je la force de vous obéir ?... je n’en ai que pour vous résister, mais celle-là, je la sens en moi invincible !... Ah ! on s’attaque à mon enfant... on veut la faire mourir !... Vous comprenez vous-même que pour la sauver il faut des miracles d’énergie et de tendresse, un oubli absolu de soi-même, des inspirations du ciel, que sais-je, moi !... Et vous croyez trouver cela autre part que dans le cœur d’une mère ?... Quelle que soit votre décision à l’égard de ma fille, la mienne est prise ; je ne la quitterai pas !...
LE DUC.
Il le faut, madame, il le faut !...
LA DUCHESSE, avec force et on pleurant.
Je ne la quitterai pas !...
LE DUC.
Ce soir, je serai loin d’ici avec ma fille !...
LA DUCHESSE.
Non, non ! je vous en supplie, je vous implore, ne me condamnez pas !... ne me brisez pas !... Ma fille est en danger, est-ce que je ne suis pas assez malheureuse ?
LE COMMANDEUR, au duc.
Armand !
LA DUCHESSE, au commandeur.
Tenez, vous qui nous écoutez... soyez mon juge... qu’ai-je fait pour qu’il me condamne ainsi ?... Dites-lui donc qu’il n’a pas le droit de me séparer de mon enfant ! dites-lui donc qu’il ne le fasse pas !
LE COMMANDEUR, hors de lui.
Eh bien, non ! non !... il ne le doit pas, il ne le fera pas !...
LE DUC.
Que dis-tu ?...
LE COMMANDEUR.
Je dis... qu’à présent que je l’ai entendue, je me croirais injuste, je me croirais coupable si je n’élevais pas la voix pour prendre sa défense ; je dis que tu ne lui arracheras pas son enfant !
LA DUCHESSE.
Ah ! c’est bien ! c’est bien !
LE DUC.
Qu’a-t-elle donc l’ait pour se justifier à tes yeux ?
LE COMMANDEUR.
Tu me demandes ce qu’elle a fait ?... Mais regarde-là donc, malheureux ! elle ne soupçonne même pas l’odieuse accusation que tu fais planer sur elle !...
LA DUCHESSE, étonnée.
L’odieuse accusation !...
Cherchant.
sur moi... sur...
Poussant un cri.
Ah !... ah !... il croit encore que c’est moi qui tue ma fille !
Scène VII
LE COMMANDEUR, LE DUC, LA DUCHESSE, BLANCHE
LE DUC.
Blanche !
LA DUCHESSE.
Blanche !... viens dans mes bras... viens ! viens !...
LE DUC, s’avançant.
Madame !...
LA DUCHESSE, serrant Blanche contre son sein.
Tu ne sais pas, mon enfant !... on veut que tu me quittes !... on veut nous séparer !...
BLANCHE.
Me séparer !... de toi, ma mère !...
LA DUCHESSE.
On dit que je ne t’aime pas, que je ne t’ai pas assez soignée... veillée !... ah ! si tu savais ce que l’on dit !...
D’une voix sourde.
Si tu savais ce que l’on pense !...
BLANCHE.
Que tu ne m’aimes pas ?... oh ! mais c’est un horrible blasphème !...
LA DUCHESSE.
Et celui qui le profère... le voici... c’est ton père !...
BLANCHE.
Mon père !... vous !... c’est vous qui voulez me séparer de ma mère ?... Mais pourquoi ? pourquoi ?
LE DUC.
Il le faut, Blanche, il le faut !...
LA DUCHESSE.
Vois-tu... tu as été malade... très dangereusement malade, ma pauvre chère enfant, mais maintenant, c’est passé... il n’y a plus de danger. Eh bien !... ton père croit...
LE DUC, l’interrompant.
Madame ! par pitié pour cette enfant...
LA DUCHESSE, continuant.
Il croit... que la cause de ta maladie... que la cause du danger qui avait menacé tes jours... il croit que... c’est... que c’est ta mère !... que c’est moi !...
BLANCHE, elle se jette a son cou et l’embrasse avec transport.
Tiens !... tiens !... voici ma réponse !...
LA DUCHESSE.
Oh ! ma fille !... ma fille bien-aimée !...
LE DUC.
Blanche !
BLANCHE.
Mon père !... je me traînerai à vos pieds... j’y mourrai plutôt... mais vous ne me prendrez pas ma mère !...
LE DUC.
Blanche, tu me brises le cœur... Tu m’accuses d’être injuste, cruel, mais c’est pour te sauver que je veux t’emmener loin d’ici ! Va ! tu ne soupçonnes pas à quel point je suis malheureux. ! Tu ne sais pas à quels horribles combats, à quels déchirements mon âme est livrée... mais je donnerais ma vie, entends-tu, oui, ma vie tout entière, pour être convaincu que je puis, sans danger, te confier à l’amour de la mère. Mon Dieu ! vous le savez, une fois déjà, je me suis laissé convaincre par ses serments, je me suis laissé toucher par ses larmes, à elle, mais aujourd’hui l’horrible menace se dresse de nouveau, comment puis-je la combattre autrement que par la fuite ?... Que faut-il que je fasse ?... je ne sais plus, je ne sais plus !...
Il sanglote.
BLANCHE.
Mon père, il faut nous laisser l’une à l’autre... Ah ! vous ne la connaissez pas, ma mère ! vous n’avez pas, comme elle, depuis mon berceau, veillé sur moi des nuits entières !... vous n’avez pas passé votre vie à deviner mes pensées, à satisfaire mes moindres désirs, à pleurer quand j’étais souffrante, à chercher votre bonheur dans mes plus petites joies !... C’est elle qui m’a appris ma première prière !... et vous exigez que je m’en sépare ?... Oh ! c’est impossible... vous ne voulez pas me faire mourir... et je ne vivrai qu’à côté de ma mère !...
LA DUCHESSE.
Merci, Blanche !... je n’ai jamais souffert !... je ne me rappelle plus aucune peine, aucune douleur !... Un moment comme celui-ci, des paroles comme les tiennes... embrassent une éternité de bonheur !... Monsieur le duc, reprenez votre fille !... la voilà libre !... emmenez-la !... son cœur reste avec moi ; vous ne nous aurez pas séparées...
Scène VIII
LE COMMANDEUR, LE DUC, LA DUCHESSE, BLANCHE, JEANNE
JEANNE, troublée.
Mon père !... il y a au salon des hommes vêtus de noir... Le lieutenant-criminel... demande à vous parler... tenez !...
Elle lui remet un papier.
LE DUC, lui montrant du regard Blanche.
Silence !...
LA DUCHESSE, s’approchant vivement du duc, tandis que Jeanne passe auprès de Blanche.
Que se passe-t-il ?
LE DUC, à la duchesse.
Le docteur Didier, que nous avions appelé en consultation, a fait son rapport à la justice... La voici qui arrive et nous mande devant elle...
LA DUCHESSE, avec joie et bas au duc.
La justice !... tant mieux ! elle saura découvrir le coupable, elle...
LE DUC, à part.
Pas un signe de trouble, pas un indice d’émotion sur son visage.
LA DUCHESSE, à Blanche.
Blanche, le ciel envoie à notre aide, et nous te quittons pour un instant... À tout à l’heure, Blanche, à tout à l’heure.
BLANCHE.
Tu reviendras, bientôt... n’est-ce pas ?
LA DUCHESSE.
Oui, oui, bientôt, bientôt !...
Au duc avec, dignité.
Venez, monsieur le duc... venez !...
LE DUC.
Allons, madame.
Sortie du duc et de la duchesse.
Scène IX
LE COMMANDEUR, BLANCHE, JEANNE
BLANCHE.
Les voilà partis !... oh ! je puis vous dire maintenant à quel point je me sens faible... Ce cruel débat m’a brisée ; j’ai cru que j’allais perdre connaissance.
LE COMMANDEUR.
Il vous faut du repos. Venez là, sur ce canapé.
JEANNE, soulevant Blanche d’un côté tandis que le commandeur la soutient de l’autre.
Oui, viens, Blanche !
Ils l’aident à se coucher sur le canapé.
BLANCHE.
Ah ! je suis mieux ainsi !... Mais d’où venait donc à mon père cette idée de départ, de voyage, de séparation ?... Le savez-vous, commandeur ?
LE COMMANDEUR.
Votre santé préoccupe très vivement votre père. L’idée lui est venue de vous faire changer de climat... de vous emmener au loin... Ce projet n’aura pas de suites, je l’espère !
BLANCHE.
À la bonne heure ! Je ne veux quitter ni ma mère, ni Jeanne.
JEANNE.
Nous séparer... jamais !
BLANCHE.
Tu es si bonne, ma petite sœur !... Quand, en me réveillant je retrouve devant mes yeux ton visage souriant, il me semble que c’est un rayon de soleil qui entre chez moi...
Pause.
Je suis bien fatiguée et bien faible...
LE COMMANDEUR.
Essayez de dormir un peu...
BLANCHE.
Oui... oui... voilà... mes yeux... qui se ferment... mon Dieu !... prenez-moi en votre sainte garde !
Elle s’endort.
LE COMMANDEUR, marchant sur la pointe du pied.
La nuit est venue, je vais appeler pour demander une veilleuse.
JEANNE, de même.
Non ; laissons-la dormir !
LE COMMANDEUR, de même.
Soit !... j’obéis.
Scène X
LE COMMANDEUR, BLANCHE, JEANNE, GERMAINE
GERMAINE, entr’ouvrant la porte.
Mademoiselle !...
LE COMMANDEUR.
Qui est là ?...
JEANNE.
C’est toi, Germaine ? parle bas ! ma sœur dort.
GERMAINE.
Ah ! monsieur le commandeur.
LE COMMANDEUR.
Que me voulez-vous ?
GERMAINE.
Ces messieurs qui viennent d’arriver, demandent tout le monde. M. le duc vous envoie chercher, vous et mademoiselle Jeanne.
LE COMMANDEUR.
C’est bon ! nous y allons... venez-vous, ma cousine ?
Germaine sort.
JEANNE.
Non... j’attendrai que la duchesse vienne me remplacer... Blanche n’aurait qu’à se réveiller...
LE COMMANDEUR.
Vous avez raison ; on vous fera prévenir en temps opportun...
Il sort.
Scène XI
JEANNE, BLANCHE endormie, puis LA DOUAIRIÈRE
JEANNE, elle se dirige sur la pointe des pieds vers Blanche, l’observe une minute, puis descend la scène.
Pauvre cher ange ! son visage a pris tout à coup un air sombre et triste, comme si elle était sous l’obsession d’un pénible rêve !... Elle souffre peut-être même dans son sommeil...
Elle passe au fond de la scène, à droite, en face le canapé de Blanche et s’agenouille.
Mon Dieu ! ayez pitié d’elle !... Protégez-la contre les tentatives du crime ; accordez-lui tout le bonheur pour lequel vous semblez l’avoir créée, et qu’elle mérite si bien ! Si des chagrins doivent fondre sur notre maison, réservez-les pour moi, Seigneur !... la mort ne m’effraye pas ! J’ai, là-haut, ma mère qui m’attend !...
Elle s’absorbe dans sa prière. En ce moment, au fond, en face du canapé, une porte secrète s’ouvre. La douairière paraît. Elle s’arrête un instant, examine le lit et le canapé, voit Blanche endormie, se penche au-dessus d’elle, puis apercevant sur le guéridon le verre rempli d’eau, elle y verse le contenu d’une fiole. Ici, Jeanne lève la tête, un rayon de lune glisse a travers la fenêtre et éclaire l’action de la douairière. Jeanne se dresse en sursaut, elle reconnaît sa grand’mère et se rend compte de son action ; elle voudrait crier, elle voudrait courir, mais la voix et les forces lui manquent à la fois. Elle ne les recouvre que lorsque la porte vient de se refermer sur la douairière.
JEANNE, comme égarée.
Ah !... elle !... cet ennemi qui lui versait du poison !... c’était...
BLANCHE, se réveillant.
Ma mère !... Jeanne !... à boire !...
Elle tend le bras vers le guéridon, mais Jeanne se précipite vers elle, enlève le verre et le jette.
JEANNE, d’une voix étranglée.
Non, non !... Blanche !... Ah !... mon Dieu !... mon Dieu !...
Elle tombe agenouillée auprès du lit de Blanche.
ACTE V
Un côté du parc. Un pavillon à larges fenêtres masquées par des stores.
Scène première
JEANNE, seule, assise sur le devant de la scène, et se tenant la tête dans les mains
Ce que j’ai vu n’est-il pas un songe ? Un crime aussi épouvantable !... Non, non, c’est impossible !... je me suis trompée, ce n’était pas elle !... Que faut-il que je fasse ? je ne peux pas la dénoncer !
Pleurant.
Mais je ne peux pas non plus laisser tuer ma sœur !...
Scène II
BLANCHE et JEANNE
BLANCHE, entrant sur les dernières paroles et prenant la tête de Jeanne qu’elle embrasse.
Bonjour, petite sœur.
JEANNE.
Toi !... déjà levée ?
BLANCHE.
Oui, je me suis Sentie beaucoup mieux ce matin... Il y a déjà longtemps que je suis levée.
JEANNE.
Ah !... et qui as-tu vu ? Es-tu entrée chez... ta mère ?
BLANCHE.
Oui.
JEANNE.
Et chez... chez... la marquise ?
BLANCHE.
Non. Après ma mère, la première personne que je veux voir, c’est toi, toujours toi.
JEANNE.
Merci... ma Blanche. Assieds-toi là... j’ai à te parler.
BLANCHE, s’asseyant.
Je vous écoute, mademoiselle.
JEANNE.
Blanche... tu crois à ma tendresse pour toi, n’est-ce pas ?
BLANCHE.
Si j’y crois !... c’est mal de me le demander.
JEANNE.
Eh bien !... si j’avais dans l’esprit une pensée... qui m’obsédât sans relâche ! si j’avais, dans le cœur, un pressentiment que rien ne pût combattre... si je croyais avoir trouvé le moyen de te sauver... tout à fait, de te conserver à l’amour de ta mère et de Gaston... ferais-tu ce que je te demanderais ?
BLANCHE.
Si cela dépendait de moi, je le ferais.
JEANNE.
Tu me le promets... tu me le jures ?
BLANCHE.
De grand cœur.
JEANNE.
Eh bien !... il faut que tu partes d’ici...
BLANCHE, étonnée.
Que je parte !... Toi aussi, tu veux... ?
JEANNE.
Oui, il faut que tu quittes le château aujourd’hui, à l’instant même !... Pars, ma Blanche chérie, ne perds pas une minute !... pars !... je t’en supplie !...
BLANCHE.
Comme tu médis cela !... Pourquoi cette précipitation ?... Qu’y a-t-il ?
JEANNE.
Ne me demande rien... je ne peux pas... je n’ai rien à te répondre !... c’est un pressentiment... qui m’est venu... je ne sais d’où... mais enfin, j’y crois... et situ veux le suivre, il te portera bonheur... il te sauvera, Blanche, il te sauvera !
BLANCHE.
Mais comment veux-tu que je décide cela toute seule ? quand hier encore, je luttais contre la volonté de mon père qui voulait, comme toi, me faire partir ?
JEANNE.
Tu diras que tu as changé d’avis, que tu ne veux pas rester une heure de plus dans ce château, que l’air de ce pays le sera fatal ; que tu sens qu’ailleurs tu te rétabliras en peu de jours ; enfin, insiste sur ce départ, exige-le !... Quand bien même ils croiraient que ce n’est qu’un caprice de ta part, ils t’aiment tant qu’ils seront trop heureux de le satisfaire...
BLANCHE.
Je veux bien, mais à une condition. Tu me connais, je suis curieuse... Est-ce un rêve que tu as fait ?...
JEANNE.
Un rêve !... oh ! non ! je n’ai rien rêvé !... j’étais éveillée comme maintenant... je te voyais comme je te vois, quand l’idée m’est venue de te faire partir, sans délai ! Et tu partiras... ô ma sœur chérie !... tu partiras, n’est-ce pas ?... Promets-le moi... jure-le... Il le faut !...
Entrée de la duchesse et du commandeur qui s’arrêtent un instant au fond et écoutent les dernières paroles de Jeanne.
Scène III
BLANCHE, JEANNE, LE COMMANDEUR, LA DUCHESSE
LA DUCHESSE, à Jeanne vivement.
Vous demandez à Blanche de partir... Est-ce votre père qui vous a chargée de le faire ?
JEANNE, troublée.
Non, madame, non ! c’est de mon propre mouvement que j’engageais Blanche à vous prier de l’emmener loin d’ici...
LE COMMANDEUR.
Ah ça, cousine, vous allez donc sur mes brisées ?... vous faites aussi de la médecine ?...
BLANCHE.
Oui, Jeanne assure qu’un déplacement me ferait grand bien...
JEANNE, vivement.
Il te sauverait !...
La duchesse et le commandeur se regardent avec étonnement. Jeanne se reprend.
Il te rendrait la santé, voulais-je dire, il te ferait perdre jusqu’au souvenir de ce que tu as souffert...
LA DUCHESSE.
Mais comment cette idée de faire partir Blanche vous est-elle venue ?
LE COMMANDEUR.
L’idée de faire changer d’air à un convalescent est très simple, et...
Avec intention.
et nous pourrons y songer... dans quelques jours.
JEANNE.
Dans quelques jours ! Pourquoi attendre ! pourquoi différer ce départ ?...
LA DUCHESSE.
Quel motif aurions-nous de le hâter à ce point ? Votre père ne peut, en ce moment, s’éloigner du château.
JEANNE.
Eh bien !... partez avec elle, vous, madame la duchesse ; partez, sans perdre un jour, une heure, une minute !...
Au commandeur.
Mais dites-lui donc de partir... joignez vos prières aux miennes ! Et toi, ma sœur... n’oublie pas que tu me l’as promis, que tu me l’as juré... Rester ici !... non ! non ! jamais ! à aucune condition !... n’est-ce pas, Blanche ?...
LE COMMANDEUR.
Pardon, cousine, je pense, moi, qu’il conviendrait d’attendre...
JEANNE.
Attendre !...
LE COMMANDEUR.
Parce que, dans quelques jours, votre sœur sera plus forte.
JEANNE, très vivement.
Et moi je vous dis qu’elle sera m...
LA DUCHESSE.
Jeanne !...
Bas au commandeur.
Elle connaît le coupable... Emmenez Blanche, emmenez-la !
LE COMMANDEUR.
Venez, cousine ; je ne vous ai permis de quitter votre chambre que pour faire un tour de promenade. Il est temps de rentrer, et, si vous devez partir, il faut prendre des forces avant de vous mettre en route.
Il lui offre son bras.
LA DUCHESSE, à elle-même.
Ah ! je vais donc la savoir cette horrible vérité !...
BLANCHE.
À tout à l’heure, ma mère !...
LA DUCHESSE.
Va, mon enfant, va !...
Bas à Jeanne.
Reste !
Sortie du commandeur et de Blanche.
Scène IV
LA DUCHESSE, JEANNE
LA DUCHESSE.
Jeanne, tu connais la cause de la maladie de la sœur ?...
JEANNE.
Oui, le poison.
LA DUCHESSE.
Ce n’est pas tout. La main criminelle qui porte ici la mort, tu la connais ?
JEANNE, avec terreur.
Moi !...
LA DUCHESSE.
Tu la connais !... nomme-moi l’assassin !...
JEANNE.
Vous vous trompez, madame, je ne puis nommer personne !
LA DUCHESSE.
Ce n’est qu’un indice, peut-être, que t’a fait rencontrer le hasard... Tu n’as que des soupçons ?... N’importe, dis-nous ta pensée, jette un rayon de lumière au milieu de ces ténèbres qui nous entourent ; si faible qu’il soit, il nous suffira peut-être pour nous guider !... un mot, Jeanne !... un seul mot !...
JEANNE.
Mais si je pouvais vous le dire, vous le sauriez déjà, madame !...
LA DUCHESSE.
Prends garde, enfant !... sais-tu qu’il y a des moments ou le silence devient criminel ? sais-tu qu’il y a des secrets qui brûlent, qui déshonorent la conscience qui les garde, des secrets que Dieu réprouve, et qu’il punit ?...
JEANNE.
Je me remets entre les mains de Dieu ; dussé-je être malheureuse, je bénirai sa justice !
LA DUCHESSE.
Mais on a voulu tuer ma fille, on a voulu tuer Blanche, la tentative peut se renouveler... ici... ou ailleurs, que sais-je, moi ? comment la prévenir, comment la détourner, si nous ne parvenons pas à découvrir d’où vient le danger ?... Ce que je te demande, c’est le salut de ta sœur !... Tu ne veux pas qu’on la fasse mourir, n’est-ce pas ?
JEANNE.
Emmenez-la, madame, je vous l’ai déjà dit, partez avec elle, et elle sera sauvée... oui !... elle sera sauvée... je vous le jure sur mon âme, je vous le jure sur Dieu, je vous le jure sur sa vie à elle !...
LA DUCHESSE.
Écoute-moi, Jeanne ! j’ai pris la place de ta mère, mais le ciel m’est témoin, que je n’ai pas été pour toi une marâtre !... je ne t’ai jamais fait de mal ; je tâchais de l’aimer comme mon propre enfant ! je cherchais toutes les occasions de le rendre heureuse, et quand j’y réussissais, ce n’était pas pour te faire oublier celle que tu avais perdue, mais pour te donner à penser que tu avais deux mères qui veillaient sur toi, l’une là-haut, l’autre à tes côtés...
JEANNE, avec effusion.
C’est vrai, madame, vous avez été bonne, et votre tendresse n’est pas tombée sur un cœur ingrat, car je vous aime de toute mon âme.
LA DUCHESSE.
Tu m’aimes !... Eh bien !... si je te disais que tu peux me sauver plus que la vie... si je te disais que tu peux me sauver l’honneur !
JEANNE.
Madame !... je ne comprends pas !...
LA DUCHESSE.
Jeanne... sais-tu sur qui on fait planer le plus odieux soupçon, sais-tu qui l’on accuse du crime abominable ?
JEANNE, vivement.
Qui, cela ?... madame, qui ?...
LA DUCHESSE, avec éclat.
Moi !...
JEANNE.
Vous !...
LA DUCHESSE.
Entends-tu !... c’est moi que l’on accuse d’attenter à la vie de mon enfant !...
JEANNE.
Ah ! mon Dieu !
LA DUCHESSE, continuant.
Comprends-tu ce qui se passe dans mon âme !... ce soupçon affreux, cette accusation monstrueuse ! j’en ai subi l’outragé... j’en ai souffert la torture !... on m’a jugée indigne de veiller sur ma fille... On veut me séparer d’elle de crainte que je ne la tue !... C’est en vain que je me débats sous la douleur qui m’accable ; le seul moyen de faire éclater mon innocence, serait de découvrir le coupable... et ce moyen, c’est toi qui en disposes... et cette branche de salut, c’est toi seule qui peut me la tendre ! Voyons, Jeanne, voyons, parleras-tu, maintenant ?
JEANNE, émue.
Madame !... je puis donner ma vie, et je la donnerais avec bonheur pour prouver que vous êtes un ange de bonté, de tendresse, de dévouement. Je me placerai entre vous et vos accusateurs, et je leur crierai, du fond de mon âme, que vous êtes innocente, que je le sais, que j’en ai la conviction, la preuve, et je le jurerai !... voilà tout ce que je puis faire et ce que je ferai, madame ; mais par grâce, par pitié ! ne me demandez rien de plus !...
LA DUCHESSE.
Ah ! elle reste insensible âmes larmes ! Mais que lui ai-je donc fait pour qu’elle veuille me laisser mourir de douleur et de honte, quand elle sait que, d’un mot, elle peut nous sauver tous !...
Scène V
LA DUCHESSE, JEANNE, LE DUC
LA DUCHESSE, vivement au duc.
Ah ! monsieur le duc, ne cherchez plus l’assassin de Blanche !... Votre fille le connaît...
LE DUC.
Jeanne !...
JEANNE.
Que dites-vous ?
LA DUCHESSE.
Interrogez-la... Ordonnez ou priez... par obéissance ou par affection, il faudra bien qu’elle parle.
LE DUC.
Tu connais le criminel... toi !...
JEANNE.
Mon père, j’ai supplié madame la duchesse de quitter avec Blanche ce château à l’instant même, parce que je crois que c’est le seul moyen de sauver ma sœur, voilà tout ce que j’ai dit.
LA DUCHESSE.
Non, non ! ce n’est pas tout !... Lorsqu’emportée par mon désespoir je lui ai avoué les soupçons que l’on avait la cruauté de faire peser sur moi, elle m’a répondu qu’elle jurerait de mon innocence, et qu’elle en avait la preuve.
LE DUC, à Jeanne.
Tu l’as dit ?... et c’est la vérité... Réponds !...
JEANNE.
Oui, je jure que madame la duchesse est innocente !...
LE DUC.
Tu connais alors le vrai coupable !... Qui t’empêche de le désigner ?... Pour garder le secret du crime, pour laisser le soupçon peser sur les innocents, sais-tu ce qu’il faut être soi-même ?
JEANNE.
Je le sais ; il faut être complice du criminel. M’en croyez-vous capable ?... Répondez à votre tour, mon père !
LE DUC, avec éclat.
Assez !... c’est moi qui interroge !... Connais-tu le coupable ?...
LA DUCHESSE.
Elle le connaît... je vous dis qu’elle le connaît ! Regardera bien !...
JEANNE.
Je n’ai rien à ajouter à mes paroles...
LE DUC.
Jeanne, mon enfant... je n’ai pas le cœur de te parler avec la sévère autorité d’un juge... j’ai tellement souffert, depuis quelques jours que tu devrais avoir pitié de moi...
Il la prend dans ses bras.
Voyons, si moi, ton père... je t’implorais de nous dire la vérité, de faire cesser cet enfer qui nous tue tous... aurais-tu le courage, aurais-tu la force de me refuser !... dis !... Réponds !... ma fille chérie !...
Il l’embrasse.
JEANNE, sanglotant.
Je ne sais rien, mon père, je ne sais rien !...
LE DUC.
Tu ne sais rien ?... Jure le donc sur la mémoire de ta mère !...
JEANNE.
Oh ! mon père !... pitié !...
LE DUC.
Jure-le !... sur la tombe de ta mère !...
JEANNE.
Non !... non !... j’aimerais mieux...
LE DUC.
Parle donc, alors !...
LA DUCHESSE.
Oui, Jeanne... parle !... parle !...
JEANNE, sanglotant.
Eh bien !...
En ce moment les rideaux du pavillon s’écartent en face du public, et Jeanne seule aperçoit la douairière assise dans son fauteuil ; à part.
Ah !... Elle !
LE DUC.
Parle, j’attends !...
JEANNE, les yeux tournés vers le pavillon.
Mon père, vous pouvez me tuer, mais je n’ai plus rien à dire...
LE DUC.
Soit ! fais ta volonté ; d’autres feront leur devoir, j’emmènerai ma fille.
JEANNE, avec joie.
Ah !
LE DUC.
Mais il y a quelqu’un ici qui n’aura ni les ménagements ni la tendresse d’un père... c’est le magistrat lui-même qui t’interrogera tout à l’heure...
À la duchesse.
Venez, madame, venez !...
LA DUCHESSE, s’approchant de Jeanne qui demeura immobile le regard fixé sur la douairière.
Jeanne, ma seconde fille bien-aimée, je ne désespère pas encore de toi ; tu réfléchiras, mon enfant ; c’est ma vie, c’est la vie de la sœur, que je mets dans tes mains... tu réfléchiras. Jeanne... et tu nous sauveras... oui, oui, tu nous sauveras.
Elle l’embrasse.
Scène VI
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE
JEANNE.
Mon Dieu ! ne m’abandonnez pas !... inspirez-moi !... soyez mon conseil et mon appui, car je me sens a bout de mes forces !...
On fait entrer en scène la douairière dans son fauteuil.
GERMAINE.
Madame la marquise veut-elle boire ?
LA DOUAIRIÈRE.
Non, je n’ai besoin de rien ! Qui donc est là ?
GERMAINE.
C’est mademoiselle Jeanne ; madame la marquise n’a plus d’ordres à me donner ?
LA DOUAIRIÈRE.
Non ! merci !
Germaine et les domestiques sortent.
Tu étais donc là, Jeanne ? Comment se fait-il que je ne t’aie pas encore vue ?... Viens !...
Mouvement d’hésitation de Jeanne.
Approche ! Mais qu’as-tu donc ?... je te trouve bien pâle... Tu auras encore veillé près de ta sœur...
JEANNE.
C’est peut-être la dernière nuit que j’aurai passé près d’elle...
LA DOUAIRIÈRE, vivement.
La dernière !...
JEANNE.
Oui !... puisque aujourd’hui même elle quitte le château.
LA DOUAIRIÈRE.
Aujourd’hui !... ah !... est-ce décidé ?...
JEANNE.
C’est... décidé.
LA DOUAIRIÈRE.
Elle va donc mieux... la fille... de madame la duchesse ?
JEANNE.
Beaucoup mieux... et je crois... que c’est... grâce à moi !...
LA DOUAIRIÈRE.
Comment cela ?
JEANNE.
Je me suis méfiée... de la science du commandeur... j’ai cru remarquer que la boisson qu’elle prenait, chaque soir, la rendait... le lendemain plus souffrante et plus faible...
LA DOUAIRIÈRE.
Ah !
JEANNE.
Cette nuit, j’ai remplacé sa tisane par de l’eau pure.
LA DOUAIRIÈRE, vivement.
Tu as fait cela, toi ?
JEANNE.
Et ma sœur est, aujourd’hui, bien mieux qu’hier.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah !... elle... est mieux...
JEANNE, l’observant.
Peut-être ai-je moins de mérite que je ne le pense... car... la boisson que prenait Blanche n’était pas mauvaise.
LA DOUAIRIÈRE, avec un cri.
Tu en as bu ?
JEANNE.
Moi ?...
LA DOUAIRIÈRE.
Tu en as bu ? Réponds !...
JEANNE.
Pourquoi cela, grand’mère ?...
LA DOUAIRIÈRE.
Mais réponds donc !...
JEANNE, froidement.
Non !...
LA DOUAIRIÈRE, à elle-même.
C’est bien.
JEANNE, à part.
C’était elle !
LA DOUAIRIÈRE.
Ainsi, elle va tout à fait bien ?
JEANNE.
Tout à fait !... S’il lui était arrivé malheur, j’en serais morte de chagrin...
LA DOUAIRIÈRE.
Oui ! oui ! La mort de Blanche eût été un grand malheur que j’aurais déploré moi-même, bien que ce malheur eût fait de toi l’unique héritière du nom et du titre de la maison, tandis que tu n’es maintenant qu’une orpheline dont personne n’aura pitié quand je ne serai plus là.
JEANNE, à part.
Oh !... c’est pour moi qu’elle n’a pas reculé devant un Crime !...
Elle s’éloigne de la douairière.
LA DOUAIRIÈRE.
Qu’est-ce donc ?
On entend rouler une voiture.
JEANNE.
Une voiture, celle qui doit emmener Blanche, sans doute.
LA DOUAIRIÈRE, à part.
Déjà ! j’aurais donc commis un crime inutile !...
JEANNE, à part.
Elle part... Et je vais rester seule, en face de mes cruels souvenirs... mais du moins Blanche vivra.
LA DOUAIRIÈRE, haut.
Va-t-elle s’éloigner sans nous faire ses adieux ?... Le sais-tu, Jeanne ?...
JEANNE, la regardant en face.
Vous... désirez donc... lavoir ?
LA DOUAIRIÈRE.
Pourquoi non ?...
JEANNE.
Ah !... Blanche !...
Avec effroi.
Elle vient !
LA DOUAIRIÈRE.
Elle vient !...
À part.
Est-ce une dernière chance que m’envoie le destin ?...
Haut.
Vas au-devant d’elle, Jeanne...
JEANNE.
Moi ! que je...
LA DOUAIRIÈRE.
Oui, amène-là ici... Va... va donc...
JEANNE, très émue.
Oui... oui... j’y vais... je...
Elle s’éloigne lentement.
LA DOUAIRIÈRE.
Cette fois, si ce n’est pas pour elle, ce sera la mort pour moi !
Elle verse dans un verre le contenu d’un flacon ; sa main qui tremble fait tinter la fiole contre le verre ; à ce bruit, Jeanne, qui est arrivée au fond du théâtre, se retourne vivement et voit, avec terreur, le mouvement de la douairière.
JEANNE, redescendant vivement.
Grand’mère !...
LA DOUAIRIÈRE, froidement.
Quoi donc ?
JEANNE, les yeux fixés sur le verre.
C’est... c’est ma sœur... la voilà... Elle vient...
Pendant tout ce qui suit, Jeanne demeure les regards fixés sur le verre.
Scène VII
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, BLANCHE et GASTON
BLANCHE.
Nous allons nous séparer, Jeanne, mais ce n’est pas pour longtemps ; tu nous rejoindras.
GASTON.
Oui, nous venons, en présentant nos adieux à madame la marquise, la supplier de vous permettre de venir nous rejoindre bientôt.
LA DOUAIRIÈRE.
Vous rejoindre ?
BLANCHE.
Je serai bien malheureuse, madame, si vous lui défendiez d’assister à mon mariage.
LA DOUAIRIÈRE.
Ah ! vous voulez qu’elle vous serve de demoiselle d’honneur, qu’elle vous pare elle-même de cette couronne de mariée qui vous donnera tout, à vous, l’amour, le bonheur, la richesse !... vous voulez que ce soit elle...
BLANCHE.
Oh ! ne me refusez pas, madame ; si vous saviez combien ce refus me rendrait malheureuse, combien je souffre déjà à la pensée de me séparer d’elle...
JEANNE.
Blanche ! ma sœur !
LA DOUAIRIÈRE.
La pauvre enfant !... la voilà, en effet, toute émue, toute tremblante...
BLANCHE, souriant tristement.
C’est que je ne suis pas encore bien forte, madame !... on dit que j’ai été tout près de mourir, et le moindre chagrin suffit pour m’abattre. Tenez, dans ce moment, je me sens plus faible que de coutume.
LA DOUAIRIÈRE.
Allons, remettez-vous... voyons...
Lui désignant le verre.
prenez cela !... Jeanne sera libre d’agir comme il lui plaira !
BLANCHE.
Soyez bénie, madame !...
Elle s’approche du guéridon ; Jeanne s’en approche vivement aussi ; Blanche tendant la main pour prendre le verre.
Tu as entendu, petite sœur ?
JEANNE.
Oui, j’ai bien entendu...
Elle met la main sur le verre.
et j’ai bien compris !
La douairière la regarde avec étonnement.
Scène VIII
JEANNE, LA DOUAIRIÈRE, BLANCHE, GASTON, LE DUC, LA DUCHESSE, LE COMMANDEUR, TROIS MAGISTRATS
LE DUC.
Jeanne, voici les magistrats. Il faut parler maintenant.
LA DUCHESSE.
Oui, Jeanne, il faut nommer le coupable !
JEANNE, à part.
Le nommer !
LA DOUAIRIÈRE.
Le coupable !... est-ce que tu le connais ?
JEANNE.
Non, je ne le connais pas ; je ne sais rien, je n’ai qu’une pensée, qu’un souvenir... c’est que vous m’avez toujours bien aimée... trop aimée, grand’mère, et, c’est à vous que je bois !
Elle vide le verre.
LA DOUAIRIÈRE, poussant un cri et se dressant debout pour lui arracher le verre.
Ah ! malheureuse ! malheureuse !...
LE DUC.
Qu’est-ce donc ? que vois-je ?
LA DUCHESSE.
Madame !
LE COMMANDEUR.
Madame la marquise !...
LA DOUAIRIÈRE.
Ne songez qu’à elle seule ; elle est perdue ; elle se meurt !
LE DUC, la prenant dans ses bras.
Ma fille !...
LA DUCHESSE.
Jeanne ! se meurt !...
LE COMMANDEUR, avec force.
Mais expliquez-vous donc, madame !...
LA DOUAIRIÈRE.
Je vous dis qu’elle est perdue !
Montrant le verre.
La mort que je destinais à l’étrangère, c’est Jeanne que j’en aurai frappée !
LA DUCHESSE, prenant Blanche dans ses bras.
Ah ! c’est elle !... elle qui me tuait ma fille !
LE DUC.
Jeanne !... Est-ce que je vais la perdre, mon Dieu ?...
LE COMMANDEUR, qui a examiné le verre.
Non ! non !... ah ! l’ennemi que j’ai vingt fois combattu !... Jeanne, sur ma vie, je vous sauverai !
TOUS, avec joie.
Ah !...
LA DOUAIRIÈRE, relevant la tête.
La sauver... elle vivra... elle vivra... elle... et moi... ah ! Dieu est juste !
Elle retombe.
LA DUCHESSE, avec un cri.
Ah !...
Le commandeur est allé se placer auprès delà douairière, le duc qui s’est approché de lui et l’a interrogé du regard, se tourne vers les magistrats.
LE DUC.
Messieurs, la justice des hommes n’a plus rien à faire quand la justice divine a accompli son œuvre !
Les magistrats s’inclinent.