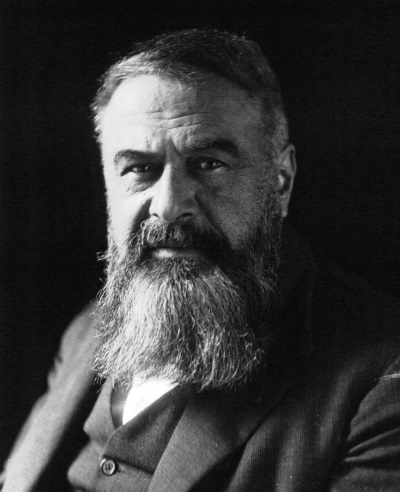Le Petit café (Tristan BERNARD)
Comédie en trois actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du Palais-Royal, le 12 octobre 1911.
Personnages
PHILIBERT
ALBERT
VEAUCHENU
BIGREDON
LE GÉNÉRAL DE KERKOADEC
LE PLONGEUR
PLOUVIER
XAVIER
LE JOURNALISTE
GASTONNET
PÉZARD
ARTHUR
LE FACTEUR
LE GÉRANT
L’HUISSIER
BOUZIN
UN GARÇON
LE SOMMELIER
JABERT
BÉRENGÈRE D’AQUITAINE
EDWIGE
ISABELLE
LA CAISSIÈRE
JACQUELINE
AGATHE
IRMA
AMÉLIE
UNE DAME
UNE AUTRE DAME
L’HABILLEUSE
UN SERGENT DE VILLE
PREMIER CLIENT
DEUXIÈME CLIENT
TROISIÈME CLIENT
QUATRIÈME CLIENT
QUINZE CONSOMMATEURS, hommes et femmes
CHANTEUSES HONGROISES
ACTE I
La scène représente un petit café de modeste apparence. À droite, tout au premier plan, une porte donnant sur la cuisine et les dépendances du café. À droite, toujours, un peu plus haut que cette porte, un comptoir où est installée une jeune femme. Le café fait le coin de la rue. Le fond de la scène et le côté gauche sont censés donner sur la rue. À gauche, au fond, en pan coupé, l’entrée du café, assez spacieuse. Une autre petite porte donnant accès dans le café se trouve au fond à droite.
Scène première
VEAUCHENU, un très vieux monsieur de quatre-vingts ans environ, LA CAISSIÈRE
Au lever du rideau, une quinzaine de consommateurs sont en train de jouer aux cartes, aux dominos, aux dames, aux échecs. On entend des mots tels que : « Domino ! » « Je vous souffle ! » « J’en demande ! » « Il faut jouer ça ! » « Le roi ! » Une jeune femme assise à la caisse cause avec le vieux monsieur. Quelques instants après le lever du rideau, elle frappe sur un timbre, et tous les consommateurs se lèvent et sortent en courant.
VEAUCHENU.
Qu’est-ce qu’ils ont donc à se sauver comme ça ?
LA CAISSIÈRE.
Ce sont les employés des grands magasins « À la Porte des Ternes », vous savez, près du bureau des omnibus. Ils reprennent leur travail à deux heures. Alors c’est convenu que je dois les prévenir avec un coup de timbre, trois minutes avant : comme ça ils peuvent jouer jusqu’à la dernière minute.
VEAUCHENU.
Et alors, ils se lèvent au milieu de la partie ?
LA CAISSIÈRE.
Oui, oui, c’est une convention. À partir du coup de timbre, les parties ne comptent plus. Il y en a même qui en profitent : quand ils sentent qu’ils sont pour perdre, eh bien, ils trainent, ils traînent jusqu’à tant que le coup de timbre arrive à sonner.
VEAUCHENU.
Ça doit faire des disputes, ça ?
LA CAISSIÈRE.
Non, non, c’est pour l’un comme pour l’autre, n’est-ce pas ? Ça fait partie du jeu.
VEAUCHENU.
Ils ont l’air plutôt agréable, ces jeunes gens. Ils vous font bien un peu la cour ?
LA CAISSIÈRE.
Pensez-vous ? Ils aiment mieux jouer aux cartes ou aux dominos...
VEAUCHENU.
Ah ! les jeunes gens d’aujourd’hui ne sont pas à la hauteur.
LA CAISSIÈRE.
Et les vieux messieurs n’y sont plus... Je ne dis pas ça pour vous, monsieur Veauchenu...
VEAUCHENU.
Ah ! dame ! Vous pourriez presque le dire : je commence à n’être plus de la première jeunesse, en tout cas...
Un silence.
Ça ne vous fatigue pas de rester comme ça toute la journée à votre caisse ?
LA CAISSIÈRE.
Oh ! je ne reste pas tout le temps. Ainsi, tout à l’heure, je vais aller déjeuner avec mon mari, qui est gérant dans une brasserie, à deux pas d’ici, et, pendant ce temps-là, c’est la demoiselle du patron qui me remplacera.
VEAUCHENU.
Elle est gentille, la demoiselle du patron ?
LA CAISSIÈRE.
Il n’y a pas à dire, elle est très jolie. Elle est surtout remarquablement élevée : piano, anglais, tout ce qui s’en suit. Le patron tient la main à ça, mais il veut aussi qu’elle vienne au comptoir, qu’elle l’aide dans son commerce, pour qu’elle n’ait pas trop de fierté... C’est que lui, n’est-ce pas, il a cinquante-cinq ans. Il aurait bien de quoi se retirer, mais il veut encore travailler. Ça ne l’empêche pas d’être tout le temps dans son café à surveiller... Et il n’a qu’un garçon avec lui : Albert. Vous attendez après lui pour payer votre consommation ?
Appelant.
Albert ! Il est toujours dans un coin de la cuisine avec le petit officier.
VEAUCHENU.
Le petit officier ?
LA CAISSIÈRE.
Oui, le plongeur.
VEAUCHENU.
Le plongeur ?
LA CAISSIÈRE.
Celui qui lave les verres, les soucoupes, qui s’occupe de la pompe à bière, c’est l’ami d’Albert. Albert, voyez-vous, c’est un très bon garçon, mais il a un défaut, c’est qu’il est un peu distrait. Comment dites-vous, de ces oiseaux qui n’ont pas de cervelle ?
VEAUCHENU.
Je vois ce que vous voulez dire : un moineau ?
LA CAISSIÈRE.
Non, non... attendez...
VEAUCHENU.
Une linotte ?
LA CAISSIÈRE.
Non, non, ça n’est pas encore ça...
VEAUCHENU.
Une linotte n’a pas de cervelle.
LA CAISSIÈRE.
Ce n’est pas tout à fait ça...
Appelant.
Albert !... Il ne vient pas ! Enfin, monsieur, si vous voulez vous en aller, vous n’avez qu’à me payer à moi le prix de votre consommation.
VEAUCHENU.
Je m’en vais. Je vais à un comité. Au revoir, madame !
Il se dirige vers la porte.
LA CAISSIÈRE.
Au revoir, monsieur.
Le montrant du doigt.
Étourneau !
VEAUCHENU, se retournant.
Qu’est-ce que j’ai fait ?
LA CAISSIÈRE.
C’est le nom de l’oiseau que je cherchais.
VEAUCHENU.
Ah ! bien !
Il va pour sortir, et se croise avec Isabelle qui entre.
Scène II
VEAUCHENU, LA CAISSIÈRE, ISABELLE
ISABELLE.
Tiens, monsieur Veauchenu ! Eh bien, merci ! Si je m’attendais ! Comment allez-vous, monsieur Veauchenu ? Vous ne me reconnaissez pas ?
VEAUCHENU.
Non, mademoiselle.
ISABELLE.
Je suis la petite ouvrière en journée qui venait chez madame votre fille... Isabelle.
VEAUCHENU.
Ah ! oui, oui, je me souviens !
ISABELLE.
Ah ! monsieur Veauchenu ! Comme je suis contente de vous voir !... Vous allez bien prendre quelque chose avec moi ?
VEAUCHENU.
...C’est que j’ai un comité... Je vous dirai qu’un ne me voit pas trop souvent au café. Je suis venu aujourd’hui parce que j’avais un peu d’avance et que je n’avais pas pris mon café chez moi...
ISABELLE.
Un comité de quoi, monsieur Veauchenu ?
VEAUCHENU.
Un comité d’encouragement au travail, mon enfant.
ISABELLE.
Oh bien ! il n’a qu’à attendre, votre comité !... Je serais si contente de vous offrir quelque chose ! Mais ça vous déplaît, sans doute, de vous attabler avec moi ?
VEAUCHENU, poli.
Pas du tout, mon enfant. Si je n’étais pas pressé...
ISABELLE.
Restez tout de même un instant.
VEAUCHENU.
Alors c’est moi qui veux vous offrir...
ISABELLE.
C’est vous qui commencerez, je paierai la deuxième tournée... Asseyez-vous là, monsieur Veauchenu...
Elle s’assoit contre le mur à une table au premier plan à gauche.
VEAUCHENU, après une hésitation.
Enfin !...
Il s’assoit en face d’elle.
Qu’est-ce que vous faites, maintenant, mon enfant ?
ISABELLE.
Oh ! comme il dit ça sévèrement !... Oh ! mais, vous n’êtes, pas rigolo quand vous dites ça, monsieur Veauchenu ! Mais je travaille !... Je crois bien que je travaille !
VEAUCHENU.
Vous ne travaillez pas tout le temps ?
ISABELLE.
Souvent ! Quelquefois, bien entendu, je viens au café pour voir des amis... avec qui je fais une partie et qui m’emmènent au théâtre.
VEAUCHENU.
Enfin, la vie que vous menez n’est pas des plus régulières ?
ISABELLE.
Mais qu’est-ce qu’il vous faut, monsieur Veauchenu ? Je vous assure que je mène une vie très régulière... à part que je fais la fête, mais c’est toujours avec des amis, et jamais avec des personnes que je ne connais pas... sauf, bien entendu, si je rencontre un type qui me plaît... qui me fait de l’œil. Mais, du moment qu’il me plaît, eh bien, c’est un ami !
VEAUCHENU.
Enfin, je vois...
Un temps.
Ah ! que ça me fait de la peine ce que vous me dites !
ISABELLE.
Pourquoi ça, monsieur Veauchenu ?
VEAUCHENU.
Parce que j’aurais mieux aimé vous voir travailler que faire ainsi la fête... Vous ne savez pas où ça vous entraînera... La vie de travail, voyez-vous, c’est la plus sûre, et, au fond, quand on s’y habitue, c’est la plus gaie et la plus tranquille...
ISABELLE.
Est-ce que vous jouez au jacquet, monsieur Veauchenu ?
VEAUCHENU hausse les épaules.
Évidemment, je sais jouer au jacquet. Mais ce n’est pas là la question.
Hochant la tête.
Jadis, vous gagniez votre vie si gentiment, pendant que vous étiez ouvrière en journée...
ISABELLE.
Nous allons prendre le jacquet... parce que d’ici qu’Albert arrive...
Elle prend un jeu de jacquet derrière elle, près de la fenêtre.
VEAUCHENU.
Mais, vous savez, je ne vais pas pouvoir jouer.
ISABELLE.
Mais si, mais si ! Une petite partie !
Appelant.
Albert !
LA CAISSIÈRE.
Il va venir.
ISABELLE.
C’est le garçon d’ici. Un numéro pas ordinaire !... Nous allons lui faire raconter son histoire...
Appelant.
Albert !
LA CAISSIÈRE.
Eh bien, Albert ! Voyons !
Albert entre.
Ce n’est pas malheureux ! Où étiez-vous donc, Albert ?
Scène III
VEAUCHENU, LA CAISSIÈRE, ISABELLE, ALBERT
ALBERT.
Où j’étais ? Avec le patron.
LA CAISSIÈRE.
Où était-il, le patron ?
ALBERT
Il était avec moi.
Allant à Veauchenu.
Vous voulez peut-être consommer, monsieur ?
ISABELLE.
Eh bien, dites donc, vous vous faites attendre !
ALBERT.
Oh ! vous savez... moi... je finis toujours par venir... Qu’est-ce que vous prenez ?
ISABELLE.
Voyons, monsieur Veauchenu, qu’est-ce que vous prenez ?
ALBERT.
Comment, vous n’êtes pas encore décidés ?
ISABELLE.
Eh bien, dites donc ?
ALBERT.
Ce n’est pas un reproche, mais vous m’attrapez parce que je me fais attendre, et, quand j’arrive, vous ne savez pas ce que vous voulez prendre. Vous auriez bien pu penser à ça en m’attendant... D’ailleurs, vous savez, moi, ce que j’en dis ! je ne suis pas pressé ! Il est à peine deux heures de l’après-midi, nous fermons à minuit cinq... Et ce n’est pas ce que vous boirez qui me fera passer ma soif...
Allant à la caisse.
Vous voulez savoir ous’qu’est le patron ?... Il est à la cave... en train de vendanger.
LA CAISSIÈRE.
De vendanger ?
ALBERT.
Oui. La Seine a débordé un peu... Il vient de l’eau dans la cave... Quand l’eau vient dans la cave, elle se mêle au vin. Hier, on a reçu deux barriques ; aujourd’hui, nous en avons trois.
ISABELLE, appelant.
Albert ! Deux bocks !
ALBERT.
Deux bocks ? Voilà ! Deux bocks... C’était la peine de réfléchir un quart d’heure pour demander ça !
LA CAISSIÈRE.
Vous avez déjà déjeuné ?
ALBERT.
Oui, à la cuisine.
LA CAISSIÈRE.
Moi, je m’en vais retrouver mon mari pour déjeuner avec lui, aussitôt que mademoiselle sera descendue pour me remplacer.
ALBERT.
Ah ! bien ! elle ne se presse pas, mademoiselle !
LA CAISSIÈRE.
Qu’est-ce que vous dites ?
ALBERT.
Je dis : Elle ne se presse pas, mademoiselle !
LA CAISSIÈRE.
Vous dites ça avec un air ! Vous ne l’aimez pas ?
ALBERT, au comptoir.
Oh ! ce n’est pas que je ne l’aime pas... C’est que je la déteste !... Vous la connaissez comme moi. Elle vous traite du haut des tours de Notre-Dame parce qu’on n’est que garçon de café et qu’elle est la fille du patron. Fille du patron, garçon de café, ça n’empêche pas qu’on est tous les deux dans la limonade... Pas vrai ?
Il prend un plateau.
Tiens ! comme c’est gentil de vous faire attendre quand elle sait que vous allez rejoindre votre pauvre mari... À propos, votre pauvre mari, vous ne voulez pas le tromper avec moi ?
LA CAISSIÈRE.
Oh ! je n’y pense guère !
ALBERT.
Alors, n’en parlons plus. Vous savez, si ça vous dit un jour... que ce ne soit pas la timidité qui vous arrête. Je suis un homme de bonne composition.
LA CAISSIÈRE.
Qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? Est-ce que vous n’avez pas déjà une bonne amie ?
ALBERT.
J’ai une amie ? Qui est-ce qui a pu commettre cette indiscrétion-là ?
LA CAISSIÈRE.
C’est vous.
ALBERT.
Ah ! bon ! Si c’est moi, je n’ai rien à dire.
LA CAISSIÈRE.
Vous m’avez même raconté que vous l’aviez connue jeune fille...
ALBERT.
Je vous ai raconté une chose pareille ! C’est d’ailleurs exact. C’est une personne envers qui j’ai contracté des devoirs... Elle m’embête beaucoup.
LA CAISSIÈRE.
Quel âge a-t-elle ?
ALBERT.
Elle n’est plus toute jeune.
LA CAISSIÈRE.
Trente ans passés ?
ALBERT.
Dans ces eaux-là. Enfin, entre quarante et quarante-cinq.
LA CAISSIÈRE.
Et c’est vous qui, le premier ?...
D’un air d’incrédulité.
Oh ! oh !
ALBERT.
Si vous croyez qu’on me fiche dedans comme ça ?
LA CAISSIÈRE.
Oh ! la ! la !
ALBERT.
Eh bien, qu’est-ce qu’il a fait : « Oh ! la ! la ! » ?
LA CAISSIÈRE.
Les hommes me font rire... Vous n’êtes pas une bête, certainement, mais vous êtes aussi poire que les camarades... Avec deux ou trois compliments bien placés, on vous ferait voir du pays.
ALBERT.
Ne croyez pas ça, j’ai les pieds en dentelle !
LA CAISSIÈRE.
Mais vous marchez tout de même.
ALBERT.
En tout cas, je voudrais bien qu’Edwige m’en ait conté...
LA CAISSIÈRE.
Edwige ?
ALBERT.
Oui, Edwige... parce que si elle m’en avait conté, je ne l’aurais pas connue jeune fille... je n’aurais pas ce remords dans ma vie, je n’aurais pas de devoirs envers elle.
ISABELLE, à Albert.
Eh bien, nos deux bocks ?
ALBERT.
Voilà ! Voilà ! Jamais je ne me rappelle que je suis garçon de café... Il faut toujours que je fasse un effort de mémoire.
Il apporte les deux bocks.
ISABELLE.
Nous attendons depuis un quart d’heure !
ALBERT.
Faut pas me gronder... Je suis infirme !
ISABELLE.
Qu’est-ce que vous avez ?
ALBERT.
Je marche doucement !... Ça m’est venu parce que j’ai été domestique chez un homme qui n’avait qu’une jambe... Alors, il s’achetait des bottines toutes faites, il me donnait toujours ses bottines du pied droit... Mon pied droit ne s’en trouvait pas mal, mais ça allait moins bien pour mon pied gauche... Il m’en est resté quelque chose dans l’allure... Et puis, j’ai une conformation un peu défectueuse : j’ai les côtes en long, je ne suis bien que sur le dos... Je n’étais pas fait pour être garçon de café...
ISABELLE.
Mais vous n’.avez pas toujours été garçon de café ?
Elle pousse Veauchenu du coude.
Écoutez ça, monsieur Veauchenu...
ALBERT.
Vous touchez à la partie bien triste de mon existence.
VEAUCHENU.
Je vous demande pardon...
ALBERT.
Oh ! à force de la raconter, ça m’est devenu tout à fait égal... Mon enfance s’est passée dans un château magnifique, dans un immense parc, avec des arbres des plus vieux et des plus grands. Il y avait plutôt quelque chose comme pelouses : du vert, du vert qui n’en finissait pas, à croire que toute la terre était verte... Au milieu, une pièce d’eau, mais dix fois le lac d’Enghien, et du poisson, du poisson à la pelle, de la vieille carpe énorme, grosse comme un homme et dorée comme un maréchal... Moi, je courais dans le parc du matin au soir. J’étais élevé chez le jardinier du comte de Caspion, Caspion, de la vieille, vieille noblesse... Ça remonte, ça remonte dans la nuit des temps : ça va chercher Hugues Capet... Charlemagne, et ça ne s’arrête pas là, ça va encore plus au fond... Si vous aviez vu le salon et les portraits des ancêtres, des costumes de toutes les époques, un vrai bal masqué ! Et, au milieu de tout ça, le châtelain qui se baladait, et avec quelle allure ! Une bonne figure d’image à deux sous, et des cheveux blancs... non, soyons exact, des cheveux gris...
Pénétré.
Ce qu’il était respectable ! Ce qu’il était vénérable ! Croiriez-vous que ce vieux fourneau a été pris de l’idée idiote de s’en aller faire le tour du monde, pour explorer, qu’il a dit. Le résultat de cette exploration, c’est qu’on ne sait pas ce qu’il a pu devenir... Il y a cinq ans qu’il est parti... Pendant la première année, une lettre de temps en temps... Arrivé au moment où l’intendant du château n’a plus trouvé dans sa caisse l’argent nécessaire à mon entretien, j’ai dû venir me placer à Paris où, grâce à mon instruction, mon éducation, mon savoir-faire, mon intelligence, j’ai trouvé une place de garçon de café ; d’établissement en établissement, je suis tombé ici, chez le père Philibert... Vous voilà aussi savants que moi : vous connaissez mon histoire.
VEAUCHENU.
Nous vous faisons causer : voulez-vous prendre quelque chose avec nous ?
ALBERT.
Oh ! je n’aime pas la bière d’ici, mais, enfin, je ne veux pas vous désobliger.
Il va à la caisse.
Un bock, un !
À la caissière.
Je viens de gagner un bock en racontant ma vie... Dites donc, madame Mirmain, tout à l’heure, pendant que je me suis absenté, est-ce qu’Edwige n’est pas venue ?
LA CAISSIÈRE.
Qui est-ce ça, Edwige ?
ALBERT.
Eh bien, c’est mon amie, la chanteuse. Du moment, elle est chanteuse hongroise. Oui, c’est elle qui dirige l’orchestre des femmes hongroises à l’Exposition des Arts de l’Ameublement : le soir, elle va chanter avec ses sœurs...
LA CAISSIÈRE.
Elle a des sœurs ?
ALBERT.
Elle a toujours des dames avec elle. Ce sont ses sœurs. Tantôt, c’est des Hongroises comme aujourd’hui, tantôt c’est des Russes, tantôt c’est des Siciliennes. Elle a de la famille dans toutes les parties du monde, cette femme-là !... Le soir, elle chante avec ses sœurs dans les restaurants de nuit... Aussi, moi, je ne la vois que tous les quinze jours, et il y a déjà près de deux semaines que je ne l’ai pas vue. Je ne dis pas que le temps ne commence pas à me durer.
Apparaît Edwige.
Ah ! zut ! la voilà !
Il va au fond et revient à la caisse.
LA CAISSIÈRE.
Qu’est ce qu’il y a ?
ALBERT.
C’est elle.
LA CAISSIÈRE.
Mais vous disiez que vous trouviez le temps long après elle ?
ALBERT.
Je ne suis pas content quand je ne la vois pas, mais je ne suis pas très content quand je la vois. C’est une femme qui m’aime.
LA CAISSIÈRE.
Eh bien ?
ALBERT.
À la folie... Mais elle ne peut pas me voir sans me disputer. Pour qu’elle vienne me voir comme ça, au café, il faut qu’elle ait à me disputer... Je vais lui demander qu’est-ce qu’elle prend, mais c’est plutôt moi qui prendrai quelque chose.
LA CAISSIÈRE.
Pourquoi vous dispute-t-elle ?
ALBERT.
J’en sais rien. Et elle non plus. Mais il faut qu’elle attrape le monde. C’est sa façon de vous aimer.
Entre Edwige.
Scène IV
VEAUCHENU, LA CAISSIÈRE, ISABELLE, ALBERT, EDWIGE
Edwige une femme d’allure un peu exotique, d’une quarantaine d’années. Elle s’assoit à une table.
EDWIGE.
Garçon !
Albert s’approche timidement.
Une liqueur !
ALBERT.
Quelle liqueur !
EDWIGE, à mi-voix.
Je te hais !
ALBERT, gêné.
Oui, oui, je sais.
EDWIGE.
Pourquoi est-ce que tu le sais ?
ALBERT.
C’est-à-dire que je ne le sais pas. Mais quand tu... quand vous...
EDWIGE, impérieusement.
Quand tu...
ALBERT, à voix basse.
Quand tu...
EDWIGE.
Plus haut !
ALBERT, élevant très peu la voix.
Quand tu...
EDWIGE.
Pourquoi est-ce que tu ne me tutoies pas ?
ALBERT, montrant les consommateurs.
Les gens...
EDWIGE.
Eh bien, les gens ? Je me fiche des gens ! Et toi aussi. Mais tu as peur de la dame du comptoir...
ALBERT.
Moi ?
EDWIGE.
Oui, toi !
ALBERT.
J’ai peur de la dame du comptoir ?
EDWIGE.
C’est ta maîtresse.
ALBERT.
Ah ! bien, par exemple !
EDWIGE, après réflexion.
C’est la voix de l’innocence. Mais tu serais coupable, que tu serais assez roublard pour prendre cette voix-là... Écoute, je suis une femme très calme et très raisonnable. Mais, quand on m’affole, je ne vois plus clair, je finirai par...
Elle fait le geste d’appuyer sur une gâchette.
Aussi, fais bien attention de ne pas me tromper.
ALBERT.
Oh ! je suis bien tranquille !
EDWIGE.
Je n’aurai pas besoin d’une certitude. Un simple soupçon me suffira.
ALBERT.
Qu’est-ce que vous désirez prendre ?
EDWIGE.
Laisse-moi donc tranquille avec tes consommations ! Quand ma conversation le gêne, il me demande ce que je veux prendre. Quel triste individu !... Si je reste attachée à toi, c’est par une espèce de fatalité.
ALBERT.
Merci.
EDWIGE.
Merci de quoi ?
ALBERT.
Je remercie la Fatalité.
EDWIGE.
Je t’assure que si je pouvais me détacher de toi... Mais, pour le moment, je voudrais t’avoir tout à moi... Quel jour nous unirons-nous pour la vie !
ALBERT, mollement.
Oui, quel jour ?
EDWIGE.
Je n’en sais rien encore. Actuellement, ta position est trop précaire. Je ne veux pas t’entretenir. ! Tu accepterais !
ALBERT, faisant un geste.
Moi !
EDWIGE.
Tu accepterais, mais pas moi. J’ai besoin de t’estimer. Pour le moment, vivons chacun de notre côté. Mais si ton sort s’améliore, si tu gagnes un peu d’argent, nous irons trouver un maire quelconque, et nous nous unirons pour la vie.
ALBERT, pénétré.
C’est entendu... Qu’est-ce que vous prenez ?
EDWIGE.
Qu’est-ce que vous prenez ? Qu’est-ce que vous prenez ? Il n’a que cette phrase-là à la bouche !
ALBERT.
Dame ! je suis dans la limonade !
EDWIGE.
Donne-moi... voyons, donne-moi...
D’une voix sombre.
un amer.
ALBERT.
Voilà.
Il va à la caisse.
Un amer !
LA CAISSIÈRE.
Eh bien, comment ça se passe-t-il ?
ALBERT.
Ne m’adressez pas la parole : elle me tuerait.
La caissière rit.
Ne riez pas : elle me tuerait. Tant qu’elle est là, je ne réponds plus de mon existence...
Il apporte la consommation, verse l’amer, qu’il étend avec de l’eau.
EDWIGE.
Bois d’abord !
ALBERT.
Pourquoi ?
EDWIGE.
C’est ta maîtresse là-bas qui tripote dans toutes ces bouteilles. Je ne sais pas ce qu’elle a mis là-dedans. Bois d’abord, pour plus de sûreté.
Albert trempe ses lèvres dans le verre, après avoir regardé autour de lui avec circonspection. Il boit et repose le verre sur la table.
ALBERT, à Edwige.
Vous ne buvez pas ?
EDWIGE.
Non, s’il y a quelque chose dans le verre, une seule victime suffira.
Elle se lève.
Quand est-ce que je te reverrai !
ALBERT.
Je ne sais pas... Vous chantez toujours au pavillon du Bois ?
EDWIGE.
Jusqu’à minuit. Après cela, je rentre chez ma mère.
ALBERT, à part.
Étrange créature !
EDWIGE.
Alors, tu me laisses partir ?... Et tu ne me demandes pas quand je reviendrai ?
ALBERT.
Quand reviendrez-vous ?
EDWIGE.
Je te hais !
Elle le regarde avec hostilité et sort.
ALBERT.
Soit !
Il revient à la caisse.
Ça y est ! Vous pouvez me parler maintenant, je suis disponible.
LA CAISSIÈRE.
Alors, elle vous cramponne, hein ?
ALBERT.
Non. Elle m’aime. Ça me console un peu de n’être pas aimé... là-bas.
LA CAISSIÈRE.
De qui ?
ALBERT.
De deux ou trois personnes à qui je pense, dont je souhaite l’amour. Ça change tous les jours. Entre autres, une grue admirable que j’ai vue à Saint-Germain, du temps que j’étais maître d’hôtel au pavillon Henri IV. Une belle femme qui m’a humilié... Elle m’a traité comme le dernier des derniers... sans me regarder... À partir de ce moment, je lui ai voué une adoration farouche... Mais n’en parlons plus.
Il enlève l’amer. Bigredon entre et s’assied au fond.
Voilà M. Bigredon qui entre... Mais il faut que je boive mon bock...
À Veauchenu et à Isabelle.
Je bois mon bock...
Il le boit.
À votre santé !
Il porte la soucoupe à la table de Veauchenu. À la caissière.
Maintenant, donnez-moi le café crème de M. Bigredon... Il vient tous les jours à la même heure prendre son café crème... Et on voudrait que je ne sois pas las de cette vie monotone !...
Il va à Bigredon avec la cafetière et le pot à crème.
Monsieur Bigredon, voilà votre café crème.
Scène V
VEAUCHENU, LA CAISSIÈRE, ISABELLE, ALBERT, EDWIGE, BIGREDON, puis YVONNE
BIGREDON, à Albert.
Où est votre patron ?
ALBERT.
Il n’est pas là !
BIGREDON.
Allez donc le chercher. J’ai quelque chose à lui dire.
ALBERT.
Je m’en vais à la cave... Il est à la cave.
À la caissière.
Je vais chercher le patron. Dites donc, est-ce que ça ne fait pas de mal, un verre de vin après un bock ?
LA CAISSIÈRE.
Ça ne doit pas être très bon.
ALBERT.
Je vais toujours essayer... Si le premier ne passe pas, je le pousserai avec un deuxième.
Entre Yvonne, de droite, premier plan. Albert, à la caissière.
Ah ! voilà la princesse de la limonade qui vient vous remplacer.
YVONNE, à Albert.
Je viens de passer par la cuisine. Le déjeuner est encore là. Vous avez déjeuné il y a une demi-heure, et vous ne vous donnez pas la peine d’enlever votre couvert.
ALBERT.
Je vais l’enlever, mademoiselle.
À part.
Il faut toujours qu’elle m’humilie !...
À lui-même.
Je m’en fous !... Je m’en fous !
Changeant de ton.
Est-ce que je m’en fous tant que ça !
Il sort.
VEAUCHENU, à Isabelle.
Dites donc, ce monsieur qui est là-bas, il me semble que je le connais.
ISABELLE.
Non, vous ne le connaissez pas. Vous avez de meilleures connaissances !
VEAUCHENU.
Qu’est-ce qu’il a fait !
ISABELLE.
On n’en sait rien... mais c’est un homme qui est dans toutes sortes d’affaires louches et dans des combinaisons extraordinaires.
VEAUCHENU.
Ça ne lui a pas réussi ? Ça prouve qu’il n’y a rien de tel que l’honnêteté.
ISABELLE.
Oui. Mais, à côté de ça, vous verrez des gens honnêtes qui réussissent et d’autres qui ne réussissent pas.
VEAUCHENU.
À côté de ça, vous verrez des crapules qui ne font pas leurs affaires, et d’autres qui les font parfaitement.
ISABELLE.
Alors ?
VEAUCHENU.
Eh bien, oui !
Ils boivent. Pendant ce temps, la caissière s’en va et la jeune fille la remplace au comptoir.
ISABELLE, à Veauchenu.
Tenez, voilà le patron de l’établissement.
Scène VI
VEAUCHENU, ISABELLE, YVONNE, BIGREDON, PHILIBERT
PHILIBERT, entrant, à Yvonne.
Eh bien ! T’as bien appris ton piano ?
YVONNE.
Oui, papa.
PHILIBERT.
Qu’est-ce qu’elle t’a fait jouer ?
YVONNE.
Du Schumann.
PHILIBERT.
De quoi ?
YVONNE.
Du Schumann.
PHILIBERT.
Ah !
Un temps.
Est-ce qu’elle est restée toute son heure ?
YVONNE.
Oui, papa.
PHILIBERT.
Et, ce matin, t’as bien pris ta leçon d’anglais ?
YVONNE.
Oui, papa.
PHILIBERT.
Qu’est-ce qu’elle t’a appris, ta maîtresse ?
YVONNE.
J’ai traduit du Longfellow.
PHILIBERT.
Comment que t’as dit ?
YVONNE.
Du Longfellow.
PHILIBERT.
Ah ! Ah ! Est-ce qu’elle est bien restée toute son heure ?
YVONNE.
Oui, papa.
PHILIBERT.
Très bien.
Il va à Bigredon.
Bonjour, monsieur Bigredon.
BIGREDON.
Bonjour, monsieur Philibert. Je vous ai fait demander par votre garçon parce que j’ai des choses d’une importance capitale à vous dire.
PHILIBERT.
Elle est gentille, ma petite fille, hein ?
BIGREDON.
Oui, très gentille. Écoutez...
PHILIBERT.
Elle apprend bien... Quand elle m’a dit les noms de tout ce qu’elle apprend, je n’en revenais pas... Elle apprend des choses tout ce qu’il y a de mieux, en anglais, en piano... Vous verrez ça... Si je lui fais dire les noms, je suis sûr qu’il y en a que vous ne connaissez pas.
BIGREDON.
Écoutez... Voilà : j’ai des choses extraordinaires à vous dire.
PHILIBERT.
Des choses extraordinaires ? Qu’est-ce que c’est encore que ça ?
BIGREDON.
C’est au sujet d’Albert, votre garçon.
PHILIBERT.
Moi, je pense à une chose, à propos de mon garçon : c’est que je l’ai quitté à la cave tout seul.
BIGREDON.
Laissez-le donc ! Laissez-le donc !
PHILIBERT.
Vous en parlez à votre aise...
Il fait mine de se lever.
BIGREDON.
Mais, nom d’un chien ! voulez-vous rester ici ? Savez-vous ce qui lui arrive, à votre garçon ?
PHILIBERT.
Quoi donc ?
BIGREDON, le fait rasseoir et lui dit à mi-voix.
Il hérite de huit cent mille francs !
PHILIBERT.
Qu’est-ce que vous dites ?
BIGREDON.
Il avait été élevé dans un château, chez le comte de Caspion...
PHILIBERT.
Oui, je sais ça... il m’a bien souvent rasé avec cette histoire-là !
BIGREDON.
Eh bien, le comte de Caspion, qui était parti faire un voyage autour de monde, a eu un accident. Il est mort... On a appris qu’il a été tué par des cannibales. Je crois même qu’ils l’ont mangé. Enfin, on n’a rien retrouvé, ni corps, ni vêtements, ni même son casque de feutre. Ils en avaient de l’appétit ! Ils n’ont laissé que son portefeuille.
PHILIBERT.
Parce que ce sont des honnêtes gens.
BIGREDON.
Non, parce qu’ils n’aiment pas le cuir de Russie. Et, alors, dans son portefeuille...
PHILIBERT.
Il y avait un testament.
BIGREDON.
Et sur ce testament, il léguait huit cent mille francs à Albert. Il serait son enfant naturel que je n’en serais pas autrement surpris que ça...
PHILIBERT.
Ah ! nom de nom ! Je vais raconter ça à Albert... il va en faire une de ces pommes !
BIGREDON.
Ne dites rien ! Ah ! sapristi ! Il faut d’abord que vous tiriez votre épingle...
PHILIBERT.
Comment ça ?
BIGREDON.
Albert ne saura la chose que dans une heure. On lui a expédié de chez Me Gédebois, notaire – je sais ça par un des clercs – une lettre recommandée. Or, cette lettre arrivera à la troisième distribution, c’est-à-dire dans une heure ou trois quarts d’heure. Avant qu’elle arrive, il faut absolument chambrer notre Albert et vous réserver deux cent mille francs sur son héritage.
PHILIBERT.
Deux cent mille francs !
BIGREDON.
C’est tout ce qu’il y a au monde de plus facile par le petit moyen que j’ai préparé.
PHILIBERT.
Qu’est-ce que c’est encore que cette canaillerie ?
BIGREDON.
Vous vous assurez les services d’Albert pour une durée de vingt ans, à raison de cinq mille francs par an.
PHILIBERT.
Dites donc, cinq mille francs par an ? Vous êtes timbré ? Ce n’est pas moi qui ai fait l’héritage !
BIGREDON.
Vous aurez comme garçon, entendez-vous, à votre service, un homme qui aura huit cent mille francs à lui.
PHILIBERT.
Mais je n’y tiens pas.
BIGREDON.
Monsieur Philibert, vous savez ce que c’est que d’être pocheté ?
PHILIBERT.
Non, monsieur.
BIGREDON.
Vous savez ce que c’est que d’en avoir une couche ?
PHILIBERT.
Non, monsieur.
BIGREDON.
Eh bien, je vous expliquerai ça. Vous comprenez bien espèce de... monsieur Philibert... que ce garçon ne va pas rester à servir des bocks, s’il a huit cent mille francs à lui, et qu’aussitôt qu’il aura sa fortune entre les mains, il vous rendra tout de suite son tablier...
PHILIBERT.
Eh bien, il me le rendra !
BIGREDON.
Mais il ne pourra pas vous le rendre sans vous payer un dédit de deux cent mille francs que j’ai inscrit sur ce papier-là et que je vais lui faire signer. Vous l’engagez pour vingt ans, moyennant cinq mille francs par an, avec un dédit de deux cent mille francs. On lui apprend qu’il hérite... Alors, comme il ne veut pas rester garçon de café, il vous paie vos deux cent mille francs, et puis il s’en va. Est-ce que ce n’est pas bien arrangé, ça ?
PHILIBERT.
C’est canaille !
BIGREDON.
Vous hésitez ?
PHILIBERT.
Oui, j’hésite toujours quand c’est canaille, jusqu’à ce que je finisse par trouver comme ça, par l’effort de ma réflexion qui tourne et retourne la chose, jusqu’à ce que j’aie fini par me persuader que ce n’est plus canaille... et je finis toujours par me persuader ça, surtout quand c’est un peu avantageux.
BIGREDON.
Alors, dépêchez-vous de réfléchir. Vous avez à peine vingt ou vingt-cinq minutes.
PHILIBERT.
Oh ! c’est fini !... J’ai réfléchi... Quand je réfléchis, vous savez, je n’ai pas besoin de réfléchir longtemps... juste le temps de me dire que je réfléchis et ça y est.
BIGREDON.
Alors, en voyez-moi votre garçon.
PHILIBERT.
Dites donc, un dédit de deux cent mille francs, je trouve que c’est un peu beaucoup... j’ai comme qui dirait des scrupules.
BIGREDON.
Des scrupules ?
PHILIBERT.
Oui, j’ai des scrupules. J’ai peur qu’il n’accepte pas.
BIGREDON.
Mais qu’est-ce que ça peut lui faire ? Il n’est encore au courant de rien... Il signera deux cent mille francs comme quatre cent mille.
PHILIBERT.
Alors, demandez-lui quatre cent mille...
BIGREDON.
Non, deux cent mille francs, c’est deux fois vingt années d’appointements, ça a l’air d’un chiffre raisonnable.
PHILIBERT.
Je vais vous le chercher... d’autant plus qu’il est en train de boire mon vin.
BIGREDON.
Tant mieux, farceur ! S’il a un peu de vent dans les voiles, il marchera plus sûrement.
PHILIBERT, à Yvonne.
Dis donc, fifille, sonne en bas à Albert. Le timbre sonne près de la cave, il saura bien que c’est lui qu’on appelle.
BIGREDON.
Je vais rajouter sur mon papier quelques lignes d’explications.
PHILIBERT.
Dites donc, Bigredon, c’est canaille.
BIGREDON.
Oui, vous savez, c’est un peu canaille.
PHILIBERT.
C’est pas trop, trop canaille ?
BIGREDON.
Mais non, mais non !
PHILIBERT.
Ah ! vous savez, moi... Mais le voilà qui vient... Oh ! la ! la ! la ! Il fait du bruit dans l’escalier... Ce n’est pas le bruit d’un homme qui monte très droit !
Scène VII
VEAUCHENU, ISABELLE, YVONNE, BIGREDON, PHILIBERT, ALBERT
ALBERT, entrant, il est visiblement ivre, il parle tout seul à mi-voix.
C’est bête ! Y a pas à dire ! J’en ai trop pris... Seulement, il y a une fatalité : j’ai pas trouvé de verre en bas... Alors, quand on boit après le tonneau, eh bien, dame, on ne sait pas ce qu’on en boit... on ne sait pas si c’est un litre ou un verre à bordeaux... Oh ! ça a bien coulé pendant une, deux, trois minutes... je ne me suis pas rendu compte... Heureusement que le singe mannezingue il a mis un peu d’eau dedans... Sans ça, j’aurais parfaitement été capable de me cuiter... Oh ! la ! la ! pas de ça, pas de ça, mesdames...
Pendant ce monologue, il nettoie des verres sur une table. Philibert vient au comptoir parler à sa fille.
Personne ne peut se vanter de me dire qu’il m’a jamais vu saoul... jamais ! jamais ! jamais ! Quand je sens que je suis mûr, eh bien, je vas me coucher... Aujourd’hui je ne suis pas mûr et je n’ai pas le temps de me coucher...
Sévèrement.
Le travail ! Le travail !... J’ai tout mon sang-froid... J’ai tout mon sang-froid.
BIGREDON, descendant.
Albert !
ALBERT.
Me voilà. On vous reconnaît, monsieur... Je sais bien qui vous êtes... Je reconnais aussi votre nom... Je vous le dirai une autre fois.
BIGREDON.
Voyons, Albert ! Votre patron m’a chargé de vous dire quelque chose.
ALBERT.
C’est-y qu’il veut me fiche à la porte ?
BIGREDON.
Il n’est pas question de ça !
ALBERT.
Entre nous, bien entre nous... si j’ai bu... un litre... un litre et demi... c’est le bout du monde ! c’est le bout du monde !
BIGREDON.
Mais ça n’a aucune importance... Votre patron songe si peu à vous mettre à la porte qu’il veut vous augmenter...
ALBERT.
Très bien... j’y consens.
BIGREDON.
Il a reconnu que vous étiez un garçon intelligent.
ALBERT.
Non !
BIGREDON.
Vous n’êtes pas intelligent ?
ALBERT.
Moi ? Je suis supérieurement intelligent... je suis une des grandes intelligences du quartier des Ternes... Mais c’est rare s’il a pu le reconnaître... il n’en est pas capable... c’est un daim, M. Philibert !... Voilà, c’est un daim !
BIGREDON.
C’est un daim ?
ALBERT.
Oui ! Oh ! il ne faut pas qu’il vienne me dire à moi que je suis intelligent ! Je lui dirais : monsieur, vous n’êtes pas capable de savoir si je suis intelligent ! Si je n étais pas de bonne humeur, je ne me gênerais pas pour lui coller ma main sur la figure !
BIGREDON.
Philibert, votre patron, s’est dit : « Je vais m’attacher ce garçon... je vais lui donner cinq mille francs par an. »
ALBERT.
Bien.
BIGREDON.
Et lui faire un traité... un traité de vingt ans...
ALBERT.
Très bien.
BIGREDON.
Si l’un des deux quitte l’autre, il faudra qu’il paie un dédit. C’est-il juste ?
ALBERT.
C’est très juste.
BIGREDON.
Comme nous savons bien que ça ne se présentera jamais, nous allons faire inscrire dedans un dédit très fort : deux cent mille francs.
ALBERT.
Non !
BIGREDON.
Vous trouvez que c’est trop ?
ALBERT.
C’est pas assez ! S’il m’attache pour vingt ans, je veux bien accepter, mais je ne m’engage pas comme ça. À supposer que ma fiole lui déplaise tout à coup, il va me mettre sur le pavé en me donnant deux cent mille francs ?... Non, non ! il faut mettre cinq cent mille.
BIGREDON.
Mais non, mais non, c’est trop, ça vicierait le traité, c’est un chiffre invraisemblable.
ALBERT.
Alors, deux cents francs !
BIGREDON.
Non, deux cent mille francs !
ALBERT.
Deux cent mille francs... Je vais signer...
BIGREDON.
J’ai ce qu’il faut.
ALBERT.
Faut-il que je signe-tous mes petits noms ?
BIGREDON.
Si vous voulez.
ALBERT.
Je n’en ai qu’un : Albert. Quant à mon nom, c’est le nom de Loriflan... celui de ma mère. Monsieur Albert Loriflan... Voilà ! Je m’en vais signer...
BIGREDON.
Là... et là.
Appelant.
Monsieur Philibert ?
Philibert vient signer et remonte au fond avec Bigredon.
YVONNE, de la caisse.
Albert !
ALBERT.
Elle va encore m’humilier, cette personne-là. Oh ! si elle veut m’humilier encore comme ça pendant vingt ans ! J’aurais dû faire mettre sur le papier qu’elle ne doit plus m’humilier...
YVONNE, l’appelant.
Je ne voudrais rien vous dire devant les consommateurs, mais je vous ai répété trois fois de ne pas laisser traîner des soucoupes... Vous quitterez la maison ce soir...
ALBERT.
Mademoiselle, je ne pense pas !
YVONNE.
Comment, vous ne pensez pas ?
ALBERT.
Nous sommes aujourd’hui le 15 avril 1911... c’est-il juste, mademoiselle ?
YVONNE.
C est juste. Mais qu’est-ce que ça signifie ?
ALBERT.
Ça signifie que je partirai le 15 avril... 1931... C’est dur à calculer ! Le 15 avril 1931, je quitterai cette maison. Vous pouvez chercher quelqu’un pour ce jour-là.
YVONNE.
Vous êtes complètement ivre, mon garçon ! Je vous prépare votre compte immédiatement. On vous doit quarante-cinq francs pour le mois en cours et sept francs que vous avez prêtés à la cuisinière, cela fait cinquante-deux francs. C’est juste ?
ALBERT.
Non !
YVONNE.
Comment ça ?
ALBERT.
Mademoiselle, si c’est mon compte juste que vous voulez, ça fait cinquante-deux francs et puis deux cent mille francs, en tout deux cent mille cinquante-deux francs.
YVONNE.
Papa !
PHILIBERT, s’approchant d’Albert.
Voilà votre traité.
YVONNE.
Papa, veux-tu faire sortir cet homme immédiatement ?... il se moque de ta fille... Je le mets à la porte.
PHILIBERT.
Mais non ! mais non ! qu’est-ce qu’il y a ?
ALBERT.
Il y a que mademoiselle m’a disputé rapport aux soucoupes que j’avais oublié d’enlever. Alors, mademoiselle, qui est maîtresse ici, m’a mis à la porte. Je lui ai dit que je n’étais prêt à m’en aller que dans vingt ans. Elle a voulu me faire mon compte, je lui ai réclamé deux cent mille francs.
YVONNE.
Tu vois, papa, qu’il est ivre !
ALBERT.
Monsieur le patron du café, voulez-vous prier mademoiselle votre fille de ne pas insulter votre garçon ?
PHILIBERT.
Allons ! Allons ! Laisse donc ; je te dirai pourquoi il faut le laisser tranquille.
ALBERT.
Ah ! ah ! c’est qu’on ne me marchera plus sur les pieds, maintenant !
Entre le facteur au fond à droite.
Scène VIII
VEAUCHENU, ISABELLE, YVONNE, BIGREDON, PHILIBERT, ALBERT, LE FACTEUR, puis UN MONSIEUR et UNE DAME, puis LE PLONGEUR
ALBERT, au facteur.
Qui est-ce qui vous a permis d’entrer par la porte du café ? Je ne peux pas tolérer ça...
Avec éclat.
On ne me marchera plus sur les pieds
LE FACTEUR.
J’ai une lettre recommandée pour vous.
ALBERT, voulant le faire sortir.
Passez par la porte de la rue. Il y a une concierge, la maison ne manque pas de concierge.
LE FACTEUR.
Ce n’est pas la peine de m’avaler en travers !... Je l’ai vue, la concierge. Elle m’a dit : « M. Albert, c’est au café. »
ALBERT.
Une lettre pour moi ?
Lisant l’en-tête de l’enveloppe.
« Monsieur Gédebois, notaire. »
Au facteur.
Qu’est-ce qu’il y a donc dans cette lettre ?
Philibert va au fond retrouver Bigredon.
LE FACTEUR.
Ah ! moi, je n’en sais rien, mon vieux. Signez seulement mon livre et nous serons quittes.
ALBERT.
Oh ! je n’aurai jamais tant signé qu’aujourd’hui... Mais qu’est-ce que ça peut encore être que cette lettre ?...
Il s’interrompt de signer.
LE FACTEUR, lisant la signature.
Albert Lori...
ALBERT.
...flan ! Je vais ajouter flan... Attendez, facteur, je vois ce que c’est, c’est quinze francs d’indemnité que j’ai demandés à la Compagnie de l’Ouest qui m’a esquinté mon vélo... Si c’est quinze francs, facteur, quatre sous pour vous... Vous entendez ? quatre sous pour vous...
Il ouvre la lettre et lit.
Ah ! la ! la ! la ! la ! la ! la ! la ! la ! je suis saoul !... ça y est, je suis complètement saoul !... Oh ! qu’est-ce qui m’arrive ?
Il tombe assis sur une chaise, à côté de Veauchenu, et boit une gorgée d’un bock tout frais que le patron vient de servir à Veauchenu et à Isabelle.
VEAUCHENU.
Eh bien, dites donc, donnez-moi un autre bock !
ALBERT.
Non, je n’en ai bu qu’une gorgée... J’ai assez bu... J’avais la gorge sèche.
VEAUCHENU.
Donnez-moi un autre bock.
ALBERT, solennellement.
C’est moi qui paie, cher ami... c’est moi qui paie !
D’une voix très agitée.
J’ai huit cent mille francs.
À Isabelle.
J’ai huit cent mille francs !...
Il va au facteur.
Ce n’est pas quatre sous que je vais te donner, à toi, c’est vingt francs... Puis, d’abord,
Il l’embrasse sur les deux joues.
tu as une femme ?... Tu as deux, trois enfants ?
LE FACTEUR.
Trois.
ALBERT.
Ce n’est pas assez ! Il faut en faire un autre, et donne-leur à chacun trois francs... Et voilà pour ta femme... Elle les a bien gagnés...
Il va embrasser Isabelle, puis Veauchenu, puis Bigredon, puis Philibert, et s’arrête devant le comptoir, puis il embrasse une seconde fois Philibert, en disant.
Pour mademoiselle.
Yvonne sort à droite en haussant les épaules. À Philibert.
Lisez ça, mon vieux patron.
À Bigredon.
Lisez ceci en même temps, mon vieux consommateur, vous m’en direz des nouvelles... Voilà des clients !
Entrent un monsieur et une dame. Albert embrasse la dame, puis le monsieur. Au monsieur.
Ne vous fâchez pas, aujourd’hui c’est fête... on consomme à l’œil... Vous pouvez prendre un demi, payer à madame une boisson avec une paille : c’est moi, c’est le garçon qui régale !
Venant à Philibert.
Eh bien, patron, qu’est-ce que vous dites de ça ?
PHILIBERT.
Je vous félicite.
BIGREDON.
Nous sommes tous bien contents.
ALBERT.
Croyez-vous que c’est une chose épatante !
Au plongeur qui paraît près de la porte.
Arrive ici, toi, je ne t’ai pas embrassé...
Il lui pose un baiser sur le front.
Je t’embrasse... Tu viens d’être embrassé par un homme qui a huit cent mille francs de fortune.
LE PLONGEUR.
Comment ça ?
ALBERT.
J’ai hérité de huit cent mille francs. Je vais la mener, maintenant, la grande vie... Je vais retrouver cette grue admirable qui m’a insulté à Saint-Germain... Elle sera ma maîtresse... J’achèterai une automobile électrique, un smoking, une fleur pour ma boutonnière... je me promènerai tout le temps en souliers vernis.
Il fait le geste d’enfiler des gants.
Non, je ne mettrai pas des gants, parce que ça me gêne, mais j’aurai tout le temps une paire de gants tout propres dans ma main, pour faire comme ça avec la main... Voilà comme je vais être maintenant... Écoutez tous, vous êtes tous au courant de ce qui m’arrive... Mais, surtout, il ne faut pas que ça vienne aux oreilles d’une certaine personne, chanteuse hongroise, que vous avez peut-être vue à la maison... Si jamais cette personne arrive me demander, je suis parti dans ma famille, très, très, très loin... je serai pour donner de mes nouvelles...
Geste vague.
un de ces jours...
À Philibert.
Patron, dites donc, je n’ai pas l’intention départir tout de suite et de vous laisser en plan... J’attendrai que vous trouviez un extra. Ça ira bien jusqu’à ce soir.
PHILIBERT.
Mais non, mais non, mon cher Albert... Si vous voulez prendre votre liberté dès maintenant...
ALBERT.
Vous êtes trop bon. Vous savez, vous me devez cinquante-deux francs, mais vous comprenez que dans ma position, dans ma situation, je suis homme à vous en faire grâce. Ce sera pour offrir un cadeau à mademoiselle Yvonne.
PHILIBERT.
Mais non ! Mais non ! Il faut que les comptes se fassent en règle... Je vous dois cinquante-deux francs, vous me les retiendrez sur les deux cent mille.
ALBERT.
Sur les deux cent mille ?
PHILIBERT.
Dame ! Puisque vous quittez la maison, mon cher Albert, il faut payer votre dédit.
ALBERT.
Voyons ! voyons ! voyons ! voyons !... ce n’est pas possible, monsieur Bigredon ?
BIGREDON.
Qu’est-ce qu’il y a ?
ALBERT.
Ce n’est pas possible ! Si j’avais su, ce matin, ce qui m’arrive, je n’aurais pas signé. Vous n’allez pas me réclamer ça, patron ?
BIGREDON.
Avec ça que vous ne les avez pas réclamés quand on a voulu vous mettre à la porte ?
ALBERT.
Deux cent mille francs !
BIGREDON.
Vous en avez huit cent mille !
ALBERT.
Et alors, si j’en donne deux cent mille, je n’en aurai plus que six cent mille. Oh ! non ! non ! Oh ! non ! non ! je ne peux pas vivre à moins de huit cent mille francs. J’ai fait mon budget. Il me faut huit cent mille francs.
BIGREDON.
Il faudra pourtant bien vous résoudre à verser deux cent mille francs à votre patron, À moins que vous n’ayez l’intention de rester garçon de café...
ALBERT.
Oh ! je ne veux pas cracher deux cent mille francs !... Ça me ferait trop mal au cœur !
BIGREDON.
Alors, restez garçon de café !
ALBERT.
Le patron ne peut pas me réclamer ça, voyous, ça serait canaille !
BIGREDON.
Mettez-vous à sa place : vous lui devez par traité une somme considérable. Il est père de famille, il est forcé de l’exiger.
ALBERT.
Je ne veux pas verser deux cent mille francs.
BIGREDON.
Alors, restez garçon de café. Ça sera un peu embêtant d’être cloué ici de huit heures du matin à minuit et de servir des bocks quand on a quarante mille livres de rentes...
ALBERT.
Ça ne peut pas durer éternellement.
À Philibert, avec une colère contenue.
Patron ! j’ai réfléchi, le métier me plaît. Ça me ferait de la peine de quitter cette maison. Je reste à votre service.
PHILIBERT.
Bien ! Bien !...
À Bigredon.
Vous voyez, il reste à mon service et je serai obligé de lui donner cinq mille francs par an pendant vingt ans... la belle combinaison que vous m’avez fait faire là !
BIGREDON.
Patience, il ne restera pas longtemps.
Ils remontent.
ALBERT, au plongeur.
J’ai mon plan... Tu vas voir... Je vais me faire fiche à la porte, voilà tout. Comme c’est lui qui se privera de mes services, c’est lui qui me devra les deux cent mille francs...
Philibert sonne. Yvonne rentre.
D’ailleurs, tu sais, moi, je l’en tiendrai quitte ; pourvu que je ne les donne pas, ça me suffit...
Entrent Jabert et Amélie.
Scène IX
LES MÊMES, JABERT et AMÉLIE
JABERT, à Amélie.
Qu’est-ce que tu prends ?
AMÉLIE.
Une grenadine au kirsch.
JABERT.
Garçon !
PHILIBERT.
Albert, voyez au trois.
ALBERT, assis au premier plan, à Philibert.
Plaît-il, Auguste ?
PHILIBERT.
Voyez au trois.
ALBERT, sans se lever.
Fatigué !... Excessivement fatigué.
PHILIBERT.
Qu’est-ce qu’il y a ?
ALBERT.
Il y a, bon Auguste, que je suis fatigué... et qu’il faut que tu te déranges toi-même...
ISABELLE, à Veauchenu.
Eh bien, dites donc, monsieur Veauchenu, ce n’est pas ordinaire ! Vous entendez comme il parle au patron ?
PHILIBERT.
Albert, voulez-vous servir les clients ?
ALBERT.
Je ne peux pas marcher... j’ai une poussière dans l’œil !
PHILIBERT, à Albert.
Une dernière fois, voulez-vous servir les clients ?
ALBERT.
Non, mon gros. T’es pas ankylosé... t’as des jambes... faut savoir t’en servir...
PHILIBERT, à Albert.
Faites bien attention, c’est grave ! Je vous dis d’aller servir les clients !
JABERT.
Eh bien, garçon...
ALBERT.
Ne les faites pas attendre, cher Auguste ! Moi, je vous dis qu’il m’est impossible de marcher.
PHILIBERT, furieux.
Eh bien ! Eh bien !
Se ravisant.
Je vais y aller moi-même.
ALBERT.
C’est ça ! c’est ça !
PHILIBERT, à Bigredon, en passant.
Il est insupportable !... Je ne puis plus y tenir...
BIGREDON.
Patience ! Il se calmera...
Deux clients entrent et vont s’asseoir à une table au premier plan, près de l’endroit où est assis Albert.
Scène X
LES MÊMES, DEUX CLIENTS
PREMIER CLIENT.
Garçon ! Une fine et un café noir !
ALBERT.
Patron !
PHILIBERT.
Qu’est-ce qu’il y a ?
ALBERT.
Prenez la commande de ces messieurs.
Aux clients.
J’ai un patron très bien, qui marche au doigt et à l’œil.
PHILIBERT, à Albert.
Vous ne voulez pas les servir ?
ALBERT, se ravisant.
Mais si !...
Il va à la caisse, prend la cafetière ; il apporte un grand verre et un petit verre à liqueur. Il sert. Il prend de la fine et en remplit le grand verre ; il prend du café et en verse dans le petit verre à liqueur.
PHILIBERT, à part.
Qu’est-ce qu’il fait ?
ALBERT, aux clients.
Je vous verse un grand verre de fine parce qu’elle nous revient très bon marché... C’est fabriqué avec de l’esprit de bois et des semelles de bottes... Quant au café, je vous en verse très peu parce que c’est du jus de tabac, c’est très malsain pour la santé.
PHILIBERT, aux clients.
Je vous demande pardon, messieurs et dames.
Il enlève les deux verres et verse du café et de la fine dans deux verres qu’il a apportés. À Bigredon.
Je ne peux plus y tenir !
BIGREDON.
Attendez !
Sortent Bigredon et Philibert, à droite au fond.
DEUXIÈME CLIENT.
Mais c’est inouï !
PREMIER CLIENT.
Qu’est-ce qu’il a ce garçon-là ?
DEUXIÈME CLIENT.
Et ce patron qui le laisse faire ?
PREMIER CLIENT.
Ah ! c’est rigolo ! Moi, il faut que je m’en aille, mais je le regrette...
DEUXIÈME CLIENT.
Moi, j’ai rendez-vous à la brasserie du Tonneau avec Pézard qui est à côté... Je vais le chercher, pour qu’il assiste à cette scène, c’est plutôt rigolo !
PREMIER CLIENT, en sortant, à Albert.
Eh bien, vous ne vous épatez pas avec vos patrons !
ALBERT, assis.
Faut ça ! Faut ça !
Sortent les deux clients.
Scène XI
ALBERT, VEAUCHENU, YVONNE, LE PLONGEUR, entrant de droite
LE PLONGEUR, à Albert.
Oh ! écoute, mon vieux ! il faut que je te prévienne de quelque chose. Le patron et le père Bigredon viennent de parler tout de suite devant la fenêtre de la cuisine... Bigredon disait : « Faut chercher un huissier, il constatera qu’il vous répond impoliment et c’est comme si c’était lui qui vous avait donné votre congé, puisqu’il vous met dans l’obligation de le mettre à la porte... » Alors, ils sont chez l’huissier.
ALBERT.
Chez l’huissier ?
LE PLONGEUR.
Oui, qui demeure au-dessus, dans la maison.
ALBERT.
Ah ! oui, l’étude du deuxième.
LE PLONGEUR.
Tiens-toi ça pour dit !
ALBERT.
Bien ! Bien !
Scène XII
ALBERT, VEAUCHENU, YVONNE, LE PLONGEUR, DEUXIÈME CLIENT, entrant avec PÉZARD
DEUXIÈME CLIENT, à Pézard.
Ici, nous sommes mieux qu’au Tonneau, et je te réponds que tu auras des distractions supplémentaires... Tu n’es jamais venu ici ? Mais tu vas me regarder ce garçon-là.
PÉZARD.
Qu’est-ce qu’il a d’extraordinaire ?
DEUXIÈME CLIENT.
C’est un numéro dont tu me diras des nouvelles... Tu vas voir la façon dont il va répondre à son patron... Ce que l’autre file doux quand il est là !... Moi, je n’ai jamais vu ça...
PÉZARD.
Qu’est-ce que tu prends ?
DEUXIÈME CLIENT.
Oh ! ne te presse pas, mon vieux ! faut attendre que le patron soit là, c’est pour ça que je t’ai amené.
ALBERT, s’approchant.
Qu’est-ce que ces messieurs désirent ?
PÉZARD.
Nous réfléchissons.
Pendant cette scène, le plongeur n’est pas sorti. Il a mis des soucoupes en tas près du comptoir. Entrent Philibert et Bigredon par la porte qui donne dans l’intérieur.
Scène XIII
ALBERT, VEAUCHENU, YVONNE, LE PLONGEUR, DEUXIÈME CLIENT, PÉZARD, PHILIBERT et BIGREDON, puis L’HUISSIER
DEUXIÈME CLIENT, à Pézard.
Voilà le patron, nous allons rigoler !
PHILIBERT, à Bigredon.
L’huissier arrive par là.
BIGREDON.
Bon ! N’ayons l’air de rien.
L’huissier entre par la gauche.
LE PLONGEUR, à Albert, passe devant lui en portant des soucoupes et se dirige vers la cuisine.
Voilà l’huissier !
ALBERT.
Je le vois, va !
L’huissier va s’asseoir à une table près des deux clients.
DEUXIÈME CLIENT.
Patron !...
Philibert s’approche d’eux.
Faites-nous donc servir un café pour moi et une fine.
PÉZARD.
J’aimerais mieux un cassis à l’eau.
DEUXIÈME CLIENT.
Non, mon vieux, prends une fine, tu vas voir... c’est plus rigolo !
PÉZARD.
Ça me fait mal à l’estomac...
DEUXIÈME CLIENT.
Ça ne fait rien, c’est plus rigolo !...
PÉZARD.
Je ne te comprends pas.
DEUXIÈME CLIENT.
Tu vas voir...
À Philibert.
Faites-nous servir, patron !
PHILIBERT, inquiet.
Je vais encore me faire engueuler... Ça y est.
En passant devant l’huissier.
Vous allez voir.
L’HUISSIER
Bon, bon, je suis là pour ça.
PHILIBERT, d’une voix tremblante.
Albert !
ALBERT, accourant.
Plaît-il, patron ?
PHILIBERT.
Voulez-vous servir à ces messieurs une fine et un café ?
ALBERT, docilement.
Tout de suite, patron, tout de suite.
Il va au comptoir.
PHILIBERT, à l’huissier.
Regardez ce qu’il va faire avec la fine.
Albert rapporte la cafetière et la bouteille, ainsi que le plateau avec un grand et un petit verre. Philibert est toujours près de la table. L’huissier et Bigredon sont aux aguets. Albert fait d’abord le geste de verser la fine dans le grand verre, puis il regarde Philibert, et verse la fine dans le petit verre.
PÉZARD, au deuxième client.
Qu’est-ce qu’il y a de drôle ? Il est très bien, ce garçon !
DEUXIÈME CLIENT.
Tu vas voir.
À Albert.
Garçon, est-ce qu’elle est bonne, cette fine Champagne ?
PHILIBERT, à l’huissier.
Écoutez ça !
ALBERT.
Cette fine Champagne, monsieur, oh ! elle est de premier choix !
DEUXIÈME CLIENT.
Elle n’est pas truquée ?
ALBERT.
Absolument naturel... C’est une des vieilles distilleries de la Charente qui met ça de côté pour la maison. Personne n’a le droit d’y toucher... On met ça dans des fûts entourés de cire...
PHILIBERT, à part.
Il est épatant !
ALBERT.
Buvez-moi ça !
Il verse du café dans le grand verre.
Et, si vous voulez vous envoyer du café à la hauteur, il n’y a qu’ici qu’on le fait comme ça... Vous pouvez chercher dans tous les Ternes.
DEUXIÈME CLIENT.
Je croyais que c’était du jus de tabac.
ALBERT.
Moka, Zanzibar, Martinique, par quarts. Pour l’autre quart, un spécial à nous.
À part.
Je crois que je leur ai posé ça proprement !
PÉZARD, au deuxième client.
Je ne te comprends pas... Tu me fais venir ici pour voir un phénomène... Tu me fais boire de la fine au lieu de mon cassis à l’eau !... Je te retiens, moi, tu sais.
DEUXIÈME CLIENT.
Ah ! mon vieux, je n’y comprends rien !
À Philibert.
Dites donc, c’est ce garçon-là qui vous a manqué tout à l’heure ?
PHILIBERT.
Où c’est que vous avez vu qu’il m’a manqué ?
PÉZARD.
Oui, où c’est-il que t’as vu ça ?
DEUXIÈME CLIENT.
Pourtant, tout à l’heure, il vous disait...
PHILIBERT.
Oh ! vous avez pu voir, mon petit gars, que je n’ai pas été long à lui faire rentrer ça... Il n’y a qu’à savoir mater les gens.
ALBERT, à l’huissier, avec une politesse exagérée.
Qu’est-ce que vous prenez, monsieur ?
L’HUISSIER
Merci ! Je suis entré un instant voir un ami qui n’est pas là et je sors.
ALBERT.
Oh ! monsieur ! Vous ne voulez pas me permettre de vous offrir quelque chose, simplement pour vous faire constater que les garçons, ici, sont des garçons modèles et qu’ils régalent les clients, n’importe quels clients. Ils ne sont pas fiers.
L’HUISSIER, à Philibert.
Qu’est-ce que vous voulez que je constate ?
PHILIBERT.
Rien. Il se conduit très bien, maintenant...
Sort l’huissier. À Bigredon.
Je trouve même qu’il se conduit trop bien. C’est un serviteur modèle. Je vais être obligé de le garder pendant vingt ans !
ALBERT, au plongeur.
Me voilà garçon de café pour vingt ans, maintenant... avec quarante mille livres de rentes ! Moi qui voulais me mêler à la vie parisienne, voir des gens de mon monde avec des grues épatantes... faut que je serve des bocks à des margoulins. Mais j’aime mieux être garçon de café que de flanquer deux cent mille francs à cette crapule !
ISABELLE, à Veauchenu.
Une autre partie ?
VEAUCHENU.
C’est la quinzième...
ISABELLE.
C’est la dernière.
À Albert.
Donnez-nous encore des bocks, Albert !
ALBERT, sombre.
Je ne m’appelle plus Albert ; je m’appelle « Ruy Blas » ! « Ruy Blas ou vingt ans de domesticité ! »
ACTE II
La scène représente un salon de restaurant de nuit très élégant. À gauche, premier plan, une table de plusieurs couverts ; au deuxième plan, à droite, une autre table. Une porte au premier plan, à droite, et une autre au deuxième plan, à gauche. Au fond, une large baie donnant sur un couloir à proximité d’autres salons.
Scène première
LE GÉRANT, au premier plan, à droite, UN MONSIEUR en habit et UNE DAME décolletée
On entend une musique de tziganes.
LE MONSIEUR.
Ah ! voilà une table !
LE GÉRANT.
Cette table est retenue, monsieur et madame.
LA DAME.
Celle-là aussi ?
LE GÉRANT.
Celle-là aussi !... Je vais vous trouver de la place dans d’autres salons.
LA DAME.
Oh ! comme c’est ennuyeux ! Moi j’aime bien mieux être ici, c’est plus gai... nous y étions si bien l’autre jour...
Au monsieur.
Tu aurais dû retenir une table !
LE MONSIEUR.
Mais, voyons, chère amie, puisque tu ne t’es décidée à sortir que tout à l’heure !... Puisque nous voulions rester à la maison...
LA DAME.
Tu es toujours le même ! Tu trouves toujours des raisons...
LE MONSIEUR, timidement.
Mais oui, puisque ces raisons existent...
LE GÉRANT.
Venez donc par ici, messieurs, dames, je vous assure que vous serez très bien.
Il fait signe à un maître d’hôtel de les conduire un peu plus loin.
Scène II
AGATHE, IRMA, LE GÉRANT
AGATHE, au gérant.
Bonjour, mon petit Léonce. Il n’y a pas de table ici ?
LE GÉRANT.
Non, tout le monde en veut. Mais il y en a d aussi bien par là.
AGATHE.
Dites donc ?
IRMA.
On a quelque chose à vous dire...
AGATHE.
Oui, une chose un peu délicate...
IRMA.
Dis-lui, toi...
AGATHE.
Non, toi plutôt.
IRMA.
Tout à l’heure, nous soupons ici avec l’ami de mon amie...
AGATHE.
Oui, le commandant Béchut...
LE GÉRANT.
Oui, je sais.
AGATHE.
Et nous ne voulons pas rester longtemps.
IRMA.
Parce que, comprenez-vous, nous sommes attendues ailleurs.
LE GÉRANT.
Je comprends.
AGATHE.
Seulement, nous ne voulons pas avoir l’air pressé. Vous comprenez ?
LE GÉRANT.
Mais oui, je comprends...
AGATHE.
Alors, il faut que ce soit vous qui preniez la commande.
IRMA.
Et que vous ne poussiez pas trop à la consommation...
AGATHE.
Je sais bien que ce n’est pas l’intérêt de la maison.
IRMA.
Mais on se rattrapera un autre soir.
LE GÉRANT.
Mais oui, mais oui... Allez donc !
AGATHE.
Merci, mon petit Léonce !
IRMA.
On va souper par là...
Elles sortent. Entrent Veauchenu et Isabelle.
Scène III
LE GÉRANT, VEAUCHENU, ISABELLE, très élégante
ISABELLE, à la cantonade.
Eh bien, Gabriel ?...
VEAUCHENU, entrant, au gérant.
Vous n’avez pas de table, par ici ?
LE GÉRANT.
Non, messieurs, dames.
Montrant la table de droite.
Celle-ci va être prise immédiatement : les clients sont pour arriver dans un instant. L’autre est retenue pour minuit et demi, et il est déjà minuit passé.
ISABELLE.
Eh bien, celle-là ira très bien ; nous ne voulons pas rester plus de quelques minutes.
À Veauchenu.
Je ne soupe pas...
VEAUCHENU, désappointé.
Pourquoi ça ?
ISABELLE.
Tu sais très bien qu’il vaut mieux que tu ne soupes pas.
VEAUCHENU.
Mais tu m’avais dit qu’on souperait.
ISABELLE.
J’ai changé d’avis.
Au gérant.
Vous donnerez simplement du chocolat... Comme ça, ça ira, ce sera très bien.
VEAUCHENU, boudeur.
Oui, oui.
ISABELLE.
Je te dis que ce sera très bien. Et tu me conduiras chez moi à minuit et demi, puis tu rentreras te coucher immédiatement.
VEAUCHENU.
Si tôt ?
ISABELLE.
À minuit et demi, ce n’est pas tôt. Il faut que tu travailles demain matin. Tu sais bien que tu as une séance de ton conseil d’administration...
VEAUCHENU.
Demain matin ?
ISABELLE.
Certainement.
VEAUCHENU.
Tu es mieux renseignée que moi.
ISABELLE.
Oui, je me suis renseignée. Tu me mentais. Tu me disais que tu n’avais pas conseil, quand tu avais conseil... Et je veux que tu assistes très régulièrement à tes conseils d’administration. Tu n’es vraiment pas d’âge à faire le feignant. Et puis, c’est écœurant de voir un vieillard ne pas s’occuper de ses affaires, alors qu’il a, je ne dis pas toute sa force ni toute son intelligence, mais encore quelques petites facultés... Tu travailleras tant que tu pourras, entends-tu ?
VEAUCHENU.
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
ISABELLE.
Qu’est-ce qu’il y a : Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ?
VEAUCHENU.
Comme tu as changé en moins de trois semaines !
ISABELLE.
Dame ! On a beau être jeune, on devient sérieux à force de fréquenter des gens sérieux.
Levant les épaules.
Des gens sérieux ! sérieux comme tu étais, parce que maintenant, tu as changé encore plus que moi. Tu es devenu un vieux fêtard !
VEAUCHENU, gaiement.
Oui, oui, c’est vrai, je suis devenu un vieux fêtard !
ISABELLE.
Oh ! écoute, je te défends de prendre ces airs-là ! Je déteste ça, entends-tu ? Moi qui étais si contente d’avoir trouvé un camarade respectable, si je m’aperçois que tu n’es qu’un vieux marcheur, je ne serai pas longue à te plaquer.
VEAUCHENU.
Tu étais si gentille au café, il y a trois semaines !
ISABELLE.
Mais tu m’as fait de la morale tout le temps, et je m’en suis souvenu...
VEAUCHENU.
Trop ! ça me plaisait de te faire de la morale. Maintenant, je n’ai plus le même agrément à te morigéner. Tu es d’une sagesse décourageante, tu es plus sage que la Sagesse elle-même. Et tu étais si gaie ! Il faudra y retourner, dans ce petit café.
ISABELLE.
Non, non ! je n’y vais plus, et, tu sais, je te défends d’y aller. Je ne veux pas que tu ailles au café pendant la journée. Si on te laissait faire, tu deviendrais un pilier de café.
VEAUCHENU.
Tout de même, Isabelle, si nous y retournions : ne serait-ce que pour voir Albert, le fameux garçon de café ?
ISABELLE.
Mais nous n’avons pas besoin d’aller là pour le voir, nous le rencontrons dans tous les restaurants de nuit.
VEAUCHENU.
C’est curieux, tout de même !
ISABELLE.
Mais non, ce n’est pas curieux ! Son patron n’a pas voulu lui rendre sa liberté, alors, comme il veut profiter de sa fortune, il fait la noce toute la nuit, aussitôt qu’il a terminé son service au café. Il m’a expliqué ça l’autre jour à « la Paix », quand je l’ai rencontré au lavabo. Il m’a même demandé le secret sur toute cette histoire-là, parce qu’il est maintenant avec Bérengère d’Aquitaine... oui, cette grue épatante qu’il aimait déjà lorsqu’il était garçon de café ! Seulement comme il a eu peur de se faire chiner par Bérengère, il ne lui a pas dit ce qu’il était. Il s’en cache même soigneusement. Elle le prend pour un jeune fils de famille, très occupé dans une banque où l’on travaille jusqu’à minuit.
VEAUCHENU.
C’est une jolie femme ?
ISABELLE.
Je te crois ! Bérengère, c’est une des grues les plus en vue de Paris... Il a voulu l’avoir, il l’a eue. Oh ! quand on a de l’argent !...
VEAUCHENU.
Ah ! la fête !...
ISABELLE, le regardant.
Si ça ne fait pas pitié !
Au garçon.
Garçon ! recevez.
À Veauchenu.
J’ai payé. Je te mène chez toi.
VEAUCHENU.
Mais non, voyons ! Puisque c’est convenu que c’est moi qui te ramène.
ISABELLE, avec autorité.
Pas du tout, comme ça je serai sûre que tu te coucheras de bonne heure, que tu n’iras pas godailler à droite et à gauche, après m’avoir reconduite.
VEAUCHENU.
Oh ! voyons, Isabelle !... Penses-tu que je vais aller faire la fête sans toi ?
ISABELLE.
Je n’ai aucune confiance !...
S’apercevant qu’elle a oublié son sac.
Mon sac ? Eh bien, Gabriel !...
Ils sortent par la baie, au moment où Bigredon et le gérant entrent par la porte à gauche.
Scène IV
BIGREDON, LE GÉRANT
BIGREDON.
Je vous entends dire que cette table est retenue. C’est peut-être pour un ami à moi. Dites-moi donc le nom.
LE GÉRANT, regardant sur un calepin.
Loriflan... M. Loriflan.
BIGREDON, à part.
Bon !
LE GÉRANT.
Vous connaissez ?
BIGREDON, vivement.
Non, non, je ne connais pas.
Haut.
Et cette autre table ?
LE GÉRANT.
Retenue aussi. Par M. Plouvier, un vieil habitué d’ici.
BIGREDON.
Eh bien, je vais en chercher une autre par là. J’attends une personne avec qui je dois souper.
LE GÉRANT.
Une dame ?
BIGREDON.
Pensez-vous que je vais me faire payer à souper par une dame ?
LE GÉRANT.
Non, mais vous auriez pu payer.
BIGREDON, entre ses dents.
Il n’en est pas question... Dans l’après-midi, il n’est pas venu un monsieur Philibert pour retenir une table ?
LE GÉRANT.
Je n’ai pas de table à ce nom-là.
BIGREDON.
Et il n’arrive pas ! Et j’ai faim... je n’ai pas dîné...
LE GÉRANT.
Pour acheter des gants ?
BIGREDON, étonné.
Pourquoi ça ?
LE GÉRANT.
Pour rien, c’est une phrase qu’on dit comme ça.
BIGREDON.
Non, je n’ai pas dîné pour pouvoir manger davantage.
LE GÉRANT.
Faites-vous servir une douzaine d’ostendes en attendant votre ami.
BIGREDON.
C’est que...
À part.
Oh ! il viendra sûrement.
Haut.
L’idée n’est pas mauvaise. Je vais prendre deux ou trois douzaines d’huîtres.
LE GÉRANT.
Avec une bouteille de Pouilly ?
BIGREDON.
Voyons...
À part.
Il viendra...
Haut.
Oui, du vieux Pouilly.
Il sort à droite premier plan.
Scène V
LE GÉRANT, ARTHUR
LE GÉRANT.
Te voilà encore, toi ? Mon vieux, on se connaît, on a été amis, c’est entendu, mais ce n’est pas pour moi que je parle, c’est pour l’établissement... Si tu te figures que c’est agréable d’avoir ici un coco comme toi, et qu’on s’aperçoive que tu touches à la préfecture.
ARTHUR.
Mais personne n’en sait rien.
LE GÉRANT.
Personne n’en sait rien ?... tu prends des airs mystérieux qui font que tout le monde s’aperçoit tout de suite de quoi il retourne et qu’on dit sans hésitation : « En voilà un qui en est !... »
ARTHUR.
Je vais faire un de ces soirs un de ces coups... qui va t’épater.
LE GÉRANT.
Écoute, je souhaite en tout cas que ce ne soit pas ici. Ce n’est pas agréable pour l’établissement. Au revoir, mon vieux, au revoir. Je t’aime bien, mais file ! Voilà du monde qui arrive par ici.
Sort Arthur. Entrent Bérengère d’Aquitaine, Jacqueline Cœur et le jeune Bouzin.
Scène VI
LE GÉRANT, BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN
BÉRENGÈRE.
C’est bien ici la table qu’a fait retenir M. Loriflan ?
LE GÉRANT.
Oui, mademoiselle.
BÉRENGÈRE, aux autres.
C’est ici.
BOUZIN.
Loriflan n’est pas arrivé ?
Ils s’assoient autour de la table.
BÉRENGÈRE.
Non ! non ! non ! voyons ! ce n’est pas son heure.
BOUZIN.
Où est-il donc ?
BÉRENGÈRE.
Il va venir ! Il va venir !
BOUZIN.
Mais, enfin, où est-il ?
JACQUELINE.
Tu ne peux pas nous dire où il est ?
BÉRENGÈRE, les attirant à part, à mi-voix.
Eh bien, je vais vous dire la vérité : je n’en sais rien.
JACQUELINE.
Comment, toi, sa bonne amie ?
BÉRENGÈRE.
Entre nous, je ne suis pas plus renseignée que les autres. Quand il y a du monde, je fais semblant de savoir où il est... ce qu’il fait... pour n’avoir pas l’air poire, mais la vérité, c’est qu’il y a dans sa vie un mystère qui m intrigue terriblement quand j’y pense.
JACQUELINE, intéressée.
Un mystère ?
BÉRENGÈRE.
C est stupéfiant, mais je ne le vois jamais que la nuit ; je ne le vois ni le matin, ni l’après-midi, ni le soir ; de huit heures du matin à minuit, il est invisible pour moi.
JACQUELINE.
C’est bizarre !
BÉRENGÈRE.
Il me donne rendez-vous et il arrive à minuit et demi, quelquefois à une heure moins le quart. Il est toujours fatigué, un peu énervé. Comment voulez-vous qu’il en soit autrement ! C’est un homme qui ne dort presque pas. Nous soupons ici jusqu’à deux, trois heures. À trois heures, on se couche et, jusqu’à ce qu’on dorme, il est encore plus tard. Et savez-vous à quelle heure il se lève ?... À sept heures un quart, tous les matins, il est réveillé par un petit réveille-matin qu’il met toujours à côté de lui.
JACQUELINE.
Oh ! mais, tu sais, ma chère, c’est effrayant, ça ! À ta place, je ne serais pas tranquille du tout. Si c’était un employé de banque qui fasse des détournements ! je serais très embêtée. Je suppose qu’on l’arrête, tu serais poursuivie comme complice.
BÉRENGÈRE.
J’ai eu peur de ça un moment... mais je ne crois pas. C’est de l’argent à lui, va, qu’il a.
JACQUELINE.
Qu’est-ce qui te fait croire ça ?
BÉRENGÈRE.
C’est parce qu’il ne le gâche pas. Je ne dis pas qu’il n’est pas généreux. Mais il est regardant. Ainsi, je lui avais demandé un collier de perles, c’était à peu près promis. Eh bien, il m’a apporté une bague. Il m’a dit : « Je préfère te donner une belle perle, une perle vraiment belle de quinze mille francs qu’une soixantaine de perles médiocres à mille francs. »
BOUZIN.
Ça se soutient.
BÉRENGÈRE.
Il dépense son argent largement, mais il ne perd pas la boule. Il joue. Il s’était mis en tête de gagner deux cent mille francs, je ne sais pas pourquoi. Il me disait : « Je voudrais gagner deux cent mille francs ! » Et puis il a commencé par perdre quelques billets de mille, il l’a trouvée mauvaise ; alors, il s’est arrêté net. Ce n’est pas un homme qu’on peut taper facilement. L’autre jour, le petit Dangeac a essayé de le taper de deux mille francs. Il lui a donné cinq cents francs, rien de plus... Il n’ose pas refuser, parce que ce n’est pas un mauvais garçon, mais, quand une fois il est tapé, il fait une figure d’une tristesse ! Et puis, il ne faut pas y revenir, parce qu’il s’arrange à mettre les tapeurs à l’écart, comme s’ils avaient une maladie contagieuse.
JACQUELINE.
Enfin, moi, tout de même, à ta place je tâcherais de savoir ce qu’il fait de huit heures du matin à minuit. En admettant qu’il soit occupé dans une banque, il ne serait pas occupé jusqu’à minuit. Pourquoi ne le fais-tu pas filer ?
BÉRENGÈRE.
Oh ! je ne veux pas m’en mêler. Sur cette question, tu sais, cette question du mystère de sa vie, il est tellement terrible ! Qu’est-ce que tu veux, j’ai un amant gentil qui me plaît assez ; en admettant que j’en trouve un autre beaucoup mieux, eh bien, je verrai. Évidemment, celui-là n’est pas l’idéal, d’autant qu’il est un peu embêtant tout le temps à me demander si je l’aime pour lui-même !... Comme si j’en savais quelque chose ! Puis il a des idées... il veut que j’apprenne le piano, il voudrait que je prenne des leçons d’anglais. Il me rase.
JACQUELINE.
C’est tout de même utile de savoir l’anglais.
BÉRENGÈRE.
Pourquoi ça ?
JACQUELINE.
Parce que, quelquefois, on rencontre des Anglais qui ne savent pas le français.
BÉRENGÈRE.
Eh bien, ce sont les meilleurs. Jamais je n’ai vu un homme m’écouter avec autant d’attention que lorsqu’il ne comprenait pas ce que je disais... Il y en avait un comme ça : un Italien. Il était en admiration, il voulait toujours que je lui parle, et il disait à un monsieur, qui m’a traduit la phrase, que j’étais la femme la plus intelligente qu’il connaissait.
JACQUELINE.
Mes enfants, je pense à une chose !
BÉRENGÈRE.
Tu m’étonnes.
JACQUELINE.
C’est que je suis toute défrisée... Je vais aller me mettre de la poudre.
BÉRENGÈRE.
Oh ! ce qu’elle est coquette, cette femme-là ! Je vais avec toi.
Elles sortent ainsi que Bouzin.
Scène VII
PHILIBERT, BIGREDON, rentrant chacun par un côté
BIGREDON.
Enfin, vous voilà ! Pourquoi est-ce que vous n’êtes pas venu retenir une table, comme je vous avais dit ?
PHILIBERT.
Quand on retient une table, il faut consommer beaucoup. Et puis, je ne sais pas vraiment ce que nous venons faire ici ?
BIGREDON.
Mais nous venons surveiller Albert, ou plutôt le troubler dans son plaisir.
PHILIBERT.
Monsieur Bigredon, vous êtes un homme de la plus vaste intelligence, c’est entendu, mais vous êtes trop compliqué et trop ténébreux. À quoi ça nous sert-il de le troubler dans son plaisir ?
BIGREDON.
À quoi cela sert-il ? Mais quand il vient s’amuser et faire la fête dans les établissements de nuit, il oublie qu’il est garçon de café... Nous venons nous dresser devant lui...
PHILIBERT.
Comme des fantômes, je sais, vous me l’avez dit. Mais qu’est-ce que ça peut bien lui faire ?
BIGREDON.
Eh bien, il finira par se lasser de la vie qu’il mène et vous donnera son congé. Je sais que ça le travaille et qu’il est allé consulter un homme de loi pour lui montrer son traité. Mais il se trouve que ce soi-disant homme de loi lui avait été indiqué par une de mes créatures, et que, de connivence avec moi, il lui a déclaré qu’il n’y avait rien à faire et que son traité était parfaitement valable.
PHILIBERT.
Monsieur Bigredon, vous êtes trop ténébreux ! Le résultat de tout ça, c’est qu’il va rester à mon service pendant vingt ans. Je vais être forcé prochainement de lui verser son mois, qui s’élève au douzième de cinq mille francs, soit quatre cent seize francs et des centimes. Jamais un garçon de café n’a eu un fixe pareil, et il a encore les pourboires en plus. Il y a bien des gens qui font les farauds ici et qui n’ont pas une aussi belle situation. Par-dessus le marché, vous me conduisez dans les restaurants chers où je viens consommer en une soirée ma sueur de toute une quinzaine. Vous allez me faire le plaisir de prendre simplement une tasse de chocolat.
BIGREDON.
Après trois douzaines d’huîtres et une bouteille de Pouilly ? Non, non, il faut faire un souper sérieux. Est-ce que vous seriez content si on vous retenait une table pour ne rien consommer ?
PHILIBERT.
Jamais le patron du restaurant ici n’aurait l’idée de retenir une table dans mon établissement. Est-ce que c est l’affaire d’un patron de venir payer de la nourriture dix ou douze fois plus cher qu’aux Halles ?
BIGREDON.
Ils ont des frais généraux.
PHILIBERT.
Mais ce n’est pas à moi à les payer. Il ne manque pas de clients pour ça.
BOUZIN, à la cantonade.
Garçon !... Garçon !...
PHILIBERT, allant au fond.
Garçon !
UN GARÇON.
Qu’est-ce qu’il y a ?
PHILIBERT.
Voyez donc là.
À Bigredon.
Allons-nous-en ! Le service est mal fait, ça m’énerve !
BIGREDON.
Mais non, monsieur Philibert. J’ai mon plan. Nous le poursuivrons. Nous ferons au besoin tous les restaurants de Paris.
PHILIBERT.
Vous les ferez sans moi. Monsieur Bigredon, vous êtes un homme de la plus vaste intelligence, mais, outre que vous êtes trop ténébreux, vous aimez trop faire des enquêtes dans les restaurants.
BIGREDON.
C’est mon faible. Et je pousse le dévouement jusqu’à ne rien manger chez moi pour pouvoir manger ici.
PHILIBERT.
On s’en aperçoit.
En sortant, au garçon.
Garçon... Un coup de cachemire sur cette table.
Le garçon le regarde étonné. Sortent Philibert et Bigredon. Entre Edwige, suivie des quatre chanteuses hongroises.
Scène VIII
EDWIGE, LE GÉRANT, QUATRE CHANTEUSES
EDWIGE.
Non ! Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas possible !
LE GARÇON.
Qu’est-ce qu’il y a !
EDWIGE.
Nous ne pouvons pas rester près de la porte d’entrée, il y a un va-et-vient perpétuel.
LE GÉRANT, arrivant.
Mais qu’est ce que c’est que ça ?
EDWIGE.
Eh bien, c’est nous, les cinq sœurs magyares !... Nous avons été engagées cet après-midi par votre patron à l’Exposition des Arts de l’Ameublement. Nous chantions tous les soirs dans un restaurant du Bois, nous en avions pour un mois encore, mais il ne vient presque personne là-bas, en ce moment. En quinze jours, nous avons fait trois francs de quête. Alors je n’ai pas hésité, je les ai plaqués pour venir ici...
LE GÉRANT, au garçon.
Il a toujours des idées comme ça, le patron. Moi, je trouve que ça n’est pas bon genre, des orchestres de dames.
LE GARÇON.
Des violonistes tziganes, tout au plus !
EDWIGE.
Où allez-vous nous mettre ? Près de la porte d’entrée, il y a trop de courants d’air.
LE GÉRANT.
Eh bien, vous allez vous installer sous le grand escalier.
Après l’avoir regardée.
Attendez donc ! Mais il me semble que je vous connais, vous... Ces dames, ce sont vos sœurs ?
EDWIGE.
Oui, monsieur, ce sont mes quatre sœurs magyares.
LE GÉRANT.
Qu’est-ce que vous faites de vos quatre autres sœurs ?
EDWIGE.
Mes quatre autres sœurs ?
LE GÉRANT.
Oui, vos quatre autres sœurs norvégiennes... que vous aviez l’année dernière, à la Taverne anglaise ?
EDWIGE.
Vous les avez connues ?
LE GÉRANT.
Mais oui.
EDWIGE.
Elles ne sont plus mes sœurs... ce sont ces dames qui sont mes sœurs, qui le sont depuis le mois dernier...
LE GÉRANT.
Mais ce sont de vraies magyares ?
EDWIGE.
Oh ! naturellement ! voyons ! cette vieille histoire de prendre des gens des Batignolles pour figurer des chanteuses étrangères !... Comme si ce n’était pas les, femmes de Paris qui coûtent le plus cher ! Celles-là arrivent directement du pays. Elles sont vierges toutes les quatre... Elles ont une très jolie voix, vous savez !... Et elles obéissent ! je n’ai qu’à lever mon archet pour les faire partir et les mener militairement. Vous allez voir.
Elle lève son archet, elles se mettent à chanter à tue-tête quelques mesures d’une chanson hongroise.
LE GÉRANT, interrompant.
Assez ! assez ! Dites donc, vous ne chanterez pas des morceaux trop longs...
EDWIGE.
Non, non, très courts, c’est mon système. On chante plus souvent, voilà tout, et on fait une quête après chaque morceau.
LE GÉRANT.
Ah ! non, non ! Je ne veux pas de ça ! Ici, vous n’allez pas raser les gens tout le temps... vous ferez, la quête pas plus de trois fois dans la nuit.
EDWIGE.
C’est pas bésef ! Enfin !
LE GÉRANT.
Venez par là...
EDWIGE.
Attendez, il faut avoir bien ma petite troupe dans la main... il faut que je la conduise en musique, et puis, il faut qu’elles chantent le plus possible, autrement elles ont le mal du pays.
En hongrois.
La Petite Sœur. Attention !
Elles s’en vont en chantant, suivies d’Edwige qui reste seule en scène et répète l’air de sortie en l’accompagnant sur son violon. À ce moment, Bérengère et Jacqueline s’arrêtent sur le pas de la porte.
Scène IX
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, LE GÉRANT, puis GASTONNET et PLOUVIER, puis BOUZIN
BÉRENGÈRE, au gérant.
Elle a une très jolie voix, cette femme-là !
LE GÉRANT.
Oui, oui, c’est des femmes hongroises que le patron a engagées aujourd’hui... Ça n’est peut-être pas une très bonne idée...
JACQUELINE.
Si, si, c’est très amusant...
À Bérengère.
C’est très gentil ce qu’elle chante !
BÉRENGÈRE.
Oh ! j’ai faim !...
JACQUELINE.
Et Albert qui n’arrive pas !
Elles vont s’asseoir à une table. Entrent Henri de Gastonnet et Plouvier. Henri est un jeune homme de province et Plouvier, un clubman un peu fatigué.
LE GÉRANT, à Plouvier.
Voilà votre table... Mais vous avez bien fait de la retenir, vous savez, parce que nous avons un monde, ce soir...
GASTONNET.
Vous l’aviez retenue cet après-midi ?
LE GÉRANT.
Oui, par téléphone ! Ah ! monsieur Plouvier la connaît. Il sait qu’il doit y avoir presse, ce soir. C’est un jour à ça. Je ne demande pas ce qu’il faut servir à ces messieurs. C’est toujours le souper de monsieur Plouvier...
GASTONNET.
Comme vous êtes connu partout ! Ça me flatte de sortir avec vous, un vieux Parisien... non, non, un vrai Parisien...
PLOUVIER, accent du Midi très prononcé.
Vous pouvez dire un vieux Parisien !
GASTONNET.
Mais came donne l’impression d’être si obscur... Ah ! quand on arrive de Poitiers à Paris, vous savez, on est impatient de se sentir en vue...
PLOUVIER.
Bah ! laissez donc, mon ami... Avec l’intelligence naturelle que vous avez, vous serez connu en moins de six mois.
GASTONNET.
C’est long ! c’est long ! Croyez-vous qu’il faille six mois ?
PLOUVIER.
À moins d’avoir tout de suite une histoire retentissante... Ah ! mais ça, ça n’existe plus, c’était bon sous l’Empire. Maintenant, les gens qui s’amusent ne s’occupent pas beaucoup les uns des autres... Et puis, c’est tellement mêlé partout, il y a du monde de tous les pays, de toutes les classes de la société, personne de la même éducation, personne ne parle la même langue. Ainsi moi, qui suis un Parisien de race, le croiriez-vous, je ne suis même pas né à Paris.
GASTONNET.
Vraiment ! Ah ! c’est égal ! Si vous pouviez trouver une façon de me mettre en évidence, ça me ferait tellement plaisir. Tenez, si j’étais l’amant d’une grue célèbre !
PLOUVIER.
Oh ! mais, ça, c’est plus difficile que tout ce que vous me demandez là... Ce serait plus aisé d’être l’amant d’une femme du monde.
GASTONNET.
Qu’est-ce que c’est que ces femmes-là, à côté ?
PLOUVIER, après avoir regardé au salon.
La grande blonde, c’est Bérengère d’Aquitaine, une des femmes de Paris les plus en vue... Eh bien, tenez, celle-là, elle doit avoir un amant nouveau : je la vois, depuis une quinzaine, avec un jeune homme que je ne connais pas, ça doit être évidemment un garçon très bien.
GASTONNET.
Et l’autre petite, avec elle ?
PLOUVIER.
On l’appelle Jacqueline Cœur... c’est un oiseau de second ordre... de l’avenir... Voulez-vous que je vous présente ?
GASTONNET.
Si je le veux !
PLOUVIER, se levant et allant à Bérengère.
Bonjour, comment allez-vous ?
À Bouzin qui entre.
Bonjour, Bouzin !
Faisant les présentations.
Mon ami le vicomte Henri de Gastonnet, mademoiselle Bérengère d’Aquitaine, monsieur Bouzin, mademoiselle Jacqueline...
JACQUELINE.
Cœur !
PLOUVIER.
Cœur ?
JACQUELINE.
Jacqueline Cœur !
PLOUVIER.
Jacqueline Cœur.
LE GÉRANT.
Ces messieurs sont servis... les œufs à la Napoule doivent être mangés très chauds.
BÉRENGÈRE.
Vous allez manger ? Vous avez de la veine, vous !
PLOUVIER.
Si le cœur vous en dit ?...
BÉRENGÈRE.
Oh ! non... nous sommes obligées d’attendre Albert...
Plouvier et Gastonnet s’inclinent et se mettent à table. Bérengère, se levant.
Ah ! tu sais, tu sais, cet Albert !...
JACQUELINE, l’apercevant.
Ah ! le voilà !
Le gérant, qui était sorti par la droite, rentre, précédant Albert.
Scène X
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, GASTONNET, PLOUVIER, BOUZIN, ALBERT, LE GÉRANT, puis LE GARÇON
Albert est très chic, en chemise molle, en macfarlane doublé de soie ; il donne son chapeau à un maître d’hôtel qui vient derrière lui ; Albert paraît assez ennuyé.
BÉRENGÈRE, à Albert.
Enfin, te voilà ! Tu ne pouvais pas arriver plus tard ?
ALBERT.
Non, ne me dispute pas. Je suis déjà assez embêté de la vie que je mène ; je marronnais assez de ne pas pouvoir venir, j’étais retenu par de grands industriels anglais...
À part.
Trois gaziers au café qui faisaient une manille, ces cochons ! Ils ne s’en allaient pas, j’avais beau leur dire qu’on fermait ! Oh ! oh ! quelle existence !
LE GÉRANT.
Qu’est-ce que je dois vous faire servir ?
ALBERT.
Envoyez-moi un garçon, je lui donnerai la commande.
Le gérant s’incline.
Bon ! Bon !
S’asseyant, pendant que le gérant s’éloigne.
Il me dégoûte ce gérant-là ! je déteste les gérants ! J’aime encore mieux les patrons que les gérants... C’est vrai ! C’est toujours à faire les malins avec le garçon, et qu’est-ce que c’est de plus qu’un garçon, un gérant, je vous le demande ? C’est un salarié comme les autres !
BÉRENGÈRE.
Albert ! Ne te fais pas de bile avec ça !
ALBERT, convaincu.
Je déteste les gérants.
LE GARÇON.
Qu’est-ce que ces messieurs et ces dames désirent ?
ALBERT.
Qu’est-ce que vous proposez ?
À Bérengère.
Je lui demande ça pour savoir ce que je ne dois pas prendre.
LE GARÇON.
Des croquettes de volaille...
ALBERT.
Tu peux les garder tes croquettes, je les connais !...
À Bérengère.
Je vous dirai un jour ce qu’ils fourrent là-dedans.
Au garçon.
Tu vas commencer par nous donner des œufs brouillés... pas au fromage ! Tes vieux morceaux de fromage, tu les serviras à quelqu’un d’autre. À nous, donne-nous des pointes, des pointes d’asperges, ça ne se truque pas.
LE GARÇON.
Après ça ?... de la viande froide ?
ALBERT.
Non ! tu ne m’as pas regardé, toi et ta viande froide qui s’est baladée sur toutes les tables !... qui a trainé dans le garde-manger depuis deux jours, que ton sale cuisinier a attrapée avec ses doigts pour la poser dans le plat. Non, mon vieux, tu me prends pour un autre !
BÉRENGÈRE.
De la viande chaude, alors ?
ALBERT.
Prenez-en si vous voulez, moi, je n’ai même pas confiance dans la viande chaude.
LE GARÇON.
Un chateaubriand aux pommes ?
BÉRENGÈRE.
Je veux bien.
LE GARÇON.
Et comme dessert ? Des fruits rafraîchis ?
ALBERT, avec dégoût.
Ah !
BÉRENGÈRE, à Albert.
Mais tu es dégoûtant, voyons ! nous avons faim, nous !
ALBERT.
Tout ce qui reste de fruits sur les assiettes, les grains de raisins oubliés, les prunes entamées qu’on a mordues, tout ça, ça passe aux fruits rafraîchis.
LE GARÇON.
Je demande pardon à monsieur, ça dépend des maisons. Ici, monsieur n’a qu’à venir voir comment c’est qu’on les fait !
ALBERT.
Enfin ! Servez des fruits rafraîchis à ces dames. Moi, je m’en vais prendre un camembert non entamé... comme ça, en enlevant la croûte je serai sûr de manger quelque chose de propre.
Le sommelier s’approche.
Scène XI
LES MÊMES, LE SOMMELIER
LE SOMMELIER.
Et en vins, que désirent ces messieurs et dames ?
JACQUELINE.
Du Champagne, très sec, pas ?
BÉRENGÈRE.
Moi, j’aimerais bien un verre ou deux de bon Bourgogne.
LE SOMMELIER.
Nous avons du Pommard 81.
ALBERT.
Comment que tu dis ?
LE SOMMELIER.
81.
ALBERT.
Ça fait trente ans ! Je te demande l’âge de ton Pommard. Je ne te demande pas l’âge de ta sœur !... Combien que tu le fais payer ton Pommard ?
LE SOMMELIER.
Quinze francs la bouteille.
ALBERT.
Ah ! mon vieux, tu sais, ce n’est pas assez cher : tu ne me feras jamais croire qu’il a trente ans. Enfin, donne à ces dames de ce Pommard qui est si bien conservé pour son âge. Moi, je vais me payer une bouteille de vin blanc ordinaire à trois francs. Comme ça, je ne serai refait que de deux francs vingt-cinq...
BÉRENGÈRE.
Dépêchez-vous de nous servir tout de suite.
Le sommelier et le garçon s’éloignent. À Albert.
Tu sais que tu es insupportable avec ce garçon, à chipoter, à le taquiner. Comme tu finis toujours par payer !
ALBERT.
C’est vrai que je finis toujours par payer... et ce n’est pas ce qu’il y a de plus drôle !...
BÉRENGÈRE.
Tu sais, mon vieux, si tu en as assez, tu n’as qu’à le dire !
ALBERT, douloureusement, à lui-même.
Toujours le marché en main !... Je ne sens chez cette femme aucune affection, aucune expansion... Rien que le vil intérêt... la cupidité.
BÉRENGÈRE.
Qu’est-ce que tu as à mâchonner ?
ALBERT.
Je fais des comptes...
Reprenant, à lui-même.
Le vil intérêt ! la cupidité ! la sordide cupidité ! le grappin sur moi ! je suis celui qu’on exploite !... Pas un élan du cœur !
BÉRENGÈRE.
Tu n’as pas bientôt fini ?
ALBERT.
Dans un instant.
À lui-même.
Pas un élan du cœur, pas un mouvement généreux ! Et cependant, tel est l’empire de la beauté sur la pauvre âme masculine, que, lâchement, bassement, je reste attaché à elle... Tout ça, c’est bien triste... Allons ! allons ! fouettons-nous... n’en parlons plus.
Haut, d’un air sombre.
Nous sommes ici pour festoyer, festoyons ! Vive la joie ! Bon, voilà M. Philibert !... Qu’est-ce qu’il vient faire ici, celui-là ?
Scène XII
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN, GASTONNET, PLOUVIER, à leurs tables, à l’avant-scène, PHILIBERT, ALBERT
ALBERT.
Tiens ! du monde de connaissance.
À mi-voix.
Bonjour, patron.
PHILIBERT.
Bonjour, Albert.
ALBERT.
Comme on se rencontre !
PHILIBERT.
Vous aimez faire la fête, à ce que je vois ?
ALBERT.
Pas mal, pas mal ! Et vous aussi, à ce que je vois ?
PHILIBERT.
Pas mal, pas mal !... Je suis venu souper avec... avec un ami. Mais il a meilleur appétit que moi... Et vous, vous êtes aussi avec des personnes de connaissance ?
ALBERT.
Oui, oui, elles ont aussi bon appétit.
PHILIBERT, regardant Bérengère.
Une jolie femme, fichtre ! Et elle vous aime beaucoup ?
ALBERT.
Énormément.
PHILIBERT.
Est-ce qu’elle sait que vous êtes... employé dans un café ?
ALBERT.
Je l’ignore. Mais s’il y a des gens qui sont venus ici pour lui raconter des choses, je suis bien capable de leur casser la figure.
PHILIBERT, le calmant.
Il n’est pas question de ça. Qu’est-ce que vous allez chercher ?... Non, je suis venu ici... pour m’amuser.
ALBERT.
À la bonne heure. Et vous vous amusez ?
PHILIBERT.
Énormément.
ALBERT.
Allons, tant mieux !
PHILIBERT.
Ça ne vous fatigue pas trop de vous coucher si tard, quand vous êtes obligé de vous lever si matin ?
ALBERT.
Je n’ai pas besoin de sommeil.
PHILIBERT.
Vous n’avez pas bonne mine.
ALBERT.
Si vous trouvez que je me fatigue trop et que je ne fais plus l’affaire, vous n’avez qu’à vous rendre au bureau de placement. Vous trouverez bien à me remplacer.
PHILIBERT.
Il n’est pas question de ça... Enfin, si vous voulez vous éreinter, c’est votre affaire. Vous pouvez faire la fête, vous en avez les moyens. Vous devez même savoir ce que ça vous coûte.
ALBERT.
Hé bien, oui. Ici, ce n’est pas les prix des Ternes.
PHILIBERT.
Quarante sous un verre de fine !
ALBERT.
Ils la paient aussi plus cher que vous.
PHILIBERT.
Guère plus !
ALBERT.
Et puis, les verres sont plus grands.
PHILIBERT.
Dix-huit au litre, au lieu de vingt-cinq ou trente. À quarante sous, on s’y retrouve quand même.
ALBERT.
Il doit y avoir du coulage.
PHILIBERT.
Les garçons...
ALBERT.
Et le gérant... Mais il faut que chacun gagne sa vie. Les garçons ne sont pas bien payés. Ils ne gagnent pas quatre cent seize francs par mois.
PHILIBERT, sombre.
Quatre cent seize francs...
ALBERT.
Voyez-vous, depuis que je fais la fête et que je vois comment l’argent file, je me trouve assez heureux... Une supposition que je vienne à me ruiner, d’avoir toujours cette bonne petite place chez vous pendant vingt ans...
PHILIBERT, suffoqué.
C’est honteux !... Mais ça ne se passera pas comme ça ! Vous verrez, vous aurez beau me menacer...
ALBERT.
Je ne vous crains pas.
Inquiet, à part.
Qu’est-ce qu’il va me faire ? J’ai bien envie d’aller dans un autre restaurant...
UN GARÇON, s’approchant de Philibert.
Monsieur, il y a votre ami, le monsieur qui soupe avec vous...
PHILIBERT.
M. Bigredon ?
LE GARÇON.
Je ne sais pas comment vous l’appelez. Mais il n’est pas bien... Comprenez-moi. Il est un peu parti, mûr, si vous voulez. Enfin, il a le nez sale...
PHILIBERT.
Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ?
LE GARÇON.
Il faudrait le ramener chez lui. Et puis, voici l’addition...
Le garçon présente l’addition sur une assiette. Philibert soulève le papier avec précaution, y jette un coup d’œil et se hâte de le replier, pendant que son visage exprime un grand stoïcisme.
Il faudrait emmener ce monsieur. Nous n’avons pas l’habitude de faire payer la casse aux clients, mais il y a une glace derrière lui qui est en danger, et, s’il la cassait, nous serions forcés...
PHILIBERT.
Je vais l’emmener !
LE GARÇON.
Il n’est vraiment pas bien, vous savez !
PHILIBERT.
Mais moi non plus !
Il sort à droite avec le garçon.
ALBERT.
Enfin ! Un bon débarras ! Je n’étais pas tranquille !
BÉRENGÈRE.
Eh bien, est-ce que tu es avec nous, maintenant ?
ALBERT.
Oui, je viens d’avoir un petit souci... Mais c’est passé... Nous sommes ici pour nous amuser. Nous sommes dans un restaurant chic, avec des créatures superbes...
La musique commence doucement.
On boit, on mange. On entend de la jolie musique... C’est joli, ce morceau...
BÉRENGÈRE.
Mais tu vas entendre chanter la violoniste : elle a une voix prenante.
ALBERT.
Je ne sais pas si elle a une voix prenante, mais elle est toujours moins épatante que la voix d’une femme que j’ai connue et qui chante au pavillon du Bois !
BÉRENGÈRE.
Attends un peu, tu verras...
ALBERT.
Nous allons rester ici le plus longtemps possible, ce soir, je veux me griser de ce bruit de fête... nous allons rester toute la nuit, toute la nuit !
À ce moment, on entend la voix d’Edwige qui chante. Albert se lève, effaré.
Allons-nous-en !
BÉRENGÈRE.
Mais qu’est-ce que tu as ?
ALBERT.
Rien ! rien !... C’est une chanson de mon enfance que chantait ma grand’mère...
BÉRENGÈRE, à Bouzin.
Est-il impressionnable !
ALBERT.
Je vais m’en aller !
BÉRENGÈRE.
Tu es fou !
La voix continue à chanter.
ALBERT, à un garçon.
Garçon !... Donnez-moi mes vêtements !
À Bérengère.
Nous allons dans un autre café.
BÉRENGÈRE.
Ah ! non, par exemple. Nous avons commandé maintenant, nous restons ici.
ALBERT.
Je t’en prie ! Je ne veux pas rester ici ; quand j’entends cette chanson, je suis malade.
BÉRENGÈRE, bas, au garçon, pendant qu’Albert se lève.
N’apportez pas ses vêtements et allez dire à la chanteuse qu’elle s’arrête, qu’il y a quelqu’un de malade...
BOUZIN.
Mais restez donc avec nous.
ALBERT, au garçon.
Eh bien, mon chapeau, mon pardessus ?
BÉRENGÈRE, se levant.
Tu vas me faire le plaisir de rester ici, maintenant... Tu es bête, avec ta chanson ! D’abord, c’est fini, elle ne chante plus, elle ne chante plus.
ALBERT.
C’est égal, je veux m’en aller.
BÉRENGÈRE.
Oh ! tu m’embêtes, je veux souper. On apporte les œufs...
Le garçon entre en effet avec le plat.
ALBERT.
Pourquoi n’apporte-t-il pas mes vêtements ?
Il remonte un peu vers le fond. À ce moment, Edwige paraît, tenant une assiette à la main pour la quête.
Scène XIII
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN, GASTONNET, PLOUVIER, PHILIBERT, ALBERT, EDWIGE
EDWIGE, avec un mouvement de surprise, à mi-voix.
Tiens ! qu’est-ce que tu fais ici ?
ALBERT, troublé.
Eh bien...
EDWIGE.
Tu es employé ici, maintenant ?
ALBERT, mettant vivement sur son bras la serviette qu’il tient à la main.
Oui, oui !
EDWIGE.
Elle est bonne, celle-là ! Depuis quand ?
ALBERT.
Hé bien... depuis tout à l’heure.
EDWIGE.
Moi aussi, j’ai quitté le pavillon du Bois aujourd’hui et on m’a engagée ici... Ah ! tu as quitté ton café ?
ALBERT.
Non, non... je ne viens ici qu’à minuit, pour remplacer quelqu’un.
EDWIGE.
Mais tu vas te crever, mon pauvre vieux !
ALBERT.
Oh ! non, non, je suis courageux...
EDWIGE.
Crois-tu ! quel heureux hasard de se trouver ici tous les deux ?
ALBERT.
Oui, oui, oui... c’est un heureux hasard !
EDWIGE.
Mais ce qui m’embête, c’est que tu vas voir des femmes ici, des tas de grues.
ALBERT.
Oh ! non, non, non ! Il n’y a pas de danger !
PLOUVIER, à table.
Garçon !
EDWIGE, à Albert.
On appelle !...
ALBERT, effaré, va pour aller à la table de Plouvier.
Non, non, ce n’est pas ma table...
BÉRENGÈRE.
Qu’est-ce qu’il a donc à causer avec la chanteuse ?
Tout haut.
Albert !
ALBERT.
Voilà !
EDWIGE.
Elle connaît déjà ton nom ?
ALBERT.
Oui, oui, ces femmes-là aiment bien appeler les garçons par leur nom. Elle m’a demandé le mien, tout à l’heure...
EDWIGE.
Attention ! Ces grues-là sont beaucoup trop familières avec les garçons, méfie-toi !
Elle s’approche de la table de Plouvier en tendant son assiette.
BÉRENGÈRE, à Albert.
Eh bien, Albert !...
ALBERT, s’approchant et restant debout.
Qu’est-ce qu’il y a ?
BÉRENGÈRE.
Tu ne t’assois pas ?
ALBERT, regardant encore du côté d’Edwige.
Je vais m’asseoir... tout à l’heure !
BÉRENGÈRE.
Qu’est-ce que tu as donc à lui dire, à cette chanteuse ?
ALBERT, légèrement troublé.
Quelques renseignements sur la Hongrie...
BÉRENGÈRE.
Donne-moi donc un louis que je lui donne.
ALBERT.
Un louis ?
BÉRENGÈRE.
Oui, parce que je lui ai fait dire de s’arrêter, tout à l’heure. Elle s’est arrêtée tout de suite. Elle est très gentille. Je lui ai dit de ne plus chanter parce que ça te rendait malade.
ALBERT.
Non, non ! il faut qu’elle chante, il faut qu’elle chante tout le temps...
À part.
Au moins, quand elle chante, elle n’est pas ici...
BÉRENGÈRE.
Eh bien, vrai !... tu en changes d’avis, tu sais, dans une soirée !... Allons, assieds-toi donc !...
ALBERT.
Non, non, non, j’aime mieux pas, j’ai des crampes dans les jambes...
Il s’éloigne un peu de la table.
EDWIGE, revenant de la table de Plouvier, et allant à Albert.
Les types, là-bas, m’ont donné quarante sous...
Elle s’approche de la table de Bérengère.
BÉRENGÈRE.
Tenez, voilà vingt francs. C’est moi qui vous ai priée de cesser, tout à l’heure, mais vous pouvez continuer... mon ami va mieux.
EDWIGE.
Je vous remercie, madame, vous êtes bien aimable...
Elle s’incline et s’éloigne. En passant devant Albert.
Devine un peu ce qu’elle m’a donné, la grue, là-bas ?
ALBERT, sombre.
Vingt francs !
EDWIGE.
Tout juste... Tiens, prends donc ces quarante sous-là.
ALBERT, se défendant.
Je te remercie.
EDWIGE.
Tu es bête ! C’est de bon cœur.
Lui mettant les deux francs dans la main.
Veux-tu bien prendre ça... Si tu ne les prends pas, je suis fâchée...
ALBERT, les empoche.
Allons ! Ça ne m’aura coûté que dix-huit francs !
Sort Edwige.
Scène XIV
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN, GASTONNET, PLOUVIER, PHILIBERT, ALBERT
BÉRENGÈRE.
Eh bien, Albert ?
ALBERT, regardant autour de lui, avec inquiétude.
Je viens ! Je viens !
BÉRENGÈRE.
Eh bien, tu ne t’assois pas ?
ALBERT.
Pas encore.
Il entend tout à coup la musique, tranquillement, il s’assoit.
Ça y est... elle joue...
BÉRENGÈRE.
Tu ne manges pas ?
ALBERT.
Je n’ai pas faim...
BÉRENGÈRE.
Oh ! tu es gai, ce soir ! Tu devrais bien te mettre en frais pour Bouzin et Jacqueline.
BOUZIN.
Mais non, ça ne fait rien.
JACQUELINE.
Laisse-le donc !
BÉRENGÈRE.
Écoute-moi : j’en ai assez de ces histoires-là ! Tu vas me faire le plaisir de souper très gentiment avec nous et d’être un peu moins nerveux.
ALBERT.
Je n’ai pas faim !
BÉRENGÈRE.
Tu sais que, si tu te conduis comme ça avec moi, je ne serai pas longue à te plaquer !
ALBERT.
Mais non !
BÉRENGÈRE.
Tu crois peut-être que je serai en peine de trouver un autre ami ? Je n’aurai pas quinze pas à faire. Regarde ce petit jeune homme du Poitou, qui est à la table de là-bas : il s’appelle Gastonnet... ou Gasconnet, je ne sais plus ; Plouvier me l’a présenté tout à l’heure.
ALBERT.
Tu es méchante avec moi ! tu profites de ce que je suis un homme tendre et délicat, et de ce que je ne peux pas quitter les femmes. Mais si tu m’exaspères, je te quitterai !
BÉRENGÈRE.
Moi, je ne veux pas qu’on me quitte. Je te quitterai si je veux, mais je ne supporterai pas que tu me plaques ! Dans ma position, on n’a pas le droit de se laisser plaquer. Si tu me plaques, je te tire dessus un coup de revolver. Je m’arrangerai pour ne pas te tuer ; je t’enverrai une balle dans le bras, par exemple, mais quelque chose qui fasse un peu de bruit à Paris. Ça me suffira...
ALBERT.
Et à moi aussi.
BÉRENGÈRE.
Veux-tu me faire le plaisir de souper avec nous ?
Albert va se mettre à manger, mais il se gratte l’oreille et, ri entendant plus la musique, il se lève de nouveau.
ALBERT, à part.
Ça y est ! Elle ne joue plus !
BÉRENGÈRE.
Voilà que tu te lèves encore ! C’est trop fort !
Appelant.
Plouvier !
PLOUVIER.
Qu’est-ce qu’il y a ?
BÉRENGÈRE.
Venez donc à notre table, on fera de la place : ce sera plus amusant.
PLOUVIER.
Je veux bien, d’autant que nous avons fini.
Il s’approche.
BÉRENGÈRE, faisant les présentations.
Monsieur Albert Loriflan... Monsieur Plouvier... Monsieur Gasconnet.
GASTONNET.
Gastonnet !...
BÉRENGÈRE.
Gastonnet ! Ça ne fait rien. Asseyez-vous donc, messieurs.
Ils s’assoient. À Albert.
Assois-toi, maintenant !
ALBERT.
Oui.
Il va pour s’asseoir, mais apercevant Edwige, au fond, qui vient faire la quête, il reste debout et s’éloigne un peu de la table.
Scène XV
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN, GASTONNET, PLOUVIER, PHILIBERT, ALBERT, EDWIGE
JACQUELINE.
Tiens ! la chanteuse !
BÉRENGÈRE.
Ah ! mes enfants, puisque la chanteuse est là, nous allons lui faire chanter pour nous seuls une chanson ! Oh ! elle en chantait une charmante tout à l’heure !
Haut, à Edwige.
Madame !
EDWIGE, rectifiant.
Mademoiselle !
BÉRENGÈRE.
Hé ! bien, mademoiselle... mademoiselle la chanteuse, voulez-vous nous chanter une chanson, une chanson pour nous... de préférence une chanson sentimentale ?
EDWIGE.
Je veux bien.
Elle va faire un signe aux quatre chanteuses. Le gérant paraît à droite avec Arthur.
Scène XVI
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN, GASTONNET, PLOUVIER, PHILIBERT, ALBERT, EDWIGE, ARTHUR, LE GÉRANT
ARTHUR, au gérant.
Tu vois, celui-là qui est debout : d’après les conversations qu’on a entendues tout à l’heure, il est tout à fait suspect... on ne sait pas ce qu’il fait de ses journées ; je lui ménage quelque chose.
LE GÉRANT.
Oh ! tu m’embêtes, tu sais ! Va-t’en ! Va t’asseoir ! Je ne veux pas de scandale dans cet établissement.
Arthur sort par la gauche.
Scène XVII
BÉRENGÈRE, JACQUELINE, BOUZIN, GASTONNET, PLOUVIER, PHILIBERT, ALBERT, EDWIGE, LE GÉRANT
LE GÉRANT, à Albert.
Monsieur n’a pas commandé le café ?
Edwige écoute le gérant avec stupeur. Les chanteuses sont entrées et se sont rangées à droite.
ALBERT.
Non, tout à l’heure.
Le gérant s’éloigne. Albert, à Edwige.
Il m’a demandé si le monsieur de là-bas n’a pas commandé le café...
EDWIGE.
C’est étrange ! Il te parle d’une façon bizarre ! Il est poli, plein de respect...
ALBERT.
C’est pour se moquer de moi.
Il passe à la table de Bérengère et reste debout derrière une chaise.
PLOUVIER, à Albert.
Vous ne vous asseyez pas ?
ALBERT.
Non, non... Oh ! moi, pour entendre la musique, j’aime mieux être debout !
BÉRENGÈRE.
Albert, assieds-toi !
ALBERT.
Oui... oui...
À Edwige.
Ils sont un peu partis, qu’est-ce que tu veux ! Ils me demandent maintenant de m’asseoir à leur table : une fantaisie de fêtards !
TOUS
Eh bien, voyons, asseyez-vous !...
ALBERT.
Oui, oui.
À Edwige.
Ils veulent que le maître d’hôtel s’assoie à leur table...
Sourire forcé.
C’est drôle !...
EDWIGE.
Je te le défends !
ALBERT.
Oh ! il faut, il faut. Ils seraient mécontents, ils ne reviendraient pas... Il ne faut pas les contrarier.
Aux autres.
Je m’assois.
Il s’assoit timidement sur le bord de la chaise.
EDWIGE commence à chanter une chanson tendre, en s’accompagnant sur le violon.
La grand’mère, assise dans l’allée,
A revu sa jeunesse écoulée.
Son noble front demeure serein,
Loin de la vie et de son bruit vain...
Mais Edwige s’est aperçue que Bérengère caressait les cheveux d’Albert, et le vers précédent a fini sur une fausse note, qui a fait sursauter tout le monde. Edwige s’excuse d’un geste et reprend sa romance.
Une paix s’étend sur la nature.
Mais comme Bérengère continue à caresser Albert, la romance devient un chant d’abord haletant.
À peine on entend le doux murmure...
Puis la voix d’Edwige crie furieusement les deux derniers vers.
Le murmure des roseaux
Qui palpitent sur les eaux.
Tous les assistants, stupéfaits, se lèvent à la fin du couplet.
PLOUVIER.
Qu’est-ce qu’il y a ?
EDWIGE, montrant Bérengère.
Il y a que madame est un chameau !
BÉRENGÈRE, suffoquée.
Chameau ! Chameau ! Elle m’appelle chameau !... C’est la première fois qu’on se permet de m appeler chameau ! Qu’est-ce que c’est que cette vieille saltimbanque ?
EDWIGE.
Saltimbanque !... Saltimbanque !...
À Albert.
Tu me laisses traiter de saltimbanque !
BÉRENGÈRE, à Albert.
Elle te tutoie, maintenant ?
EDWIGE, à Albert.
Elle te tutoie, maintenant ?
À Bérengère.
Qui est-ce qui t’a permis de tutoyer mon ami ?
BÉRENGÈRE.
Ton ami ?... Ton ami ?...
À Albert.
Voilà que tu es son ami, à présent ! Eh bien, je ne te félicite pas ! Un vieux laissé pour compte comme ça !...
Les soupeurs, attirés par le bruit, arrivent.
EDWIGE.
Viens donc !... Je vais te montrer si je suis un vieux laissé pour compte.
Elle relève ses manches.
Il y a cinq ans, j’ai fait un numéro de force à l’Olympia...
BÉRENGÈRE, à Jacqueline et à Bouzin qui la retiennent.
Pensez-vous que je vais me commettre avec cette femme-là ?... Sa perruque en poil de chien me resterait dans les doigts. Qu’est-ce qu’elle a là-dessous ? Une pomme d’escalier, je ne tiens pas à la voir. Je laisse ça à monsieur, qui a du goût pour ça ?
EDWIGE, à Albert.
Tu vas me laisser traiter comme ça ?
Elle s’avance vers Bérengère.
Moi, je veux un peu lui rebrousser les plumes à cette volaille-là !...
GASTONNET, s’interposant.
Voulez-vous ne pas toucher madame !...
EDWIGE.
Quoi ?
GASTONNET.
Voulez-vous...
Edwige veut passer tout de même. Gastonnet l’arrête. Edwige feint d’avoir été frappée.
EDWIGE, à Albert.
Ah ! Il m’a frappée !... Si tu ne le gifles pas, tu es le dernier des mufles !
ALBERT, très ennuyé, s’inclinant devant Gastonnet.
Monsieur, considérez-vous comme giflé !
GASTONNET.
Bien, monsieur, nous réglerons ça demain...
À Plouvier, d’un ton triomphant.
La voilà, mon affaire retentissante !
ARTHUR, entrant suivi d’un sergent de ville. Au sergent de ville.
Priez ce monsieur de vous suivre...
TOUS
Oh !
ALBERT.
Moi ?
ARTHUR.
Oui !
LE SERGENT DE VILLE
Suivez-moi au commissariat !
ALBERT.
Oh ! merci !
Il embrasse le sergent de ville et l’entraîne avec empressement.
EDWIGE.
Mais moi, je n’ai pas fini de régler mon affaire...
Elle se précipite du côté de Bérengère, que protège Gastonnet. Elle lève son archet pour la frapper au visage. À ce moment, les quatre chanteuses hongroises, attirées par le bruit, se mettent à chanter à tue-tête.
ACTE III
Même décor qu’à l’acte premier. Il est huit heures du matin.
Scène première
LE PLONGEUR, LA CAISSIÈRE
LE PLONGEUR, tout en balayant le café et replaçant les chaises qui sont autour des tables.
Eh bien, madame Mirmain, vous arrivez de bonne heure, aujourd’hui. Vous êtes plus matinal qu’Albert.
LA CAISSIÈRE, qui est entrée du fond à droite.
C’est que je ne veux pas rester. Je suis de noce. Mademoiselle a la complaisance de me remplacer ce matin, et, alors, je suis venue de bonne heure... Mais c’est Albert qui n’est pas encore ici. Il vase faire attraper par le patron. Vous savez qu’il est huit heures cinq ?
LE PLONGEUR.
Oh ! il ne sera pas long avant de venir. Je suis allé jusqu’à un hôtel des Champs-Élysées où c’est qu’il couche quelquefois... Il ne s’était mis au lit qu’à cinq heures. Figurez-vous qu’il n’était pas même déshabillé. Il m’a raconté je ne sais pas quelle aventure... qu’on l’avait conduit chez le commissaire...
LA CAISSIÈRE.
Chez le commissaire ?
LE PLONGEUR.
Que le commissaire s’avait trouvé là, justement... que mon Albert lui avait dit comme ça son histoire, et que le commissaire l’avait relâché.
LA CAISSIÈRE.
Ah ! on l’a relâché ?
LE PLONGEUR.
Oh ! oh ! vous parlez qu’il avait l’air d’avoir mal aux cheveux, notre Albert ! Et ce qu’il fait des dépenses !... Croyez-vous qu’il avait une voiture de remise à la porte avec un cocher épatant. Il ne l’avait pas lâchée depuis minuit.
LA CAISSIÈRE.
Oh ! mais c’est que c’est un grand seigneur ! Tiens, voilà déjà des clients.
Elle va à son comptoir.
LE PLONGEUR.
Dites donc, je vais pourtant pas pouvoir les servir comme ça... je suis sale, dégoûtant !... Je vais m’habiller. Faites-les patienter en attendant que je sois prêt ou que notre Albert arrive.
LA CAISSIÈRE.
Oui, mais dépêchez-vous.
LE PLONGEUR.
Oh ! Albert sera là avant moi !
Il sort.
Scène II
LA CAISSIÈRE, UN JOURNALISTE, XAVIER, puis ALBERT et PHILIBERT
XAVIER, s’asseyant avec le journaliste.
Monsieur le journaliste, la meilleure chose était de se rendre compte de visu.
LE JOURNALISTE.
Attendez que je tire mon carnet, d’abord, et que je note votre titre exact.
XAVIER.
Je suis secrétaire de la Chambre syndicale des garçons de café. Je suis garçon de café depuis plus de vingt ans.
LE JOURNALISTE, écrivant.
Bien.
XAVIER.
En venant ici, dans ce café, où nous sommes entrés au hasard, vous allez vous rendre compte, monsieur, de l’existence de martyr que mènent les garçons de café... Notez qu’il est huit heures du matin et qu’à cette heure-ci, où les banques ne sont pas encore ouvertes, le garçon de café, qui doit veiller jusqu’à minuit et même davantage, le garçon de café est déjà à son poste.
LE JOURNALISTE.
Où est-il ?
XAVIER.
Il va venir.
À la caissière.
Eh bien, et le garçon ?
LA CAISSIÈRE.
Il va venir.
XAVIER, impatient.
Il devrait déjà être ici... Qui est-ce qui va servir les clients ? C’est insupportable !
LE JOURNALISTE.
Mais ne soyez pas exigeant pour quatre minutes de retard.
XAVIER, sec.
Cela ne devrait pas arriver.
LA CAISSIÈRE.
Attendez un peu... Je ne sais pas comment ça se fait qu’il ne soit pas là... Une voiture qui s’arrête... le voilà qui arrive.
LE JOURNALISTE.
Il arrive en voiture ?
XAVIER.
C’est probablement un cocher de ses copains qui aura eu la gentillesse de le déposer en passant... Oh ! vous savez, ce n’est pas une complaisance inutile... le pauvre diable doit être fatigué ! Attention, monsieur le journaliste, vous allez voir un des martyrs de la civilisation moderne !
LA CAISSIÈRE.
Eh bien, Albert !
ALBERT, avant d’entrer.
Voilà ! Voilà !
Il entre, un chapeau à huit reflets sur la tête, son macfarlane laissant voir son habit et son plastron.
LE JOURNALISTE.
Comment, c’est lui ?
XAVIER.
Je crois...
ALBERT, s’approchant.
Qu’est-ce qu’il faut servir à ces messieurs ?
XAVIER.
Deux cafés nature.
ALBERT.
Une petite seconde.
Entre le plongeur. Albert à la caissière.
Donnez quarante francs à mon compte au plongeur, c’est pour mon cocher.
Au journaliste.
Je l’ai depuis hier soir minuit, ça vaut bien ça pour une voiture de cercle...
À la caissière.
Deux cafés nature, deux !
LE JOURNALISTE, à Xavier.
Quarante francs de voiture !
XAVIER.
Il va expliquer ça... ça ne doit pas être pour lui.
LE JOURNALISTE.
Il est superbement vêtu.
XAVIER.
Ils sont très soigneux de leurs effets.
ALBERT, au plongeur qui revient.
Ma veste et mon tablier, vite !
Le plongeur va lui chercher sa veste et son tablier pendant qu’il ôte son macfarlane et son habit. Le plongeur lui rapporte sa veste.
Ah ! je me sens si bien, là dedans !... Je retrouve avec tant de plaisir cette veste et ce tablier !
Au moment où le plongeur emporte son habit.
Attendez, mon carnet de chèques !
Il prend un carnet dans la poche de son habit et le met dans sa veste.
LE JOURNALISTE, à Xavier.
Il a un carnet de chèques !
XAVIER, étonné.
Je... je ne sais pas... Il a peut-être quelques économies qu’il met dans une banque au lieu de les placer à la caisse d’épargne.
LE JOURNALISTE.
C’est intéressant, ça !
À Albert.
Dites donc, vous préférez mettre votre argent dans une banque qu’à la caisse d’épargne ?
ALBERT.
Le maximum des dépôts à la caisse d’épargne est de quinze cents francs... Me voyez-vous m’amener au bureau de poste avec des paquets de trente ou quarante mille francs ?
LE JOURNALISTE.
Eh bien, je vois que vous avez pas mal d’argent de côté.
ALBERT.
Oh ! un peu !
XAVIER.
Et, malgré ça, vous n’êtes pas heureux ?
ALBERT.
Ah ! fichtre non !
XAVIER, au journaliste.
Vous voyez...
À Albert.
Dites un peu à monsieur le martyre de votre existence.
ALBERT.
Martyre ! C’est le mot ! Monsieur ne me croira jamais.
LE JOURNALISTE.
Je vous écoute.
ALBERT.
Si je vous disais ce que j’ai dormi cette nuit : deux-heures un quart !... Et tout habillé !
LE JOURNALISTE.
Vous n’avez même pas le temps de vous déshabiller ? Mais, à quelle heure sortez-vous d’ici ?
ALBERT.
À minuit, mais d’ici que je sois au-café de Paris, à la Paix ou chez Maxim’s, ça fait une belle pièce d’une heure moins le quart.
LE JOURNALISTE.
Ah ! vous êtes aussi au café de Paris et chez Maxim’s ? Après votre service d’ici, vous allez faire le maître d’hôtel dans les restaurants ?
ALBERT, servant les cafés.
Le maître d’hôtel !... Ah ! là là là là !... je voudrais bien !... Ça me rapporterait, au lieu de me coûter. Et je ne serais pas engueulé...
LE JOURNALISTE, prenant des notes.
Engueulé...
ALBERT, sombre.
Et trahi...
LE JOURNALISTE, de même.
Trahi !...
ALBERT.
Par-dessus le marché.
LE JOURNALISTE.
Qu’est-ce que vous racontez ?
XAVIER.
Procédons par ordre... ne parlons pas de ce que vous êtes obligé de faire la nuit.
Au journaliste.
Ça, c’est exceptionnel... les garçons de café s’en tiennent à leur service de jour, ce qui est bien suffisant ! Dites simplement à monsieur combien vous êtes malheureux le jour, ici, au café.
ALBERT.
Ici, au café ? Mais c’est la partie agréable de ma vie. Je trime, je me fatigue, mais je suis tranquille... Je sers des bocks, des apéritifs, mais, monsieur, je trouve ça idéal !... Je sais que les garçons de café se plaignent, je le sais. Mais s’ils avaient mené comme moi la vie de fêtard et de noctambule... s’il leur était arrivé le quart de ce qui m’est arrivé à moi, ils reprendraient avec joie leur tablier !
Il reporte la cafetière.
XAVIER, se levant.
Celui-là n’est pas intéressant.
LE JOURNALISTE.
Mais si, mais si... Tout ce qu’il dit est très curieux. Ça va me faire un papier excellent.
XAVIER, agacé, payant Albert.
Tenez ! deux soucoupes à trente... Voilà douze sous.
Au journaliste.
Ce n’est pas un garçon de café, c’est une espèce de toqué, d’imbécile... Nous avons autre chose à faire qu’à écouter ses bêtises.
ALBERT.
Ah ! bien... dites donc !
XAVIER, au journaliste.
Allons, venez !
LE JOURNALISTE.
Moi, je le trouvais très drôle.
XAVIER.
C’est un garçon de café à la manque : il déshonore la corporation.
ALBERT, recevant.
Voilà tout ce qu’il me donne comme pourboire.
XAVIER.
Nous prendrons un café autre part.
PHILIBERT, entrant par la droite, pendant que Xavier et le journaliste s’apprêtent à sortir par la gauche.
Qu’est-ce qu’ils ont donc à s’en aller comme ça ?... Pardon, messieurs, qu’est-ce qui vous a mécontentés ?
XAVIER.
Il y a que vous devriez faire un peu plus attention au recrutement de vos garçons... J’en connais qui sont sans place et qui sont excellents. Au lieu de cette espèce de toqué ! Mais je suis sûr que, si vous le gardez, c’est que vous le payez un prix dérisoire.
PHILIBERT, suffoqué.
Un prix dérisoire !
XAVIER.
Prenez garde ! Si j’apprends que vous le payez au-dessous du tarif des chambres syndicales...
PHILIBERT, écumant.
Quatre cent seize francs par mois, est-ce que c’est au-dessous du tarif ? Et avec un traité de vingt ans !
LE JOURNALISTE.
Quatre cent seize francs par mois ? Un traité de vingt ans ?
Il prend son calepin.
Voilà qui est intéressant.
XAVIER, vivement, lui enlevant son carnet.
Mais non ! Ce n’est pas intéressant ! Allons dans un autre café ! Ici, c’est une botte.
Il l’entraine et sort.
PHILIBERT, vivement.
Dites donc ! dites donc !
À Albert.
C’est encore vous qui m’attirez ça ! Allez ranger le vin que j’ai mis en bouteilles et faites attention, je les ai comptées.
ALBERT.
Pour qui me prenez-vous ?... Je suis un honnête serviteur !
À la caissière, à mi-voix, en sortant.
Et je n’ai pas soif !
Scène III
PLOUVIER, LE GÉNÉRAL, PHILIBERT, LA CAISSIÈRE, puis ALBERT et YVONNE
LE GÉNÉRAL, à Plouvier.
Alors, c’est au café qu’il habite, notre homme ?
PLOUVIER.
Je n’y comprends rien, mon général... Après cette altercation avec M. de Gastonnet, notre client, M. Loriflan, a été emmené au poste par un agent trop zélé. Il était parti sans laisser sa carte à M. de Gastonnet, mais nous avons eu son adresse par la chanteuse hongroise qui se trouvait là. Et le concierge de la maison vient de me dire qu’il faut s’adresser au café.
LE GÉNÉRAL.
Mais enfin, quoi ! vous ne le connaissez pas plus que ça ?
PLOUVIER.
Soyez tranquille, mon général, c’est un gentleman. Bérengère me l’a affirmé... D’ailleurs, Bérengère n’a jamais été qu’avec des gens très bien... Voici probablement le patron du café.
À Philibert.
Pardon, monsieur, nous cherchons M. Loriflan... N’est-il pas ici ?
PHILIBERT, renfrogné.
Il est à la cave, en train de mettre du vin en bouteilles. Il ne va pas tarder à remonter. Qu’est-ce qu’il faut vous servir ?
LE GÉNÉRAL.
Du madère.
PHILIBERT.
Deux madères, deux !
Il s’éloigne.
LE GÉNÉRAL, à Plouvier.
En train de mettre du vin en bouteilles. Singulière occupation !...
PLOUVIER, rappelant Philibert.
Vous seriez bien aimable de lui faire remettre nos cartes.
PHILIBERT.
Je vais y descendre moi-même. Ce n’est pas que je le soupçonne de boire mon vin. Mais il n’est pas plus adroit que ça, vous savez !
LE GÉNÉRAL.
Alors, il est presque tout le temps ici ?
PHILIBERT, en s’éloignant.
Dame ! de huit heures du matin à minuit !...
LE GÉNÉRAL, à Plouvier.
C’est un pilier de café. J’ai connu un nommé Bertoulier, à Montauban, qui était dans ce goût-là.
Songeur.
Un garçon brillant, qui a bien gâché sa carrière...
PLOUVIER.
Je ne saurais trop vous remercier, mon général, d’avoir bien voulu assister mon client dans cette affaire. C’est pour M. de Gastonnet une consécration. Le général baron de Kerkoadec accepter d’être témoin !... Quand on sait que vous ne vous dérangez plus que pour les duels tout à fait sélects.
LE GÉNÉRAL.
Il est bien entendu, Plouvier, que nous n’acceptons pas d’excuses, et que l’on va sur le terrain en tout état de cause ! Je ne suis pas l’homme des palabres et des conciliations.
PLOUVIER.
C’est entendu, mon général, pas d’excuses !
LE GÉNÉRAL.
Ce serait trop commode. On gifle un monsieur...
PLOUVIER.
Il n’a pas été giflé... On lui a dit simplement : Considérez-vous...
LE GÉNÉRAL.
C’est la même chose !
PLOUVIER.
Et puis, mon jeune Poitevin est trop content d’avoir un duel sensationnel avec un adversaire très chic, qui choisira probablement, pour le représenter, deux témoins à la hauteur...
À ce moment Albert entre. Il s’approche de la table où sont assis les témoins. Plouvier lui tourne le dos.
ALBERT, au général.
Vous m’avez demandé, monsieur ?
LE GÉNÉRAL.
Nous avons demandé M. Loriflan.
ALBERT.
C’est moi, messieurs... Albert Loriflan.
PLOUVIER, se retournant.
Comment, c’est vous ?
ALBERT.
Bonjour, cher monsieur.
Il s’essuie la main pour la lui tendre. Plouvier lui tend une main hésitante.
Ah ! au fait, vous ne saviez pas que j’étais dans la limonade...
En prenant son parti.
Eh bien, vous le savez, maintenant ! Je vous demande pardon. Je suis à vous dans la minute. Je suis seul au café du moment et voilà un consommateur...
Il va à une table au fond pour prendre la commande d’un client qui vient d’entrer.
LE GÉNÉRAL, à Plouvier.
Qu’est-ce que ça veut dire ?
PLOUVIER.
Je n’y comprends rien. C’est pourtant l’homme qui est avec Bérengère et qui l’entretient très richement...
LE GÉNÉRAL.
Qu’elle dit... Mais ça m’a tout l’air d’être le contraire.
À Philibert qui entre.
Dites donc, patron, arrivez un peu ici...
PHILIBERT.
Qu’est-ce que c’est, messieurs ?
LE GÉNÉRAL.
Est-ce que vous connaissez bien les ressources de votre garçon ?
PHILIBERT, douloureusement.
Ah ! je vous crois !
LE GÉNÉRAL.
C’est un Alphonse, n’est-ce pas ?
PHILIBERT.
Un Alphonse ?
LE GÉNÉRAL.
Enfin, quoi, il vit aux crochets d’une femme ?
PHILIBERT.
Ah ! je ne pense pas. Sans parler de ce qu’il gagne ici, il a peut-être plus que vous d’argent de côté.
LE GÉNÉRAL.
Vous êtes sûr de ça ?
PHILIBERT, de mauvaise humeur.
Oui, mossieu, oui, mossieu.
Il s’éloigne.
LE GÉNÉRAL.
C’est une histoire à nous faire foutre de nous dans tout Paris !
PHILIBERT, à Albert.
Qu’est-ce-que c’est que ces clients-là ?
ALBERT.
Attendez donc ! Je me doute enfin pourquoi ils viennent. C’est pour une affaire d’honneur... je suis à vous, messieurs.
À Philibert.
C’est deux témoins d’un type à qui j’ai dit : Considérez-vous comme giflé !
PHILIBERT.
Eh bien, qu’est-ce que ça peut leur faire, ça ?
ALBERT.
Il va falloir me battre.
PHILIBERT.
Vous allez vous battre ?... Pas dans le café !
ALBERT.
Soyez tranquille. On se bat le matin de bonne heure, et je serai là pour l’ouverture.
PHILIBERT.
Vous n’avez pas la frousse ?
ALBERT.
Un peu... Mais on ne se fait jamais bien mal.
Au général et à Plouvier qui se lèvent pour partir.
Pardon, messieurs, je suis honteux de vous avoir fait attendre... Vous venez de la part de ce monsieur que j’ai giflé hier soir ?
Le général et Plouvier se regardent embarrassés.
LE GÉNÉRAL.
Oh ! giflé !
PLOUVIER.
Vous avez simplement dit : Considérez-vous...
ALBERT, simple et digne.
C’est la même chose. Je lui dois une réparation.
LE GÉNÉRAL.
Il ne la demande pas... Une dispute d’après boire... Vous étiez très gais l’un et l’autre...
ALBERT.
Moi, très gai ? Je n’étais pas gai du tout ! Je n’avais rien bu et, quand je n’ai rien bu, c’est effrayant ce que j’ai le vin triste ! Non, messieurs, je connais les usages du monde. Et puis, d’abord, si ce monsieur ne veut pas de réparation, pourquoi est-ce que vous êtes venus ?
PLOUVIER.
Eh bien, nous avons réfléchi que ce n’était pas grave...
PHILIBERT, qui s’est approché depuis un instant, bas à Albert.
Ils ne veulent pas parce que vous êtes garçon de café.
Il s’éloigne.
ALBERT.
Ah ! c’est comme ça ! Ah ! c’est comme ça !... Messieurs, vous êtes venus me demander une réparation, eh bien, je vous réponds que vous l’aurez ! Et puis, d’abord, je ne veux pas causer avec vous ! Je vais vous mettre en rapport avec deux de mes amis... Je n’ai pas sous la main des messieurs huppés, mais je connais deux braves garçons, un facteur des postes, employé du gouvernement, et le petit officier.
LE GÉNÉRAL.
Un petit officier ?
ALBERT.
Oui, le plongeur.
PLOUVIER.
Le plongeur ?
ALBERT.
Enfin, le jeune homme qui s’occupe de laver la vaisselle. Ils viendront vous trouver à votre club.
Au plongeur qui paraît.
J’aurai besoin de toi cet après-midi.
Au général.
Je connais les usages. Je vais demander au facteur quelles sont ses heures de tournée.
LE GÉNÉRAL.
Mais, enfin, vous insistez pour pousser cette affaire, et vous êtes l’offenseur...
ALBERT.
Je n’ai pas à savoir, moi, si je suis l’offenseur. Ça regarde le plongeur et le facteur. Je vais tout de suite prévenir le facteur.
Il s’éloigne.
LE GÉNÉRAL.
Évitons ça au plus vite... Garçon !...
Se reprenant.
Monsieur Loriflan !
Albert revient.
Eh bien... notre client vous fait des excuses...
ALBERT.
Bien ! bien ! Mais des excuses écrites ?
LE GÉNÉRAL, irrité.
Des excuses écrites...
Avec effort.
C’est entendu !...
Soulevant son chapeau.
Au revoir, monsieur.
ALBERT, poliment.
Au revoir, messieurs.
LE GÉNÉRAL, furieux.
C’est une histoire... vous savez !
PLOUVIER.
Pardonnez-moi, mon général...
LE GÉNÉRAL.
Pour sûr que non, je ne vous pardonnerai pas !
Il sort.
PLOUVIER, gêné.
À qui dois-je payer les deux consommations ?
ALBERT.
Mais à moi ! Je vous les offrirais bien... Mais c’est contre les usages.
PLOUVIER.
Voici vingt sous.
ALBERT.
J’ai vingt centimes à vous rendre... Les voici.
Il met vingt centimes sur la table.
PLOUVIER, après avoir fait le geste de les laisser en pourboire, paraît gêné et les prend.
Merci, monsieur.
Ils se dirigent vers la sortie. Philibert s’en va également par une autre porte.
ALBERT.
Ils n’ont pas osé me laisser de pourboire... Heureusement que j’ai un fixe important !
YVONNE, entrant, à la caissière.
Je viens vous remplacer dans un instant. Si je ne suis pas là quand vous serez obligée de sortir, allez-vous en tout de même, je ne tarderai pas... Qu’est-ce que ces messieurs voulaient à Albert ?
LA CAISSIÈRE, à Albert.
Albert, qu’est-ce que vous voulaient ces messieurs ?
ALBERT.
Pour un duel... Ils m’ont fait des excuses...
YVONNE.
Naturellement ! ils ne voulaient pas se battre avec vous.
Elle sort.
ALBERT.
Elle a toujours des choses aimables à vous servir !
LA CAISSIÈRE.
Ça vous affecte ?
ALBERT.
Ce n’est pas ça !... mais je ne suis pas en train.
LA CAISSIÈRE.
Voilà quelqu’un pour vous.
ALBERT.
Edwige ! Elle manquait à la fête !
Scène IV
EDWIGE, ALBERT, LA CAISSIÈRE
EDWIGE.
Eh bien, me voilà.
ALBERT.
Je te vois.
EDWIGE.
Ne perdons pas de temps en conversations inutiles. D’abord, tu m’as trompée... avec une créature. Ensuite, tu ne m’as pas dit que tu avais fait un héritage considérable... J’avais deux raisons pour te tuer... Mais j’ai parlé de la situation à ma mère. C’est une femme d’un grand bon sens. Elle m’a dit qu’humainement je n avais pas le droit de tuer un homme qui possédait huit cent mille francs. Je consens donc, non seulement à te pardonner, mais encore à t’épouser. Inutile de me remercier. Ne t’imagine pas que c’est pour toi que je fais cela : tu ne le mérites certainement pas...
Albert s’éloigne un peu.
Je ne veux pas que tu m’embrasses, j’ai trop de mépris pour toi ! Je suis simplement venue te prévenir pour que tu prépares sans retard tes papiers. Moi, je vais envoyer, dès à présent, une dépêche en Bulgarie et une autre en Suède, pour avoir mon extrait de naissance.
ALBERT.
Vous êtes donc née en deux pays différents ?
EDWIGE.
Ma sainte mère ne sait plus au juste... Elle n’a jamais rien compris à la géographie... Je volis au télégraphe et je reviens.
Elle sort.
ALBERT, à la caissière.
Ça y est ! Je vais être forcé d’épouser Edwige... Je l’ai séduite, je dois l’épouser. Le temps d’arrêter quelques dispositions testamentaires et j’en finirai avec la vie.
LA CAISSIÈRE.
Vous êtes fou !
ALBERT.
Non, je suis las, je ne trouve que déceptions... Il n’y a qu’une seule femme au monde qui m aime : c’est elle. Vous comprenez qu’il ne me reste plus qu’à me tuer. Elle sera d’ailleurs bien attrapée.
LA CAISSIÈRE.
Voilà deux autres personnes.
ALBERT.
C’est encore pour moi. Tous les clients du café, ce matin, c’est pour moi.
Scène V
EDWIGE, ALBERT, LA CAISSIÈRE, BÉRENGÈRE, entrant, suivie de JACQUELINE, puis EDWIGE, puis PHILIBERT, puis YVONNE
BÉRENGÈRE, à la caissière.
M. Albert Loriflan ?
LA CAISSIÈRE.
Albert !
BÉRENGÈRE, stupéfaite, apercevant Albert.
Garçon de café !
JACQUELINE.
Garçon de café !
ALBERT, paisiblement.
Garçon de café.
BÉRENGÈRE.
Eh bien, me voilà fraîche !
ALBERT.
Pourquoi vous voilà-t-il fraîche ?
BÉRENGÈRE.
Parce que je vais être la risée de tout Paris.
JACQUELINE.
Quand on saura qu’elle a été la bonne amie d’un garçon de café...
BÉRENGÈRE.
Ça ne se passera pas comme ça !
JACQUELINE.
Ça ne peut pas se passer comme ça.
BÉRENGÈRE.
Tu me coûtes ma situation, il faut que tu répares cela : tu m’épouseras... tu m’épouseras !
ALBERT.
Ah ! bon... Eh bien, il faut vous arranger avec madame...
Il montre Edwige qui entre.
EDWIGE.
Qu’est-ce qu’il y a ?
BÉRENGÈRE.
La chanteuse hongroise !
EDWIGE.
La créature !
ALBERT, à Bérengère, en désignant Edwige.
Mademoiselle désire déjà m’épouser. Discutez toutes les deux, faites valoir vos droits ; quand vous vous serez mises d’accord, vous me direz ce qui aura été décidé. Attendez.
Il leur apporte des bouteilles et des verres.
Tenez, voilà des consommations... c’est une tournée à mon compte.
Il s’éloigne et va près de la caisse. À la caissière.
C est égal, j’aime mieux qu’elles soient deux à m’épouser : comme ça, j’ai des chances de n’en épouser aucune.
Il reste derrière le comptoir et écoute.
EDWIGE, à Bérengère.
Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ? Est-ce que vous vous imaginez qu’il va vous épouser ?
BÉRENGÈRE.
Et vous donc ?
EDWIGE.
Moi, c’est autre chose ; il m’a connue innocente, il me doit une réparation.
BÉRENGÈRE.
Il vous a connue innocente ? Eh bien, il a fallu qu’il se lève de bonne heure.
EDWIGE.
Insolente !
BÉRENGÈRE.
Ça prend peut-être avec lui, mais pas avec moi... j’ai eu des renseignements précis sur vous, depuis hier... Les quatre chanteuses hongroises d’hier, ce n’étaient pas vos sœurs.
EDWIGE.
Ce n’étaient pas mes sœurs ?
BÉRENGÈRE, à mi-voix.
C’étaient vos filles !
Edwige reste suffoquée. Bérengère, continuant.
Vous avez encore trois autres enfants connus, dont le géant russe qui était l’année dernière aux Folies-Bergère...
EDWIGE. s’évanouit, et tombe sur un siège.
Ah !...
Se relevant.
J’aime mieux m’en aller.
Elle sort très exaltée.
ALBERT, à la caissière.
Oh ! alors, je ne me tue plus... Sept enfants, dont un géant !...
LA CAISSIÈRE.
Et vous pensiez l’avoir connue jeune fille ?
ALBERT.
Comme il y a des physionomies trompeuses !
Il sort.
BÉRENGÈRE, à Jacqueline.
Je pense que son mariage est plutôt compromis.
JACQUELINE.
Mais le tien ?
BÉRENGÈRE.
Je n’y crois pas énormément non plus.
Philibert entre et va à la caisse.
LA CAISSIÈRE.
Ah ! monsieur Philibert, j’ai oublié de vous remettre, tout à l’heure, un mot de M. Bigredon.
La caissière sort. Yvonne la remplace.
PHILIBERT, ouvrant le mot, il lit.
Nouveau plan de campagne...
À part.
Il m’embête, celui-là !
Lisant.
Pour vexer Albert, vous lui soufflez sa maîtresse. J’ai envoyé ce matin à Bérengère d’Aquitaine un bouquet de deux louis avec une carte de vous... Oh ! il m’embête, celui-là !
JACQUELINE, à Bérengère.
En somme, qu’est-ce que tu vas faire ?
BÉRENGÈRE.
Eh bien, je n’en sais rien.
JACQUELINE.
Tu vas te trouver bien seule !
BÉRENGÈRE.
J’espère que ça ne durera pas longtemps, mais je ne serais pas fâchée de savoir qui est le nommé Philibert qui habite précisément dans la maison et qui m’a écrit ce matin en m’envoyant des fleurs.
À Philibert.
Pardon, monsieur, connaîtriez-vous M. Philibert ?
PHILIBERT.
C’est moi, madame.
JACQUELINE.
Eh bien, j’espère que tu en as du succès dans la limonade !
BÉRENGÈRE.
Si le patron est aussi chic qu’Albert, je ne m’embêterai pas.
Souriant, à Philibert.
Cela ne vous étonne pas de me voir ici ?
PHILIBERT.
Non, madame, nous avons eu souvent du beau monde.
À part.
J’ai déjà vu cette femme-là.
BÉRENGÈRE.
C’est vous qui m’avez envoyé des fleurs, ce matin ?
PHILIBERT.
Ah ! oui !...
À part.
Ça y est ! C’est la poule à Albert !... Eh bien, madame, c’est une erreur !
BÉRENGÈRE.
Ce n’était pas pour moi ?
PHILIBERT.
Si, si, madame, vous pouvez garder le bouquet. Mettez-le dans un vase, mais n’y faites pas attention.
BÉRENGÈRE, tirant une carte de son réticule et lisant.
Vous me disiez sur votre carte que vous aviez pour moi la plus vive admiration.
PHILIBERT.
Mais ce n’est pas vrai, madame, ce n’est pas vrai !
BÉRENGÈRE.
Et que vous désiriez vivement être reçu chez moi...
PHILIBERT.
Non, madame, mais non, madame, je n’y tiens pas... Et puis, que voulez-vous ? moi, il ne faut pas venir me parler de ça dans mon établissement. Je suis un commerçant, j’ai beaucoup à faire. Je sais bien qu’il y a des débitants qui sont à courailler à droite et à gauche, ce n’est pas mon numéro.
BÉRENGÈRE.
Eh bien, vous êtes encore poli !
PHILIBERT.
Je vous demande pardon, madame, je n’ai rien d’impoli à vous dire... et vous êtes une femme ; puis, d’autre part, vous venez consommer, mais il ne faut pas venir chercher autre chose ici, madame.
BÉRENGÈRE.
Eh bien, dites donc, vous en avez un toupet !
PHILIBERT.
Depuis que je suis veuf, je vous avoue, madame, que je n’ai pas pensé à la bagatelle... et je ne veux pas commencer aujourd’hui. Je ne dis pas que vous ne soyez pas appétissante, vous, et la petite aussi, mais c’est comme ça !
BÉRENGÈRE.
Mais qu’est-ce qu’il a, celui-là ? Est-ce que c’est moi qui ai été vous chercher ? qui vous ai dit de m’envoyer un bouquet ?
PHILIBERT.
Certainement que non ! Car vous auriez pu me le dire ! je ne vous l’aurais jamais envoyé.
À part.
Attrape ça et mets ton mouchoir là-dessus !
BÉRENGÈRE, à Jacqueline.
Qu’est-ce que tu dis de ça, toi ?
JACQUELINE.
Je n’y comprends rien !
BÉRENGÈRE.
Eh bien, si on m’y repince, à mettre les pieds dans cette maison ! Ah !
PHILIBERT.
Elle ne vous réclame pas, cette maison.
Elles sortent.
Allez-vous-en, fleurs vénéneuses !
À Yvonne qui entre et l’embrassant.
Voilà ma fleur d’innocence.
Scène VI
PHILIBERT, YVONNE
PHILIBERT.
Voyons les comptes, maintenant. Dis donc, la caissière doit avoir de l’argent à me remettre ?
YVONNE.
Oh ! non, papa, je crois que c’est le contraire.
PHILIBERT.
Comment ça ?
YVONNE.
Je vois qu’elle a laissé une note là. Il paraît qu’elle a payé une facture de tailleur pour M. Bigredon.
PHILIBERT.
De tailleur ?
YVONNE.
Oui, un habit de soirée.
PHILIBERT.
Eh bien, il a plutôt un certain toupet !
YVONNE.
Hier, il est venu avec sept ou huit personnes de ses amis... on leur a servi trois tournées.
PHILIBERT.
Il a payé ?
YVONNE.
Non, il a dit que c’était à ton compte à toi... que ça rentrait dans son plan de campagne, qu’il faisait ça pour fatiguer Albert et qu’il n’ait pas la vie trop douce. Enfin, qu’est-ce que c’est que ces manigances-là ? Papa, m’expliqueras-tu ça un jour ?
PHILIBERT.
C’est des choses que tu ne peux pas comprendre. Ah ! misère de misère ! Pourquoi me suis-je embarqué là-dedans ?
YVONNE.
Le voilà, M. Bigredon !
Scène VII
PHILIBERT, YVONNE, BIGREDON
BIGREDON, aimable.
Bonjour, bonjour !
PHILIBERT, sèchement.
Bonjour !
BIGREDON.
Je vais mieux, vous savez.
PHILIBERT.
Ça me fait bien plaisir.
BIGREDON.
Hier soir, au restaurant, j’étais mal à mon aise ; c’est parce que j’avais trop attendu pour souper. Ce matin, j’ai fait venir votre médecin...
PHILIBERT.
Mon médecin ?
BIGREDON.
Oui. Il m’a donné une drogue excellente...
PHILIBERT.
Que vous avez fait prendre chez mon pharmacien ?
BIGREDON.
Parfaitement... et me voici remis.
PHILIBERT.
Allons, tant mieux !
BIGREDON.
Et prêt à recommencer ce soir !
PHILIBERT.
Ça, c’est moins sûr, c’est moins sûr ! Monsieur Bigredon, le moment est venu de vous parler sérieusement... Je crois que, si vous voulez continuer à être le bienvenu ici, il vaut mieux ne plus remettre les pieds dans mon établissement... Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire de bouquet que vous m’avez fabriquée ? Voilà que vous me faites offrir des fleurs à des grues, maintenant ?... Ce matin, c était un défilé de poules dans la maison...
À mi-voix.
dans cette maison... où habite ma fille !... Ah ! si je ne me retenais pas !
À Yvonne, avec une voix tremblante.
T’as bien pris ta leçon d’anglais ?
YVONNE.
Il ne s’agit pas deçà, papa... Je désirerais te parler au sujet d’Albert... Depuis quelque temps, il n’est plus possible, je lui fais observations sur observations...
BIGREDON.
C’est très bien, ça.
PHILIBERT.
Pourquoi est-ce très bien ?
BIGREDON.
Il faut lui faire beaucoup d’observations pour qu’il finisse par être excédé et par rendre son tablier.
YVONNE.
Ah ! c’est comme ça ! Ah ! c’est comme ça ! Eh bien, vous pouvez être tranquille ! Monsieur, je ne comprends rien à vos combinaisons, mais il ne faut pas que vous comptiez sur moi pour les faire aboutir... je trouve ça dégoûtant, si vous voulez le savoir... monsieur Bigredon ! Au revoir, monsieur Bigredon !
Elle s’en va.
PHILIBERT.
Elle a raison !... Elle a raison !... Je suis un fou de vous avoir suivi dans cette affaire-là !
BIGREDON, inspiré.
Monsieur Philibert, il me pousse une idée merveilleuse qui va sauver la situation.
PHILIBERT.
Je ne veux pas la savoir.
BIGREDON.
Vous ne voulez pas la savoir... Eh bien, vous ne la saurez pas...
PHILIBERT.
Dites-la toujours, ça n’engage à rien.
BIGREDON.
Vous connaissez la jeune fille qui vient de sortir ?
PHILIBERT.
Ma fille ?
BIGREDON, fatidique.
Il faut qu’Albert épouse votre fille.
PHILIBERT.
Épouser ma fille ?
BIGREDON.
Eh bien, est-ce que ce n’est pas une idée géniale ?
PHILIBERT.
Oh ! voyons ! voyons ! voyons !
Il reste immobile, en proie à un travail de réflexion.
Pour un homme intelligent, vous n’êtes pas si bête que ça... Vous savez qu’Albert ne manque pas de qualités, au fond... Il ne boit plus, et il a plus d’instruction qu’il n’en a l’air... Je le soupçonne même de n’être pas sans délicatesse... Non, mais voilà... ma fille n’en voudra jamais.
BIGREDON.
Pourquoi ça ?
PHILIBERT.
Ah ! la fierté ! la fierté ! Il suffit qu’Albert ait été garçon de café ici...
BIGREDON.
Ah ! voilà bien le résultat des leçons d’anglais... Est-ce qu’on fait prendre des leçons d’anglais aux jeunes filles ?
PHILIBERT.
J’ai peut-être eu tort ?
BIGREDON.
Quelle idée vous avez eue de lui faire apprendre l’anglais, pour habiter les Ternes !
PHILIBERT.
D’autant que tous les Anglais des Ternes parlent français.
BIGREDON.
Monsieur Philibert, mon vieux monsieur Philibert, il faut la décider... dites-lui qu’Albert a un pépin pour elle...
PHILIBERT.
Ce n’est pas vrai !
BIGREDON.
Dites-le lui toujours, vous verrez ce que ça donnera.
PHILIBERT.
Ça m’embête d’entamer cette conversation avec elle...
BIGREDON.
Voulez-vous que je m’en charge ?
PHILIBERT.
Non, vous la dégoûtez... je lui parlerai ce soir ou demain...
BIGREDON.
Le plus tôt possible.
PHILIBERT.
Si ça s’arrange et qu’il veuille rester comme garçon de café sans être payé. Au fond, je ne suis pas mécontent de son service...
BIGREDON.
Venez par là, le voici.
Ils sortent premier plan à droite, comme Albert entre.
Scène VIII
ALBERT, LE PLONGEUR
Albert les regarde s’en aller d’un air défiant. Au bout d’un instant, le plongeur, qui était entré sournoisement pendant la scène de Bigredon et de Philibert, montre sa tête au-dessus du comptoir.
LE PLONGEUR.
Mon vieux ! oh ! mon vieux ! mon vieux ! j’ai quelque chose à t’avertir.
ALBERT.
Qu’est-ce qu’il y a ?
LE PLONGEUR.
Le père Philibert et le père Bigredon machinent contre toi une combine. Oh ! mon vieux ! mon vieux !
ALBERT.
Mais qu’est-ce que c’est ?
LE PLONGEUR.
Tu demandes qu’est-ce que c’est ?
ALBERT.
Mais dis-le donc ?
LE PLONGEUR.
Ils veulent te faire épouser mademoiselle.
Albert, ému, s’assoit.
« Il faut qu’il épouse votre fille, que disait le père Bigredon ! Il ne consentira jamais, que disait le père Philibert ! Oh ! les leçons d’anglais ! que disait le père Bigredon ! J’oserai pas lui parler, que disait Philibert ! Il faut y parler tout de suite, que disait le père Bigredon ! »
Le plongeur passe devant le comptoir.
ALBERT.
Faut-il que ça soit une paire de canailles pour imaginer ça !
LE PLONGEUR.
Qu’est-ce que tu dis ?
ALBERT.
Je dis : Faut-il que ça soit une paire de canailles pour imaginer ça !
LE PLONGEUR.
Oui, te faire marier à une personne que tu détestes !
ALBERT.
Oui... Certainement que je la déteste, mais encore ça ne serait pas une raison... Pour un mariage, on peut passer là-dessus. Mais vouloir marier un garçon de café comme moi à une jeune demoiselle qui sait l’anglais, le piano, tu vois ça d’ici ?
LE PLONGEUR.
Tout de même, ça se pourrait bien. Avec ça que tu n’es pas encore plus riche qu’elle ?
ALBERT.
Oh ! tu te fais sur la richesse des idées... de plongeur. Tu vois ça de ta cuisine ! Si tu avais fait la fête comme moi, si tu avais fréquenté des riches, tu verrais que ce n’est pas ça qui fait la différence des personnes... Ainsi, avec la Bérengère, on a logé et couché dans des meubles autrement beaux que ceux du père Philibert... Et Bérengère, si tu voyais ce qu’elle a comme bagues : les doigts tout enflés. Jamais mademoiselle n’a eu des bagues comme ça. Tout ça n’empêche pas que Bérengère n’est pas au-dessus d’un plongeur... Je ne dis pas ça à cause de ses mœurs qui ne valent pas les tiennes, mais je parle pour son éducation qui est kif-kif avec toi. Tandis que mademoiselle... eh bien, c’est mademoiselle... pas parce qu’elle est la fille du père Philibert... le père Philibert, je ne le respecte pas plus qu’un litre entamé... Il faut vraiment qu’il ne doute de rien et qu’il n’ait pas peur pour vouloir marier une belle demoiselle comme ça avec un galvaudeux, même doré sur tranches, comme mézigue.
LE PLONGEUR.
Albert, tu te méprises trop.
ALBERT.
Mais non !
LE PLONGEUR.
Mais si. Évidemment, quand tu me causes, tu as l’air d’un pédezouille, mais je t’ai déjà entendu converser avec des gens chics ; je ne m’y connais pas en intelligence, mais je te réponds que tu peux y faire avec n’importe qui.
ALBERT.
Tu ne t’y connais pas.
LE PLONGEUR.
J’en tiens pour ce que j’ai dit.
ALBERT.
En tout cas, je me demande comment ils vont s’y prendre pour parler à mademoiselle.
LE PLONGEUR.
Oh ! je sais comment, moi. Ils vont lui dire que tu as un pépin pour elle.
ALBERT.
Ah ! tu vas me faire rougir jusqu’à la peau du crâne... Tu crois qu’ils diraient ça ? Mais, du coup, je ne vais plus savoir où me fourrer. Non, non, il ne faut pas qu’on aille lui colporter une chose pareille.
LE PLONGEUR.
Il n’y a qu’un moyen d’empêcher ça.
ALBERT.
Lequel ?
LE PLONGEUR.
Que tu causes à mademoiselle et que, tout en causant, tu lui fasses comprendre qu’elle ne t’a jamais donné dans l’œil.
ALBERT.
Eh bien, tu as raison, il faut que je lui parle... D’abord, depuis que je la connais, et pourtant je la déteste bien, je suis à chercher ce que je pourrais lui dire... Cette fois-ci, j’ai de quoi lui parler... je vais lui dire ça tout de suite... sans réfléchir... en me pinçant le nez et en fermant les yeux.
LE PLONGEUR.
Il est bientôt l’heure qu’elle va rentrer de sa leçon d’anglais.
ALBERT, avec un effort d’énergie.
Je vais lui parler, je vais lui parler !
Scène IX
ALBERT, LE PLONGEUR, UN CLIENT
ALBERT.
Zut ! voilà un client !
LE PLONGEUR.
Il faut le sacquer.
ALBERT, au client.
Qu’est-ce qu’il y a, monsieur ?
LE CLIENT.
Un bock, d’abord, et de quoi écrire !...
ALBERT.
De quoi écrire ?
LE PLONGEUR.
Il en a pour deux heures.
ALBERT.
Monsieur, nous attendons de la bière en retard.
LE PLONGEUR.
Nous n’avons plus qu’un fond de tonneau.
ALBERT.
Si j’ai un conseil à vous donner, c’est d’aller à la brasserie en face. Ils ont de la Pilsen extraordinaire.
LE CLIENT.
Je ne tiens pas à de la bière. Donnez-moi un café noir.
ALBERT, hésitant.
Eh bien... eh bien...
LE PLONGEUR, à mi-voix, à Albert.
Ouvriers !... On attend des ouvriers.
ALBERT.
Oui, on attend des ouvriers, avec des échelles... Ils vont repeindre tout l’établissement.
LE PLONGEUR.
Au milieu d’un courant d’air terrible.
LE CLIENT.
Ah ! zut ! Il fallait fermer votre botte, alors... J’ai donné rendez-vous à un de mes amis ici.
ALBERT.
Eh bien, on l’enverra vous rejoindre en face.
LE PLONGEUR, allant ouvrir la porte.
Comment est-ce qu’il est ?
LE CLIENT.
Un grand monsieur avec une barbe grise.
ALBERT.
Soyez tranquille, on vous enverra tout ce qui vient ici comme barbes grises.
Sort le client.
Et même comme barbes blanches, barbes noires et pas de barbe du tout...
Scène X
ALBERT, LE PLONGEUR, YVONNE
YVONNE, qui a vu sortir le client.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Il est parti sans consommer ?
LE PLONGEUR.
Oh ! Il demandait des choses impossibles. Il ne sait pas ce qu’il veut, cet homme-là.
YVONNE, au plongeur.
Oui, les clients s’en vont sans consommer... parce que le café est très mal tenu !... Je sais bien que ce n’est pas vous que ça regarde.
ALBERT, à part.
Elle ne me le dira pas directement ! Je suis un paria, comme on dit dans les Indes.
LE PLONGEUR, bas.
Eh bien, vas-y, maintenant, c’est peut-être le moment.
ALBERT.
Ça ne va pas être commode...
LE PLONGEUR.
Vas-y tout de même.
Il sort.
Scène XI
YVONNE, ALBERT
ALBERT, s’approchant du comptoir.
Vous êtes dure pour moi, mademoiselle.
YVONNE.
Qu’est-ce que c’est ?
ALBERT, ému.
Mademoiselle, avec le plus grand respect... avec le respect... qui se doit... voulez-vous me donner la licence de vous parler pendant... pendant cinq minutes, montre en main, et de vous dire ma respectueuse façon de penser... Les cinq minutes écoulées, bouche cousue... Je serai muet comme une statue. Voilà : Je sais pourquoi vous êtes si dure avec moi. C est à cause d’un sentiment de votre part qui est tout à fait bien... D’ailleurs, vous n’êtes capable que de ça...
Geste d’Yvonne.
Laissez-moi parler. Je ne dépasserai pas ces cinq minutes que vous m’avez permises.
YVONNE.
Vous avez pris la permission tout seul.
ALBERT.
Mettons que vous ne l’avez pas défendu... Mais je dépense mes cinq minutes à parler pour ne rien dire.
Avec une grande rapidité de débit.
Je disais donc que vous n’êtes capable que de sentiments très bien, et que c’est à cause d’un sentiment très bien que vous êtes dure pour moi.
Reprenant un débit ordinaire.
Vous vous dites : « Maintenant que ce garçon est riche, je ne veux pas avoir l’air de changer mon air que j’ai toujours eu vis-à-vis de lui. »
YVONNE, vivement.
Pas du tout.
ALBERT.
Vous vous défendez de ça. Encore un sentiment très bien. Je vous dis que vous n’avez que ça !
S’asseyant et douloureusement, à lui-même.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
YVONNE.
Qu’est-ce qui vous prend ?
ALBERT.
Je parle au bon Dieu, au bon Dieu qui n’est pas fier et qui laisse les garçons de café lui parler comme ils veulent... Seigneur !...
À Yvonne.
Ça ne compte pas dans les cinq minutes...
Les yeux au ciel.
Seigneur !...
À Yvonne.
Mais vous pouvez écouter ce que je lui dis...
De nouveau les yeux au ciel.
Seigneur, je suis destiné à être malheureux toute ma vie. Dites à la Providence qu’elle soit un peu plus douce pour moi. Elle m’envoie la fortune, c’est entendu, des centaines et des centaines de mille francs qui ne me font aucun plaisir. Elle me met en relations avec des personnes très brillantes... qui m’embêtent... Elle me dit après ça, la Providence, avec son petit air malin : « De quoi que tu te plains, Albert ? » Elle sait bien que les seuls bonheurs qui seraient de vrais bonheurs, ce n’est pas pour moi ! Interdit à Albert. Le public n’entre pas ici.
S’approchant du comptoir.
Mademoiselle, je vous le demande en grâce. Dites-moi, une fois pour toutes, que vous me méprisez !
YVONNE.
Monsieur Albert, assez sur ce sujet !
ALBERT.
Vous ne voulez même pas me dire que vous me méprisez. Je me rends bien compte que j’aurais encore plus de fortune, je serais un garçon mal élevé... Ce qui serait gentil de votre part, et ce qu’on peut vous demander, car, en somme, c’est des choses qu’une demoiselle patronne peut très bien dire à un garçon employé, c’est de m’adresser des observations quand je fais des choses qui ne sont pas suivant la bonne éducation... Ce que je demande là, ce n’est pas pour m’élever au-dessus de ma condition... Ah ! fichtre non ! Il y a quinze jours que, tous les soirs à minuit et demi, je m’élève au-dessus de ma condition. Ça ne me réussit pas du tout.
Avec véhémence.
Je veux rester dans ma condition ! Mais ce que je ne supporte pas, c’est que vous me considériez comme un mal élevé.
Les larmes aux yeux.
C’est des choses bien douloureuses pour moi.
YVONNE, un peu moins sèchement.
Allons ! Calmez-vous, je vous ferai des observations...
ALBERT.
Oui, n’est-ce pas ?... Mais des observations dures, dures... Parce que, n’est-ce pas, quand on n’est pas en position d’entendre d’une jeune dame les choses... que l’on voudrait entendre, eh bien, à défaut de ça, on souhaite qu’elle vous attrape, comme le dernier des derniers, avec de la cruauté !...
Yvonne fait un geste de dénégation.
Si ! si ! de la cruauté !... Oh mademoiselle, comme je regrette que votre papa ne puisse pas me flanquer à la porte !
YVONNE.
Pourquoi ça ?
ALBERT.
Parce que, dans ce cas, je me dirais : « Eh bien ! allons-y ! vaille que vaille ! brûlons nos vaisseaux ! Tout le monde sur le pont ! Faisons-nous flanquer à la porte, mais lâchons le paquet, disons ce que nous avons sur le cœur... » Seulement, voilà... voilà ma destinée... Je ne peux pas me débarrasser du secret qui m’étouffe. Je suis forcé de rester ici jusqu’au 15 avril 1931, et si je disais ce que j’ai dans le cœur, ma situation serait un enfer. Et, en plus, voulez-vous que je vous dise ce qui me fait encore souffrir ?... Eh bien, c’est que je n’ai pas le courage de perdre tout espoir... Si j’avais perdu tout espoir, je serais plus tranquille. Je me dirais : « Eh bien ! tant pis ! Tu es dans le seau, reste au fond du seau... Tu as eu tort d’aimer une femme au-dessus de ta condition... »
Vivement, sur un geste d’Yvonne.
Une personne que vous ne connaissez pas... On dit qu’on a vu des rois épouser des bergères. Encore, quand on dit qu’on a vu... j’aurais voulu être là, moi !... Mais ce qu’on n’a jamais vu, c’est un garçon de café ignorant, bête, grossier, sans éducation, jeter les yeux sur une personne savante, distinguée, qui a plus d’esprit dans le plus petit de ses cinq doigts que cet énorme et grossier garçon de café dans toute sa personne... Seulement, hé ! hé !... cette personne savante, distinguée, ne se doute pas que ce garçon de café n’est pas si complètement bête qu’il en a l’air... il a toutes sortes d’idées dans sa tête... des idées assez gentilles, pas très bien rangées... enfin elles y sont, elles ne sortent pas souvent, mais elles sortent quelquefois... Il suffirait pour cela qu’on le regarde avec indulgence... Et puis, ce garçon de café est ignorant, mais ça se corrige, ça. Il apprendrait peut-être le piano et l’anglais tout comme un autre...
Yvonne sourit malgré elle.
Quant à son éducation, eh bien, ça se corrigera aussi, ça ! Il suffirait de lui faire une observation de temps en temps... On ne dirait pas : « Quel malheur d’être avec un butor pareil ! » on dirait simplement au butor ! « Butor, attention ! Il vaut mieux ne pas faire ça, ce n’est pas élégant. » Alors le butor se le tiendrait pour dit, car il aurait tellement peur de déplaire à cette personne qu’il serait capable de changer complètement et de devenir quelque chose comme un monsieur.
Avec exaltation.
Car l’amour, savez-vous bien, suffit à changer un homme, à condition que cet amour soit très fort, mais, pour ça, il n’y a pas d’erreur, l’amour que je ressens est un amour tout puissant... et je le dis maintenant : j’aime quelqu’un et personne ne m’empêchera de dire qui...
Il regarde Yvonne et s’arrête intimidé.
Les cinq minutes sont écoulées, je crois... et voilà des clients...
Entrent un client, Philibert et le plongeur. Yvonne se lève précipitamment.
Scène XII
ALBERT, LE PLONGEUR, YVONNE, PHILIBERT, LE CLIENT
LE PLONGEUR.
Tu lui as dit que tu n’avais pas de pépin pour elle.
ALBERT.
Oui... Oui, c’est-à-dire que je lui ai dit le contraire.
LE PLONGEUR.
Eh bien, merci !
Il sort.
YVONNE, appelant à droite.
Papa !
ALBERT, au client qui rentre.
Ah ! c’est vous, monsieur ! Qu’est-ce qu’il y a pour votre service ?
LE CLIENT.
Eh bien, je suis revenu parce que je suis sûr que mon ami va venir me prendre ici... Est-ce qu’il est venu un monsieur à barbe grise ?
ALBERT, distrait.
Un monsieur à barbe grise ?...
LE CLIENT.
Oui.
ALBERT, distrait.
Avec un chapeau haut de forme ?
LE CLIENT.
Non, un chapeau melon !
ALBERT.
Un chapeau melon et un pardessus ?
LE CLIENT.
Un pardessus marron !
ALBERT.
Un pardessus marron ?... Non, il n’est venu personne depuis que vous êtes venu tout à l’heure.
LE CLIENT, le regardant d’un air méfiant.
Donnez-moi un café noir.
ALBERT.
Tout de suite !
Il va à la table du fond, essuie la table avec sa serviette. Il épie du coin de l’œil Yvonne et Philibert.
YVONNE, au comptoir, à Philibert.
Papa, j’ai quelque chose à te dire de très grave... riens tout près... Je n’ai jamais compris pourquoi ce garçon ne pouvait pas s’en aller d’ici.
PHILIBERT.
Ce serait trop long à t’expliquer.
YVONNE, nerveuse.
Il faut qu’il s’en aille, tout de suite.
PHILIBERT.
C’est que je vais te dire... j’ai des conventions spéciales avec lui... S’il s’en va d’ici, il faut qu’il me donne une grosse somme...
YVONNE.
Pourquoi ça ?
PHILIBERT.
Nous avons fait un traité.
YVONNE.
Eh bien, papa, fais-lui grâce de cette somme.
PHILIBERT.
Comme tu y vas !
YVONNE, décidée.
Papa, si ce garçon ne s’en va pas, c’est moi qui m’en irai...
PHILIBERT.
Qu’est-ce que c’est que cette façon de parler à son père ?... D’abord, tu n’es pas majeure.
YVONNE.
Ce n’est pas ça qui m’empêcherait de m’en aller.
PHILIBERT.
Écoute, je vais tout arranger avec lui... Au fond, toute cette histoire m’embête... je vois qu’il ne veut pas s’en aller, et je lui donne cinq mille francs par an... Je vais lui parler.
YVONNE.
J’y compte bien.
Albert s’est approché du comptoir. Il a pris la cafetière et s’apprête à se diriger vers le client. Philibert l’arrête au milieu de la scène.
PHILIBERT.
Albert !
ALBERT.
Qu’est-ce qu’il y a ?
PHILIBERT.
J’ai réfléchi. Je vous demandais deux cent mille francs pour vous laisser vous en aller, eh bien, si vous voulez seulement me rembourser les petits frais que j’ai faits pour M. Bigredon, vous pourrez quitter la maison sans indemnité.
ALBERT.
Non !
PHILIBERT.
Ce n’est pourtant pas moi qui peux payer ces frais.
ALBERT.
Il ne s’agit pas de ça... On me proposerait de quitter la maison pour rien que je ne le ferais pas.
PHILIBERT.
Ah ! mais je vois ce que vous voulez...
LE CLIENT.
Eh bien ? Ce café ?
ALBERT.
Voilà ! Voilà !
Il se dirige vers le client. Philibert l’arrête.
PHILIBERT, au client.
Voilà ! Voilà !
Il retient Albert par le bras. À Albert.
Je vois ce que vous voulez... que ce soit moi qui vous renvoie et qui vous donne les deux cent mille francs ?
ALBERT, sursautant, avec indignation.
Jamais je ne prendrai cette somme... jamais je ne prendrai votre argent. Jamais je ne consentirai à dépouiller...
Il regarde du côté d’Yvonne.
votre famille... Mais je profite de ce qu’il vous est impossible de me renvoyer de cette maison que je ne peux quitter... J’ai éprouvé toutes sortes d’amertumes dans votre café
Avec émotion.
mais je l’aime, votre petit café... je ne peux pas m’en aller d’ici...
PHILIBERT, allant au comptoir.
C’est bien ! c’est bien !
LE CLIENT.
Eh bien, ce café ?
Albert va jusqu’au client et lui verse le café distraitement à côté de son verre, sur la table.
Eh bien ! Faites donc attention, nom d’un chien !
ALBERT.
Oh ! je vous demande pardon ! Je vais essuyer ça.
Il va dans le fond pour chercher une serviette.
LE CLIENT.
Eh bien, vous pourriez me verser le café, en attendant.
Albert va poser la cafetière dans le fond et revient avec sa serviette, essuie la table avec conviction, et plus longtemps qu’il ne faut.
PHILIBERT, au comptoir, à Yvonne.
Il ne veut pas s’en aller... Il profite de ce que j’ai un dédit à payer, deux cent mille francs, tu comprends... je ne peux pas lui payer cette somme.
YVONNE.
Alors, c’est moi qui vais lui parler.
PHILIBERT.
Tu ne réussiras pas.
YVONNE.
Je crois que si. Appelle-le.
Albert a été chercher la cafetière, il est revenu près du client et s’apprête à verser le café.
LE CLIENT, levant le nez d’un journal.
Enfin !
PHILIBERT.
Albert ! Venez par ici !
Albert quitte le client précipitamment.
LE CLIENT.
Eh bien, ce café ?
PHILIBERT.
Je vais vous verser, monsieur.
Il prend la cafetière, mais il reste au milieu du café, la cafetière à la main, pendant l’entretien d’Yvonne et d’Albert.
YVONNE, à Albert.
C’est vrai, ce que dit mon père ? Je ne puis le croire. Il paraît que, pour quitter la maison, vous voulez deux cent mille francs ?
ALBERT.
Je ne veux rien du tout... Je ne veux pas un sou de son argent. Jamais, pour rien au monde, je ne vous ferai tort d’un sou, à plus forte raison de deux cent mille francs... Je ne veux pas quitter cette maison.
YVONNE.
Vous ne voulez pas quitter cette maison ?
ALBERT, intimidé.
Eh bien, je ne sais pas... si c’était vous qui me le disiez... si cela vous faisait un énorme plaisir que je m’en aille ?... ou même un petit plaisir ?...
YVONNE.
Rendez-moi le service de vous en aller !
ALBERT.
Bien, mademoiselle... Bien ! Je vais m’en aller !
YVONNE.
Qu’est-ce que vous avez dans les yeux ?
ALBERT.
Rien ! Rien du tout.
YVONNE.
Si ! Si ! Vous avez quelque chose.
ALBERT.
Eh bien, j’ai un peu d’émotion...
Sanglotant.
à cause de ce petit café...
Sanglotant.
Chaque fois, d’ailleurs, que je quitte une place, c’est comme ça...
Sanglotant.
mais ça va passer... ça va passer !
YVONNE.
Albert !
ALBERT.
Mademoiselle ?
Il se met à pleurer plus fort.
YVONNE.
Monsieur Albert !
ALBERT.
Yvonne !
Se reprenant.
Mademoiselle Yvonne !
YVONNE.
Ça vous fait beaucoup de peine de quitter cette maison ?
Albert pousse un soupir.
Une peine sincère ?
Albert pousse un soupir énorme.
Ce n’est pas un caprice, un sentiment passager qui vous fait aimer ce petit café ?... Ce n’est pas parce que vous avez éprouvé des déceptions du côté d’un grand restaurant ?
ALBERT, la regardant.
Mademoiselle, j’ai toujours adoré ce petit café... je m’en rendais plus ou moins compte, mais je l’adorais malgré ses dédains, malgré sa dureté... et si j’ai été du côté des grands restaurants faciles, c’était pour m’étourdir, parce que ce petit café me semblait au-dessus de moi... Il était trop distingué... mademoiselle... trop divin !
YVONNE.
Eh bien, monsieur Albert, puisque ce petit café vous tient tant à cœur... puisque c’est sérieux, puisque c’est sincère, ne quittez pas ce petit café.
LE CLIENT, qui était resté le nez dans son journal, se lève à ce moment.
Alors, il n’y a pas moyen ?
PHILIBERT.
Voilà ! Voilà !
Il s’approche d’Albert et d’Yvonne et pose la cafetière sur une table.
Eh bien ?
YVONNE.
Eh bien, papa, il reste !
PHILIBERT.
Tu vois, je vais l’avoir pendant vingt ans.
ALBERT.
Oh ! non, monsieur, pas vingt ans.
YVONNE.
Pas vingt ans !...
PHILIBERT.
Combien de temps, alors ?... Vous avez transigé ?
Albert regarde Yvonne.
YVONNE.
Nous avons transigé... pour toute la vie...
Albert s’apprête à lui baiser la main. Mais elle le regarde et lui tend la joue, puis elle va à son père. Pendant ce temps le client s’est approché doucement de la table, a pris la cafetière et l’emporte à sa table pour se verser lui-même son café.