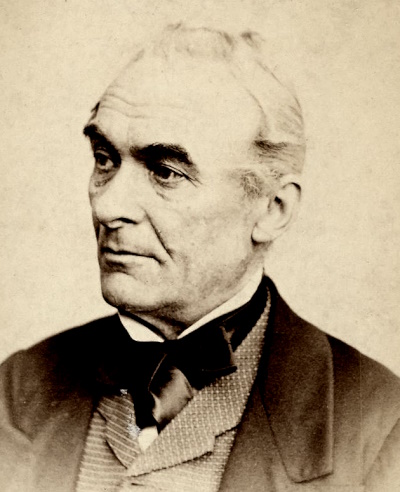L’Inspecteur général (Revizor) (Prosper MÉRIMÉE)
Pièce traduite du russe de Nicolas Gogol
Personnages
ANTON ANTONOVITCH SKVOZNIK-DMOUKHANOFSKI, gouverneur d’une ville[1]
ANNA ANDREÏEVNA, sa femme
MARIA ANTONOVNA, sa fille
LOUKA LOUKITCH KHLOPOF, recteur du collège
SA FEMME
AMMOS FËDOROVITCH LIAPKINE-TIAPKINE, juge
ARTEMII PHILIPPOVITCH ZEMLIANIKA, administrateur des établissements de bienfaisance, de l’hospice, etc.
IVAN KOUZMITCH CHPEKINE, directeur des postes (aux lettres et aux chevaux)
PËTR IVANOVITCH BOBTCHINSKI, gentilhomme propriétaire
PËTR IVANOVITCH DOBTCHINSKI, gentilhomme propriétaire
IVAN ALEXANDROVITCH KHLESTAKOF, employé dans un ministère à Pétersbourg
OSIP, son domestique
CHRISTIAN IVANOVITCH HUEBNER, Allemand, médecin du district.
FEDOR ANDREIEVITCH LIULIUKOF, fonctionnaire retraité, composant la haute société de la ville
IVAN LAZAREVITCH RASTAKOFSKI, fonctionnaire retraité, composant la haute société de la ville
STEPANE IVANOVITCH KOROBKINE, fonctionnaire retraité, composant la haute société de la ville
STEPANE ILITCH OUKHOVERTOF, inspecteur de police
SVISTINOF, sergent de ville
POUGOVITSYNE, sergent de ville
DERJIMORDA, sergent de ville
ABDOULINE, marchand
FEVRONIA PETROVA POCHLEPINE, femme d’un serrurier
MICHKA, domestique du gouverneur
LA FEMME D’UN SOUS-OFFICIER
UN GARÇON D’HÔTEL GARNI
VISITEURS
MARCHANDS, etc.
CARACTÈRES ET COSTUMES
LE GOUVERNEUR.
C’est un homme qui a vieilli dans l’administration et qui n’est pas une bête. Quoiqu’il aime les pots-de-vin et les cadeaux, il sait se conduire avec aplomb ; c’est un fonctionnaire sérieux, il raisonne même parfois assez juste ; il ne parlent trop haut, ni trop bas, ni trop, ni trop peu. Chacune de ses paroles a un sens. Ses traits sont durs et sévères, comme ceux des gens qui ont débuté dans un service pénible par les grades inférieurs. Chez lui, le passage de la terreur à la joie, de la bassesse à la hauteur sera rapide comme chez un homme qui a des penchants bas et ignobles. Il est en uniforme, boutonné, bottes à l’écuyère et éperons. Cheveux courts grisonnants.
ANNA ANDREÏEVNA.
Sa femme, coquette de province, entre deux âges, élevée en partie avec des romans et des albums, en partie avec les commérages des cuisinières et des femmes de chambre. Très curieuse ; dans l’occasion, elle se laisse aller à des vanteries. Elle exerce une certaine autorité sur son mari, par la seule raison qu’il ne trouve rien à lui répondre : mais cette autorité s’use en mercuriales et en sarcasmes. Elle change quatre fois de toilette dans le courant de la pièce.
KHLESTAKOF.
Jeune homme de vingt-trois ans, mince, fluet, un peu sot, et n’ayant pas grand chose dans la tête. Il est petit employé dans une chancellerie et non de ceux qu’on appelle des piocheurs. Il parle et agit à tort et à travers, montrant cependant parfois une certaine fermeté et quelque intelligence. Il parle par phrases entrecoupées, et les mots sortent toujours inopinément de sa bouche. Plus l’acteur qui remplira ce rôle montrera de naïveté et de simplicité, mieux il s’en acquittera. Costume à la mode.
OSIP
Domestique tel que sont ordinairement les valets d’un certain âge. Il parle lentement, regarde un peu en dessous, est raisonneur et aime à faire de la morale à son maître. En parlant il prend presque toujours sa grosse voix. Quand il cause avec son maître, il a une expression bourrue de franchise qui va jusqu’à la grossièreté. Il a plus d’esprit que son maître, et devine assez vite le fond des choses, mais il n’aime guère à parler ; c’est un coquin silencieux. Il porte une redingote grise ou bleue un peu usée.
BOBTCHINSKI et DOBTCHINSKI
L’un et l’autre humbles, bas et très curieux. Ils se ressemblent beaucoup. Tous les deux un peu ventrus, tous les deux bredouillant et gesticulant beaucoup des mains. Dobtchinski est un peu plus grand et plus sérieux que Bobtchinski, mais Bobtchinski est un peu plus vif et délié que Dobtchinski.
LIAPKINE-TIAPKINE, juge.
C’est un homme qui a lu cinq ou six livres, et qui, en conséquence, est quelque peu esprit fort ; grand chasseur, comme il est facile de s’en apercevoir au ton d’importance qu’il donne à chacune de ses paroles. L’acteur qui se chargera de ce rôle devra toujours conserver sur son visage l’expression de ce caractère. Il parle d’une voix de basse, en trainant les mots, reniflant et crachant, comme une vieille pendule qui siffle avant de sonner les heures.
ZEMLIANIKA
Très gros, maladroit et gauche, mais à cela près intrigant fieffé et voleur. Longs services et beaucoup de zèle.
LE DIRECTEUR DES POSTES.
Bonhomme jusqu’à la naïveté.
Les autres rôles n’ont pas besoin d’indication particulière ; les originaux se rencontrent à chaque instant sous les yeux. Messieurs les acteurs doivent apporter une grande attention à la dernière scène. Le dernier mot doit produire sur tous à la fois l’effet d’une commotion électrique. Tout le groupe doit changer de disposition à l’instant. Chacun doit laisser échapper en même temps un cri de stupéfaction, comme si ce cri sortait d’une seule poitrine. Faute d’observer cette recommandation on détruirait tout l’effet.
ACTE I
Un salon dans la maison du gouverneur.
Scène première
LE GOUVERNEUR, L’ADMINISTRATEUR DES HOSPICES, LE RECTEUR DU COLLÉGE, LE JUGE, L’INSPECTEUR DE POLICE, LE MÉDECIN, DEUX SERGENTS DE VILLE
LE GOUVERNEUR.
Je vous ai convoqués, Messieurs, pour vous faire part d’une nouvelle peu agréable. Il nous arrive un inspecteur général.
LE JUGE.
Comment ? un inspecteur !
L’ADMINISTRATEUR.
Un ! inspecteur général !
LE GOUVERNEUR.
Un inspecteur général, de Pétersbourg, incognito. Et notez bien, avec des instructions secrètes.
LE JUGE.
Voyez un peu !
L’ADMINISTRATEUR.
Comme si nous n’avions pas déjà assez de tracas. – Celui-là par-dessus le marché !
LE RECTEUR.
Seigneur, Dieu ! Et avec des instructions secrètes !
LE GOUVERNEUR.
J’en avais comme un pressentiment. Cette nuit je n’ai fait que rêver de deux rats extraordinaires. Je n’en ai jamais vu de pareils... noirs... et d’une taille !... Ils sont venus... ils flairaient... puis ils sont partis. – Tenez, je vais vous lire une lettre que je viens de recevoir d’André Ivanovitch Tchmykof. Vous le connaissez, Artemii Philippovitch. Voici ce qu’il me dit : « Mon cher ami, mon compère et mon bienfaiteur... » Hum !
Il marmotte en parcourant la lettre des yeux.
...« De t’avertir... » Ah ! c’est cela. « Je me hâte entre autres choses de t’avertir qu’il vient de partir un fonctionnaire avec mission d’inspecter toute la province et surtout notre district.
Il lève un doigt d’un air significatif.
Je tiens la chose de gens sûrs. Il s’annoncera comme un simple particulier, mais sois certain qu’il doit t’éplucher, ainsi que tous les autres, parce que tu es un homme d’esprit qui ne laisse pas perdre ce que charrie la rivière... » Hum !
Il s’arrête.
Ceci c’est... – « Aussi je te conseille de prendre tes précautions, car il peut arriver d’un moment à l’autre, si déjà même il n’est pas installé quelque part, incognito, dans ton endroit... Hier... » Ah ! ce sont des affaires de famille... « Ma sœur Anna Kirilovna est venue nous voir avec son mari. Ivan Kirilovitch est très engraissé. Il joue toujours du violon, etc., etc. » Vous savez toute l’affaire maintenant.
LE JUGE.
C’est étrange, tout à fait étrange... Ce n’est pas pour des prunes qu’il vient.
LE RECTEUR.
Pourquoi donc, Anton Antonovitch, pourquoi donc un inspecteur général ?
LE GOUVERNEUR.
Que voulez-vous, c’est un jugement de Dieu.
Il soupire.
Jusqu’à présent cela était tombé sur d’autres villes. C’est notre tour à présent.
LE JUGE.
Je me figure, Anton Antonovitch, qu’il y a là-dessous quelque petit mystère... et de la politique encore. Savez-vous ce que cela veut dire ? La Russie... oui... elle veut faire la guerre, et le ministère, voyez-vous... Eh bien ! il envoie un fonctionnaire pour voir s’il n’y a pas quelque part des émissaires de l’ennemi.
LE GOUVERNEUR.
Ah ! bien, oui ! Vous êtes malin ! des émissaires dans une ville de l’intérieur ! Est-ce que nous sommes sur la frontière, nous ? On voyagerait trois ans en partant d’ici qu’on n’arriverait pas à l’étranger.
LE JUGE.
Et moi je vous dis... Vous ne... Non, vous... Le gouvernement a son plan... Il a beau être loin... il sait ce qu’il fait... il a la puce à l’oreille.
LE GOUVERNEUR.
Puce ou non, Messieurs, je vous ai prévenus. Vous voilà avertis. En ce qui me regarde, j’ai pris quelques mesures ; faites-en autant, je vous le conseille. Vous surtout, Artemii Philippovitch. Sans doute notre inspecteur voudra voir tous vos établissements de bienfaisance. Aussi, vous ferez bien de vous arranger pour que tout soit sur un bon pied... qu’on ait des bonnets de coton blancs, et que les malades n’aient pas l’air de ramoneurs, comme d’habitude.
L’ADMINISTRATEUR.
Va pour des bonnets blancs. Cela n’est pas bien difficile.
LE GOUVERNEUR.
Oui ; et il faudrait avoir à chaque lit un écriteau en latin ou dans n’importe quelle langue. –
Au médecin.
C’est votre affaire, Christian Ivanovitch. – Oui, à chaque malade : quand il est tombé malade... quel jour, et un numéro... Et puis, vos malades fument du tabac si fort qu’on éternue rien qu’en entrant... Oui ; et le mieux serait qu’il y eût moins de malades ; car on ne manquera pas de dire que c’est manque de soins de la part de l’administration, ou faute de science du médecin.
L’ADMINISTRATEUR.
Oh ! pour ce qui est du traitement, je m’en suis entendu déjà avec Christian Ivanovitch. Plus on se rapproche de la nature, et mieux cela vaut ! Nous n’employons pas de médicaments coûteux. L’homme est un être simple. S’il meurt, il meurt ; s’il guérit, il guérit. Avec cela que Christian Ivanovitch aurait de la peine à s’entendre avec les malades, attendu qu’il ne sait pas un mot de russe.
Le médecin fait entendre un son entre I, I, et E, E.
LE GOUVERNEUR, au juge.
Je vous conseillerais encore à vous, Ammos Fëdorovitch, de faire attention au tribunal. Dans votre salle des pas perdus, par exemple, où se tiennent les plaideurs, votre garçon de basse-cour met vos oies et leurs oisons, qui viennent vous caqueter entre les jambes. Sans doute c’est bien fait de s’occuper de ses intérêts domestiques. Vos gens font bien de garder vos oies... seulement, voyez-vous, dans cet endroit-là, il vaudrait mieux... Il y a quelque temps que je voulais vous en parler, et je ne sais comment je l’ai oublié...
LE JUGE.
Eh bien ! je vais les faire tous envoyer à la cuisine. Voulez-vous dîner chez moi ?
LE GOUVERNEUR.
Ah ! Et puis votre salle d’audience, je suis fâché de vous le dire, elle n’est pas tenue. Elle a l’air de je ne sais quoi. Sur le bureau, avec les papiers, une cravache ! Je sais que vous aimez la chasse ; c’est très bien, mais vous ferez mieux, pour le moment, d’ôter cette cravache, vous la remettrez si vous voulez quand l’inspecteur sera parti. Il y a encore votre assesseur... c’est peut-être un homme entendu dans sa partie, mais il sent une odeur... on dirait toujours qu’il sort d’une distillerie. Cela ne vaut rien. Il y a longtemps que je voulais vous en parler, et puis je ne sais comment cela m’est sorti de la tête. Il y a des moyens d’arranger la chose, quand même, comme il le prétend, son haleine sentirait l’eau-de-vie de nature. On pourrait lui conseiller de manger de l’ognon ou de l’ail, ou n’importe quoi. On a des médicaments pour cela, n’est-ce pas, Christian Ivanovitch ?
LE MÉDECIN.
I, I, E, E.
LE JUGE.
Ma foi, je ne sais trop s’il y aura moyen. Il dit que c’est un coup qu’il a reçu en nourrice, et depuis ce temps-là, il sent l’eau-de-vie.
LE GOUVERNEUR.
Ce que je vous en dis, c’est seulement pour vous avertir. Quant à l’ordre qu’il y a ici, et à vos affaires intérieures qu’on vient éplucher, comme dit André Ivanovitch, je n’y comprends rien. Parbleu ! on le sait bien, il n’y a personne chez qui l’on ne trouve quelque chose à éplucher. Mais, c’est la providence qui le veut ainsi, et les voltairiens ont beau dire, ils n’y peuvent rien. Chacun a ses péchés.
LE JUGE.
Qu’appelez-vous péchés, Anton Antonovitch ? Il y a péchés et péchés. Moi, je ne m’en cache pas, je me laisse faire des cadeaux ; mais quels cadeaux ? des cadeaux de chiens courants. La belle affaire !
LE GOUVERNEUR.
De chiens ou d’autre chose, ce sont toujours des cadeaux.
LE JUGE.
Allons donc, Anton Antonovitch... Ah ! je ne dis pas, par exemple, que si quelqu’un se laissait donner une pelisse de cinq cents roubles, et un châle à sa femme alors...
LE GOUVERNEUR, en colère.
C’est bon ! Savez-vous pourquoi vous prenez des cadeaux de chiens ? c’est parce que vous ne croyez pas en Dieu. Vous n’allez jamais à l’église ; tandis que moi, au moins, j’ai de la religion. Tous les dimanches je vais à la messe. Mais vous... Allez, je vous connais. Quand vous vous mettez à parler de la façon dont le monde s’est fait, les cheveux m’en dressent sur la tête.
LE JUGE.
Que voulez-vous ? chacun a ses opinions.
LE GOUVERNEUR.
À la bonne heure ; moi je dis que quand on a trop d’esprit, c’est pis que si l’on n’en avait pas. Au reste, moi, je ne vous parle que du tribunal du district ; et pour dire la vérité, personne ne s’avise d’y mettre le nez. C’est un lieu privilégié, et Dieu lui-même l’a sous sa protection.
Au recteur.
Mais vous, Louka Loukitch, en votre qualité de recteur de l’Académie, vous avez vos professeurs à surveiller. Je sais que ce sont des gens instruits, qui ont été éduqués au collège, cela n’empêche pas qu’ils n’aient d’étranges façons, qui naturellement ne vont guère avec leur état. Tenez, par exemple, vous en avez un, ce gros joufflu... Je ne me rappelle pas son nom... Sitôt qu’il monte en chaire, il ne peut pas s’empêcher de faire la grimace. Il fait comme cela.
Il fait la grimace.
Et puis, il vous met la main dans sa cravate, et le voilà qui se gratte le menton. Qu’il fasse la grimace aux écoliers, passe encore, c’est peut-être nécessaire pour professer, vous le savez mieux que moi ; mais je vous en fais juge, s’il s’en va faire ainsi des mines à l’inspecteur, cela peut tourner mal. M. l’inspecteur général, ou n’importe qui, n’a qu’à croire qu’on veut se moquer de lui, et le diable sait comment il le prendra.
LE RECTEUR.
Mais qu’y faire ? Mon Dieu, je lui en ai déjà parlé. Il n’y a pas longtemps, quand l’examinateur est venu, il lui a fait une grimace comme jamais je n’en avais encore vue. Je sais bien qu’il n’y met pas de malice, mais on me réprimande : on me dit qu’il ne faut pas inculquer des habitudes d’indépendance à la jeunesse.
LE GOUVERNEUR.
Il faut encore que je vous parle de votre professeur d’histoire. C’est une tête solide, bien farcie, cela se voit. Il a pénétré dans les brouillards de la science, mais dans ses explications il apporte tant de feu, qu’il ne fait plus attention à rien. Une fois je fus l’entendre. Il nous parla des Assyriens et des Babyloniens... Passe. Mais voilà-t-il pas qu’il en vient à Alexandre de Macédoine, et alors je ne puis vous dire tout ce qu’il a fait. J’ai cru que le feu était à son estrade. Il se démenait, il sortait de sa chaire, il vous travaillait son fauteuil. Je sais bien qu’Alexandre de Macédoine est un héros, mais ce n’est pas une raison pour casser les chaises. C’est ainsi qu’on entraîne le gouvernement dans des dépenses.
LE RECTEUR.
Ah ! oui, il s’échauffe un peu trop. Je lui ai déjà dit... Il me répond : Comme vous voudrez, mais je me sacrifie pour la science.
LE GOUVERNEUR.
À la bonne heure, mais comment savoir si c’est un bomme d’esprit ou bien un ivrogne qui vous fait des grimaces à faire peur aux saints[2] !
LE RECTEUR.
Le Seigneur nous soit en aide ! Si vous saviez ce que c’est que l’enseignement ! Moi, je meurs de peur. En matière d’enseignement chacun s’y prend à sa manière, pour faire voir qu’il est homme d’esprit.
LE GOUVERNEUR.
Tout cela ne serait rien. C’est ce maudit incognito. Figurez-vous qu’il nous tombe ici : – « Ah ! c’est vous, mes farceurs ? Qui est-ce qui est juge ici ? – M. Liapkine-Tiapkine. – Avance ici, Liapkine-Tiapkine. – Qui est-ce qui est administrateur des établissements de bienfaisance ? – M. Zemlianika. – Avance ici, Zemlianika. » – C’est le diable que cela !
Scène II
LES MÊMES, LE DIRECTEUR DES POSTES
LE DIRECTEUR.
Dites-moi donc, Messieurs, qu’est-ce que c’est que cet inspecteur qui va venir ?
LE GOUVERNEUR.
En savez-vous quelque chose ?
LE DIRECTEUR.
C’est Pëtr Ivanovitch Bobtchinski qui me l’a appris. Il était tout à l’heure dans mon bureau.
LE GOUVERNEUR.
Eh bien ! qu’en dites-vous ?
LE DIRECTEUR.
Ce que j’en dis ? Nous allons avoir la guerre avec les Turcs.
LE JUGE.
Ah ! c’est précisément ce que je pensais.
LE GOUVERNEUR.
Ah ! bien oui. Vous y êtes joliment !
LE DIRECTEUR.
Oui, la guerre avec les Turcs. Les Français en crèveront de dépit.
LE GOUVERNEUR.
La guerre avec les Turcs ! Eh non, c’est à nous, pas aux Turcs qu’on va faire la guerre. La chose est certaine. J’ai là une lettre.
LE DIRECTEUR.
Ah ! bien, alors, c’est qu’on ne fera pas la guerre aux Turcs.
LE GOUVERNEUR.
Eh bien ! vous, où en êtes-vous, Ivan Kouzmitch ?
LE DIRECTEUR.
Mais comment voulez-vous ?... Et vous, Anton Antonovitch ?
LE GOUVERNEUR.
Moi ? Je n’ai pas peur, mais cela me fait quelque chose. Les marchands et les bourgeois m’inquiètent. Ils disent que je les ai écorchés. Mon Dieu ! si je leur ai pris quelque chose, c’est sans malice. Je me figure.
Il le prend par le bras et le mène d’un autre côté du théâtre.
Je me figure qu’il y a eu quelque dénonciation contre moi. Car, enfin, pourquoi nous enverrait-on un inspecteur général ? Écoutez donc, Ivan Kouzmitch, est-ce que vous ne pourriez pas, pour notre avantage à tous... Toutes les lettres qui passeraient par votre bureau, au départ et à l’arrivée... est-ce que vous ne pourriez pas les décacheter un peu, voyez-vous, et les lire, pour savoir s’il n’y a pas de dénonciations, ou seulement de la correspondance. S’il n’y a rien, on peut les recacheter ; d’ailleurs cela ne fait rien, on peut donner les lettres décachetées.
LE DIRECTEUR.
Connu, connu... Vous ne m’apprendrez pas mon métier. Je n’en fais jamais d’autres, non par mesure de précaution, mais par pure curiosité. Mais, je vous avouerai que je meurs d’envie de savoir tout ce qu’il y a de nouveau. Je vous donne ma parole qu’il n’y a pas de lecture plus intéressante... Il y a des lettres qui sont amusantes... On écrit des choses... Quelquefois c’est si bien tourné... c’est mieux que dans les gazettes de Moscou.
LE GOUVERNEUR.
Eh bien ! dites-moi, n’avez-vous rien lu au sujet d’un certain fonctionnaire de Pétersbourg ?
LE DIRECTEUR.
Non. De Pétersbourg, rien du tout ; mais d’un fonctionnaire de Kostroma et de Saratof, il en est fort question. Je suis fâché que vous ne lisiez pas les lettres. Il y a des morceaux magnifiques. Tenez, il n’y a pas longtemps, un lieutenant écrivait à un de ses amis. Il faisait la description d’un bal... Sans badinage... c’était charmant, charmant : « Je vis, mon cher, disait-il, je vis dans les cieux. Quantité de demoiselles ; la musique retentit, on s’élance... » Comme cela... une description achevée ! Tenez, je l’ai précisément sur moi. Voulez-vous que je vous la lise ?
LE GOUVERNEUR.
Non ; pas en ce moment. Ainsi, vous me ferez ce plaisir, Ivan Kouzmitch ? Si, à l’avenir, vous tombez sur une requête ou une dénonciation, retenez-la sans balancer.
LE DIRECTEUR.
De tout mon cœur.
LE JUGE, qui l’a entendu.
Prenez garde. Vous vous ferez quelque affaire.
LE DIRECTEUR.
Hélas ! mon Dieu !...
LE GOUVERNEUR.
Rien, rien ! À la bonne heure si cela se faisait publiquement, mais c’est comme en famille que cela se fait.
LE JUGE.
Mauvaise affaire, mauvaise affaire ! Dites donc, Anton Antonovitch, j’ai bien envie de vous céder un petit chien. C’est le propre frère de mon chien que vous savez. On vous a dit que Tcheptovitch est en procès contre Varkhovniski ; alors je m’en donne. Je cours des lièvres tantôt chez l’un tantôt chez l’autre.
LE GOUVERNEUR.
Mon petit père[3], j’ai bien autre chose maintenant que vos lièvres en tête. Ce diable d’incognito ne me sort pas de l’esprit. Je m’attends à chaque minute que la porte va s’ouvrir et que...
Scène III
LES MÊMES, BOBTCHINSKI et DOBTCHINSKI, accourant tout essoufflés
BOBTCHINSKI.
Grande nouvelle !
DOBTCHINSKI.
Quel événement imprévu !
TOUS.
Quoi donc ?
DOBTCHINSKI.
Une affaire incroyable ! Nous entrons chez le traiteur...
BOBTCHINSKI, l’interrompant.
Nous entrons, Pëtr Ivanovitch et moi, chez le traiteur...
DOBTCHINSKI.
Non, permettez, Pëtr Ivanovitch. Je vais leur conter l’affaire...
BOBTCHINSKI.
Non, permettez-moi... permettez-moi... Je... Vous ne savez pas tout...
DOBTCHINSKI.
Mais vous vous embrouillerez, et vous ne vous souvenez pas...
BOBTCHINSKI.
Mon Dieu si, je me souviens parfaitement de tout. Seulement, ne me troublez pas. Je vais raconter la chose, mais ne me troublez pas. Je vous en prie, Messieurs, faites-moi la grâce d’empêcher Pëtr Ivanovitch d’interrompre.
LE GOUVERNEUR.
Parlez donc ! Au nom de Dieu ! qu’y a-t-il ? J’ai le cœur sens dessus dessous. Asseyez-vous, messieurs. Prenez des sièges. Pëtr Ivanovitch, voilà une chaise.
Tous s’assoient en cercle autour des deux Pëtr Ivanovitch.
Eh bien donc ! de quoi s’agit-il ?
BOBTCHINSKI.
Permettez, permettez, commençons par le commencement. Aussitôt que j’eus pris congé de vous, vous laissant dans l’inquiétude à cause de cette lettre que vous aviez reçue... oui... c’est alors que je courus... Allons, je vous en prie, ne m’interrompez pas, Pëtr Ivanovitch. Je vous dis que je sais tout, tout, tout. Donc, comme j’avais l’honneur de vous le dire, je courus chez Korobkine. Korobkine n’était pas chez lu, de sorte que je retournai chez Rastakofski, et Rastakofski étant sorti, j’entrai chez Ivan Kouzmitch, pour lui raconter la nouvelle que vous m’aviez communiquée ; sortant de là, je rencontre Pëtr Ivanovitch...
DOBTCHINSKI, l’interrompant.
Près de la boutique du pâtissier...
BOBTCHINSKI.
Près de la boutique du pâtissier. Oui, je rencontre Pëtr Ivanovitch, et je lui dis : Dites donc, savez-vous la nouvelle que vient de recevoir Anton Antonovitch, dans une lettre d’une personne sûre ? Mais Pëtr Ivanovitch la savait déjà de votre femme de charge Avdotia, qui s’en allait, je ne sais pour quelle commission, chez Philippe Antonovitch Potchetchouïef.
DOBTCHINSKI, interrompant.
Chercher un petit baril à mettre du cognac.
BOBTCHINSKI, lui imposant silence de la main.
Oui, pour chercher un petit baril à mettre du cognac. Eh bien, nous nous en allons, Pëtr Ivanovitch et moi, chez Potchetchouïef... Allons, Pëtr Ivanovitch... n’interrompez pas... de grâce, n’interrompez pas ! – Nous nous en allons chez Potchetchouïef, et dans le chemin, voilà Pëtr Ivanovitch qui me dit : Entrons, dit-il, dans le restaurant. Je me sens je ne sais quoi dans l’estomac... Je n’ai rien mangé depuis ce matin. J’ai des tiraillements d’estomac... Oui, Pëtr Ivanovitch avait quelque chose à l’estomac... Oui, me dit-il, le traiteur vient de recevoir du saumon frais. Nous allons en manger. – À peine étions-nous dans le restaurant, que tout à coup un jeune homme...
DOBTCHINSKI.
D’un extérieur assez agréable, bien mis...
BOBTCHINSKI.
D’un extérieur assez agréable, bien mis ; il entre dans le salon. Sur son visage, on voyait un air décidé... une physionomie... des traits...
Tournant sa main autour de son front.
beaucoup, beaucoup de tout cela. J’eus comme un pressentiment, et je dis à Pëtr Ivanovitch : Voilà quelqu’un qui n’est pas ici pour des prunes. Oui. Et Pëtr Ivanovitch, il fait signe comme cela, du doigt, au maître du restaurant. Vlas, le maître du restaurant... Sa femme est accouchée il y a trois semaines d’un vigoureux petit gaillard, qui, un jour, comme son père, tiendra le restaurant. Pëtr Ivanovitch appelle donc Vlas, et lui demande tout bas : Qui est donc, dit-il, ce jeune homme. Vlas lui répond comme cela : – Celui-ci ? dit-il... Ah ! n’interrompez pas, Pëtr Ivanovitch. Mon Dieu ! ne m’interrompez pas. Ce n’est pas vous qui parlez, mon Dieu, non ! Vous bredouillez. Vous savez bien que vous avez une dent dans la bouche qui siffle... Celui-ci, dit-il, ce jeune homme ? C’est un employé du gouvernement qui vient de Pétersbourg. Il s’appelle, dit-il, Ivan Alexandrovitch Khlestakof, et il va, dit-il, dans le gouvernement de Saratof, et, dit-il, il a de drôles de façons. Voilà près de deux semaines qu’il est ici. Il ne sort pas de l’hôtel. Il prend tout à crédit, et de son argent... on n’en voit pas un kopek. Voilà ce qu’il me dit, et moi, cela me donna à penser. – Dites donc, que je dis à Pëtr Ivanovitch...
DOBTCHINSKI.
Non, Pëtr Ivanovitch, c’est moi qui vous ai dit : dites donc...
BOBTCHINSKI.
Oui, d’abord vous m’avez dit : dites donc ; mais après moi, j’ai dit à Pëtr Ivanovitch : À propos de quoi donc, que je dis, reste-t-il ici, puisqu’il s’en va dans le gouvernement de Saratof ? – Oui... et c’est un employé du gouvernement.
LE GOUVERNEUR.
Comment ? un employé !
BOBTCHINSKI.
L’employé, dont on vous a annoncé l’arrivée... l’inspecteur général.
LE GOUVERNEUR, effrayé.
Comment ! Le bon Dieu vous bénisse ! C’est impossible !
DOBTCHINSKI.
C’est lui. Il ne paie rien ; il ne s’en va pas. Qu’est-ce donc que ce serait ? Son passeport est visé pour Saratof.
BOBTCHINSKI.
C’est lui, sur mon honneur, c’est lui... C’est qu’il remarque tout... Il regardait ; rien ne lui échappait... Il a vu que nous mangions du saumon, Pëtr Ivanovitch et moi, d’autant plus que Pëtr Ivanovitch, à cause de son estomac... oui... Il a jeté un regard dans nos assiettes... Il m’a fait peur.
LE GOUVERNEUR.
Ah ! Seigneur Dieu, ayez pitié de nous pauvres pécheurs ! Où est-il ?
DOBTCHINSKI.
N° 5, sous l’escalier.
BOBTCHINSKI.
Le même numéro, où l’année passée se sont battus ces officiers qui passaient.
LE GOUVERNEUR.
Et ya-t-il longtemps qu’il est là ?
DOBTCHINSKI.
Environ deux semaines. Il est descendu chez Vassili-Eghiptianine.
LE GOUVERNEUR.
Deux semaines !
À part.
Oh ! mes patrons ! Ô mes petits saints ! Épargnez-moi, mes protecteurs ! Et la femme du sous-officier qu’on a fouettée pendant ce temps-là[4] ! Et les prisonniers qui n’ont pas eu leurs rations ! Et les cabarets dans les rues, et pas de balayage !... Miséricorde ! je suis perdu.
Il se prend la tête à deux mains.
L’ADMINISTRATEUR.
Eh bien, Anton Antonovitch, il faut aller en uniforme à l’hôtel.
LE JUGE.
Non, non. D’abord, il faut lui détacher le prévôt, le clergé, les marchands. Savez-vous ce qu’il y a dans le livre de la vie de Jean Masson...
LE GOUVERNEUR.
Non, non, laissez-moi faire. Allons, il y a des moments pénibles dans la vie ; cela passe, grâce au ciel. Pourvu que le bon Dieu ne nous abandonne pas !
À Bobtchinski.
Vous dites que c’est un jeune homme ?
BOBTCHINSKI.
Un jeune homme de vingt-trois à vingt-quatre ans, pas davantage.
LE GOUVERNEUR.
Tant mieux. Un jeune homme, ça se devine. Le pire, c’est un vieux diable. Un jeune est toujours en dehors. Vous, messieurs, préparez-vous. Moi, j’y vais seul, avec Pëtr Ivanovitch, sans faire semblant de rien, comme si je me promenais, pour voir si les voyageurs sont bien traités. Holà ! Svistinof !
SVISTINOF.
Plaît-il ?
LE GOUVERNEUR.
Cours après l’inspecteur de quartier... Non. J’ai besoin de toi. Dis à quelqu’un qu’on me fasse venir tout de suite l’inspecteur de quartier, et reviens vite.
L’ADMINISTRATEUR.
Allons, allons-nous-en, Ammos Fëdorovitch. Il peut arriver quelque malheur.
LE JUGE.
Pourquoi avoir peur ? Les malades ont des bonnets blancs, tout est dit.
L’ADMINISTRATEUR.
Des bonnets ! on ordonne de donner du bouillon aux malades, et dans tous les corridors c’est une odeur de choux qui vous prend au nez...
LE JUGE.
Quant à cela, moi, je suis tranquille. Qui s’aviserait d’aller au tribunal ? Et si l’on s’avise de regarder dans quelque papier, on sera bien avancé. Il y a quinze ans que je siège sur le fauteuil de juge, et si j’ai regardé un mémoire... Bah ! bah ! Salomon lui-même ne découvrirait pas s’ils disent vrai ou non.
Le juge, l’administrateur des hospices, le recteur et le directeur des postes sortent et se rencontrent à la porte avec Svistinof qui revient.
Scène IV
LE GOUVERNEUR, BOBTCHINSKI, DOBTCHINSKI, SVISTINOF
LE GOUVERNEUR.
Le drochki est-il là ?
SVISTINOF.
Oui, monsieur le gouverneur.
LE GOUVERNEUR.
Va-t’en dans la rue... non, attends... Va prendre... Où sont donc les autres ? Est-ce que tu es tout seul ? J’avais commandé que Prokhorof fût ici. Où est Prokhorof ?
SVISTINOF.
Prokhorof est au corps de garde. Seulement, il ne peut rien faire.
LE GOUVERNEUR.
Comment cela ?
SVISTINOF.
C’est qu’on l’a rapporté ce matin ivre mort. Voilà deux seaux d’eau qu’on lui jette sur la tête, il ne revient pas.
LE GOUVERNEUR.
Ah ! mon Dieu, mon Dieu ! Cours vite dans la rue... Non, reste... va-t’en d’abord dans ma chambre, entends-tu ? Tu m’apporteras mon épée et mon chapeau neuf. Allons, Pëtr Ivanovitch, partons.
ВОВТCHINSKI.
Et moi, et moi... Permettez-moi d’y venir aussi, Anton Antonovitch.
LE GOUVERNEUR.
Non, Pëtr Ivanovitch. Cela ne se peut pas. Je n’ai qu’un drochki, et il n’y a pas de place.
ВОВTCHINSKI.
Ne faites pas attention ; j’irai à pied, je courrai derrière le drochki... pourvu que je puisse regarder par une fente au travers de la porte, et savoir ce qu’il fait.
LE GOUVERNEUR, prenant son épée que Svistinof lui apporte.
Va-t’en bien vite, prendre les dizainiers, et que chacun d’eux m’empoigne... – Ah ! comme cette épée est abîmée ! Ce maudit marchand Avdouline ! il voit que le gouverneur a une vieille épée, et il ne lui en envoie pas une neuve ! Quel tas de coquins ! Ah ! mes drôles ! et je suis bien sûr qu’ils ont déjà leurs pétitions toutes prêtes, et qu’il en va sortir de dessous les pavés... faut que chacun m’empoigne la rue... Le diable emporte la rue... ! qu’il m’empoigne un balai, veux-je dire, et qu’on me nettoie la rue devant l’hôtel, et qu’elle soit propre... Écoute. Fais attention ! Je te connais, toi ! Tu fais le bon apôtre, oui, et tu fourres des cuillers d’argent dans tes bottes. Prends-y garde. Ne m’échauffe pas les oreilles. Quel tripotage as-tu fait chez le marchand Tchernaïef ? Hein ? Il t’a donné deux archines de drap pour te faire un uniforme, et tu as chipé toute la pièce. Prends-y garde. Tu n’es pas d’un rang à voler comme cela[5] ! File !
Scène V
LE GOUVERNEUR, BOBTCHINSKI, DOBTCHINSKI, SVISTINOF, L’INSPECTEUR DE QUARTIER
LE GOUVERNEUR.
Ah ! Stepane Ilitch, dites-moi donc, pour l’amour de Dieu, où vous vous étiez fourré ? Quelles diables de manières est-ce là ?
L’INSPECTEUR.
J’étais, il n’y a qu’un instant, à la porte de la ville.
LE GOUVERNEUR.
Voyons. Écoutez, Stepane Ilitch. Il est arrivé un fonctionnaire de Pétersbourg. Comment sommes-nous parés ?
L’INSPECTEUR.
Comme vous l’avez commandé. J’ai envoyé le sergent Pougovitsyne avec les dizainiers pour nettoyer le trottoir.
LE GOUVERNEUR.
Et Derjimorda où est-il ?
L’INSPECTEUR.
Derjimorda est allé à un feu de cheminée.
LE GOUVERNEUR.
Et Prokhorof est ivre ?
L’INSPECTEUR.
Ivre.
LE GOUVERNEUR.
Comment souffrez-vous cela ?
L’INSPECTEUR.
Mon Dieu ! comment faire ? Hier, il y a eu une batterie dans le faubourg. Il est allé mettre le holà, et il est revenu ivre.
LE GOUVERNEUR.
Écoutez-moi. Voici ce que vous allez faire... Notre sergent de quartier... c’est un grand gaillard... qu’il se tienne sur le pont, pour le bon ordre. Ha ! ce vieil enclos, près du bottier, qu’on le nettoie au plus vite, et qu’on y plante des jalons, comme si on allait y faire des constructions. Des chantiers et des constructions, voyez-vous, il n’y a rien qui témoigne plus de l’activité de l’administration. – Ah ! mon Dieu ! Et moi qui oubliais qu’on a jeté dans cet enclos quarante charretées d’ordures ! Quelle sale ville ! S’il y a ici un monument ou un enclos réservé, bon ! le diable sait où ils vont chercher les saloperies qu’ils y apportent. Ah !... Et si l’inspecteur général demande à quelqu’un de vous : Est-on content ici ?... qu’on réponde : – Tout le monde est content, Monsieur. Et celui qui ne serait pas content, je me charge plus tard de lui donner du mécontentement... Oh ! oh ! malheureux pécheur que je suis !
Il prend un carton au lieu de son chapeau.
Ô mon Dieu ! fais seulement que je me tire de ses griffes, et je te donnerai un cierge comme personne ne t’en a offert. Chacun de ces coquins de marchands en sera pour trois pouds de cire. Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !... Partons, Pëtr Ivanovitch.
Par distraction, il met le carton aux papiers sur sa tête au lieu du chapeau.
L’INSPECTEUR.
C’est le carton que vous prenez, Anton Antonovitch ; voilà votre chapeau.
LE GOUVERNEUR, jetant le carton.
Quel carton ? Au diable le carton !... Et si on demande pourquoi on n’a pas bâti l’église de l’hospice pour laquelle, il y a cinq ans, on avait envoyé des fonds, il ne faut pas oublier de dire qu’on avait commencé à la bâtir, mais qu’elle a brûlé. J’ai fait un rapport là-dessus... Ah ! Et puis, que personne ne s’avise d’aller dire, comme une bête, qu’on n’a pas encore commencé. Dites encore à Derjimorda de ne pas trop jouer des poings. Qu’il ait soin de mettre à tout le monde, honnêtes gens ou autres, sa lanterne sous le nez. Qu’il ait l’air d’être à son service. Partons, partons, Pëtr Ivanovitch.
Il va pour sortir et revient.
Ah ! Et qu’on ne laisse pas sortir dans la rue des soldats faits comme je ne sais quoi... Cette maudite garnison met sa capote pardessus la chemise, et l’uniforme d’en bas elle s’en passe.
Ils sortent.
Scène VI
ANNA ANDREÏEVNA et MARIA ANTONOVNA, entrent en courant
ANNA.
Où sont-ils, où sont-ils ? Ah ! mon Dieu !
Elle ouvre la porte.
Mon mari ! Antoncha ! Anton ! – C’est toi, c’est toujours ta faute ! Toujours à lambiner ! une épingle par-ci, une collerette par-là !...
Elle court à la fenêtre et crie.
Anton ! où vas-tu, où vas-tu donc ? Est-ce qu’il est arrivé, l’inspecteur ? Est-ce qu’il a des moustaches ? quelles moustaches ?
Voix du GOUVERNEUR.
Tout à l’heure, tout à l’heure, mérotte.
ANNA.
Tout à l’heure... attendre des nouvelles ! Je ne veux pas attendre... Un mot seulement. Est-ce un colonel ? Hein ?
Avec dépit.
Allons ! il est parti ! Ah ! bien, c’est bon ! Je m’en souviendrai. – Et c’est toujours cette lambine-là ! Maman, maman, attendez-moi, je passe ma collerette ; je suis prête. Diantre soit de ton : Je suis prête ! Tu es cause que nous n’avons rien appris, et tout cela pour ta maudite coquetterie. Mademoiselle a su que le directeur des postes était ici, et la voilà à minauder devant le miroir, à se tourner par-ci, à se tourner par-là, et pendant ce temps-là, on est parti. Elle se figure peut-être qu’on en tient pour elle : il se moque de toi quand tu as le dos tourné.
MARIA.
Que voulez-vous, maman ? il faut prendre son parti. Nous saurons tout dans deux heures.
ANNA.
Dans deux heures ! bien des remerciements ! Ah ! j’aime fort cette réponse. Pourquoi donc ne pas dire dans un mois, nous en saurons bien davantage.
À la fenêtre.
Eh ! Avdotia ! Ah !... On t’a dit, Avdotia, que quelqu’un est arrivé... n’est-ce pas ?... Tu ne sais pas ? Qu’elle est bête ! Eh bien, ces signes que tu fais, je les vois bien, mais pourquoi ne pas avoir demandé ?... Elle n’a pas pu le savoir !... Des bêtises, elle ne voit que des amoureux... ? Ah ! partir si vite... Tu aurais dû courir après le drochki ! Vas-y, vas-y tout de suite. Tu entends bien ; cours, informe-toi. Sache où ils sont allés... Et puis ce voyageur, quel homme c’est, tu entends bien ? Regarde par le trou de la serrure, et dis-moi tout... Comment sont ses yeux, noirs, ou non, et reviens sur-le-champ. Tu entends : vite, vite, vite, vite !
Elle continue à parler à la fenêtre jusqu’à ce que la toile tombe.
ACTE II
Une petite chambre dans une auberge ; un lit, une table, une male, une bouteille vide, des bottes, une brosse à habits, etc.
Scène première
OSIP, couché sur le lit de son maître
Je crève de faim, le diable m’emporte ! Mes boyaux font autant de bruit que si j’avais dans le ventre toutes les trompettes d’un régiment. Est-ce que nous ne mangerons donc notre soûl que lorsque nous serons chez nous ? Qu’allons-nous devenir ? Voilà deux mois qu’il a quitté Piter[6]. Mon farceur a fricassé l’argent sur la route ; maintenant il a l’oreille basse, et il est doux comme miel. Nous avions bien de quoi payer la poste, et de reste. – Non, dans chaque ville, il faut que monsieur se montre.
Contrefaisant son maître.
Osip, monte voir ma chambre. La meilleure. Qu’on me fasse un bon dîner. Je ne puis manger de la drogue. Il me faut de la bonne chère. – Hélas ! aujourd’hui, comme nous nous arrangerions de la fricasse du premier gargotier venu ! Monsieur fait connaissance avec les voyageurs. On joue aux cartes... attrape ! nous voilà tondus. Ah ! cette vie-là m’ennuie. Je soupire après notre village. Dame ! ce n’est pas une vie publique ; mais au moins, on n’a pas à trimer. On a sa petite femme, on ne bouge pas de sa soupente, on mange des pâtés. D’un autre côté, il faut en convenir, il n’y a rien de comparable à la vie qu’on mène à Piter. Qu’on ait le gousset garni, quelle jolie vie d’homme politique on y fait... Les théâtres... les chiens savants, tout ce qu’on peut souhaiter. On y a des façons de parler si délicates qu’on dirait que c’est tout noblesse. Tu sors, les marchands te crient : Monsieur daigne-t-il commander quelque chose ? Tu passes la rivière, c’est un employé qui s’assied auprès de toi. Tu veux de la compagnie, entre dans un magasin. Un chevalier-garde te racontera ce qui se passe au camp, et t’explique ce que veut dire chaque étoile au ciel comme si tu l’avais dans la paume de ta main... Une vieille femme d’officier est prête à faire des bêtises... Une autre fois, c’est une jolie femme de chambre qui se retourne d’un air... fff !
Il sourit en secouant la tête.
Au diable la galanterie ! Elles n’ont pas un mot tendre à vous dire ; toujours vous. – Quand on est las de marcher, on prend un fiacre, on s’assied comme un monsieur, et si on ne veut pas payer – chose facile ; chaque maison a sa porte de derrière, par où l’on file que le diable ne vous rattraperait pas. Il y a un revers à la médaille : aujourd’hui on se donne une bosse, demain on crève de faim. Exemple : aujourd’hui. C’est sa faute. Mais qu’y faire ? Le papa nous donne de l’argent ; ce n’est pas pour en faire des reliques. Allons faire la noce ! Il nous faut des fiacres ; chaque jour il m’envoie lui chercher un billet pour la comédie – ça dure une semaine, et puis il me dit de porter son habit neuf chez ma tante. Je lui ai vu vendre au fripier jusqu’à sa dernière chemise, tant qu’il ne lui restait plus qu’une malheureuse petite redingote et sa robe de chambre, vrai comme il n’y a qu’un Dieu. Et de si beau drap ! du drap anglais. Un habit lui coûte cent cinquante roubles. Il met vingt roubles à son gilet, et pour les pantalons, je n’en dis rien ; on ne sait pas où cela va. Et pourquoi tout cela ? Pourquoi ? parce que monsieur n’est pas à son affaire. Au lieu d’aller à son bureau, monsieur se promène sur la Prechpective ; il fait sa partie. Ah ! si le vieux seigneur savait ce commerce-là ! Peut-être bien qu’il ne ferait pas attention que monsieur est employé du gouvernement, qu’il vous lui relèverait la chemise, et qu’il lui donnerait une dégelée à s’en frotter pendant une semaine. Comme tu sers, on te sert. Voilà le traiteur qui dit qu’il ne lui donnera plus à manger qu’il n’ait payé son mémoire... Et si nous ne payons pas...
Il soupire.
Hélas ! mon Dieu ! Tout ce que tu voudras, rien qu’une écuellée de soupe aux choux ! Je parie que tout le monde a déjà dîné à cette heure. On frappe. Ce doit être lui.
Il se lève précipitamment.
Scène II
OSIP, KHLESTAKOF
KHLESTAKOF.
Tiens...
Il lui donne sa casquette et sa badine.
Eh bien ! tu t’es encore vautré sur le lit ?
OSIP.
Moi ! Pourquoi donc me vautrer ? Je ne l’ai pas même regardé votre lit, moi.
KHLESTAKOF.
Tu mens. Tu t’es couché. Il est tout défait.
OSIP.
Comment ça se peut-il ? Je ne sais pas seulement ce que c’est qu’un lit. J’ai mes pieds. Je me tiens dessus. Je n’ai que faire de votre lit.
KHLESTAKOF, se promenant.
Regarde dans la blague s’il y a du tabac ?
OSIP.
Du tabac ? Il y a quatre jours que vous avez fumé le reste.
KHLESTAKOF se promène en se mordant les lèvres, d’un ton décidé et terrible.
Écoute, Osip !
OSIP.
Plaît-il ?
KHLESTAKOF, d’un ton terrible mais moins décidé.
Descends.
OSIP.
Où ?
KHLESTAKOF, d’un ton qui n’est plus ni terrible ni décidé mais presque suppliant.
En bas, au buffet... dis qu’on me monte à dîner.
OSIP.
Ah ! ma foi, non. Je n’y vais pas.
KHLESTAKOF.
Comment, drôle !
OSIP.
Et d’ailleurs, quand même j’irais, qu’est-ce que cela ferait. Le bourgeois dit qu’il ne veut plus vous donner à dîner.
KHLESTAKOF.
Comment, il oserait ! Voilà un impudent maroufle.
OSIP.
Il dit qu’il ira au gouverneur, parce qu’il y a quinze jours qu’on ne l’a payé. – Toi, dit-il, et ton maître vous êtes des polissons, et ton maître un escroc. J’en ai déjà vu, qu’il dit, des pique-assiettes comme vous.
KHLESTAKOF.
As-tu fini, brute que tu es, de dire tes sottises ?
OSIP.
Il dit : Cela vient, cela s’installe, cela prend à crédit, et on ne peut faire déguerpir cela. Mais moi, dit-il, je ne plaisante pas. Je fais ma plainte, et je vous fais fourrer en prison.
KHLESTAKOF.
Assez, imbécile ! Descends, descends lui parler. Quelle brute !
OSIP.
Il vaut mieux que je dise au maître de venir vous parler.
KHLESTAKOF.
Eh ! je n’ai que faire de le voir. Parle-lui toi-même.
OSIP.
Mais, Monsieur...
KHLESTAKOF.
Va donc, le diable t’emporte ! Fais monter le maître d’hôtel.
Osip sort.
Scène III
KHLESTAKOF, seul
J’ai une faim terrible. J’ai fait un tour, pensant que cela me ferait passer l’appétit, non, le diable emporte, il ne s’en va pas. Ah ! si je n’avais pas fait des bêtises à Penza, j’aurais encore assez d’argent pour aller à la maison. Ce capitaine d’infanterie m’a joliment refait. Ce n’est pas pour dire, mais l’animal sait bien filer la carte. En un quart d’heure, il m’a tondu rasibus. Avec tout cela, je donnerais bien quelque chose pour me reprendre encore une fois avec lui. Si j’avais seulement trouvé ma belle ! Quelle vilaine petite ville ! Les pâtissiers ne donnent rien à crédit. Polissons !
Il siffle l’ouverture de Robert et quelques airs russes.
Personne ne veut donc venir ?
Scène IV
KHLESTAKOF, OSIP et UN GARÇON DE L’HÔTEL
LE GARÇON.
Monsieur m’a chargé de demander à monsieur ce qu’il y a pour son service.
KHLESTAKOF.
Ah ! bonjour, mon camarade. Tu vas bien ?
LE GARÇON.
Oui, grâce à Dieu.
KHLESTAKOF.
Et dans l’hôtel, comment va tout le monde ? Tout va bien, j’espère ?
LE GARÇON.
Tout le monde va bien, Dieu merci.
KHLESTAKOF.
Vous avez beaucoup de voyageurs ?
LE GARÇON.
Oui, pas mal.
KHLESTAKOF.
Dis donc, mon cher, on ne m’a pas encore apporté mon dîner ; ainsi, fais-moi le plaisir de descendre, et de dire qu’on me le monte tout de suite, parce que, vois-tu, après dîner j’ai quelque chose à faire...
LE GARÇON.
Oui, Monsieur. C’est que monsieur a dit qu’il ne veut plus vous faire crédit. Il ne s’en est fallu de rien qu’il n’allât aujourd’hui se plaindre au gouverneur.
KHLESTAKOF.
Se plaindre ? Et de quoi ? Je t’en fais juge, mon cher, voyons... Il faut que je mange, d’abord... Je ne peux pas jeûner comme cela. J’ai une faim terrible ; je ne plaisante pas.
LE GARÇON.
Très bien, Monsieur. C’est qu’il a dit comme cela : Je ne lui donnerai pas à manger qu’il n’ait payé ce qu’il doit. Voilà ce qu’il a dit.
KHLESTAKOF.
Allons, allons, petit farceur, parle-lui.
LE GARÇON.
Mais que voulez-vous que je lui dise ?
KHLESTAKOF.
Parle-lui sérieusement, dis-lui que j’ai besoin de manger... De l’argent, quant à cela... Il s’imagine qu’on est comme un paysan et qu’on peut rester tout un jour sans manger... Il est bon là !
LE GARÇON.
Je m’en vas lui dire cela.
Il sort avec Osip.
Scène V
KHLESTAKOF, seul
Ce serait un peu fort s’il s’obstinait à ne pas me donner à manger. J’ai un appétit comme jamais je n’en ai eu. Peut-être qu’en vendant mes habits je pourrais me procurer assez d’argent pour gagner la maison... Vendre ses culottes ? Hein ? – Non, mieux vaut mourir de faim et revenir à la maison avec un costume de Pétersbourg... Je suis fâché que Joachim n’ait pas voulu me prêter une calèche. Le diable m’emporte ! je ne serais pas embarrassé avec une calèche ; je serais allé grand train, les lanternes allumées et Osip en livrée derrière, sous le balcon de quelque château. Alors tout le monde est en l’air. – Qu’est-ce qui vient ? Qu’est-ce que cela peut être ? – Mon valet se présente :
Il contrefait un valet qui annonce.
Ivan Alexandrovitch Khlestakof de Pétersbourg. Ordonnez-vous qu’il entre ? Mais ces lourdauds savent-ils seulement ce que cela veut dire : « Ordonnez-vous qu’il entre ? » Pour ces gens-là, qu’il arrive n’importe quelle oie, un campagnard... l’ours qu’il est, vous entre droit dans le salon. On trouve là une jolie demoiselle, on s’approche : Mademoiselle, je...
Il se frotte les mains et fait craquer ses bottes.
Heuh !
Il crache.
J’ai mal à l’estomac. C’est drôle, comme j’ai faim.
Scène VI
KHLESTAKOF, OSIP, puis LE GARÇON DE L’HÔTEL
KHLESTAKOF.
Eh bien ?
OSIP.
On apporte le dîner.
KHLESTAKOF frappe des mains et tambourine doucement sur la table.
Le dîner ! le dîner ! le dîner !
LE GARÇON, portant quelques assiettes.
Monsieur dit que c’est pour la dernière fois qu’il vous fait servir à dîner.
KHLESTAKOF.
Monsieur, monsieur... Je me moque pas mal de ton monsieur. Qu’est-ce que tu as là ?
LE GARÇON.
De la soupe et du rôti.
KHLESTAKOF.
Comment, deux plats seulement !
LE GARÇON.
Oui.
KHLESTAKOF.
Mais quelle infamie ! Je n’en reviens pas. Dis-lui... que jamais on n’a vu... Comme il y en a peu !
LE GARÇON.
Non, le maître dit qu’il y en a beaucoup.
KHLESTAKOF.
Et des légumes, pourquoi n’y en a-t-il pas ?
LE GARÇON.
Il n’y en a pas.
KHLESTAKOF.
Pourquoi donc ? En passant près de la cuisine, j’ai vu qu’on en faisait à force. Et aujourd’hui, dans le salon du restaurant, il y avait deux petits messieurs qui mangeaient du saumon et beaucoup de toutes sortes de choses.
LE GARÇON.
De cela, il y en a, et il n’y en a pas, s’il vous plaît.
KHLESTAKOF.
Comment, il n’y en a pas !
LE GARÇON.
Mon Dieu, non, il n’y en a pas.
KHLESTAKOF.
Il n’y a pas du saumon, du poisson, des côtelettes ?
LE GARÇON.
Ah ! oui, mais pour ceux qui paient.
KHLESTAKOF.
Quel imbécile tu fais !
LE GARÇON.
Je ne dis pas.
KHLESTAKOF.
Tu es un vilain maroufle... Qu’est-ce à dire ? Je ne mangerai pas de ce que les autres mangent ? Pourquoi pas moi, de par tous les diables ! Ne suis-je pas un voyageur comme eux ?
LE GARÇON.
Pardonnez-moi, ce n’est pas la même chose.
KHLESTAKOF.
Pourquoi donc ?
LE GARÇON.
Mais la différence... Eux, Monsieur... les autres voyageurs paient.
KHLESTAKOF.
Imbécile, je ne veux pas disputer avec toi.
Il se met à manger la soupe.
Qu’est-ce que cela ? De la soupe ! C’est de l’eau que tu as versée dans la soupière... ça ne sent rien... c’est de la lavasse infecte... Je ne mange pas de cela, donne-moi d’autre soupe.
LE GARÇON.
Je vais l’emporter. Dame, monsieur dit que si vous n’en voulez pas, vous la laissiez.
KHLESTAKOF, retenant la soupière que le garçon veut emporter.
Laisse... laisse cela, imbécile... Tu es habitué à faire aller le monde ici... mais moi je n’aime pas les plaisanteries... ne t’y frotte pas...
Il mange.
Ah ! grand Dieu ! quelle soupe !
Il mange toujours.
Je suis sûr qu’il n’y a pas un homme au monde qui en ait mangé de pareille... De la graisse... et des plumes à la nage.
Il découpe une poule.
Ah ! quelle poule !... donne-moi le rôti. Osip, il reste un peu de soupe, c’est pour toi.
Il coupe le rôti.
Ça du rôti ! Ça n’est pas du rôti.
LE GARÇON.
Qu’est-ce donc que c’est ?
KHLESTAKOF.
Le diable le sait, mais je vois bien que ce n’est pas du rôti. C’est une savate brûlée au lieu de rôti.
Il mange.
Canaille ! drôles ! voilà comme ils vous nourrissent. On s’abîme la mâchoire à en manger une bouchée.
Il se cure les dents avec le doigt.
Faquins ! c’est comme une écorce, impossible d’avaler cela, et cela vous noircit les dents.
Il s’essuie la bouche avec la serviette.
Est-ce qu’il n’y a plus rien ?
LE GARÇON.
Rien.
KHLESTAKOF.
Canaille ! drôles ! comment, pas un légume, pas de pâtisserie ! Gredins ! Voilà comme on traite les voyageurs !
Le garçon et Osip emportent les assiettes.
Scène VII
KHLESTAKOF, puis OSIP
KHLESTAKOF.
Parbleu ! c’est comme si je n’avais rien mangé. Cela n’a fait que me mettre en appétit. Si j’avais quelque chose dans ma poche, j’enverrais chercher un pain d’un sou.
OSIP, entrant.
Le gouverneur est ici, qui veut se faire annoncer, et demande après vous.
KHLESTAKOF, effrayé.
Que dis-tu ? Comment ! cette bête de maître d’hôtel a déjà porté sa plainte ! Est-ce qu’il voudrait par hasard me fourrer en prison ? Diable ! Si j’essayais d’une manière noble... non, non, je ne veux pas. Dans cette ville, les officiers et les bourgeois sont toujours à flâner. J’ai voulu leur montrer les belles manières, et j’ai commencé par faire l’œil à la fille d’un marchand... Non, non, cela ne vaut rien... Mais comment oserait-il... Suis-je donc un marchand ou un artisan ?
S’enhardissant et se redressant.
Ah ! je m’en vais lui dire : Avez-vous bien l’audaces...
Le bouton de la porte tourne ; Khlestakof pâlit et frémit.
Scène VIII
KHLESTAKOF, LE GOUVERNEUR et DOBTCHINSKI
Le gouverneur fait un pas en avant et s’arrête ; tous les deux, effrayés se regardent l’un l’autre un moment, puis baissent les yeux.
LE GOUVERNEUR, prenant un peu de courage.
Bonjour, Monsieur...
KHLESTAKOF.
Serviteur.
LE GOUVERNEUR.
Pardonnez-moi si...
KHLESTAKOF.
Comment donc... de rien...
LE GOUVERNEUR.
Mon devoir, comme le principal magistrat de cette ville, c’est de prendre des mesures pour que les voyageurs et tous les gens comme il faut n’éprouvent aucun...
KHLESTAKOF, balbutiant d’abord, mais se rassurant et grossissant sa voix peu à peu.
Que voulez-vous... que j’y fasse... ce n’est pas ma faute... Je paierai... On m’enverra de chez moi...
Bobtchinski entr’ouvre la porte et regarde.
C’est plutôt sa faute : il me donne du veau dur comme une planche ; de la soupe... le diable sait ce qu’on a mis dedans, et j’ai été obligé de la jeter par la fenêtre. Il me fait mourir de faim toute la journée... Du the incroyable : il sent le poisson, pas le thé... Pourquoi donc... ? voilà une drôle...
LE GOUVERNEUR, intimidé.
Pardonnez, Monsieur, ce n’est pas ma faute. Le veau que j’achète au marché est toujours bon. Ce sont des marchands de Kholmogor qui l’apportent, gens honnêtes et de bonnes mœurs. Je ne sais pas où il prend celui dont vous parlez. Mais s’il n’est pas... alors... permettez-moi de vous proposer de vous faire changer de logement.
KHLESTAKOF.
Non pas ! je ne veux pas. Je sais bien ce que vous voulez dire avec votre logement : c’est la prison. Mais quel droit avez-vous, et comment osez-vous... C’est que je... je suis employé... à Pétersbourg...
Fièrement.
Je... je... je...
LE GOUVERNEUR, à part.
Oh ! mon Dieu ! comme il est colère... Il sait tout ! Ces maudits marchands lui ont tout dit.
KHLESTAKOF, s’enhardissant de plus en plus.
Vous avez beau être gouverneur... Je n’irai pas. J’aurai recours au ministre.
Il frappe du poing sur la table.
Qui êtes-vous ? qui êtes-vous ?
LE GOUVERNEUR, prêt à défaillir et tout tremblant.
Ah ! de grâce, Monsieur, ne me perdez pas. J’ai une femme et de petits enfants... ne ruinez pas un infortuné !
KHLESTAKOF.
Non, je ne veux pas. Eh ! que m’importe à moi que vous ayez une femme et des enfants ? faut-il pour cela que j’aille en prison ? Voyez un peu la belle raison !
Bobtchinski entr’ouvre la porte, regarde et se retire effrayé.
Non, non, je vous remercie très humblement. Je ne veux pas.
LE GOUVERNEUR, tremblant.
Inexpérience, Monsieur, inexpérience de ma part, et insuffisance de la place. Mon Dieu, daignez en juger vous-même. Les appointements ne me rendent pas le thé et le sucre seulement. S’il y a eu des cadeaux, je vous proteste que c’étaient des misères... Quelque chose pour la table, ou peut-être une couple d’habits. Quant à la veuve du sous-officier qui faisait le commerce, que j’aurais fait fouetter, c’est une calomnie, Monsieur, sur mon honneur, c’est une calomnie. Ce sont mes ennemis qui ont inventé cela. Les gens d’ici sont i méchants, qu’ils sont prêts à m’assassiner...
KHLESTAKOF.
Eh bien ! je n’ai pas affaire à eux, moi...
Réfléchissant.
Je ne sais pas, moi, pourquoi vous me parlez de vos ennemis ou de la veuve de ce sous-officier... Une femme de sous-officier, c’est autre chose... mais moi, vous n’oseriez pas me faire fouetter... vous n’y pensez pas, apparemment ? Je vous le répète, je paierai, je paierai... mais en ce moment, je me trouve sans argent. Si je suis ici, c’est que je n’ai pas un kopek.
LE GOUVERNEUR, à part.
Oh ! le farceur ! Quelle diable d’histoire nous fait-il et où veut-il en venir ? On ne sait par où le prendre. Ma foi, essayons ; il en sera ce qu’il en sera, essayons toujours.
Haut.
Si vous aviez besoin d’argent, Monsieur, ou de toute autre chose, veuillez disposer de moi. Mon devoir est d’obliger les voyageurs.
KHLESTAKOF.
Si vous vouliez me prêter quelques roubles, je satisferais le maître de l’hôtel. Deux cents roubles me suffiraient, et même moins.
LE GOUVERNEUR, lui donnant des billets.
Voici précisément deux cents roubles ; ne vous donnez pas la peine de compter.
KHLESTAKOF.
Mille remerciements. Je vous renverrai cela de la campagne... C’est un accident que... Je vois, Monsieur, que vous êtes un galant homme... C’est une autre affaire.
LE GOUVERNEUR, à part.
Dieu soit loué ! il a pris l’argent. Nous allons être d’accord, à ce que je vois. Au lieu de deux cents, je lui en glisse quatre cents.
KHLESTAKOF.
Osip !
Osip entre.
Appelle le garçon.
Au gouverneur et à Dobtchinski.
Comment ! vous êtes debout ! Faites-moi donc le plaisir de vous asseoir.
À Dobtchinski.
Asseyez-vous donc, je vous en supplie.
LE GOUVERNEUR.
Ne faites pas attention ; nous sommes bien.
KHLESTAKOF.
Faites-moi donc la grâce de vous asseoir ! Ah ! je vois toute la cordialité et toute la franchise de votre caractère... Et moi qui m’étais imaginé que vous veniez pour me...
À Dobtchinski.
Asseyez-vous donc.
Le gouverneur et Dobtchinski s’assoient, Bobtchinski entr’ouvre la porte et écoute.
LE GOUVERNEUR, à part.
Allons, un peu plus d’audace. Il veut qu’on respecte son incognito. C’est bon, nous sommes à deux de jeu pour la comédie. Faisons semblant de ne pas savoir quel homme c’est.
Haut.
J’étais sorti pour des affaires de service, avec Pëtr Ivanovitch Dobtchinski, gentilhomme de ce pays, et nous avons voulu entrer dans l’hôtel pour voir si les voyageurs étaient convenablement reçus, parce que, voyez-vous, je ne suis pas comme bien des gouverneurs, qui ne se mêlent pas de ces affaires-là. Mais, moi, outre les affaires de mon administration, par pure charité chrétienne, je veux que tout mortel reçoive ici un bon accueil. Et c’est une récompense de mon zèle quand je trouve l’occasion de faire une connaissance si agréable.
KHLESTAKOF.
Pour mon compte, j’en suis ravi. Sans vous, j’aurais été contraint de rester longtemps ici. Je ne savais comment faire pour payer.
LE GOUVERNEUR, à part.
Oui, oui, conte-nous cela. Tu ne savais comment payer !
Haut.
Oserais-je vous demander de quel côté votre voyage se dirige ?
KHLESTAKOF.
Je vais dans le gouvernement de Saratof, dans ma terre.
LE GOUVERNEUR, à part, ironiquement.
Il a un fameux front ! Il faut jouer serré avec lui.
Haut.
C’est une chose bien intéressante que les voyages, les particularités de la route... d’un côté, les contrariétés qui résultent des chevaux en retard, d’un autre côté... c’est une grande dissipation pour l’esprit. Monsieur voyage sans doute pour son agrément ?
KHLESTAKOF.
Non, c’est papa qui me demande. Il se vexe, papa, parce que, jusqu’à présent, je n’ai pas eu d’avancement à Pétersbourg. Il s’imagine comme cela que, dès qu’on est arrivé, on va vous mettre la croix de Saint-Vladimir à la boutonnière. Ma foi, qu’il aille lui-même faire sa cour à la Chancellerie.
LE GOUVERNEUR, à part.
En voilà de sévères ; et ce papa qu’il nous coule en douceur...
Haut.
Est-ce pour longtemps que vous vous proposez de vous absenter ?
KHLESTAKOF.
Mon Dieu ! je ne sais pas. Mon père... mon père est bête, entêté comme une mule, un vieux roquentin dur comme du bois. Je lui dirai tout bonnement : faites ce que vous voudrez, je ne puis pas vivre hors de Pétersbourg. Pourquoi donc serais-je condamné à passer ma vie avec des paysans... ? Cessez d’exiger cela de moi ; mon âme a soif de civilisation.
LE GOUVERNEUR, à part.
Comme il défile son chapelet, et sans se couper. Il se figure qu’il me fait avaler toutes ses histoires. Va, va, tu n’as pas trouvé ta dupe. Je te laisse faire et t’en donner.
Haut.
La remarque que vous avez bien voulu faire est parfaitement juste. Que peut-on faire dans l’ignorance et l’obscurité ? Ici, par exemple dans notre petit endroit, on ne dort pas la nuit, on s’extermine pour son pays, on n’épargne rien, sans seulement songer à quand la récompense...
Il promène ses regards par la chambre.
Il me semble que cette chambre est un peu humide.
KHLESTAKOF.
Abominable ! et des punaises comme je n’en ai jamais vu. Elles vous ont des dents comme des chiens.
LE GOUVERNEUR.
Est-il possible ! Un étranger si distingué exposé à des tortures semblables ; d’indécentes punaises comme il n’en devrait pas exister dans le monde ! – Est-ce qu’il ne fait pas bien sombre dans cette chambre ?
KHLESTAKOF.
Horriblement sombre ! Le maître d’hôtel n’a pas l’habitude de donner des bougies. On ne peut rien faire. On veut lire, ou bien l’envie vous prend d’écrire quelque chose, impossible ; on n’y voit goutte.
LE GOUVERNEUR.
Oserais-je vous demander... mais non, je ne suis pas digne...
KHLESTAKOF.
Quoi donc ?
LE GOUVERNEUR.
Non, non, je suis indigne de cet honneur...
KHLESTAKOF.
Mais de quoi s’agit-il ?
LE GOUVERNEUR.
C’est que, si j’osais... J’ai chez moi un appartement parfaitement convenable, bien éclairé, tranquille, que je serais heureux de vous offrir... Mais non, je sens moi-même que ce serait trop d’honneur pour moi... Veuillez, je vous en supplie, ne pas vous en offenser ; c’est dans la simplicité de mon cœur que je faisais cette offre indiscrète.
KHLESTAKOF.
Comment donc ? mais au contraire, j’en suis enchanté. Il me sera infiniment plus agréable d’être dans une maison particulière que dans une auberge.
LE GOUVERNEUR.
Ah ! vous me comblez ! Et quel bonheur pour ma femme ! Pour moi, c’est mon caractère ; je n’ai pas de plus grand bonheur que d’exercer l’hospitalité, surtout à l’égard de personnes distinguées. Ce n’est pas la flatterie qui dicte mon langage, je vous prie de le croire ; je n’ai pas ce défaut, Dieu merci, et je parle à cœur ouvert.
KHLESTAKOF.
Je vous en remercie très humblement. Pour moi, je n’aime pas les gens à double visage. Votre cordialité et votre franchise me plaisent ; et quant à moi, je ne demande qu’une chose, c’est qu’on me montre du dévouement et de la considération... de la considération et du dévouement.
Scène IX
KHLESTAKOF, LE GOUVERNEUR, DOBTCHINSKI, LE GARÇON DE L’HÔTEL accompagné de OSIP
Bobtchinski regarde par la porte entr’ouverte
LE GARÇON.
Monsieur demande quelque chose ?
KHLESTAKOF.
Donne-moi mon compte.
LE GARÇON.
Il y a longtemps que je vous l’ai remis votre compte.
KHLESTAKOF.
Est-ce que je me souviens de tes bêtes de comptes ? Combien dois-je ici ?
LE GARÇON.
Le premier jour, Monsieur a commandé à dîner ; le lendemain, Monsieur n’a mangé que du saumon, et puis, Monsieur, depuis lors, a tout pris à crédit...
KHLESTAKOF.
Imbécile, vas-tu recommencer tes additions ? En tout combien cela fait-il ?...
LE GOUVERNEUR.
Ne vous donnez pas cette peine, il attendra bien.
Au garçon.
Va-t’en, on règlera cela.
KHLESTAKOF.
Au fait, vous avez raison.
Il met l’argent dans sa poche ; le garçon sort. Bobtchinski regarde par la porte entr’ouverte.
Scène X
LE GOUVERNEUR, KHLESTAKOF, DOBTCHINSKI
LE GOUVERNEUR.
Ne vous plairait-il pas de voir maintenant quelques établissements publics de notre ville... l’hospice, par exemple, et quelques autres...
KHLESTAKOF.
Qu’est-ce qu’il y a donc à voir ?...
LE GOUVERNEUR.
C’est que chez nous, voyez-vous, l’administration est si régulière... il y a tant d’ordre, que...
KHLESTAKOF.
Je serai enchanté ! Je suis tout à vos ordres.
Bobtchinski passe la tête par la porte entr’ouverte.
LE GOUVERNEUR.
De là, si vous aviez envie de visiter le collège du district, vous verriez l’ordre remarquable avec lequel on cultive ici les sciences.
KHLESTAKOF.
Volontiers, volontiers.
LE GOUVERNEUR.
Ensuite, si vous vouliez entrer dans le fort et dans la prison de ville, vous verriez de quelle manière on garde ici les coupables.
KHLESTAKOF.
Pourquoi voir la prison ? il vaut mieux visiter les établissements de bienfaisance.
LE GOUVERNEUR.
Comme il vous plaira. Que préférez-vous ? irons-nous dans votre voiture ou bien accepterez-vous une place dans mon droschki ?
KHLESTAKOF.
J’aime mieux aller avec vous dans votre droschki.
LE GOUVERNEUR, à Dobtchinski.
Ma foi, Pëtr Ivanovitch, je n’ai plus de place pour vous.
DOBTCHINSKI.
Ne faites pas attention à moi.
LE GOUVERNEUR, bas à Dobtchinski.
Écoutez. Vous allez courir, mais comme un dératé, pour porter deux billets, l’un à Zemlianika, à l’hospice, l’autre à ma femme.
À Khlestakof.
Oserais-je vous demander la permission d’écrire en votre présence une ligne à ma femme, pour qu’elle se prépare à recevoir un hôte si distingué.
KHLESTAKOF.
Oh ! Monsieur, ce n’est pas la peine... Au reste, voici l’écritoire... seulement du papier... je ne sais pas... Ah ! tenez ce compte, cela peut-il servir ?
LE GOUVERNEUR.
Parfaitement.
À part, tout en écrivant.
Ah ! nous verrons comment iront nos affaires quand il aura tâté d’un déjeuner et des bouteilles à grosse panse... Nous avons le madère du gouvernement ; il n’est pas très bien pour l’œil, mais il vous enfoncerait un éléphant. Je voudrais bien savoir quel homme c’est, et de quel côté il faut s’en garer.
Il écrit le billet, le donne à Dobtchinski qui se dirige vers la porte, mais en ce moment elle se détache et Bobtchinski qui s’y tenait collé, tombe avec elle sur la scène. Exclamation générale. Bobtchinski se relève.
KHLESTAKOF.
Vous êtes-vous fait mal ?
ВОВТСНINSKI.
Rien, rien du tout, pas la moindre des choses ; seulement sur le nez, un petit horion. Je cours chez Christian Ivanovitch. Il y a chez lui de l’emplâtre si bon qu’il n’y paraîtra plus.
LE GOUVERNEUR, après avoir fait un geste de reproche à Bobtchinski, à Khlestakof.
Ce n’est rien. Je vous en supplie, Monsieur, veuillez passer... Je vais dire à votre domestique d’apporter vos effets.
À Osip.
Mon cher ami, tu porteras tout le bagage chez moi, chez le gouverneur ; tout le monde te dira le chemin. Je vous en supplie, Monsieur...
Il fait passer devant Khlestakof et le suit ; au moment de sortir, il se retourne d’un air irrité vers Bobtchinski.
A-t-on vu pareille maladresse ! Comme si vous ne pouviez pas prendre un autre endroit pour vous jeter par terre. Et s’étaler comme un je ne sais quoi !...
Il sort suivi de Bobtchinski.
ACTE III
Une chambre chez le gouverneur ; décoration du premier acte.
Scène première
ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, à la fenêtre et dans les mêmes attitudes où on les a vues à la fin du premier acte
ΑΝΝΑ.
Voilà une heure que nous attendons, et tout cela pour ta sotte coquetterie... Elle est tirée à quatre épingles ; non, il faut encore chiffonner... Ah ! et ne pas la voir revenir ! Quel ennui ! Et pas une âme ! On dirait que tout est mort ici.
MARIA.
Allons, maman, dans deux minutes nous saurons tout. Avdotia va revenir tout de suite.
Elle regarde à la fenêtre et fait un petit cri.
Ah ! petite, maman, petite maman, voilà quelqu’un qui vient au bout de la rue.
ANNA.
Où donc ? Tu te figures toujours comme cela... C’est vrai, on vient... Qui donc cela peut-il être ?... Il n’est pas grand... en frac... qui donc ? Dieu que c’est ennuyeux de ne pas savoir qui c’est.
MARIA.
C’est Dobtchinski, petite maman.
ANNA.
Dobtchinski Allons donc. Tu as toujours des imaginations comme cela. Ce n’est pas Dobtchinski.
Elle agite son mouchoir.
Eh ! vous ! par ici, venez donc, venez donc, plus vite !
MARIA.
Je vous assure, maman, que c’est Dobtchinski.
ANNA.
Ce que c’est que la manie de disputer ! On te dit que ce n’est pas Dobtchinski.
MARIA.
Mais si, petite maman, mais si. Vous voyez bien que c’est Dobtchinski.
ANNA.
Tiens, c’est Dobtchinski. Je le vois à présent. Mon Dieu ! c’est inutile de disputer pour cela.
Elle crie à la fenêtre.
Plus vite, dépêchez-vous donc ! vous allez comme une tortue ! Eh bien ! où sont-ils ? Parlez donc ! parlez d’ici... Vous êtes... qu’est-ce que cela fait ? Quoi... bien sévère ? Ah ! Et mon mari, mon mari ?
S’éloignant de la fenêtre avec dépit.
Quel imbécile ! jusqu’à ce qu’il soit monté au salon, il ne nous dira rien !
Scène II
ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, DOBTCHINSKI
ANNA.
Allons, parlez, je vous en prie. Je vous demande un peu si c’est honnête de votre part ? Moi qui ne comptais que sur vous seul, comme sur un homme raisonnable, et vous vous enfuyez et nous laissez là. Et depuis ce moment-là, personne pour me dire la moindre chose ! N’avez-vous pas de honte ! moi qui été la marraine de votre Vanitchka et de Lizanka ! Voilà comment vous êtes avec moi ?
DOBTCHINSKI.
Eh ! mon Dieu, ma commère, j’ai tant couru pour vous présenter mes respects que je n’en suis pas encore remis... Mes respects, Maria Antonovna.
MARIA.
Bonjour, Pëtr Ivanovitch.
ANNA.
Voyons donc, parlez ! Que se passe-t-il ?
DOBTCHINSKI.
Anton Antonovitch vous envoie ce billet.
ANNA.
Eh bien ! qu’est-ce que c’est ? un général ?
DOBTCHINSKI.
Général, non ; mais il vaut bien un général. Un air, des manières, une dignité...
ANNA.
Ainsi, c’est bien le fonctionnaire dont on annonçait l’arrivée à mon mari.
DOBTCHINSKI.
En personne. Et c’est moi qui l’ai découvert le premier avec Pëtr Ivanovitch.
ANNA.
Eh bien, parlez donc ! vous disiez...
DOBTCHINSKI.
Ah ! grâce à Dieu tout s’est arrangé. D’abord il a reçu Anton Antonovitch un peu sévèrement. Oui, il s’est échauffé, et il a dit que dans l’auberge cela n’allait pas bien, qu’il n’irait pas chez lui, et qu’il ne se souciait pas d’aller en prison pour lui ; mais ensuite, lorsqu’il a reconnu l’innocence d’Anton Antonovitch, et quand il a eu une petite explication avec lui, alors il a changé d’avis, grâce à Dieu, et tour s’est bien passé. Ils sont allés voir les établissements de bienfaisance... C’est bien comme nous le pensions, Anton Antonovitch et moi, une dénonciation secrète... Savez-vous que j’ai eu aussi fameusement peur pour moi ?
ANNA.
Qu’avez-vous à craindre, vous ? Vous n’êtes pas employé.
DOBTCHINSKI.
C’est égal. Savez-vous, quand on entend parler un grand personnage comme cela, on se sent saisi.
ANNA.
Mais enfin, comment est-il ?... Tout cela ce sont des chansons. Quel homme est-ce ? Dites-moi, comment est-il de sa personne, vieux ou jeune ?
DOBTCHINSKI.
Jeune, il est jeune. Vingt-trois ans. Mais il parle tout à fait comme un homme d’âge. Si vous le permettez, dit-il, j’irai là, et là...
Gesticulant.
comme cela ; J’aime à lire, dit-il, et à écrire ; mais ce qui me gêne, a-t-il dit, c’est que la chambre est sombre.
ANNA.
Mais de quelle couleur a-t-il les cheveux ? Bruns ou blonds ?
DOBTCHINSKI.
Non, plutôt châtains, et des yeux d’une vivacité... comme des étincelles... qui vont toujours comme cela... le regard comme s’il avait le diable au corps.
ANNA.
Voyons ce qu’il me mande dans son billet : « Je m’empresse de t’informer, m’amour, que ma position a été fort critique ; mais je dois à la miséricorde divine deux concombres salés et une demi-portion de caviar, roubles, zéro, vingt-cinq kopeks... » Qu’est-ce que cela veut dire ? des concombres et du caviar ?...
DOBTCHINSKI.
Ah ! c’est que dans sa précipitation, Anton Antonovitch s’est servi de papier écrit : il aura pris le mémoire du restaurant.
ANNA.
Ah ! oui, c’est cela.
Continuant de lire.
« Mais je dois à la miséricorde divine de voir tout finir heureusement. Fais préparer au plus vite une chambre pour un hôte d’importance, celle où il y a du papier doré. Il est inutile de te donner de la peine pour le dîner, nous allons manger à l’hospice chez Artemii Philippovitch ; mais il faut du vin, dis au marchand Avdouline qu’il en envoie du meilleur, ou sinon je mets sa cave en cannelle. Je te baise les mains, et suis ton Anton Skvoznik-Dmoukhanofski. » Ah ! mon Dieu ! il n’y a pas un moment à perdre ! Holà ! quelqu’un ! Michka !
DOBTCHINSKI, courant à la porte et criant.
Michka ! Michka ! Michka !
Michka entre.
ANNA.
Écoute. Cours chez le marchand Avdouline... attends, je vais te donner un billet.
Elle s’assied au bureau et écrit tout en parlant.
Tu vas donner cette lettre à Sidor, au cocher, pour qu’il aille tout de suite chez Avdouline, et qu’il rapporte du vin. Et toi, tu vas préparer joliment cette chambre pour un monsieur qui vient ici. Tu mettras un lit, une cuvette, et cætera.
DOBTCHINSKI.
Moi, Anna Andreïevna, je m’en vais voir comment il inspecte là-bas.
ANNA.
Allez, allez, je ne vous retiens pas.
Scène III
ANNA ANDREÏEVNA et MARIA ANTONOVNA
ANNA.
Allons, ma petite, il faut un peu penser à notre toilette. C’est un élégant de la capitale. Dieu garde qu’il ne trouve ici quelque chose à critiquer. Toi, je te conseille de mettre ta robe bleue à petits retroussis.
MARIA.
Fi donc, petite maman, du bleu ! Cela ne me va pas : madame Liapkine Tiapkine met du bleu, et la fille de M. Zemlianika se met en bleu aussi. Non, je serai mieux en rose.
ANNA.
En rose ! Ah ! par exemple, c’est bien pour l’amour de la contradiction ! Cela t’ira infiniment mieux, d’autant plus que je vais mettre ma robe paille. J’aime beaucoup cette nuance-là.
MARIA.
Ah ! petite maman, vous ne mettrez pas votre robe paille ! Elle ne vous va pas.
ANNA.
Ma robe paille ne me va pas ?
MARIA.
Mais, non, maman. Je vous dirai ce qu’il vous faut. Pour la nuance paille, il faudrait que vous eussiez les yeux foncés.
ANNA.
Ah ! vraiment, voilà qui est fort ! Je n’ai pas les yeux foncés, moi ! Mais je les ai trop foncés, au contraire. A-t-on jamais vu une idée pareille ! Je n’ai pas les yeux foncés ! Et quand je me tire les cartes, c’est toujours moi qui suis la dame de trèfle.
MARIA.
Ah ! petite maman, vous seriez bien plutôt la dame de cœur.
ANNA.
Ah ! c’est trop trop fort ! par trop fort ! La dame de cœur ! Où a-t-elle l’esprit !
Elle sort précipitamment, en répétant derrière la scène.
La dame de cœur ! Quelle idée ! On n’est pas plus folle !
Lorsqu’elles sont sorties, la porte s’ouvre et Michka paraît poussant devant lui des balayures. Par une autre porte entre Osip portant une malle sur sa tête.
Scène IV
MICHKA, OSIP
OSIP.
Par où est-ce ?
MICHKA.
Par ici, mon oncle, par ici.
OSIP.
Un instant, que je souffle. Ah ! gredin de sort ! On dit bien que pour ventre vide il n’y a pas de léger fardeau !
MICHKA.
Dites donc, mon oncle, le général va venir bientôt ?
OSIP.
Quel général ?
MICHKA.
Votre maître.
OSIP.
Mon maître ? Quel général est-ce qu’il est ?
MICHKA.
Comment, est-ce qu’il n’est pas général ?
OSIP.
Général, ah ! oui ; mais d’une autre façon.
MICHKA.
Est-ce plus ou moins fort qu’un général en service ?
OSIP.
Plus.
MICHKA.
Voyez-vous cela ! Voilà la chose pourquoi il y a ce remue-ménage chez nous.
OSIP.
Écoute petit. À ce que je vois, tu es un gaillard futé ? Est-ce qu’il n’y aurait pas un morceau à manger ?
MICHKA.
Hélas ! mon oncle, c’est que pour vous il n’y a rien de prêt. Vous ne mangeriez pas quelque chose de tout simple. Je crois bien que quand votre maître se met à table, il vous envoie de ce qu’il mange lui-même.
OSIP.
Mais qu’est-ce qu’il y a ici en fait de choses simples ?
MICHKA.
Il n’y a que de la soupe aux choux, du gruau, et puis des pâtés.
OSIP.
Rien que de la soupe aux choux, du gruau et des pâtés ? C’est bon, nous mangerons tout cela. Allons, portons cette malle. Il y a une autre porte par ici ?
MICHKA.
Oui.
Tous deux portent la malle dans la chambre de côté.
Scène V
Des sergents de ville ouvrent la porte du fond à deux battants, entre KHLESTAKOF, il est suivi du GOUVERNEUR, viennent ensuite à distance L’ADMINISTRATEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE, DOBTCHINSKI et BOBTCHINSKI, ce dernier avec un emplâtre sur le nez
Le gouverneur montre aux sergents de ville un morceau de papier sur le plancher. Ils s’empressent de le ramasser en se heurtant l’un l’autre dans leur précipitation.
KHLESTAKOF.
Excellent établissement ! Ce qui me plaît ici, c’est qu’on montre aux voyageurs tout ce qu’il y a à voir dans la ville. Dans les autres villes on ne m’a rien montré.
LE GOUVERNEUR.
Dans d’autres villes, oserais-je vous le faire remarquer, les fonctionnaires publics sont surtout préoccupés de leurs intérêts. Tandis qu’ici, je puis le dire, on n’a qu’une pensée, c’est, à force de zèle et de vigilance de remplir les généreuses intentions du gouvernement.
KHLESTAKOF.
Le déjeuner était excellent. Ah ! j’ai mangé comme il faut. Est-ce qu’on s’en donne ici comme cela tous les jours ?
LE GOUVERNEUR.
On célébrait la présence d’un hôte illustre.
KHLESTAKOF.
Moi, j’aime à manger. À quoi bon vivre si ce n’est pas pour cueillir la fleur du plaisir ? Comment s’appelle ce poisson ?
L’ADMINISTRATEUR, s’avançant.
Du labardane.
KHLESTAKOF.
Fameux poisson ! Où est-ce donc que nous avons déjeuné, dans l’infirmerie ?
L’ADMINISTRATEUR.
Si vous le voulez bien. Dans l’hospice.
KHLESTAKOF.
Ah ! oui, je me rappelle, il y avait des lits. Et les malades, ils sont donc guéris ? Il n’y en avait guère.
L’ADMINISTRATEUR.
Il n’en restait que dix. Les autres étaient sortis guéris. Cela tient à l’excellent ordre qui règne dans l’établissement. Depuis le moment où j’ai pris l’administration de l’hospice, peut-être le fait vous paraîtra-t-il incroyable, tous les malades guérissent comme des mouches. À peine un malade entre-t-il dans l’infirmerie qu’il est guéri. Ce n’est pas dû seulement à la médicamentation, mais à la propreté et à l’ordre.
LE GOUVERNEUR.
Oserais-je vous exposer les devoirs accablants qui incombent à l’administrateur de ce district... Combien d’affaires !... Tenez, pour ne parler que de la voirie, des travaux publics, de la police... En un mot, l’esprit le plus vaste s’y casserait la tête ; mais, par la miséricorde de Dieu, tout marche ici à merveille. Un autre gouverneur peut-être penserait à ses intérêts. Mais, moi, le croiriez-vous, moi, quand je vais me coucher, je me dis : Mon Dieu, daigne faire en sorte que le gouvernement connaisse mon zèle et mon désintéressement et qu’il soit satisfait... qu’il m’en récompense ou non, je m’abandonne à sa volonté, au moins mon cœur sera tranquille. Lorsque dans notre ville je vois l’ordre régner partout, les rues balayées, les prisonniers bien sûrement sous les verrous, qu’il n’y a pas trop d’ivrognes... que me faut-il de plus ? Hélas ! je ne demande pas des distinctions ! C’est un appât trompeur, et auprès du bonheur de faire le bien, tout n’est que poussière et vanité !
L’ADMINISTRATEUR, à part.
Le gredin, comme il dégoise ! Si Dieu m’avait donné une langue si bien pendue !
KHLESTAKOF.
Vous avez bien raison. Moi aussi, j’aime à faire de temps en temps... j’aime à faire de la morale. Quelquefois j’en fais en prose, d’autres fois je me lâche en vers.
BOBTCHINSKI, à Dobtchinski.
Comme c’est bien dit, comme c’est fort, Pëtr Ivanovitch ! Quelles observations il a... Il faut qu’il ait fait de fameuses études.
KHLESTAKOF.
Dites donc, est-ce qu’il n’y a pas ici quelque petite société joyeuse où l’on pourrait, par exemple, faire une partie de cartes ?
LE GOUVERNEUR, à part.
Hein ? Est-ce qu’il voudrait jeter des pierres dans mon jardin ?
Haut.
Ah ! Dieu nous en préserve ! Ici on ne sait pas ce que c’est que de semblables réunions. Pour moi, je n’ai jamais touché une carte... Et même je ne sais pas y jouer... aux cartes. Je ne puis pas en voir de sang-froid, et quand j’ai le malheur d’apercevoir un roi de carreau ou de n’importe quoi, cela me donne un tel mal de cœur qu’il faut que je crache. Une fois, je ne sais comment cela se fit, les enfants s’étaient amusés à construire un château de cartes... Eh bien ! toute la nuit j’ai rêvé de ces maudites cartes. Mon Dieu ! comment y a-t-il des gens qui perdent un temps précieux dans des occupations semblables !
LE RECTEUR, à part.
Ah ! farceur, qui m’a décavé hier de cent roubles !
LE GOUVERNEUR.
Pour moi, je trouve mieux à employer mon temps pour l’avantage de l’administration.
KHLESTAKOF.
Ah ! bien, cependant, voyez-vous... cela dépend beaucoup de la manière de voir. Par exemple, si l’on s’en va faire son vatout quand on n’a rien dans la main, alors... mais allez, quelquefois c’est bien attachant de jouer.
Scène VI
LES MÊMES, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA
LE GOUVERNEUR.
Oserais-je vous présenter ma famille ? ma femme et ma fille.
KHLESTAKOF.
C’est un grand bonheur pour moi, Madame, d’avoir celui de vous voir.
ANNA.
C’en est un bien grand pour moi, Monsieur, de voir une personne si distinguée,
KHLESTAKOF, avec galanterie.
Pardonnez-moi, Madame, au contraire. Cela m’est bien plus agréable.
ANNA.
Vous vous moquez, Monsieur ; c’est la politesse qui vous fait parler. Veuillez prendre la peine de vous asseoir.
KHLESTAKOF.
C’est assez de bonheur, Madame, d’être debout auprès de vous ; mais puisque vous l’exigez absolument, je m’assieds. C’est un grand bonheur, Madame, d’être enfin assis auprès de vous.
ΑΝΝΑ.
Pardonnez-moi, Monsieur, je n’ose prendre pour moi... Je pense que venant de quitter la capitale, votre petite excursion vous a paru bien monotone.
KHLESTAKOF.
Monotone, c’est le mot. Habitué à vivre dans le monde, comprenez-vous, et tout à coup se trouver sur une grande route... Des auberges sales, le manque de comfort, la grossièreté de la province... S’il n’y avait des hasards, comme celui que... qui...
Lorgnant Anna Andreïevna avec galanterie.
...Cela fait oublier tout ce...
ANNA.
En effet, cela doit être bien désagréable pour vous...
KHLESTAKOF.
Comment, Madame ? dans ce moment, je trouve très agréable...
ANNA.
Ah ! Monsieur, vous êtes trop bon. Je ne mérite pas l’honneur que vous me faites.
KHLESTAKOF.
Pourquoi donc cela, Madame ? Au contraire, vous le méritez bien.
ANNA.
Nous autres qui vivons dans la solitude...
KHLESTAKOF.
Oui, mais la solitude a ses collines, ses ruisseaux... c’est vrai que rien ne vaut Pétersbourg. Ah ! Pétersbourg ! quelle vie que celle-là ! Vous croyez peut-être que je suis expéditionnaire. Non. Le directeur est avec moi sur un pied d’intimité. Il me frappe sur l’épaule et me dit : Eh bien, camarade, dînons-nous ensemble ? Je vais à la direction pour deux minutes, seulement pour dire : Faites-moi ceci, faites-moi cela. Il y a un employé pour les écritures. Un gratte-papier... tr... tr... tr... Il se met à écrire. On voulait me faire assesseur de collège. Je sais bien pourquoi... Le garçon de bureau court après moi dans l’escalier avec une brosse : Permettez, Ivan Alexandrovitch, qu’il me dit, que je donne un coup à vos bottes... Mais, Messieurs, vous êtes debout ? Asseyez-vous donc, je vous en prie.
LE GOUVERNEUR.
Devant une personne de votre rang...
L’ADMINISTRATEUR.
Nous devons rester debout.
LE RECTEUR.
Ne faites pas attention.
KHLESTAKOF.
Point d’étiquette, Messieurs. Asseyez-vous, je vous prie, sans faire attention au rang.
Tous s’assoient.
Moi, au contraire, je fais tout ce que je peux pour me faufiler sans qu’on fasse attention à moi. Mais, comment voulez-vous, cela m’est impossible. On me reconnaît toujours. Que j’aille n’importe où, on dit... tiens, diton, voilà Ivan Alexandrovitch qui passe. Une fois on m’a pris pour le commandant en chef ; les soldats sont sortis du corps de garde et ont porté les armes. Alors l’officier, qui était une de mes connaissances, me dit : Tiens, mon camarade ! nous qui t’avons pris pour le commandant en chef !
ANNA.
Vraiment.
KHLESTAKOF.
Je connais toutes les petites actrices... Je me mêle aussi de vaudevilles... Je vois tous les auteurs. Je suis intime avec Pouchkine. Il y a quelque temps, je lui dis : « Eh bien ! Pouchkine ? – Eh bien, dit-il comme cela... heuh ? » C’est un grand original.
ANNA.
Ah ! vous êtes auteur ? Comme ce doit être agréable d’être auteur ? Est-ce que vous travaillez dans les journaux ?
KHLESTAKOF.
Oui, j’écris aussi dans les journaux. C’est moi qui ai fait le Mariage de Figaro, Robert le Diable, Norma. Mon Dieu ! je ne me rappelle déjà plus les titres. Tout cela par occasion. Je ne voulais rien écrire, et puis les directeurs de théâtre me disent : « Je t’en prie, mon cher, écris-nous quelque chose. » Je me mets à réfléchir. – C’est bon. Nous verrons, mon cher. – Et dans une soirée, je broche tout cela. J’ai une facilité extraordinaire. Tout ce qui a paru sous le nom du baron de Brambeus, la Frégate l’Espérance, et le Télégraphe de Moscou... Tout cela est de moi.
ΑΝΝΑ.
Est-il possible ! Comment, c’est vous qui êtes Brambeus ?
KHLESTAKOF.
Mon Dieu, oui. C’est moi qui leur arrange leurs vers. Smirdine me donne pour cela quarante mille roubles.
ΑΝΝΑ.
Et Iourii Miloslavski, est-ce que c’est de vous ?
KHLESTAKOF.
Oui, c’est de moi.
ΑΝΝΑ.
Je l’avais deviné tout de suite.
MARIA.
Mais, maman, il y a écrit sur le titre que c’est de M. Zagoskine.
ΑΝΝΑ.
Allons ! je le savais bien que tu ne perdrais pas cette occasion de contredire !
KHLESTAKOF.
Oui, oui, c’est vrai, c’est de Zagoskine, mais il y a un autre Iourii Miloslavski, et celui-là, c’est le mien.
ANNA.
C’est cela, c’est le vôtre que j’ai lu. Comme c’est bien écrit.
KHLESTAKOF.
Je vous avouerai que c’est la littérature qui me fait vivre. J’ai la première maison de Pétersbourg. Elle est si connue la maison d’Ivan Alexandrovitch...
Saluant tous les assistants.
Faites-moi la grâce, Messieurs, quand vous serez à Pétersbourg de venir me voir. J’y donne aussi des bals.
ANNA.
Je pense que les bals que l’on donne là doivent être d’un goût et d’une recherche merveilleuse.
KHLESTAKOF.
Très simples, cela ne vaut pas la peine d’en parler. On met sur la table, par exemple, un melon d’eau, – oui, un melon d’eau de six cents roubles. La soupe dans la soupière m’arrive par la vapeur, droit de Paris. On ôte le couvercle... un parfum comme il n’y a rien de pareil au monde. Je vais tous les jours au bal. Nous avons aussi notre whist, le ministre des affaires étrangères, l’ambassadeur de France, l’ambassadeur d’Allemagne et moi. Ah ! c’est là qu’on s’extermine, on n’a jamais rien vu de semblable. Quand on rentre chez soi, et qu’il faut monter à son quatrième étage, on n’a que la force de dire à sa bonne : Ha ! Mavrouchka, ma robe de chambre... Qu’est-ce que je dis donc ? J’oubliais que je demeure au premier... J’ai chez moi un escalier... Je vous assure que c’est amusant de regarder dans mon antichambre quand je ne suis pas encore éveillé. Des comtes, des princes sont là qui jasent, qui bourdonnent comme des mouches à miel ; on n’entend que j. j. j... Une fois le ministre...
Le gouverneur et les employés se lèvent tout émus à ce mot.
Sur les adresses on me met : À Son Excellence... Une fois, c’est moi qui ai fait aller la direction. C’est une drôle d’histoire. Le directeur était parti ; où était-il allé ? on ne savait pas. Naturellement on se met à causer. Qu’est-ce qui va le remplacer ? Il y avait là bien des généraux qui ne demandaient pas mieux. Les voilà qui essaient, mais, diable, non ! ce n’est pas aisé. On se figure que ce n’est rien, mais quand on y regarde de près... Le diable emporte, ils donnent leur langue aux chiens. On vient à moi. Sur-le-champ voilà des courriers qui partent, des courriers, des courriers... Figurez-vous trente-cinq mille courriers. Quelle situation ! hein ?-Venez prendre la direction, Ivan Alexandrovitch. Moi, je vous avoue, je fus un peu contrarié ; je passe ma robe de chambre. Ma foi, j’avais bien envie de refuser, mais qu’est-ce que dira l’empereur ? Puis, pour mes états de service, vous concevez... Messieurs, je leur dis, j’accepte, je prends le service, je leur dis, je le prends, mais, je leur dis : avec moi... ah ! ah ! avec moi, il ne faut pas... Qu’on ne m’échauffe pas les oreilles... ou bien... ! C’est bon. Je vais droit à la direction... Tous ventre à terre, tremblants comme la feuille.
Le gouverneur et les employés tremblent de peur. Khlestakof s’animant.
Oh ! je ne plaisante pas, moi. Je ne me gêne pas pour leur donner à chacun leur paquet. Le conseil d’État a peur de moi. Et pourquoi pas ? Moi, je suis... Je ne me soucie de personne, moi... Je leur parle à tous... Je me connais, moi, je me connais bien. Je suis partout, moi, partout. Tous les jours je vais à la cour... Aujourd’hui pour demain on me fera feld-mar...
Il chancelle, et tomberait par terre si les employés ne le soutenaient respectueusement.
LE GOUVERNEUR, bégayant d’effroi.
Vo... vo... vo...
KHLESTAKOF, se réveillant brusquement.
Plaît-il ?
LE GOUVERNEUR.
Vo... vo... vo...
KHLESTAKOF.
Je n’entends pas... Des bêtises !
LE GOUVERNEUR.
Vo... vo... cellence... excellence... voudrait peut-être se reposer... Elle a sa chambre, et tout ce qui est nécessaire.
KHLESTAKOF.
Reposer... des bêtises !... Ah ! reposer, oui, je ne demande pas mieux... Votre déjeuner, Messieurs... Me voilà... volontiers... Fameux labardane ! oh ! quel bon labardane !
Il entre dans la chambre de côté suivi du gouverneur.
Scène VII
LES MÊMES, excepté LE GOUVERNEUR et KHLESTAKOF
BOBTCHINSKI.
Voilà un homme, Pëtr Ivanovitch !... Voilà où l’on reconnaît un homme. Jamais de ma vie je ne m’étais trouvé en présence d’un personnage si imposant, et j’ai failli mourir de peur. Quel grade, croyez-vous comme cela, Pëtr Ivanovitch, quel grade croyez-vous qu’il puisse bien avoir ?
DOBTCHINSKI.
Ma foi, je crois qu’il pourrait bien être général.
BOBTCHINSKI.
Et moi, je pense qu’un général ne lui va pas seulement à la cheville ; s’il est général, alors il sera général en chef. Avez-vous entendu comme il fait marcher le conseil d’État ? Allons, allons raconter tout cela à Ammos Fëdorovitch et à Korobkine. Adieu, Anna Andreïevna.
DOBTCHINSKI.
Adieu, ma commère.
Ils sortent.
L’ADMINISTRATEUR, au recteur.
C’est effrayant, savez-vous ? Et ne pas savoir d’où viendra le coup ! Mais nous, qui ne sommes pas encore en uniforme ! Et lui qui dès qu’il sera réveillé va écrire à Pétersbourg une dénonciation !... Adieu, Madame.
Il sort avec le recteur tout pensif et dans le plus grand abattement.
Scène VIII
ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA
ANNA.
Ah ! quel charmant jeune homme !
MARIA.
Qu’il est aimable !
ANNA.
Mais quelles manières charmantes ! On reconnaît bien un élégant de la capitale. Son affabilité, et puis tout cela... Il est délicieux ! Moi, je suis folle de ces jeunes gens-là ! D’honneur ! ils me ravissent. Et je me suis bien aperçue que je lui plaisais... Il n’a fait que me regarder.
MARIA.
Ah ! petite maman, il m’a bien regardée aussi.
ANNA.
Mon Dieu ! comme la voilà bien là avec ses folies ! Mais cela n’a pas le sens commun.
MARIA.
Mais oui, petite maman, il m’a regardée.
ANNA.
Mon Dieu ! mon Dieu ! vas-tu encore disputer ! C’est bien assez pour aujourd’hui. Lui, te regarder ! Et à propos de quoi te regarder ?
MARIA.
Si, maman, il m’a regardée. Et quand il a commencé à parler de littérature, alors il m’a regardée, et ensuite quand il a raconté comment il jouait au whist avec des ambassadeurs, alors encore il m’a regardée.
ANNA.
À la bonne heure, peut-être bien une fois, et encore... Allons, se sera-t-il dit, regardons-la une fois.
Scène IX
ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LE GOUVERNEUR
LE GOUVERNEUR, marchant sur la pointe du pied.
Chut ! chut !
ANNA.
Qu’y a-t-il ?
LE GOUVERNEUR.
Je ne suis pas content qu’il ait tant bu. Cependant, si la moitié seulement de ce qu’il a dit est vrai ?
D’un air pensif.
Eh ! comment ne serait-ce pas vrai ? L’homme qui se grise livre tous ses secrets. Ce qu’il a dans le cœur lui vient sur la langue. Oui, il nous a fait quelques petites menteries... Mais si l’on ne ment pas, le moyen de parler de quelque chose ? Il joue avec les ministres et il va à la cour... Euh ! Plus j’y pense... Le diable sait quel homme c’est. Pour moi, la tête m’en tourne, il me semble que je suis sur le haut d’un clocher, ou bien qu’on va me pendre.
ANNA.
Pour moi, je n’ai pas été intimidée un instant. Je n’ai vu en lui qu’un jeune homme du monde, ayant des manières de la plus haute distinction. Cela me suffit, et je ne me mets pas en peine du grade qu’il peut avoir.
LE GOUVERNEUR.
Voilà les femmes ! – Cela vous suffit, à vous, vous n’en demandez pas davantage. – Fadaises ! il n’y a pas moyen de tirer de vous autre chose. On écorche votre mari : vous ne savez plus comment il s’appelait... Toi, mon cœur, tu étais à ton aise avec lui comme tu le serais avec un Dobtchinski.
ANNA.
Moi, je vous conseille de ne pas vous mettre en peine de cela. Nous savons déjà quelque chose...
Elle regarde sa fille avec affectation.
LE GOUVERNEUR.
Il n’y a pas moyen de parler avec elles... Ah ! quelle aventure ! Je n’ai pas encore pu reprendre haleine de l’émotion que j’ai eue.
Il ouvre la porte.
Michka, fais-moi venir les sergents de ville Svistinof et Derjimorda. Ils doivent être par ici dans les environs de la porte. –
Après un silence.
C’est drôle comme tout va dans le monde à présent. Encore si on pouvait connaître les gens... Mais ce petit fluet, qui diable devinera ce qu’il est ? Les militaires au moins ont toujours une certaine tournure, et lorsqu’ils mettent un habit bourgeois ils ont l’air de mouches à qui on a coupé les ailes... Mais pourquoi se tenir chez le restaurant ? Et ces équivoques, ces allégories qu’il me faisait tantôt... Le diable n’y comprendrait rien. Enfin pourtant il s’est livré... même plus qu’il n’était nécessaire avec moi. On voit bien que c’est un jeune homme.
Scène X
ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LE GOUVERNEUR, OSIP
Tous courent à lui et lui font signe du doigt.
ANNA.
Viens un peu par ici, mon cher.
LE GOUVERNEUR.
Chut... Eh bien ! dort-il ?
OSIP.
Pas encore. Il s’allonge un peu.
ANNA.
Comment t’appelles-tu, mon ami ?
OSIP.
Osip, Madame.
LE GOUVERNEUR, à sa femme.
Un moment donc !
À Osip.
Hé bien ! mon brave, t’a-t-on bien donné à dîner ?
OSIP.
Parfaitement, Monsieur. On m’a bien donné à dîner, je vous remercie.
ΑΝΝΑ.
Dis-moi donc, ton maître, n’est-ce pas, voit souvent des comtes et des princes, à ce que je pense ?
OSIP, à part.
Que lui dire ? On m’a bien donné à manger ; si je dis oui, je mangerai encore mieux.
Haut.
Oui, il nous vient des comtes aussi.
MARIA.
Osip, mon garçon, comme ton maître est gentil !
ANNA.
Dis donc, Osip, je t’en prie, comment il...
LE GOUVERNEUR.
Taisez-vous donc, pour l’amour de Dieu ! Avec vos sottes questions vous m’embrouillez dans ce que j’avais à lui dire. – Eh bien ! mon brave...
ΑΝΝΑ.
Et quel grade a ton maître ?
OSIP.
Un grade, comme cela...
LE GOUVERNEUR.
Diantre soit de vos bavardages ! Vous ne sauriez dire un mot qui aille au fait. Dis-moi, mon brave, ton maître est-il... sévère ? Hein... aime-t-il à gronder, ou bien estes un bon enfant ?
OSIP.
Dame ! il aime que tout aille bien. Il faut marcher droit avec lui.
LE GOUVERNEUR.
Tu as une mine qui me revient. Tu dois être un brave garçon. Si tu...
ANNA.
Dis donc, Osip, quand ton maître met son uniforme...
LE GOUVERNEUR.
Ah ! trêve de balivernes ! Quelles niaiseries, lorsqu’il s’agit de vie ou de mort.
À Osip.
Oui, mon cher, tu me plais fort. En route, je parie que tu n’as pas le temps de boire une petite tasse de thé. Encore est-il toujours froid. Tiens, voilà deux roubles pour t’avoir du thé.
OSIP.
Bien des remerciements, Monsieur. Le bon Dieu vous conserve la santé. Les pauvres gens, on les assiste.
LE GOUVERNEUR.
Merci. J’en suis bien aise. Mais, dis-moi...
ANNA.
Écoute donc, Osip, quelle est la couleur d’yeux que préfère ton maître ?...
MARIA.
Osip, mon cher ami, comme ton maître a un joli petit nez !
LE GOUVERNEUR.
Morbleu ! permettez-moi...
À Osip.
Je voudrais bien savoir, en route, à quoi ton maître fait le plus d’attention, ce qui lui plaît davantage ?
OSIP.
Il aime à savoir comment vont les choses... Il aime surtout à être bien reçu, à faire bonne chère.
LE GOUVERNEUR.
Bonne chère !
OSIP.
Oui. Il n’y a pas jusqu’à moi, qui ne suis qu’un serf ; il veut que je sois bien aussi. Mon Dieu, un jour, nous allions quelque part. – Osip, dit-il, eh bien, es-tu content ? T’a-t-on bien traité ? – Mal, Votre Excellence, que je dis. – Ah ! dit-il, Osip, ce sont donc des coquins chez qui nous avons logé. Rappelle-moi cela quand je repasserai. – C’est bon que je dis, en voilà un qui a son affaire. Moi, je ne me mêle de rien.
LE GOUVERNEUR.
Fort bien. Tu réponds à merveille. Je t’ai donné pour du thé ; tiens, voilà pour avoir des biscuits.
OSIP.
Oh ! Monseigneur, vous êtes trop bon. Je les boirai à votre santé.
ANNA.
Tiens, Osip, tiens, cela pour toi.
MARIA.
Osip, mon brave garçon, tiens, pour boire à la santé de ton maître.
On entend Khlestakof tousser dans la chambre voisine.
LE GOUVERNEUR.
Chut !
Tous marchent sur la pointe du pied et parlent à demi-voix.
Que le bon Dieu vous bénisse de faire tant de bruit ! Allez-vous-en. Que diable lanternez-vous ici ?
ANNA.
Allons, fillette, j’ai à te dire quelque chose que j’ai remarqué dans notre hôte, et qui ne peut se dire qu’entre nous deux.
LE GOUVERNEUR.
Encore, toujours parler ! Écoute donc ! Viens donc ! Dis donc ! Ah ! j’ai les oreilles écorchées.
À Osip.
Mon cher...
Scène XI
ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LE GOUVERNEUR, OSIP, DERJIMORDA et SVISTINOF
LE GOUVERNEUR.
Chut ! Diantre soit de ces ours cagneux avec leurs bottes. On dirait, à chaque pas qu’ils font, qu’on décharge une charrette de quarante pouds de je ne sais quoi. Que diable venez-vous faire ici ?
DERJIMORDA.
On nous a donné l’ordre...
LE GOUVERNEUR.
Chut !
Il lui met la main sur la bouche.
Au diable le corbeau et ses croassements. On nous a donné l’ordre ! On dirait un bœuf qui beugle dans une futaille.
À Osip.
Toi, mon cher, apprête tout ce qu’il faudra pour ton maître. Tout ce qu’il y a dans la maison, disposes-en.
Osip sort.
Vous autres, en faction sur le perron, et n’en bougez pas d’une semelle. Et qu’on ne laisse entrer ici pas un étranger... pas un marchand surtout... Si vous avez le malheur d’en laisser entrer un seul, je... Surtout, ayez l’œil à ce qu’il ne vienne personne avec des pétitions... quand même il n’y aurait pas de pétitions... personne qui ressemble à quelqu’un qui veut remettre des pétitions contre moi. Recevez-le-moi comme cela... vivement... vigoureusement.
Il fait signe de donner un coup de pied.
Vous m’entendez ? Chut ! Chut !
Il sort sur la pointe du pied en congédiant les deux sergents de ville.
ACTE IV
Une chambre chez le gouverneur. Décoration du premier acte.
Scène première
L’ADMINISTRATEUR DE L’HOSPICE, LE JUGE, LE DIRECTEUR DES POSTES, LE RECTEUR, BOBTCHINSKI, DOBTCHINSKI
Tous, en grand uniforme, entrent avec précaution et sur la pointe du pied. Toute cette scène est jouée à voix basse.
LE JUGE, après les avoir formés en demi-cercle.
Au nom de Dieu ! Messieurs, vite en cercle, et de l’ordre surtout. Dieu le bénisse ! il va à la cour, et fait enrager le Conseil d’État ! Mettons-nous sur le pied de guerre, Messieurs, en ordre de bataille. Vous, Pëtr Ivanovitch, mettez-vous de ce côté ; vous, Pëtr Ivanovitch, en sentinelle ici.
L’ADMINISTRATEUR.
Avec votre permission, Ammos Fëdorovitch, il faut absolument que nous fassions une tentative.
LE JUGE.
Quelle tentative ?
L’ADMINISTRATEUR.
Vous savez bien ce que je veux dire.
LE JUGE.
Graisser la patte ?
L’ADMINISTRATEUR.
Oui, il faut bien lui graisser la patte.
LE JUGE.
Affaire grave. Il n’a qu’à jeter les hauts cris. C’est un fonctionnaire public... Peut-être que si on lui offrait quelque chose sous forme de cadeau, d’un souvenir, de la part de la noblesse ?...
LE MAÎTRE DE POSTE.
Ou bien, on lui dirait : Voilà de l’argent qui vient d’arriver à la poste ; on ne sait pas à qui il appartient.
L’ADMINISTRATEUR.
Prenez garde qu’il ne vous fasse aller de la poste quelque part plus loin. Écoutez-moi. Ce n’est pas comme cela que se font les choses dans un gouvernement bien organisé. Pourquoi venons-nous ici tout un escadron ? Il vaut bien mieux se présenter individuellement, et entre quatre yeux, alors... on fait l’affaire. Qui est-ce qui en sait quelque chose ? Voilà comme cela se passe dans la bonne compagnie. Tenez, vous, Ammos Fëdorovitch, c’est à vous de commencer.
LE JUGE.
Il vaut bien mieux que ce soit vous. L’inspecteur général est allé chez vous et a mangé votre pain.
L’ADMINISTRATEUR.
Non, alors ; que ce soit Louka Loukitch en sa qualité d’instructeur de la jeunesse.
LE RECTEUR.
Oh ! je ne puis pas, Messieurs, je ne puis pas. Je vous avoue que dès que je suis obligé de parler à un fonctionnaire d’un grade un peu élevé, je perds la tête, ma langue s’épaissit comme si on l’avait chargée de boue. Non, Messieurs, dispensez-moi, je vous en supplie, dispensez-moi.
L’ADMINISTRATEUR.
Allons, Ammos Fëdorovitch, si ce n’est vous, ce ne sera personne. Nous savons que vous avez tout votre Cicéron sur le bout de votre langue.
LE JUGE.
Bah ! bah ! Cicéron, y pensez-vous ! Si j’allais me laisser un peu entraîner à lui parler d’un chien courant, ou d’un limier...
TOUS, l’entourant.
Non, non, vous ne vous entendez pas seulement en chiens, vous savez organiser un dîner... Non, Ammos Fëdorovitch, ne nous abandonnez pas. Soyez notre père... Non, Ammos Fëdorovitch.
LE JUGE.
Permettez-moi, Messieurs...
En ce moment, on entend marcher, tousser et cracher dans la chambre de Khlestakof. Tous se précipitent en désordre vers la porte, se pressent et s’empêchent mutuellement de sortir. Ils y parviennent cependant, mais non fans quelques petits accidents. On entend des exclamations étouffées.
La voix de BOBTCHINSKI.
Aïe ! Pëtr Ivanovitch ! Pëtr Ivanovitch, vous me marchez sur le pied ! La voix de L’ADMINISTRATEUR.
Ah ! de grâce ! Messieurs... ah ! laissez-moi sauver mon âme au moins... Vous m’étouffez ! Je n’en puis plus.
On entend encore quelques interjections : oh ! aïe ! etc. ; enfin tous sortent et la chambre demeure vide.
Scène II
KHLESTAKOF, seul, avec les yeux de quelqu’un qui a dormi trop longtemps
Il paraît que nous avons pioncé comme il faut. Où diable ont-ils pris tant de matelas et d’édredons. Je suis tout en sueur. On m’a flanqué je ne sais quoi hier à ce déjeuner... la tête m’en tinte encore. Ma foi, il y a moyen de passer le temps agréablement dans ce pays-ci. Moi, j’aime les bonnes gens, et j’aime à être traité de tout cœur plutôt que par intérêt. Et puis la fille du gouverneur n’est pas mal, et la maman est si bien conservée, qu’on pourrait... Non, je ne sais pas, moi, j’aime cette vie-là.
Scène III
KHLESTAKOF, LE JUGE
LE JUGE, à part, en entrant.
Mon Dieu ! mon Dieu ! fais que je réussisse ! mes genoux fléchissent sous moi.
Haut, après avoir salué, et se redressant dans une attitude officielle.
Permettez-moi de prendre la liberté de vous présenter l’hommage de mon respect. Je suis le juge du district, l’assesseur de collège Liapkine-Tiapkine.
KHLESTAKOF.
Veuillez vous asseoir. Ah ! vous êtes le juge d’ici ?
LE JUGE.
Depuis 1816. J’ai été délégué pour trois ans par la noblesse, et depuis lors j’ai été maintenu dans cet emploi.
KHLESTAKOF.
Est-ce une bonne place que d’être juge ?
LE JUGE.
Après avoir été délégué trois fois pour trois ans, j’ai été décoré de l’ordre de Saint-Vladimir de quatrième classe, et j’ai reçu les félicitations du gouvernement.
À part.
J’ai l’argent dans ma main ; il me semble tenir des charbons.
KHLESTAKOF.
J’aime l’ordre de Saint-Vladimir. Je trouve que c’est mieux que Sainte-Anne de troisième classe.
LE JUGE, avançant sa main fermée, et la retirant ; à part.
Mon Dieu ! je ne sais où je suis. Il me semble que je suis assis sur de la braise.
KHLESTAKOF.
Qu’avez-vous là, dans la main ?
LE JUGE, ouvre la main comme par distraction et laisse tomber un billet sur le plancher.
Rien, Monsieur.
KHLESTAKOF.
Comment, rien ? vous venez de laisser tomber un billet de banque.
LE JUGE, tremblant de tous ses membres.
Oh ! non... rien.
À part.
Ah ! mon Dieu ! me voilà sur la sellette. Voilà la charrette qui part pour la Sibérie.
KHLESTAKOF, ramassant le billet.
Je disais bien, c’est un billet de banque.
LE JUGE, à part.
Ah ! tout est fini ! je suis mort !
KHLESTAKOF.
Dites donc, vous me feriez plaisir de me prêter cela.
LE JUGE, avec empressement.
Comment donc ! comment donc... avec le plus grand plaisir.
À part.
Ah ! du courage ! du courage ! Très sainte mère de Dieu, tire-moi d’affaire.
KHLESTAKOF.
C’est que, voyez-vous, j’ai été retenu en route, et puis comme cela... dès que je serai chez moi, je vous renverrai cela.
LE JUGE.
Pardonnez-moi... excusez... trop d’honneur pour moi... Mes faibles efforts, mon dévouement et mon zèle pour les intérêts de l’administration... Je m’efforcerai toujours... que le service...
Il se lève, prend la position officielle, le petit doigt sur la couture de la culotte.
Je n’ose abuser plus longtemps de vos moments précieux. Avez-vous quelques ordres à me donner ?
KHLESTAKOF.
Quels ordres ?
LE JUGE.
Je veux dire quelques ordres pour le tribunal d’ici.
KHLESTAKOF.
Pourquoi donc ? Je n’y ai pas d’affaires. Non, je vous remercie de tout mon cœur.
LE JUGE salue et se retire ; à part en s’en allant.
Ville gagnée !
KHLESTAKOF, après l’avoir reconduit.
C’est un galant homme que ce juge.
Scène IV
KILESTAKOF, LE DIRECTEUR DES POSTES en grande tenue
LE DIRECTEUR, attitude officielle, la main au fourreau de l’épée.
Permettez-moi d’avoir l’honneur de prendre la liberté de vous offrir l’hommage de mon respect. Je suis le directeur des postes, le conseiller de cour, Chpekine.
KHLESTAKOF.
Soyez le bienvenu. J’aime beaucoup la compagnie des gens aimables. Asseyez-vous. Vous demeurez toujours ici ?
LE DIRECTEUR.
Oui, Monsieur.
KHLESTAKOF.
Votre petite ville me plaît. C’est vrai qu’il n’y a pas grand monde ; mais que voulez-vous, ce n’est pas la capitale. N’ai-je pas raison ? ce n’est pas la capitale.
LE DIRECTEUR.
Vous avez parfaitement raison.
KHLESTAKOF.
Ce n’est que dans la capitale qu’on trouve le bon ton. Il n’y a pas là d’oies comme en province. Qu’est-ce que vous en dites ? n’est-ce pas vrai ?
LE DIRECTEUR.
Parfaitement vrai.
À part.
Au moins il n’est pas fier. Il parle de tout.
KHLESTAKOF.
Eh bien, voyez-vous, dans une petite ville on peut encore s’arranger pour vivre heureusement.
LE DIRECTEUR.
En effet.
KHLESTAKOF.
Moi, je me dis, que faut-il pour y être bien ? Il faut être considéré, avoir de bons amis... n’est-ce pas ?
LE DIRECTEUR.
C’est bien ma manière de voir.
KHLESTAKOF.
Je suis bien aise que vous soyez de mon avis. On dit que je suis un original, mais, moi, j’ai mes idées...
Il le regarde entre deux yeux ; à part.
Si j’empruntais de l’argent à ce directeur ?
Haut.
Il m’arrive une drôle d’aventure. J’ai été retenu très longtemps en voyage. Ne pourriez-vous pas me prêter trois cents roubles ?
LE DIRECTEUR.
Comment donc ! comment donc ! avec le plus grand bonheur ! Voici, Monsieur, disposez de moi.
KHLESTAKOF.
Mille remerciements. C’est que, voyez-vous, moi, en voyage je n’aime pas à me rien refuser, d’abord, et puis, d’ailleurs... n’êtes-vous pas de cet avis ?
LE DIRECTEUR.
Tout à fait.
Se levant, et dans l’attitude officielle.
Je n’ose abuser plus longtemps de vos moments précieux. Auriez-vous quelques observations à m’adresser sur le service des postes ?
KHLESTAKOF.
Rien du tout.
Le Directeur des postes salue et sort. Khlestakof seul, allumant un cigare.
Ce directeur des postes est aussi, à ce qu’il me semble, un brave homme. Au moins il est serviable. C’est comme cela que j’aime les gens.
Scène V
KHLESTAKOF, LE RECTEUR qu’on pousse dans la chambre
UNE VOIX, s’adressant au recteur.
Pourquoi avoir peur ?
LE RECTEUR, tremblant et dans l’attitude officielle.
Permettez-moi d’avoir l’honneur de vous offrir l’hommage de mon respect. Je suis le recteur du collège, le conseiller titulaire Khlopof.
KHLESTAKOF.
Soyez le bienvenu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voulez-vous un cigare ?
LE RECTEUR, à part, toujours tremblant.
Ah ! mon Dieu ! et c’est la seule chose à quoi je n’avais pas pensé. Faut-il accepter ou refuser ?
KHLESTAKOF.
Prenez, prenez. C’est un bon cigare. Dame ! ce n’est pas comme ce qu’on a à Pétersbourg. Savez-vous, là, mon petit papa, je fumais des cigares à vingt-cinq roubles le cent. Tenez, voilà du feu, fumez-moi cela.
Le recteur essaie de fumer, et tremble toujours.
Mais ce n’est pas le bon bout.
LE RECTEUR jette son cigare effrayé, crache et s’agite avec inquiétude, à part.
Le diable emporte ! maudite timidité !
KHLESTAKOF.
À ce que je vois, vous n’êtes pas amateur. Moi, je l’avoue, c’est mon faible. Ma foi, aussi, sous le rapport du beau sexe, je ne suis pas indifférent. Et vous ? Qu’est-ce que vous préférez, les brunes ou les blondes ?
Le recteur stupéfait, ne trouve pas un mot a dire.
Voyons, dites-nous franchement : êtes-vous pour les brunes ou pour les blondes ?
LE RECTEUR.
Je n’ose pas...
KHLESTAKOF.
Non, non ! Expliquez-vous. Je tiens à savoir votre goût.
LE RECTEUR.
Je prendrai la liberté de vous faire observer...
À part.
Je ne sais ce que je dis. La tête me tourne.
KHLESTAKOF.
Ah ! vous ne voulez rien dire. Allons, je parie qu’une petite brunette vous aura joué quelque tour de sa façon. Convenez-en.
Le recteur se tait.
Ah ! vous rougissez ! voyez-vous, voyez-vous ! Pourquoi donc ne parlez-vous pas ?
LE RECTEUR.
Je suis intimidé monsi... monsei... votre ex...
À part.
Maudite langue ! traîtresse de langue !
KHLESTAKOF.
Vous êtes intimidé ? Eh bien ! En effet, il y a dans mes yeux quelque chose qui intimide. Ce que je sais bien, c’est qu’il n’y a pas une jeune personne qui soutienne mon regard ! Hein ?
LE RECTEUR.
Assurément.
KHLESTAKOF.
Je me trouve dans une situation très drôle. Je me suis amusé en route. Ne pourriez-vous pas me prêter trois cents roubles ?
LE RECTEUR, à part tirant son portefeuille en tremblant.
Comment donc ! comment donc ! Voilà ! voilà !
Il lui remet en tremblant des billets.
KHLESTAKOF.
Je vous remercie infiniment.
LE RECTEUR.
Je n’ose abuser plus longtemps de vos moments précieux.
KHLESTAKOF.
Adieu.
LE RECTEUR, à part, en s’enfuyant à la course.
Ah ! Dieu merci, il n’a pas visité les classes !
Scène VI
KHLESTAKOF, L’ADMINISTRATEUR DE L’HOSPICE en tenue et posture officielles
L’ADMINISTRATEUR.
Permettez-moi d’avoir l’honneur de vous offrir l’hommage de mon respect. Je suis l’administrateur des établissements de bienfaisance, conseiller de cour, Zemlianika.
KHLESTAKOF.
Bonjour. Veuillez prendre la peine de vous asseoir.
L’ADMINISTRATEUR.
J’ai eu l’honneur de vous accompagner et de vous recevoir dans l’établissement confié à ma surveillance.
KHLESTAKOF.
Ah ! oui, je sais. Vous nous avez donné un fameux déjeuner.
L’ADMINISTRATEUR.
Heureux de me dévouer au service du pays.
KHLESTAKOF.
Il faut que je vous avoue mon faible. J’aime la bonne chère. Dites-moi donc, il me semble que vous avez grandi depuis hier ? Hein ?
L’ADMINISTRATEUR.
C’est possible.
Après un silence.
Moi, Monsieur, je ne demande rien pour moi, et je me consacre tout entier aux intérêts du service.
Approchant sa chaise et parlant à demi-voix.
Ce n’est pas comme le directeur des postes qui ne fait rien du tout. Toutes les affaires sont à l’abandon ; on retient les paquets... Veuillez vous en enquérir vous-même. Il y a encore le juge, qui était ici un peu avant mon arrivée, il ne pense qu’à courir le lièvre : il tient les chiens dans le prétoire, et sa conduite, car il faut bien vous l’avouer, et l’intérêt du pays me contraint à faire auprès de vous cette démarche, sa conduite est des plus répréhensibles. Il y a ici un propriétaire, un certain Dobtchinski, qui a eu l’honneur de vous être présenté, et comme ce Dobtchinski est sans cesse hors de la maison, le juge alors tient compagnie à sa femme, et je suis prêt à lever la main... Tenez, il suffit de regarder ses enfants. Pas un seul qui ressemble à Dobtchinski. Tous, jusqu’à sa petite dernière, c’est le juge tout craché.
KHLESTAKOF.
Ah ! bah ! Je ne m’étais pas douté de cela.
L’ADMINISTRATEUR.
Par exemple, le recteur de notre collège... Je ne comprends pas que le gouvernement ait pu le charger de semblables fonctions. Il n’y a pas de pire jacobin, et il inculque à la jeunesse des principes si détestables que vous ne sauriez vous le figurer. Si vous le commandiez, je mettrais tout cela par écrit.
KHLESTAKOF.
Mettez, mettez. Ce me sera très agréable. C’est que j’aime, voyez-vous, quand on s’ennuie, à lire quelque chose d’amusant... Comment vous appelez-vous donc ? Je ne me rappelle plus.
L’ADMINISTRATEUR.
Zemlianika.
KHLESTAKOF.
Ah ! oui, Zemlianika. Et, dites-moi, avez-vous des enfants ?
L’ADMINISTRATEUR.
Pour vous servir. Cinq, dont deux déjà grands.
KHLESTAKOF.
Bah ! déjà grands ! Et comment... est-ce que...
L’ADMINISTRATEUR.
Vous désirez savoir leurs noms, peut-être ?
KHLESTAKOF.
Ah ! oui, comment les appelez-vous ?
L’ADMINISTRATEUR.
Nicolas, Ivan, Élisabeth, Maria et Perpétue.
KHLESTAKOF.
Fort bien.
L’ADMINISTRATEUR.
Je n’ose abuser plus longtemps des instants consacrés à de saints devoirs...
Il salue et se dirige vers la porte.
KHLESTAKOF, le reconduisant.
Non, pas du tout. C’est bien drôle tout ce que vous m’avez dit. Et s’il vous plaît dans un autre temps... Ah ! cela me ravit.
Il revient, ouvre la porte et le rappelle.
Eh ! dites donc... comment... ma foi, je l’ai oublié... Dites-moi donc votre nom et celui de votre père.
L’ADMINISTRATEUR.
Artemii Philippovitch.
KHLESTAKOF.
Faites-moi donc un plaisir, Artemii Philippovitch. C’est une drôle d’aventure qui m’arrive. Je me suis arrêté si longtemps en route... Est-ce que vous n’auriez pas quatre cents roubles à me prêter ?
L’ADMINISTRATEUR.
Oui.
KHLESTAKOF.
Ah ! comme c’est heureux. Je vous remercie très humblement.
Scène VII
KULESTAKOF, BOBTCHINSKI, DOBTCHINSKI
BOBTCHINSKI.
Permettez-moi d’avoir l’honneur de vous présenter l’hommage de mon respect. Je suis habitant de cette ville, Pëtr fils d’Ivan, Bobtchinski.
DOBTCHINSKI.
Propriétaire de ce pays, Pëtr fils d’Ivan, Dobtchinski.
KHLESTAKOF.
Ah ! je vous ai vu, je crois. C’est vous qui êtes tombé. Comment va votre nez ?
DOBTCHINSKI.
Bien obligé. Veuillez ne pas vous en inquiéter. C’est déjà sec, déjà sec.
KHLESTAKOF.
Sec ? Ah ! fort bien. J’en suis enchanté...
D’un ton brusque.
Avez-vous de l’argent sur vous ?
DOBTCHINSKI.
De l’argent ? comment, de l’argent ?
KHLESTAKOF.
Prêtez-moi mille roubles.
BOBTCHINSKI.
Hélas ! mon Dieu, une somme comme celle-là ! je ne l’ai pas. Et vous, Pëtr Ivanovitch, ne l’auriez-vous pas ?
DOBTCHINSKI.
Mon Dieu, non, parce que mon argent, si vous voulez le savoir, est placé au bureau de bienfaisance publique.
KHLESTAKOF.
Si vous n’avez pas mille roubles, vous en avez bien cent, au moins.
BOBTCHINSKI, fouillant à sa poche.
Est-ce que vous n’auriez pas cent roubles sur vous, Pëtr Ivanovitch ? Moi, je n’en ai que quarante en papier.
DOBTCHINSKI, fouillant dans sa poche.
Moi, je n’en ai que vingt-cinq en tout.
BOBTCHINSKI.
Cherchez donc, Pëtr Ivanovitch. Là, je vois, dans votre poche à droite, il me semble que vous avez mis quelque chose, la poche droite.
DOBTCHINSKI.
Non, en vérité. Je n’ai rien dans cette poche-là.
KHLESTAKOF, prenant l’argent.
Allons, cela ne fait rien. N’importe. Soixante-cinq roubles... c’est égal.
DOBTCHINSKI.
Oserais-je vous demander la permission de vous entretenir d’une petite affaire.
KHLESTAKOF.
Quelle est-elle ?
DOBTCHINSKI.
Oh ! une affaire de très petite importance. Voici : mon fils aîné, si j’ose le dire, est né un peu avant le mariage.
KHLESTAKOF.
Oui dà !
DOBTCHINSKI.
C’est une façon de parler, car il est né pour ainsi dire pendant le mariage, et d’ailleurs tout s’est arrangé après par un mariage légitime. Aussi j’ai voulu, s’il m’est permis de le dire, qu’il fût comme un fils légitime, et c’est pourquoi je l’ai appelé comme moi, Dobtchinski.
KHLESTAKOF.
Bon. La chose était faisable.
DOBTCHINSKI.
Je ne voudrais pas vous déranger ; mais seulement pour ce qui est de ses moyens... Ce garçon-là donne les plus grandes espérances. Il récite par cœur des fables, et lorsqu’il peut attraper un couteau, il se met à vous tailler de petits chariots, avec tant d’adresse, qu’on dirait un escamoteur. Voilà Pëtr Ivanovitch pour le dire.
ВОВТCHINSKI.
Pour cela, il a prodigieusement de moyens.
KHLESTAKOF.
Bon, bon ! J’en fais mon affaire. J’en parlerai... j’espère... que la chose se fera. Oui, oui.
À Bobtchinski.
Et vous, avez-vous quelque chose à me demander ?
BOBTCHINSKI.
Mon Dieu ! j’ai une très humble requête à vous présenter.
KHLESTAKOF.
De quoi s’agit-il ?
BOBTCHINSKI.
Ce serait pour vous supplier très humblement, quand vous reviendrez à Pétersbourg, de dire à tous les grands là-bas... aux sénateurs, aux amiraux... de leur dire, Votre Excellence... ou bien Monseigneur... il y a dans cette ville... c’est dans cette ville que reste Pëtr Ivanovitch Bobtchinski. Oui, rien que cela, c’est là que reste Pëtr Ivanovitch Bobtchinski.
KHLESTAKOF.
Très bien.
BOBTCHINSKI.
Si par hasard cela revenait à l’empereur, eh bien, dites à l’empereur comme cela : Votre Majesté impériale, c’est dans cette ville que reste Pëtr Ivanovitch Bobtchinski.
KHLESTAKOF.
Très bien.
DOBTCHINSKI.
Mille pardons d’avoir abusé de vos moments précieux.
BOBTCHINSKI.
Mille pardons d’avoir abusé de vos moments précieux.
KHLESTAKOF.
Comment donc ! Enchanté.
Il les reconduit.
Scène VIII
KHLESTAKOF, seul
Il y a bien des employés ici. Il me semble qu’on me prend pour un fonctionnaire du gouvernement. Au fait, je leur ai joliment jeté de la poudre aux yeux hier. Ah ! quels imbéciles ! Il faut que j’écrive tout cela à Triapitchkine à Pétersbourg qui fait des articles. Il en rira un peu.
Il appelle.
Eh ! Osip ! donne-moi du papier et de l’encre.
Osip entr’ouvre la porte et répond : Tout de suite.
Mais Triapitchkine, c’est que s’il s’empare de l’anecdote... gare ! Il ne ménagerait pas son père pour dire un bon mot, et il aime l’argent par-dessus le marché. D’ailleurs ces employés sont de braves gens, et c’est un beau trait de leur part de m’avoir ainsi prêté de l’argent. Ah ! à propos, combien est-ce que j’ai là ? Du juge, trois cents, du directeur des postes, trois cents, six cents ; six cents, sept cents, huit cents... Comme ce billet est gras !... Neuf cents... Oh ! oh ! cela fait plus de mille... Où est mon capitaine maintenant ? Ah ! s’il me tombait sous la patte... Nous savons maintenant ses tours...
Scène IX
KHLESTAKOF, OSIP, apportant du papier et de l’encre
KHLESTAKOF.
Eh bien ! grosse bête, que dis-tu de la façon dont on nous reçoit et dont on nous traite ici ?
Il se met à écrire.
OSIP.
Oui dà, grâce à Dieu : mais savez-vous, Ivan Alexandrovitch ?
KHLESTAKOF, écrivant.
Quoi ?
OSIP.
Filez-moi d’ici : il est temps, croyez-moi.
KHLESTAKOF, de même.
Quelle bêtise ! pourquoi ?
OSIP.
C’est comme cela. Le bon Dieu les bénisse et tout le monde aussi. Voilà deux jours que vous faites la noce, bon, c’est assez comme ça. Pourquoi s’acoquiner si longtemps à ce monde-là ? Crachez sur eux. L’heure est impaire. Il en viendra une autre... Ah ! Ivan Alexandrovitch ! il y a ici de fameux chevaux. Comme nous roulerions !
KHLESTAKOF, de même.
Non. Je veux rester encore un peu ici. Nous y penserons demain.
OSIP.
Ah ! demain... Partons, partons, Ivan Alexandrovitch. Dans votre intérêt et pour votre honneur, il vaut mieux filer tout de suite... Vous voyez bien qu’on vous a pris pour un autre... Avec cela que le petit papa se fâchera si vous tardez si longtemps... Croyez-moi, vous rouleriez bon train... Et on vous donnerait des chevaux d’importance.
KHLESTAKOF, de même.
Eh bien ! c’est bon. Seulement porte avant cette lettre à la poste, et tu ramèneras une voiture et des chevaux. Et fais attention que j’aie de bons chevaux. Dis aux postillons que je donnerai un rouble d’argent de guides, mais que je veux un train de Feljæger, et qu’on chante tout le temps...
Il continue à écrire.
Je me figure que Triapitchkine en crèvera...
OSIP.
Dites donc, Monsieur, je vais envoyer l’homme d’ici ; moi je ferai la malle, pour ne pas perdre de temps.
KHLESTAKOF.
À la bonne heure. Apporte-moi seulement une bougie.
OSIP, à la cantonade.
Eh ! camarade ! c’est pour porter une lettre à la poste ; et tu diras au directeur qu’il l’affranchisse. Dis-lui aussi qu’il envoie tout de suite son meilleur attelage de trois chevaux, pour courrier. Monsieur ne paie pas la poste ; tu diras : Service du gouvernement ; n’oublie pas. Et qu’on aille gaiement, que monsieur ne gronde pas. Attends, la lettre n’est pas encore prête.
KHLESTAKOF.
Je suis curieux de savoir où il demeure à présent : rue de la Poste ou rue aux Pois ? Il aime assez à déménager sans payer le terme. Ma foi, je vais lui écrire à son ancien logement, rue de la Poste.
Il plie la lettre et écrit l’adresse. Osip lui apporte une bougie, il la cachette.
Voix de DERJIMORDA, derrière la scène.
Ohé ! la barbe ! où que tu vas ? On te dit qu’on ne peut pas entrer.
KHLESTAKOF remet la lettre à Osip.
Tiens, porte cela.
Voix de MARCHANDS derrière la scène.
Laissez-nous entrer, petit père ! Vous ne pouvez pas nous renvoyer. Nous venons pour affaire.
Voix de DERJIMORDA.
Hors d’ici, hors d’ici ! Il ne reçoit pas. Il dort.
KHLESTAKOF.
Qu’est-ce que cela, Osip ? Regarde d’où vient ce tapage.
OSIP, regardant à la fenêtre.
Ce sont des marchands qui veulent entrer, et le sergent de ville qui les repousse. Ils tendent des papiers, et il paraît qu’ils veulent vous voir.
KHLESTAKOF, à la fenêtre.
Qu’y a-t-il, mes amis ?
Voix de MARCHANDS.
Nous implorons ta grâce ! Maître, ordonne qu’on reçoive notre requête.
KHLESTAKOF.
Laissez-les entrer. Qu’ils entrent : Osip, dis-lui de les laisser entrer.
Osip sort. Khlestakof reçoit des pétitions qu’on lui donne par la fenêtre.
« À son excellentissime seigneurie le monsieur des finances, Abdouline, marchand, expose... » Que diable est-ce là, et quel titre me donne-t-il ?
Scène X
KHLESTAKOF, MARCHANDS portant des corbeilles où il y a des bouteilles d’eau-de-vie et des pains de sucre.
KHLESTAKOF.
Que me voulez-vous, mes braves ?
LES MARCHANDS.
Nous venons frapper du front devant ta miséricorde.
KHLESTAKOF.
Qu’y a-t-il pour votre service ?
LES MARCHANDS.
Ne nous perds pas, Monseigneur. Nous venons te demander justice.
KHLESTAKOF.
Contre qui ?
UN MARCHAND.
Contre le gouverneur d’ici. Un pareil gouverneur, Monseigneur, jamais encore on n’en a vu. Il nous fait tant de misères qu’il serait impossible de les écrire. Il nous accable tant de billets de logement, qu’il vaut autant se mettre la corde au cou pour en finir. Il n’en fait ni un ni deux. Il vous prend à la barbe et vous dit : Chien de Tartare. Mon Dieu ! si encore nous lui avions fait quelque chose. Mais nous faisons tout régulièrement ; comme pour ce qui est des habits pour madame son épouse et sa demoiselle, nous ne disons rien là contre. Mais ce n’est rien pour lui ! hélas ! hélas ! Il entre dans la boutique, et ce qu’il rencontre il l’emporte. Il voit une pièce de drap : « Voilà du bon petit drap, dit-il ; mon cher, envoie cela chez moi. » Et il emporte ainsi des pièces d’au moins vingt-cinq archines.
KHLESTAKOF.
Est-il possible ? Mais c’est donc un gueux !
LE MARCHAND.
Hélas ! personne ne se souvient d’avoir jamais vu son pareil en fait de gouverneur. Tout ce qu’il voit dans la boutique, il l’escamote. Et encore, je ne dis pas des choses délicates, mais jusqu’à des saloperies, il les emporte. Des pruneaux, parlant par respect, qui sont depuis six ans dans le tonneau, et que mon garçon de boutique ne mangerait pas, il en bourre ses poches. Son jour de nom, c’est la Saint-Antoine, et ce jour-là il faut lui apporter tout, même ce dont il n’a que faire ; non, cela ne fait rien, il lui en faut encore. Il dit aussi que la Saint-Onufre, c’est sa fête. Il faut lui fêter encore la Saint-Onufre.
KHLESTAKOF.
C’est donc un voleur ?
LE MARCHAND.
Hélas ! hélas ! qu’on essaye de résister, il vous envoie tout un régiment à loger. Quand on réclame, il ferme la porte : « Je ne te fais pas donner la question, dit-il, ni un châtiment corporel, parce que la loi ne le permet pas ; mais, mon cher, dit-il, je saurai bien te faire avaler tant de couleuvres... »
KHLESTAKOF.
Diantre ! quel coquin ! Il y a de quoi l’envoyer en Sibérie.
LE MARCHAND.
Si Ta Grâce voulait l’envoyer seulement quelque part, seulement un peu loin d’ici, tout serait pour le mieux. Ne refuse pas notre pain et notre sel, notre père ; nous venons t’offrir nos hommages avec ces pains de sucre et ces paniers d’eau-de-vie.
KHLESTAKOF.
Vous n’y pensez pas ; je n’accepte jamais de cadeaux. Par exemple, si vous me prêtiez trois cents roubles, ce serait un autre affaire : je puis bien emprunter.
LES MARCHANDS, tirant de l’argent.
Prends, notre père. Qu’est-ce que trois cents roubles ? Prends-en tout de suite cinq cents, et sois-nous en aide.
KHLESTAKOF.
À la bonne heure. C’est un prêt... qu’on ne réplique pas. J’accepte.
LES MARCHANDS, lui offrant les roubles sur un plat d’argent.
Prends la soucoupe encore.
KHLESTAKOF.
Va pour la soucoupe.
LES MARCHANDS.
Pour une seule fois, prends le sucre...
KHLESTАКОF.
Oh ! jamais ! des cadeaux je n’en veux pas entendre parler...
OSIP.
Monseigneur, hé ! prenez tout de même. En route tout est utile. Allons, passez-moi ces pains de sucre et ces bouteilles. Bah ! tout servira. Qu’est-ce que cela ? de la ficelle ; passe-moi cette ficelle : la ficelle est toujours bonne en route. Il arrive un accident à la voiture, avec de la ficelle on raccommode tout.
LES MARCHANDS.
Que Votre Excellence nous fasse cette grâce. Monseigneur, si vous n’accueillez pas notre requête, nous ne savons plus que devenir. Autant vaut se pendre tout de suite.
KHLESTAKOF.
Comptez sur moi ; je ferai mes efforts...
Les marchands sortent. On entend des voix de femmes.
DEUX FEMMES derrière la scène.
Non, tu n’auras pas le front de me chasser. Je me plaindrai de toi à lui-même. Veux-tu bien ne pas me pousser !
KHLESTAKOF, à la fenêtre.
Qu’y a-t-il ? qu’est-ce que c’est, la mère ?
Voix de DEUX FEMMES.
Grâce ! notre père ! Justice ! Monseigneur ! Ordonne que nous te parlions.
KHLESTAKOF.
Qu’on les laisse entrer.
Scène XI
KLESTAKOF, LA FEMME D’UN SERRURIER, LA FEMME D’UN SOUS-OFFICIER
PREMIÈRE FEMME, se prosternant.
Je demande miséricorde.
DEUXIÈME FEMME.
Je demande miséricorde !
KHLESTAKOF.
Qui êtes-vous ?
DEUXIÈME FEMME.
Femme Ivanova, femme d’un sous-officier.
PREMIÈRE FEMME.
Moi, femme d’un serrurier d’ici, Fevronia Pëtrova Pochlepine, à ton service, mon père.
KHLESTAKOF.
Levez-vous. Qu’une seule parle à la fois. Que demandes-tu, toi ?
PREMIÈRE FEMME.
Je demande miséricorde. Je viens battre du front contre le gouverneur. Que le bon Dieu lui envoie tous les maux possibles, et à ses enfants, de ce gredin-là, à ses oncles et à ses tantes, et à toute sa race, s’il en a.
KHLESTAKOF.
Qu'a-t-il fait ?
PREMIÈRE FEMME.
Il a fait tondre mon mari au front pour en faire un soldat, et ce n’était pas notre tour ; quel gredin ça fait ! et la loi le défend, puisqu’il est marié.
KHLESTAKOF.
Comment cela s’est-il pu faire ?
PREMIÈRE FEMME.
Il l’a fait, le gredin ! il l’a fait. Que le bon Dieu le frappe dans ce monde et dans l’autre ! S’il a une tante, que sa tante attrape toutes les misères de la création ! et que son père, s’il vit, la canaille ! qu’il crève, ou qu’il meure asthmatique, le gredin qu’il est ! C’était le tour au fils du tailleur, avec cela que c’était un pochard ; mais les parents, qui sont riches, ont donné un cadeau, de sorte qu’on est venu pour prendre le fils de la Panteleïef, la marchande ; alors la Panteleïef a porté à madame son épouse trois pièces de toile ; là-dessus on tombe sur moi. – « Qu’est-ce que cela te fait, qu’il me dit, qu’on te prenne ton mari ? il ne te sert à rien. Eh bien, je le sais, mais qu’il me serve ou ne me serve pas, c’est mon affaire, à moi. Le gredin qu’il est ! – C’est un voleur, qu’il dit ; s’il n’a pas encore volé, il volera, c’est égal. » – Donc l’année suivante on l’empoigne pour conscrit ; et moi, je resterai donc sans mari ? Le gredin qu’il est ! Ah ! je voudrais que toute ta lignée fut privée de voir le jour du bon Dieu, et si tu as une grand’mère, que ta grand’mère...
KHLESTAKOF.
C’est bon, c’est bon. –
À l’autre femme.
Et toi ?
PREMIÈRE FEMME.
Ne m’oublie pas, mon père ! sois miséricordieux.
Elle sort.
DEUXIÈME FEMME.
C’est contre le gouverneur, mon petit père, que je viens...
KHLESTAKOF.
Qu’est-ce qu’il a fait ? Parle en peu de mots.
DEUXIÈME FEMME.
C’est le fouet, mon petit père.
KHLESTAKOF.
Comment cela ?
DEUXIÈME FEMME.
Par erreur, mon père. Nos femmes se sont querellées sur le marché. La police est venue un peu tard ; elle m’a empoignée, et on m’a fait un rapport, que j’ai été deux jours sans pouvoir m’asseoir.
KHLESTAKOF.
Et que peut-on faire à cela ?
DEUXIÈME FEMME.
On n’y peut rien faire. Mais pour l’erreur, on pourrait lui faire payer une indemnité. Je ne la refuserai pas, et un peu d’argent me ferait grand bien pour le moment.
KHLESTAKOF.
C’est bien, c’est bien. J’arrangerai cela.
Des mains paraissent à la fenêtre avec des pétitions.
Encore !
À la fenêtre.
Je ne puis pas ! je ne puis pas ! impossible ! Ils m’ennuient à la fin. Que le diable les emporte ! Ne laisse entrer personne, Osip.
OSIP, à la fenêtre criant.
Allez-vous-en, allez-vous-en. On n’a pas le temps. Revenez demain.
La porte s’ouvre, et l’on aperçoit une figure en houppelande d’hôpital, barbe longue, les lèvres enflées et les joues enveloppées. Derrière, quelques autres paraissent dans le second plan.
OSIP.
Dehors ! dehors ! On n’entre pas.
Il appuie les mains sur le ventre du premier et le repousse dans l’antichambre. La porte se referme sur eux.
Scène XII
KHLESTAKOF, MARIA ANTONOVNA
MARIA.
Ah !
KHLESTAKOF.
Qu’est-ce qui vous a fait peur, mademoiselle ?
MARIA.
Je n’ai pas eu peur.
KHLESTAKOF, d’un ton séducteur.
Pardonnez-moi, Mademoiselle, mais je suis bien heureux que vous m’ayez pris pour un homme qui... Oserai-je vous demander où vous aviez dessein d’aller...
MARIA.
Vraiment, je n’allais nulle part.
KHLESTAKOF.
Comment se peut-il que vous n’alliez nulle part.
MARIA.
Je pensais que peut-être maman était ici...
KHLESTAKOF.
Non. Je voudrais bien savoir comment il se fait que vous n’alliez nulle part ?
MARIA.
Je vous dérange. Vous êtes occupé d’affaires très sérieuses.
KHLESTAKOF.
Il n’y a pas d’affaire sérieuse qui vaille vos yeux. Vous ne pouvez jamais me déranger. En aucune façon. Au contraire, vous pouvez m’apporter le bonheur.
MARIA.
Vous avez bien le style de la capitale.
KHLESTAKOF.
Oui, avec des personnes douées de tant d’attraits. Oserai-je être assez heureux pour vous offrir un siège ? Mais, que dis-je ? ce n’est pas un fauteuil qu’il vous faudrait, c’est un trône.
MARIA.
Vraiment, je ne sais... Je crois qu’il faut que je m’en aille.
Elle s’assied.
KHLESTAKOF.
Quel joli fichu vous avez là.
MARIA.
Comme c’est mal à vous de vous moquer des pauvres provinciales.
KHLESTAKOF.
Ah ! Mademoiselle, je voudrais être ce fichu pour entourer ce col de lis.
MARIA.
Mon Dieu ! je ne comprends rien du tout à ce que vous dites... ce fichu-là... Quel beau temps de printemps il fait aujourd’hui !
KHLESTAKOF.
Il n’y a pas de printemps qui ressemble à ces lèvres de rose, mademoiselle.
MARIA.
Mon Dieu ! comme vous me parlez... Moi qui avais envie de vous demander si vous voudriez m’écrire quelque chose sur mon album. Des vers. Je suis sûre que vous en savez tant.
KHLESTAKOF.
Pour vous, Mademoiselle, je ferais tout. À vos ordres. Quels vers voulez-vous ?
MARIA.
Des vers, n’importe lesquels... de bons vers, nouveaux.
KHLESTAKOF.
Ah ! des vers, j’en sais beaucoup.
MARIA.
Eh bien, dites-moi ceux que vous m’écrirez.
KHLESTAKOF.
À quoi bon les dire, puisque je les sais bien sans cela ?
MARIA.
J’aime tant les vers...
KHLESTAKOF.
C’est que j’en sais tant de toutes sortes... Voulez-vous, tenez, que je vous écrive, par exemple :
Toi dont le désespoir ose accuser ton Dieu,
Homme...
Ou bien ceux-ci... C’est drôle, je ne me rappelle plus... Au reste, cela ne fait rien. Au lieu de cela, si je vous offrais mon cœur, qui, depuis que je vous ai vue...
Il approche sa chaise.
L’amour...
MARIA.
L’amour !... Je ne sais pas ce que c’est que l’amour... Je ne comprends pas ce que c’est.
Elle éloigne sa chaise.
KHLESTAKOF.
Pourquoi éloignez-vous votre chaise ? Il est si agréable d’être assis l’un auprès de l’autre.
MARIA, éloignant sa chaise.
Pourquoi, près ? On est aussi bien, loin.
KHLESTAKOF, se rapprochant.
Pourquoi loin ? On est aussi bien, près.
MARIA, s’éloignant.
Pourquoi cela ?
KHLESTAKOF, se rapprochant.
Vous croyez que nous sommes près ! Figurez-vous que nous sommes loin... Ah ! mademoiselle, que je serais heureux si je pouvais être près, près... à vous serrer dans mes bras.
MARIA, regardant à la fenêtre.
Tiens ! qu’est-ce qui vient de voler là ? Une pie, ou bien un autre oiseau ?
KHLESTAKOF, lui donnant un baiser sur l’épaule.
C’est une pie.
MARIA, se levant.
Ah ! c’en est trop... Quelle audace !
KHLESTAKOF, la retenant.
Pardon, Mademoiselle. C’est l’amour qui m’a entraîné. L’amour...
MARIA, essayant de se dégager.
Vous me prenez pour une provinciale...
KHLESTAKOF, la retenant.
C’est l’amour, le pur amour. C’était pour rire, Maria Antonovna ; ne vous fâchez pas. Je vous demande mon pardon à genoux. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vous voyez, je suis à vos genoux...
Scène XIII
KHLESTAKOF, MARIA ANTONOVNA, ANNA ANDREÏEVNA
ANNA.
Ah ! Quelle situation est-ce là ?
KHLESTAKOF, se relevant, à part.
Le diable emporte !
ANNA, à sa fille.
Qu’est-ce que cela veut dire, Mademoiselle ? Quelles manières avez-vous là ?
MARIA.
Mais, petite maman...
ANNA.
Sortez, tout de suite ! M’entendez-vous ? Ne vous avisez de plus de reparaître à mes yeux.
Maria sort toute en larmes.
Excusez-moi, Monsieur, mais mon étonnement...
KHLESTAKOF, à part.
Ma foi, elle est appétissante aussi. Elle n’est pas mal.
Il se jette à ses genoux.
Madame, vous le voyez, je me meurs d’amour...
ANNA.
Vous ! à genoux ! Levez-vous, levez-vous, Monsieur. Le parquet n’est pas propre.
KHLESTAKOF.
Non, à genoux, toujours à genoux ; je veux attendre le sort qui m’est réservé. La vie ou la mort ?
ΑΝΝΑ.
Permettez, Monsieur ; je ne comprends pas encore parfaitement le sens de vos paroles. Si je ne me trompe, vous étiez à faire une déclaration à ma fille ?
KHLESTAKOF.
Non, je suis amoureux de vous. Ma vie ne tient plus qu’à un cheveu. Si vous ne couronnez un amour constant, je suis indigne de conserver l’existence. C’est un cœur embrasé qui vous demande votre main.
ANNA.
Mais, permettez-moi de vous faire observer... C’est impossible ; je suis mariée.
KHLESTAKOF.
Qu’importe ! L’amour ne connaît pas de différences. D’ailleurs Karamzine l’a dit les lois condamnent. Éloignons-nous à l’ombre d’un ruisseau. Votre main, je vous demande votre main.
Scène XIV
KHLESTAKOF, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, qui entre en courant
MARIA.
Maman, petit papa m’a dit de te...
Apercevant Khlestakof à genoux.
Ah ! quelle situation est-ce là ?
ANNA.
Eh bien ! quoi ? qu’est-ce ? qu’y a-t-il ? Qu’est-ce que cette étourderie ! Se précipiter dans une chambre comme un chat échaudé ? Qu’y a-t-il donc de si extraordinaire ? Pourquoi cet étonnement ? En vérité, on dirait un enfant de trois ans. Certes, on ne se douterait pas, non assurément on ne s’en douterait pas, on ne se douterait pas qu’elle en a dix-huit. Je ne sais pas quand tu auras jamais un peu de raison et que tu sauras te conduire comme une jeune personne bien élevée : quand apprendras-tu jamais les avantages des bons principes et de la sévérité des manières ?
MARIA, pleurant.
Mais, maman, je ne savais pas...
ANNA.
Il y a toujours dans ta tête je ne sais quelle fumée, quelles incroyables vapeurs ! Tu te modèles sur les filles de Liapkine-Tiapkine. Pourquoi les regardez-vous, Mademoiselle ? Vous ne devez pas les regarder. Vous avez d’autres exemples à suivre. Votre mère est sous vos yeux. Voilà les modèles sur lesquels vous devez vous former.
KHLESTAKOF, prenant la main de Maria.
Anna Andreïevna, ne vous refusez pas à notre bonheur ! Bénissez un constant amour !
ANNA.
Comment, c’est d’elle que...
KHLESTAKOF.
Prononcez ! ma vie ou ma mort !
ANNA.
Eh bien ! petite sotte, tu vois ce que c’est que tes manières ridicules. Monsieur a la bonté de se mettre à genoux, et là-dessus tu prends ta course comme une folle. Va, tu mériterais bien que je refusasse : tu n’es pas digne de tant d’honneur.
MARIA.
Je ne le ferai plus, petite maman, je ne le ferai plus.
Scène XV
KHLESTAKOF, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LE GOUVERNEUR, tout essoufflé
LE GOUVERNEUR.
Je ne le ferai plus, Votre Excellence ! Ne me perdez pas ! ne me perdez pas !
KHLESTAKOF.
Qu’avez-vous ?
LE GOUVERNEUR.
Les marchands sont venus me dénoncer à Votre Excellence. Sur mon honneur, je vous jure qu’il n’y a pas la moitié de vrai dans ce qu’ils disent. Eux-mêmes ils trompent le public et vendent à faux poids. La femme du sous-officier est une menteuse. Elle dit qu’on l’a fouettée, elle ment, comme il y n’a qu’un Dieu, elle ment, c’est elle-même qui s’est fouettée.
KHLESTAKOF.
Au diable la femme du sous-officier. Je m’en soucie bien !
LE GOUVERNEUR.
Ne les croyez pas, ne les croyez pas ! Ce sont de tels menteurs !... Un enfant ne les croirait pas. Dans toute la ville ils sont connus pour des menteurs. Quant à cette canaille-là, je puis prendre la liberté de vous assurer que c’est une canaille comme le monde n’en a jamais vu.
ANNA.
Sais-tu l’honneur que nous fait Ivan Alexandrovitch ? Il nous demande la main de notre fille.
LE GOUVERNEUR.
Quoi ! quoi !... As-tu perdu la boule, petite mère ? Votre Excellence, veuillez ne pas vous offenser. Elle a la tête un peu fêlée. Elle tient cela de sa mère.
KHLESTAKOF.
Oui, oui. Je demande sa main. Je suis amoureux.
LE GOUVERNEUR.
Je ne puis vous croire, Excellence.
ANNA.
Mais, quand on te dit...
KHLESTAKOF.
C’est très sérieusement que je parle... Je suis homme à en perdre la cervelle... tant je suis amoureux.
LE GOUVERNEUR.
Je n’ose croire... Je suis si indigne de tant d’honneur.
KHLESTAKOF.
Oui, si vous ne consentez pas à me donner la main de Maria Antonovna, le diable sait ce que je ne fais pas !
LE GOUVERNEUR.
Je ne puis croire... Votre Excellence veut s’amuser.
ANNA.
Ah ! quel balourd incorrigible ! Combien de fois faudra-t-il te répéter...
LE GOUVERNEUR.
Je ne puis croire...
KHLESTAKOF.
Donnez-la-moi, donnez-la-moi !... Je suis un homme désespéré, et résolu à tout... Quand je me serai brûlé la cervelle, vous en répondrez devant la justice.
LE GOUVERNEUR.
Hélas ! seigneur Dieu ! je ne suis coupable ni de fait ni d’intention. Ne vous fâchez pas, Excellence ! Veuillez faire tout ce qu’il plaira à Votre Excellence... Je n’ai pas la tête à moi dans ce moment... et je ne sais ce qui se passe. Je suis devenu si bête, que je ne me suis jamais vu comme cela.
ANNA.
Allons, donne-leur ta bénédiction.
Khlestakof prend Marie Antonovna par la main et s’incline.
LE GOUVERNEUR.
Dieu vous bénisse, mais je ne suis pas coupable.
Khlestakof embrasse Maria Antonovna.
Diable ! Au fait !
Il se frotte les yeux.
Ils s’embrassent ! Ma foi ! ils s’embrassent. C’est un fiancé pour tout de bon ! Ah ! quelle chance ! En voilà d’une sévère !
Scène XVI
KHLESTAKOF, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LE GOUVERNEUR, OSIP
OSIP.
Les chevaux sont arrivés.
KULESTAKOF.
Bon. Je viens.
LE GOUVERNEUR.
Est-ce que vous partez ?
KHLESTAKOF.
Oui.
LE GOUVERNEUR.
Alors, quand donc ?... Vous aviez même, je pense, daigné faire allusion à un... mariage.
KHLESTAKOF.
Je reviens tout de suite. Je vais chez mon oncle pour un jour. C’est un vieillard fort riche... Demain, je serai ici.
LE GOUVERNEUR.
Nous n’osons pas vous retenir, dans l’espoir de votre prompt retour.
KHLESTAKOF.
Je ne fais qu’aller et venir. Adieu, mon amour !... Non, je ne puis vous exprimer... Adieu, mon âme.
Il lui baise la main.
LE GOUVERNEUR.
N’avez-vous besoin de rien pour la route ? Si vous aviez besoin d’argent ?
KHLESTAKOF.
Oh ! non. Pourquoi donc ?
Se ravisant.
En effet... Oui, volontiers.
LE GOUVERNEUR.
Combien vous faut-il ?
KHLESTAKOF.
Vous m’avez déjà donné deux cents roubles, c’est-à-dire quatre cents, – je ne veux pas profiter de votre méprise. – Eh bien, donnez-moi encore autant, et cela fera huit cents roubles juste.
LE GOUVERNEUR, prenant l’argent dans son portefeuille.
Vous allez les avoir. Tenez, voici précisément des billets neufs.
KHLESTAKOF.
C’est vrai. Tant mieux. On dit que des billets neufs annoncent un bonheur nouveau.
LE GOUVERNEUR.
C’est bien le cas de le dire.
KHLESTAKOF.
Adieu, Anton Antonovitch. Je vous suis bien reconnaissant de votre hospitalité. Jamais je n’ai trouvé des hôtes si aimables. Adieu, Anna Andreïevna. Adieu, ma chère âme, Maria Antonovna.
Tous sortent ; on les entend derrière la scène.
Voix de KHLESTAKOF.
Adieu, ange de mon âme, Maria Antonovna !
Voix du GOUVERNEUR.
Comment donc ! Vous partez dans une voiture de la poste ?
Voix de KHLESTAKOF.
Oui, c’est mon habitude. Les ressorts me font mal à la tête.
Voix du POSTILLON.
Heuh !
Voix du GOUVERNEUR.
Au moins, mettez donc quelque chose sous vous... un tapis... Permettez-moi de vous faire donner un tapis.
Voix de KHLESTAKOF.
Non, non ! Ce n’est pas la peine... Au reste, si vous l’exigez, je veux bien un tapis.
Voix du GOUVERNEUR.
Hé ! Avdotia ! cours au garde-meuble. Prends le meilleur tapis... le tapis de Perse à fond bleu... Vite, dépêche !
Voix du POSTILLON.
Heuh !
Voix du GOUVERNEUR.
Quand voulez-vous que nous vous attendions ?
Voix de KHLESTAKOF.
Demain, après demain au plus tard.
Voix d’OSIP.
C’est là le tapis ? Donnez-le-moi... Un tour par ici. – Bon, une poignée de foin.
Voix du POSTILLON.
Heuh !
Voix d’OSIP.
Bien. Par ici. C’est cela. Ça va bien. Bravo !
Frappant sur le tapis.
Allons, asseyez-vous, Monsieur.
Voix de KHLESTAKOF.
Adieu, Anton Antonovith !
Voix du GOUVERNEUR.
Adieu, Excellence !
Voix de FEMMES.
Adieu, Ivan Alexandrovitch.
Voix de KHLESTAKOF.
Adieu, petite maman !
Voix du POSTILLON.
Enlevez, les ailés !
On entend un bruit de sonnettes, la toile tombe.
ACTE V
Même décoration.
Scène première
LE GOUVERNEUR, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA
LE GOUVERNEUR.
Eh bien, Anna Andreïevna ? hein ? t’en serais-tu jamais doutée ? En voilà-t-il un quine à la loterie ? Voyons, dis-moi franchement : est-ce que tu y avais jamais pensé, même en rêve ? Tu étais madame la gouvernante pour tout potage... crac !... Quel changement. Il faut que tu sois la fille de quelque diable.
ANNA.
Mon Dieu ! rien de tout cela ne me surprend. Il y a longtemps que je l’avais prévu. Cela t’étonne, toi, parce que tu es un pauvre bonhomme qui n’a jamais vu des gens comme il faut.
LE GOUVERNEUR.
Est-ce que je ne suis pas un homme comme il faut, moi, petite maman ? Non, vraiment, Anna Andreïevna, c’est drôle de penser que nous voilà devenus tous deux des oiseaux de cette sorte. Hein, Anna Andreïev des oiseaux de haut-vol, le diable m’emporte. Ah ! maintenant je m’en vais laver la tête, de la bonne sorte, à tous ces farceurs qui remettent des pétitions et des dénonciations. Holà ! quelqu’un ?
Un sergent de ville entre.
Ah ! c’est toi, Ivan Karpovitch. Va me chercher messieurs les marchands, mon camarade. Ah ! je leur apprendrai, à cette canaille-là, à se plaindre de moi. A-t-on jamais vu de mauvais Juifs comme cela ! C’est bon, c’est bon, mes agneaux, je vous ai fait manger des crapauds jusqu’à présent, mais aujourd’hui, parbleu ! vous avalerez des couleuvres. Ah ! je tiens bonne note de tous ces plaignants, surtout des écrivains, des écrivains rédacteurs de placets dont ils ont été l’entourer. Apprends-leur à tous, qu’ils n’en ignorent pas, l’honneur que le bon Dieu envoie à leur gouverneur. Il va donner sa fille, non pas au premier venu, mais à quelqu’un qui n’a pas son pareil au monde et qui peut faire tout, tout, tout, tout ! Dis-leur bien à tous pour qu’ils le sachent. Crie-le à tout le peuple ; sonne la cloche : le diable m’emporte, c’est mon jour de triomphe, et je triomphe.
Le sergent de ville sort.
Eh bien ! Eh bien ! Anna Andreïevna ! comment sommes-nous à présent ? Où allons-nous vivre, ici ou bien à Piter ?
ANNA.
À Pétersbourg, cela va sans dire ? Le moyen de rester ici ?
LE GOUVERNEUR.
Va pour Piter, puisque Piter il y a. On est bien ici, cependant. Quoi donc ? quand j’y pense, faut-il envoyer mon gouvernement au diable, hein, Anna Andreïevna ?
ANNA.
Cela va sans dire. La belle chose qu’un gouvernement !
LE GOUVERNEUR.
Dis donc, Anna Andreïevna, maintenant je puis bien attraper un meilleur grade. Il est à tu et à toi avec tous les ministres, et il va à la cour. Il me fera avoir de l’avancement, et avec le temps, je puis bien accrocher les épaulettes de général. Qu’en penses-tu, Anna Andreïevna, est-ce que je ne puis pas bien passer général ?
ΑNNΑ.
Comment donc ! mais certainement.
LE GOUVERNEUR.
Ah ! le diable m’emporte ! c’est fameux d’être général et de se pendre un cordon sur l’épaule. Quel cordon vaut mieux, Anna Andreïevna, rouge ou bleu ?
ANNA.
C’est le bleu, sûrement.
LE GOUVERNEUR.
Peste ! c’est comme cela qu’elle les aime ! Le rouge est beau aussi. Sais-tu pourquoi c’est agréable d’être général ? C’est que, par exemple, on veut aller quelque part : – bon ! feldjægers et adjudants galopent devant vous. Des chevaux ! – Dans le relais il n’y en a pour personne ; il faut que tout le monde attende : tous les petits fonctionnaires, capitaines, gouverneurs... tandis que M. le général fait le gros dos sans daigner se mêler de rien. On dîne chez l’intendant, et là le gouverneur vous fait la cour. Ah ! ah ! ah !
Il pleure à force de rire.
Voilà une vie enchanteresse, morbleu !
ANNA.
Tu n’aimes que les choses grossières. Tu auras la complaisance de changer complètement de façons de vivre ; car tes relations ne seront plus avec je ne sais quel juge, amateur de chiens, avec lequel tu vas courir des lièvres, ou bien un Zemlianika. Tu auras, au contraire, des relations avec les personnes les plus distinguées, des comtes, des gens du monde... Je t’avoue que je suis en peine de toi. Il t’arrive parfois de lâcher des mots qu’on n’entend jamais dans la bonne compagnie.
LE GOUVERNEUR.
Bah ! un mot, ça ne fait de mal à personne.
ANNA.
À la bonne heure quand tu étais gouverneur. Mais, maintenant, c’est une vie toute différente.
LE GOUVERNEUR.
Oui. On dit qu’il y a là-bas deux petits poissons, le riapouchka et le koriouchka, que l’eau vous en vient à la bouche quand on commence à en manger.
ΑΝΝΑ.
Il ne pense qu’aux poissons ! Moi, je veux que notre maison soit la première de la capitale. Je veux avoir ma chambre toute parfumée d’ambre, qu’en y entrant seulement on en ferme les yeux et...
Elle ferme les yeux en respirant avec force.
Ah ! que c’est délicieux !
Scène II
LE GOUVERNEUR, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LES MARCHANDS
LE GOUVERNEUR.
Bonjour, mes petits amis.
LES MARCHANDS, se prosternant.
Nous venons te présenter nos hommages, petit père.
LE GOUVERNEUR.
Eh bien, mes petits agneaux, comment va la santé ? Et notre commerce ? Comment, des raccommodeurs de bouilloires, des chevaliers de l’aune s’avisent de faire des pétitions ? Archi-voleurs, triples bêtes, vieux veaux marins, vous faites des pétitions, hein ? On vous a pris beaucoup ? Vous vous imaginez que vous allez me faire mettre en prison ?... Savez-vous bien, Messieurs, et que six diables et une sorcière vous sautent à la gorge, savez-vous bien...
ANNA.
Ah ! mon Dieu ! Antoncha, quels mots est-ce que tu dis là ?
LE GOUVERNEUR.
Les mots n’y font rien. – Mais savez-vous bien que ce haut fonctionnaire, à qui vous avez porté vos plaintes se marie avec ma fille ? Hein ? qu’avez-vous à dire à cela ?... Maintenant, si je vous... Vous volez le monde. Toi, tu fais une soumission au gouvernement, tu nous passes un compte d’apothicaire de cent mille roubles, et tu livres du drap pourri, et parce que tu fais le sacrifice d’une douzaine d’archines, tu crois qu’il faut qu’on t’en remercie encore ? Et si l’on savait comme tu... Mais il a du foin dans ses bottes : c’est un marchand, on ne peut pas le toucher. Un marchand, dis-tu, vaut bien un gentilhomme... Un gentilhomme !... ah ! vilain singe, sais-tu ce que c’est qu’un gentilhomme ? Un gentilhomme est éduqué. C’est vrai qu’on lui donne le fouet au collège, et c’est bien fait pour qu’il apprenne ce qu’il faut apprendre ; tandis que toi... ce qu’on t’apprend d’abord c’est à larronner. Ton maître te rosse pour t’instruire à flouer les chalands. Quand tu es apprenti et que tu ne sais pas encore ton pater, tu sais déjà donner le coup de pouce à la balance. Et puis quand tu t’es arrondi, que ta poche est bien bourrée, tu fais le gros et le fier. Voilà un beau venez-y-voir ! – Et toi, parce que tu soudes seize bouilloires par jour, tu fais le gros et l’important ? Ah ! je vais te cracher sur ta tête et sur ton importance !
LES MARCHANDS, à genoux.
Grâce ! Anton Antonovitch ! nous sommes coupables !
LE GOUVERNEUR.
Tu fais des placets toi ? Et qui donc t’a donné un coup d’épaule pour faire ton beurre, lorsque tu as bâti ce pont et que tu nous as fait un compte de vingt mille-roubles de bois tandis qu’il n’y en avait pas pour cent roubles ? C’est moi qui t’ai tendu la perche, barbe de bouc ! Tu l’as oublié. Si je disais ce que je sais sur ton compte, je te ferais faire gratis le voyage de Sibérie. Hein ? qu’as-tu à dire à cela ?
UN MARCHAND.
Nous eûmes tort, Anton Antonovitch : c’est le diable qui nous poussa. Mais nous ne ferons jamais plus de placets. Dis-nous seulement quelle satisfaction tu veux, mais ne sois plus fâché.
LE GOUVERNEUR.
Ne sois plus fâché ! Tu es à plat-ventre devant moi, à présent : c’est que j’ai le bon bout du bâton. Mais si j’étais à ta place, et toi à la mienne, canaille, tu me pousserais dans le ruisseau, bien heureux si tu ne me jetais pas des pierres.
LES MARCHANDS, à ses pieds.
Grâce ! grâce ! Anton Antonovitch !
LE GOUVERNEUR.
Grâce ! grâce ! Voilà ce que vous dites à présent. Et tout à l’heure, je vous... Allons ! Dieu commande de pardonner ! Suffit. Je ne suis pas rancunier ; seulement, faites-y attention : à l’avenir, qu’on ne m’échauffe plus les oreilles. Vous aurez la bonté de vous rappeler que je donne ma fille, non pas à un simple gentilhomme... Ainsi que les félicitations soient convenables, vous m’entendez ? Ne vous imaginez pas que vous vous en tirerez avec un saumon fumé ou avec un pain de sucre... Non. Allez, et que Dieu vous conduise.
Les marchands sortent.
Scène III
LE GOUVERNEUR, ANNA ANDREÏEVNA, MARIA ANTONOVNA, LE JUGE, L’ADMINISTRATEUR DE L’HOSPICE, RASTAKOFSKI
LE JUGE.
La nouvelle est-elle vraie, Anton Antonovitch ? On dit qu’il vous arrive un bonheur extraordinaire.
L’ADMINISTRATEUR.
J’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations de ce bonheur extraordinaire.
Baisant la main à Anna Andreïevna, puis à Maria Antonovna.
Anna Andreïevna !... Maria Antonovna !...
RASTAKOFSKI.
Anton Antonovitch, je vous offre mes félicitations ! Que Dieu prolonge votre vie et celle du nouveau couple, qu’il vous donne une nombreuse postérité de petits-fils et d’arrière-petit-fils. Anna Andreïevna... Maria Antonovna...
Il leur baise la main.
Scène IV
LES MÊMES, KOROBKINE, LA FEMME DE KOROBKINE, LULUKOF
KOROBKINE.
J’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations, Anton Antonovitch. Anna Andreïevna... Maria Antonovna...
Baisement de mains.
LA FEMME DE KOROBKINE.
Je vous félicite bien sincèrement, Anna Andreïevna, de ce nouveau bonheur.
LULUKOF.
J’ai l’honneur de vous féliciter, Anna Andreïevna.
Il lui baise la main, puis se tournant vers les spectateurs, fait claquer sa langue d’un air cavalier.
Maria Antonovna !
Il lui baise la main avec la même pantomime.
Scène V
LES MÊMES, BOBTCHINSKI et DOBTCHINSKI
Entrent une grande quantité de personnes en redingote et en habit, qui vont processionnellement baiser la main d’Anna Andreïevna en disant : Anna Andreïevna ; puis celle de Maria Antonovna, en disant : Maria Antonovna. Bobtchinski et Dobtchinski s’entre-poussent pour se présenter plus tôt.
BOBTCHINSKI.
J’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations...
DOBTCHINSKI.
Anton Antonovitch, j’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations...
BOBTCHINSKI.
...Dans une circonstance si heureuse.
DOBTCHINSKI.
Anna Andreïevna...
BOBTCHINSKI.
Anna Andreïevna...
Tous deux s’avançant en même temps pour lui baiser la main, se cognent le front.
DOBTCHINSKI.
Maria Antonovna !
Il lui baise la main.
J’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations. Vous allez être bien, bien heureuse. Vous aurez des robes d’or et vous mangerez des soupes délicates de toute espèce. Vous passerez agréablement votre temps.
BOBTCHINSKI, l’interrompant.
Maria Antonovna, j’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations. Dieu vous donne toutes sortes de richesses, beaucoup de ducats, et un petit garçon, grand comme cela, qu’on tiendra dans la paume de la main, et qui criera bien gentiment : Oua ! oua ! oua !
Scène VI
LES MÊMES, LE RECTEUR et SA FEMME
Arrivée de nouvelles visites. Le baisemain continue.
LE RECTEUR.
J’ai l’honneur...
LA FEMME DU RECTEUR, se jetant dans les bras d’Anna.
Je vous félicite, Anna Andreïevna.
Elles s’embrassent.
Ah ! quel plaisir j’ai eu en apprenant cette nouvelle. On me dit : Anna Andreïevna marie sa fille. – Ah ! mon Dieu, que je me dis, j’en suis si contente ! Dis donc, que je dis à mon mari, dis donc, Loukantchik, quel bonheur pour Anna Andreïevna ! Ah ! je me dis, loué soit Dieu. Je lui dis : J’en suis si ravie, que je meurs d’impatience d’aller le dire à Anna Andreïevna en personne... Ah ! mon Dieu, que je me dis, Anna Andreïevna qui souhaitait tant un bon parti pour sa fille, voilà un bonheur comme cela... Cela se fait juste comme elle le désirait. Moi j’en suis si contente que je ne saurais le dire. J’en pleure, j’en pleure, vrai cela me fait sangloter. Et Louka Loukitch qui me dit : Pourquoi donc, Nastenka, que tu pleures ? – Loukantchik, que je lui dis, je ne sais pas, mais les larmes me coulent comme d’une fontaine...
LE GOUVERNEUR.
Je vous en supplie, Messieurs, prenez la peine de vous asseoir. Hé ! Michka ! apporte ici d’autres chaises.
On s’assied.
Scène VII
LES MÊMES, UN INSPECTEUR DE POLICE et LES SERGENTS DE VILLE
L’INSPECTEUR.
J’ai l’honneur de vous offrir mes félicitations, monsieur le gouverneur, et de vous présenter mes souhaits pour de nombreuses années.
LE GOUVERNEUR.
Merci, merci ! Asseyez-vous, Messieurs.
LE JUGE.
Mais, dites-nous donc, je vous en prie, Anton Antonovitch, de quelle manière cela s’est fait. Contez-nous la chose par le menu.
LE GOUVERNEUR.
Le menu de la chose est extraordinaire. Il a fait la demande en personne.
ANNA.
Et de la façon la plus respectueuse et la plus comme il faut. Il m’a dit avec des manières excellentes : Tenez, Anna Andreïevna, ce que j’en fais, c’est par pure admiration de votre mérite. On n’a jamais vu un homme mieux élevé, plus distingué, plus à la tête des gens comme il faut. Pour moi, a-t-il dit, Anna Andreïevna, je me soucie de la vie comme d’un kopek. Et c’est seulement parce que je suis pénétré d’estime pour vos rares qualités...
MARIA.
Ah ! petite maman, c’est à moi qu’il a dit cela.
ANNA.
Tais toi donc. Tu n’y entends rien, et tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde pas. – Moi, dit-il, Anna Andreïevna, je suis transporté... À peine avait-il prononcé ces mots flatteurs, et comme j’allais lui répondre que nous n’avions jamais osé espérer un tel honneur, – tout à coup il tombe à genoux, et avec ces manières si distinguées... Anna Andreïevna, dit-il, ne faites pas mon malheur. Consentez à payer mes sentiments de retour, ou bien la mort va mettre fin à ma vie.
MARIA.
Mais, petite maman, c’est pour moi qu’il a dit cela.
ANNA.
Oui, certainement, c’était pour toi. Je ne dis pas le contraire.
LE GOUVERNEUR.
C’est qu’il nous a fait peur. Il disait qu’il se brûlerait la cervelle. – Je me brûlerai la cervelle, je me brûlerai la cervelle, qu’il disait.
PLUSIEURS PERSONNES DE LA COMPAGNIE.
Vraiment ! Est-il possible !
LE JUGE.
Quel caractère !
LE RECTEUR.
En vérité, c’est la destinée qui a fait cela.
L’ADMINISTRATEUR.
Ne dites donc pas la destinée, petit père. La destinée n’est qu’une dinde. C’est le mérite qui est récompensé.
À part.
Des perles qui tombent aux pourceaux !
LE JUGE.
Dites donc, Anton Antonovitch, je vous vendrai cette petite chienne dont nous étions er marché.
LE GOUVERNEUR.
Merci. J’ai autre chose à penser à votre chienne.
LE JUGE.
Eh bien, si vous n’en voulez pas, faisons affaire pour un autre chien.
LA FEMME DE KOROBKINE.
Ah ! comme je suis contente du bonheur qui vous arrive, Anna Andreïevna. Vous ne pouvez pas vous le figurer.
KOROBKINE.
Et maintenant, où est donc cet hôte illustre ? On m’a dit qu’il était parti pour quelque affaire...
LE GOUVERNEUR.
Oui, il est parti pour un jour, à cause d’une affaire fort importante.
ANNA.
Il est allé chez son oncle, lui demander sa bénédiction.
LE GOUVERNEUR.
Oui, lui demander sa bénédiction ; mais demain pour...
Il éternue.
TOUS, s’écrient à la fois.
À vos souhaits !
LE GOUVERNEUR.
Bien des remerciements ! Mais demain pour sûr il...
Il éternue.
Il reviendra.
TOUS, s’écrient de nouveau.
À vos souhaits !
L’INSPECTEUR.
Bonne santé, monsieur le gouverneur !
BOBTCHINSKI.
Cent ans de vie et un muids de ducats !
DOBTCHINSKI.
Dieu vous en donne quarante quarantaines !
L’ADMINISTRATEUR, à part.
De fièvres quartaines !
LA FEMME DE KOROBKINE, à part.
Le diable te torde le cou !
LE GOUVERNEUR.
Très humbles remerciements. Je vous en souhaite autant à tous.
ANNA.
Nous nous sommes décidés à nous fixer à Pétersbourg. Il y a ici un air !... C’est trop la campagne... J’ai, je l’avoue, une aversion extrême... Voici mon mari... qui va recevoir le grade de général.
LE GOUVERNEUR.
C’est vrai, Messieurs, je l’avoue, le diable m’emporte, mais j’ai fort envie d’être général.
LE RECTEUR.
Dieu fasse que vous le soyez.
ROSTAKOFSKI.
L’homme ne peut rien : Dieu peut tout.
LE JUGE.
Au grand vaisseau, la grande mer.
L’ADMINISTRATEUR.
Le mérite est toujours récompensé.
LE JUGE, à part.
Les poules auront des dents quand tu seras général. Cela lui irait comme des manchettes à un cochon. Tu fais le fanfaron trop tôt. Tu as ton affaire, mais tu n’es pas encore général.
L’ADMINISTRATEUR, à part.
Le voilà général, le diable emporte ! Lui, général, et à quoi bon ! Ce n’est pas l’embarras, il a un aplomb que le diable ne l’emporterait pas volontiers.
Haut, au gouverneur.
Alors, Anton Antonovitch, vous ne nous oublierez pas.
LE JUGE.
S’il arrivait quelque chose, par exemple, une mauvaise affaire, vous nous serviriez de protecteur.
KOROBKINE.
L’année prochaine, je dois envoyer mon fils dans la capitale pour qu’il soit utile au gouvernement. Vous aurez la bonté, n’est-ce pas, de lui accorder votre protection ? Vous servirez de père à ce pauvre orphelin.
LE GOUVERNEUR.
Oui, je vous promets de m’employer pour lui.
ANNA.
Mon Dieu, Antoncha, tu es toujours à faire des promesses. D’abord, tu n’auras pas le temps de penser à cela. Et comment est-ce possible, et à propos de quoi se charger de ces engagements-là ?
LE GOUVERNEUR.
Mais, ma chère, quand c’est possible.
ANNA.
Possible ! possible ! Enfin pourquoi se faire le protecteur de tous les pauvres hères ?...
LA FEMME DE KOROBKINE.
Entendez-vous comme elle nous traite ?
QUELQUES VISITEURS.
Oui, elle a toujours été comme cela. Je la connais bien. Quand elle est à table, elle met ses pieds dans...
Scène VIII
LES MÊMES, LE DIRECTEUR DES POSTES, tout essoufflé, et tenant à la main une lettre décachetée
LE DIRECTEUR.
Quelle étrange aventure, Messieurs. Ce fonctionnaire que nous avons pris pour l’inspecteur général, ce n’était pas l’inspecteur général.
TOUS.
Comment ! ce n’est pas lui !
LE DIRECTEUR.
Pas du tout. Je l’ai appris par cette lettre.
LE GOUVERNEUR.
Qu’est-ce que vous dites ? qu’est-ce que vous dites Quelle lettre ?
LE DIRECTEUR.
Oui, une lettre qu’il a écrite. On n’apporte une lettre pour la poste. Je regarde l’adresse et je vois : À Pétersbourg, rue de la Poste. Je reste stupéfait. Bon, que je me dis, il a trouvé quelque chose à dire dans le service, et il en prévient l’autorité supérieure. – Je la prends et je la décachette...
LE GOUVERNEUR.
Comment ! vous...
LE DIRECTEUR.
Moi-même, je ne sais pas comment j’ai fait. C’est une force surnaturelle qui m’a soutenu. J’allais faire partir une estafette pour la porter... mais la curiosité s’était emparée de moi à un point que je n’ai jamais rien senti de pareil. Impossible, impossible, cela ne se peut pas, mais une tentation, une démangeaison... Il me semblait entendre une voix dans une oreille : – Ne décachette pas ! tu te perds. Tu es flambé. Dans l’autre oreille, je ne sais quel diable me souffle : Décachette, décachette, décachette ! Si bien qu’en touchant la cire... je sentais du feu dans mes veines... et en décachetant, de la glace, oui, de la glace. Mes mains tremblaient et tout se brouillait à mes yeux.
LE GOUVERNEUR.
Comment avez-vous bien eu l’audace de décacheter la lettre d’un personnage si puissant !
LE DIRECTEUR.
Eh ! le bon, c’est qu’il n’est pas puissant, et que ce n’est pas un personnage.
LE GOUVERNEUR.
Et qu’est-ce donc à votre compte ?
LE DIRECTEUR.
Ma foi, ni ceci ni cela. Le diable sait qui c’est.
LE GOUVERNEUR, avec emportement.
Comment ! ni ceci ni cela. Osez-vous bien l’appeler ceci et cela, et le diable sait qui ! Je vais vous faire arrêter.
LE DIRECTEUR.
Vous ?
LE GOUVERNEUR.
Oui, moi.
LE DIRECTEUR.
De la douceur.
LE GOUVERNEUR.
Savez-vous bien qu’il va épouser ma fille, que je vais être un grand personnage, et que je puis vous envoyer en Sibérie...
LE DIRECTEUR.
Oh ! la Sibérie ! Anton Antonovitch ! C’est loin, la Sibérie. Écoutez ce que je vais vous lire, cela vaut mieux. Messieurs, permettez-moi de vous lire cette lettre.
TOUS.
Lisez, lisez.
LE DIRECTEUR, lisant.
« Je me hâte de te faire part, mon cher Triapitchkine, des étranges aventures qui m’arrivent. En route, je fus tondu rasibus par un capitaine d’infanterie, si bien que le maître d’hôtel, faute d’argent, voulait me faire mettre en prison, quand, à ma physionomie pétersbourgeoise et à mon costume, toute la ville m’a pris pour un intendant général en tournée. Si bien que me voilà installé chez le gouverneur ; on est aux petits soins pour moi, et je fais la cour à mort à sa femme et à sa fille. Seulement, je suis indécis pour savoir par laquelle je commencerai. Je crois que ce sera par la maman, car elle paraît toute prête à out. Te rappelles-tu nos infortunes, comment nous dînions à l’œil, et comment une fois un pâtissier me prit au collet à l’occasion de certains petits pâtés que nous avions mangés au compte du roi de Prusse. Cette fois, l’aventure tourne tout différemment. C’est à qui me prêtera l’argent qu’il me faut. Ce sont de drôles d’originaux. Ils te feraient mourir de rire. Tu écris des articles. Voici des portraits à ton service. D’abord le gouverneur : bête comme un âne gris...
LE GOUVERNEUR.
C’est impossible. Il n’y a pas cela.
LE DIRECTEUR.
Lisez vous-même...
LE GOUVERNEUR, lisant.
« Comme un âne gris... » C’est impossible ; c’est vous qui avez écrit cela.
LE DIRECTEUR.
Qui, moi, écrire cela !
L’ADMINISTRATEUR.
Lisez.
LE RECTEUR.
Lisez.
LE DIRECTEUR, lisant.
« Le gouverneur... bête comme un âne gris... »
LE GOUVERNEUR.
Le diable l’emporte, il faut encore qu’il recommence. Comme si c’était nécessaire !
LE DIRECTEUR, lisant.
Hum... hum... hum... « Âne gris. Le directeur des postes est un brave homme... » Ah ! il s’exprime d’une manière assez inconvenante sur mon compte.
LE GOUVERNEUR.
Lisez toujours.
LE DIRECTEUR.
Heuh ! À quoi bon ?
LE GOUVERNEUR.
Mais, le diable emporte ! quand on lit, on lit. Lisez tout.
L’ADMINISTRATEUR, prenant la lettre.
Permettez que je continue.
Il met ses lunettes et lit.
« Le directeur des postes ressemble comme deux gouttes d’eau à Mikheïef, le garçon de bureau. Ce doit être comme lui une canaille qui boit de l’absinthe.
LE DIRECTEUR.
Un polisson, qui mériterait qu’on lui donnât le fouet ! Il n’y a plus rien ?
L’ADMINISTRATEUR, lisant.
« L’administrateur des établissements de bien... » Br... br... br...
KOROBKINE.
Pourquoi vous arrêtez-vous ?
L’ADMINISTRATEUR.
Une écriture illisible... On voit bien que c’est un mauvais sujet.
KOROBKΙΝΕ.
Donnez-moi la lettre. J’ai, je crois, de meilleurs yeux.
L’ADMINISTRATEUR, retenant la lettre.
Non, on peut passer ce passage-là. Le reste se déchiffre mieux.
KOROBKINE.
Non, permettez, je lirai bien...
L’ADMINISTRATEUR.
Et moi aussi, je lirai bien. Plus loin c’est très lisible.
LE DIRECTEUR.
Non, lisez tout. On a déjà lu tout ce qui est avant.
TOUS.
Donnez la lettre, Artemii Philippovitch. Lisez-la, Korobkine.
L’ADMINISTRATEUR, donnant la lettre.
À la bonne heure. Tenez... permettez.
Il met le doigt sur une ligne.
C’est à partir d’ici qu’il faut lire.
LE DIRECTEUR.
Lisez tout ! morbleu ! lisez tout.
KOROBKINE, lisant.
« L’administrateur des établissements de bienfaisance, Zemlianika, est un cochon en bonnet carré. »
L’ADMINISTRATEUR.
Cela n’a pas le sens commun. Un cochon en bonnet carré ! Qui est-ce qui a jamais vu un cochon en bonnet carré !
KOROBKINE, lisant.
« Le recteur du collège empeste l’ail. »
LE RECTEUR.
Mon Dieu ! moi qui ne mange jamais d’ail.
LE JUGE, à part.
Grâce à Dieu, il n’est pas question de moi.
KOROBKINE, lisant.
« Le juge... »
LE JUGE, à part.
Attrape !
Haut.
Messieurs, la lettre a l’air d’être un peu longue, et à mon avis, je trouve qu’il est bien ennuyeux de lire tant de sottises.
LE RECTEUR.
Non, non.
LE DIRECTEUR.
Non, lisez toujours.
KOROBKINE, lisant.
« Le juge Liapkine-Tiapkine est du dernier mauvais ton[7]. » – C’est sans doute quelque mot français.
LE JUGE.
Le diable sait ce qu’il veut dire. C’est bon si cela ne veut dire que polisson. C’est peut-être quelque chose de pire.
KOROBKINE, lisant.
« Au reste tout ce monde est fort accueillant et rempli de bienveillance. Adieu, mon cher Triapitchkine. Je veux, à ton exemple, me mettre dans la littérature. On s’ennuie à la longue, mon brave, et il faut des aliments. Je m’aperçois qu’il faut se lancer dans les choses élevées. Écris-moi dans le gouvernement de Saratof, et là au château de Podkatilofka. »
Il retourne la lettre et lit l’adresse.
« Monsieur M. Ivan Vassilievitch Triapitchkine, Saint-Pétersbourg, rue de la Poste, n° 97, au troisième à droite. »
UNE DAME.
Quelle épigramme inattendue !
LE GOUVERNEUR.
Voilà comme on m’égorge... comme on m’égorge ! Je suis assassiné ! assassiné ! Je ne vois rien. Je ne vois que des groins de cochon au lieu de visages... Il faut le rattraper, le rattraper.
LE DIRECTEUR.
Comment le rattraper ! Et moi qui ai recommandé de lui donner les meilleurs chevaux. C’est le diable qui m’a soufflé cette maudite idée.
LA FEMME DE KOROBKINE.
Voilà vraiment une confusion sans exemple.
LE JUGE.
Et savez-vous, Messieurs, le diable m’emporte, c’est qu’il m’a emprunté trois cents roubles !
L’ADMINISTRATEUR.
Et à moi aussi trois cents roubles.
LE DIRECTEUR.
Hélas ! Et à moi aussi trois cents roubles.
ВОВТСHINSKI.
Et à nous, à Pëtr Ivanovitch et à moi soixante-cinq en billets. Oui.
LE JUGE, se croisant les mains, avec un geste de surprise.
Mais comment, Messieurs, nous sommes-nous laissés refaire comme cela.
LE GOUVERNEUR, se donnant des coups à lui-même.
Et moi, moi ! vieil imbécile ! comment ai-je fait ? Vieux mouton que je suis, je suis devenu bête de vieillesse... Il y a trente ans que je suis fonctionnaire : pas un marchand, pas un fournisseur n’a pu m’attraper. J’ai fait la queue aux plus déliés coquins ; des filous, des gredins si forts qui faisaient aller tout le monde, je les ai joués par-dessous la jambe. J’ai floué trois intendants... des intendants !... C’est quelque chose pourtant que des intendants...
ANNA.
Mais tout cela est impossible, Antoncha. Il est fiancé à la petite...
LE GOUVERNEUR, en fureur.
Fiancé ! Et tu ne vois pas qu’il nous a encore floués ! J’en ai plein le dos de tes fiançailles !
Avec stupéfaction.
Non, venez tous, tout l’univers, toute la chrétienté, venez voir un gouverneur bafoué ! Appelez-le bête ! vieille bête d’escroc.
Il se donne des coups de poing.
Ah ! gros imbécile qui prend un blanc-bec, un moutard pour un homme d’importance ! Et pendant ce temps-là, le voilà, lui, sur la route qui fait sonner ses grelots ! Il va conter l’histoire au monde entier... Je serai la fable, la risée générale, et le pire, c’est que quelque barbouilleur de papier, quelque fainéant d’homme de lettres me mettra en comédie. Ah ! voilà le terrible... Cela ne ménage ni le grade, ni l’emploi, et cela trouve des imbéciles qui montrent les dents et qui applaudissent. De quoi riez-vous ? C’est de vous que vous riez. Ah ! vous...
Frappant du pied.
Ah ! si je tenais tous ces barbouilleurs de papier ! ah ! ces écrivassiers, ces maudits libéraux, cette engeance du diable ! je vous les mettrais tous dans un sac, et je les écraserais en poussière ; au diable ce qui serait dedans.
Il agite les poings et frappe du pied avec fureur. Après un moment de silence.
Je n’en reviens pas encore ! C’est sûr, quand Dieu veut nous punir, il commence par nous faire perdre le bon sens. Mais cet écervelé en quoi ressemblait-il à un inspecteur ? Lui !... comme à un moulin à vent. Et les voilà tous à dire : Un inspecteur général ! un inspecteur général ! Voyons, quel est le premier qui s’est avisé de dire que c’était un inspecteur général. Répondez.
L’ADMINISTRATEUR.
Je veux être pendu si je sais comment cela est arrivé. Nous avons eu la berlue ; c’est le diable qui nous a joués.
LE JUGE.
Qui l’a dit le premier ? Tenez, voici qui l’a dit le premier. Ce sont ces gaillards-là.
Il montre Bobtchinski et Dobtchinski.
BOBTCHINSKI.
Mon Dieu ! mon Dieu ! je ne pensais pas...
DOBTCHINSKI.
Mon Dieu ! moi, je ne l’ai pas...
L’ADMINISTRATEUR.
Enfin, c’est vous.
LE RECTEUR.
Parbleu ! Ils sont accourus comme des fous, sortant de l’hôtel : Il est arrivé, le voilà ! Il ne paye rien !... Un bel oiseau que vous avez déniché.
LE GOUVERNEUR.
Ce devait être vous. Maudits menteurs, vieux colporteurs de commérages !
L’ADMINISTRATEUR.
Que le diable vous emporte avec votre inspecteur général et vos contes à dormir debout !
LE GOUVERNEUR.
Des animaux qui ne font rien que rôder par la ville, ennuyer tout le monde, répandre des mensonges, vieilles pies sans queues !...
LE JUGE.
Maudits barbouilleurs !
LE RECTEUR.
Oisons bridés !
L’ADMINISTRATEUR.
Ânes bâtés !
BOBTCHINSKI.
Eh non ! ce n’est pas moi ; c’est Pëtr Ivanovitch.
DOBTCHINSKI.
Eh non, Pëtr Ivanovitch, c’est vous qui le premier...
BOBTCHINSKI.
Mais non. C’est vous qui l’avez dit le premier.
Scène IX
LES MÊMES, UN GENDARME
LE GENDARME.
Vous êtes prié de vous rendre sur-le-champ chez M. l’inspecteur général qui arrive en mission de Pétersbourg. Il est descendu à l’hôtel.
Ces mots les frappent tous comme un coup de tonnerre. Un cri d’étonnement sort de la bouche de toutes les dames. Tableau général. Tous semblent pétrifiés.
Scène muette.
Au milieu le gouverneur, immobile comme un piquet, les bras étendus et la tête renversée en arrière. À sa droite sa femme et sa fille, se dirigeant vers lui d’un mouvement de tout le corps. Derrière elles, le directeur des postes se tournant vers les spectateurs avec un geste d’interrogation. Derrière lui le recteur, dans l’attitude d’une stupéfaction naïve, et dans la même partie de la scène trois dames qui se groupent ensemble, contemplent avec une expression satirique la situation de la famille du gouverneur. À la gauche du gouverneur Zemlianika, la tête un peu penchée de côté comme s’il écoutait quelque chose. Auprès de lui le juge les bras étendus, touchant presque la terre et faisant un mouvement de lèvres comme s’il sifflait ou prononçait : « Tiens, grand’maman, voici la Saint-George. » Après lui Korobkine tourné vers les spectateurs, fermant un œil et désignant le gouverneur avec une expression de malignité. Du même côté de la scène, Bobtchinski et Dobtchinski les mains étendues l’un vers l’autre, la bouche ouverte et s’entre-regardant les yeux écarquillés. Les autres personnages demeurent immobiles comme des termes. Tout ce groupe pétrifié conserve la même attitude pendant une demi-minute. La toile tombe.
[1] Je traduis par gouverneur le mot gorodnitchii. C’est l’administrateur d’une ville et d’un district. Il réunit des fonctions municipales et politiques, qui répondent à peu près à celle de sous-préfet chez nous.
[2] Dans le russe : à emporter les saintes images. Il y a dans les appartements des images de saints dans un cadre, et les gens pieux ne souffriraient pas qu’on se permit une action indécente devant ces images.
[3] Batouchka, expression familière très usitée dans la conversation, et que l’on emploie sans faire attention au rapport d’âge entre les personnes qui causent ensemble.
[4] La femme d’un sous-officier est nécessairement une personne libre qui ne peut être soumise sans jugement a un châtiment corporel.
[5] Ty ne po tchinou berech, mot à mot : tu ne prends pas selon ton grade. Le grade, tchin, règle les préséances en Russie. On entre dans une salle à manger, on s’assied, po tchinou, selon le grade. J’ai été obligé de changer l’expression et d’en affaiblir l’énergie pour la rendre intelligible au lecteur français.
[6] Abréviation populaire de Saint-Pétersbourg.
[7] Ces mots sont en français dans l’original.