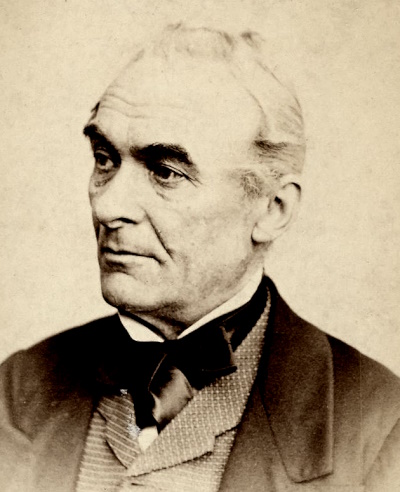Les Deux héritages (Prosper MÉRIMÉE) ou Don Quichotte
Moralité à plusieurs personnages.
Éditée en 1850.
I
Scène première
FÉLIX, seul, assis devant un bureau, et coupant des brochures
Un appartement de garçon élégamment meublé.
Et de trois. Passons à celle-ci. Qu’est-ce qu’elle chante ? Essai... c’est toujours des essais, – sur l’amélioration des races ovines, par J.-B. Kermouton. Que diable cela peut-il être ? Ovines ? Il doit être question d’œufs. Pourtant, monsieur pourrait bien se faire donner des livres plus amusants !... Pour ce qu’il en fait, au reste, c’est bien égal. – Voyons, faisons des cornes ; trois au moins par brochure, c’est la règle. – Ça doit être un bel endroit ; il y a trois points d’admiration. – Encore une ici ; c’est du latin, Dieu me pardonne ! – Et ici, c’est la dernière page. – Voilà qui est fini. Maintenant, rangeons le bureau, mettons en bataille les lettres des ministres, ça fait de l’effet. – Ministère de l’Intérieur, cabinet ; c’est sans doute une invitation à dîner. Ministère des Cultes, ministère de la Marine. – Trois dîners pour sa semaine, c’est gentil... Tout de même, ça donne bon air à un cabinet.
On sonne.
Allons ! voilà la procession qui va commencer comme hier.
Scène II
FÉLIX, MONSIEUR KERMOUTON
MONSIEUR KERMOUTON, entrant.
M. Louis de Saqueville est-il visible ?
FÉLIX.
Non, Monsieur, il vient de sortir. M. le ministre de... de l’Intérieur l’a fait prier de venir causer avec lui.
MONSIEUR KERMOUTON.
Et pourriez-vous me dire quand on serait sûr de le trouver ?
FÉLIX.
Mais, Monsieur, toujours... excepté... Vous le trouveriez plus volontiers sur les midi, une heure.
MONSIEUR KERMOUTON.
Je reviendrai. Vous lui direz que je suis venu. – Kermouton. – Vous vous rappellerez bien mon nom ? Kermouton.
FÉLIX.
Oh ! parfaitement, Monsieur. Je viens de... Monsieur a lu hier au soir un livre de vous. Le voilà, tenez.
MONSIEUR KERMOUTON.
Ah ! c’est vrai. Déjà lu ! Et une marque ! Je voudrais bien savoir pourquoi il a fait une marque ici ?
FÉLIX.
Dame ! Monsieur... monsieur a l’habitude de faire des cornes comme cela aux beaux endroits.
MONSIEUR KERMOUTON.
Je crains que ce passage sur les chèvres ne lui ait paru un peu fort... Je donnerais quelque chose pour savoir ce qu’il en pense... Cela m’effraie. Je crains que cela ne lui ait déplu.
FÉLIX.
Oh ! du tout. Monsieur n’aurait pas fait de marque, dans ce cas.
MONSIEUR KERMOUTON.
Ainsi, vous en êtes bien sûr, M. de Saqueville ne marque que les endroits qui lui plaisent ?
FÉLIX.
Oui, Monsieur.
MONSIEUR KERMOUTON.
Allons ! tant mieux. Vous connaissez bien votre maître, à ce que je vois. Il y a longtemps que vous le servez ? Il travaille beaucoup. Il est bien studieux. C’est étonnant pour un jeune homme et un Parisien.
FÉLIX.
Il passe ses nuits à travailler.
MONSIEUR KERMOUTON.
Il ira loin, oui... Vous lui direz que c’est un de ses amis de Bretagne... Kermouton... de la part de M. le sous-préfet de Morlaix... et vous le remercierez d’avoir bien voulu lire mon Essai... Je regrette de n’avoir pas eu le temps de le faire relier. Vers midi, n’est-ce pas ?
Il sort.
FÉLIX.
Je n’y manquerai pas. Oui, Monsieur.
Seul.
Il est bon là avec ses chèvres ! Ce doit être un électeur. Moi qui le prenais pour un usurier.
Scène III
FÉLIX, JULIETTE
JULIETTE, entrant.
Pas encore levé à l’heure qu’il est ! C’est là ce qui s’appelle une vie !
FÉLIX.
Ah ! c’est vous, Mademoiselle. Nous sommes allés à une réunion de députés qui doivent nous recommander à nos électeurs. Nous avons beaucoup parlé politique, et nous ne sommes rentrés qu’à deux heures du matin ; il a bien fallu encore travailler, selon notre louable habitude... et voilà. Défense d’entrer avant dix heures et demie.
JULIETTE.
Bon à dire à vos électeurs, tout cela ! Je parle que Monsieur a fait la noce quelque part.
FÉLIX.
Mademoiselle Juliette, vous saurez que monsieur, depuis qu’il veut être député, ne fait plus la noce, comme vous dites. Il va devenir un homme public, entendez-vous... D’ailleurs mademoiselle Clémence doit savoir que nous sommes au-dessus des scènes de jalousie. – Qu’est-ce qu’il y a dans cette lettre ?
JULIETTE.
Quelque chose de très pressé.
FÉLIX.
C’est-à-dire une carotte.
JULIETTE.
Malhonnête ! Allons, portez cela ; j’attends après.
FÉLIX.
À dix heures et demie. Je suis esclave de ma consigne.
JULIETTE.
Vous verrez que madame vous fera donner un galop.
FÉLIX.
Elle s’en garderait. Nous sommes gens à ménager, ma petite. Il n’est pas jaloux ; mais, comme il y a trois mois que cela dure, on ne serait peut-être pas fâché d’avoir un prétexte.
JULIETTE.
Farceur ! vous avez trop d’esprit. Allons, Félix, soyez gentil, vous ne vous en repentirez pas. – Si vous voulez savoir la chose, c’est un châle superbe, une occasion magnifique...
FÉLIX.
Connu ! J’en sais une meilleure et à meilleur marché.
JULIETTE.
Taisez-vous. Madame fera bien les choses, si vous nous aidez.
FÉLIX.
La robe de satin que je lui ai portée l’autre jour ne m’a pas valu grand’chose.
JULIETTE.
Dame ! mon garçon, les eaux étaient basses ; c’était le 28. Fallait venir le 1er du mois. – Écoutez, voici l’affaire. C’est un châle qu’on nous donne, et, comme monsieur pourrait le remarquer...
FÉLIX.
Nous voulons faire la frime de l’acheter, afin d’avoir le châle et l’argent.
JULIETTE.
Eh bien ! oui. Qu’avez-vous à dire à cela ?
FÉLIX.
Ah ! les femmes ! les femmes !
JULIETTE.
Et les hommes donc ! – Ah çà ! n’allez pas dire de bêtises, d’abord. Récompense honnête au porteur.
FÉLIX.
Honnête ?
JULIETTE.
Allez, vous êtes pire que nous !
Elle sort.
Scène IV
FÉLIX
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Seul.
Y a-t-il des hommes bêtes ! Donner un cachemire à un rat qui se moque de vous, c’est dans l’ordre ; mais quand on se moque du rat comme de cela !... Bah ! chacun prend son plaisir où il le trouve... Mlle Clémence ! avec cela qu’elle vous a une belle tournure !... Quand on pense qu’il y a tant de pauvres filles, bien gentilles et bien honnêtes, dont on ferait le bonheur pour un morceau de pain !... Ah ! si j’avais de quoi, je ne serais pas embarrassé... Mais voici monsieur.
Scène V
FÉLIX, LOUIS DE SAQUEVILLE
LOUIS DE SAQUEVILLE entrant, en robe de chambre.
Félix ! du thé, un cigare
Il décachette les lettres et parcourt les journaux qui sont sur la table.
Eh bien ! mon oncle est-il arrivé ? – Laisse les enveloppes de ces lettres sur la table, l’adresse en dessus. – Comment se porte-t-il ?
FÉLIX.
Très bien, Monsieur, je vous remercie. Il est arrivé ce matin par la malle de quatre heures et demie. Je l’ai mené à l’hôtel. – M. Kermouton est venu. Je lui ai dit que monsieur était sorti. Il a vu que monsieur avait lu sa brochure. Il a dit qu’il repasserait. – Voici une lettre de la part de mademoiselle...
LOUIS.
Kermouton ? Mais ce doit être un électeur. Tu aurais dû le faire entrer.
FÉLIX.
Comme monsieur m’avait dit...
LOUIS.
Que diable ! il faut connaître les gens !... Kermouton ? C’est cela, le sous-préfet m’en a parlé... Un fabricant ou un propriétaire de Morlaix... Un homme fort riche...
FÉLIX.
Dame ! Monsieur, je ne savais pas.
LOUIS.
Enfin, quand il reviendra...
FÉLIX.
Je lui ai dit que monsieur avait lu sa brochure ; il en a été bien content.
LOUIS.
Quelle brochure ?
FÉLIX, la lui présentant.
Essai sur l’amélioration des races ovines.
LOUIS.
Ah ! – Était-elle coupée ?
FÉLIX.
Et cornée. – C’est mademoiselle Juliette qui vient d’apporter cette lettre de la part de mademoiselle Clémence.
LOUIS, après l’avoir lue.
Oui, je t’en souhaite !... – Eh bien ! tu me parlais de mon oncle ? Tu l’a vu ? Le diable m’emporte si je le reconnaîtrais ! Treize ou quatorze ans en Afrique... Comment est-il ?
FÉLIX.
Mais, Monsieur, c’est un bel homme, de ma taille à peu près, bien hâlé, l’air militaire, une cicatrice sur le front, un képi sur la tête.
LOUIS.
Tu lui as dit que j’étais bien fâché que mon logement fût trop petit pour le recevoir ?
FÉLIX.
Oui, Monsieur. Il croyait d’abord que vous étiez là. – Où est mon neveu ? qu’il a dit ; car, en le voyant descendre en képi de la malle de Marseille, je me suis tout de suite approché : – C’est à monsieur le colonel de Saqueville que j’ai l’honneur de parler ? lui ai-je dit ; je suis le valet de chambre de monsieur son neveu. – Est-il ici ? m’a-t-il demandé d’un air... tout chose.
LOUIS.
Il croyait peut-être que j’allais l’attendre à quatre heures du matin !
FÉLIX.
J’ai cru bien faire. Je lui ai dit : – Monsieur a travaillé toute la nuit ; comme il allait partir pour la poste, Monsieur s’est endormi, et je n’ai pas osé le réveiller.
LOUIS.
Tu as trouvé cela tout seul ?
FÉLIX.
Puis, comme il paraissait avoir envie de venir ici tout de suite, je lui ai fait comprendre qu’il valait mieux aller à l’hôtel, où je lui ai retenu un appartement, se baigner, s’habiller, se reposer. J’ai fait venir un fiacre et j’ai dit : À l’hôtel Chatham. Comme nous étions en route, il m’a appelé pour me dire qu’il voulait passer par la rue de l’Université. J’ai pris la liberté de lui faire observer que ce n’était pas le chemin. – N’importe, a-t-il dit. – J’ai bien vu que c’était son idée ; j’ai dit au cocher qu’on le prenait à l’heure et qu’il aurait pour boire. Pour lors il a fait arrêter devant l’hôtel de madame la marquise de Montrichard. – Ah Dieu ! a-t-il dit, on a détruit le jardin ! – Il n’avait pas l’air de bonne humeur. Il répétait entre ses dents : – Couper ce grand cèdre ! – Puis, tout à coup il m’a dit d’aller à l’hôtel avec son bagage, qu’il allait faire un tour à pied pour voir la ville.
LOUIS.
À cinq heures du matin !
FÉLIX.
Oui, Monsieur. Il a dit aussi qu’il viendrait vous demander à déjeuner vers les onze heures. Quand j’ai eu rangé ses affaires dans l’hôtel, il était plus de huit heures et demie, et le colonel n’était pas encore rentré. Pour lors, j’ai pensé que monsieur pourrait peut-être avoir besoin de moi, et je suis revenu. – On voulait avoir une réponse tout de suite à la lettre de mademoiselle Clémence. J’ai dit que monsieur reposait ; mais...
LOUIS.
Tu as bien fait.
FÉLIX.
En passant par la rue de la Paix, j’ai rencontré mademoiselle... mademoiselle... Pardon, Monsieur, je ne me rappelle pas bien son nom... C’est elle qui est avec M. de Boismorand.
LOUIS.
Virginie ?
FÉLIX.
Justement, Monsieur. Elle m’a remis ; elle m’a appelé et m’a chargé de vous dire mille choses honnêtes, et que vous n’oubliiez pas que vous lui avez promis de la mener à l’Ambigu avec mademoiselle Clémence. Elle va se promener tous les matins aux Tuileries pour sa santé. Ah ! quelle belle toilette elle avait !
LOUIS.
Ça a une santé ! Depuis quand se donne-t-elle ces airs-là ?
FÉLIX.
Je ne sais pas, Monsieur. On se retournait pour voir son châle. Aussi le valet de chambre de M. de Boismorand dit qu’il a coûté gros.
LOUIS.
Boismorand donne des cachemires ?
FÉLIX.
Il paraît, Monsieur. Quand monsieur m’a envoyé chercher mademoiselle Clémence, l’autre jour après le ballet, il y avait deux dames dans les coulisses qui disaient, en voyant passer mademoiselle Virginie, qu’il n’y avait que M. de Boismorand pour faire les choses.
LOUIS.
Ah ! vous écoutez les conversations de ces demoiselles ?
FÉLIX.
Dame ! Monsieur, quand on attend... Le cocher de M. Boismorand était là en perruque, à la porte, avec le coupé pour mademoiselle Virginie. Fallait voir comme les autres demoiselles faisaient cercle pour la voir monter. Il y en avait plus d’une qui enrageait, à ce qu’il me paraissait... Ah ! j’oubliais de remettre à monsieur ce rouleau que M. Villiers lui a envoyé ce matin.
LOUIS.
Voilà la victime du lansquenet la plus ponctuelle !
Il fait sauter le rouleau d’un air pensif.
FÉLIX.
J’ai cru devoir commander à déjeuner pour monsieur votre oncle.
LOUIS.
Il est bien ridicule avec sa Virginie.
FÉLIX.
Je n’ai rien oublié, je pense. Ah ! mademoiselle Juliette a dit que mademoiselle Clémence vous priait de lui envoyer un mot de réponse dès que vous seriez éveillé.
LOUIS.
Que le diable l’emporte ! Donne-moi du papier... Il faut que je me défasse de cette fille-là...
Il écrit.
Tiens, porte ce billet et ce rouleau à Clémence, et dis-lui qu’elle ne s’avise plus... Tu reviendras tout de suite... Ô Athéniens, il en coûte pour mériter vos éloges !
FÉLIX.
Monsieur ?
LOUIS.
Quoi ?
FÉLIX.
Je croyais que monsieur me parlait.
LOUIS.
Non ; c’était Alexandre le Grand qui parlait ainsi en passant le Granique. Il était aussi bête que moi.
On sonne.
FÉLIX.
Monsieur, c’est un monsieur qui demande si vous êtes visible. Il est habillé de noir, et s’appelle Quernet.
LOUIS.
Quernet ? C’est un Breton sans doute, un électeur. Fais entrer.
FÉLIX.
M. Quernet.
Il sort.
Scène VI
LOUIS, MONSIEUR QUERNET
MONSIEUR QUERNET.
Monsieur, je vous demande bien des pardons si je vous dérange... Vous êtes peut-être occupé ?... Je suis marchand de beurre...
LOUIS.
De Bretagne ?... C’est le meilleur beurre du monde, un commerce très important pour le pays ! une branche d’industrie féconde. Veuillez vous asseoir, Monsieur.
MONSIEUR QUERNET.
Oh ! Monsieur, vous êtes trop bon.
LOUIS.
Un commerce qui n’a pas toute l’extension qu’il devrait avoir !
MONSIEUR QUERNET.
C’est vrai, Monsieur. Il y a des gens qui préfèrent l’huile. Passe peut-être pour la friture ; mais, pour les ragoûts, le beurre est souverain.
LOUIS.
Pour moi, je ne puis souffrir l’huile. Je ne vis que de beurre. Celui de Morlaix, c’est le premier de tous, à mon avis.
MONSIEUR QUERNET.
Il y en a qui préfèrent le beurre d’Isigny ; cela dépend des goûts. Moi, j’en ai de Morlaix et d’excellent... Si vous...
LOUIS.
Vous êtes électeur, monsieur Quernet ?
MONSIEUR QUERNET.
Oui, Monsieur, pour vous servir.
LOUIS.
Si j’avais l’honneur de représenter l’arrondissement de Morlaix, je ferais tout pour le beurre. Encourager la production du beurre, c’est non-seulement encourager l’élève des bestiaux, mais encore c’est faire fleurir l’agriculture, c’est populariser l’hygiène publique, si je puis m’exprimer ainsi, car il n’y a pas au monde d’aliment plus sain...
MONSIEUR QUERNET.
C’est la vérité, Monsieur.
LOUIS.
Ce qu’il y a de triste, monsieur Quernet, c’est que des gens qui spéculent sur tout n’ont pas craint de prendre cette branche d’industrie pour en faire l’objet d’indignes... floueries, passez-moi le mot.
MONSIEUR QUERNET.
Monsieur, notre maison est connue...
LOUIS.
Je ne parle pas pour vous, bien entendu, monsieur Quernet ; mais, l’autre jour, je dînais chez le ministre de l’intérieur. Comment, lui dis-je, ne tirez-vous pas votre beurre de Bretagne ! Votre cuisinier vous trompe abominablement. Si vous vouliez, je vous mettrais en rapport avec des négociants dignes de toute votre confiance.
MONSIEUR QUERNET.
Pour cela, Monsieur, cela ne m’étonne pas. Je connais le beurre des ministres, quoique je n’en mange pas, et je n’en voudrais pas manger, Monsieur. Ça se fait avec du rocou qu’on y met pour lui donner de la couleur qui flatte, et puis un tas de saloperies que je n’oserais dire. Mais notre maison est au-dessus de cela. Nous défions les contrefacteurs. Veuillez en essayer, Monsieur ; si c’est du beurre de Bretagne que vous désirez, nous en avons à 30 sous le pot, première qualité.
LOUIS.
Veuillez m’en envoyer cent pots pour essayer. Permettez-moi de m’acquitter tout de suite. Les bons comptes font les bons amis, monsieur Quernet.
Il lui donne de l’argent.
MONSIEUR QUERNET.
Monsieur, c’était inutile ; vous auriez payé en recevant la marchandise, ou à votre commodité.
LOUIS.
Non, non. Moi, je ne connais que les affaires rondement faites. Pour cela, je suis un vrai Breton... quoique je n’aie pas l’honneur d’être né en Bretagne ; mais toute la famille en vient... Tous Bretons bretonnants, monsieur Quernet... Parbleu ! si votre beurre est bon, comme je n’en doute pas, je veux en envoyer à madame de Clairville, la femme du ministre de l’intérieur, pour lui faire honte du sien.
MONSIEUR QUERNET, se levant.
Monsieur, vous êtes trop bon. J’aurai l’honneur d’en envoyer à son hôtel un échantillon de votre part. Veuillez agréer tous mes remerciements. Vous aurez les cent pots dans une heure.
LOUIS.
Oh ! rien ne presse. Monsieur Quernet, dites donc... nous allons avoir une élection disputée. Vous êtes trop bon citoyen pour ne pas aller voter au pays.
MONSIEUR QUERNET.
Au pays ?
LOUIS.
Oui ; vous savez que l’arrondissement de Morlaix va nommer un député.
MONSIEUR QUERNET.
Cela se peut bien ; mais je ne savais pas.
LOUIS.
Comment ! mais c’est dans tous les journaux. Serait-il possible, monsieur Quernet, que vous oubliassiez vos devoirs de citoyen, vos glorieux privilèges d’électeur ?
MONSIEUR QUERNET.
Non, Monsieur ; mais je ne suis pas de Morlaix.
LOUIS.
Comment donc !
MONSIEUR QUERNET.
Je n’y suis jamais ailé de ma vie.
LOUIS.
Mais vous êtes électeur ?
MONSIEUR QUERNET.
Je m’en flatte, monsieur, au septième arrondissement, rue Pavée, 22. Je n’ai jamais manqué d’aller retirer ma carte.
LOUIS.
À Paris ?
MONSIEUR QUERNET.
Oui, Monsieur. Notre établissement est le plus ancien de la capitale, et j’ose dire que mon associé Durand et moi, nous n’avons rien fait pour nous faire perdre la confiance que le public nous accorde. Pour le beurre de Bretagne, le beurre d’Isigny...
LOUIS.
Mais que diable me chantiez-vous de Morlaix et de la Bretagne ?
MONSIEUR QUERNET.
C’est vous, Monsieur, qui m’avez demandé du beurre de Bretagne. Mon devoir est de me conformer au goût des consommateurs. Si vous m’en aviez demandé de Normandie, je vous en aurais fourni d’excellent. Si vous en voulez à demi-sel, beurre fondu...
LOUIS.
Eh ! je n’ai que faire de beurre fondu !
MONSIEUR QUERNET.
Monsieur, je suis bien votre serviteur. Je me recommande toujours à vos bons offices auprès de M. le ministre de l’intérieur et de madame son épouse.
Il sort.
LOUIS.
Il a bien d’autres choses à faire que de penser à votre beurre.
Seul.
Au diable l’imbécile ! Animal de Félix, qui me laisse entrer pareille espèce ! Impossible de lui apprendre à connaître son monde ! Voilà une journée qui commence bien !
À Félix qui rentre.
Ah ! c’est vous ? Depuis quand, je vous prie, ma porte est-elle ouverte pour les marchands de beurre ?
FÉLIX.
Quel marchand de beurre ? C’est monsieur votre oncle que je viens de rencontrer sur l’escalier.
Saqueville entre.
Scène VII
LOUIS, FÉLIX, SAQUEVILLE
LOUIS.
Ah ! mon oncle !
SAQUEVILLE, l’embrassant.
Mon cher Louis ! que je suis heureux de te revoir !
LOUIS.
Vous m’excuserez, mon cher oncle, j’allais courir chez vous, mais Félix m’a dit que vous étiez sorti, à peine installé.
SAQUEVILLE.
Oui, j’ai voulu marcher dans les rues de ce vieux Paris, que je n’avais pas vues depuis si longtemps. Comme tout est changé ! Mais, toi ! que te voilà grand ! J’ai quitté un collégien, et je retrouve un homme. Comme tu ressembles à ta pauvre mère ! Sais-tu qu’il y a près de quatorze ans que je ne t’ai vu ! Quel âge as-tu, dis-moi ?
LOUIS.
Mais... vingt-neuf ans et quelques mois.
SAQUEVILLE.
Vingt-neuf ans ! Il me semble que c’est hier que nous nous sommes quittés. Tu as déjà vingt-neuf ans !
LOUIS.
Je voudrais bien avoir trente ans, pour l’affaire dont je vous ai parlé.
SAQUEVILLE.
Quelle affaire ?
LOUIS.
Eh ! la députation. Il faut avoir trente ans pour être député, de par cette maudite charte, faite par des barbons.
SAQUEVILLE.
Alors, comment diable se fait-il que tu te présentes maintenant à l’élection de Morlaix ?
LOUIS.
Ah ! voici : si je suis nommé, ce sera dans six semaines. J’aurai alors vingt-neuf ans et huit mois. Le préfet et le ministre me feront l’amitié de mettre beaucoup de négligence à envoyer à la chambre le procès-verbal de l’élection, si bien que le rapport n’en sera fait qu’au bout de six semaines ou deux mois. Il faudra bien produire mon acte de naissance ; alors l’élection sera cassée. On recommencera au bout de six semaines, c’est-à-dire quand j’aurai vingt-neuf ans et onze mois. On me renomme ; on lambine encore, les pièces n’arrivent à la chambre qu’au bout de six semaines ; alors j’ai trente ans et quelques jours. Le vice de l’élection est couvert. Nous avons des précédents décisifs.
SAQUEVILLE.
Fort bien ; mais si un électeur de Morlaix te demande : Quel âge avez-vous ? que lui répondras-tu ?
LOUIS.
Que je n’ai pas mon acte de naissance sur moi, et qu’il aille en chercher un extrait à Paris, à la mairie du 1er arrondissement.
SAQUEVILLE.
Je n’aime point cela. Au fond, c’est se moquer de la loi et des électeurs.
LOUIS.
Bah ! mon cher oncle. Est-ce que les électeurs n’ont pas été faits pour qu’on se moque d’eux ! Défaites-vous donc de votre puritanisme. Nous vivons sous un régime constitutionnel, et nous savons remédier aux lois bêtes par d’innocents subterfuges. M. Pitt a bien été nommé avant d’être majeur.
SAQUEVILLE.
M. Pitt était M. Pitt... Mon cher enfant, je suis fâché de te voir embarquer dans la politique, surtout de t’y voir débuter de la sorte. Ton père refusa la place de conseiller d’État que l’empereur voulait lui donner, uniquement parce que...
LOUIS.
Oui, cela se faisait de son temps, mon cher oncle. Autre temps, autres mœurs. Il faudra que nous vous formions, à ce que je vois. – Félix, vite à déjeuner. Vous excuserez ma cuisine, mon oncle ; je ne connais pas encore vos habitudes...
Ils s’assoient à une table.
SAQUEVILLE.
Tout est bon pour moi. Je ne sais jamais ce que je mange.
LOUIS.
Je vous permets de ne pas le savoir aujourd’hui, car je n’ai pas eu le temps de faire un menu qui mérite du recueillement. – Attendez, ceci demande à être mangé avec un peu de sauce anglaise. Félix !... – Ah çà ! nous avons un nouveau ministre de la guerre. J’espère bien qu’il pense à vous.
SAQUEVILLE.
Il y pense si bien, qu’il m’a envoyé, courrier par courrier, le congé que je lui demandais.
LOUIS.
Belle grâce, ma foi ! après douze ou treize ans de campagnes continuelles. Mais je vous conseille de lui serrer le bouton... Et moi, je sais bien par où le prendre.
SAQUEVILLE.
Pourquoi faire ?
LOUIS.
Il faut que vous soyez général.
SAQUEVILLE.
Général ? Oh ! pas encore. Et Robineau et Molinos, qui sont mes anciens.
LOUIS.
Qu’est-ce que cela fait ? Est-ce qu’ils sont du bois dont nous faisons des maréchaux ? – Molinos ? N’est-ce pas lui que vous avez dégagé si vigoureusement à la bataille d’Isly ?
SAQUEVILLE.
Il s’y est couvert de gloire. Il a été admirable !
LOUIS.
On dit que sans vous il était perdu.
SAQUEVILLE.
C’est possible ; mais il avait fait la plus rude besogne, et il est bien juste qu’il en soit récompensé. D’ailleurs, moi, je ne demande rien... J’ai toujours été heureux en tout... à la guerre. Je suis arrivé en Afrique lieutenant, et je reviens colonel. Combien de braves gens y ont laissé leurs bras ou leurs jambes ! Avec le temps, je serai général ; je le sais ; mais j’aurais honte de l’être avant mon tour. Au reste, peut-être bien, ceci soit dit entre nous, peut-être bien vais-je pendre l’épée au croc. Sais-tu ce qui m’arrive ?
LOUIS.
Non.
SAQUEVILLE.
Tu connaissais notre vieille cousine de Ponthieu ?
LOUIS.
Oui, une vieille dévote qui s’était brouillée avec ma mère, je ne sais pourquoi. Je lui ai écrit dernièrement, elle ne m’a pas répondu... Cependant c’était pour lui faire mon compliment de condoléance sur la mort de son fils.
SAQUEVILLE.
Elle est morte. Ce fils est mort quelques mois avant elle, comme tu sais... Un charmant garçon, qui a servi dans mon régiment. J’allais souvent autrefois, quand j’avais ton âge, chasser chez Mme de Ponthieu. Je lui ai tué je ne sais combien de lièvres et de perdreaux. Et puis, le soir, comme elle n’y voyait guère, je lui lisais quelquefois le journal.
LOUIS.
Elle était énormément riche.
SAQUEVILLE.
Je ne m’en inquiétais pas plus que toi ; mais je disais à son fils qu’il avait une trop faible santé pour être spahi. Le brave garçon ne voulait pas me croire... Toujours il était le premier à toutes nos expéditions. Enfin la fièvre l’a pris ; je l’ai fait partir pour la France, et, au bout d’un an, il est mort poitrinaire, m’a-t-on dit.
LOUIS.
Eh bien ?
SAQUEVILLE.
Eh bien ! la vieille cousine de Ponthieu s’est souvenue, je pense, du journal que je lui lisais et des soins que j’avais pour son fils. En arrivant à Alger, à mon retour du Maroc, j’ai appris qu’elle était morte, et elle m’a tout laissé.
LOUIS.
Mon Dieu ! ma mère était plus proche cependant... Quel bonheur pour vous, mon oncle !... Je m’en réjouis... excessivement.
SAQUEVILLE.
À quoi tiennent les choses ! Jamais je ne lui ai écrit. Tu sais que je n’écris guère, mon garçon. Après la bataille d’Isly, j’avais attrapé un beau sabre maroquin. Je pensai à ce pauvre Ponthieu, qui recherchait partout des armes curieuses. Je le croyais rétabli. Je lui envoyai ce sabre, avec deux lignes pour lui dire combien nous avions regretté tous qu’il n’eût pas été à la fête. Il était mort, et c’est sa mère qui a reçu le sabre, au bout de je ne sais combien de temps. Probablement, c’est cela qui l’aura fait penser à moi... Mais qu’as-tu donc à me regarder ainsi ? On dirait que tu me respectes davantage. Tu as raison, mon cher Louis. Un oncle riche n’est bon qu’à servir de caissier à son coquin de neveu. Je ne veux pas le céder aux oncles d’Amérique. Voyons, es-tu un mauvais sujet ? As-tu des dettes ? Tu dois en avoir, vaurien. Avec d’aussi bons déjeuners que les tiens, on en fait.
LOUIS.
Non, mon oncle. Je suis assez rangé pour une personne de mon âge et de mon sexe... Je mange mon petit revenu... en herbe souvent... voilà tout.
SAQUEVILLE.
Fort bien ; mais tu dois aimer les beaux chevaux... et peut-être les jolies femmes, coquin ?
LOUIS.
Modérément. Quant aux chevaux, depuis que j’ai vu mon meilleur ami, du Clinquant, se rompre l’épine dorsale en sautant une haie, j’ai renoncé à l’équitation... Pour les femmes, j’ai bien eu mes faiblesses autrefois, quand j’étais jeune ; mais, depuis que j’aspire à entrer dans la carrière politique, je veux faire une fin, et je songe à me marier.
SAQUEVILLE.
C’est-à-dire que tu es amoureux. Bravo !
LOUIS.
Oui. Les choses sont assez avancées. Je pense que le mariage se fera. Du moins on me donne les plus grandes espérances...
SAQUEVILLE.
Elle est jolie, ma nièce future ?
LOUIS.
Assez. Elle est riche... spirituelle... elle a je ne sais combien de talents. Sa famille est bonne... vieille noblesse... elle a de l’influence... Mais vous la connaissez, j’en suis sûr : Mlle de Montrichard ?
SAQUEVILLE.
Julie ! mais c’est un enfant.
LOUIS.
Un enfant de dix-neuf à vingt ans. C’est vrai que sa mère a encore l’air jeune. C’est une femme distinguée, Mme de Montrichard ; elle est remplie de bontés pour moi, et me sert vraiment avec une ardeur étonnante dans mes petites intrigues électorales. Vous la voyiez beaucoup autrefois ?...
SAQUEVILLE, troublé.
Oui.
LOUIS.
N’est-ce pas que c’est une femme... supérieure ?
SAQUEVILLE.
Oui.
LOUIS.
D’un vrai mérite ; elle fait des livres...
SAQUEVILLE.
Des livres ?
LOUIS.
Oui, couronnés par l’Académie française.
SAQUEVILLE.
Et sur quel sujet ?
LOUIS.
Oh ! des livres très remarquables... sur les femmes... le monde, la religion, l’avenir... les Pères de l’Église... Il y a de tout, et un style élevé... On dit que Sévin les retouche, mais je ne le crois pas.
SAQUEVILLE.
Sévin ?
LOUIS.
Sa fille a un caractère charmant... point trop sérieux... admirablement élevée.
SAQUEVILLE.
Ce doit être un ange. A-t-elle toujours ses beaux cheveux blonds comme de l’or ?
LOUIS.
Blonds ? Oui... c’est-à-dire châtains, châtain clair.
SAQUEVILLE.
Des yeux bleus comme le ciel ?
LOUIS.
Oui, je crois.
SAQUEVILLE.
Comment, je crois ?
LOUIS.
On ne sait jamais la couleur des yeux d’une demoiselle. Somme toute, elle est très agréable ; elle se met à merveille. Toujours un choix de couleurs irréprochable. C’est fâcheux qu’elle soit en deuil maintenant. Vous savez que le vieux marquis est mort ; ce n’est pas grande perte.
SAQUEVILLE.
Non.
LOUIS.
Mon oncle, ma cousine de Ponthieu avait une terre près de Morlaix !
SAQUEVILLE.
C’est possible.
LOUIS.
J’en suis sûr. Il faut que les fermiers votent pour nous.
SAQUEVILLE.
Te voilà donc devenu tout à fait un homme politique ?
LOUIS.
Vous voyez. Mais, parlez-leur de leurs baux... Il y a moyen de les prendre... les Bretons tiennent à l’argent.
SAQUEVILLE.
Ah ! je ne me mêle pas de cela... Franchement, mon ami, je t’aimais mieux attaché d’ambassade. Pourquoi diable as-tu quitté la diplomatie ?
LOUIS.
Moi, je ne l’ai pas quittée ; mais on n’avance pas. Aujourd’hui il faut être député pour devenir quelque chose dans la carrière. Il faut se faire craindre pour que les ministres pensent à vous.
SAQUEVILLE.
Je croyais... tu m’avais dit que le ministre appuyait ton élection ?
LOUIS.
Assurément.
SAQUEVILLE.
Alors il ne sait pas que tu veux l’exploiter.
LOUIS.
Au contraire, c’est le ministre qui croit m’exploiter, s’il faut se servir de ce terme peu parlementaire. Je lui laisse croire tout ce qui lui plaît ; mais, une fois à la chambre, il faudra bien qu’il compte avec moi. D’ailleurs, mon but c’est surtout d’être député... pour être député. Cela vous pose. Dans le monde, pour être bien, sans être député, il faut avoir trop d’esprit. Je serai très prudent, très réservé... aurai toujours ma garde à carreau. À Morlaix, je ne suis pas mal avec l’opposition... Je leur donne de l’espoir pour le sel et la morue... Mais qu’avez-vous, mon oncle ? vous êtes tout rêveur.
SAQUEVILLE.
Comme te voilà savant ! Tu as donc étudié toutes ces questions-là ? Moi je veux mourir, si j’entends quelque chose au sel et à la morue.
LOUIS.
Il faut bien travailler sur toutes ces matières. Voyez-vous, mon oncle, dans un grand pays comme celui-ci... le sel... c’est très important... Tenez, ce tas de brochures... je les ai toutes lues et annotées... Ah ! je m’y suis mis tout entier.
SAQUEVILLE.
À la bonne heure ; mais un amour et une candida. ture sur les bras tout à la fois... comment fais-tu pour mener tout cela de front ?
LOUIS.
L’intrigue électorale le matin... les soupirs le soir.
FÉLIX, bas à Louis.
Monsieur.
LOUIS.
Qu’y a-t-il ?
FÉLIX, de même.
Mlle Clémence est là, qui veut entrer.
LOUIS.
Dis-lui que je suis occupé... que je suis avec mon oncle.
SAQUEVILLE.
Est-ce un électeur ? Reçois-le.
LOUIS.
Non, mon oncle... Tenez... je ne sais pas pourquoi je ferais du mystère avec un saphi. C’est un rat, un simple rat, qui me favorise quelquefois de ses visites.
SAQUEVILLE.
Diable ! autre occupation.
LOUIS.
Que voulez-vous ? Cela a toujours des affaires avec la direction des beaux-arts. Il faut protéger cela, et cela est reconnaissant. Oh ! elle n’est point gênante... C’est commode, parce qu’on ne perd pas de temps avec elle comme avec les femmes du monde. Économie de temps, voyez-vous. – Voulez-vous que je vous la présente ?
SAQUEVILLE.
Volontiers.
LOUIS, à Félix.
Dis-lui qu’on lui permet d’entrer.
Scène VIII
LOUIS, FÉLIX, SAQUEVILLE, CLÉMENCE
CLÉMENCE, entrant et montrant son châle.
Voyez-vous ?
LOUIS.
Mon oncle, permettez-moi... Ne vous levez donc pas... Permettez-moi de vous présenter Mlle Clémence, artiste choragique, qui a créé le rôle de la vivandière dans le Philtre. Vous verrez cela.
SAQUEVILLE.
Je m’en fais une fête.
LOUIS.
Allons, Mademoiselle, faites la révérence... saluez monsieur le colonel et allez lui chercher des cigares dans la boîte que vous savez. On veut bien vous autoriser à en prendre un pour vous.
SAQUEVILLE.
Mademoiselle fume ?
CLÉMENCE, présentant des cigares.
Oui, Monsieur. Veuillez prendre celui-ci, Monsieur, il est tiqueté de blanc, ce sont les meilleurs, je m’y connais. Voulez-vous vous allumer ?
Elle lui donne une allumette.
SAQUEVILLE.
Après vous, Mademoiselle.
LOUIS.
Ma foi, mon oncle, convenez que, dans le désert, vous ne seriez pas fâché de rencontrer de temps en temps des bayadères aussi bien ficelées pour vous allumer la pipe.
SAQUEVILLE.
Assurément ; mais ne crois pas que les amateurs manquent de rien en Afrique.
CLÉMENCE.
Monsieur le colonel vient d’Alger ? C’est sûrement à monsieur le colonel de Saqueville que j’ai l’honneur de parler, dont il est tant question dans les bulletins ?
SAQUEVILLE.
Comment ! vous lisez les bulletins, Mademoiselle ? Je croyais que vous ne lisiez que les feuilletons.
CLÉMENCE.
Oh ! Monsieur, j’aime beaucoup la lecture. Et puis tout ce qui touche à la gloire du pays... J’ai le cœur français. D’ailleurs, j’ai des amis en Afrique. Vous devez connaître Alfred Demontel ?
SAQUEVILLE.
Il était lieutenant au 4e de chasseurs, je crois.
CLÉMENCE.
Oui, Monsieur, un joli militaire, avec une petite moustache retroussée, à la hongroise ; toujours un lorgnon dans l’œil. Comment se porte-t-il ?
SAQUEVILLE.
Mal. Il a été tué d’une balle à la tempe, auprès de Tlemcen.
CLÉMENCE.
Ah ! mon Dieu ! que cela me fait de peine ! un si aimable jeune homme ! Il devait m’envoyer des oranges et des écharpes brodées de Tunis. Moi qui comptais là-dessus pour mon hiver !
SAQUEVILLE.
Je ne sache pas qu’il ait fait de testament.
CLÉMENCE.
Et M. Daumas, le sous-intendant militaire, le connaissez-vous ? Vous a-t-il parlé de moi ?
SAQUEVILLE.
Non. – Louis, je te dis adieu. Tu viendras me prendre pour dîner, si tu n’as pas un dîner d’électeurs.
LOUIS.
Comment ! vous vous en allez, mon oncle ?... Voulez-vous que je la renvoie ?
SAQUEVILLE.
Non. Cette voiture m’a fatigué : j’ai besoin de marcher.
LOUIS.
Eh bien ! faisons ensemble un tour de promenade. Permettez-moi de passer une redingote, et je suis à vous.
Il sort.
CLÉMENCE.
Oserai-je vous demander du feu... Je suis éteinte.
SAQUEVILLE.
Vous fumez comme un Turc, Mademoiselle.
CLÉMENCE.
L’habitude du monde... D’abord cela me rendait malade, maintenant cela ne me fait plus rien. – Il y a longtemps, Monsieur, que je désirais voir un officier qui connût l’Afrique aussi bien que vous. Me permettrez-vous, colonel, de vous faire une question... de vous demander un renseignement ?
SAQUEVILLE.
Je suis à vos ordres.
CLÉMENCE.
C’est que je crains d’abuser de votre complaisance... Monsieur, je ne vous apprends rien, sans doute, en vous disant... que je suis avec votre neveu...
SAQUEVILLE.
Il est vrai. Je m’en étais douté.
CLÉMENCE.
Je l’aime beaucoup... mais malheureusement il est bien froid... Il ne comprend pas le caractère de mon affection... D’ailleurs, il songe à se marier... Il va se marier... Alors je serai bien malheureuse. Mes camarades se moqueront de moi, et vous comprenez que le séjour de Paris me sera insupportable. J’ai quelque idée d’aller en Afrique pour me distraire. Je pense que peut-être, par la protection de M. Daumas, je pourrais entrer au grand théâtre d’Alger.
SAQUEVILLE.
Le théâtre d’Alger sera trop heureux de vous avoir.
CLÉMENCE.
Oh ! Monsieur, ce sera une pauvre acquisition. Cependant, outre ma danse, j’ai un peu de déclamation. J’ai joué les ingénues à Chantereine, et l’on m’a accueillie avec quelque bienveillance. Outre cela, colonel, j’ai mon plan à moi. M. Sharper, le grand banquier de Londres, qui a été mon premier protecteur, et, je puis le dire, un second père, Monsieur... il ne me refuserait pas un petit capital pour m’établir là-bas. D’ailleurs, j’ai mes petites économies... oh ! bien petites... et je pense à les placer en Afrique, où l’argent rapporte beaucoup, m’a-t-on dit. On m’a assuré qu’une maison garnie, bien tenue, à Alger, donnerait de bons bénéf.ces. Peut-être pourrai-je en acheter une et loger des officiers.
SAQUEVILLE.
Vous ne manquerez pas de locataires, Mademoiselle.
CLÉMENCE.
Vous riez, Monsieur, c’est fort mal. Voyez-vous, je suis une pauvre fille qui n’aspire qu’à sortir de la fausse position où des malheurs de famille m’ont jetée. Je me sens des dispositions pour le commerce, et je me dis comme cela que je pourrais faire peut-être ma fortune en Algérie.
SAQUEVILLE.
Vous avez plus d’une corde à votre arc, à ce que je vois.
CLÉMENCE.
Ce qu’il me faudrait, c’est un peu de protection. Si Monsieur le colonel de Saqueville daignait me recommander à ses amis, je suis sûre qu’on accueillerait avec faveur la protégée d’un des vainqueurs d’Isly.
SAQUEVILLE.
Mademoiselle, je ne suis pas un vainqueur, mais je serais charmé de vous savoir en Afrique. S’il ne vous faut que des recommandations et un peu d’argent pour vous y établir, disposez de moi.
CLÉMENCE.
Oh ! Monsieur, que vous êtes bon ! Que je voudrais être un jour à même de vous témoigner ma vive reconnaissance !
Elle lui serre les mains.
LOUIS, entrant.
Eh bien, ne vous gênez pas. Laissez donc vos femmes seules avec un spahi !
CLÉMENCE.
Ah ! Louis, vous ne vous figurez pas comme votre oncle est bon.
LOUIS.
Au contraire, je me le figure très bien, et j’en suis fort jaloux. Mademoiselle, vous allez me faire le plaisir d’aller à votre répétition voir si j’y suis.
CLÉMENCE.
Allez, vous devriez bien apprendre de votre oncle à être aimable.
LOUIS.
Mon oncle, je suis à vous.
À Félix qui entre.
Je n’y suis pour personne.
FÉLIX.
Monsieur, c’est ce monsieur que vous m’avez dit, M. Kermouton, qui est revenu.
LOUIS.
Mon oncle, c’est un électeur influent... un homme très riche. Il est déjà venu ce matin. Permettez-moi de lui dire un seul mot, rien qu’un seul.
SAQUEVILLE.
J’attendrai...
Bas.
Mais ce bel objet ? Les électeurs aiment la morale.
Scène IX
LOUIS, FÉLIX, SAQUEVILLE, CLÉMENCE, MONSIEUR KERMOUTON
LOUIS, bas à Saqueville.
Est-ce qu’ils reconnaissent un rat sous un cachemire ?
À M. Kermouton, qui entre.
Mon cher monsieur de Kermouton, je suis si heureux de vous voir ! notre ami commun, M. le sous-préfet de Morlaix, m’avait annoncé votre visite ; si j’avais su votre adresse, je l’aurais prévenue. Eh bien, nos petites affaires électorales, comment vont-elles ?
MONSIEUR KERMOUTON.
À merveille, Monsieur. Je désirais avoir l’honneur de vous entretenir un moment d’une petite affaire où M. le sous-préfet dit que vous pouvez m’être fort utile.
LOUIS.
Disposez de moi, Monsieur.
MONSIEUR KERMOUTON.
Mais vous êtes en affaires et en agréable compagnie... Je vous dérange... je repasserai.
LOUIS.
Nullement, Monsieur, nous allions sortir... mais... C’est mon oncle le colonel de Saqueville.
MONSIEUR KERMOUTON.
Ah ! M. le colonel de Saqueville, qui a fait cette charge décisive à Isly. Très humble serviteur.
Bas Louis.
C’est sa dame ? Elle fume ? On m’avait bien dit que c’était l’usage en Algérie.
LOUIS, bas.
Excusez un spahi revenant du désert.
MONSIEUR KERMOUTON.
Ah ! fort bien ! j’entends. – Monsieur, vous avez pris la peine de lire ma petite brochure... Excusez un provincial étranger aux lettres...
LOUIS.
Je l’ai lue avec infiniment de plaisir.
MONSIEUR KERMOUTON.
Veuillez m’en dire votre opinion... là, bien franchement.
LOUIS.
D’honneur, elle est parfaite. Pas un mot à y changer.
MONSIEUR KERMOUTON.
Cependant vous y avez fait des notes... J’ai mes espions, Monsieur.
LOUIS.
Ah ! oui, c’est vrai... un passage que je voulais montrer au ministre de l’Intérieur.
MONSIEUR KERMOUTON.
C’est-à-dire au ministre du commerce. Les races ovines...
LOUIS.
C’est ce que voulais dire.
MONSIEUR KERMOUTON.
Mais les chèvres ?... les chèvres... là ?
LOUIS.
Les chèvres ?...
MONSIEUR KERMOUTON.
Oui ; je crains que la mesure ne vous ait paru hardie.
LOUIS.
Hardie ?... Peut-être... Mais il y a des cas...
MONSIEUR KERMOUTON.
Oh ! Monsieur, je prévois ce que vous allez me dire... Mais permettez-moi de vous demander si vous voulez avoir des bois ?
LOUIS.
Des bois ? – Oui, j’aimerais assez à en avoir.
MONSIEUR KERMOUTON.
Monsieur, elles vous mangeront tout.
LOUIS.
C’est juste : c’est une bête si vorace !
MONSIEUR KERMOUTON.
Tout, Monsieur !
LOUIS.
En effet, mon oncle me parlait à l’instant de tout ce qu’elles mangent en Algérie. Elles empêchent la colonisation... Mais cette affaire, Monsieur, dont vous vouliez me parler...
MONSIEUR KERMOUTON.
Monsieur, il y a des lais de mer le long d’une petite terre que j’ai à l’embouchure de notre rivière, j’y fais des clayonnages qui me coûtent peu, et je gagne des prairies qui me rapportent beaucoup.
LOUIS.
Bravo !
MONSIEUR KERMOUTON.
Dans ces prairies j’ai mis des moutons du Lancashire, que j’ai fait venir avec de grands risques, car ces maudits Anglais ne veulent pas les laisser sortir de chez eux : peine de sept ans de transportation pour chaque mouton exporté.
LOUIS.
C’est odieux !
MONSIEUR KERMOUTON.
Il m’en a coûté deux cents livres sterling à un smuggler pour les emmener chez moi ; mais je ne plains pas l’argent qu’ils m’ont coûté. Leur laine, Monsieur, c’est la toison d’or ! Je la vends ce que je veux. Bref, mon industrie prospère ; mes prairies s’étendent, mes moutons se multiplient... La viande est excellente, vrai Présalé ! On vient de partout m’acheter leur laine. L’année dernière, on m’offrait cinq cent mille francs de mes prairies, sans les moutons. J’ai refusé, car j’aime à faire fleurir l’agriculture, et puis je crois servir mon pays.
LOUIS.
L’agriculture est le premier des arts.
MONSIEUR KERMOUTON.
J’ai aussi introduit des vaches suisses, qui paraissent des éléphants auprès de nos bretonnes. J’ai une petite manufacture de fromages de Hollande qui rapporte assez, à cause du commerce maritime.
LOUIS.
Vous avez de tout.
MONSIEUR KERMOUTON.
Un peu de tout. La fromagerie commence ; cependant, j’en ai refusé cent quatre-vingt mille francs.
LOUIS.
Vous devez avoir des fermiers électeurs ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Quelques-uns, Monsieur, à vos ordres. Vous verrez... J’ai encore une petite tannerie... et puis je pense aux ouvriers. Je fais bâtir à Morlaix quelques maisons à l’instar de Paris, que je loue assez bien.
LOUIS.
Propriétaire, agriculteur, fabricant...
MONSIEUR KERMOUTON.
Que voulez-vous, Monsieur ? je suis soutenu dans la tâche que je me suis imposée par l’idée que je suis utile à ma ville natale, à mon département, à mon pays.
LOUIS.
Qui en doute ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Eh bien ! Monsieur, voilà ce que je tenais à vous dire... Vous comprenez...
LOUIS.
Mais en quoi pourrais-je... ?
MONSIEUR KERMOUTON, après un silence.
Monsieur, ma femme a la fantaisie de faire faire mon portrait pour servir de pendant à celui de son frère, lieutenant de vaisseau ; mais ce ne sera jamais un vrai pendant.
LOUIS.
Comment ! à cause de l’uniforme ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Oh ! l’uniforme ne serait rien, je suis capitaine dans la garde nationale... mais mon beau-frère est décoré... et...
Il montre sa boutonnière.
LOUIS.
Comment ! Monsieur, vous n’êtes pas décoré !...
MONSIEUR KERMOUTON.
Non, Monsieur.
LOUIS.
Mais c’est une horreur ! Mais le ministre ne sait donc pas ce que vous avez fait pour votre pays ! Un grand citoyen qui n’est pas décoré !
MONSIEUR KERMOUTON.
C’est à cause de ce portrait, surtout... et cela m’a toujours fait retarder...
LOUIS.
Que voulez-vous ? les ministres ne savent rien. Je ne sais à quoi pensent les préfets ! Mais tout peut se réparer : permettez-moi de parler au ministre de l’intérieur...
MONSIEUR KERMOUTON.
Du commerce.
LOUIS.
Sans doute, du commerce. Je le connais, il a de la bienveillance pour moi. Je lui porterai votre brochure.
MONSIEUR KERMOUTON.
Je lui en ai envoyé un exemplaire, avec une pétition.
LOUIS.
Il n’a le temps de rien lire, mais je lui en ferai l’analyse. Je lui parlerai des bois et des chèvres, et il faudra bien...
MONSIEUR KERMOUTON.
Oh ! Monsieur, que je vous suis reconnaissant !... Mais, diable ! ne parlez pas des chèvres ; toute réflexion faite, j’ai été un peu vif. Notre préfet les soutient peut-être... Je me rappelle que sa femme prend du lait de chèvre...
LOUIS.
Eh bien ! nous ne parlerons pas des chèvres. – Dites-moi, monsieur, M. Mériadec, comment vote-t-il ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Bien, toujours avec moi. Il me doit de l’argent. J’en tiens plus d’un par là, allez. – Le ministre m’a répondu une lettre fort polie ; la voici : il dit qu’il examinera mes titres à la première occasion, avec l’intérêt qu’ils méritent : mais l’occasion...
LOUIS.
Nous la ferons naître, reposez-vous sur moi. – Pouvez-vous m’avoir le notaire de Saint-Aubin ? Le sous-préfet dit qu’il est influent dans son canton.
MONSIEUR KERMOUTON.
Yvon Lantillerac’h, c’est un malin ! Mais j’y pense : je suis en marché pour les prés du Kist-Vaën, je lui ferai faire l’acte.
LOUIS.
Admirable ! Monsieur de Kermouton, excusez-moi de vous recevoir si mal. Donnez-moi votre adresse, et ne quittez pas Paris sans venir me demander à dîner. J’ai besoin de causer longuement avec vous.
MONSIEUR KERMOUTON.
Toujours à vos ordres, Monsieur ; hôtel des Messageries royales, numéro 89. Un mot à la poste, et je suis chez vous.
Il sort, reconduit par Louis.
Scène X
SAQUEVILLE, LOUIS, CLÉMENCE
CLÉMENCE.
Quelle figure vous ont ces électeurs de Morlaix ! Je ne voudrais pas les représenter !
SAQUEVILLE, à Louis, qui revient.
Si je devais avoir affaire à beaucoup de Kermouton, j’aimerais mieux n’être jamais député.
LOUIS.
Savez-vous, mon oncle, que c’est un homme immensément riche !
SAQUEVILLE.
Il a l’air d’un imbécile.
LOUIS.
Il a des millions au soleil !
CLÉMENCE.
Si je vais à Morlaix, vous me donnerez une lettre pour lui.
LOUIS.
Il vous fera manger du mouton de présalé et du fromage de Hollande.
À Félix qui entre.
Ah ! encore. Je n’y suis pas.
FÉLIX.
Monsieur, c’est une lettre de la part de madame la marquise de Montrichard.
LOUIS, après avoir lu.
Ah ! cela vous concerne, mon oncle. – « J’ai appris que M. le colonel Saqueville, votre oncle, arrivait à Paris ces jours-ci. S’il n’a pas oublié une ancienne amie, veuillez, Monsieur, nous l’amener à Montrichard. Vous nous ferez grand plaisir. Morienval de Montrichard. »
CLÉMENCE.
Ah ! voyons donc l’écriture d’une grande dame.
SAQUEVILLE, saisissant la lettre.
Donnez !
LOUIS, à Clémence.
Comment ! vous n’êtes pas encore partie ?
CLÉMENCE.
Allons, on s’en va. – Monsieur le colonel, veuillez ne pas m’oublier. Mademoiselle Clémence Ménétrier, danse et déclamation, l’hôtel garni, tout peut aller ensemble.
Elle sort.
LOUIS.
Quelle diable d’histoire vous fait-elle là ?
SAQUEVILLE.
Mon ami, un homme d’honneur qui prétend à la main de mademoiselle Montrichard ne peut pas entretenir une fille d’Opéra.
LOUIS.
Vous avez raison ; j’y pensais ce matin. Je vais lui donner son congé aujourd’hui même. Allons faire un tour de boulevard.
II
Scène première
LA MARQUISE DE MONTRICHARD, à droite, assise devant une table de jardin, à gauche, JULIE, assise près d’un métier de tapisserie, MISS JACKSON, MONSIEUR SÉVIN, près de la marquise
Une tente devant une terrasse ; un canal dans le fond avec un bateau.
Les trois femmes sont en deuil.
MONSIEUR SÉVIN, lisant un papier.
« Art. 71. Toute pensionnaire de l’Asile de Notre-Dame de Repentance qui manquerait deux fois à la prière du matin ou à celle du soir, qui troublerait l’ordre par des chants profanes ou qui désobéirait à madame la supérieure ou aux dames protectrices, qui écrirait des lettres ou en recevrait de son séducteur... »
LA MARQUISE.
Passez, monsieur Sévin.
MONSIEUR SÉVIN.
Brr, brr... « ou qui introduirait un roman dans la maison, sera chassée sur-le-champ et déclarée indigne à jamais des bienfaits de l’Association de Notre-Dame-de-Repentance. »
LA MARQUISE.
Bien ; la dernière clause surtout... les romans, c’est cela. Julie, que dis-tu de cet article ?
JULIE.
Que voulez-vous, mère ? je serais chassée.
LA MARQUISE.
Fi donc ! Julie.
MONSIEUR SÉVIN.
Comment, Mademoiselle ! Qu’est-ce que j’entends là ?
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia.
JULIE.
Je voudrais bien savoir quel si grand mal on trouve à lire des romans ? Je n’ai jamais compris pourquoi...
LA MARQUISE.
Julie, ma fille, il ne faut jamais parler de ce qu’on ne connaît pas.
JULIE.
D’accord ; mais je puis bien parler de romans, puisque j’en ai lu... Et j’en lirai encore...
MISS JACKSON.
Oh ! oui, des romans anglais, ce qui est bien différent.
JULIE.
Anglais ou français. J’ai lu, par exemple...
LA MARQUISE.
Julie ! – Monsieur Sévin, vous la connaissez trop pour croire un seul mot de ce qu’elle va dire.
MONSIEUR SÉVIN.
Je suis bien sûr que mademoiselle Julie...
JULIE.
Monsieur Sévin, monsieur Sévin, si vous dites un mot de plus, à la place de ce grimoire arabe que je copie sur ma tapisserie, je vais broder en bon français : J’ai lu des romans, et je signe Julie Montrichard.
LA MARQUISE.
Monsieur Sévin, ramassez mes ciseaux, s’il vous plaît.
Bas.
Ne la poussez pas, je vous en supplie...
MONSIEUR SÉVIN.
Cela ferait une tapisserie un peu romantique. – Je passe les derniers articles ; c’est l’uniforme, le trous seau. Vous avez réglé cela à merveille. Robe grise, voile blanc, tablier de toile écrue...
JULIE.
Oh ! de la toile écrue. Fi donc ! Je demande des tabliers de levantine noire, avec les poches garnies de rubans bleus.
LA MARQUISE.
Non, la toile écrue est bien. Cela est humble, cela est convenable pour ces pauvres créatures.
JULIE.
Elles auront l’air de Cendrillons. Donnez-leur alors de pantoufles vertes.
MONSIEUR SÉVIN.
Lecture faite des articles de la constitution, car, Madame, c’est une vraie constitution, c’est une charte que vous octroyez à l’Asile de Notre-Dame de Repentance, les pensionnaires seront introduites et défileront devant monseigneur et les dames bienfaitrices...
JULIE.
Sur quel air ? Je propose la marche de Semiramide. Tra la la la.
Elle chante.
MONSIEUR SÉVIN.
En vérité, mademoiselle Julie a là une heureuse idée ; un peu de musique ne gâterait rien. Savez-vous que nous en avons déjà quelques-unes qui chantent passablement des cantiques. Si on chantait votre bel hymne : Reine des cieux, ton trône de nuages...
LA MARQUISE.
Vous vous souvenez de cela !
MONSIEUR SÉVIN.
Je le sais par cœur.
LA MARQUISE.
Non... Et puis, voyez-vous, la musique de M. Lucchesi ne rend pas bien ce sentiment de sérénité religieuse que j’ai cherché à exprimer dans ces vers.
MONSIEUR SÉVIN.
Quelle âme assez dénuée de poésie pour penser à la musique de Lucchesi en entendant vos paroles ?
LA MARQUISE.
Nous verrons.
MONSIEUR SÉVIN.
Eh bien ! voilà toute notre affaire. Elles défileront et se formeront sur deux lignes pour chanter. Le malheur, c’est que nous n’en avons encore que dix-sept. Pour le défilé, il nous faudrait un nombre pair... Mais, j’y pense.
Bas.
Savez-vous que madame Lelorrain pourrait bien nous fournir une recrue pour la cérémonie. Sa femme de chambre qu’elle nous vantait l’autre jour...
LA MARQUISE, bas.
Est-ce vrai ?
MONSIEUR SÉVIN.
Hélas ! oui. C’est la troisième à qui ce malheur arrive. Aussi, pourquoi se loger si près d’un quartier de cavalerie ?
LA MARQUISE.
J’en suis désolée assurément ; mais enfin, puisque le malheur devait arriver, j’avoue que je ne suis pas trop fâchée qu’il tombe sur cette maison-là.
MONSIEUR SÉVIN.
Est-ce parce qu’on en a l’habitude ?
LA MARQUISE.
Ne soyez pas méchant, monsieur Sévin ; mais madame Lelorrain est d’une indulgence odieuse. Vous n’avez pas d’idée des propositions incendiaires qu’elle nous fait dans nos comités. – « Oh ! Mesdames, elle est si malheureuse !... » Voilà son mot.
MONSIEUR SÉVIN.
Puisse la leçon lui profiter !
Haut.
L’abbé Ballon terminera la cérémonie par une allocution.
JULIE.
Comment dites-vous cela, monsieur Sévin ? Par une... ?
MONSIEUR SÉVIN.
Par une allocution.
JULIE.
Je croyais qu’il ne savait faire que des circonlocutions ?
MONSIEUR SÉVIN.
Très joli !
LA MARQUISE.
Détestable ! Julie !...
MONSIEUR SÉVIN.
Et puis madame la duchesse de Roseville fera la quête, voilà tout.
LA MARQUISE.
Non, point de quête chez moi ; cela effraierait peut-être quelques-uns de mes habitués. M. le comte de Lardjaune doit venir. Vous savez que cela le contrarie quand on lui demande de l’argent pour les malheureux. Il aime à faire ses aumônes incognito... à sa manière. D’ailleurs j’ai un service à lui demander...
JULIE.
Comment ! spectacle gratis ! Ma foi, je trouve qu’on pourrait bien payer pour voir dix-sept pénitentes en tablier de toile écrue, sans parler de l’allocution. Quel dommage qu’on ne me laisse pas assister à la fête !
LA MARQUISE.
La fête ? Julie !
JULIE.
Mère, c’est bien triste une allocution pour bouquet. Savez-vous ce qu’il faudrait pour finale ? Une polka échevelée. Monsieur Sévin, je voudrais vous voir polker.
LA MARQUISE.
Julie, vous oubliez que vous êtes en deuil de votre père... et comment se fait-il que ma fille se serve de termes si bas... C’est votre femme de chambre qui vous a appris celui-là sans doute ?
JULIE.
Pas du tout. Je le tiens de la duchesse de Roseville.
LA MARQUISE.
Excellent modèle à suivre ! Apparemment que vous aimeriez à lui ressembler pour vous entendre appeler folle, comme elle, par tout le monde.
JULIE.
Le grand malheur de passer pour folle ! Ce n’est qu’à ce prix-là qu’on a la liberté de faire tout ce qu’on veut.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia !
LA MARQUISE.
Julie, vous me faites beaucoup de peine !
MONSIEUR SÉVIN.
Non, Mademoiselle. On ne dira jamais la folle mademoiselle Julie ; vous aurez beau faire, on dira toujours l’aimable, l’espiègle mademoiselle Julie.
JULIE.
Vite un notaire et des témoins ! monsieur Sévin vient de me faire un compliment.
MONSIEUR SÉVIN.
Qu’y a-t-il là de si extraordinaire ?
JULIE.
C’est que d’habitude vous gardez les sermons... les allocutions... pour moi et les compliments pour ma mère.
MONSIEUR SÉVIN.
Vous me faites tort, Mademoiselle. Ici, de quelque côté qu’on se tourne, on ne trouve qu’à admirer.
JULIE.
Hiatus ! – Monsieur Sévin, tenons-nous-en à notre ancien commerce d’épigrammes.
LA MARQUISE.
Vous avez bien de la patience, monsieur Sévin. – À propos, monseigneur de Quimper vous donne-t-il quelques espérances pour notre ami M. de Saqueville ?
MONSIEUR SÉVIN.
J’attends tous les jours une lettre de lui. Vous savez qu’il est en tournée pastorale, par conséquent fort occupé ; mais cette tournée lui donne l’occasion de canevasser un peu pour notre ami. Je ne doute pas qu’il ne le serve avec toute l’autorité de son caractère. D’ailleurs il aimait tant madame de Ponthieu, la cousine de Saqueville !
LA MARQUISE.
Pourquoi dites-vous il aimait ?
MONSIEUR SÉVIN.
C’est que madame de Ponthieu est morte il y a un mois ou six semaines.
LA MARQUISE.
Que me dites-vous là ? Morte ! mais comment est-ce possible ? Comment M. Louis de Saqueville, qui était son seul héritier, ne m’en a-t-il pas prévenue ? il n’a pas même pris le deuil.
MONSIEUR SÉVIN.
Je l’ai su aujourd’hui chez le chargé d’affaires de Naples. Vous savez qu’elle avait mené à Ischia son fils poitrinaire. C’est là qu’elle est morte. C’était une personne bien bizarre. Depuis la mort de son fils, elle n’a voulu voir âme qui vive.
LA MARQUISE.
Mais j’ai su tout de suite la mort de ce fils... C’est étrange ! Qu’en pensez-vous, monsieur Sévin.
JULIE, déclamant.
« N’en doutez point, Burrhus... » l’infortuné Louis de Saqueville est déshérité, je le parie.
À miss Jackson.
Voilà le premier défaut qu’on va lui trouver dans cette maison.
LA MARQUISE.
Assurément, les bizarreries de madame de Ponthieu ne peuvent changer en rien mon opinion sur le compte de M. de Saqueville. N’a-t-il pas une fortune indépendante... d’ailleurs ? Seulement, je ne puis m’empêcher de trouver singulier qu’il ne m’ait rien dit. – Savez-vous, monsieur Sévin, qu’elle était femme à léguer toute sa fortune à quelque couvent ?
MONSIEUR SÉVIN.
Hé !... cela serait fort possible. Elle était réellement pieuse, malgré son idolâtrie pour son mauvais sujet de fils. C’était un de mes chagrins de penser qu’il hériterait d’elle.
LA MARQUISE.
Était-il donc si mauvais ?
MONSIEUR SÉVIN.
Un vrai hussard. Tapageur, querelleur, que sais-je ? Il n’avait qu’un souffle de vie, et on eût dit qu’il cherchât toutes les occasions de la perdre. Vous vous rappelez le scandale qu’il donna chez madame de Sainte-Luce, à son retour d’Afrique ?
LA MARQUISE.
Quel scandale ? Est-ce que cela peut se dire ?
MONSIEUR SÉVIN.
Celui-là, on le peut. Il a cassé le bras d’un coup de pistolet à M. de Brétizel, un autre officier, parce que M. de Brétizel, en plaisantant, avait appelé leur colonel un don Quichotte.
LA MARQUISE.
Un don Quichotte ! Ce colonel, c’est M. de Saqueville, l’oncle de M. Louis. Quel rapport entre don Quichotte et lui ?
MONSIEUR SÉVIN.
Oui, c’est parce que lorsque le colonel fut si grièvement blessé, ses soldats trouvèrent sur sa poitrine, à côté du trou de la balle, un médaillon avec des cheveux, et quand il revint à lui, ce fut la première chose qu’il demanda.
JULIE.
Oh ! contez-nous donc cela. Savez-vous que ce colonel me plaît infiniment ! Nous le verrons, n’est-ce pas ?
LA MARQUISE.
C’étaient, sans doute, des cheveux de sa mère.
JULIE.
Je suis bien sûre que non.
LA MARQUISE.
Julie !
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia !
JULIE.
Quel homme est-ce ? Vous le connaissiez beaucoup, mère ? C’est lui qui vous a donné ce vase que je vous ai demandé pour ma cheminée.
LA MARQUISE.
Mais... c’est un homme... très bien.
MONSIEUR SÉVIN.
On le dit bizarre... Outre l’histoire des cheveux...
LA MARQUISE.
Oui, romanesque... un peu susceptible... emporté, jaloux jusqu’à...
JULIE.
Jaloux ? de qui, mère ?
LA MARQUISE.
Oh ! tout cela ce sont de sots propos du monde... Je ne l’ai jamais trouvé, moi, qu’un homme très comme il faut.
JULIE.
Comme vous êtes pâle, mère ?
LA MARQUISE.
Vos sorties ridicules me donnent la migraine. – Monsieur Sévin, vous ne me parlez pas de M. Dumanoir ? L’avez-vous vu ?
MONSIEUR SÉVIN.
Oh ! mon Dieu, quelle étourderie est la mienne ! C’est la première chose dont je devais vous parler.
LA MARQUISE.
Eh bien ! est-ce qu’il a lu mon volume ?
MONSIEUR SÉVIN.
Et relu, madame la marquise, trois ou quatre fois au moins, car il le sait par cœur. Je l’ai trouvé dans l’enthousiasme.
LA MARQUISE.
Non ? Au vrai, qu’en pense-t-il ?
MONSIEUR SÉVIN.
D’honneur, il est ravi.
LA MARQUISE.
Cela me fait grand plaisir, car c’est un des juges les plus éclairés que je connaisse. Alors il fera peut-être l’article dans la Revue. Vous en a-t-il parlé ?
MONSIEUR SÉVIN.
Il le réclame comme son plus doux privilège.
LA MARQUISE.
Je veux que vous me l’ameniez un jour à dîner ici. Nous lui ferons lire quelques morceaux de sa traduction de Klopstock. Mais, au moins, vous me répondez qu’il ne sera pas trop méchant ?
MONSIEUR SÉVIN.
Oh ! Madame, pourriez-vous croire un instant que Dumanoir voulût se brouiller de gaieté de cœur avec tout le monde distingué ?
LA MARQUISE.
Mais enfin, il a dû vous faire quelques critiques... Moi, j’aime la critique quand elle est éclairée et qu’elle est bienveillante.
MONSIEUR SÉVIN.
Le seul passage qu’il se soit permis d’attaquer, c’est le chapitre des veuves.
LA MARQUISE.
Vous me surprenez, car enfin c’est assurément le meilleur du livre ; vous me l’avez dit vous-même.
MONSIEUR SÉVIN.
Il vous trouve, Madame, un peu bien sévère d’interdire aux veuves de convoler en secondes noces. – « Madame la marquise, dit-il, prétend sans doute éloigner d’elle cette multitude d’hommages dont la grâce, l’esprit et la vertu sont toujours obsédés. Elle n’y parviendra pas. » Voilà ce qu’il dit.
JULIE.
C’est bien tourné pour un feuilletoniste.
LA MARQUISE.
J’espère qu’il ne dira pas cela dans son article, et qu’il me fera des critiques sérieuses. Sur ce point, d’ailleurs, je suis armée de toutes pièces, et par l’Écriture et les Pères je lui prouverai que mon opinion est la seule chrétienne.
JULIE.
Et les hommes, peuvent-ils se remarier ?
MONSIEUR SÉVIN.
La plupart des docteurs nous le permettent.
JULIE.
Ah ! c’est injuste. Ces docteurs-là sont des imbéciles.
LA MARQUISE.
Ma chère amie, je vous en conjure, ne parlez pas de choses qui ne sont pas à votre portée.
JULIE.
Eh bien ! mère, je veux étudier la théologie aussi. Monsieur Sévin, apprenez-moi cela.
LA MARQUISE.
Apprends d’abord à être raisonnable et à ne plus parler à tort et à travers.
JULIE.
Si je parle de travers, c’est que je ne sais pas la théologie. Monsieur Sévin, en combien de leçons la montrez-vous ?... Tiens, voilà le cabriolet de M. de Saqueville. Qu’est-ce donc que ce monsieur en noir à côté de lui ?
LA MARQUISE, troublée.
Déjà ? mon Dieu ! c’est sans doute son oncle qu’il nous amène. Julie, miss Jackson... recevez ces messieurs... Voici l’heure de la poste, et j’ai vingt billets à écrire pour notre comité.
Elle sort précipitamment.
Scène II
MONSIEUR SÉVIN, JULIE, MISS JACKSON
JULIE.
Monsieur Sévin, nous allons donc passer à un autre exercice. Plus d’écoles, plus d’asiles, plus de bienfaisance, encore moins de théologie. Nous allons conjuguer le verbe : Je canevasse, tu canevasses, il ou elle canevasse... ce qui me paraît synonyme du verbe : Je m’ennuie, tu m’ennuies, on m’ennuie ; verbe réfléchi, n’est-ce pas, miss Jackson ?
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia !
Scène III
MONSIEUR SÉVIN, JULIE, MISS JACKSON, puis LOUIS entrant avec SAQUEVILLE
LOUIS.
Toujours à l’ouvrage ! comme c’est édifiant ! Bonjour, Sévin. Miss Jackson, how d’ye do ?
Saqueville s’approche de Julie et s’arrête tout à coup.
SAQUEVILLE.
Madame...
JULIE.
Ma mère est dans sa chambre qui finit une lettre pressée, Monsieur. Elle descend dans deux minutes. Monsieur le colonel de Saqueville ne me reconnaît pas sans doute.
SAQUEVILLE.
Julie !... mademoiselle Julie ! Vous ressemblez tant à votre mère !
JULIE.
Vous trouvez ?
LOUIS.
Permettez-moi, Mademoiselle, de vous présenter mon oncle. Depuis notre glorieuse révolution, nous autres neveux, nous chaperonnons nos oncles. Il n’y a pas plus de quatorze ou quinze ans qu’il vous donnait de belles poupées. Il s’en souvient parfaitement, par conséquent vous ne pouvez l’avoir oublié non plus.
JULIE.
Eh bien ! non ; je ne l’ai pas oublié. Et ce n’est pas le seul bienfait dont j’aie gardé la mémoire. – Je me rappelle parfaitement, par exemple, que, grâce à l’intervention du colonel, je suis allée, avant l’âge légal, – l’âge légal est le mot, monsieur de Saqueville, n’est ce pas ? – je suis allée à l’Opéra, où l’on donnait la Muette. Je me souviens encore de gens qui couraient sur la scène avec des épées et des flambeaux.
SAQUEVILLE.
Vous avez une mémoire admirable, Mademoiselle. Votre première visite à l’Opéra a été ma dernière, à moi... Vous vous êtes endormie avant la fin, et je vous portai dans la voiture.
JULIE.
Voyez comme j’étais précoce ! Eh bien ! je m’endors encore à l’Opéra, mais je n’ai plus de porteurs patentés.
LOUIS.
Il s’en présentera, gardez-vous d’en douter. – Sévin, avez-vous lu le Morlaisien du 15.
MONSIEUR SÉVIN.
Non, mon cher. Qui est-ce qui lit le Morlaisien, sinon le futur représentant de Morlaix ?
LOUIS.
C’est un très bon journal. Jugez-en plutôt.
Il lit.
« Variétés : Aspirations chrétiennes, par H. S. ; un volume in-18. Ces petits poèmes, soupirs mélodieux d’une âme religieuse et enthousiaste, se trouvent aujourd’hui sur toutes les tables de la fashion parisienne. L’auteur... » Ah ! vous rougissez ! Écoutez, je ne veux pas trop faire souffrir votre modestie. Lisez cela... Je vous assure que c’est très bien... Dites donc, Sévin, vous qui voyez tous les jours le ministre de l’instruction publique, tâchez donc de faire quelque chose pour le rédacteur du Morlaisien. C’est un garçon d’un vrai mérite. Son père est un épicier de Morlaix très influent...
JULIE.
Messieurs, Messieurs, halte-là ! Défense de parler politique ou élections à moins de trois mètres de ma tapisserie. – Colonel, êtes-vous candidat ?
SAQUEVILLE.
Non, Mademoiselle.
JULIE.
À la bonne heure ! En ce cas, demeurez et asseyez-vous ici. Regardez un peu cette broderie et admirez. N’est-ce pas que j’ai acquis bien du talent depuis que nous fréquentions ensemble l’Opéra ?
SAQUEVILLE.
En effet, Mademoiselle... et un dessin arabe... un verset du Coran, si je ne me trompe.
JULIE.
Vraiment, vous pouvez lire cela ?
SAQUEVILLE.
Que faire en Algérie, si on n’y apprend l’arabe ?
JULIE.
Et cela veut dire ?...
SAQUEVILLE.
« Malheur aux hypocrites !... parce qu’ils n’entreront pas... malekout essemaouat dans le royaume des cieux. »
JULIE.
Vraiment, il y a cela ?... Oh ! que c’est bien fait !... mais c’est admirable, ce Coran. J’ai envie de me faire Turque... Mais savez-vous que me voilà bien embarrassée ! Je ne sais plus à qui donner mon coussin... Il y a tant de gens à qui la leçon pourrait profiter... monsieur Sévin...
MONSIEUR SÉVIN.
Enfin, vous rappelez les exilés ! Nous renonçons à la politique, Mademoiselle.
JULIE.
Je ne sais plus ce que je voulais vous dire... ha ! ha ! ha !... Monsieur de Saqueville... non, monsieur Louis de Saqueville... comment trouvez-vous mon coussin ? Si je vous le donnais ?...
LOUIS.
Vous me rendriez bien heureux... Mais pourquoi riez-vous ?...
SAQUEVILLE.
Qu’en ferait-il, Mademoiselle ?
JULIE.
Qui sait ?... Miss Jackson, montrez donc au colonel cette vue d’Alger que ma mère a achetée l’autre jour à la vente des orphelins du choléra.
SAQUEVILLE, vivement.
Elle a acheté une vue d’Alger ?
Il s’approche de miss Jackson.
JULIE, bas à Louis.
Savez-vous que votre oncle me plaît beaucoup ? Il a un air sinistre...
LOUIS.
Sinistre, lui ! c’est le meilleur homme du monde. S’il a l’air un peu triste, c’est qu’il vient de perdre un de ses bons amis, un camarade d’Afrique... M. de Ponthieu, un cousin à nous... Un autre que lui serait gai... car il hérite de tous les biens de madame de Ponthieu, ma cousine... plus de cent mille livres de rente.
JULIE.
Cent mille livres de rente ! Redites votre affaire... Est-ce vrai qu’il porte sur son cœur un médaillon avec des cheveux de la fille d’Abd-el-Kader ?
LOUIS.
Quel conte ! Vous ne le connaissez guère. Il n’a et n’aura jamais qu’un seul amour, qui s’appelle le deuxième spahis. Oh ! c’est le meilleur des hommes ! un père pour moi... De quelle couleur ferez-vous le fond ?
JULIE.
Il faut que je prenne les instructions du colonel, qui me paraît très fort en tapis arabes.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia, le colonel dit que c’est très exact... et il reconnaît la maison où il a demeuré à Alger.
SAQUEVILLE.
Oui, cette petite maison blanche avec une terrasse ; c’est là que j’ai logé en sortant de l’hôpital.
JULIE.
Vous avez été à l’hôpital ? Ah ! je sais...
SAQUEVILLE.
Mon Dieu, oui.
MISS JACKSON.
Est-il possible ?
LOUIS.
Ah ! voici madame de Montrichard. Madame la marquise, je vous amène un Algérien...
Scène IV
MONSIEUR SÉVIN, JULIE, MISS JACKSON, LOUIS, SAQUEVILLE, LA MARQUISE
LA MARQUISE, entrant et parlant vite.
Je descends pour une minute... Je n’ai pas voulu m’habiller avant d’avoir félicité M. de Saqueville de son heureux retour... Que je suis charmée de vous revoir !... Vous nous avez donné de vives inquiétudes... Cette affreuse blessure !... Mais vous êtes parfaitement bien, j’espère ?
Elle lui donne la main. Saqueville est tout tremblant ; il s’appuis sur le métier de Julie.
JULIE.
Colonel, vous allez casser mon métier !
LA MARQUISE.
Au milieu de tous les malheurs que nous avons éprouvés, nous avons souvent pensé, ma fille et moi, aux dangers que vous avez courus... Tant de fatigues ne vous ont point trop changé... Vous avez vu ma grande fille ?... vous ne l’auriez pas reconnue. Ah ! cela nous chasse... Permettez-moi de vous présenter M. Sévin ; M. Sévin est parent de monseigneur d’Alger, votre pasteur... Mille pardons, Messieurs. Je suis honteuse de mon costume de campagnarde, mais je ne suis pas longue à ma toilette... n’est-ce pas, monsieur Sévin ? Rassurez-vous, Messieurs, vous n’attendrez pas longtemps le dîner.
JULIE.
Mère, pourquoi donc êtes-vous allée mettre cet affreux bonnet sur vos beaux cheveux ?
LA MARQUISE.
Ma chère ! que dis-tu là ? des cheveux à mon âge !... Un enfant terrible, colonel, qui obligera sa mère à confesser devant le monde qu’elle a des cheveux blancs. Allons, Julia dear, montons nous habiller ; ces messieurs veulent bien nous excuser.
JULIE.
Mère, je suis habillée, et miss Jackson aussi.
LA MARQUISE.
En ce cas, montre le jardin à ces messieurs... Monsieur Sévin, je vous recommande de veiller sur ces deux étourdis.
Elle sort.
Scène V
SAQUEVILLE, LOUIS, JULIE, MISS JACKSON, MONSIEUR SÉVIN
SAQUEVILLE, se laissant tomber dans un fauteuil.
Ouf !
LOUIS.
Qu’avez-vous, mon oncle ?
JULIE.
En effet !... qu’avez-vous, Monsieur ? Vous êtes pâle-comme la mort.
SAQUEVILLE, se levant.
Rien... non, rien... peut-être cette maudite blessure... le changement de temps... Cela m’arrive quelquefois... mille pardons ! Cela ne dure qu’un instant... C’est passé... je suis parfaitement bien !
JULIE.
Mais, au contraire, vous avez l’air de souffrir beaucoup. Vous devriez prendre un peu d’éther.
SAQUEVILLE.
Mille grâces... Je suis tout à fait bien.
MISS JACKSON.
Mon père, qui était militaire, quand sa blessure le faisait souffrir, prenait un grand verre d’eau-de-vie avec un peu d’eau. Cela lui faisait du bien. Essayez.
SAQUEVILLE.
Non, je vous remercie. Je suis honteux d’avoir été si faible.
MONSIEUR SÉVIN.
Une cause si honorable.
LOUIS.
Il a été percé de part en part d’un coup de feu.
JULIE.
Vous nous avez vraiment effrayés... Comment êtes-vous à présent ?
SAQUEVILLE.
Parfaitement. Que vous êtes bonne ! N’y pensez plus, je vous en supplie.
Bas.
– Qui est ce monsieur ?
Montrant M. Sévin.
JULIE.
C’est M. Sévin. Vous ne voulez rien prendre ?
SAQUEVILLE.
Rien au monde. Faisons plutôt un tour de jardin.
Bas à Louis, qui tient un journal.
Louis, tu n’es guère empressé.
LOUIS, bas.
Elle déteste qu’on fasse le dameret. Ce n’est plus la mode... – Vous ne savez pas, Mademoiselle, qui nous avons croisé en venant ici ? Devinez... Madame de Vaugrenand en rouge. Oui, en rouge de feu, ma foi !
JULIE.
C’est qu’elle espère qu’on ne verra pas comme elle est couperosée. Je voudrais bien qu’elle rencontrât un troupeau de bœufs en ce costume.
LOUIS.
Ah ! si M. Person vous entendait !
JULIE.
Il m’arracherait les yeux.
LOUIS.
Oui, s’il pouvait les donner à Madame de Vaugrenand. A-t-on jamais vu deux personnes plus laides s’aimer si ridiculement ?
JULIE.
Ils sont faits l’un pour l’autre. – Allons.
LOUIS.
Prenez garde, il fait encore du soleil. Mettez cet élégant chapeau de paille, ou madame votre mère nous grondera. – Mon oncle, parlez donc à M. Sévin du professeur de rhétorique du collège de Morlaix, dont le frère est spahi. Vous pouvez lui dire comme c’est une famille honorable.
SAQUEVILLE.
Nous avons le temps.
MONSIEUR SÉVIN.
Vous avez connu sans doute à Alger mon parent, monseigneur Grandet ? Comment se trouve-t-il là-bas ?...
SAQUEVILLE.
Bien.
À miss Jackson.
Mademoiselle, voulez-vous accepter mon bras ?
JULIE, qui vient de mettre un chapeau de paysanne.
Colonel, comment me trouvez-vous avec ce chapeau ? N’est-ce pas élégant ? Vous saurez que c’est la dernière mode à Montrichard.
SAQUEVILLE.
Il vous sied à merveille. Cela ressemble beaucoup aux chapeaux que portent nos cheiks arabes.
LOUIS.
Prenez encore cette écharpe, et vous ressemblerez comme deux gouttes d’eau à la Dame du Lac.
JULIE.
Ah ! la Dame du Lac !... Faisons une promenade en bateau dans cette grenouillère que nous appelons un canal. Vous allez voir comme je suis bonne marinière !
MISS JACKSON.
Miss Julia, madame la marquise a défendu...
JULIE.
Miss Julia se permet tout ce que madame la marquise défend. Allons, qui m’aime me suive ! O matutini albori...
Elle entre dans le bateau.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia !
MONSIEUR SÉVIN.
Je n’entre pas dans le bateau.
LOUIS.
Vous vous écorcherez les mains en ramant.
SAQUEVILLE.
Mademoiselle, prenez garde. Ne vous tenez pas ainsi. L’amiral Duchêne me disait qu’il ne s’était jamais tenu debout dans une embarcation. Asseyez-vous, je vous en supplie !
JULIE.
Fi donc ! Où serait la grâce ? Monsieur Louis, donnez-moi l’autre rame. Monsieur Sévin, détachez la corde. Voyons, qui veut passer l’eau ?
SAQUEVILLE.
Moi, quand vous serez assise.
JULIE.
Où est la gaffe ? – N’est-ce pas que je sais bien tous les termes de marine ?
MISS JACKSON.
Miss Julia ! le bateau penche ! – Oh ! monsieur Sévin, faites-la rentrer ! Ne lui donnez pas la gaffe.
MONSIEUR SÉVIN.
Vraiment, Mademoiselle, si madame la marquise...
JULIE.
Ah ! que les hommes sont poltrons... Ah !
Elle tombe. Saqueville saute dans le canal.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia ! Oh ! monsieur Sévin !
LOUIS.
La gaffe, Sévin ! donnez-moi la gaffe !
SAQUEVILLE, reparaît tenant Julie dans ses bras.
Ce n’est rien. Louis, donne-moi la main.
JULIE, riant aux éclats.
Ha ! ha ! ha ! J’en mourrai de rire. Trempés tous les deux !
TOUS.
Mademoiselle !
MISS JACKSON.
Oh ! que dira madame la marquise !
SAQUEVILLE.
Pour Dieu ! ne riez pas ainsi ! Vous me faites peur. Rassurez-vous.
JULIE, riant toujours.
Je suis toute rassurée... Mais regardez donc votre neveu, qui voulait me harponner comme une baleine... ha ! ha ! ha !... Miss Jackson, laissez-moi vous serrer dans mes bras !... Colonel, c’est la seconde fois que vous me portez.
MONSIEUR SÉVIN, à part.
Elle est folle.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia, oh ! que j’ai eu peur ! Et madame la marquise, comme elle sera fâchée quand elle saura... Oh ! dear ! oh ! dear ! mais ne riez donc pas ! Oh ciel ! voici madame la marquise. Si vous vous étiez noyée !
Scène VI
SAQUEVILLE, LOUIS, JULIE, MISS JACKSON, MONSIEUR SÉVIN, LA MARQUISE, entrant
LA MARQUISE.
Mon Dieu ! ma fille ! Qu’est-il donc arrivé ?
SAQUEVILLE.
Le pied lui a glissé, mais elle ne s’est pas fait le moindre mal. Ne craignez rien, Madame.
LA MARQUISE.
Tu n’es pas blessée... Mon Dieu ! toujours une nouvelle folie... Vous me faites mourir de honte, cruelle enfant ! Quelle inconvenance ! Courez vite vous habiller.
LOUIS.
Le costume de néréide est assez gracieux.
JULIE.
Mais, chère mère, ce n’est pas ma faute, c’est votre barque qui est mal construite. Mais regardez donc le colonel ! Quelle moustache de Neptune ! Ha ! ha ! ha ! Mon Dieu ! que je voudrais que Marie de Roseville fût ici !
LA MARQUISE.
Il est donc tombé aussi ?
JULIE.
Oui, il m’a repêchée. Ah ! quel dommage que les autres ne fussent pas dans la barque !
Elle défait et essuie ses cheveux.
LA MARQUISE.
Julie, Julie, montez vite chez vous. Ne restez pas une minute de plus. Vous essuierez vos cheveux là-haut.
JULIE.
Laissez-moi donc, mère. Vous n’avez donc pas lu sur le Rhin les histoires des sirènes qui font des conquêtes en séchant leurs cheveux ? J’ai l’air d’un caniche.
LA MARQUISE.
Julie !
JULIE.
Mère, qu’allons-nous faire du colonel dans ce bel état ? Où lui trouver des habits ? S’il n’était pas si grand, je lui donnerais une robe de chambre.
SAQUEVILLE.
Deux minutes au soleil, et il n’y paraîtra plus ; mais, vous, vous allez vous enrhumer.
LA MARQUISE, à Julie.
Allez donc, allez-vous-en, mon Dieu ! – Colonel, Joseph va vous trouver de quoi changer. Que d’excuses j’ai à vous faire... et que de remerciements !
JULIE.
Mère, si on donnait au colonel le costume d’Othello de nos charades de l’année dernière ?... Oh ! vite, qu’on lui donne le costume d’Othello ; ce sera délicieux. Quel bonheur si le curé vient ! Nous lui dirons que c’est un Bédouin... D’abord, j’ai une fluxion de poitrine si on ne lui donne pas le costume d’Othello.
LA MARQUISE.
Encore ! Miss Jackson, emmenez-la.
Miss Jackson sort avec Julie.
SAQUEVILLE.
J’admire son courage ; elle riait dans l’eau.
LA MARQUISE.
Je suis confuse et désolée, monsieur de Saqueville...
À un domestique.
Joseph, tâchez de trouver à monsieur de quoi changer.
Elle sort.
LE DOMESTIQUE.
Je crains qu’il n’y ait pas d’habit ici pour la taille de monsieur.
SAQUEVILLE.
J’ai une redingote dans le cabriolet de Louis. Dites-moi où il faut aller.
LOUIS.
Mon oncle, ne plaisantez pas avec l’eau froide. Je gèle rien que de vous voir. Il y a là de quoi vous rendre fort malade. Que diable ! vous auriez pu la repêcher sans vous jeter à l’eau. Allez vite changer.
Saqueville sort avec le domestique.
Scène VII
MONSIEUR SÉVIN, LOUIS
MONSIEUR SÉVIN.
Charmante demoiselle ! Je parie qu’elle est bien contente de sa journée. Une scène tragique ! Il n’y manquait que la duchesse de Roseville. Et le dîner qui était prêt. Nous en avons pour une heure avant qu’elle ait séché ses cheveux.
LOUIS.
Elle a de beaux cheveux.
MONSIEUR SÉVIN.
Oui, et tout sera froid.
LOUIS.
Que voulez-vous, Sévin ? un peu de philosophie !
MONSIEUR SÉVIN.
Saqueville, vous savez que la philosophie et moi nous n’avons rien de commun. Il n’y a rien que je déteste comme les événements à la campagne... surtout à cette heure-ci.
LOUIS.
À propos de philosophie, tirez-moi de Morlaix mon professeur de rhétorique, et placez-le-moi dans un collège royal. Son père est électeur et me tourmente horriblement... Si vous ne pouvez pas, ayez-moi une lettre du ministre, comme la dernière, qui promette pour la première occasion.
MONSIEUR SÉVIN.
Faites vous-même une lettre vague, qui ne dise rien ; je la porterai au chef du cabinet, qui la fera expédier et signer.
LOUIS.
À la bonne heure ; mais... Ah ! dites-moi, connaissez-vous un M. Kermouton, un grand propriétaire à Morlaix ?
MONSIEUR SÉVIN.
Oui, un homme fort riche, qui a une fille.
LOUIS.
Il faut absolument que vous m’aidiez à lui faire avoir. la croix.
MONSIEUR SÉVIN.
Il l’aura. J’ai fait son affaire.
LOUIS.
Bah ! Qui vous en a parlé ?
MONSIEUR SÉVIN.
Des gens que je connais.
LOUIS.
Je vous en ai une véritable obligation.
MONSIEUR SÉVIN.
Il n’y a pas de quoi. Dès que j’ai dit au ministre quel homme c’était et quelle fortune il avait, il l’a tout de suite compris dans l’ordonnance qui doit paraître cette semaine.
LOUIS.
Voilà qui va le mieux du monde. Je puis regarder la chose comme faite ?
MONSIEUR SÉVIN.
Je voudrais être aussi assuré de dîner dans une heure.
LOUIS.
Ainsi je puis le lui annoncer ?
MONSIEUR SÉVIN.
Si vous voulez... mais dites-lui alors que c’est moi qui ai parlé au ministre.
LOUIS.
Assurément... mais pourquoi ?
MONSIEUR SÉVIN.
Pour rien. Allons ! il faut bien faire un tour de jardin. Que ces beaux cheveux seront longs à sécher !
III
Scène première
SAQUEVILLE, LOUIS, MONSIEUR SÉVIN
Une terrasse. Il est presque nuit. La lune se lève. Une table rustique avec des tasses et du café.
LOUIS.
Règle sans exception, mon oncle : jamais, chez des femmes, vous ne trouverez du vin tolérable. Le champagne était douceâtre, le bordeaux trop vert, l’un et l’autre fabriqués. J’en fais juge Sévin.
SAQUEVILLE.
Je ne m’en suis pas aperçu.
LOUIS.
Je le crois bien. Vous ne buvez ni ne mangez.
SAQUEVILLE.
Je ne te savais pas gourmand. À ton âge, c’est singulier.
LOUIS.
C’est là mon moindre défaut ; mais tout le monde est gourmand aujourd’hui... jusqu’à Sévin, qui est un saint enherbe.
MONSIEUR SÉVIN.
La table est le plus innocent de tous les plaisirs. Cependant, quand on songe à tous les malheureux pour qui les miettes de nos somptueux repas...
LOUIS.
Vous avez bien raison ; mais ne parlons pas de cela sitôt après le dîner ; cela trouble la digestion. Pendant que ces dames sont allées chercher leurs châles, si nous fumions un léger cigare ? Hein ! mon oncle ?
SAQUEVILLE.
Oh ! ici, c’est impossible.
LOUIS.
À la campagne, la marquise le tolère. Prenez celui-ci ; il n’a pas l’air mauvais.
SAQUEVILLE.
En revenant à Paris.
LOUIS.
Nous en aurons d’autres. Venez, c’est l’usage ici. Un tour d’allée seulement. Je ne vous en offre pas, Sévin ?
MONSIEUR SÉVIN.
Ah Dieu ! non.
Saqueville et Louis sortent ; entrent la marquise, Julie, miss Jackson.
Scène II
LA MARQUISE, MONSIEUR SÉVIN, JULIE, MISS JACKSON
LA MARQUISE.
Eh bien ! déjà partis, nos messieurs ? Monsieur Sévin nous demeure, notre fidèle, comme toujours. Aussi nous allons avoir bien soin de lui.
MONSIEUR SÉVIN.
Je ne comprends pas ces messieurs, qui abandonnent les dames pour un peu de fumée. C’est renouvelé des Grecs. Ixion fut le premier à quitter une déesse pour courir après un nuage.
JULIE.
Monsieur Sévin, avec cet Ixion et ce nuage, en travaillant, il y aurait, je parie, de quoi faire une épigramme. Essayez donc. En attendant, puisque ma mère a soin de vous, moi, j’aurai soin du colonel, et je vais lui porter du café.
LA MARQUISE.
Non, reste, Julie, ils vont revenir. Il ne faut pas accoutumer les hommes à ces complaisances pour leurs mauvaises habitudes. – Ah ! monsieur Sévin, que cette lune est belle !
MONSIEUR SÉVIN.
Oui, quand je suis dans les champs par une nuit comme celle-ci, calme, silencieuse, majestueusement éclairée par cette immortelle lumière, il me semble voir l’œil d’un génie tout-puissant qui veille sur la nature endormie.
JULIE.
Est-ce qu’il est borgne, le génie ?
LA MARQUISE, sévèrement.
Julie !
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia.
MONSIEUR SÉVIN.
Mademoiselle, je ris tout le premier de vos railleries, lorsqu’elles ne s’adressent qu’à moi ; mais celle-ci... en vérité, elle est indigne de vous.
LA MARQUISE.
La leçon est méritée. Je ne connais rien de plus misérable que de jeter le ridicule sur les choses grandes et saintes. C’est la marque d’un petit esprit, et, je t’en demande pardon, ma fille, d’un cœur sec.
JULIE.
Ne vous fâchez pas, mère ; monsieur Sévin, je ne le ferai plus. Continuez donc, vous improvisiez.
MONSIEUR SÉVIN.
Le colonel paraît un homme fort aimable... bien qu’un peu étranger à la civilisation... C’est singulier qu’il soit resté si longtemps en Afrique.
LA MARQUISE.
Il s’y plaît.
JULIE.
Je conçois maintenant pourquoi on l’appelait don Quichotte. Il est toujours prêt à redresser les torts... Et puis je gage qu’il a une Dulcinée en Algérie.
LA MARQUISE.
Encore !
JULIE.
Au reste, il m’en plaît davantage. Savez-vous à quoi je pensais pendant le dîner ?... C’est qu’il est bien plus beau de risquer sa vie en Afrique, trois ou quatre fois par semaine, que de se promener en gants jaunes sur le boulevard des Italiens.
MONSIEUR SÉVIN.
Ah ! Mademoiselle, je vous prends à faire des épigrammes aussi.
JULIE.
Je ne pensais pas à vous, monsieur Sévin. Au moins, vous, vous allez au sermon, et vous êtes secrétaire de tous les comités de bienfaisance, commissaire de tous les bals de charité ; cela est encore plus méritoire que de faire des razzias. Oh ! il faut que je lui demande comment on fait une razzia.
MONSIEUR SÉVIN.
Justement, voici ces messieurs qui reviennent et qui vont nous embaumer.
Scène III
LA MARQUISE, MONSIEUR SÉVIN, JULIE, MISS JACKSON, SAQUEVILLE
LA MARQUISE, à Saqueville.
Avouez, colonel, que votre lune d’Afrique n’est pas plus belle que celle-ci.
SAQUEVILLE.
La lune de Paris a toujours été la plus belle pour moi...
JULIE.
Colonel, nous parlions razzia. Je voudrais bien en voir une. Qu’est-ce que vous faites de toutes les femmes arabes que vous prenez ?
LA MARQUISE, bas à Julie.
Eh bien !
SAQUEVILLE.
On les met dans une tente avec les enfants. À la porte, une douzaine de spahis pied à terre, avec un vieux maréchal des logis, bon musulman. Ordre de casser la tête à quiconque oserait toucher le voile d’une des prisonnières.
JULIE.
Toujours chevaleresque. Mais pourquoi un bon musulman ?
SAQUEVILLE.
C’est qu’un musulman respectera mieux les usages de ses compatriotes. Il craindrait d’offenser une femme en la regardant.
JULIE.
Oh !
MONSIEUR SÉVIN.
Vous trouvez à redire à ces manières musulmanes, mademoiselle ?
JULIE.
Un peu.
SAQUEVILLE.
J’ai remarqué que les Arabes me savaient gré du soin que je prenais à détourner les yeux quand une de leurs femmes paraissait devant moi. Il faut toujours s’observer avec eux, et le meilleur moyen de s’en faire obéir, c’est de montrer du respect pour leurs coutumes et leur religion.
MONSIEUR SÉVIN.
Moi, je trouve qu’on pousse ce respect-là un peu trop loin.
SAQUEVILLE.
Comment cela, Monsieur ?
MONSIEUR SÉVIN.
Pas le moindre effort pour les éclairer ! Au contraire, on leur bâtit des mosquées, on leur imprime des Alcorans.
JULIE.
Ah ! c’est un très beau livre que l’Alcoran. Il y a des versets qui me plaisent fort.
SAQUEVILLE.
Nous leur montrons ainsi notre tolérance. Pour moi, je fais grand cas des bons musulmans, et j’ai confiance dans mes spahis, quand je les sais exacts à faire la prière aux heures prescrites. J’avoue que j’ai plus d’une fois éprouvé quelque honte à voir nos Français occupés tout différemment.
MONSIEUR SÉVIN.
Ce n’est pas ma faute. Il y a longtemps que je demande qu’on donne des aumôniers à nos régiments.
SAQUEVILLE.
Vous devriez aller en Afrique, Monsieur, pour y faire des conversions.
MONSIEUR SÉVIN.
Oh ! Monsieur...
LA MARQUISE, se levant.
Monsieur Louis, je voudrais bien vous dire quelque chose. Donnez-moi le bras...
Bas.
On m’a dit aujourd’hui que madame de Ponthieu était morte ! Serait-ce vrai ?
LOUIS.
Très vrai, Madame. Vous savez sans doute qu’elle a laissé...
Ils passent.
JULIE.
Faisons-nous aussi un tour de promenade ? Colonel, je prends votre bras, et parlez-moi de l’Algérie.
SAQUEVILLE.
Parlez-moi plutôt, vous, de Paris.
Ils passent.
MONSIEUR SÉVIN.
Les suivrons-nous, miss Jackson ? Vraiment, cette pauvre mademoiselle Julie devient tous les jours lus insupportable. C’est une bizarrerie, une aigreur !...
MISS JACKSON.
Oh ! monsieur Sévin !
Ils passent.
LA MARQUISE, revenant avec Louis.
...Il est surprenant qu’il ne m’en ait rien dit dans sa lettre. Au reste, je suis persuadée qu’il pensera à vous.
LOUIS.
Pourriez-vous en douter ? D’abord il doit comprendre que c’est en quelque sorte... par une injustice... car enfin ma cousine de Ponthieu était cousine-germaine de ma mère... Mon oncle, à vrai dire, n’était pas son parent... Vous pourriez lui faire entendre...
LA MARQUISE.
C’est un sujet un peu délicat à traiter... Cependant il faut que je lui en dise quelques mots... Son caractère est si noble, qu’il sentira lui-même...
Ils passent.
SAQUEVILLE, rentrant avec Julie.
...Les cavaliers sortent à leur rencontre, revêtus de leurs plus beaux habits, montés sur des chevaux magnifiques. Ils les font caracoler, ils tirent des coups de fusil en poussant des cris de joie. C’est vraiment un spectacle curieux.
JULIE.
Ce doit être magnifique ! je voudrais voir cela.
SAQUEVILLE.
Il vaut encore mieux aller à l’Opéra.
JULIE.
Pour qu’on m’y porte ?
SAQUEVILLE.
Ce M. Sévin est fort pieux ?
JULIE.
La vertu est sa partie.
SAQUEVILLE.
Votre mère... l’estime beaucoup ?
JULIE.
Elle en est entichée. Vous l’avez bien jugé ; c’est un petit Tartufe... Il m’est odieux. – Les femmes, comment sont-elles habillées ?
Ils passent.
MONSIEUR SÉVIN, rentrant avec miss Jackson.
À ce compte-là, la marquise ferait bien d’y regarder à deux fois... car enfin l’oncle peut se marier... avec une fortune comme celle que vous dites, il peut trouver tous les partis qu’il voudra, et alors, notre ami...
MISS JACKSON.
C’est ce que je me suis dit tout d’abord. D’ailleurs ce monsieur est fort romanesque, comme il semble ; et il peut très bien vouloir faire le bonheur d’une jeune personne sans fortune. Lord Touchstone a bien épousé une paysanne du Lancashire.
MONSIEUR SÉVIN.
Ou bien, il peut manger sa fortune au lansquenet, ou la gaspiller dans la plus mauvaise compagnie. Un monsieur de Morlaix, que j’ai vu aujourd’hui, m’a dit qu’il s’était accointé d’une danseuse ou de quelque chose de semblable.
MISS JACKSON.
Est-il possible !
Ils passent.
SAQUEVILLE, rentrant avec Julie.
« Prends tous mes chameaux, mes chevaux, mes esclaves, et rends-moi Fatimah ! » me disait-il en versant de grosses larmes. Il vous aurait fait pitié. Je lui dis : « Garde tes biens, mais quitte Abd-el-Kader et sers le sultan des Français. » Le lendemain, il vint à mon camp avec soixante des plus braves cavaliers que j’aie vus, et depuis lors il nous a toujours fidèlement servis.
JULIE.
Et Fatimah ? était-elle jolie ?
SAQUEVILLE.
Je ne l’ai jamais vue que voilée.
JULIE.
Allons donc !
SAQUEVILLE.
C’est la chose du monde la plus simple. Je ne suis pas curieux.
JULIE.
Laissons-les passer.
Ils s’arrêtent.
MISS JACKSON, rentrant avec M. Sévin.
Quelle charmante nuit, colonel ? Avez-vous été en Angleterre ?
SAQUEVILLE.
Autrefois, mademoiselle.
JULIE.
Miss Jackson, emmenez M. Sévin. J’ai des secrets à dire à M. le colonel. Je ne veux pas qu’on les entende.
MONSIEUR SÉVIN.
Sauvons-nous ! miss Jackson ; que de méchancetés on va dire !
Bas.
Miss Jackson, vous devriez peut-être bien faire remarquer à madame la marquise...
Ils passent.
LA MARQUISE, rentrant avec Louis, à Saqueville.
Vous ne vous promenez plus ?
JULIE.
Nous contemplons la lune. C’est vraiment un assez bel œil.
SAQUEVILLE, bas à Louis.
Prends le bras de Julie. – Je suis au bout de mes histoires algériennes.
LA MARQUISE, à part.
Il faut lui parler... Cela semblerait une affectation.
Haut.
Je suis déjà lasse ; asseyons-nous, colonel.
Elle s’assied.
SAQUEVILLE, à part.
Enfin !... Du courage !
Il s’assied.
LA MARQUISE.
Monsieur Sévin, monsieur Sévin.
SAQUEVILLE, à part.
Toujours M. Sévin.
MONSIEUR SÉVIN, rentrant avec miss Jackson.
Madame ?
LA MARQUISE.
Emmenez Julie et M. Louis voir les cygnes, là-bas. Miss Jackson, allez avec eux. Dites à Julie de bien se couvrir les épaules. Il fait un peu frais au bord de la pièce d’eau... Et qu’elle n’y tombe plus, miss Jackson.
LOUIS, à Julie.
Je voudrais bien savoir, mademoiselle, le pourquoi de tous ces oh ! et de tous ces ah ! que vous faisiez en causant avec mon oncle.
JULIE.
Il me contait de très belles choses.
M. Sévin lui parle bas.
Oh ! que c’est ennuyeux ! Cela sera-t-il long ? Venez, miss Jackson, laissons ces messieurs parler politique.
Elle sort avec miss Jackson, suivie par Louis et M. Sévin.
Scène IV
LA MARQUISE, SAQUEVILLE
LA MARQUISE, après un silence.
Il est doux... et triste tout à la fois... de se revoir après si longtemps...
SAQUEVILLE.
Triste surtout, madame, pour celui qui, après un long exil, ne trouve qu’un accueil glacé.
LA MARQUISE.
Ah ! colonel, vous ne doutez point cependant du...
SAQUEVILLE.
J’ai passé treize ans en Afrique à chérir une espérance... Quelques minutes ici me l’ont fait perdre. Vous êtes cruelle pour moi, madame.
LA MARQUISE.
Vous êtes injuste, monsieur, à votre ordinaire. Vos premières paroles sont des reproches. N’aurais-je pas le droit de vous en faire, moi ?...
SAQUEVILLE.
Quels reproches ai-je donc mérités ?
LA MARQUISE.
Votre lettre... Vous ne vous en souvenez plus ?
SAQUEVILLE.
Ma lettre ?... Eh quoi ! Je me suis tu treize ans ! J’ai tenu ma promesse. Dieu sait ce qu’il m’en a coûté. Dieu sait combien de fois... mais vous l’aviez défendu... je l’avais juré... Enfin un journal m’arrive au fond de l’Afrique, et m’apprend que vous êtes libre. J’ai cru pouvoir vous écrire alors ; j’ai fait plus, je suis venu. Suis-je donc si coupable ?
LA MARQUISE.
Mais cette joie... farouche... Mon Dieu ! comment avez-vous pu avoir de pareilles pensées en apprenant la mort de... de mon meilleur ami.
SAQUEVILLE.
Que voulez-vous ! Un de nous deux était de trop dans ce monde. Cent fois je me suis dit que c’était moi qui devais mourir... mais on ne trouve pas toujours ce qu’on cherche. Pour moi, vous étiez une esclave... lui un tyran... et je ne pouvais le tuer... Oui, je me suis réjoui de sa mort.
LA MARQUISE.
Encore ! Épargnez-moi, de grâce ! Votre emportement me fait mal.
SAQUEVILLE.
Autrefois vous l’auriez excusé ; autrefois...
LA MARQUISE.
Monsieur, ne me rappelez pas un temps... que je voudrais pouvoir oublier... que j’ai mérité peut-être d’oublier.
SAQUEVILLE.
Mérité ?
LA MARQUISE.
Oui, monsieur. Comptez-vous pour rien mes regrets, mes larmes, mes ardentes prières ?... Treize années passées dans l’expiation !...
Elle porte son mouchoir à ses yeux.
SAQUEVILLE.
Eh bien ! j’ai tort ; j’ai toujours tort. Que faut-il faire pour obtenir mon pardon ? Mais je ne sais rien cacher... à vous surtout. Excusez le langage d’un homme qui, s’il avait jamais su le monde, a vécu seul assez longtemps pour l’oublier. – Pardonnez-moi ; je ne voulais pas vous faire de la peine.
LA MARQUISE.
Ce que je n’ai point oublié, monsieur de Saqueville, c’est votre caractère si droit, si honorable... votre bonté que vous cachez, je ne sais pourquoi, sous une sauvagerie dont il vous serait pourtant si facile de vous défaire.
SAQUEVILLE, rapprochant sa chaise.
Ma lettre était celle d’un fou... d’un Bédouin... Mais, madame, si vous m’aviez écrit... au moins pour me faire des reproches... !
LA MARQUISE.
Mon Dieu ! monsieur, le pouvais-je alors ?
SAQUEVILLE.
Mais, maintenant, vous le pouvez... Un seul mot, – je vous l’ai déjà dit. Je vous aime comme il y a treize ans. Vous êtes libre. M’aimez-vous encore ?
LA MARQUISE.
Oh ! colonel, ne parlons pas de cela. Je suis une vieille femme, et j’ai une fille à marier.
SAQUEVILLE.
Voulez-vous me dire qu’à mon âge on ne doit pas être amoureux ? qu’un vieux soldat ne doit pas penser à se marier ? À la bonne heure ; mais vous, madame... consultez votre miroir.
LA MARQUISE.
Voilà, certes, une galanterie que je n’attendais pas d’un farouche Africain ! Mais laissons ces folies, mon cher monsieur Saqueville, et parlons de choses sérieuses. À notre âge, nous ne devons plus penser qu’au bonheur de nos enfants, car Louis est un fils pour vous ; il porte votre nom.
Elle rapproche sa chaise.
SAQUEVILLE.
Je l’aime comme un fils ; mais qui empêcherait...
LA MARQUISE.
Oh ! laissez-moi parler... Votre neveu aime ma fille et lui plaît ; il y a longtemps que je m’en aperçois avec plaisir... Ce sont deux caractères faits l’un pour l’autre... Nous les marions, mon ami. Je sais que vous êtes devenu fort riche... À propos, pourquoi ne m’en avez-vous rien dit dans cette fameuse lettre ?
SAQUEVILLE.
Je n’y ai pas pensé.
LA MARQUISE.
C’est bien de vous ! – Votre neveu est un jeune homme rempli de distinction et de mérite, parfaitement posé dans le monde. Sans nul doute il est appelé à une carrière brillante. Il faut qu’à nous deux nous l’aplanissions pour ces pauvres enfants. Je donne à ma fille...
SAQUEVILLE.
Si vous le désirez, je donnerai à Louis tout ce que m’a laissé madame de Ponthieu. Que me faut-il, à moi ? Un sabre, un cheval... Le roi et le ministre de la guerre ne m’en laisseront pas manquer. – Cette fortune, je ne l’ai acceptée qu’à cause de vous. À bord du vaisseau qui me ramenait en France, je pensais que je vous ferais construire la plus belle serre de Paris. Ces fleurs que vous aimez tant...
LA MARQUISE.
Vous me croyez donc toujours une étourdie de vingt ans, mon ami ? Grâce à Dieu, je ne suis plus cette femme frivole que vous avez connue il y a bien longtemps... Parlons raison maintenant. Non, il ne faut pas vous dépouiller pour votre neveu. Une fortune trop considérable, c’est un danger immense pour la jeunesse. Assurons-leur une existence agréable, indépendante, heureuse... Vous êtes toujours trop généreux.
SAQUEVILLE.
Vous arrangerez tout vous-même ; mais vous pensez au bonheur de Louis et vous ne pensez pas à celui de son oncle. Dites-moi, vos projets seraient-ils donc dérangés, si nos enfants et nous n’avions qu’une maison ? Auprès de vous, votre fille trouverait tous les exemples qu’une bonne femme doit suivre. Moi, j’apprendrais à Louis à aimer sa femme...
LA MARQUISE.
Toujours ! Ah ! colonel, pensez-y donc ! À quarante ans passés, me remarier ! Que dirait-on dans le monde
SAQUEVILLE.
Eh ! qu’importe le monde ?
LA MARQUISE.
Toutes les femmes que je vois m’accableraient. Vous avez beau dire, il faut bien que nous vivions pour les gens qui nous entourent. J’ai mes habitudes... ma société... c’est ma vie.
SAQUEVILLE.
Rien de tout cela ne changerait... Vous auriez un domestique de plus.
LA MARQUISE.
Non, mon ami. Je sens tout ce qu’il y a de noble et de vraiment dévoué dans ce que vous me dites ; mais je suis un être brisé par l’orage... Je ne puis vous offrir qu’une amitié douce... Oh ! monsieur de Saqueville, vraiment, c’est trop ridicule pour de vieilles gens comme nous...
SAQUEVILLE, renversant une chaise.
Voilà les femmes de Paris ! Elles font mourir un homme pour n’être pas ridicules !
LA MARQUISE.
Ne cassez pas mes chaises.
SAQUEVILLE.
Vous plaisantez, quand vous me faites souffrir horriblement !
LA MARQUISE.
Ne vous emportez pas, mon ami, cette explication me fait assez de mal. Faut-il vous dire tout ?... Ces médisances cruelles... que votre départ si généreux a fait taire, ce mariage les réveillerait ! Oh ! mon Dieu !
SAQUEVILLE.
Si quelqu’un...
LA MARQUISE.
Non, non, mon ami. La marquise de Montrichard se remariant... oh ! songez donc à ce qu’on dirait... D’ailleurs, n’ai-je pas exprimé assez publiquement mon opinion sur les secondes noces ?
SAQUEVILLE.
Comment ! publiquement ?...
LA MARQUISE.
Ah ! c’est vrai, vous n’avez pas lu mon livre sur les Devoirs des Femmes. J’aurais dû vous l’envoyer. Mon Dieu ! je n’ai plus d’autre exemplaire que celui de miss Jackson... mais on fait une seconde édition...
SAQUEVILLE.
Mais que diable ce livre peut-il faire, si...
LA MARQUISE, se levant.
Oh ! ne me tourmentez pas, mon ami, ne soyez pas ridicule. Tenez, regardez ces deux aimables enfants qui s’en viennent à nous. Comme ils sont bien faits, grands, jeunes ! Ne vous sentez-vous pas assez heureux de leur bonheur... en voyant comme ils s’aiment ?
Julie rentre avec Louis, miss Jackson et M. Sévin.
Scène V
SAQUEVILLE, LA MARQUISE, JULIE, LOUIS, MISS JACKSON et MONSIEUR SÉVIN
JULIE, à Louis.
Vous ne savez ce que vous dites ! C’est Whitefoot qui gagnera.
LOUIS.
Gageons douze paires de gants que c’est Mascara.
JULIE.
Donc !
MONSIEUR SÉVIN.
Madame la marquise, il est tard ; il faut que je prenne congé de vous. Demain matin, de bonne heure, je passerai chez l’imprimeur, et je verrai ces pauvres gens que vous savez.
LA MARQUISE.
Vous êtes la bonté même, monsieur Sévin ; mais, écoutez, ce n’est pas tout d’être malheureux, il faut voir d’abord si ces gens vivent régulièrement.
MONSIEUR SÉVIN.
Aussi, je compte passer d’abord chez l’abbé Ballon.
LA MARQUISE.
C’est le plus sûr. Tout ce que vous ferez sera bien. Adieu, mon cher monsieur Sévin.
LOUIS.
Mon oncle, il faut aussi songer à la retraite.
JULIE.
Déjà ? Mon Dieu ! que je déteste les gens qui se couchent de bonne heure ! J’avais un million de choses à vous dire, colonel. J’imagine que vous avez des chevaux arabes. Présentez-les-moi. On dit que je monte comme Caroline.
LOUIS.
C’est vrai.
SAQUEVILLE.
Je n’ai pas de chevaux à Paris.
JULIE.
Oh bien ! vous trouverez ici une bête qui vous fera travailler. Votre neveu s’en abstient prudemment... Vous verrez que je suis en état de faire une razzia avec vos spahis. – Mère, nous allons tous un de ces jours en Afrique, aux bains de...
À Saqueville.
Comment dites-vous ?
SAQUEVILLE.
Sidi-Hhamdan.
JULIE.
À la bonne heure, mais je ne me charge pas de’ demander le chemin. Le colonel nous fera venir je ne sais combien de tribus qui nous apporteront des plumes d’autruche, des dattes, et qui nous feront des fantasias. Vous viendrez, monsieur Sévin, et vous sermonnerez les Arabes. – Et vous, monsieur de Saqueville junior, vous étudierez sur les lieux la question de la colonisation. Le colonel et moi, nous irons raser un douar, et nous vendrons miss Jackson à Abd-el-Kader.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia !
SAQUEVILLE, à la marquise.
Et vous, madame, ne venez-vous pas en Algérie avec nous ?
LA MARQUISE.
Je suis trop vieille pour voyager, mon cher colonel. Adieu, messieurs.
Bas à Saqueville.
Eh bien ! je vous enverrai un de ces jours mon notaire. Adieu. – Ah ! miss Jackson, prêtez votre exemplaire au colonel. – Vous m’en direz votre avis, n’est-ce pas ? – avec votre franchise... brutale...
IV
Scène première
SAQUEVILLE est assis à lire, entre MONSIEUR KERMOUTON, décoré
L’appartement de Saqueville dans un hôtel garni.
MONSIEUR KERMOUTON.
Monsieur, je vous demande bien pardon si je vous dérange.
SAQUEVILLE.
Qu’y a-t-il pour votre service, monsieur ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Vous ne me remettez pas, monsieur ?... Kermouton ! J’ai eu l’honneur de vous voir chez monsieur votre neveu. Comment se porte cette dame ?...
SAQUEVILLE.
Que désirez-vous, monsieur ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Je viens de chez monsieur votre neveu ; on m’a dit qu’il était allé chez vous, et j’ai pris la confiance de venir ici, tant mon impatience était grande de lui porter l’hommage de ma gratitude. On m’a bien dit qu’un autre monsieur s’était employé pour moi, mais je tiens de monsieur votre neveu lui-même...
SAQUEVILLE.
Quel service ?
MONSIEUR KERMOUTON, montrant son ruban.
Vous voyez.
SAQUEVILLE.
Ah ! c’est lui qui vous a fait avoir ce ruban rouge ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Oui, monsieur ; il a eu la bonté de m’écrire, le soir même que j’ai eu l’honneur de vous voir, qu’il avait causé avec le ministre, et l’effet n’a pas tardé à suivre la promesse. Il peut compter qu’il a gagné un ami dévoué.
SAQUEVILLE.
Je ne lui savais pas tant de crédit.
MONSIEUR KERMOUTON.
Monsieur, il connaît tous les ministres. Ils font tout ce qu’il leur demande, et il est l’obligeance même. Aussi, aux prochaines élections, il verra si je m’épargne pour lui.
SAQUEVILLE.
Ah ! ah ! affaire électorale.
MONSIEUR KERMOUTON.
Oui, monsieur ; mais ce n’est pas la seule dont j’avais à l’entretenir, – à vous entretenir aussi, vous surtout, monsieur, si vous le permettez... Je suis père, monsieur ; j’ai une fille... une fille à marier...
SAQUEVILLE.
Je ne suis point à marier, monsieur.
MONSIEUR KERMOUTON.
Permettez-moi d’achever. La Providence m’a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles, et j’ose dire que, par mon industrie, j’ai fait une fortune assez honnête...
SAQUEVILLE.
Tant mieux pour vous.
MONSIEUR KERMOUTON.
Considérable, monsieur. Aussi la fille de Kermouton a-t-elle une dot comme n’en ont pas bien des filles de pairs de France ou d’agents de change. Je n’ai rien épargné pour son éducation, je lui ai donné les meilleurs maîtres de Morlaix. Elle touche du piano, elle chante la Normandie de manière à mériter les suffrages de tous les connaisseurs.
SAQUEVILLE.
Où voulez-vous en venir ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Monsieur, monsieur votre neveu est votre héritier, je pense...
SAQUEVILLE.
Oui ; mais après ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Et vous, héritier de madame de Ponthieu, qui avait la terre de Plouhely. Nous sommes donc voisins ; il ne tient qu’à vous que nous soyons alliés. Je suis franc comme un Breton, vous le voyez, monsieur.
SAQUEVILLE.
Alliés !
MONSIEUR KERMOUTON.
Oui, monsieur. Je cherche ici un parti pour ma fille, qui veut habiter la capitale. Votre neveu a un beau nom, il a des espérances ; il va être député, et je n’y nuirai pas. Il connaît les ministres : une belle place ne peut lui manquer, quand il voudra... Souffrez que je continue. Voilà pour un côté ; de l’autre, je donne à ma fille huit cent mille francs, – cinq cent mille francs, écus ; le reste...
SAQUEVILLE.
Monsieur, je suis forcé de vous interrompre : mon neveu a un engagement. J’en suis désolé, mais mademoiselle votre fille trouvera assurément un bon parti par le temps qui court.
MONSIEUR KERMOUTON.
Est-ce signé cet engagement, Monsieur ? Veuillez considérer, Monsieur, que cinq cent mille francs écus, et trois cent mille en bons effets, ne se rencontrent pas tous les jours. Bien des demoiselles du grand monde...
SAQUEVILLE.
Monsieur, je vous le répète, il n’y faut plus songer : il a un engagement ailleurs.
MONSIEUR KERMOUTON.
On m’avait pourtant dit qu’avec mademoiselle de Montrichard rien n’était encore conclu. Je ne sais si vous êtes informé que feu M. le marquis de Montrichard a laissé des affaires... embarrassées, dit-on ?
SAQUEVILLE.
Peu importe.
MONSIEUR KERMOUTON.
Oserai-je vous demander si vous avez l’assurance que monsieur votre neveu désire ce mariage ? une personne que j’avais chargée de le sonder...
SAQUEVILLE.
Eh bien, Monsieur ?...
MONSIEUR KERMOUTON.
Eh bien, Monsieur, monsieur votre neveu n’avait pas parlé d’un engagement positif.
SAQUEVILLE.
On vous a trompé, Monsieur. Je ne sais quelles gens vous avez chargés de pareilles commissions ; on s’est étrangement mépris.
MONSIEUR KERMOUTON.
Cependant...
SAQUEVILLE.
Brisons là, Monsieur ; excusez-moi, je suis obligé de sortir.
MONSIEUR KERMOUTON.
Je regrette, Monsieur, que cette affaire ne puisse avoir lieu ; très humble serviteur. Quand vous irez à Plouhely, vous me permettrez de venir vous offrir mes civilités.
Il se dirige vers la porte.
SAQUEVILLE.
Bonjour, Monsieur.
Le rappelant.
Ah ! monsieur Kermouton !
MONSIEUR KERMOUTON.
Plaît-il, Monsieur ?
SAQUEVILLE.
Pardon ; vous disiez que les affaires de M. de Montrichard étaient dérangées ?
MONSIEUR KERMOUTON.
Mon Dieu, Monsieur, chez les grands seigneurs tout ce qui reluit n’est pas or... tandis que nous autres, propriétaires industriels...
SAQUEVILLE, se parlant à lui-même.
Oh ! tant mieux ! Ainsi elle est ruinée...
MONSIEUR KERMOUTON.
Oh ! je ne dis pas cela. J’ai dit des affaires embarrassées... ni plus ni moins. Très humble serviteur.
Il sort.
SAQUEVILLE, seul.
Voilà la première fois que je me trouve heureux d’être riche ! quel bonheur si elle était ruinée !
Il s’assied et reprend son livre.
Maudit livre ! quelle diable d’idée de lire saint Augustin et saint Cyprien... et de quoi se mêlaient-ils !
Scène II
SAQUEVILLE, LOUIS
LOUIS, entrant.
Bonjour, mon oncle. Eh bien, avez-vous achevé votre volume ?
SAQUEVILLE.
À peu près.
LOUIS.
Et vous avez compris ?
SAQUEVILLE.
Comment ?
LOUIS.
Tout le monde n’a pas l’esprit de comprendre les chefs-d’œuvre.
SAQUEVILLE.
Point de méchantes plaisanteries. Eh bien, tu as diné hier à Montrichard ? Y avait-il du monde ?
LOUIS.
Personne. Sévin et moi.
SAQUEVILLE, bas.
Sévin !
Haut.
Qu’y fait-on ? que dit-on ?
LOUIS.
On y fait de l’esprit.
SAQUEVILLE.
Et Marie... ? et Julie ?
LOUIS.
Très bien. Elle n’est pas tombée à l’eau.
SAQUEVILLE.
Qu’as-tu ? tu as l’air triste et préoccupé ? Est-ce que ton élection va mal ?
LOUIS.
Non pas... mais... mon oncle... Voyons... la main sur la conscience, dites-moi, comment trouvez-vous mademoiselle de Montrichard ?
SAQUEVILLE.
Une charmante enfant.
LOUIS.
Oui, charmante enfant ; mais elle n’en aura pas plutôt fait un qu’elle deviendra forte comme sa mère.
SAQUEVILLE.
Comment ! sa mère a un port de reine !
LOUIS.
Mais, laissant de côté les perfections physiques... que dites-vous de son caractère ?
SAQUEVILLE.
À quoi tendent toutes ces questions ?
LOUIS.
À vous demander si vous ne la trouvez pas la demoiselle la plus mal élevée de Paris.
SAQUEVILLE.
Mort Dieu ! que dis-tu là ?
LOUIS.
Ce que dit tout le monde ; Sévin tout le premier : capricieuse, frivole, entêtée, parfois impertinente...
SAQUEVILLE.
Ah ! je comprends ; elle t’a fait une scène, et tu l’avais méritée. Elle aura su quelque chose de ton rat, comme tu l’appelles.
LOUIS.
Ah bien oui ! soyez assuré que la jalousie n’est pas au nombre de ses défauts... mais il sera bon peut-être que son mari en soit exempt...
SAQUEVILLE.
Louis !
LOUIS.
Je sais que ces manières-là sont fort à la mode ; elle ne les invente pas, elle les copie de madame de Roseville. Or, le mariage étant, grâce à nos lois, une union indissoluble, l’accord des caractères serait une des conditions accessoires qu’il ne faudrait pas trop négliger dans ma position.
SAQUEVILLE.
L’accord des caractères I mais c’est ce que tu aurais dû examiner tout d’abord. Est-ce maintenant que tu es engagé ?...
LOUIS.
Engagé... engagé...
SAQUEVILLE.
Oui, engagé. Comment, sur un prétexte frivole !...
LOUIS.
Mon Dieu ! mon oncle... de prétexte je n’en ai pas besoin. Chaque jour me montre plus clairement qu’on ne se soucie pas de moi.
SAQUEVILLE.
Es-tu fou ? Hier encore tu me parlais d’elle avec enthousiasme.
LOUIS.
Ma foi ! je faisais contre fortune bon cœur ; mais il faut bien se rendre à l’évidence : je suis sûr qu’elle ne veut pas de moi ; j’en ai cent preuves pour une.
SAQUEVILLE.
Quelles preuves ? parle !
LOUIS.
Eh bien !... par exemple... Elle me traite comme un nègre... Tenez, le plus sage pour moi serait de ne jamais remettre les pieds dans cette maison-là. Ma mère me disait bien qu’une fille élevée dans le monde... à Paris... n’est bonne qu’à faire enrager un honnête homme... Moi, je me considère comme dégagé.
SAQUEVILLE.
Mais, au nom du ciel ! que s’est-il passé ?
LOUIS.
Faut-il attendre qu’on me mette à la porte ?... Au reste, apparemment que je ne suis pas destiné à mourir vierge et martyr, car on me propose une femme d’un autre côté, et de province...
SAQUEVILLE.
Voilà qui est singulier ; tout à l’heure on m’en offrait une pour toi, de province aussi.
LOUIS.
Tant mieux, nous aurons du choix ; la mienne, c’est la tille d’un industriel fort riche, que j’ai obligé...
SAQUEVILLE.
Un M. Kermouton est venu m’offrir sa fille...
LOUIS.
Ah ! Qu’avez-vous répondu ?
SAQUEVILLE.
Je l’ai envoyé promener.
LOUIS.
Mon oncle, mais vous ne savez donc pas qui est cet homme-là ! Moi non plus, je ne le connaissais guère. Savez-vous que tout l’arrondissement est à lui, qu’il a plusieurs millions, qu’il paie trente-deux mille francs de contributions directes, qu’il a des fabriques partout... et qu’il m’adore.
SAQUEVILLE.
Parce que tu lui as fait avoir la croix d’honneur. Morbleu ! en voilà une bien gagnée... parce qu’il a tant fait que d’être millionnaire. Et mon pauvre Robin, qui a reçu trois coups de feu, qui a été mis quatre fois à l’ordre de l’armée... je n’ai pu l’obtenir pour lui.
LOUIS.
Oh ! bien, donnez-moi une note. Qu’est-ce que c’est que ce Robin ? un officier ?
SAQUEVILLE.
Un brigadier, le plus brave des hommes...
LOUIS.
Ah ! c’est plus difficile ! mais nous verrons... D’abord, mon oncle, quant à M. de Kermouton... un homme si riche... un grand manufacturier... c’était une honte qu’il n’eût pas la croix. Et puis cela lui faisait tant de plaisir !
SAQUEVILLE.
À ta place, je rougirais de m’être mêlé de cette affaire-là.
LOUIS.
Mon Dieu ! on en voit bien d’autres, et de pires que lui... Mais enfin que vous disait-il ?
SAQUEVILLE.
Que sais-je ? Je ne l’ai pas seulement écouté.
LOUIS.
Tant pis. Sa fille est une charmante personne. Dix-neuf ans, brune, grande musicienne... ne sachant que le bas-breton et un peu de français... élevée dans un couvent de Morlaix... ni frères, ni sœurs... des habitudes d’économie, éducation de province, des mœurs, de la dévotion...
SAQUEVILLE.
Tu l’as vue ?
LOUIS.
Non, mon oncle... Mais je suis si irrité... on m’a tellement mystifié, voyez-vous, qu’il faut que je me venge. Je veux leur montrer que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs d’un plus haut prix. J’épouserais, je crois, la fille du diable...
SAQUEVILLE.
Si elle avait une bonne dot... je le crois.
LOUIS.
Et, à propos de dot, la petite Montrichard aura-t-elle seulement ce qu’on nous annonce ? Sa mère est une belle dame qui fait des livres, qui tient bureau d’esprit, qui donne des raouts, et qui bâtit des écoles et des hospices pour les filles repentantes, avec cent autres bêtises.
SAQUEVILLE.
Louis !
LOUIS.
Quoi, mon oncle ?
SAQUEVILLE.
Non ! c’est impossible ! tu sors d’un trop bon sang pour être un lâche gredin.
LOUIS.
Comment, mon oncle ?...
SAQUEVILLE.
Que le diable t’emporte ! Tu dis tout sur le même ton. Je ne sais jamais si tu plaisantes ou si tu parles sérieusement... Mais, morbleu ! si tu t’avisais !... Oh ! cela est impossible !... Tiens, je vois bien ce qui est arrivé... Querelles d’amants ! Cela se raccommode vite... à ton âge. Je vais à Montrichard, je fais ta paix, et tu ne me parleras plus de ton Kermouton ni de son infernale fille qui parle un peu français... ou bien... que le tonnerre m’écrase si jamais !... Oh ! mais, je suis fou ! – Je vais à Montrichard...
LOUIS.
Mon oncle, je suis désespéré de vous avoir mis en colère... mais daignez considérer... Voyez la demoiselle vous-même... Je ne sais ce qu’elle vous dira... mais observez-la... étudiez-la. Elle ne peut me souffrir... Demandez à Sévin !
SAQUEVILLE.
Morbleu ! qu’ai-je affaire de Sévin !
LOUIS.
Il est de bon conseil, et la marquise, vous le savez, n’a pas de secrets pour lui.
SAQUEVILLE.
Il trouve la petite...
LOUIS.
Au moins, mon oncle, n’allez pas...
SAQUEVILLE.
Laisse-moi, te dis-je. Je n’écoute rien que je n’aie vu Julie.
LOUIS.
Gardez-vous de leur dire à brûle-pourpoint... Il faudrait que la rupture... puisqu’elle est inévitable, vînt de leur côté...
SAQUEVILLE.
Mais, malheureux ! te tairas-tu !
Il sort.
LOUIS, seul.
Je ne le savais pas si violent. Peut-être ai-je été un peu trop prompt. Bah ! je n’ai pas peur qu’elle dise du bien de moi.
V
Scène première
JULIE, MISS JACKSON
Un salon.
JULIE, au piano, chante.
Mon bien-aimé d’amour s’enivre.
La ila il Allah, oua Mohhammed raçoul Allah ! Allah ou akbar. Ya al’ esselah... Est-ce comme cela ?
MISS JACKSON.
Très bien, miss Julia ; mais pourquoi toujours le désert ? Un peu de Bellini maintenant.
JULIE.
J’aime cette voix qui meurt. Al’ esselah, ah, ah, ah. Cela doit bien faire, la nuit, au bivouac, par un beau clair de lune.
MISS JACKSON.
Oh ! oui.
JULIE.
Miss Jackson ?
MISS JACKSON.
Quoi, miss Julia ?
JULIE.
Miss Jackson... Avez-vous été jamais amoureuse de quelqu’un ?
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia ! For shame !
JULIE.
Voyons, dites-le franchement. C’est impossible qu’avec des yeux si bleus vous n’ayez pas fait quelque passion. Avouez-le, vous avez été amoureuse de quelqu’un.
MISS JACKSON.
Fi donc ! Si madame la marquise vous entendait !
JULIE.
Je voudrais savoir à quoi on reconnaît qu’on est amoureuse... Être longtemps à s’endormir, c’est un symptôme, n’est-ce pas ? Vous vous tourniez dans votre lit, j’en suis sûre, comme Gipsey quand il va se coucher sur son coussin.
MISS JACKSON.
Les symptômes de l’amour, Shakespeare les décrit ainsi : « Le pourpoint mal boutonné... pas de chapeau sur la tête... les bas qui tombent sur les talons[1]... »
JULIE.
Ah ! fi donc, miss Jackson ; il n’y a que les Anglaises pour être amoureuses comme cela. Moi, quand je ferme les yeux, je vois de grands drapeaux tout chamarrés d’or, des chevaux arabes qui piaffent, des coups de fusil, des ballots de cachemires hauts comme la maison, des tapis à ramages, et cent mille figures basanées qui crient : Vive madame la maréchale ! Vive madame la Gouvernante !
MISS JACKSON.
Oh ! comment voyez-vous tant de choses !
JULIE.
In the mind’s eye, Horatio. N’est-ce pas que cela doit être fort joli ?
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia ; vraiment, vous voudriez aller à Alger ?
JULIE.
Oui, ma belle. Mais, dites-moi, je voudrais bien savoir si je suis amoureuse pour de bon. Tâtez-moi le pouls. Je ne me sens pas de pouls. Ce doit être un grand symptôme. Savez-vous tirer les cartes ?
MISS JACKSON.
Non.
JULIE.
Il faut que je voie une somnambule pour savoir si j’irai à Alger.
MISS JACKSON.
Vous irez avec M. de Saqueville voir son oncle à Alger.
JULIE.
Oh ! que je n’aimerais pas voyager dix lieues avec M. Louis de Saqueville. Quand il a fait un mauvais dîner, ce doit être un homme affreux !
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia, c’est un si aimable jeune homme !
JULIE.
Pour ses électeurs... mais comme sa femme s’ennuiera.
MISS JACKSON.
Non, miss Julia, vous ne vous ennuierez pas.
JULIE, étendant la main.
Non, je ne m’ennuierai pas, je me suis déjà trop ennuyée : j’en fais le serment. Savez-vous ce que cela veut dire, miss Jackson ? – Comment trouvez-vous cette main-là ? Et ces ongles... roses... grâce à la pommade onychophane... c’est trop joli pour un député. – Miss Jackson, sans bêtises, c’est que je suis amoureuse, passionnée, furieuse, miss Jackson. – Si vous vous avisez de faire de grands yeux et d’ouvrir ainsi la bouche comme une boîte aux lettres, je fais des folies. J’envoie une déclaration en quatre pages à mon objet. M’en défiez-vous ?
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia ! est-il possible ! Comment vous n’aimez plus M. Louis de Saqueville ? Qui donc ?
JULIE.
Qui donc ! qui donc ! c’est bien difficile à deviner. Allez-vous faire la bête maintenant ? Voyons. Essayez de dire que l’oncle ne vaut pas mieux que le neveu. Essayez pour voir, et je vous arrache les yeux... Dites, si vous l’osez, du mal de l’oncle.
Elle la pince et lui tire les cheveux.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia, vous me faites mal avec vos ongles.
JULIE.
Ah ! très joli ! très joli ! Miss Jackson a fait un calembour ! Que je vous embrasse pour la peine, miss Jackson. – C’est très fort pour une insulaire, dans un âge si tendre... Mais d’abord je voudrais bien savoir ce que vous pourriez dire contre mon choix...
MISS JACKSON.
Premièrement, vous êtes engagée.
JULIE.
Secondement, je me dégage.
MISS JACKSON.
Et puis, il a quarante ou quarante-cinq ans.
JULIE.
Il n’en paraît pas plus de quarante-quatre et demi. Je les aime comme cela. Après ? – Il a une belle moustache, que je lui ferai mettre en papillote, et il a les cheveux encore très noirs... couleur solide.
MISS JACKSON.
Mais bientôt il deviendra gris.
JULIE.
Bientôt ! bientôt n’arrive jamais. Dans je ne sais combien de temps il sera gris, l’année prochaine... après la saison... au moment de partir pour les eaux. Qu’importe ?
MISS JACKSON.
Miss Julia, vous êtes trop jeune.
JULIE.
Trop jeune ! j’ai bientôt vingt ans. La duchesse de Roseville était libre à vingt ans ! Il y a deux ans qu’elle est mariée, et moi, il y a quatre ans que je vis dans un enfer. Oh ! miss Jackson, comme je me suis ennuyée depuis que je suis au monde ! Des comités de bienfaisance, de la tapisserie, des crèches, de la théologie et des théologiens ! Oh ! miss Jackson ! est-ce là vivre quand on est jeune et pas trop laide !
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia !
JULIE.
Mais raisonnons un peu, miss Jackson, et voyez si je suis pas une fille sensée ? Premièrement, c’est un héros : vous êtes forcée d’en convenir. Secondement, il a cent mille livres de rente, et avec cela, et ce que j’aurai de mon père, je tiendrai une maison charmante dont on parlera, vous verrez. À propos, comment trouvez-vous ma mère, qui lui demande tout bonnement la moitié de sa fortune pour que monsieur son neveu fasse manger du veau à ses Bas-Bretons ! Vous figurez-vous la mine que je ferais avec des Morlaisiens ! Où est-ce Morlaix ? – En résumé, ma chère, vous voyez bien que je suis très raisonnable. Au lieu de cinquante mille francs de rente, j’en préfère cent mille. Vous voyez que j’ai profité de vos leçons d’arithmétique. On dira : Elle épouse un homme qui pourrait être son père. Qu’est-ce que cela me fait, pourvu qu’on me trouve jeune ? Nous allons à Alger. Il va être général. Grande entrée triomphale... On me donne des écharpes brodées, des chevaux arabes. – J’envoie des bracelets à la duchesse de Roseville, et vous, je vous marie à un cheik. Mettez-moi cela en turban.
Elle lui présente un châle.
MISS JACKSON.
Un cheik !
JULIE.
Oui, un cheik, et, si vous dites quelque chose, à un marabout. Puis viendra le moment d’entrer en campagne. Alors quelle séparation déchirante ! J’attends les bulletins avec une impatience anxieuse, comme dit M. Sévin. Vous me lirez le Moniteur. Je serai couchée sur un divan, dans un petit salon tendu en satin blanc à fleurs, avec une bordure en versets du Coran. Là, je ne reçois pas un ennuyeux. Ma mère laissera son Sévin à la porte avec les parapluies. Nous nous amuserons comme des bienheureuses. – Arrangez donc mieux mon turban, un peu plus de côté... crânement, comme dit Marie de Roseville.
MISS JACKSON.
Et puis un bulletin viendra, et on lira : Le général a été tué.
JULIE.
Ah ! bah ! comment voulez-vous que cela arrive ! J’ai vraiment bon air avec un turban. – Est-ce qu’on est jamais veuve à vingt ans ? Savez-vous ce que je ferais alors. Je ne me remarierais jamais. Je me loge avec Marie de Roseville, qui est comme veuve, puisque le duc ne sort pas de son fauteuil, et nous nous consolons en faisant enrager tous les hommes. Mais regardez-moi donc, et dites-moi si je n’étais pas née pour être la femme d’un pacha ou d’un général algérien ? En vérité, je ne veux plus porter que des turbans.
MISS JACKSON.
Oh ! miss Julia ! C’est l’heure où M. Louis de Saqueville vient. Ôtez cela.
JULIE.
Oh ! miss Jackson. Et si l’oncle allait venir sur son grand cheval de bataille ?... Ma foi ! je saute en croupe et je galope avec lui. Au désert ! au désert ! – J’entends un cheval ?
MISS JACKSON, regardant à la fenêtre.
Oh ! miss Julia... Eh mais ! c’est lui-même ! Pour l’amour du ciel, ôtez ce turban ! Mon Dieu ! que pensera-t-il ?
Saqueville entre.
Scène II
JULIE, MISS JACKSON, puis SAQUEVILLE
JULIE.
Salamalek !
SAQUEVILLE.
Alekoum Salam. – Vous êtes charmante en ce costume ! Comment est madame votre mère ?
JULIE.
Elle est dans sa chambre, qui corrige une épreuve avec M. Sévin. Résignez-vous, vous m’appartenez.
SAQUEVILLE.
Je me résigne, et sans difficulté, car je viens surtout pour vous voir et pour vous parler... Mais que faisiez-vous donc ? Vous jouiez des charades avec miss Jackson ?
JULIE.
Demandez-lui ce que nous faisions... et ce que nous disions.
MISS JACKSON, bas.
For shame !
SAQUEVILLE.
Je crains d’arriver en trouble-fête. Il faut pourtant que vous m’accordiez cinq minutes d’audience. Savez-vous que j’ai à vous parler... et très sérieusement ?
JULIE.
En effet, je vous trouve la mine que vous devez avoir un jour de razzia. – Allons, venez par ici. – Miss Jackson, faites-moi l’amitié de rester à votre place et de broder cela lestement. – Prenez un siège, Cinna.
SAQUEVILLE.
Je regrette d’être si vieux, quand je vois la gaieté de votre âge. – Dites-moi, vous avez vu Louis hier ?
JULIE, avec distraction.
Si je l’ai vu hier ?... Attendez...
SAQUEVILLE.
Comment ! vous ne savez pas ?
JULIE.
Ah ! oui, je me rappelle ; il avait son cheval bai, qui porte si mal les oreilles.
SAQUEVILLE.
De quoi avez-vous parlé ?
JULIE.
Mais c’est donc un interrogatoire en forme ?
SAQUEVILLE.
Vous avez causé ensemble...
JULIE.
Probablement ; mais de quoi ? je l’ai oublié... ah ! d’élections sans doute.
SAQUEVILLE.
Il a tort d’en parler à d’autres qu’à ses électeurs ; mais je crains que vous ne l’ayez peut-être... un peu... querellé...
JULIE.
Moi, le quereller ! oh ! mon Dieu, non ! Une querelle avec lui ! Je n’aurai jamais de querelles qu’avec une personne... pour qui... Tenez, j’en aurais peut-être avec vous.
SAQUEVILLE.
Oh ! j’espère bien ne jamais mériter votre courroux. Écoutez-moi, ma chère enfant... vous me permettez de vous appeler ainsi... Nous autres hommes, nous accusons les femmes d’exigences et de susceptibilité... et nous sommes cent fois plus exigeants et susceptibles qu’elles... C’est que pour un homme... c’est une peine... bien cruelle, voyez-vous... d’aimer, de nourrir une affection que nous sentons n’être pas partagée... il n’y a pas au monde de plus grand malheur. Vous traitez mal mon pauvre Louis.
JULIE.
Comment cela ?
SAQUEVILLE.
Je m’en aperçois moi-même. Vous n’avez pas pour lui...
JULIE.
Que faut-il donc que j’aie ?
SAQUEVILLE.
Tout ceci est bien délicat à dire... mais vous excuserez l’indiscrétion d’un homme qui a vécu si longtemps parmi les sauvages... Vous ne paraissez pas avoir pour lui l’affection à laquelle peut prétendre la personne qui vous est destinée.
JULIE.
Il trouve que je manque d’affection ?
SAQUEVILLE.
Il s’en désole et s’en irrite, au lieu de chercher à la gagner, cette affection. – Voyons, ma chère Julie, parlez-moi à cœur ouvert. À mon âge, vous pouvez me dire bien des choses... Quoique vieux, j’aime la jeunesse... Que vous n’aimiez pas Louis, cela peut tenir à deux causes... ou bien vous n’aimez encore personne... C’est cela, sans doute... vous êtes si jeune, et votre éducation...
JULIE.
En effet, on nous défendait cela au couvent, et de nous manger les ongles.
SAQUEVILLE.
Vous dites cela singulièrement. Regardez-moi, je suis un peu physionomiste. Au travers de ce joli sourire, je vois une petite moue qui m’effraie... Après tout, un attachement ne se commande pas... Vous avez peut-être cru trouver ailleurs ce qui manque à Louis : cette vivacité expansive, cet enthousiasme qu’à votre âge on croit la preuve d’une affection véritable.
Elle fait un signe de tête affirmatif.
Je le craignais ! – Écoutez-moi. Vous êtes bien jeune, bien jolie, sans expérience... Voilà de grandes chances pour mal placer son affection ; mais n’avez-vous pas près de vous une bonne mère qui vous aime, qui ne vit que pour vous ? C’est votre meilleure amie, c’est elle que vous devez consulter.
JULIE.
C’est qu’elle corrige ses épreuves.
SAQUEVILLE.
Ah ! – Ainsi vous aimez... et ce n’est pas le pauvre Louis que vous aimez... Je ne vous en parlerai plus... Je ne pense maintenant qu’à vous seule... Au moins, celui que vous aimez, êtes-vous sûre qu’il soit digne de vous ?
JULIE, souriant avec malice.
Oui.
SAQUEVILLE.
On croit toujours ce qu’on désire. Regardez dans cette glace cette jolie tête rose et blanche... Demandez-vous si tant de grâces... si ce petit cœur si noble doivent appartenir à un fat.
JULIE.
Non, jamais !
SAQUEVILLE.
Votre accent me rassure. Je crois qu’il est digne de vous. Votre mère sait-elle que vous l’aimez ?
JULIE.
Non ; elle corrige...
SAQUEVILLE.
Ah ! laissez cette triste plaisanterie. Nous parlons, hélas ! du bonheur ou du malheur de toute votre vie, ma chère enfant. Je tremble, quand je pense qu’un homme peut ensorceler une pauvre jeune fille, parce qu’il danse bien.
JULIE.
Oh ! pour cela, je parie qu’il danse fort mal !
SAQUEVILLE.
Tant mieux, si c’est d’après des qualités plus recommandables que vous le jugez ; mais pourquoi ne parle-t-il pas à madame votre mère ?
JULIE.
Ah !... c’est que je ne sais pas trop s’il pense à moi.
SAQUEVILLE.
S’il pense à vous ! Ah ! Julie, Julie ! voilà un roman comme on en faisait de mon temps ! Vous aimez un inconnu qui vous aura sauvée de quelque danger au clair de la lune.
JULIE.
Peut-être.
SAQUEVILLE.
Folies, mon enfant, déplorables folies ! La contredanse valait mille fois mieux. – Comment ! il ne sait pas que vous l’aimez ? Mais c’est donc un imbécile ?...
JULIE, riant.
Oui... ou bien peut-être il ne se rend pas justice.
SAQUEVILLE.
Vous n’avez pas le sens commun, ma pauvre enfant ; mais vous voilà toute sérieuse, vous changez de couleur : est-ce une larme que je vois dans ces grands yeux ? Pauvre jeunesse ! pauvre jeunesse ! que de chagrins elle se prépare avec un seul moment d’étourderie ! – Enfin, ce bel inconnu...
MISS JACKSON, se levant avec inquiétude.
Miss Julia, madame la marquise doit avoir fini. Je vais la prévenir que le colonel est ici...
JULIE.
Non, je vais la prévenir moi-même...
Avec un rire forcé.
Dites-moi, colonel... en Algérie... les femmes sont voilées... c’est comme si les hommes étaient aveugles... Comment une femme s’y prend-elle... pour faire une déclaration ?...
SAQUEVILLE.
Mais vous pensez bien que je n’en ai guère reçu.
JULIE.
Mais d’autres plus heureux que vous... moins humbles...
SAQUEVILLE.
Vous me rappelez une assez ridicule histoire... J’entrais à Tlemcen, j’avais à côté de moi mon adjudant-major, brave officier, beau comme un ange. Dans la grande rue, une femme voilée prend la bride de son cheval, et lui jette un bouquet dans le pli de son burnous...
Julie lui jette son bouquet et sort en se cachant la figure.
SAQUEVILLE.
Ah !
MISS JACKSON.
Oh ! colonel ! colonel ! Oh ! poor miss Julia. Oh ! que dira madame la marquise !
Elle sort.
SAQUEVILLE, après un silence.
Pauvre enfant !
VI
Scène première
SAQUEVILLE, seul devant une table
L’appartement de Saqueville. Préparatifs de départ.
Il tient un paquet de lettres.
Faut-il rapporter cela en Afrique ? Pauvres lettres ! que de chemin vous avez déjà fait dans l’Atlas et dans le désert ! Plus d’une fois vous avez risqué d’allumer la pipe d’un Arabe ou d’un Kabyle. Faut-il vous exposer encore ?... ou, ce qui serait pire... le jour où le cheval du colonel ralliera seul le régiment, on vous lirait au bivouac, avec des commentaires moqueurs. – Non, le régiment ne rira pas ce jour-là, c’est là que je serai regretté... Je crois voir mes pauvres spahis le cœur gros et la larme à l’œil, tirant la dernière salve sur ma fosse... Allons ! Bismillah ! je ne suis pas seul au monde. Du courage ! – Il fut un temps où c’était un trésor pour moi... C’était comme un de ces talismans des Arabes avec lesquels ils se croient invulnérables, jusqu’au jour où vient une balle qui déchire le talisman et la poitrine qu’il couvrait. Le cœur est déchiré ! À quoi bon conserver le talisman ? – Ces violettes... ont encore de l’odeur... Elles ne compromettront personne. Conservons-les.
Il brûle les lettres.
Voilà qui est fini. Un peu de flamme, un peu de fumée, plus rien ! Il n’en faut pas davantage pour tuer un homme.
Un clerc de notaire entre.
Que demandez-vous, monsieur ?
Scène II
SAQUEVILLE, UN CLERC DE NOTAIRE
LE CLERC.
Monsieur, je suis clerc de M. Doublet, notaire de madame la marquise de Montrichard. Je vous apporte de la part du patron un projet de contrat pour le mariage de monsieur votre neveu, et un autre projet pour la donation que vous voulez faire en sa faveur.
SAQUEVILLE.
C’est bien, monsieur.
LE CLERC.
M. Doublet vous prie de lui renvoyer le tout quand vous en aurez conféré avec votre notaire, avec vos observations.
SAQUEVILLE.
Je vous remercie, monsieur. – Ah ! à propos d’actes, je voudrais bien vous consulter sur un testament que j’ai fait. Cela n’est pas long à lire. Est-il en bonne forme ?
Il lui donne un papier.
LE CLERC, après avoir lu.
Oui, monsieur. Seulement, permettez-moi de vous faire observer qu’il est singulier qu’au moment de faire une donation par contrat de mariage à monsieur votre neveu, vous léguiez votre fortune aux officiers, sous-officiers et soldats du 2e de spahis.
SAQUEVILLE.
Si mon neveu se marie, je ferai la donation que j’ai promise. Quant au reste, n’en puis-je disposer comme il me plaît ?
LE CLERC.
Indubitablement : mais...
SAQUEVILLE.
Le testament est-il valable ?
LE CLERC.
Olographe. Il est excellent ; mais...
SAQUEVILLE.
Cela suffit. Je vous remercie, monsieur.
Seul.
Louis ne pourra pas désirer ma mort. – C’est singulier qu’un si jeune homme tienne tant à l’argent. Il a raison. puisqu’il vit à Paris... Si j’y étais resté, peut-être serais-je comme lui. Il faut avoir été soldat pour apprendre à mépriser l’argent, et savoir qu’un bon camarade vaut mieux, au jour du danger, qu’un chameau chargé d’or... Pauvre garçon ! on l’a si mal élevé ! Et Julie ! malheureuse enfant ! À son âge, sa mère était enthousiaste comme elle... Aujourd’hui !... Je voudrais être déjà en Afrique.
Entre Danet.
Ah ! c’est toi, Danet ? Je ne te savais pas dans ce pays.
Scène III
SAQUEVILLE, DANET
DANET.
Salut, mon colonel. En passant dans la rue, j’ai vu votre domestique qui m’a dit que vous étiez ici, que vous partiez. J’ai pris la liberté de monter pour vous présenter mes devoirs.
SAQUEVILLE.
Eh bien ! tu nous a donc quittés, mon garçon ?
DANET.
Dame, oui. Mon temps était fini, mon colonel. J’ai voulu revoir ma famille.
SAQUEVILLE.
C’est bien. Ç’a été un grand plaisir pour toi.
DANET.
Mais comme ça. Le père était mort. Mon frère a pris l’hôtel, qui est bien achalandé... près de Juvisy... un bon hôtel de rouliers. Et puis après il m’a montré des comptes... des comptes... Il n’y a pas de maréchal des logis chef qui en fasse de si longs. Fin de compte, il m’a donné sept cent soixante-cinq francs soixante-dix centimes qui me revenaient pour ma moitié, soit disant. Je lui a dit : « Et ton hôtel ? » Il m’a dit : « C’est ma part, dit-il. J’ai fait des économies, de quoi je l’ai acheté. Plaide si tu veux. – Oui-dà, ai-je dit. » Voilà que je commence à le plaider, et l’avocat m’a mangé bien quatre cent cinquante francs. Moi, j’ai mangé le reste à bambocher, en attendant, avec des camarades. Maintenant je suis à sec, et l’avocat ne veut plus plaider. J’allais gagner pourtant, à ce qu’il disait.
SAQUEVILLE.
Ne plaide pas.
DANET.
Vous avez peut-être raison, mon colonel. Ce qui me chagrine, ce n’est pas tant l’argent, car je sais panser un cheval, vous le savez, et je gagne quelque chose avec M. Lacour, qui tient le manège royal ; ce qui me chagrine, c’est que l’avocat m’a refait, et puis... ma cousine que je devais épouser...
SAQUEVILLE.
Elle ne t’a pas attendu ?
DANET.
Je l’ai trouvée à son troisième enfant, et si changée que, sauf votre respect, je ne me chargerais pas de lui faire le quatrième.
SAQUEVILLE.
Que veux-tu, Danet ? les absents ont tort.
DANET.
Depuis que je suis en France, je me sens comme dépaysé. Je pense à l’Afrique ; et l’autre jour, en voyant un Arabe qui vendait des dattes... ça m’a fait un drôle d’effet. Je rêve du régiment et des camarades ; je pense à mon cheval Coco... Selim en a soin, j’espère.
SAQUEVILLE.
Oui, mais il commence à se faire vieux. – Vois-tu, Danet, quand on a été huit ans soldat, et bon soldat comme toi, le régiment, c’est la famille. C’est une famille où il n’y a pas de voleurs... Lorsque tu as mangé ton couscoussou et fumé ta pipe, tu t’endors en disant : « C’est un tel qui sera de garde... c’est bon, je puis dormir... quand ce sera mon tour... il pourra dormir tranquille. » Quant aux femmes... la meilleure, Danet, c’est la cantinière qui nous donne un verre d’eau-de-vie le soir, quand le vent de l’Atlas vient nous glacer la moelle des os.
DANET.
La mère Rabatjoie est-elle toujours au corps ?
SAQUEVILLE.
Toujours, et voilà son fils aspirant-trompette. C’est un petit drôle qui fera son chemin. Il sait lire et parle arabe comme un marabout. Danet, sais-tu ce que tu devrais faire ?
DANET.
Quoi, mon colonel ?
SAQUEVILLE.
Te réengager au deuxième spahis. Je pars dans une heure. Viens avec moi. Tu porteras mon fanion.
DANET.
Au fait ?... C’est dit ! Ai-je le temps d’aller chercher mon butin à mon garni ?
SAQUEVILLE, lui donnant de l’argent.
Va. Tiens, voilà pour payer ton garni.
DANET.
Merci, mon colonel. Je ne fais qu’aller et revenir au pas gymnastique.
Il sort.
Scène IV
SAQUEVILLE, LOUIS
LOUIS.
Eh bien ! mon oncle, vous partez ? Je viens de voir votre domestique qui charge une voiture.
SAQUEVILLE.
Oui.
LOUIS.
Si c’est pour cette chasse où nous sommes invités, je n’irai pas, moi. J’ai bien d’autres affaires en tête. Vous voyez un homme furieux.
SAQUEVILLE.
Pourquoi ?
LOUIS.
Je joue de malheur. Tout tourne contre moi. Sur qui peut-on compter aujourd’hui !
SAQUEVILLE.
Que t’arrive-t-il ?
LOUIS.
D’abord mon élection va fort mal. Le ministre m’a reçu aujourd’hui comme un chien dans un jeu de quilles. Il m’a reproché de le compromettre. Il m’a dit que je n’avais pas l’âge, et qu’il ne pouvait me soutenir.
SAQUEVILLE.
Il a raison ; mais il aurait dû te dire cela plus tôt.
LOUIS.
Mais plus tôt il ne s’était pas avisé d’un M. Dessaleurs, receveur-général, qui marie sa fille au neveu de Son Excellence, et qui cède sa recette générale au neveu de ce même ministre ; mais il me le paiera, et ce honteux marché sera rendu public.
SAQUEVILLE.
Tu es devenu trop susceptible ; c’est une chose toute simple.
LOUIS.
Un infâme journal me tympanise ce matin pour une mystification dont j’ai été victime. Un marchand de beurre est allé au ministère... de ma part, a-t-il dit... C’est un mensonge odieux... On fait entendre que j’achète les électeurs... Parbleu ! si j’avais de quoi les acheter, je ne serais pas assez bête pour vouloir être député !
SAQUEVILLE.
Quel marchand de beurre ?... quelle histoire est-ce là ?
LOUIS.
Ce n’est pas tout. Cet imbécile de Kermouton... Devinez qui épouse sa fille ?
SAQUEVILLE.
Comment puis-je le deviner ?
LOUIS.
Le roi des intrigants et des hypocrites, mon oncle !... Sévin.
SAQUEVILLE, se parlant à lui-même.
Oh ! tant mieux ! tant mieux pour elle !
LOUIS.
En effet, épouser un Tartufe de vingt-cinq ans ! voilà un grand bonheur ! Un petit jésuite de robe courte, toujours faufilé parmi les vieilles femmes. Il porte les charités de celle-ci, il retient une chaise au sermon pour celle-là. Tout lui réussit à lui !... S’il ne m’a pas soufflé Julie Montrichard, c’est qu’il savait bien qu’il avait mieux à faire... Ah ! à propos, vous l’avez vue. Je ne sais quelle sotte fantaisie m’était entrée dans la tête l’autre jour. J’y ai réfléchi, et j’ai vu que j’étais un grand fou. Vous me le disiez bien... Ah ! j’ai besoin de la revoir pour me remettre un peu de baume dans le sang.
SAQUEVILLE.
Ne la revois pas. Elle ne t’aime pas et ne veut pas de toi.
LOUIS.
Comment ! mais c’est impossible ! On ne se joue pas ainsi d’un engagement sacré.
SAQUEVILLE.
Elle se considère comme dégagée.
LOUIS.
Dégagée !... Heureusement sa mère est là qui saura bien la contraindre... Courez chez madame de Montrichard, mon cher oncle...
SAQUEVILLE.
Eh ! malheureux ! ne vois-tu pas que cette inconstance que tu accuses, c’est la tienne ? Que fait-elle, cette pauvre enfant ? Elle ne veut pas d’un homme qui l’épouse pour sa fortune. Son cœur généreux se révolte à la pensée d’un marché si lâche, tandis que toi, tu la quittais hier pour une sotte provinciale plus riche qu’elle de quelques milliers de francs.
LOUIS.
Mon oncle, vous vous méprenez totalement... Veuillez, je vous en supplie...
SAQUEVILLE.
Non ! Tais-toi, tu me fais honte. Au moins ne sois pas hypocrite. Avoue ton amour pour l’argent. Dis-moi : J’aime l’argent ! j’ai besoin d’argent ! Je t’en donnerai de l’argent !
Scène V
SAQUEVILLE, LOUIS, CLÉMENCE
CLÉMENCE, entrant, qui a entendu les derniers mots.
Prenez, prenez, Louis ; cela est toujours bon à prendre. Bonjour, Messieurs ; ce n’est que moi. Je ne vous dérange pas, j’espère ?
SAQUEVILLE.
Mademoiselle, j’ignore ce qui me procure cette visite.
LOUIS.
Clémence, laissez-nous ; nous sommes en affaires.
CLÉMENCE.
Je suis chez monsieur le colonel ; c’est lui que je viens voir. Et puis, si vous saviez ce que je vais vous dire, vous me traiteriez avec plus de considération. Vous auriez bien dû m’envoyer quelques pots de beurre de Bretagne. – Colonel, je viens vous exprimer toute ma reconnaissance.
SAQUEVILLE.
Vous ne m’en devez aucune. C’est une bagatelle qui doit vous aider dans votre établissement à Alger.
CLÉMENCE.
Ah ! Monsieur, combien j’ai été touchée de la noblesse de votre procédé ! Et le billet qui accompagnait ce qu’il vous plaît d’appeler une bagatelle, était si aimable !... Je vous en remercie, colonel, et je crois ne pouvoir mieux répondre à l’intérêt que vous me portez qu’en vous faisant part d’une heureuse aventure qui m’arrive.
LOUIS.
Allons, Clémence, on n’a que faire de vos aventures ! Vous voyez que mon oncle est pressé.
CLÉMENCE.
Je n’ai que deux mots à dire. Oui, colonel, vous avez eu pour moi une bienveillance si... si paternelle, que, j’en suis sûre, vous serez sensible à mon bonheur. C’est à vous que j’ai voulu tout d’abord l’annoncer. M. Sharper de Londres, le grand banquier, qui a été le protecteur de ma jeunesse... il est mort d’apoplexie, le pauvre homme... et... monsieur de Saqueville, il me laisse trente-cinq mille livres sterling.
LOUIS.
Quel conte !
CLÉMENCE.
Oui, trente-cinq mille livres sterling ; trente-cinq mille fois vingt-cinq francs soixante-dix centimes au cours d’aujourd’hui, ce qui fait juste huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents francs. Ils sont drôles, ces Anglais ; ils ont des comptes bizarres. Je ne comprends pas pourquoi il ne m’a pas laissé un million, ce qui eût fait un compte rond. Tenez, voici la lettre que je reçois de Londres... et qui me coûte assez cher de port.
SAQUEVILLE, lisant.
« Extrait du testament de M. John Sharper : Item, voulant témoigner de l’intérêt que j’ai toujours porté aux beaux-arts, je charge mon dit neveu Samuel, mon héritier universel, de payer à mademoiselle Clémence Ménétrier, artiste à l’Opéra de Paris, bien connue par la beauté de sa jambe et ses talents divers, que je me plais à reconnaître ici, la somme de trente-cinq mille livres sterling pour en faire une honnête femme. »
LOUIS.
Est-il possible ?
CLÉMENCE.
Quels originaux, hein ? Dorothée m’écrit que cela fait un scandale horrible à Londres ; mais le neveu s’exécute en galant homme, car j’ai une traite sur M. de Rothschild.
SAQUEVILLE.
Et vous allez devenir une honnête femme ?
CLÉMENCE.
C’est bien mon intention. Au lieu d’aller à Alger, je vais prendre les eaux à Bade. Je trouverai là quelque prince polonais ruiné, et je deviendrai princesse.
SAQUEVILLE.
Je vous félicite.
LOUIS.
Vous n’oublierez pas les anciens, ma belle.
CLÉMENCE.
Ce que je n’oublierai jamais, c’est que le colonel m’a envoyé cinq mille francs pour m’établir à Alger dans le temps que je n’étais qu’une pauvre fille... Je garderai toujours le portefeuille qui contenait les billets. Quant aux billets, colonel, je vous les rendrais tout de suite, si...
SAQUEVILLE.
Bien donné ne se reprend pas.
CLÉMENCE.
Ah ! si. Permettez. Dès que j’aurai touché... car maintenant mon deuil que j’ai à payer... Et puis, si on me faisait attendre les trente-cinq mille...
SAQUEVILLE.
N’en parlons plus, Mademoiselle, ce sera mon cadeau de noce pour votre mariage avec le prince polonais.
UN DOMESTIQUE, entrant.
Monsieur, c’est une dame avec un monsieur qui dit qu’il faut absolument qu’elle vous parle. Elle m’a remis cette carte.
SAQUEVILLE, lisant.
Madame de Montrichard.
À Clémence.
Mademoiselle...
CLÉMENCE.
C’est vrai, il faut que je m’en aille. Quand je serai devenue princesse, on me permettra de rester. Adieu, colonel.
LOUIS.
Elle va se trouver nez à nez avec la marquise. Mon oncle, il y a une sortie par votre chambre à coucher. Passez par là, Clémence.
CLÉMENCE.
Les petites entrées en attendant mieux.
Elle sort.
Scène VI
SAQUEVILLE, LOUIS, CLÉMENCE, LA MARQUISE, MONSIEUR SÉVIN
LA MARQUISE.
Vous devinez quel motif m’amène, Monsieur... Monsieur Louis de Saqueville, je suis bien aise de vous rencontrer. J’ai aussi besoin d’une explication avec vous. Il est votre neveu... je puis parler devant lui... M. Sévin est un ancien ami qui a bien voulu m’accompagner... je n’ai pas de secrets pour lui : il sait tout.
SAQUEVILLE, bas.
Tout, Madame ?
LA MARQUISE.
Il sait... tout ce que j’ai eu à souffrir comme mère.
MONSIEUR SÉVIN.
Pardon, Madame, je ne sais rien encore, et je ne puis croire...
LA MARQUISE.
Colonel, avant votre arrivée, j’étais la plus heureuse des mères. Ma fille... sa douceur, sa docilité... son dévouement répondaient à ma tendresse. J’étais fière de ma fille... et maintenant... Vous êtes venu, Monsieur... vous vous êtes amusé de cette imagination ardente... vous vous êtes complu à l’exciter... à porter le trouble dans une âme si pure et si facile à recevoir toutes les impressions. Qu’avez-vous fait, Monsieur ?... quel barbare plaisir avez-vous pu trouver à vous jouer ainsi de l’innocence et de l’inexpérience d’une jeune fille ? Je sais tout, Monsieur... J’ai perdu l’amour de ma fille... Voilà la récompense de ma tendresse de mère... voilà comment vous avez reconnu... l’intérêt que je portais à votre famille.
SAQUEVILLE, bas.
Madame, avez-vous cru un instant que George Saqueville fût un infâme ?... Votre fille... ai-je besoin de vous le dire, n’est-elle pas pour moi un objet sacré ?
LOUIS.
Mon oncle ! Madame ! pour Dieu ! que s’est-il donc passé ?
SAQUEVILLE.
Est-ce de vous que vient ce soupçon ? N’y a-t-il pas parmi vos conseillers quelque misérable qui vous le suggère ? Répondez.
LA MARQUISE.
Monsieur... je n’accuse pas... je supplie.
SAQUEVILLE.
Eh bien ! que demandez-vous de moi ?
LA MARQUISE.
Vous voyez combien je suis malheureuse... Quittez Paris, Monsieur... il le faut... Si vous connaissiez son caractère emporté... C’est à votre générosité que je m’adresse.
SAQUEVILLE.
J’ai prévenu vos désirs, Madame : je pars aujourd’hui... dans l’instant.
LA MARQUISE.
Vous partez ?...
LOUIS.
Madame la marquise, je ne comprends pas un mot à ce qui se passe. Mon oncle désire mon mariage avec presque autant d’ardeur que moi...
LA MARQUISE.
Votre mariage, Monsieur, qu’il n’en soit plus question. Croyez-vous que ma fille, croyez-vous qu’une Montrichard soit faite pour être pesée dans la même balance que la fille de M. Kermouton ? Monsieur, la dot de ma fille est sans doute peu en rapport avec la noblesse de son origine... mais je ne permets à personne de la marchander. Tout est rompu entre nous.
LOUIS.
J’en atteste le ciel, madame la marquise...
SAQUEVILLE.
Va, tu perds ton temps.
LA MARQUISE.
Colonel ! je suis bien malheureuse !... Que va-t-on dire ?
SAQUEVILLE.
Qu’importe ce que dira le monde ? Songez seulement à remplir vos devoirs de mère.
Il lui donne un paquet cacheté.
Tenez, Madame, je crois avoir le droit de faire ce présent à votre fille. Adieu.
LA MARQUISE, lui tendant la main.
Adieu !... Si la plus profonde estime...
SAQUEVILLE.
Je n’ai besoin de l’estime de personne.
LA MARQUISE.
Hélas !... monsieur Sévin, conduisez-moi à ma voiture.
Elle sort avec M. Sévin.
Scène VII
LOUIS, SAQUEVILLE
LOUIS.
Eh bien, mon oncle ?
SAQUEVILLE.
Eh bien, mon neveu ?
LOUIS.
Je perds tout en un jour !
SAQUEVILLE.
Par ta faute.
LOUIS.
Comment ! par ma faute ? Si j’ai compris quelque chose à ce que je viens d’entendre, n’est-ce pas vous que je dois accuser de toutes mes déconvenues ?
SAQUEVILLE.
Tu as voulu être intrigant, et tu n’avais ni l’expérience ni la suite dans les idées qui font réussir tes pareils. Tu as voulu courir deux lièvres à la fois, tu les as manqués l’un et l’autre. Adieu.
LOUIS.
Eh quoi, mon oncle, est-ce ainsi que vous me traitez ?... Comment ! n’est-ce pas vous qui m’avez aliéné le cœur d’une jeune personne charmante dont j’attendais tout mon bonheur ?... N’est-ce pas vous ?
SAQUEVILLE.
Il est trois heures. Ah ! voici Danet.
DANET, entrant.
Mon colonel, voici les chevaux qui arrivent.
SAQUEVILLE.
Danet, prends ce manteau. – Je n’oublie rien ? Ah ! la donation, papiers inutiles !
Il la déchire.
Le 2e spahis gagne cent pour cent aujourd’hui.
Il sort avec Danet.
Scène VIII
LOUIS, CLÉMENCE
LOUIS.
Mon oncle !...
Seul.
Malédiction !
CLÉMENCE, entrant.
Ah ! ah ! ah ! je crois que j’en mourrai à force de rire !
LOUIS.
Vous étiez là ?
CLÉMENGE.
Le moyen de sortir ? La petite porte était fermée. Et puis, j’étais bien aise de savoir ce que lui voulait cette grande dame... Ah ! mon pauvre Louis ! ah ! quelle aventure... et de la part d’un oncle !... Ah ! c’est cruel !... un oncle qui vous souffle votre belle, sous votre nez ! ah ! ah ! ah ! c’est par trop drôle !
LOUIS.
Tout cela est très plaisant, sans doute... Quand on a trente-cinq mille livres sterling, on voit les choses du côté comique.
CLÉMENCE.
Ah çà ! est-ce que vraiment il a... Quel vieux monstre, hein ! Sais-tu que, dans ta position, c’est un grand luxe d’avoir un oncle comme le tien ?
LOUIS.
Il est né pour mon malheur.
CLÉMENCE, ramassant les morceaux de papier, et lisant.
Qu’est-ce que cela ? « Neveu, pour son mariage... la terre de... rentes inscrites au grand-livre... » Ça a l’air d’une donation ou d’un testament.
LOUIS.
Si j’avais attendu !
CLÉMENCE.
Ainsi te voilà tondu, rasé, déshérité, et par-dessus le marché... hein ? par un oncle !... Mais ta conscience et tes pots de beurre te restent... Allons, du courage ! Bah ! la première balle sera peut-être pour lui, et alors tu hériteras.
LOUIS.
Ce qu’il a dit du 2e spahis m’inquiète.
CLÉMENCE.
Veux-tu dîner chez moi ? J’ai Virginie. Tu nous mèneras au spectacle, cela te distraira. Quand je suis triste, cela me réussit.
LOUIS.
Quand vas-tu à Bade ?
CLÉMENCE.
Mais le temps de toucher et de prendre des arrangements avec mon notaire. – J’ai un notaire.
LOUIS.
Ton prince polonais te grugera jusqu’au dernier sou.
CLÉMENCE.
Je prendrai un garçon rangé... comme toi.
LOUIS.
J’ai envie d’aller à Bade... pour t’empêcher de faire des bêtises.
CLÉMENCE.
Ça y est !
LOUIS.
Quelle diable d’envie as-tu de te marier ?
CLÉMENCE.
Et Sharper qui veut que je devienne une honnête femme ? il me faut deux ans à voyager pour cela.
LOUIS.
Allons plutôt en Italie.
CLÉMENCE.
Ça m’est égal ; mais une personne comme moi ne voyage qu’avec son époux.
LOUIS.
Peste !... Tu as aujourd’hui une petite mine chiffonnée qui me plaît !
CLÉMENCE.
Et trente-cinq mille livres sterling.
LOUIS.
Allons dîner.
Ils sortent.
[1] Hamlet, acte II, scène première.