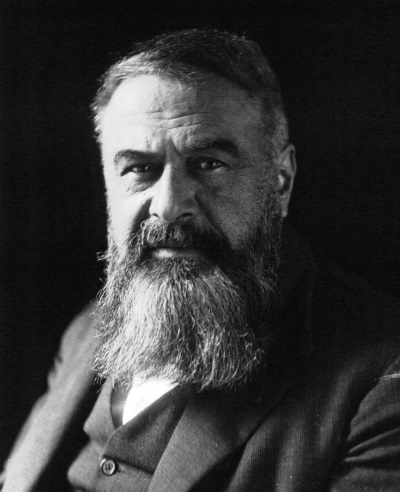Les Deux canards (Alfred ATHIS - Tristan BERNARD)
Comédie en trois actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du Palais-Royal, le 3 décembre 1913.
Personnages
LUCIEN GÉLIDON
BÉJUN
HONORÉ FLACHE
LA BARON DE SAINT-AMOUR
LE COMMANDANT MOUFLON
LA CHEVILLETTE
LARNOIS
MOREAU
LE DOCTEUR
LÉONTINE BÉJUN
MADELEINE DE SAINT-AMOUR
AMÉLIE FLACHE
MADAME DE FIFTY
MADAME DE TRÉMOUSSIN
L’OPÉRATEUR
UN CLIENT
LE JARDINIER
ALFRED
ACTE I
La scène se passe à Valmoutiers, dans l’imprimerie Béjun. Un bureau donnant à gauche sur l’atelier. Escalier intérieur conduisant à deux chambres ; à gauche, celle de Gélidon, à droite, celle de Léontine. Une large porte vitrée, à droite, en pan coupé, donnant sur la rue. Aux murs, affiches, placards, avis, tarifs, prospectus divers, etc. À droite, une table encombrée de paperasses. De chaque coté de la scène, des rayons, contenant des registres. À terre sont entassés des rouleaux d’affiches et des piles de journaux.
Scène première
FLACHE, UN CLIENT, puis AMÉLIE, puis GÉLIDON
Flache, longs cheveux, barbe inculte, est assis à la table de droite, en train de travailler, en fumant sa pipe.
LE CLIENT, entrant.
Bonjour, monsieur. C’est ici l’imprimerie Béjun ?
FLACHE.
Si vous voulez... C’est surtout le bureau du journal la Torche.
LE CLIENT.
Je suis le nouveau fondé de pouvoir de la Grande Épicerie. C’est pour le petit annuaire commercial de la Ville que nous donnons en prime aux acheteurs. On a fait une grosse faute : on a indiqué trois mille cinq cents habitants, nous en avons bel et bien ici quatre mille cinq cents.
FLACHE.
Ah ! c’est pour l’imprimerie que vous venez !
LE CLIENT.
Bien sûr, monsieur.
FLACHE.
Moi, ça ne me regarde pas. Je suis secrétaire de rédaction du journal, je n’ai pas à m’occuper de l’imprimerie.
LE CLIENT.
Où faut-il que je m’adresse, alors ?
FLACHE.
Au directeur du journal.
LE CLIENT.
Il va me dire qu’il ne s’occupe pas de l’imprimerie.
FLACHE.
Non, il ne vous dira pas ça, parce que, lui, est également propriétaire de l’imprimerie.
LE CLIENT.
Pouvez-vous le faire appeler ?
FLACHE.
Non, monsieur, je ne peux pas vous faire appeler le propriétaire de l’imprimerie ; ça ne me regarde pas.
LE CLIENT.
Mais puisqu’il est en même temps directeur du journal !
FLACHE.
Je ne puis faire appeler M. Béjun que pour les affaires du journal.
LE CLIENT.
Mais, alors, pouvez-vous m’indiquer quelqu’un de l’imprimerie ?
FLACHE.
Tenez, la citoyenne va vous renseigner.
LE CLIENT.
C’est une personne de l’imprimerie ?
FLACHE.
Demandez-le lui.
LE CLIENT, à Amélie.
Est-ce que vous êtes de l’imprimerie ?
AMÉLIE.
Non, citoyen.
Geste découragé du client.
Mais qu’est-ce que vous désirez ?
LE CLIENT.
Je voudrais parler à M. Béjun, le propriétaire de l’imprimerie.
AMÉLIE.
Je vais le chercher.
À Flache.
Citoyen époux, as-tu pris ton café au lait ?
FLACHE.
Oui, citoyenne épouse... As-tu préparé le petit-déjeuner du citoyen directeur ?
AMÉLIE.
Oui. Et j’ai déjà porté celui de la citoyenne directrice. Je vais maintenant travailler au rappropriement de la chambre à coucher du citoyen directeur.
Amoureusement.
À tout à l’heure, citoyen époux.
Au client.
Je vais chercher le patron.
Elle entre à gauche, dans l’atelier.
LE CLIENT, étonné.
Je vous demande pardon, je sais que je ne dois pas poser de questions qui ne se rapportent pas au journal...
FLACHE.
Pourquoi ça ? Si elles ne se rapportent pas à l’imprimerie Béjun, je peux toujours y répondre : le journal embrasse toutes les matières... sauf ce qui regarde l’imprimerie Béjun.
LE CLIENT.
Cette bonne, tout à l’heure, qui vous appelait citoyen époux ?
FLACHE.
C’est ma femme.
LE CLIENT.
Elle est au service de M. Béjun ?
FLACHE, se redressant.
Au service ? Où vous croyez-vous donc ? La citoyenne Flache travaille de son plein gré à divers soins du ménage.
LE CLIENT.
Et pas de gages, alors ?
FLACHE.
Des gages ! Elle n’accepterait pas. Tous les mois, simplement, un présent fraternel de soixante francs.
GÉLIDON, apparaissant en pyjama à la porte de gauche, au-dessus de l’escalier.
Monsieur Flache ?
FLACHE.
Plaît-il, citoyen rédacteur en chef ?
GÉLIDON.
Citoyen Flache, pardon... Voulez-vous être assez aimable pour presser sur ce bouton électrique ? La citoyenne Flache comprendra que c’est l’heure où elle pousse la fraternité jusqu’à m’apporter mon eau chaude.
Il va pour sortir, puis, se reprenant.
Ma part d’eau chaude.
FLACHE.
Bien entendu.
Gélidon rentre dans sa chambre.
LE CLIENT.
Qu’est-ce que c’est que ce monsieur... pardon ! ce citoyen ?
FLACHE, rallumant sa pipe.
Ah ! Vous pouvez dire : ce monsieur ! C’est un écrivain, un monsieur de Paris, qui est ici depuis deux mois. C’est à cause de lui qu’on a fondé la Torche !
LE CLIENT.
Ah ! C’est donc un journal de création très récente ?
FLACHE.
Oui, oui, six semaines à peine.
LE CLIENT.
Alors, il n’y a pas longtemps que vous êtes ici ?
FLACHE.
Non. Auparavant, j’étais rédacteur dans l’Ouest, à un journal réactionnaire. Quand on m’a proposé de venir ici, j’ai accepté avec d’autant plus de plaisir que je n’avais jamais appartenu à un journal d’extrême gauche. Eh bien, c’est très intéressant, vous savez.
LE CLIENT.
Alors, vous changez d’opinion comme ça ?
FLACHE.
Il faut bien, quand on change de journal.
LE CLIENT.
Et votre patron ?
FLACHE.
Mon patron, il veut être maire, c’est-à-dire que la patronne veut être mairesse ; alors, comme son adversaire, le baron de Saint-Amour, est très réac, on n’avait pas le choix, il a bien fallu aller de l’autre côté.
LE CLIENT, réfléchissant.
Est-ce qu’on peut vous apporter des articles ? Oh ! pas moi, mais une personne que je connais ?
FLACHE.
Ah ! Demandez-le au patron. Tenez, le voilà qui vient.
Entre Béjun, avec une grande blouse d’imprimeur.
Scène II
FLACHE, LE CLIENT, BÉJUN
LE CLIENT.
Monsieur Béjun ?
BÉJUN.
C’est moi.
LE CLIENT.
Je disais justement à monsieur : est-ce qu’on peut envoyer des articles, à votre journal ?
BÉJUN.
Oh ! il ne faut pas me parler de ça, je ne m’occupe que de l’imprimerie. Je vais vous chercher ma femme.
À Flache.
Ah ! dites donc, vous ne l’avez pas vue, Léontine ?
FLACHE.
Si, tout à l’heure, elle est venue sur le pas de la porte, pour affirmer son droit au petit déjeuner du matin, et elle en a profité pour demander si les premières affiches pour votre candidature au conseil municipal étaient placardées.
BÉJUN.
Ah ! diable ! Vous lui avez répondu que non ?
FLACHE.
Je me suis récusé : c’était une question d’imprimerie.
BÉJUN.
Alors, elle fumait ?
FLACHE, regardant sa pipe.
Je n’ai pas remarqué.
BÉJUN.
Enfin je veux dire : elle était en colère ?
FLACHE.
Un peu ! Je me suis dit, en la voyant : j’ai bien peur que le citoyen directeur prenne quelque chose en dehors de sa part sociale...
BÉJUN, revenant.
Oh ! la ! la ! la ! la ! Eh bien, alors, il vaut mieux que je n’aille pas la chercher.
Au client.
Vous la verrez une autre fois pour le journal. C’est elle que ça regarde...
LE CLIENT.
Mais, monsieur, j’étais venu surtout pour l’imprimerie.
BÉJUN.
Pour l’imprimerie ?... Il fallait le dire... Donnez-vous la peine de vous asseoir.
Le client reste debout.
Qu’est-ce qu’il y a pour votre service ?
LE CLIENT.
Je suis représentant de la Grande Épicerie. Vous nous avez livré, pour nos primes, un petit livret annuaire ; eh bien, ça n’a pas été corrigé ; il y a une grave erreur à la première page, sur la population de la ville. Vous mettez trois mille cinq cents habitants au lieu de quatre mille cinq cents.
BÉJUN.
Qu’est-ce que ça peut faire, ça ?
LE CLIENT.
Ça désoblige les habitants.
BÉJUN.
Parce qu’on leur dit qu’ils sont mille de moins ? On ne leur dit pas quels sont les mille qui sont en moins.
LE CLIENT, tirant un papier de sa poche.
Enfin, le patron vous en parlera. Quelque chose de plus grave : sur nos en-têtes de factures, on fait l’énumération de nos produits et, lessive de soude, vous écrivez ça avec un s à la fin !
BÉJUN.
Ah !
LE CLIENT.
Il n’en faut pas.
BÉJUN.
Oui, il y a un s de trop. Eh bien, je ne vous le compte pas en plus.
LE CLIENT.
Ça fait une faute.
BÉJUN.
Eh bien, c’est excellent ! Les clients disent : « Tiens, il y a une faute », et ils ne songent plus à discuter la facture.
LE CLIENT.
Le patron avait pensé qu’une diminution de prix...
BÉJUN.
Ah ! non, par exemple ! Pour un s en trop ! Vous croyez peut-être que mes ouvriers vont me le diminuer sur leur salaire ?
LE CLIENT.
J’en parlerai au patron.
BÉJUN.
Combien est-ce que je vous en ai fait, de ces factures ?
LE CLIENT.
Mille.
BÉJUN, en le reconduisant.
Eh bien, je vais vous en faire un autre mille au même prix. Qu’est-ce que c’est que ça : deux mille ! Vous ne serez pas en peine de les utiliser. Celles où il y a une faute, vous les enverrez aux clients qui ne savent pas l’orthographe... Au revoir, monsieur !
Exit le client. À Flache.
Je vais à l’atelier. Si ma femme me demande, dites-lui bien que je suis allé à la mairie, et que je me suis occupé de ma candidature. Il faut flatter sa manie.
FLACHE.
Mais, vous vous présentez toujours au conseil municipal et à la mairie ?
BÉJUN.
Il faut bien, puisque Léontine le veut. Et, si je suis maire, je continuerai à faire ce qu’elle veut. Et les femmes se plaignent de ne pas être électeurs et éligibles ! Mais qu’elles votent, nom d’un tonnerre ! qu’elles deviennent députées, ministresses ! Que leur influence s’exerce au grand jour !
FLACHE.
Au lieu de s’exercer la nuit !
BÉJUN.
Ce n’est pas pour moi qu’il faut dire ça.
Il sort.
FLACHE.
Je ne le dis pas pour toi, citoyen Béjun...
Gélidon apparaît sur le pas de sa porte. Flache le regarde et répète à voix basse.
Non, je ne le dis pas pour le citoyen Béjun !
Scène III
FLACHE, GÉLIDON, LÉONTINE
GÉLIDON.
Dites donc, monsieur Flache ! Vous n’avez pas vu Mme Béjun ?
FLACHE.
Je crois qu’elle est dans sa chambre. Quant au patron, il est à l’imprimerie, et soi-disant à la mairie pour sa candidature... Seulement, pas de blagues, ne le dites pas à la patronne.
GÉLIDON.
Non, non, je ne le lui dirai pas.
Il bâille.
FLACHE.
Vous n’avez pas encore dormi votre compte, cette nuit ?
GÉLIDON.
Mais si ! mais si ! Oh ! que je suis fatigué !
Il va pour rentrer dans sa chambre. À ce moment Léontine ouvre la porte de la sienne.
LÉONTINE, impétueusement.
Béjun !
FLACHE.
Le patron n’est pas ici, madame.
LÉONTINE, de même.
Où donc est-il ?
FLACHE.
À la mairie, madame.
LÉONTINE, sèchement.
Ce n’est pas vrai !
FLACHE.
Je vous demande pardon, madame, il m’a dit en s’en allant...
LÉONTINE.
Oh ! vous êtes son complice ! À la mairie, je ne le crois pas : il doit être chez quelque client, en train de mendier une commande de prospectus ou de cartes de visite. Mais, vous savez, monsieur Flache, ça ne peut pas durer, cette vie-là. Je me donne une peine effrayante pour le faire arriver et voilà comment il m’aide... C’est un grossier individu et vous, monsieur Flache...
À ce moment, elle aperçoit Gélidon. Sa colère tombe. À Gélidon.
Bonjour...
Avec hésitation.
monsieur Gélidon...
Flache se rassoit.
GÉLIDON, de même.
Bonjour... madame Béjun...
LÉONTINE.
Vous avez bien dormi ?
GÉLIDON.
Très bien.
Il lui montre Flache du doigt.
LÉONTINE, bas.
Je sais. Je sais... Et qu’est-ce que vous faites, ce matin... monsieur Gélidon ?
GÉLIDON.
Eh bien, je travaille à mon article.
LÉONTINE.
Vous êtes gentil de vous occuper de nous comme ça... Moi, je vais aller chez Mme Bernot, mon amie, qui arrive de Paris ce matin et que je n’ai pas vue depuis deux mois... Vous pensez, monsieur Gélidon, si j’ai des choses à lui dire !
GÉLIDON, incline la tête.
À tout à l’heure !
LÉONTINE.
À tout à l’heure, monsieur Gélidon, au déjeuner.
Elle pose deux doigts sur sa bouche et lui envoie un petit baiser, puis pénètre dans sa chambre. Gélidon, la main sur la bouche, reste un instant en contemplation à regarder la porte par où est sortie Léontine.
FLACHE.
Citoyen rédacteur en chef, je n’oublie pas que je vous dois cent francs.
GÉLIDON.
Ça va bien, ça va bien, monsieur Flache !
FLACHE.
Je dois vous dire que j’ai touché hier quelque argent du patron, en avance sur mes appointements.
GÉLIDON.
Bon, alors vous me les donnerez tout à l’heure.
FLACHE.
C’est que je comptais employer cet argent à acheter le cadeau de fête d’Amélie.
GÉLIDON.
Achetez-le, achetez-le, vous me paierez plus tard.
FLACHE.
C’est que, pour le cadeau d’Amélie, il me manque encore cinquante francs.
GÉLIDON.
Ah ?... Eh bien, dans le petit bureau de l’imprimerie, ouvrez un tiroir à droite. Il y a une centaine de francs à moi...
FLACHE.
Merci, je vous devrai alors cent francs de plus.
GÉLIDON.
Non, je vous disais de prendre les cinquante francs que vous me demandiez.
FLACHE, digne.
Bien, bien, je ne prendrai que cinquante francs ! Oh ! je ne prendrai que cinquante francs !
Gélidon entre dans sa chambre. Flache va pour sortir.
Scène IV
FLACHE, LARNOIS, puis GÉLIDON
LARNOIS, entrant.
C’est ici le bureau du journal la Torche !
FLACHE.
Oui, citoyen. Qu’est-ce que vous désirez ?
LARNOIS.
Je voudrais parler au directeur.
FLACHE.
Le directeur est à l’imprimerie ; mais, si c’est pour une affaire du journal, je suis secrétaire de la rédaction.
LARNOIS.
Et M. Gélidon ?
FLACHE.
M. Gélidon est rédacteur en chef...
LARNOIS.
C’est à lui que je veux parler.
FLACHE.
Attendez, je vais vous l’appeler.
Appelant.
Monsieur Gélidon !
GÉLIDON, du dehors.
Voilà !
FLACHE.
Le voici, vous allez pouvoir lui parler, lui communiquer cette affaire trop importante, paraît-il, pour être communiquée à un simple secrétaire de rédaction.
Il sort dignement en emportant ses papiers. Gélidon descend l’escalier. Il est habillé.
GÉLIDON.
Larnois !
LARNOIS.
Montillac !
GÉLIDON et LARNOIS.
Qu’est-ce que tu fais ici !
Un temps. Ensemble.
J’allais te le demander.
LARNOIS.
À toi, va, commence.
GÉLIDON.
Oh ! moi, c’est toute une histoire.
LARNOIS.
Mais, d’abord, dis-moi donc, qu’est-ce que c’est que ce farceur qui me charrie ?
GÉLIDON.
Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
LARNOIS.
Il m’a dit que tu étais monsieur Gélidon.
GÉLIDON.
Il t’a dit ça ?
LARNOIS.
Oui, j’ai demandé M. Gélidon et il m’a dit que c’était toi.
GÉLIDON.
Et tu l’as cru ?
LARNOIS.
Imbécile !
GÉLIDON.
C’est toi, l’imbécile, mon vieux, car je suis en effet monsieur Gélidon, rédacteur en chef de la Torche.
LARNOIS.
Ah ! bah ! Alors, c’est toi qui diriges ce canard infâme... je veux dire infime... je te demande pardon.
GÉLIDON.
Va donc !
LARNOIS.
Voilà pourquoi on ne te voyait plus nulle part à Paris ? Ah ! elle est bonne ! elle est curieuse ! Toi, l’écrivain raffiné, le romancier pour dames, voilà que tu signes des articles incendiaires contre le château, toi, Montillac !
GÉLIDON.
Chut !... Non, pas moi, Montillac ; moi, Gélidon.
LARNOIS.
Mais où as-tu été pêcher ce nom ridicule ?
GÉLIDON.
C’est le mien ! Je l’ai pêché dans un registre d’état civil du huitième arrondissement, acte dressé par l’adjoint devant mon père et deux témoins... Oui, mon vieux, c’est comme ça, tu ne m’as jamais connu que sous mon nom pseudonyme : je ne m’appelle Montillac que par accident ; Gélidon, c’est de naissance.
LARNOIS.
Tu ne me l’avais jamais dit.
GÉLIDON.
Tu ne me l’avais jamais demandé.
LARNOIS.
Alors, bon, j’y suis. Tu ne veux pas qu’on sache à Paris ce que tu fais ici, et, pour ne pas être reconnu...
GÉLIDON.
Je me fais appeler par mon nom, voilà. À présent, tâche de ne pas l’oublier : je suis Gélidon pour tout le monde. Gélidon est plus connu dans ce petit patelin que Montillac ne l’a jamais été à Paris. À Valmoutiers, je suis un personnage important. Ainsi, je vais tout à l’heure voir le sous-préfet.
LARNOIS.
Vous avez du sous-préfet, ici ?
GÉLIDON.
Non, nous en avons à quinze kilomètres, au chef-lieu d’arrondissement. C’est là-bas qu’on va pour les rouleaux de pianolas, les poissons de mer de Paris et le sous-préfet. Quelquefois, le sous-préfet, qui est mobile, vient jusqu’à Valmoutiers. Aujourd’hui, par exemple, il m’a convoqué chez le maire.
LARNOIS.
Tu es donc ministériel ?
GÉLIDON.
C’est-à-dire que nous sommes moins loin du gouvernement sur la gauche que les autres ne le sont sur la droite : les autres, c’est les gens du château.
LARNOIS.
Chez qui j’habite en ce moment.
GÉLIDON.
Comment, tu habites au château, chez notre ennemi ?
LARNOIS.
Depuis huit jours, mon vieux.
GÉLIDON.
Mais, alors, nous n’avons plus rien de commun ensemble... Une cigarette ?...
LARNOIS.
Non, merci.
GÉLIDON.
Et, dis-moi, quel homme est-ce, le baron de Saint-Amour ?
LARNOIS.
Eh bien, c’est un dégénéré, un gâteux, un grelot vide.
GÉLIDON.
Pas possible !
LARNOIS.
Mais c’est toi-même qui le disais dans ton article de ce matin.
GÉLIDON.
C’est entendu, mais, sans blague, quel homme est-ce ? Qu’est-ce qu’on en pense dans son entourage ?
LARNOIS.
Le baron est un homme très hautain, très gourmé, mais, au fond, pas si intransigeant qu’il en a l’air. La preuve, c’est que je suis chargé de te demander ce matin, en son nom, un entretien... À M. Béjun ou à toi.
GÉLIDON.
Eh bien, adresse-toi à Béjun. J’aime autant qu’ils se débrouillent ensemble.
LARNOIS.
Mais qu’est-ce qui te pousse à attaquer comme ça le château ?
GÉLIDON.
Mes convictions.
LARNOIS.
C’est entendu, mais, à part ça ?
GÉLIDON.
C’est une histoire que je ne peux pas te dire...
LARNOIS.
Oui, tu ne peux pas me la dire dans les cinq premières minutes où nous nous rencontrons ; non par discrétion, sans doute, mais pour donner plus de prix à ton secret... Enfin, comme tu voudras !
GÉLIDON.
En tous cas, depuis que tu m’as vu, mon tempérament n’a pas changé : je me fatigue très vite et je me remets très rapidement... C’est déplorable, parce que, si je restais fatigué, on me laisserait tranquille, et moi, je resterais tranquille. Mais non, j’ai beau être vanné, écœuré, il suffit qu’elle revienne à moi, en souriant, j’oublie ma lassitude et je me fatigue à nouveau.
LARNOIS.
Oui, je vois... tu es un coq... trop cérébral.
GÉLIDON.
Oui, si tu veux... ou un cérébral un peu trop coq... Ce sont mes hérédités qui veulent ça... Ma mère était une personne très délicate qui se brisait pour un rien, mais mon père avait trois maîtresses qui, toutes, lui demandaient grâce... Voilà : ma vie est faite d’exaltations subites et de dépressions brusques...
LARNOIS.
Les montagnes russes.
GÉLIDON.
Mais toi, mon vieux, qu’est-ce que tu deviens ? Pas d’histoires de femmes ?
LARNOIS.
Non, pas d’histoires bien caractérisées... pourtant une petite ébauche à Paris : une petite blonde...
GÉLIDON, regardant sa montre.
Mon vieux, il faut que j’aille retrouver le sous-préfet.
LARNOIS.
Oui, tu te fiches de mon histoire.
GÉLIDON.
Comment peux-tu dire ça, mon vieux, puisque c’est moi qui te la demande ?
LARNOIS.
Oui, tu me la demandes, et puis tu n’écoutes pas... D’ailleurs, c’est partout la même chose : on me prend pour confident et on se fout de mes confidences. Je suis l’homme qui doit tout écouter et jamais raconter.
GÉLIDON.
Je t’assure, mon vieux, qu’une autre fois...
LARNOIS.
Jamais, je te dis, jamais !
GÉLIDON, regardant sa montre.
Eh bien, raconte-la.
LARNOIS.
Mais non, voilà quelqu’un.
Léontine paraît à la porte de sa chambre.
GÉLIDON, bas, à Larnois.
Gélidon, hein ! Gélidon !
À Léontine.
Chère madame, monsieur Larnois, un de mes bons amis de Paris.
À Larnois.
Madame Béjun.
Salutations.
Je vous demande pardon, je suis appelé chez le sous-préfet, je vais revenir.
LÉONTINE.
Un instant, cher monsieur.
À Larnois.
Excusez-moi, j’aurais quelque chose à dire à notre rédacteur en chef, pour notre numéro de demain.
LARNOIS.
Faites donc, madame, faites donc !
LÉONTINE.
Pour notre numéro de demain.
Tout bas, à Gélidon.
Je t’aime !
GÉLIDON, de même.
Moi aussi, mais il n’est pas nécessaire que cela paraisse dans le numéro de demain.
Il sort.
Scène V
LÉONTINE, LARNOIS
LÉONTINE.
Vous êtes Parisien, monsieur ?
LARNOIS.
Oui, madame.
LÉONTINE.
Et, comme votre ami, vous êtes dans la littérature ?
LARNOIS.
Oui, madame, un peu. Et vous, madame ? Je devine à votre air que la littérature vous intéresse.
LÉONTINE.
Oui, monsieur. Je vous dirai que je suis poétesse.
LARNOIS.
Ah ! charmant ! charmant ! Voulez-vous me rappeler les titres de vos volumes de vers ?
LÉONTINE.
Monsieur, je n’en ai pas publié.
LARNOIS.
Je vois, je vois, madame ; vous voulez vous réserver et, un de ces matins, vous allez nous sortir un beau recueil.
LÉONTINE.
Je ne crois pas, monsieur, je ne crois pas.
LARNOIS.
Oh ! pourquoi donc ?
LÉONTINE.
Parce que je n’ai encore jamais fait de vers.
LARNOIS.
Ah ! vraiment !
LÉONTINE.
Je vous dirai que je ne sais pas très bien les faire... Mais je suis tout de même poétesse. J’ai l’âme pleine de poésie, seulement, c’est de la poésie qui ne peut pas... qui ne peut pas s’exprimer.
LARNOIS.
Ça doit être un bien grand tourment ?
LÉONTINE, indifféremment.
Non, non... Vous êtes venu voir M. Gélidon, monsieur ? Vous êtes un de ses bons amis ?
LARNOIS.
Oui, madame.
LÉONTINE.
Alors, il vous dit tout, n’est-ce pas ?
LARNOIS.
Oh ! à peu près tout.
LÉONTINE, avec une certaine retenue.
Je suis sûre qu’il aurait une maîtresse, il vous le dirait ?
LARNOIS.
Ah ! ça, je n’en sais rien.
LÉONTINE.
Oh ! si, si ! Il vous le dirait. Les gens qui aiment et qui sont discrets, ce ne sont pas les vrais passionnés, vous savez. Il y en a d’autres, dont le cœur déborde : ceux-là ne peuvent pas s’empêcher de proclamer leur amour ; seulement, n’est-ce pas, il faut qu’ils aient quelqu’un à qui le dire. Ah ! on ne pense pas assez au supplice des malheureuses femmes qui ont une profonde passion dans le cœur, qui voudraient l’exhaler devant leurs amis et connaissances et qui n’ont pour confident possible qu’un mari vulgaire, arriéré...
LARNOIS.
Et qui ne comprendrait pas la beauté d’un pareil aveu.
LÉONTINE.
Mais non, monsieur...
Ardemment.
Cette femme brûle d’interroger le monde entier sur celui qu’elle aime... Oh ! tant pis ! tant pis !... il faut que je vous dise tout : vous n’êtes pas du pays !
LARNOIS.
C’est vrai !
LÉONTINE.
Et puis je suis sûre que vous êtes un véritable ami, un vrai, vrai ami, monsieur... Voulez-vous me rappeler votre nom ?
LARNOIS.
Larnois.
LÉONTINE, l’invitant à s’asseoir et retirant son chapeau qu’elle pose sur le bureau.
Eh bien, cher monsieur Larnois, voilà exactement comment ça s’est passé, dans les moindres détails.
Elle s’assied près de lui.
Il y a deux mois environ, votre ami, M. Gélidon, a écrit de Paris à mon mari...
LARNOIS.
M. Béjun ?
LÉONTINE.
Oui, M. Béjun. Il écrivait donc qu’il venait à Valmoutiers pour une période de dix-sept jours ; il savait, par un de ses amis, que nous avions une chambre à louer, au-dessus de l’imprimerie... Je vous dirai que je ne connaissais pas M. Gélidon, mais, eu recevant sa lettre, je me suis dit tout de suite que j’allais l’aimer, et même que, fatalement, je serais sa maîtresse. Pourtant, monsieur, je vous assure que je suis une honnête femme, je vous en fais le serment. Je n’ai trompé mon mari que trois fois... trois aventures, bien insignifiantes, éphémères, comme on dit, ça ne vaut pas la peine d’en parler... Vous savez, monsieur Larnois, si je vous en parle, c’est parce que je tiens à tout vous dire ; mais moi, voyez-vous, je suis très réservée, plutôt renfermée.
LARNOIS.
Je vois, madame, je vois...
LÉONTINE.
Le jour où votre ami arriva avec sa valise dans l’omnibus de la gare, j’ai eu, il faut que je vous le dise, une déception ; il était bien, certes, on ne peut pas dire qu’il n’est pas bien, mais je me l’étais figuré tout autrement. Seulement, n’est-ce pas, j’avais décidé que je l’aimerais, je n’ai pas voulu en avoir le démenti et je me suis forcée à l’aimer avec tant de volonté, tant d’énergie, qu’au bout d’une demi-heure, je me sentais pour lui une passion plus forte qu’auparavant. Un jour, je me suis dit que sa chambre était située au-dessus de l’imprimerie et qu’il entendait trop de bruit ; alors, j’ai pris la résolution de m’y installer et de lui donner la mienne. Seulement, à la suite d’un malentendu, je n’ai pas pensé à le prévenir de ce changement. Quand, sur le point de se coucher, il ouvrit la porte de l’alcôve, il me trouva dans son lit. Alors, je lui expliquai pourquoi je l’invitais à prendre ma chambre ; mais il refusa d’accepter mon sacrifice, et préféra ne pas s’y rendre. De mon côté, moi, je suis entêtée et je m’obstinai à ne pas sortir de sa chambre... Ceci se passait le lendemain de son arrivée à Valmoutiers. Que vous dirai-je, monsieur Larnois ? Aucun de nous ne voulut céder la place à l’autre ; il resta tout près de moi cette nuit-là, et chaque nuit il revint dans sa chambre primitive, et moi, je me refusais toujours à la lui abandonner. Ses dix-sept jours une fois terminés, il préféra ne pas rentrer à Paris plutôt que de me céder la place.
LARNOIS.
C’est ce que les militaires appellent faire du rabiot, du rabiot dans le civil.
LÉONTINE.
Je savais qu’il était écrivain de profession, alors, j’eus une idée : comme mon mari est imprimeur, je le décidai à fonder un journal, dont M. Gélidon serait le rédacteur en chef. D’ailleurs, ce journal avait un but politique...
LARNOIS.
Un but politique ?
LÉONTINE.
Oui, je voulais pousser mon mari à la mairie et, une fois qu’il sera maire, on ne sait pas, peut-être à la députation. Actuellement, ce n’est qu’un modeste imprimeur ; nous avons de quoi, je veux bien, j’ai apporté une assez jolie dot et ses affaires sont florissantes, mais ça ne me suffit pas : je veux qu’il devienne un personnage et, vous entendez, monsieur, et si je veux ça, c’est uniquement parce que j’aime M. Gélidon, et que je veux que M. Gélidon soit honoré de la situation de M. Béjun. Je tiens à ce que l’homme que M. Gélidon trompe ait une situation considérable. Il faut que mon mari soit digne de mon amant.
LARNOIS.
C’est un sentiment très délicat.
LÉONTINE.
J’espère qu’on va vous revoir quelquefois, monsieur. J’ai une grande sympathie pour vous, vous savez !
LARNOIS.
Mais, moi aussi, madame. Je me sens en confiance avec vous. J’ai toujours souhaité d’avoir un ami à qui je puisse raconter des choses de ma vie... Je suis un sentimental, moi : vers l’âge de vingt ans, vingt-deux ans...
LÉONTINE, remettant son chapeau.
Je vous demande pardon, monsieur, je vais être obligée de vous quitter ; j’ai une de mes amies qui a dû arriver ce matin de voyage, je ne l’ai pas vue depuis ces récents événements, j’ai beaucoup de choses à lui dire, vous savez... Excusez-moi de ne pas entendre vos histoires maintenant...
LARNOIS.
Oh ! ça ne fait rien, j’ai le temps, j’ai le temps...
Léontine se dispose à sortir. On sonne au téléphone.
LÉONTINE, venant s’asseoir au bureau.
Allô ! Allô !... c’est toi, Jenny... Oh ! je suis contente de te voir !... Je vole chez toi. J’ai à te parler... Non, je ne peux pas y faire allusion par téléphone. Sache seulement qu’il est survenu dans ma vie un événement. Sentimental ?... Non, pas seulement...
BÉJUN, entrant.
Tiens ! elle a l’air de bonne humeur.
LÉONTINE, l’apercevant.
Non, je t’assure, je ne veux pas t’en dire plus long... Je viens, je viens chez toi. Excusez-moi, monsieur. Je vous laisse avec mon mari.
Avec une moue significative.
Oui, c’est mon mari.
LARNOIS.
Justement, j’ai à lui parler.
LÉONTINE, allant à Béjun.
C’est comme ça que tu es à la mairie ! C’est comme ça que tu prépares ton élection ! Ah ! si je n’étais pas si pressée, je te traiterais comme tu le mérites, va, animal ! crétin ! triste individu !
À Larnois, très aimablement.
Au revoir, monsieur.
Elle sort vivement.
BÉJUN.
Heureusement qu’elle est pressée. Qu’y a-t-il pour votre service, monsieur ?
LARNOIS.
Monsieur, je viens de la part du baron de Saint-Amour.
BÉJUN.
Ah ! bon ! Ah ! ça devait arriver. Depuis le temps qu’on l’entreprend dans le journal ! Parbleu ! Je l’ai assez dit à Léontine : le baron finira par se fâcher. Oh ! mais, vous savez, s’il vient pour me chercher des raisons, il trouvera à qui parler. J’ai mon rédacteur en chef.
LARNOIS.
Mais, il ne s’agit pas de ça. Le baron m’a simplement chargé de vous demander un entretien.
BÉJUN.
Oh ! écoutez, je ne tiens pas à le voir. C’est que je le connais votre baron de Saint-Amour !
LARNOIS.
Vous avez déjà été en relations avec lui ?
BÉJUN.
Non, mais je l’ai vu souvent passer dans la rue : il n’a pas l’air commode... Non, qu’il m’écrive, s’il a quelque chose à me dire... Je vous demande pardon, monsieur, j’ai à travailler dans mon imprimerie.
Il rentre dans l’atelier.
LARNOIS.
Ma foi, tant pis ! Que le baron s’arrange lui-même.
Au moment où il va pour sortir, à droite, entre le baron.
LE BARON.
Eh bien ! Larnois, je vous attends sur la place. Quand on vous confie une mission, vous n’êtes pas très rapide en besogne.
LARNOIS.
Mais, cher ami, j’ai eu beaucoup de peine à voir le citoyen Béjun, et, une fois que je l’ai rencontré, il m’a dit qu’il aimait autant ne pas vous voir : il préfère que vous lui écriviez...
LE BARON.
Que je lui écrive ! Avec des gants, peut-être ! Nous allons voir ça. Allez donc retrouver ma fille, je n’aime pas qu’elle fasse ses courses toute seule en ville.
Larnois sort.
Je vais lui parler un peu à ce monsieur Béjun. Je m’installe là et il faudra bien qu’il vienne.
Scène VI
LE BARON, BÉJUN
Le Baron s’installe dans un fauteuil. Au bout d’un instant Béjun entre et traverse la scène.
LE BARON, se levant.
Ah ! voici quelqu’un, enfin !
À Béjun qui, en apercevant le baron, va pour se retirer.
Voulez-vous prévenir M. Béjun que le baron de Saint-Amour voudrait lui parler.
BÉJUN.
À... à M. Béjun ?
LE BARON.
Oui, à M. Béjun.
BÉJUN.
Vous ne le connaissez pas ?
LE BARON.
Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je le connaisse ?
BÉJUN.
Vous ne l’avez jamais vu ?
LE BARON.
Jamais aperçu.
BÉJUN.
Ah ! bon ! Je crois qu’il est sorti.
LE BARON.
Et vous ne savez pas quand il rentrera ?
BÉJUN.
Ça dépend.
LE BARON.
C’est malheureux que, pour une fois que je tiens à rencontrer cet immonde personnage...
BÉJUN.
Je crois qu’il ne rentrera pas de sitôt.
LE BARON.
Sapristi ! Sapristi ! J’ai pourtant à lui faire une proposition intéressante... avec de l’argent au bout.
BÉJUN.
Ah ! Est-ce que je ne pourrais pas lui faire la commission de votre part ?
LE BARON.
Oh ! non, je ne peux dire ça qu’à lui.
BÉJUN.
Je suis son homme de confiance.
LE BARON.
Ce n’est pas une recommandation. Enfin, tant pis ! c’est une idée que j’avais eue comme ça, et que je voulais mettre à exécution tout de suite, sans en parler à mes amis... Enfin, tant pis, ils vont peut-être m’en dissuader... Au revoir !
BÉJUN.
Monsieur le baron, écoutez, je sais où il est, M. Béjun.
LE BARON.
Eh bien ! allez le chercher.
BÉJUN.
Je vais vous dire : j’irais bien le chercher, mais j’ai peur que vous soyez brutal avec lui : c’est un homme qui n’aime pas les disputes... Donnez-moi votre parole de gentilhomme que vous ne serez pas méchant avec lui.
LE BARON.
Mais vous en avez de l’attachement pour lui ! Vous êtes touchant ! Enfin... s’il faut me contenir, ce sera dur, mais je me contiendrai. Allez !
Il s’assied. Béjun ne bouge pas.
Eh bien, qu’est-ce que vous attendez ?
BÉJUN, paraît embarrassé.
Il sera ici tout de suite.
Il prend une photographie encadrée sur la table.
Regardez cette photo, c’est celle de M. Béjun. Regardez-moi, maintenant.
LE BARON.
Ah ! j’y suis, vous êtes son père !
Prenant un ton de gravité.
Certes, mon pauvre homme, je n’ai pas à me louer de lui, mais excusez-moi de vous avoir parlé aussi durement de votre fils.
BÉJUN, haussant les épaules.
Vous avez bien mauvaise vue. C’est une photo qu’on m’a faite il y a trois mois et mon chef d’atelier me dit que je parais très vieux là-dessus.
LE BARON, se levant.
Alors, c’est vous, Béjun ?
BÉJUN.
C’est long, mais vous finissez toujours par comprendre.
LE BARON.
Espèce d’ignoble individu !
BÉJUN.
Votre parole de gentilhomme !
LE BARON, se contenant.
Vous me l’avez escroquée, mais enfin je vous l’ai donnée ! Ah ! c’est vous, Béjun ! Eh bien, je n’irai pas par quatre chemins : j’ai pris mes renseignements sur vous, on m’a dit que vous étiez vénal...
BÉJUN.
Vénal ?
LE BARON.
Il paraît que, pour de l’argent, on peut vous faire faire n’importe quoi.
BÉJUN.
C’est malheureux ! On me reproche de tenir à l’argent ; mais est-ce un crime ou un devoir de vouloir augmenter son patrimoine quand on est père de famille ?
LE BARON.
Vous n’avez pas d’enfants !
BÉJUN.
Ça ne fait rien, dans les questions d’argent, je me sens père de famille.
LE BARON.
Quoi qu’il en soit, j’en ai assez d’être injurié comme ça dans votre torchon, vous entendez ?
BÉJUN.
Oh ! ça ne tire pas à conséquence !
LE BARON.
Aussi, je veux vous entreprendre à mon tour.
BÉJUN.
Eh bien, allez-y, monsieur le baron, je vous écoute.
LE BARON.
Oh ! mais pas comme ça, pas entre quatre murs. Il me faut une tribune, il me faut un journal. Seulement, comme je ne peux pas le faire imprimer, puisque vous êtes le seul imprimeur du pays, il m’est venu une idée : je vais vous acheter le vôtre.
BÉJUN.
Le mien ! Oh ! ce n’est pas possible, ça !
LE BARON.
Pourquoi n’est-ce pas possible ? Si je vous offre une bonne somme ?
BÉJUN.
Un journal que j’ai vu naître !
LE BARON.
Il y a six semaines.
BÉJUN.
Eh bien, il y a six semaines, il est tout petit, ça n’en est que plus attendrissant.
LE BARON.
Vous ne voulez pas vous en défaire ? Je sais bien que c’est surtout votre femme qui vous pousse dans tout cela.
BÉJUN.
Eh bien, justement, c’est ma femme. Que voulez-vous ? En admettant que j’y consente, moi, jamais je ne pourrai faire consentir ma femme.
LE BARON.
Est-ce que vous n’êtes pas le maître ?
BÉJUN.
Vous êtes veuf, monsieur le baron, pour demander à un homme marié s’il est le maître. Vous ne savez pas ou vous avez oublié... Non, non, ce n’est pas possible, ça ferait un raffut effroyable ! Je n’aurais plus qu’à aller me cacher sous la terre.
LE BARON.
Qu’est-ce qu’on pourrait vous en donner de votre journal ?
BÉJUN.
Mais rien, rien, je ne peux pas, je vous dis, je ne peux pas !
LE BARON.
Enfin, qu’est-ce qu’il vous coûte ? Il vous a peut-être coûté trois à quatre mille francs ?
BÉJUN.
Et mèche ! Vous diriez quinze mille, vous seriez encore loin du compte !
LE BARON.
Je ne crois pas ça.
BÉJUN.
Croyez ce que vous voulez. Je vous laisse dire, si ça vous amuse d’en parler. Il faudrait aussi estimer la valeur du journal au moment des élections.
LE BARON.
Enfin, quinze mille francs.
BÉJUN.
Et puis le journal cesserait de vous insulter ; ça vaut bien encore deux à trois mille francs.
LE BARON.
Dix-huit mille.
BÉJUN.
Et puis, il commencerait à m’engueuler, moi, ça fait bien encore deux, trois mille francs.
LE BARON.
Vingt et un mille.
BÉJUN.
Vous voyez, si, par impossible, je pouvais, j’étais disposé à le vendre, ce serait une chose qui vaudrait au moins vingt-cinq mille francs en chiffres ronds.
LE BARON.
Il n’y a aucune raison pour arrondir à vingt-cinq mille plutôt qu’à vingt...
BÉJUN.
Vingt-cinq mille, c’est plus rond.
LE BARON.
Enfin, je vous les donne les vingt-cinq mille francs.
BÉJUN.
Hein ? Vous me... Ce n’est pas possible, monsieur le baron. Je regrette. Ah ! oui, je regrette !
Il s’assied.
LE BARON.
Sincèrement, il n’y a pas moyen ?
BÉJUN.
Mais non, monsieur le baron, il n’y a pas moyen. Voyons, ce n’est pas de gaieté de cœur que je laisse aller vingt-cinq mille francs comme ça... Nom d’un chien ! Vingt-cinq mille francs à portée de ma main, vous croyez que ce n’est pas vexant cette histoire-là ! Écoutez, mon baron... vous êtes le serpent tentateur, vous me tentez. Je veux faire quelque chose pour vous. À vingt-cinq mille francs, je ne le céderai pas, mais, voyons, essayez de me tenter davantage ; il se peut que, dans un moment de folie, je me laisse faire...
LE BARON.
Eh bien, j’irai jusqu’à trente mille.
BÉJUN.
Non, non, j’ai encore mon sang-froid.
LE BARON.
Trente-cinq mille.
BÉJUN.
Non, je ne suis pas assez tenté, je ne suis pas assez tenté.
LE BARON.
Je ne peux pas aller plus loin, tout de même !
BÉJUN.
Allons ! Allons ! Vous brûlez, vous brûlez ! Vous êtes peut-être tout près de la limite... Faut pas vous décourager...
LE BARON.
Trente-six mille.
Béjun, gémissant, fait « non » de la tête.
Trente-sept mille.
Béjun, même jeu.
Trente-huit mille.
Béjun, même jeu. Le baron se tait et s’éloigne avec un geste de dépit.
BÉJUN, faiblement.
Quarante mille, que vous dites ?
LE BARON.
Mais non, je n’ai rien dit...
BÉJUN.
Vous l’avez dit ! Il faut le dire...
LE BARON.
Va pour quarante mille.
BÉJUN, au bureau.
Ah ! Vous m’avez ! Vous m’avez !
Il tombe accablé sur un fauteuil, d’un air égaré.
Faites un chèque, vite ! vite ! ne me laissez pas le temps de réfléchir...
LE BARON, écrivant.
Et l’acte de cession du journal ?
BÉJUN, prend une feuille de papier et une plume.
Un mot... un mot rapide...
LE BARON, dictant.
« Je cède le journal la Torche en toute propriété au baron de Saint-Amour... »
BÉJUN.
Et je signe.
LE BARON.
Attendez !
Continuant à dicter.
« Et je m’engage à continuer à l’imprimer... » À quelles conditions ?
BÉJUN.
Aux conditions du tarif...
LE BARON, dictant.
« Aux conditions du tarif... avec la réduction d’usage... »
BÉJUN, écrivant.
« Avec la réduction d’usage... »
Avec une moue triste.
Ça, c’est un peu petit, mon baron.
LE BARON.
Vous saurez bien vous rattraper... Voilà le chèque.
BÉJUN, mettant le chèque dans son portefeuille.
Ah ! que l’homme est faible !
Entre Flache.
Scène VII
LE BARON, BÉJUN, FLACHE
BÉJUN.
Ah ! Flache ! mon cher bon Flache ! Vous allez bien me mépriser !
FLACHE.
Je ne me permettrais pas. Tout ce que fait le patron est bien fait.
BÉJUN.
Merci. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça. Oui, parce que, voilà, j’ai vendu le journal.
FLACHE.
Vendu ?
BÉJUN.
Oui, au baron de Saint-Amour.
FLACHE, avec véhémence.
Vous avez fait ça ?
BÉJUN.
Oui.
FLACHE.
Vous désertez votre poste ?
Signe d’acquiescement de Béjun.
Vous abandonnez vos partisans ?
Même jeu de Béjun.
Vous donnez des armes à l’ennemi ? Oh ! fi ! fi ! fi !
Il marche avec agitation.
LE BARON, à part.
Il est très bien, cet homme-là.
BÉJUN.
Oui, accablez-moi ! Je vais imprimer l’ennemi, à partir de demain.
LE BARON.
Non, nous ne paraîtrons qu’après-demain.
BÉJUN, changeant de ton.
Pourquoi pas demain, mon baron ?
LE BARON.
Il faut que vous ayez un dernier numéro pour annoncer votre disparition aux lecteurs.
BÉJUN.
Vous croyez que je vais faire les frais d’un numéro pour ça ?
LE BARON.
Et puis, il me faut le temps de réunir des collaborateurs, de trouver un secrétaire.
FLACHE, accourant du fond, avec véhémence.
Ah ! non ! pas ça ! monsieur le baron. Vous ne ferez pas ça !
LE BARON.
Quoi donc ?
FLACHE.
Non. Changez les rédacteurs, modifiez la ligne politique du journal, ça vous regarde ; mais, pour Dieu ! ne touchez pas au secrétariat ! C’est sacré !
LE BARON.
Comment ! Mais, vous consentiriez donc à rester ?
FLACHE.
Si je consens ! Mais c’est mon devoir !
LE BARON.
Mais la Torche cesse d’être un organe révolutionnaire. Nous allons défendre des idées diamétralement opposées.
FLACHE.
Monsieur le baron, me faites-vous l’injure de supposer que, pour une question de nuance, pour une mesquine différence d’opinions...
Se tournant vers Béjun.
Je ne suis pas de ceux qui désertent, moi !
BÉJUN.
À la bonne heure !
Au baron.
Comme ça, vous pourrez paraître dès demain.
LE BARON.
Mais je n’ai pas de texte pour le journal.
FLACHE.
Nous avons des articles en retard, tous composés.
BÉJUN.
Bien sûr, vous n’aurez qu’à changer les noms, remplacer ceux qu’on engueulait par ceux à qui on passait de la pommade.
LE BARON.
En effet, dans ces conditions...
BÉJUN.
Si vous voulez passer par ici, je vais vous mettre au courant.
FLACHE, hautain.
C’est bon, imprimeur, ce n’est pas votre affaire.
Au baron.
Passez devant, patron.
Il entre à gauche avec le baron.
BÉJUN, seul.
Ah ! c’est égal, quand Léontine va apprendre... Qu’est-ce que je vais lui raconter à Léontine ?
Il entend une voix au dehors.
Oh ! la voilà !
Il se dirige vers la porte de droite et se trouve en présence de Madeleine, suivie de Larnois.
Scène VIII
BÉJUN, MADELEINE, LARNOIS
BÉJUN.
Oh ! pardon, mademoiselle, je croyais que c’était Léontine.
Il salue.
Mademoiselle...
LARNOIS, à Béjun.
C’est mademoiselle de Saint-Amour.
BÉJUN.
Ah ! bon ! bon ! Mademoiselle, votre papa est là, mademoiselle. Il est à l’imprimerie avec Léontine... Non, je veux dire avec Flache... Je vois Léontine partout !...
Très troublé.
Au revoir, mademoiselle !
À Larnois.
Au revoir, monsieur !
Il sort par la droite, dans une grande agitation.
MADELEINE, riant.
Qu’est-ce que c’est que cet ahuri ?
LARNOIS.
C’est le citoyen Béjun en personne.
MADELEINE.
Mais il n’a pas l’air si sanguinaire que ça. Et moi qui avais si peur pour papa !
LARNOIS.
Mais je vous le disais bien.
MADELEINE.
Je croyais que papa ne sortirait pas vivant.
LARNOIS.
Nous allons l’attendre ici, votre papa.
MADELEINE.
C’est que j’ai tellement de courses à faire !... Non, non, il faut que je fasse mes courses...
Elle tire un papier de sa poche.
Homards. Il faut que je passe à la gare chercher des homards...
Elle lit sur son papier.
Photos... Il faut que j’aille chez le pharmacien prendre des plaques de photos.
LARNOIS.
Chez le pharmacien ?
MADELEINE.
Oui, dans une petite ville, tous les commerçants ont plusieurs spécialités...
Elle lit.
Fruits... Je dois chercher des fruits chez la marchande de poissons...
LARNOIS.
Et des légumes, sans doute, chez le cordonnier ?
MADELEINE.
Non, au garage. La femme du garage vend des artichauts épatants.
LARNOIS.
Alors on se retrouve sur la place ? Le premier arrivé attend l’autre.
MADELEINE.
Oui, mais il faudra attendre, parce que le premier arrivé ne voyant personne s’en va...
LARNOIS.
Le second arrivé, croyant qu’il est le premier arrivé, file et se dit : j’ai le temps de faire des courses, et finalement il n’y a jamais personne.
MADELEINE.
Et on se rencontre, par le plus grand des hasards, dans un magasin, et on rentre déjeuner à deux heures... Très peu pour moi. À tout à l’heure.
Entre Gélidon, du dehors.
Scène IX
MADELEINE, LARNOIS, GÉLIDON
GÉLIDON.
Mon vieux, je suis à toi...
Apercevant Madeleine.
Oh ! mademoiselle ?
LARNOIS.
Permettez-moi de vous présenter...
GÉLIDON, vivement.
Henri de Montillac.
LARNOIS, à demi-voix.
Tiens ! tu n’es plus Gélidon ?
Gélidon lui fait un signe impératif. Larnois, continuant la présentation.
Mademoiselle de Saint-Amour.
GÉLIDON, stupéfait.
Mademoiselle de Saint-Amour ?
MADELEINE.
Eh bien, oui, monsieur. Comment allez-vous depuis notre dernier tango ?
LARNOIS.
Vous vous connaissez ?
MADELEINE.
Non, non. Nous avons dansé le tango ensemble, mais de là à nous connaître...
LARNOIS.
On a déjà fait les présentations ?
MADELEINE.
Oui.
GÉLIDON.
C’est-à-dire que le professeur de pas de l’ours, dans la tanière de qui nous dansions, mademoiselle et moi, nous a présentés l’un à l’autre. Seulement je crois qu’il connaissait à peine mon nom.
MADELEINE.
Et pas du tout le mien.
GÉLIDON.
En effet, parce que, tout de suite après, je lui ai demandé qui vous étiez et il m’a dit, avec un accent argentin, d’ailleurs chiqué : « Oune zeunje fille de bonne famille... » Depuis, un hasard heureux m’a mis en votre présence, mais vous ne m’avez pas vu...
MADELEINE.
Non, je ne vous ai pas vu... C’était au bureau des renseignements de la gare d’Orsay.
GÉLIDON.
Comment... alors vous m’avez vu ? Mais j’étais tout à fait de côté.
MADELEINE.
Eh bien, que voulez-vous ? à la pension on m’a appris à baisser les yeux... alors je vois beaucoup mieux de côté.
GÉLIDON.
Vous avez demandé au guichet si vous pouviez emmener votre chien sans le mettre au fourgon.
MADELEINE.
On m’a répondu de prendre un panier.
GÉLIDON.
Et vous avez dit que c’était un saint-bernard... Alors, comme j’étais venu demander s’il y avait des sleepings pour Bayonne où j’allais faire mes dix-sept jours... et comme j’ai appris que vous habitiez Valmoutiers, j’ai trouvé ce dernier renseignement beaucoup plus intéressant. J’ai décidé instantanément d’aller faire mes dix-sept jours à Valmoutiers. Il y avait de la troupe à Valmoutiers ; mais on m’a appris au ministère de la Guerre qu’on ne prenait pas de réservistes. Seulement on a bouleversé les usages, donné une entorse au règlement, créé un précédent fâcheux et je suis arrivé tout de même à Valmoutiers... où je ne vous ai pas trouvée.
LARNOIS.
Après vous avoir cherchée...
GÉLIDON, le regardant.
Je vous ai cherchée autant que j’ai pu.
MADELEINE.
Nous habitons à une lieue d’ici, et je ne viens que très rarement à la ville. Mais maintenant que vous avez retrouvé votre piste, rien n’empêche que vous veniez au château continuer notre tango.
GÉLIDON.
C’est que... avec plaisir...
MADELEINE.
Est-ce que vous aimez le homard ?
LARNOIS.
Oui, oui, il adore ça.
MADELEINE.
Nous en avons ce matin. Si vous étiez gentil, tout à fait gentil, puisque vous êtes venu me chercher à Valmoutiers, eh bien ! vous demanderiez à votre ami de vous amener déjeuner aujourd’hui.
GÉLIDON.
Aujourd’hui, ce me sera peut-être difficile.
MADELEINE.
Raison de plus. Et, vous savez, si vous ne venez pas, je me dirai que, votre histoire, ce n’est pas sérieux...
GÉLIDON.
Oh ! Mademoiselle ! Je vous assure que c’est plus sérieux que tout au monde !
MADELEINE.
Alors, je compte sur vous. À tout à l’heure.
Elle sort.
Scène X
GÉLIDON, LARNOIS
GÉLIDON, la regardant sortir, extasié.
Ah ! c’est la vérité ! Voilà la vérité ! Quelle franchise ! Pas de fausse ingénuité ! Elle est exquise.
LARNOIS.
C’est une jeune fille exquise, mais, toi, tu es un jeune homme un peu menteur.
GÉLIDON.
Pourquoi ça ?
LARNOIS.
Tu vas raconter à cette jeune fille que tu l’as cherchée.
GÉLIDON.
Je l’ai cherchée.
LARNOIS.
Allons donc ! Tu es peut-être venu à Valmoutiers pour la chercher, mais le soir même de ton arrivée tu as trouvé une distraction... Si, si, je sais, j’ai passé quelques instants avec Mme Béjun.
GÉLIDON.
Et elle t’a dit... ?
LARNOIS.
Oui, elle a pensé qu’un galant homme comme toi ne voudrait pas me faire des confidences, alors elle a pris les devants... Et puis, on me fait toujours des confidences, tu sais... J’ai une tête de confesseur.
GÉLIDON.
Dis donc, jolie femme, Léontine, hein ?
LARNOIS.
Oui, mais comme tu viens de le dire, la vérité n’est pas ici, elle est au château de Saint-Amour.
GÉLIDON.
Ah ! mon vieux, tu dis ça, parce que tu ne connais pas Léontine. Évidemment l’autre a plus de candeur ; mais Léontine est un être délicieux !
LARNOIS.
Enfin, est-ce que tu viens déjeuner au château ?
GÉLIDON.
Qu’est-ce que tu me conseilles de faire ?
Après réflexion.
Mais non, je ne peux pas y aller. Comment veux-tu que j’aille déjeuner chez des gens que j’éreinte dans mon journal tous les matins depuis six semaines ? Je vais encore les éreinter dans le numéro de demain... Sacré journal ! Oh ! mais-je vais mettre un peu d’eau dans mon vin, je vais être beaucoup plus modéré...
LARNOIS, remontant un peu.
Eh bien, alors, tu peux venir déjeuner.
GÉLIDON.
Tu crois ?... Je ne risque rien d’y aller déjeuner une fois, ils ne me connaissent pas.
LARNOIS, remontant.
Parbleu ! Alors, je reviens te prendre tout à l’heure. Tiens, voilà ton... comment faut-il dire ? ton... Béjun qui arrive par là-bas. Il a l’air d’être tout remué.
GÉLIDON.
Tout remué ?
LARNOIS.
Oui, oui, et déjà, quand je suis arrivé, il était hagard. Pourvu que sa femme, qui paraissait en veine de confidences ce matin...
GÉLIDON.
Hein ? Dis donc, tu me fais peur !
LARNOIS.
À tout à l’heure ! Pardon, monsieur.
Il se croise sur la porte de droite avec Béjun et sort. Gélidon monte l’escalier.
Scène XI
BÉJUN, GÉLIDON
BÉJUN.
Monsieur Gélidon !
GÉLIDON.
Qu’est-ce qu’il y a ?
BÉJUN, lui faisant signe d’approcher.
Il faut que j’aie avec vous une conversation un peu pénible.
GÉLIDON, descendant, un peu inquiet.
Je suis à votre disposition.
BÉJUN.
Monsieur Gélidon, quand vous êtes venu dans ma maison, je ne me doutais pas de la place que vous y prendriez...
GÉLIDON, très ému.
Moi non plus, moi non plus, monsieur Béjun.
BÉJUN.
Je le sais, monsieur Gélidon, je le sais. Tout ça, c’est la faute de ma femme.
GÉLIDON.
Monsieur Béjun, je ne vous laisserai pas dire ça. Je suis homme à revendiquer mes responsabilités...
BÉJUN.
Vous n’en avez aucune, mon ami... Enfin, il se produit une catastrophe qui bouleverse notre situation à tous !
GÉLIDON, attendri.
Pauvre monsieur Béjun !
BÉJUN.
Oh ! moi ! ça m’est égal !... J’en souffre surtout à cause de vous.
Gélidon le regarde un peu étonné.
Et de ma femme... Car c’est pour elle que ça sera dur.
L’étonnement de Gélidon s’accroît.
Il faudra que vous m’aidiez à la consoler.
GÉLIDON, stupéfait.
Ah ! Mais de quoi, monsieur Béjun ?
BÉJUN, dramatiquement.
Notre journal ne paraîtra plus.
GÉLIDON, soulagé.
Ah !
BÉJUN.
Dans un moment d’aberration, je l’ai cédé au baron de Saint-Amour.
GÉLIDON.
Ah ! bon ! bon ! vous avez vendu la Torche ?
BÉJUN.
Oui, mon pauvre ami ! Mais je continue à l’imprimer. Je n’ai pas voulu m’en séparer tout à fait.
GÉLIDON.
Eh bien, monsieur Béjun, que voulez-vous, je suis très affecté, vous savez, bien que je n’en aie pas l’air ; mais je me dis qu’après tout, pour un homme comme vous, paisible, un commerçant rangé, ce n’est peut-être pas une existence que la politique.
BÉJUN.
Vous parlez admirablement. Ah ! si ma femme pensait comme vous ! Vous allez lui répéter tout ça !
GÉLIDON.
Non, non. Écoutez, il vaut mieux pas.
BÉJUN.
Mais si, mais si. J’ai besoin de votre aide...
GÉLIDON, gêné.
Non, non, ça ne serait pas adroit. Le journal ne paraît plus, monsieur Béjun ? Alors, je vais donner suite à un projet ; il faut que j’aille voir dans le pays un vieil ami d’enfance...
BÉJUN.
Non, non. Ne me laissez pas seul. Ma femme va revenir...
GÉLIDON, montant vivement l’escalier.
Mais si, mais si, il vaut mieux que vous vous expliquiez tous les deux.
Il entre dans sa chambre.
BÉJUN, regardant à droite.
La voilà !... Oh ! là ! là ! là ! qu’est-ce qu’elle va me passer !... Qu’est-ce qu’elle va me passer !
Il tombe accablé sur un fauteuil, à gauche.
Scène XII
BÉJUN, LÉONTINE, puis GÉLIDON
LÉONTINE, entrant.
Je viens de chez mon amie, elle m’a retenue, elle ne voulait plus me lâcher. Nous sommes un peu en retard pour le journal.
Elle retire son chapeau et aperçoit Béjun, effondré.
Qu’est-ce qu’il y a ?
BÉJUN.
Ah ! mon amie, je ne sais pas ce qui s’est passé : tu m’as laissé seul avec le baron de Saint-Amour...
LÉONTINE.
Le Baron ! Ici ?
BÉJUN.
Oui, tu n’aurais pas dû, tu sais, tu n’aurais pas dû...
LÉONTINE.
Mais qu’est-ce qu’il t’a fait ? Il t’a battu ?
BÉJUN.
Oh ! non ! Ce ne serait rien que ça ! Non, non, il ne m’a pas battu... il a été plus terrible que ça ; il est arrivé en souriant, très élégant, et sais-tu ce qu’il m’a proposé ?
LÉONTINE.
Qu’est-ce qu’il t’a proposé ?
BÉJUN.
De lui vendre notre journal.
LÉONTINE.
Ah ! ça, c’est un toupet extraordinaire ! Alors tu lui as répondu...
BÉJUN.
Tu penses ce que j’ai pu lui répondre !... Alors il a sorti un petit carnet de sa poche, et il m’a offert... vingt-cinq mille francs...
LÉONTINE.
Quel toupet !
BÉJUN.
Crois-tu ? Puis trente mille... la somme considérable de trente-cinq mille francs.
LÉONTINE.
Alors, tu t’es levé, n’est-ce pas ? tu lui as montré la porte ?...
BÉJUN.
Oui, oui... Il ne l’a pas regardée... il a continué... il m’a offert trente-six mille francs... trente-sept mille francs...
Il la regarde.
LÉONTINE.
Ces gens sont extraordinaires ! Ils croient qu’on peut vous avoir comme ça, avec de l’argent !
BÉJUN.
Oui, oui, ils croient ça ! Alors, il a prononcé le chiffre de quarante mille francs.
LÉONTINE.
Le misérable !
BÉJUN.
Et alors...
LÉONTINE.
Et alors ?...
BÉJUN.
Je ne sais pas ce qui s’est passé... j’ai eu une espèce d’éblouissement... il m’a tendu un papier à signer...
LÉONTINE.
Tu n’as pas signé ?
BÉJUN.
Je ne pense pas... je ne crois pas...
LÉONTINE.
Tu as signé ?
BÉJUN.
Je ne sais plus exactement ce qui s’est passé...
LÉONTINE.
Tu as signé ! Oh ! oh ! le misérable ! L’ignoble individu ! Oh ! M. Gélidon !
BÉJUN.
Calme-toi !
LÉONTINE.
Me calmer après cette honte ! Il faut avertir M. Gélidon...
BÉJUN.
Je lui ai dit ! Je lui ai dit !
LÉONTINE.
Et il ne t’a pas tué ?
BÉJUN.
Je ne crois pas... Non, non. Il a été très raisonnable. Il m’a même dit que c’était peut-être un bienfait pour moi... que je n’étais pas fait pour la politique...
LÉONTINE.
Il a dit ça ?... Il a dit ça ?
Appelant.
Monsieur Gélidon !
GÉLIDON, ouvre sa porte.
Voilà !
Il descend l’escalier. Il a un pantalon blanc, des gants blancs et une fleur à la boutonnière.
Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ?
LÉONTINE.
Où allez-vous comme ça ?
GÉLIDON.
Nulle part.
LÉONTINE.
Avec ces gants blancs et cette fleur à la boutonnière ?
GÉLIDON.
C’est une rose, qui était à mon veston...
LÉONTINE.
Monsieur Gélidon, vous savez ce qui se passe ?
GÉLIDON, innocemment.
Non, non !
LÉONTINE.
Mais si, il vous l’a dit ! Il a vendu la Torche !
GÉLIDON.
Comment ?
LÉONTINE.
Il prétend que vous l’avez approuvé ! Il mentait !
BÉJUN.
Qu’est-ce que vous m’avez dit, monsieur Gélidon ?
GÉLIDON.
Moi ! Mais non, mais non, voyons !
À Léontine.
Seulement, voilà, je suis arrivé, la chose était irrévocable...
LÉONTINE, à Gélidon.
Irrévocable ! Vous acceptez ça, tranquillement... Mais cette disparition du journal, non seulement c’est la honte pour notre parti, mais pour nous deux, monsieur Gélidon, pour nous deux !...
Gélidon, effrayé, lui fait des signes expressifs pour la faire taire.
Mais c’est la fin de tout, de notre existence...
GÉLIDON.
Amicale ! de notre existence amicale.
LÉONTINE.
Oh ! je m’en fiche de vos précautions... Il est là à chercher des mots !
GÉLIDON.
Voyons, voyons, madame ! Oui, vous avez raison... Vous voyez que je vous donne raison... Ce que vous avez fait là, Béjun, c’est abominable !
LÉONTINE.
Qu’est-ce que je vais devenir, maintenant ? C’est effrayant ! Ces gens-là vont nous injurier et nous ne pourrons pas leur répondre !
BÉJUN.
Qu’est-ce que ça peut faire ? Nous ne répondrons pas.
LÉONTINE, hors d’elle.
Nous ne répondrons pas !
À Gélidon.
Vous l’entendez ?
GÉLIDON, cherchant à la calmer.
Mais si, mais si, nous répondrons.
Il fait signe à Béjun de se taire.
LÉONTINE.
Et comment ?... Ah ! oui, oui, je vous comprends. Mais oui, mais oui, c’est bien simple...
À Béjun.
Tu vas faire un autre journal !
À Gélidon.
Vous avez l’air surpris ? C’est bien votre idée, N’est-ce pas ?
GÉLIDON.
Oui... mais... je suis surpris que vous l’ayez devinée.
BÉJUN.
Un autre journal ? Et où veux-tu que je l’imprime ?
LÉONTINE.
Mais ici !
BÉJUN.
Tu n’y penses pas... Je n’ai pas assez de presses, voyons ! Et le journal du baron, alors ?
GÉLIDON.
Ah ! oui, au fait, le journal du baron ?
LÉONTINE.
Comment, le journal du baron s’imprime ici ?
BÉJUN.
Oui, je me suis engagé... du moins je crois que j’ai signé ça sur le papier...
LÉONTINE.
Oh ! ça, c’est le comble de l’abomination !
GÉLIDON.
Oh ! oui ! Et puis ça rend votre projet... notre projet impossible, absolument impossible.
LÉONTINE.
Pourquoi donc ? Mais pas du tout. La Torche paraît le matin. Eh bien, nous paraîtrons le soir, voilà tout.
GÉLIDON.
Ah ! oui, voilà tout.
BÉJUN.
Un journal du soir, ici, à Valmoutiers ? On ne le lira pas.
LÉONTINE.
On le lira autant qu’un journal du matin... Nous allons nous y mettre tout de suite. Il est onze heures.
GÉLIDON, tirant sa montre.
Onze heures et demie !
LÉONTINE.
Nous avons encore le temps de paraître aujourd’hui.
BÉJUN.
Mais il y a des formalités à remplir.
GÉLIDON.
Beaucoup de formalités.
LÉONTINE.
Je téléphonerai à la mairie et à la sous-préfecture. Soyez tranquilles, allez. Je m’en occuperai moi-même. Toi, va chercher Flache !
BÉJUN.
Mais il est passé au service du baron.
LÉONTINE.
Au service du baron ? Le misérable ! Va me le chercher tout de même : je lui parlerai. Et, dès ce soir, tu entends, nous aurons un autre journal, encore plus violent que le premier ! Voilà ce que tu y auras gagné.
BÉJUN, à part.
J’y aurai gagné ça et puis quarante mille francs.
Il sort.
Scène XIII
LÉONTINE, GÉLIDON
Léontine se précipite sur Gélidon, l’embrasse plusieurs fois sur la bouche.
LÉONTINE.
Lucien ! Lucien ! Je t’aime !... tu entends ? Je t’aime !... Je t’ai parlé méchamment tout à l’heure. J’étais affolée. Et puis je ne m’expliquais pas bien ton attitude. Mais je me rends si bien compte à présent ! Tu as beaucoup souffert, tu as fait semblant d’être gai pour me consoler... Tu t’es même habillé, tu as mis des gants blancs et une fleur à ta boutonnière pour te donner un air de fête... C’est bien ! c’est bien !... je te comprends, va ! je te comprends !...
Elle l’embrasse longuement avec frénésie. Gélidon résiste d’abord, puis s’écrie, exalté.
GÉLIDON.
C’est la vérité ! Voilà la vérité !
LÉONTINE.
Qu’est-ce qui est la vérité ?
GÉLIDON.
Toi ! Toi ! Rien n’existe au monde que toi... Un homme qui t’a, qui te possède, qui peut te serrer dans ses bras, à toute heure du jour et de la nuit, s’en irait !... Quel fou que cet homme ! quel fou !
Il l’embrasse avec frénésie.
Ah ! je vais lui servir quelque chose, au baron de Saint-Amour !
LÉONTINE.
C’est bien ! c’est bien !
GÉLIDON.
L’important est de rendre toutes relations impossibles entre cet homme et moi.
LÉONTINE.
Mais est-ce qu’il pourrait en exister ?
GÉLIDON.
Bien sur que non, mais ça ne fait rien... Coupons les ponts, coupons les ponts... Ah ! de quoi écrire ! De quoi écrire un article terrible !...
Il s’assied à la table et tire des feuillets de sa poche.
Voilà celui que j’avais préparé pour demain, mais il n’est pas assez terrible, je vais le corser !
LÉONTINE.
Oui. Corse, corse !
BÉJUN, revenant.
Flache est parti avec le baron, mais il nous a laissé Amélie pour le remplacer.
À Gélidon.
Qu’est-ce que vous faites ?
GÉLIDON.
J’écris l’article de tête du nouveau journal.
LÉONTINE.
À propos, quel titre prendrons-nous ? Il nous faut un titre.
GÉLIDON.
Ah ! la Torche, c’était un bon titre.
BÉJUN.
Le baron l’a maintenant.
LÉONTINE.
Misérable !
GÉLIDON.
Mais qu’importe ! ce n’était qu’une torche. Il faut quelque chose de plus lumineux...
BÉJUN.
Le Réverbère...
LÉONTINE.
Imbécile !
GÉLIDON.
La Lampe électrique... C’est un peu dur...
BÉJUN.
La Lampe pigeon !
LÉONTINE.
Idiot !
GÉLIDON.
Le Fanal !... Non, non, quelque chose de plus lumineux encore... Le Phare !
LÉONTINE.
Oui, oui, le Phare !
GÉLIDON.
Le Phare !
Montrant son article.
Voilà ! C’est corsé !
LÉONTINE.
Donnez, je vais faire composer ça tout de suite.
Elle prend l’article.
GÉLIDON.
Oui, allez. Moi, je vais ajouter encore quelques lignes pour déjouer la manœuvre de Saint-Amour, quelques lignes virulentes.
D’un air inspiré.
Je les sens ! Je les sens !
LÉONTINE.
C’est ça. Travaillez, travaillez, merci !
Léontine entraîne son mari et envoie de loin un baiser à Gélidon. Celui-ci lui renvoie un baiser. Béjun se retourne.
GÉLIDON.
Oui, oui, je lui envoie un baiser, comme à ma muse.
BÉJUN.
C’est ça !
GÉLIDON, à Léontine.
À tout à l’heure, ma muse !
À Béjun.
À tout à l’heure, mari de ma muse !
BÉJUN, envoie à son tour un baiser à Gélidon. À Léontine.
Tu vois, ça sera encore mieux qu’avant.
Sortent Béjun et Léontine.
Scène XIV
LARNOIS, GÉLIDON
GÉLIDON, écrivant fiévreusement.
« La Corruption !.... L’achat des consciences !... Les vilenies des puissants de l’or !... »
LARNOIS.
Qu’est-ce qui te prend ?
GÉLIDON.
Hein ! Ah ! c’est toi, l’homme du château ? Hé bien, je leur passe quelque chose à tes amis !
Il continue à écrire.
LARNOIS.
Qu’est-ce que tu racontes ? Le baron vient d’acheter le journal de ton patron...
GÉLIDON.
Il en reparaîtra un autre, mon vieux ! Il nous a enlevé la Torche, le Phare rayonnera. Tu vas voir ce qu’il va prendre, ton baron de Saint-Amour ! Je suis en train d’écrire cinq ou six lignes qui m’interdiront à jamais de mettre les pieds au château, si j’en avais la moindre envie.
Il continue à écrire.
LARNOIS.
Voilà ta destinée ! Il arrive à cet animal les chances les plus extraordinaires, et il les repousse du pied...
GÉLIDON.
Quelles chances ?
LARNOIS.
Quand je suis sorti, tout à l’heure, avec Madeleine, elle paraissait rêveuse, troublée... Moi, j’ai profité de cet état de trouble pour lui raconter une histoire... un souvenir de jeunesse qui me fait frémir quand j’y pense... mais elle ne m’a pas laissé finir et c’est elle qui, avec un mouvement d’expansion charmante, s’est mise à me parler, à me parler de toi...
GÉLIDON.
De moi ? Qu’est-ce qu’elle t’a dit ?
LARNOIS.
Elle est folle de toi, mon vieux !
GÉLIDON, se levant, son papier à la main.
Folle de moi ?
LARNOIS.
Oui, cela a dû commencer à Paris.
GÉLIDON.
Comme pour moi.
LARNOIS.
Elle t’a revu ce matin : ç’a été la minute décisive...
GÉLIDON.
La minute décisive !
Il déchire le papier qu’il tenait à la main.
LARNOIS.
Alors, c’est dit, tu ne viens pas ?
GÉLIDON, hésitant.
Écoute, mon vieux, je...
LARNOIS.
Tu viens ?
GÉLIDON.
Attends... Attends...
Entre Léontine.
Scène XV
LARNOIS, GÉLIDON, LÉONTINE, BÉJUN
LÉONTINE.
Lucien !...
Se reprenant.
Monsieur Gélidon, votre article est superbe ! La fin sera composée dans cinq minutes.
Elle s’assied, à gauche, en lisant les épreuves.
GÉLIDON, à Larnois.
Non, je ne peux pas.
Entre Béjun.
BÉJUN, à Gélidon.
Me revoilà avec un journal sur les bras ! Enfin, ça vous regarde, Gélidon. Je compte sur vous.
Il remonte à droite.
GÉLIDON, à Larnois.
Tu vois bien que je ne peux pas.
LARNOIS.
C’est sans regrets ?
GÉLIDON, mollement.
C’est sans regrets.
LARNOIS.
Alors, au revoir.
Sonnerie du téléphone.
BÉJUN, à l’appareil.
On demande monsieur Larnois.
Larnois prend le récepteur.
LARNOIS.
Allô ! Allô ! Ah ! c’est vous !... Ah ! bien, je vais demander, il est ici.
À Gélidon.
C’est Madeleine.
Geste de Léontine.
LÉONTINE.
Madeleine ?
GÉLIDON, vivement.
Jules ! Jules Madeleine, notre vieil ami de collège. Il est de passage à Valmoutiers.
LARNOIS.
Oui. Et il insiste pour que tu viennes... Enfin, voilà, prends l’appareil...
LÉONTINE.
Comment ? Comment ?
GÉLIDON, à l’appareil.
Allô ! Allô ! Ah ! c’est vous, mad... Bonjour, made...
Il écoute avec ravissement.
Ce serait avec joie, mais ça m’est difficile, très difficile, je vous jure.
À part.
Oh ! quelle voix ! Quelle voix délicieuse !
Dans le téléphone.
Pardon.
À Léontine, en mettant sa main devant le récepteur.
Il a absolument besoin de me voir. Il veut que j’aille déjeuner avec lui.
LÉONTINE.
Ah ! non, pas aujourd’hui !
GÉLIDON.
C’est qu’il s’en va demain. Et, vous savez, Jules a de grandes relations dans le département. Il peut nous être très utile.
BÉJUN.
Eh bien, qu’il vienne déjeuner ici, votre Jules ! Je vais lui dire.
Il veut, prendre l’appareil.
GÉLIDON.
Ah ! non !
LARNOIS.
Non !
GÉLIDON.
Vous ne le connaissez pas ! C’est un sauvage. Je n’oserais même pas lui proposer.
LÉONTINE.
Attendez. Moi, je m’en charge.
Elle va vers le téléphone.
GÉLIDON, l’arrêtant.
Non, non ! inutile. Je préfère lui dire qu’il m’embête et qu’il me fiche la paix.
LÉONTINE.
À la bonne heure !
GÉLIDON, violemment.
Allô !
Très doucement.
Allô !... Je vous assure... c’est tout à fait impossible...
À part.
Oh ! quelle voix !...
À mi-voix.
Alors... vrai !... Ça vous ferait un si gros plaisir ?...
Avec extase.
Hé bien... Hé bien... merci... je... oui... c’est entendu...
Mouvement de Léontine et de Béjun.
À tout à l’heure !
Il raccroche vivement l’appareil.
LÉONTINE.
Comment ! Vous y allez ?
GÉLIDON.
Oui, je dois être plus raisonnable que vous. Un homme aussi influent ! Je serai de retour de bonne heure.
LARNOIS.
Alors tu viens ?
GÉLIDON, joyeusement.
Je viens.
À Léontine, gravement.
Il le faut !
LÉONTINE, bas.
Dis-moi que tu m’aimes !
GÉLIDON.
Je t’aime.
LÉONTINE.
Mieux que ça.
GÉLIDON, très fort.
Je t’aime !
BÉJUN.
Plaît-il ?
GÉLIDON.
Je parle à ma muse.
LÉONTINE.
Il parle à sa muse.
GÉLIDON.
Alors, je la tutoie, n’est-ce pas ? C’est l’habitude dans la poésie.
BÉJUN.
Bon ! Bon !
À Larnois.
Il tutoie sa muse et il ne tutoie pas son vieil ami Jules !
GÉLIDON.
Au revoir ! Au revoir !
Il sort avec Larnois.
ACTE II
La scène représente le hall du château de Saint-Amour. Au fond, grande porte vitrée donnant sur le parc. À gauche, en pan coupé, les premières marches d’un escalier. Portes à droite et à gauche, premier plan. Grande table à gauche ; une autre à droite, près de laquelle se trouve une grande bergère. Piano à droite, deuxième plan.
Scène première
Au lever du rideau, LE COMMANDANT MOUFLON, LA CHEVILLETTE, MADAME DE FIFTY et MADAME DE TRÉMOUSSIN sont assis à différents endroits du salon, chacun en trains d’écrire, entre les tables circulent LE BARON et le valet de chambre ALFRED
LE BARON, allant et venant.
Allons ! allons ! travaillons ! Il est trois heures moins le quart.
LE COMMANDANT.
Non, deux heures et demie.
ALFRED.
Trois heures moins vingt, mon commandant.
LE BARON.
Et tous les articles doivent être avant six heures à l’imprimerie. Il faut que notre cinquième numéro soit aussi bien que les précédents... Celui de ce matin n’était pas mal, mais je veux que celui de demain soit encore meilleur... La Chevillette, qu’est-ce que vous faites, en ce moment ?
LA CHEVILLETTE.
Je termine mon article sur la mode.
LE BARON.
Faites court, La Chevillette, faites court.
LA CHEVILLETTE.
Pas de chance ! C’est le seul sujet sur lequel il me serait facile de faire long.
LE BARON.
Et qu’est-ce que vous racontez d’intéressant aux habitants de Valmoutiers ?
LA CHEVILLETTE.
Voilà : j’examine le problème, toujours si délicat, des revers de smoking.
LE BARON.
Je me demande si, pour nos populations rurales...
Au commandant.
Et vous, commandant, vous en êtes à votre chronique militaire ?
LE COMMANDANT.
Oui. Je poursuis mes descriptions de modèles de fusils qui ne sont plus en usage. Mais je ne sais pas si mon article sera prêt pour aujourd’hui.
LE BARON.
Comme ils ne sont plus en usage, ce n’est pas d’une actualité brûlante. Et vous, mesdames, vos maris arrivent toujours dimanche ?
MADAME DE FIFTY et MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Oui.
LE BARON.
Ils ne seront pas de trop. Ils ne seront pas de trop ! Travaillez ! Travaillez !
Il monte l’escalier, suivi d’Alfred. À peine est-il sorti...
MADAME DE FIFTY.
Quelle existence !
LA CHEVILLETTE.
On a beau ne rien faire pendant l’année, on aime tout de même se reposer pendant les vacances.
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
C’est l’homme qui a le plus de cravates en France.
LA CHEVILLETTE, protestant faiblement.
Oh ! oh ! oh !
MADAME DE FIFTY.
Et ses pantalons ! Combien en avez-vous, de pantalons ?
LA CHEVILLETTE.
Ici, une vingtaine tout au plus !
LARNOIS.
Mais qu’est-ce que c’est que tous ces papiers ? Vous écrivez votre correspondance ?
LE COMMANDANT.
Ah ! mon ami, nous rédigeons la Torche, le journal du baron. Tous les jours, après le déjeuner, au moment où l’on voudrait faire sa sieste, il s’agit de venir ici et, sans piper, de se mettre au travail jusqu’à six heures et demie.
Scène II
LES MÊMES moins LE BARON et ALFRED, LARNOIS
MADAME DE FIFTY.
Tiens, Larnois ! Vous voilà de retour ?
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Ça été gentil, ce voyage ?
LARNOIS.
Très bien, très agréable... Bonjour, commandant. Bonjour, madame de Fifty. Bonjour, Mme de Trémoussin... Monsieur...
Il salue La Chevillette.
LE COMMANDANT.
Vous ne connaissez pas La Chevillette...
Présentant.
Monsieur Larnois... Monsieur La Chevillette, l’arbitre des élégances...
LA CHEVILLETTE.
Laissez donc, commandant, laissez donc ! Et vous verrez, monsieur, si le baron est commode pour les articles... J’en avais écrit un cette nuit, qu’il m’a fait recommencer trois fois. J’ai travaillé ça jusqu’à cinq heures du matin.
Il lui remet un papier.
Je ne tiens plus sur mes jambes.
Il s’étire. Mme de Fifty s’est mise au piano.
Un tango !
Scène III
LES MÊMES, LE BARON, MADELEINE
LE BARON, entrant.
Ah ! Très bien ! très bien ! Je vois que vous vous amusez...
MADELEINE.
Vous auriez bien pu m’inviter...
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Voilà... c’était pour un article...
MADAME DE FIFTY.
Pour un article sur le tango que va écrire Larnois...
LE BARON.
Ah ! vous voilà, Larnois ?
MADELEINE.
Avez-vous fait bon voyage ?
LE BARON.
Qu’est-ce que vous avez à la main ? C’est déjà votre article ?
LA CHEVILLETTE.
Non, c’est le mien. Ma chronique de l’aviation.
LE BARON.
Ah ! bien ! lisez-nous donc ça.
On s’assied.
LA CHEVILLETTE, installé à la table de droite.
Je crois que, cette fois, vous serez content.
Lisant.
« Chronique de l’aviation : On ne saurait trop recommander aux aviateurs la prudence et de ne pas monter dans leurs appareils avant de savoir les diriger... »
LARNOIS.
Eh bien... voilà qui me paraît tout à fait sensé !
LA CHEVILLETTE, continuant sa lecture.
« ...Car les accidents peuvent être funestes et pour l’aviateur lui-même et pour les personnes auxquelles son appareil peut faire mal en tombant... »
MADELEINE.
Ça n’a rien d’inattendu comme conception, mais c’est très bien.
LA CHEVILLETTE, continuant.
« ...Il est absolument nécessaire, avant de songer à voler, que le conducteur d’aéroplanes soit au courant de la marche de l’appareil, car sa chute serait dangereuse à la fois pour lui et pour les piétons... »
LE BARON.
C’est toujours la même idée.
LA CHEVILLETTE.
Oui, mais attendez...
Continuant à lire.
« ...C’est pourquoi nous adjurons vivement les aviateurs d’apprendre soigneusement leur métier avant de tenter leurs expériences, l’accident étant doublement grave pour l’homme-oiseau lui-même et pour les personnes que, dans sa brusque descente, il pourrait écraser... »
LE BARON.
Mais, mon bon, vous répétez tout le temps la même chose.
LA CHEVILLETTE.
Attendez... Vous allez voir comment je termine...
Lisant.
« ...Enfin nous arrivons à cette conclusion... »
LE BARON.
Voyons ça !
LA CHEVILLETTE, lisant.
« ...À cette conclusion que le pilote d’aéroplane doit être très confirmé avant de quitter le sol et qu’il ne doit pas perdre de vue que non seulement il risque sa vie, mais l’existence de ses concitoyens qui pourraient être atteints par la chute de l’appareil. »
MADELEINE.
Eh bien, on ne pourra pas dire que l’aviateur n’est pas averti.
LE BARON, résigné.
Enfin ! ça peut aller tout de même.
LARNOIS.
Somme toute, ce journal me paraît très intéressant, mais est-ce que celui de vos adversaires est aussi vivant que le vôtre ?
LE BARON.
Le Phare ? Oh ! il ne vaut pas la Torche, mais ils ont toujours leur Gélidon.
LE COMMANDANT.
Cette crapule de Gélidon !
LARNOIS, au baron.
Ah ! Gélidon continue ses articles ?... Mais, dites donc, Montillac ne vient plus au château ?
LE BARON.
Mais si. Pourquoi ?
MADELEINE.
Pourquoi demandez-vous ça ?
LARNOIS.
Ça n’a aucun rapport avec ce que je disais... c’est un renseignement que je voulais avoir.
LE BARON, au commandant.
Il demande si Montillac continue toujours à venir au château ?
LARNOIS.
Comment, il continue à venir ?
Gélidon descend l’escalier.
Scène IV
LES MÊMES, GÉLIDON
GÉLIDON.
Mon cher baron, je crois que vous serez satisfait : voici mon article pour demain.
LARNOIS.
Hein ?
GÉLIDON.
Tiens, Larnois ! Te voilà de retour ?
Il lui serre la main.
LE BARON.
Bravo, mon cher Montillac !
À Larnois.
C’est le plus ponctuel de mes collaborateurs, notre rédacteur en chef, du reste.
LARNOIS, ahuri.
Lui ?... Toi !... Comment, c’est toi ?
GÉLIDON.
Oui, c’est moi.
LARNOIS.
Ah ! par exemple !
GÉLIDON.
Quoi ! Ah ! par exemple !
Il lui lance un regard sévère.
LE BARON, à Larnois.
Ah ! ça n’a pas été commode de décider votre ami à être des nôtres. Il ne voulait pas en entendre parler. Mieux que ça, il me conseillait d’abandonner la lutte, de laisser Béjun et Gélidon tranquilles. Comprenez-vous ça ?
LARNOIS.
Oui !...
Se reprenant.
Non, je veux dire non.
MADELEINE.
Mais nous avons tellement insisté !
LARNOIS, regardant tour à tour Gélidon et Madeleine.
Ah ! oui... vous avez... oui, oui, oui.
Aux autres.
Vous permettez ?
Il attire Gélidon à part sur le devant de la scène.
Mais alors, dis donc, mon vieux, qui est-ce qui fait là-bas les articles de Gélidon ?
GÉLIDON.
Moi. Qui veux-tu... ?
LARNOIS.
Ah ! très bien. Et tu fais aussi ceux de Montillac ?
GÉLIDON.
Naturellement...
LARNOIS.
Mais, enfin...
GÉLIDON.
Tout à l’heure, tout à l’heure...
Il rejoint les autres.
LE BARON, à Gélidon.
Larnois a l’air stupéfait de vous voir à notre tête.
GÉLIDON.
Mais oui. Pourquoi ? Tu ne me crois pas capable de diriger un journal ?
LARNOIS.
Oh ! si ! Oh ! si ! Plutôt deux fois qu’une.
LE BARON.
Tenez, Larnois... je vous parlais de notre supériorité sur le journal de Béjun.
Montrant Gélidon.
La voilà ! Ah ! c’est que Montillac nous donne des articles de tête qui enfoncent et laissent dans le troisième dessous ceux du sieur Gélidon.
MADAME DE FIFTY.
Oh ! oui !
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Oh ! je crois bien !
GÉLIDON.
Ceux de Gélidon ne sont pas mal... je vous assure.
LE COMMANDANT.
Trop de courtoisie, Montillac, trop de courtoisie. C’est du reste le seul reproche qu’on puisse adresser à votre polémique.
MADELEINE.
Le commandant a raison.
GÉLIDON.
Que voulez-vous, mademoiselle ! Quand on a affaire à un adversaire de valeur...
LE COMMANDANT.
Aucune valeur, mon cher ami, aucune valeur, et vous le ménagez beaucoup trop.
GÉLIDON.
Mais...
LE COMMANDANT.
Oui, je sais bien, il est très gentil pour vous. Il ne manque jamais dans une petite phrase de rendre hommage à votre caractère et à votre talent ; n’empêche que c’est un jean-foutre à qui je botterai le derrière à la première occasion !
GÉLIDON, se tenant les reins malgré lui.
Commandant, permettez-moi de vous dire que ce sont là des procédés un peu violents.
LE BARON.
Soit. Voici les principaux articles pour demain.
GÉLIDON.
Donnez. Je vais y jeter un coup d’œil.
LE BARON, bas.
Oui, remettez tout ça d’aplomb. Flache va venir les prendre tout à l’heure.
GÉLIDON, vivement.
Flache ? Oh ! je ne veux pas voir cet homme-là.
MADELEINE.
Qu’est-ce que vous avez donc contre ce pauvre Flache ? Vous vous obstinez à ne pas le rencontrer.
GÉLIDON.
Non, non ! C’est un renégat !... Je ne veux pas le voir.
LE BARON.
Il ne faut pas être si entier que ça dans la politique. Enfin ! On va vous laisser travailler.
Il l’installe à la table de gauche.
LE COMMANDANT, aux autres.
C’est ça, c’est ça. Laissons-le travailler.
Larnois accompagne les autres jusqu’au fond, puis revient vers Gélidon en levant les bras au ciel.
Scène V
GÉLIDON, LARNOIS
LARNOIS.
Eh bien, mon vieux ?
GÉLIDON, courant à lui.
Ah ! mon ami ! Je suis dans un état d’énervement effrayant ! Je n’en peux plus. Regarde un peu dans quelle situation je me trouve.
LARNOIS.
Oh ! c’est fou ! c’est fou !
GÉLIDON.
Ah ! oui, mon vieux, tu as pris là une responsabilité terrible.
LARNOIS.
Moi ?
GÉLIDON.
Dame ! C’est toi qui m’as amené ici.
LARNOIS.
Est-ce que je pouvais prévoir que tu allais t’embarquer dans une aventure pareille ? Ça ne s’est jamais vu !
GÉLIDON.
Qu’est-ce que tu veux ? J’aime Madeleine, Madeleine m’aime et Léontine m’aime aussi !
LARNOIS.
Mais tu n’aimes pas Léontine ?
GÉLIDON.
Je ne peux pas dire que je ne l’aime pas, je ne veux pas dire que je l’aime. Je n’examine même pas la question... Il m’est impossible de la quitter : elle est trop attachée à moi.
LARNOIS.
Et puis tu as peur d’elle.
GÉLIDON.
Peur d’elle ! Peur d’elle ! Comment peux-tu dire des choses pareilles ? Peur d’elle ! Je sais bien qu’elle est capable de tout... mais je n’ai pas peur d’elle... C’est une femme exaltée,... je ne sais pas ce qu’elle pourrait faire sur un simple soupçon... mais je n’ai pas peur d’elle.
LARNOIS.
Mais quoi ! Elle ne soupçonne rien ?
GÉLIDON.
Non. Elle a en moi une confiance absolue.
LARNOIS.
Voyons, tu la quittes pour venir déjeuner ici tous les jours ?
GÉLIDON.
Oui, je lui ai dit que j’avais de la neurasthénie et qu’un grand médecin de Paris, que j’avais consulté par téléphone, m’avait ordonné de longues promenades en forêt.
LARNOIS.
Alors, tu viens ici. Mais, le soir, il faut que tu retournes de bonne heure à Valmoutiers ? Et il faut s’expliquer avec Madeleine. Qu’est-ce que tu lui dis, à elle ?
GÉLIDON.
Hé bien, que je suis neurasthénique. Je ne sais pas pourquoi je changerais de maladie. Cette maladie-là n’a rien de dégoûtant et les signes extérieurs en sont vagues. J’ai dit à Madeleine que mon médecin m’avait ordonné de me coucher de bonne heure.
LARNOIS.
Et Madeleine coupe là-dedans ?
GÉLIDON.
Mais oui : elle a en moi une confiance absolue. Ce qui m’affole, c’est cette confiance de ces deux femmes. C’est trop beau, ça ne peut pas durer.
LARNOIS.
Tout peut se découvrir d’un moment à l’autre.
GÉLIDON, sursautant.
Ah ! tais-toi ! Pourquoi viens-tu me dire des choses pareilles ! Je lui raconte tout ça pour qu’il me rassure et il m’affole davantage.
LARNOIS.
Je ne demanderais pas mieux que pouvoir te rassurer ; mais cette double existence est épouvantable. Quand tu rentres le soir à Valmoutiers, comment t’arranges-tu pour ne pas rencontrer quelqu’un à l’imprimerie, où se font les deux journaux ?
GÉLIDON.
Je passe par la petite porte. Je monte directement dans ma chambre et je m’y enferme. Il est naturel que la neurasthénie m’amène à la sauvagerie. Je ne reçois chez moi que Léontine. Et je la caresse ! je la caresse ! Ah ! mon vieux, quel métier ! Tu comprends, je passe avec Madeleine des heures qui m’enfièvrent. Léontine profite de mon exaltation, et elle en profite sans aucune discrétion... Cette nuit, par exemple, je n’ai pas fermé l’œil. Je ne sais pas comment je tiens debout. Si je n’avais pas tout le temps quelqu’un à côté de moi, je tomberais de sommeil... Tous les matins, je me réveille avec des jambes en coton, un cerveau en gélatine. Et il faut que j’écrive deux articles : un pour la Torche et un pour le Phare !... Madeleine ! Léontine ! Deux articles de tête forcément soignés, car ils vont tous, ici et là-bas, éplucher chaque mot. Et tout ça dans l’affolement d’un coupable que la police, que dis-je ? que deux polices poursuivent, car je suis traqué de deux côtés. Mon article d’ici, ça va encore : j’ai trouvé la bonne combinaison de le dicter à Madeleine.
LARNOIS.
Prétexte pour rester seul avec elle ?
GÉLIDON.
Et aussi pour que Flache ne reconnaisse pas mon écriture. Car Flache est là, ne l’oublie pas !... Voilà quatre jours que je fais des prodiges pour l’éviter et ils ont tous la rage de vouloir me le présenter. Je répète à tue-tête que c’est un renégat, mais, à force de le répéter, je finis par ne plus le dire avec assez de conviction...
Le Baron entre du fond.
Scène VI
GÉLIDON, LARNOIS, LE BARON
LE BARON.
Mon cher Montillac...
GÉLIDON, brusquement.
Qui est-ce qui vient là ?
LE BARON.
Mon cher Montillac, voilà Flache qui vient chercher la copie.
GÉLIDON.
Je ne veux pas le voir !... c’est un renégat ! un renégat !
À Larnois.
Tu vois, je ne le dis plus aussi bien.
Au baron.
Excusez-moi, mon cher baron, j’ai un peu mal à la tête. Je vais me reposer un moment.
LE BARON.
Entrez donc là dans mon cabinet de travail, vous ne serez pas dérangé.
Montrant les articles que Gélidon a laissés sur la table.
Vous avez examiné tout ça ?
GÉLIDON.
Oui, oui.
LE BARON.
Et ça peut aller maintenant ?
GÉLIDON.
Très bien, très bien.
Il entre à droite avec Larnois. Entrent Flache et Amélie. Flache a les cheveux et la barbe taillés. Il est en veston gris, avec une fleur à la boutonnière et un stick à la main.
Scène VII
LE BARON, FLACHE, AMÉLIE
FLACHE, entrant avec Amélie.
Monsieur le baron, permettez-moi de vous présenter ma femme. Elle vient d’installer le petit pavillon que vous avez bien voulu mettre à ma disposition dans le parc.
LE BARON.
Madame veut-elle prendre une tasse de café ?
AMÉLIE.
Merci, monsieur. J’ai pris ce qu’il me fallait chez le citoyen Béjun.
Elle incline sèchement la tête.
LE BARON, à Flache.
Dites donc, elle n’a pas l’air commode, votre femme ?
FLACHE.
Nous ne sommes plus du même camp, monsieur le baron.
AMÉLIE.
Nous ne sommes plus du même camp !
LE BARON.
Ah ! c’est vrai ! Madame travaille toujours chez Béjun.
FLACHE.
Oui. Elle passe le matin et l’après-midi à préparer le journal du sieur Béjun...
AMÉLIE.
Qui paraît le soir ; lui ne va à l’imprimerie que le soir, pour préparer la Torche...
FLACHE.
Qui paraît le matin. On ne se voit que de minuit à six heures.
LE BARON.
Et vous faites chambre à part ?
FLACHE.
Oui... Dans le même lit. Il est très large. Moi, je me mets à droite, naturellement ; elle, à l’extrême gauche.
LE BARON.
Et jamais de rapprochement ?
FLACHE.
Dix minutes par nuit. Ah ! monsieur Le Baron, c’est une étrange sensation que de serrer dans ses bras un adversaire politique. Du reste, voyez-vous, c’est nécessaire. Si on ne se rapprochait pas, on ressentirait l’un pour l’autre une certaine tendresse qui ne serait pas de mise entre deux ennemis. Nous préférons épuiser cette tendresse une bonne fois, dans un rapprochement rapide.
AMÉLIE.
Pour mieux nous haïr après ! Je vous salue bien, monsieur le baron. Je retourne à l’imprimerie.
Amélie sort dignement par le fond.
LE BARON.
Tenez, monsieur Flache, voici les articles pour demain. M. Montillac vient de les remettre au point.
FLACHE.
Ah ! M, Montillac !... Je ne pourrais pas le voir ?
LE BARON.
Il était là, il n’y a qu’un instant.
FLACHE.
Je n’ai pas de chance. Il suffit qu’on me le signale dans un endroit pour qu’il disparaisse.
LE BARON.
Vous le trouverez sûrement dans mon cabinet... Il n’y a pas de danger qu’il s’en aille, puisqu’il n’y a pas d’autre issue.
FLACHE.
Eh bien, je vais lui parler.
LE BARON.
Bonne chance !
Il sort. Flache va frapper à la porte de droite premier plan.
Scène VIII
FLACHE, LARNOIS, puis LE BARON
LARNOIS, entrant.
Qu’est-ce qu’il y a ? qu’est-ce qu’il y a ?
FLACHE.
Tiens ! bonjour, monsieur. Ça va bien depuis l’autre jour ? Je voudrais voir M. Montillac.
LARNOIS.
Vous voudriez voir M. Montillac ?...
FLACHE.
Oui, oui.
LARNOIS.
C’est que, je vous dirai qu’il ne tient pas à vous voir.
FLACHE.
Mais pourquoi ça ?
LARNOIS.
Eh bien !... il vous en veut d’avoir quitté votre parti et il a même prononcé le mot de renégat...
FLACHE.
Oh ! mais, alors, je tiens absolument à me disculper... Je vous en prie, dites-lui que je veux m’expliquer avec lui...
LARNOIS, après avoir hésité.
Enfin, je vais toujours le lui dire.
Il entre à droite.
FLACHE, seul.
Renégat ! Renégat ! c’est absurde ! Chaque fois que je quitte un parti pour un autre, on me sert ce mot : renégat !
LARNOIS, revenant.
Eh bien, monsieur Flache, l’affaire est arrangée. Montillac a longuement réfléchi, il ne vous considère plus comme un renégat. Il est plein de bonne volonté pour vous et il m’a même dit que si un petit service d’argent, cinq louis, par exemple, pouvait vous être agréable, il était à votre disposition, tout à fait en camarade.
FLACHE.
Oh ! je le remercie bien... je le remercie bien... Cependant, puisqu’il dit que c’est entre camarades, vous pouvez lui dire ceci de ma part : c’est que j’ai laissé à Valmoutiers une dette qui me pèse... Oui, je dois cent cinquante francs à M. Gélidon... Est-ce que M. Montillac voudrait me les avancer ?
LARNOIS.
Écoutez : il m’avait dit cinq louis, mais je prends sur moi
Tirant son portefeuille.
voici cent cinquante francs. Je lui dirai que c’est pour les rendre à M. Gélidon. M. Montillac ne vous en voudra pas : il trouvera même que c’est le meilleur emploi que vous puissiez en faire.
FLACHE.
Je vous remercie bien, monsieur.
LARNOIS.
Eh bien, voilà une générosité qui n’aura pas coûté cher à Montillac.
Il entre à droite.
LE BARON, venant du jardin.
Eh bien, vous avez vu Montillac ?
FLACHE.
Non, non... mais ça ne fait rien, ça ne fait rien... Je vais faire porter ça à l’imprimerie... Vous n’avez rien à faire dire au citoyen Béjun ?
LE BARON.
Si... que c’est une crapule !
FLACHE.
Oh ! ça, il le sait bien !
LE BARON.
Attendez... Vous direz encore au citoyen Béjun qu’il fera bien de ne pas se trouver sur mon chemin.
Flache sort par l’escalier.
Scène IX
LE BARON, LE COMMANDANT, LA CHEVILLETTE, MADELEINE, MADAME DE FIFTY, MADAME DE TRÉMOUSSIN, puis ALFRED, puis BÉJUN, puis FLACHE
LE COMMANDANT, entrant.
Vous allez pouvoir le lui dire vous-même, Saint-Amour !
LE BARON.
Comment ça ?
LA CHEVILLETTE.
Voilà le citoyen Béjun.
MADELEINE, entrant avec Mme de Fifty et Mme de Trémoussin.
Papa, voilà Béjun !
LE BARON.
Béjun !... Eh bien, il a un fier toupet !
ALFRED, entrant.
Monsieur le baron, il y a quelqu’un qui insiste pour vous voir.
LE COMMANDANT.
Flanquez-le dehors !
LE BARON.
Et plus vite que ça ! Non, au fait, amenez-le donc. Je ne serais pas fâché de lui dire deux mots. Amenez-le.
Alfred sort.
LE COMMANDANT.
Vous allez recevoir cet individu ?
LE BARON.
Je tiens à savoir ce qu’il me veut. Restez, mesdames, n’ayez pas peur, vous allez voir comment je vais le mater. Je l’ai déjà maté une fois.
LA CHEVILLETTE, bas, aux autres.
En lui flanquant quarante mille francs.
ALFRED, introduisant Béjun.
Entrez par ici, vous !
BÉJUN.
Qui ça, vous ?
ALFRED, rechignant.
Monsieur Béjun !
Il sort.
BÉJUN.
Monsieur le baron, messieurs, dames.
LE BARON.
Monsieur Béjun, je vous admire.
BÉJUN.
Faut pas vous gêner, monsieur le baron.
LE BARON.
Vous osez vous présenter ici après la campagne que vous avez menée contre moi ?
BÉJUN.
Oh ! faites excuse, mon baron, il y a erreur. Ce n’est pas votre adversaire qui est devant vous, c’est votre imprimeur.
LE BARON.
Soit. Et qu’est-ce qui me vaut l’honneur, le grand honneur... ?
BÉJUN.
Oh ! N’exagérons pas, monsieur le baron. Mettons le plaisir. Eh bien, voilà. Nous ne sommes plus qu’à douze jours des élections. Il faut penser à vos affiches.
LE COMMANDANT, sarcastique.
Ah ! bon ! très bien !
BÉJUN, se tournant vers lui.
Monsieur ?
LE BARON, présentant.
Le commandant Mouflon.
BÉJUN.
Commandant !
Il lui tend la main. Le commandant enfonce ses deux mains dans ses poches. Béjun reste un moment la main tendue puis il fait le salut militaire.
LE BARON.
Eh bien, vous avez raison, je vais y réfléchir à mon affiche.
BÉJUN.
C’est que les autres, là-bas, vont poser la leur.
LE COMMANDANT.
Les autres ! Vous !
BÉJUN, au baron.
Alors, moi, je suis venu vous dire : mon baron, il faut prendre les devants. Notre affiche va être tirée à cinq cents. Eh bien, imprimez-en une à cinq mille ! allez-y carrément !
LE BARON.
Eh bien, attendez, attendez ! Je vais vous en donner, moi, un texte d’affiche !
Il se met à la table de gauche entouré par Madeleine et le commandant et écrit.
Vous allez être satisfait, mon gaillard !
BÉJUN.
Mais je ne demande que ça d’être satisfait !
À La Chevillette, pendant que le baron écrit.
On est bien logé ici, et le ménage n’est pas mal fait.
La Chevillette lui tourne le dos. À Mme de Fifty.
Ce n’est pas comme à la maison. Depuis que nous avons Mme Flache comme secrétaire à la rédaction...
Mme de Fifty le quitte brusquement. À Mme de Trémoussin.
...Elle ne prend pas souvent le balai...
Mme de Trémoussin va rejoindre les autres. Béjun continue à parler.
...Je suis forcé d’enlever la poussière moi-même.
MADELEINE, lisant ce qu’écrit son père.
Oh ! non ! papa ! C’est trop violent !
LE COMMANDANT.
Laissez donc, mademoiselle, il faut leur apprendre à vivre !
LE BARON, se levant, à Béjun.
Tenez : le titre d’abord : les Canailleries du citoyen Béjun... en caractères gros comme le pouce... Qu’est-ce que vous en pensez ?
LE COMMANDANT, à Béjun.
Oui, qu’est-ce que vous en pensez ?
BÉJUN, qui a mis ses lunettes, après avoir considéré le modèle.
C’est trop petit !
LE BARON.
Vous trouvez ?
BÉJUN.
Mais oui, on ne va pas voir ça d’assez loin... Et puis : les Canailleries du citoyen Béjun... Oh ! je n’aime pas beaucoup ça !
LE BARON, reprenant le papier.
Voilà qui m’est égal, par exemple.
BÉJUN.
Non, c’est trop lourd, ça tient trop de place... Attendez... Mettez donc simplement : Béjun la canaille !
LE BARON.
C’est votre avis ?
BÉJUN.
Parbleu !... ça, au moins, ça nous fera un bel en-tête... Et puis, comme le titre est moins long, vous aurez des lettres plus grosses... Ensuite, vous pourrez raconter votre boniment... Mais une affiche comme ça, ce n’est pas cinq mille qu’il faut en mettre... C’est dix mille... Il faut que ça se voie sur tous les murs !
LE COMMANDANT, aux autres.
Il est inouï !
À Béjun.
Alors, vous encaissez ça comme ça !
BÉJUN.
Pourquoi pas ? C’est de la réclame pour la maison.
LE BARON.
Vous tenez tant que ça à travailler ? Eh bien, si je suis élu, vous me ferez deux mille cartes : « Baron de Saint-Amour, maire de Valmoutiers. »
BÉJUN, cherchant dans sa poche.
Comment ! Mais je vous ai déjà préparé un modèle !
Il le donne au baron.
Je ne demande qu’une chose, moi, c’est que vous soyez élu.
LE BARON.
Ah ! çà, pourquoi vous présentez-vous, alors ?
BÉJUN.
Mais c’est ma femme qui m’y force, vous le savez bien ! Ah ! s’il ne tenait qu’à moi !... Vous permettez que je transcrive le texte de votre affiche !
Il va s’installer à la table de gauche.
LE BARON, bas, à Madeleine.
Tiens ! tiens !
MADELEINE, même jeu.
Dis donc, dis donc papa !... Il y a peut-être moyen de s’arranger avec cet homme-là !
LE BARON.
C’est ce que j’étais en train de me dire.
MADAME DE FIFTY.
Parbleu ! Il ne demande que ça !
MADELEINE.
On pourrait peut-être obtenir son désistement.
LE BARON.
Oh ! ça serait encore cher, ça !
MADELEINE.
Avec de bons procédés...
LE COMMANDANT.
Je lui en ficherais des bons procédés !... Ma botte quelque part ! Les autres le font taire.
MADELEINE.
Il faudrait profiter, en tout cas, de ses bonnes dispositions... et ne pas le laisser redescendre en ville tout de suite...
LA CHEVILLETTE.
Oui, autrement les gens de la ville vont le reprendre...
LE BARON.
Mais quel prétexte pour le garder au château ?... Mesdames, soyez un peu aimables avec lui.
MADAME DE FIFTY.
Baron, pour qui nous prenez-vous ?
LE BARON.
Sans aller jusqu’où vous pensez, voyons ! Non, nous allons lui faire visiter le parc... Il paraît qu’il aime la pêche à la ligne.
MADELEINE.
Faisons-le pêcher dans l’étang.
LE BARON.
Mais il n’y a pas de poissons dans l’étang : la dernière carpe est morte sous Charles X...
MADELEINE.
On pourrait peut-être jeter du poisson dans l’étang... Je sais qu’on a apporté tout à l’heure un panier de goujons dans la cuisine...
LE BARON.
Mais ils ne sont pas vivants...
MADELEINE.
Presque.
LE BARON.
Il faut qu’ils soient vivants tout à fait.
MADELEINE.
Je suis sûr qu’il y en a de vivants dans le tas.
LA CHEVILLETTE.
Oui, mais ils ne vivront pas dans l’eau de l’étang.
MADELEINE.
Ils vivront bien une demi-heure, le temps qu’il les pêche.
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Je vais m’en occuper.
Elle sort au fond.
MADELEINE, à Béjun aimablement.
Monsieur Béjun, moi, je trouve que vous êtes dans le vrai.
Coup d’œil à son père, qui l’encourage du regard.
On a beau être adversaires en politique, cela n’empêche pas de s’estimer et d’user de bons procédés réciproques...
FLACHE, qui descendait l’escalier et a écoulé les derniers mots.
Oh ! c’est scandaleux !...
Il remonte aussitôt.
BÉJUN, se retournant.
Qu’est-ce que c’est ?
LES AUTRES.
Rien. Ce n’est rien.
MADELEINE.
Monsieur Béjun, vous plairait-il d’aller faire une petite partie de pêche ? Nous avons un étang poissonneux.
BÉJUN.
Ah ! Et qu’est-ce que vous y pêchez ?
LE BARON.
Du goujon.
BÉJUN.
Tiens, tiens... du goujon en eau morte ?... Ça n’est pas ordinaire.
LE BARON.
Justement, ce n’est pas ordinaire... C’est une des curiosités de cet étang.
BÉJUN.
Quel dommage que je n’aie pas mes ustensiles !
LE BARON.
Attendez, attendez...
Il appelle.
Alfred ! On va vous prêter ce qu’il faudra !
À Alfred qui entre.
Voulez-vous donner à monsieur Béjun tous nos ustensiles de pêche qui sont dans la petite baraque.
ALFRED.
On ne s’en est pas servi depuis longtemps, monsieur.
BÉJUN.
Oh ! je saurai bien en tirer parti.
Alfred va pour sortir.
MADELEINE, à Alfred.
Attendez !
À Béjun.
Voulez-vous nous faire le plaisir d’accepter une tasse de thé ?
LE COMMANDANT, furieux.
Une tasse de thé !
BÉJUN, assis à gauche.
Vous êtes bien aimable, mademoiselle, seulement, une tasse...
MADELEINE.
Vous préférez le prendre dans un verre ?...
BÉJUN.
Oui, dans un verre... Et j’aime autant qu’il y ait du vin que du thé...
MADELEINE.
Un verre de porto... rouge ou blanc ?
BÉJUN.
Oh ! ça m’est égal, mademoiselle... Je ne suis pas difficile. Le plus vieux...
LE BARON.
Alfred, donnez donc le porto et un verre à monsieur...
Au domestique qui paraît interloqué.
Eh bien, qu’est-ce que vous attendez ?
ALFRED.
Oui, monsieur le baron.
Il sort à gauche.
BÉJUN, au baron.
Un verre ?... Vous ne trinquez pas ?
LE BARON, aimablement.
Nous venons de prendre notre café. Tous sourient gracieusement à Béjun, sauf le commandant.
ALFRED, revenant avec une bouteille et un verre qu’il pose sur la table. Madeleine lui fait signe de verser.
Il faut servir un verre à monsieur ?
BÉJUN.
Eh bien, oui, mon vieux... c’est comme ça, il faut te faire une raison !
Pendant que le domestique lui verse à boire.
Tu ne comprends donc rien à la politique ?
Le domestique sort dignement Béjun boit et continue à écrire.
LE COMMANDANT, furieux aux autres.
Ce sont des procédés que je ne puis admettre !
MADELEINE.
Eh bien, je suis sûr que M. Montillac nous approuverait.
LE BARON.
Certainement.
MADELEINE.
Il a le sens des choses, et il est pour la conciliation.
LE COMMANDANT.
Ah ! jamais de la vie, par exemple !
MADELEINE.
Eh bien, nous allons bien voir ! On va rappeler ! Je vais l’appeler !
LE BARON, à Béjun.
On va vous faire faire la connaissance de M. Montillac.
BÉJUN.
Ah ! très bien ! très bien ! Je serai enchanté !
Madeleine va à la porte de droite, suivie par les autres et frappe.
MADELEINE.
Monsieur Montillac, venez !
LE BARON, aux autres.
Je parie qu’il trouvera notre idée excellente...
Gélidon entr’ouvre la porte. Il paraît avoir été réveillé en sursaut.
Scène X
LES MÊMES, GÉLIDON
GÉLIDON.
Flache n’est pas là ?
LE BARON.
Mais non, il est parti.
Gélidon entre. Tous l’entourent.
GÉLIDON.
Je vous demande pardon. Je m’étais assoupi.
Il se frotte les yeux.
MADELEINE.
Venez, vous allez voir qui est ici.
GÉLIDON.
Qui est ici ?
On l’attire vers le milieu de la pièce, en continuant à l’entourer.
MADELEINE.
Un animal dangereux que nous sommes en train de dompter.
GÉLIDON.
Un animal ?...
Il se soulève et, par-dessus les épaules de ceux qui forment le groupe, il aperçoit Béjun. Il se baisse rapidement au milieu du groupe, pour que Béjun ne l’aperçoive pas, relève son col, rentre sa tête dans ses épaules.
Non, non, je ne veux pas voir cet homme-là !... C’est un renégat !
LE BARON.
Un renégat ?
GÉLIDON.
Non... un adversaire de mauvaise foi... Je ne veux pas le voir ! Je ne veux pas le voir ! Renvoyez-le !
Il continue, toujours baissé, à se diriger vers la porte. Le groupe le découvre et Béjun l’aperçoit de dos. Le baron, le commandant et La Chevillette remontent.
BÉJUN.
Tiens ! c’est monsieur Montillac ! Mais il est tout petit !
Gélidon, en faisant des signes de dénégation, est rentré dans le cabinet et a fermé la porte.
LE COMMANDANT.
Vous voyez, M. Montillac est de mon avis ! Oh ! j’en ai assez ! La Chevillette, nous allons descendre en ville !
Il l’emmène. Alfred rentre, portant des ustensiles de pêche.
LE BARON, à Mme de Fifty.
Venez, madame, nous allons accompagner monsieur Béjun jusqu’à l’étang.
BÉJUN.
Avec plaisir !
Au domestique.
Tu viens, Alfred ?
Sortent Béjun, Mme de Fifty, le baron et Alfred.
Scène XI
MADELEINE, GÉLIDON
MADELEINE, va à la porte et frappe.
Monsieur Montillac ! Monsieur Montillac !
La porte s’ouvre avec précaution. On aperçoit Gélidon, la mine renfrognée. En voyant Madeleine, son visage change d’expression.
GÉLIDON.
Mademoiselle... Est-ce qu’on a renvoyé Béjun ?
MADELEINE, vivement.
Oui, oui. On l’a renvoyé.
GÉLIDON.
Ah ! je suis tellement énervé par cette polémique que la vue de ces gens-là m’est odieuse !
MADELEINE.
Monsieur Montillac, il faut que je vous demande pardon. Nous vous tourmentons... je vous tourmente, mais vous savez pourquoi... Vous savez que, chez moi, on avait des idées quand on a fait venir au château le petit La Chevillette... Mais vous avez rendu à mon père de si grands services qu’il ne jure plus que par vous... Et, aussitôt les élections terminées, dans douze jours...
GÉLIDON, douloureusement.
Douze jours ! Douze jours ! Oh ! être le Tout-Puissant pendant un quart d’heure pour avancer de douze jours la date du scrutin !
MADELEINE.
Le Tout-Puissant ne peut pas faire ça... Il faut une loi !
GÉLIDON.
Il faut une loi ! Il faut une loi ! Oh ! douze jours ! C’est terrible ! Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas possible !
Avec une brusque résolution.
Voulez-vous fuir avec moi ?
MADELEINE.
Qu’est-ce que vous dites, monsieur Montillac ? Fuir avec vous ?
GÉLIDON.
Ce n’est pas un enlèvement que je vous propose. Nous partirons avec vos amis et nous irons chez une de vos parentes quelconque... Vous trouverez bien une de vos parentes qui vous donnera asile. Mais je ne peux plus me voir dans ce pays, qui est empoisonné par la politique.
MADELEINE.
Monsieur Montillac, vous n’y pensez pas... Vous auriez l’air de fuir devant Gélidon.
GÉLIDON.
Gélidon ? Mais Gélidon, le jour où je serai parti, cessera sa polémique...
MADELEINE.
Mais vous serez parti le premier.
GÉLIDON.
Oui, oui, vous avez raison : il faudrait que Gélidon parte le premier...
Rêveur.
Voyons, l’article de Gélidon paraîtra tout à l’heure... mon article, demain matin... Si l’article de Gélidon ne paraît pas demain soir, c’est Gélidon qui aura fui le premier.
MADELEINE.
Mais Gélidon ne songe pas à fuir.
GÉLIDON.
On ne sait pas ! On ne sait pas !...
Avec exaltation.
Ah ! Madeleine, j’ai idée que cette vie de torture va cesser. C’est un pressentiment... Je suis heureux d’avoir trouvé ça... d’avoir trouvé ce pressentiment... Ah ! quel bonheur !
MADELEINE.
Vous prenez votre rêve pour la réalité.
GÉLIDON.
Avec une volonté forte, on réalise ce qu’on désire... Ah ! Madeleine, encore vingt-quatre heures de tourments ! Finis ces articles quotidiens ! Je n’aurai plus d’autre tâche que de vous aimer, de vous adorer.
Il lui prend la main et la couvre de baisers. Flache paraît en haut des marches.
Scène XII
MADELEINE, GÉLIDON, FLACHE
FLACHE.
Parfait ! Parfait ! De mieux en mieux !
Il descend les marches avec précaution, Madeleine aperçoit Flache, pousse un petit cri et se lève en sursaut.
MADELEINE.
Qu’est-ce que c’est, monsieur Flache ? Qui est-ce qui vous permet ces appréciations ? Vous êtes ici pour vous occuper du journal et pas pour autre chose. Tenez-vous-le pour dit !
Elle sort vivement au fond.
Scène XIII
FLACHE, GÉLIDON, puis LARNOIS
FLACHE.
Après Béjun, Gélidon !
GÉLIDON, à part.
Ah ! Gélidon !...
À Flache.
Oui, Gélidon !
FLACHE.
Décidément, on a ici des façons extraordinaires de traiter ses ennemis politiques... Qu’on fasse des mamours à Béjun, passe encore, mais que la demoiselle de la maison, pour amadouer un adversaire de son père... Ah ! non ! non ! ça, c’est plus fort que tout !... Il faudra que j’en parle au baron et que je lui donne mon avis là-dessus.
GÉLIDON, marchant sur lui.
Monsieur Flache ! Monsieur Flache ! Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez le malheur de raconter à qui que ce soit que vous m’avez rencontré ici, vous savez, je n’hésiterai pas une minute : je vous brûlerai la cervelle.
FLACHE, effrayé.
Ce sont des choses qu’on dit...
GÉLIDON.
Et que l’on fait... et je le ferai, parce que je ne raisonnerai pas... Ce sera idiot... ce sera la grosse bêtise de ma vie... mais que voulez-vous ? j’aurai un mouvement de colère que je ne pourrai pas réprimer... Alors, on m’arrêtera, on me condamnera et, comme je suis sain d’esprit, il n’y a aucune raison pour que les juges ne me considèrent pas comme responsable... Eh bien, monsieur Flache, au nom de nos anciennes relations, vous devez m’épargner cette condamnation inévitable : ne m’obligez pas à un meurtre...
FLACHE.
Oh ! du moment que vous me prenez par les sentiments... c’est bon, je ne dirai rien.
GÉLIDON.
Ça vaudra mieux.
FLACHE.
Et puis, je n’oublie pas que je suis votre obligé...
GÉLIDON.
Ah ! c’est vrai... Vous devez me rendre cent cinquante francs aujourd’hui...
FLACHE.
Comment savez-vous ça ?
GÉLIDON.
Oh ! rien ! une idée que je me faisais...
FLACHE.
Je ne suis pas encore en mesure.
GÉLIDON.
Ah ! vraiment ?
FLACHE.
On nous a installés dans le pavillon, mais nous avons fait quelques petits frais personnels... Je suis même ennuyé parce que je dois cent cinquante francs à M. Montillac...
GÉLIDON.
Oh ! il attendra !
FLACHE.
Mais je voudrais bien les lui rendre...
GÉLIDON, tirant cent cinquante francs de sa poche.
Enfin !
FLACHE, les prenant.
Merci. Je les lui rendrai ce soir même.
GÉLIDON.
Nous verrons ça.
Entre Larnois.
LARNOIS, entrant.
Ah ! bien ! Vous voilà ensemble ! Alors, cette fameuse entrevue... que tu craignais ?
GÉLIDON, sévèrement.
Quoi ! Quelle entrevue ?
LARNOIS.
Avec Flache... Ne me disais-tu pas ?
GÉLIDON.
Rien ! Je ne te disais rien !... Adieu, monsieur Flache.
FLACHE.
Adieu, citoyen Gélidon !
Il sort au fond.
Scène XIV
GÉLIDON, LARNOIS, puis MADAME DE TRÉMOUSSIN
LARNOIS.
Gélidon !... Ah ! bon ! bon !
GÉLIDON.
Ah ! bon ! bon ! Imbécile !... Tu as compris ?... Ah !, quelle journée !...
Il se laisse tomber dans la bergère.
Enfin, Béjun est parti... Flache est maté... moi, je suis brisé... je suis haché... mes bras ne tiennent plus à mon corps... mes mains ne tiennent plus à mes bras... je suis en mille morceaux !
Apercevant sur la table la photographie de Madeleine.
Ah ! Madeleine ! ma petite Madeleine !...
Il prend la photographie.
Excusez-moi de me laisser aller comme ça devant vous, mais je n’ai pas dormi de la nuit, Madeleine !... Ah ! Dormir ! Dormir près de vous !...
Il s’endort, ayant la photographie de Madeleine sur son cœur.
LARNOIS.
Ah ! dis donc, à propos, il faut que je te raconte ce qui m’arrive, tu sais que je viens de Paris, j’ai revu ma petite blonde. Ah ! oui... tu te fous de mon...
Lui frappant sur l’épaule.
Eh bien, dis donc, mon vieux !... dis donc ! Eh ! mais il dort !
MADAME DE TRÉMOUSSIN, descendant l’escalier.
Eh bien, Larnois ?
LARNOIS.
Chut ! Il dort... il dort même très bien. Laissons-le dormir. Il en a grand besoin... Venez, que je vous raconte une histoire... Figurez-vous une petite blonde...
Ils sortent tout doucement par l’escalier. Au bout d’un instant, entrent, du fond, Léontine et Amélie.
Scène XV
AMÉLIE, LÉONTINE, GÉLIDON endormi
LÉONTINE, écartant Amélie qui lui barre le passage.
C’est possible, madame Flache, que ma place ne soit pas ici ; mais je sais que Béjun y est... je sais ça par un ouvrier de l’atelier...
AMÉLIE.
Oh ! M. Flache va m’en vouloir de vous avoir amenée !
LÉONTINE.
Je me moque de M. Flache.
AMÉLIE.
Pas moi ! pas moi ! Je crâne avec lui, mais il n’est pas commode.
LÉONTINE.
Je vais attendre Béjun ici et je le ramènerai par les deux oreilles ! Ah ! quand M. Gélidon apprendra que Béjun a osé venir au château il sera indigné !
AMÉLIE, apercevant Gélidon.
Chut !
LÉONTINE.
Qu’est-ce que c’est ?
AMÉLIE.
Il y a quelqu’un qui dort.
Elle s’approche et à voix basse, avec un léger étonnement.
Tiens, mais c’est M. Gélidon !
LÉONTINE.
M. Gélidon ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Elle s’approche.
Il doit là tranquillement comme dans son lit... (Se reprenant.) Comme je suppose qu’il dort dans son lit.
Se penchant sur lui.
Il a une photographie à la main... Un portrait de femme !... Mais c’est le portrait de la demoiselle du château... Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
Avec des larmes dans la voix.
Ah ! mon Dieu ! Ah ! mon Dieu !
AMÉLIE.
Mais vous allez le réveiller, madame.
LÉONTINE, plus haut.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
GÉLIDON, se réveillant brusquement, regarde autour de lui. Il n’aperçoit que Léontine.
Léontine, tu es déjà levée ?... Quelle heure est-il donc ?
LÉONTINE.
Qu’est-ce que tu fais ici ?
GÉLIDON, tressaille, regarde autour de lui et se lève en sursaut.
Qu’est-ce que je fais ici ?
LÉONTINE, avec véhémence.
Oui, Oui !
GÉLIDON.
Plus bas !
AMÉLIE.
Ne criez pas si fort, madame.
LÉONTINE.
Ça ne fait rien, puisqu’il est réveillé !
Elle éclate en sanglots.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! Il me trahit ! Il me trahit !
Elle s’appuie sur l’épaule d’Amélie, tout en la repoussant.
N’écoutez pas, madame Flache !
AMÉLIE.
Mais, madame, ça ne fait rien... Vous savez bien qu’avec moi ça n’a aucune importance...
LÉONTINE.
Moi qui avais tout sacrifié pour lui !...
Même jeu que plus haut.
N’écoutez pas, madame Flache !
AMÉLIE.
Mais ça ne m’apprend rien, je vous assure !
LÉONTINE, à Gélidon.
Après ce que j’ai fait pour toi !...
Se reprenant.
Pour vous...
AMÉLIE.
Pour toi ! Pour toi ! Voyons, ce n’est pas avec moi qu’il faut se gêner !
GÉLIDON, reprenant peu à peu possession de lui-même.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire !
LÉONTINE.
Hein ? Allez-vous-en, Amélie ! Ça me gêne que vous soyez ici...
Les lèvres tremblantes.
pour l’explication que je veux avoir avec lui...
GÉLIDON.
Hé bien, rentrons, nous pouvons avoir chez nous cette explication...
Il cherche à l’entraîner.
LÉONTINE.
Non, non, je ne veux pas attendre.
GÉLIDON.
Alors, en chemin, tout le long du chemin...
LÉONTINE.
Non, non... je ne m’en irai pas comme ça !... Laissez-nous, Amélie !
GÉLIDON.
Eh bien, soit ! Tenez, Amélie, entrez là, dans le petit salon.
LÉONTINE.
Le petit salon ! Ah ! je vois que tu connais la maison !
GÉLIDON.
Je suppose... À côté du grand salon, il y a toujours un petit salon.
Il fait signe à Amélie qui sort à gauche.
Scène XVI
LÉONTINE, GÉLIDON
LÉONTINE.
Allons, parle ! Tu es ici pour une femme, hein ? Depuis quelques jours tu n’es plus le même... Je ne te vois plus de la journée... Parbleu ! tu venais ici... Ah ! prends bien garde : tu me connais, tu sais de quoi je suis capable ! Si tu nous as menti, si tu as trahi ton parti !... je pourrai peut-être te pardonner... Mais si tu m’as trompée dans mon amour... ! Ah ! ça ne sera pas la même chose ! Je ne sais pas ce que je te ferai !
GÉLIDON, tout à fait maître de lui.
Léontine !... Ah ça ! c’est toi qui te moques de moi ?
LÉONTINE.
Comment ?
GÉLIDON.
Moi, je te tromperais... mais c’est stupide... ça n’a pas de nom...
LÉONTINE.
Alors, qu’est-ce que c’est que ce portrait ?
Elle lui met sous les yeux la photographie qu’elle avait gardée derrière son dos.
GÉLIDON.
Ce portrait ?
LÉONTINE.
Oui, ce portrait que tu avais dans, ta main, sur ton cœur ?
GÉLIDON.
Je ne sais pas qui c’est... Pourquoi est-ce que j’avais ce portrait dans la main ?
LÉONTINE.
C’est la demoiselle du château !
GÉLIDON.
Ah ! c’est le portrait de la demoiselle du château ? Elle est jolie.
LÉONTINE.
Et tu as comme ça son portrait dans la main ?
GÉLIDON.
À quoi penses-tu ? Voilà que tu es jalouse de cette personne que je ne connais même pas... Mais d’abord, s’il y avait quelque chose entre elle et moi et que tu me soupçonnes, est-ce que je viendrais te dire qu’elle est jolie ! Tu n’as aucune psychologie ! Je te dirais qu’elle est laide ou quelconque... Tandis que je te répète : Elle est jolie... elle est très jolie !
Il considère la photographie.
LÉONTINE.
Assez ! J’ai bien entendu.
Elle va s’asseoir dans la bergère.
GÉLIDON.
Mais tu ne penses pas ce que tu dis, hein ? De quoi m’accuses-tu ? De venir au château pour cette jeune fille ! Mais d’abord, même si j’étais amoureux d’elle, crois-tu que j’aurais le toupet de me présenter chez ces gens-là ?
LÉONTINE, après une courte hésitation.
Non.
GÉLIDON.
Et crois-tu qu’on ne me ficherait pas dehors si j’osais venir ici ?
LÉONTINE, ébranlée.
Si, mais...
GÉLIDON.
Mais quoi ?
LÉONTINE.
Mais tu y es !
GÉLIDON.
J’y suis ! Voilà bien un raisonnement de femme... Toi aussi tu y es... qu’est-ce que ça prouve ?
LÉONTINE.
Enfin, pourquoi es-tu au château ?
GÉLIDON.
Pourquoi je suis au château ?... Elle me demande pourquoi je suis au château ! Oh ! les femmes ! les femmes ! Elles ne savent pas vous faire crédit ! Tout de suite, elles accusent... Tout de suite, on est coupable ! Au lieu de se donner la peine de chercher, au lieu de se demander : « Pourquoi est-il au château ? » Immédiatement l’accusation à la bouche !
LÉONTINE.
Mais comment veux-tu que j’explique ça ?
GÉLIDON.
Il faut que tu l’expliques, pourtant ! Je suis au château, pourquoi suis-je au château ?
LÉONTINE.
Endormi !
GÉLIDON.
Je suis au château endormi, c’est entendu... Eh bien, pourquoi est-ce que tu trouves celui que tu aimes au château endormi ? Allons ! Trouve, trouve ! Donne-toi un peu de mal ! Je m’en donne bien, moi !
Il s’assied à gauche.
LÉONTINE, radoucie, allant à lui.
Quoi ! Tu me diras que tu y es venu en passant ?
GÉLIDON, acceptant cette idée.
Oui, je suis venu en passant !
Changeant de ton brusquement.
Eh bien, non, ça ne tient pas debout !
LÉONTINE.
On t’a attiré, peut-être ?
GÉLIDON.
Ça, c’est mieux... Je crois que tu brûles.
LÉONTINE.
Ils ont voulu t’attirer ici par politique... pour te gagner à eux ?
GÉLIDON.
C’est plausible !
LÉONTINE.
Mais ça ne m’explique pas pourquoi je te trouve en plein sommeil dans le repaire même de nos ennemis...
GÉLIDON.
Tu ne t’expliques pas... tu ne t’expliques pas... ça doit pouvoir s’expliquer, pourtant...
LÉONTINE.
Est-ce qu’ils t’auraient endormi ?
GÉLIDON, se levant, avec un cri de triomphe.
Allons donc ! Je savais bien que tu trouverais !
LÉONTINE, s’animant de plus en plus.
Ils t’ont fait boire quelque chose !
Regardant autour d’elle.
Cette bouteille ! Tu as bu de ce vin ?
GÉLIDON, vivement.
Évidemment, ça ne peut être que ça... Voilà la bonne explication... Attends... J’y suis !...
Comme sortant d’un rêve.
Je me rappelle... je me rappelle...
LÉONTINE.
Ah ! voyons !
Elle suit son récit avec anxiété.
GÉLIDON.
Le Baron m’a fait venir ici pour une communication très urgente. Il m’a fait asseoir... Il m’a souri... Il est venu à moi, un verre de vin à la main...
LÉONTINE.
Ah !
GÉLIDON.
Avec un air de bonne amitié.
LÉONTINE.
Oh !
GÉLIDON.
Moi, je me méfiais, n’est-ce pas ? mais je n’ai pas voulu avoir l’air d’avoir peur...
LÉONTINE.
Ah ! tu es toujours le même... Je te reconnais bien là.
GÉLIDON.
Et j’ai bu... par bravade... ou par soif... j’ai bu...
LÉONTINE.
Et tu t’es endormi ?
GÉLIDON.
Et je me suis endormi, voilà.
Il se rassied dans la bergère, soulagé.
LÉONTINE.
Voilà...
Après un temps.
Mais ce portrait ?
GÉLIDON.
Ah ! ça... c’est le mystère absolu... Oh ! Sherlock Holmes !... Sherlock Holmes !... Comment ce portrait était-il entre mes mains ?
LÉONTINE, triomphalement.
J’ai trouvé !
GÉLIDON.
Pas possible !
LÉONTINE, d’un ton péremptoire.
Si. C’est encore une machination de ces gens-là... Ils m’ont vue arriver, ils ont deviné que je te surprendrais et ils ont profité de ton sommeil pour placer ce portrait dans ta main... afin de nous brouiller, de nous séparer !
GÉLIDON.
C’est clair comme le jour !
LÉONTINE.
Ah ! les lâches ! les lâches !
GÉLIDON.
Léontine, tu es admirable ! Sans toi, jamais je n’en serais venu à bout...
LÉONTINE.
Oh ! je t’aime !... et puis, je suis contente d’avoir trouvé cette explication.
GÉLIDON.
Et moi donc ! Il y a de la ressource avec une femme comme toi... qui a de l’amour, du vrai amour, et de l’imagination... Moi, je n’aurais pas pu rassembler mes souvenirs si tu ne m’avais pas aidé... Je me serais troublé, il serait resté dans ton esprit un doute.
LÉONTINE.
Oh ! il ne m’en reste plus, va ! J’ai en toi une confiance absolue...
GÉLIDON, tombant sur un fauteuil près de la table de gauche.
Voilà ! Voilà !
À part.
La confiance absolue !
LÉONTINE.
Qu’est-ce que tu as ?
GÉLIDON.
Rien. Je suis brisé !
LÉONTINE.
Il y a de quoi !
GÉLIDON.
J’ai la gorge sèche ! Machinalement il prend la bouteille pour se verser un verre de vin.
LÉONTINE, lui saisissant le bras.
Malheureux !
GÉLIDON.
Qu’est-ce qu’il y a ?
LÉONTINE.
Le narcotique !
GÉLIDON.
Ah ! c’est vrai ! c’est vrai !
Il sursaute et traverse vivement la scène.
Je ne peux même pas boire !... Je suis environné de pièges... Il faut que nous quittions cette maison !... Viens !
LÉONTINE.
Oh ! attends ! attends ! Pas si vite. Tu ne te doutes pas de ce qui se passe !
GÉLIDON.
Quoi donc ?
LÉONTINE.
Béjun est ici !
GÉLIDON.
Non ?
LÉONTINE.
Si, j’en suis sûre ; je le sais par quelqu’un de l’imprimerie ! Le misérable ! il est venu se vendre encore une fois !
GÉLIDON.
Oh ! oh ! quelle horreur ! Pouah ! Allons-nous-en !
LÉONTINE.
Non, je veux le trouver, le ramener !
GÉLIDON.
Tu vois bien qu’il n’est plus là ! Ils ont dû le mettre à la porte. Ah ! sois tranquille, moi, ils ne m’auront pas. La lutte continue, plus acharnée que jamais.
LÉONTINE.
Tu vas leur administrer un de ces articles !
GÉLIDON.
Je l’ai là !
Il tire des touilles de sa poche.
Non, pardon !
À part.
ça, c’est l’autre !
LÉONTINE, très exaltée.
Fais voir !
GÉLIDON.
Non, plus tard ! plus tard ! Il n’est pas assez terrible ! Je vais le corser... Viens !
Il remet l’article dans sa poche.
LÉONTINE.
Oui, partons, mon Lucien !
GÉLIDON, l’arrêtant.
Oui, mais pas ensemble.
LÉONTINE.
Pourquoi ça ?
GÉLIDON.
Il ne faut pas que les gens du château nous aperçoivent... Je les connais à présent... Ils diraient à Béjun des infamies sur notre compte... Ils sont capables de tout... Non, tu vas partir avec Amélie.
Il va ouvrir la porte de gauche et appelle.
Amélie !
AMÉLIE, rentrant.
J’ai mis un peu d’ordre là-dedans. Il y avait une poussière !... C’est bien mal tenu ce château !
GÉLIDON.
Oui, oui, allons-nous-en : c’est trop mal tenu !
On entend appeler au dehors : Montillac ! Montillac ! Gélidon, s’oubliant.
Voilà !
Se reprenant.
Voilà qu’on appelle Montillac ! Vite ! Vite !
LÉONTINE.
Attends ! Je ne serais pas fâchée de le voir celui-là !
GÉLIDON, cherchant à l’entraîner.
Il n’a rien d’intéressant.
LÉONTINE.
Tu n’es pas curieux de voir sa figure, toi ?
GÉLIDON, se regardant malgré lui dans la glace.
Oh ! pas du tout ! pas du tout ! Et je te défends même de rester là. Tiens, file par là avec Amélie.
Il désigne la porte de gauche.
Moi je vais passer par la cuisine.
Il va vers l’escalier.
LÉONTINE.
La cuisine ? Là-haut ?
GÉLIDON, précipitamment.
Oui. Ça doit être là-haut, la cuisine.
Il monte les marches en courant.
Scène XVII
LÉONTINE, AMÉLIE
LÉONTINE.
Ah ! Amélie ! Dire que j’avais soupçonné cet homme-là... Moi qui suis si coupable envers lui !
AMÉLIE.
Vous, madame ?
LÉONTINE.
Vous ne savez pas ce que j’ai fait ! J’ai trouvé que sou article sur Montillac n’était pas assez violent, alors j’ai rajouté quelques lignes terribles... Je n’ai pas osé le lui avouer tout à l’heure... qu’est ce qu’il va dire ?
AMÉLIE.
Ces messieurs journalistes n’aiment pas ça d’habitude...
LÉONTINE.
Il serait peut-être encore temps de supprimer ces quatre lignes.
AMÉLIE, remontant.
Pensez-vous, madame ! Le journal est tiré à cette heure-ci !
LÉONTINE.
Alors, allons-nous-en !
AMÉLIE, regardant au dehors.
Voici M. Béjun avec le Baron.
LÉONTINE.
Béjun ! Ah ! nous allons rire ! Filez par là vous !
Léontine se dissimule sur l’escalier. Amélie sort à gauche.
Scène XVIII
BÉJUN, LE BARON, MADELEINE, MADAME DE FIFTY
Béjun apparaît au fond avec le Baron. Madeleine et Mlle de Fifty.
BÉJUN, au baron.
Ah ! quel drôle d’étang, mon baron ! Les poissons flottent à la surface avec le ventre en l’air... Moi je vous dirai que ça me déroute un peu de pêcher du poisson mort !
LE BARON.
Écoutez, Béjun, nous repeuplerons l’étang sur vos indications.
MADELEINE.
Il faudra venir pêcher très souvent.
BÉJUN, à Mme de Fifty.
Et puis madame, qui dansait si gentiment sur la berge, m’apprendra ce petit pas là.
MADAME DE FIFTY.
Le tango ?
BÉJUN.
Le nom m’est égal. Moi, j’ai su danser dans mon temps... J’apprendrai très vite.
Il enlace Mme de Fifty et la fait tournoyer. Il en fait autant avec Madeleine, qui rit beaucoup. Cependant Léontine est descendue, s’est approchée, sans qu’on la remarque. Béjun, emporté par son mouvement, va pour la saisir à la taille, quand il reconnait Léontine. Il s’arrête lentement de danser et présentant Léontine.
Madame Béjun !
LE BARON et LES DAMES, saluant.
Madame...
LÉONTINE, à Béjun.
Voilà où tu en es venu ! Tu danses chez nos ennemis ?
BÉJUN, faiblement.
Ce sont des ennemis très convenables et très comme il faut.
LÉONTINE, sursautant.
Des gens très comme il faut ! qui ont attiré ici M. Gélidon pour l’empoisonner !
BÉJUN.
Qu’est-ce que c’est !
LE BARON, stupéfait.
Qu’est-ce que vous dites, madame ?
LÉONTINE.
Des gens qui lui ont fait prendre un narcotique après lui avoir mis dans la main un portrait... le portrait de mademoiselle...
MADELEINE.
Mon portrait !
LÉONTINE.
Oui, oui, pour que je le surprenne, n’est-ce pas ?
Se reprenant.
c’est-à-dire moi ou quelqu’un d’autre... Enfin toutes sortes de machinations !
LE BARON.
Mais, madame, je ne comprends rien à tout cela !
LÉONTINE.
Vous ne comprenez pas ? Ah ! je vais vous faire comprendre !
Montrant la bouteille.
Ayez donc l’aplomb de prétendre que ce vin ne contenait pas de la drogue ?
BÉJUN, effrayé.
Qu’est-ce que tu dis ?
LÉONTINE.
Il contenait de la drogue !
BÉJUN, effrayé.
Mais dis donc, moi j’en ai bu !
LÉONTINE.
Tu en as bu, imbécile !
BÉJUN.
Mais tu m’inquiètes... Je ne me sens pas à mon aise... Et puis ce poisson mort sur leur étang... Ils m’ont fait pêcher du poisson empoisonné !...
Madeleine et Mme de Fifty veulent protester. Le baron les apaise d’un geste et se contente de hausser les épaules.
LÉONTINE, prenant la bouteille.
Nous emportons le vin !
BÉJUN, prenant la bouteille des mains de Léontine.
C’est ça !
LÉONTINE.
Il y a un chimiste à Valmoutiers !
BÉJUN.
L’aide-pharmacien...
LÉONTINE.
On lui montrera le contenu de cette bouteille et, s’il y trouve ce que nous pensons, nous le dirons dans notre journal... et même sur une affiche.
BÉJUN.
C’est ça, on fera une affiche !... Et vous répondrez par une autre affiche... Il vous faudra deux ou trois affiches pour vous justifier.
LÉONTINE.
Ce sont des manières de bandits !
BÉJUN.
Ce sont des manières de bandits !
LÉONTINE.
Vous aurez de nos nouvelles, empoisonneur !
BÉJUN.
Empoisonneur !
LÉONTINE, à Béjun.
Viens avec moi, être sans dignité !
BÉJUN.
Être sans dignité !... Ah ! c’est moi !... je viens !
Ils sortent au fond.
Scène XIX
LES MÊMES, moins BÉJUN et LÉONTINE, puis MADAME DE TRÉMOUSSIN, LARNOIS, puis LE COMMANDANT et LA CHEVILLETTE
LE BARON, stupéfait.
Mais qu’est-ce que c’est que ces gens-là ?
MADAME DE FIFTY.
Cette femme est extraordinaire !
MADELEINE.
Elle est complètement folle !
À ce moment Gélidon descend l’escalier avec précaution.
LE BARON, l’apercevant.
Dites donc, Montillac, savez-vous qui nous avons trouvé ici ?
GÉLIDON.
Qui ça ?
LE BARON.
Mme Béjun !
GÉLIDON.
Ah ! vous l’avez vue ?
LE BARON.
Mais ça n’a pas l’air de vous surprendre ?
GÉLIDON.
Oh ! vous savez, je commence à m’y faire.
MADELEINE.
Savez-vous ce qu’elle a prétendu ? Elle a prétendu que nous avons voulu empoisonner Gélidon.
GÉLIDON.
Où vont-ils prendre des idées pareilles ?
LE BARON.
Au fond, ce Gélidon, que nous ne connaissons pas et que nous n’arrivons pas à voir, il est l’âme de toutes ces machinations.
MADAME DE FIFTY.
Certainement. Il doit passer sa vie à monter la tête à ces gens. Écoutez, monsieur Montillac, je n’ai pas de conseils à vous donner, mais vous devriez lui clouer le bec une bonne fois, plus énergiquement que vous ne l’avez fait jusqu’ici.
GÉLIDON.
Mais comment voulez-vous ? Vous lisez ses articles, vous voyez comme ils sont prudents. Ah ! je vous réponds que je guette l’occasion de monter le ton de la polémique, je la guette comme un chacal !... Mais on dirait qu’il se méfie... Et, comme moi, je ne crois pas de la dignité de notre parti de commencer... Ah ! nous ne l’aurons pas, j’en ai peur...
Entre Mme de Trémoussin suivie de Larnois.
MADAME DE TRÉMOUSSIN, tenant en mains le journal le Phare.
Demandez le Phare, son dernier numéro ! L’article sensationnel de M. Gélidon !
LARNOIS.
On vient de l’apporter. Nous ne l’avons pas encore lu.
LE BARON, allant s’asseoir à droite.
Voyons !
À Gélidon.
Vous voulez peut-être y jeter un coup d’œil avant ?
GÉLIDON.
Non, non, je ne suis pas pressé.
Le Baron lit des yeux l’article. Madeleine et les deux jeunes femmes le lisent par-dessus son épaule. Pendant ce temps, Gélidon s’entretient à l’avant-scène gauche avec Larnois.
LARNOIS.
Tu sais à peu près ce qu’il y a dans cet article ?
GÉLIDON.
Je m’en doute. Sais-tu ce qu’ils sont en train de faire ? Ils épluchent l’article pour voir si Gélidon monte le ton de la polémique, de façon que Montillac puisse lui répondre vertement.
LARNOIS.
Et tu es bien tranquille !
GÉLIDON.
Tu penses !
LE BARON.
Oh ! oh ! mais...
MADAME DE FIFTY.
Oh ! Oh !
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Oh ! mais il se monte, M. Gélidon !
GÉLIDON.
Qu’est-ce qu’il y a ?
LE BARON.
Voilà qui est très intéressant pour vous, Montillac. Notre ami Gélidon change singulièrement son ton habituel à la fin de son article.
GÉLIDON, tranquille.
Qu’est-ce qu’il dit !
LE BARON.
Attendez ! attendez !
Il lit.
« Mais assez de ménagements et disons une fois pour toutes son fait à ce personnage que nous avons trop bien ce traité jusqu’à présent, à ce parasite du grand monde qui n’est qu’un lâche et un goujat ! »
GÉLIDON, stupéfait.
Mais je n’ai jamais écrit ça !
MADELEINE, riant.
Mais il ne s’agit pas de votre article. C’est le Phare que nous lisons en ce moment, c’est l’article de Gélidon.
GÉLIDON.
Gélidon n’a jamais écrit ça !... C’est un abus de confiance, on a mis ces lignes au-dessus de sa signature...
Bas à Larnois.
Ça, c’est un coup de Léontine.
MADELEINE.
En tout cas, M. Gélidon en endosse la responsabilité.
LE BARON.
Enfin, nous le tenons ! Montillac, vous devez être content. Vous l’avez assez répété au commandant : « Moi, je ne le raterai pas à la première occasion ! »
GÉLIDON.
Soyez tranquille, je vais lui répondre de ma bonne encre... et, dès demain, il se calmera, il sera doux comme un agneau, je vous en réponds.
Entrent le commandant et La Chevillette.
MADAME DE FIFTY.
Voilà le commandant !
LE BARON.
Eh bien, commandant ! Vous avez lu l’article ?
LE COMMANDANT.
Oui, oui, c’est fait ! c’est arrangé !
GÉLIDON.
Qu’est-ce qui est arrangé ?
LE COMMANDANT.
Vous vous battez demain avec Gélidon.
GÉLIDON.
Je me bats demain avec Gélidon ?... Je me bats demain avec Gélidon ?...
LE COMMANDANT.
Mon cher Montillac, vous nous avez maintes fois répété que vous n’attendiez qu’une provocation de Gélidon peut nous envoyer chez lui...
GÉLIDON.
Je vous ai dit...
LE COMMANDANT.
Me l’avez-vous dit, oui ou non ?
GÉLIDON.
Je vous l’ai dit... mais...
MADAME DE FIFTY.
Quel effet ça lui fait !
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
Enfin vous ne reculez pas devant Gélidon ?
GÉLIDON.
Devant Gélidon moins que devant personne !
LE COMMANDANT.
Voilà qui va très bien. Forts de votre autorisation, nous avons pensé qu’il ne fallait pas perdre de temps. À peine avions-nous pris connaissance de l’article que nous nous sommes rendus illico aux bureaux du journal le Phare.
LE BARON.
C’est bien ! c’est très bien, commandant ! C’est une bonne initiative. MADELEINE.
Oui, oui, c’est très bien.
Elle regarde Gélidon.
MADAME DE FIFTY.
À Gélidon. C’est très bien, n’est-ce pas ?
GÉLIDON, d’une voix faible.
C’est très bien !
MADAME DE FIFTY, à Gélidon.
Eh bien, remerciez le commandant !
GÉLIDON.
Merci, mon commandant !
LE COMMANDANT, ému.
Je n’ai fait que mon devoir.
Il embrasse Gélidon.
GÉLIDON.
Mais, commandant... Il y a une petite chose que je ne m’explique pas... Comment avez-vous pu arranger le duel sans avoir vu Gélidon ?
LA CHEVILLETTE.
Mais comment savez-vous que nous ne l’avons pas vu ?
GÉLIDON, se tournant vers Larnois.
Oui, comment est-ce que je le sais ?... Eh bien, c’est parce qu’il n’est jamais à l’imprimerie vers ces heures-ci.
LE COMMANDANT.
En effet, il n’y était pas. Mais nous avons trouvé deux des membres du comité Béjun.
LA CHEVILLETTE.
Notamment un M. Moreau, un ami personnel de Gélidon.
GÉLIDON.
Oh ! ami... ami !...
Larnois le pousse du coude.
LE COMMANDANT.
Enfin, il s’est donné comme tel et il a pris sur lui d’arranger la rencontre avec nous... À l’épée, bien entendu...
GÉLIDON.
À l’épée ?...
LA CHEVILLETTE.
Vous auriez préféré le pistolet ?
GÉLIDON.
Non, je n’ai pas de préférence.
LE COMMANDANT.
Enfin, c’est pour demain matin à sept heures dans le parc du château... J’ai pensé que le baron...
LE BARON.
Mais oui, mais oui... Tout le parc est à votre disposition... Il y a vingt hectares : je pense que les adversaires n’en utiliseront qu’une faible partie.
À Gélidon.
Est-ce que vous êtes un peu là comme tireur ?
GÉLIDON, égaré.
Oh ! je dois être à peu près de la force de Gélidon.
LE COMMANDANT.
Voilà qui est arrangé.
GÉLIDON, d’un air dégagé.
Voilà qui est arrangé... Je suis content, messieurs, de cette solution... Je vous demanderai la permission de dire un mot à mon ami Larnois.
LE BARON, à La Chevillette.
Les dernières dispositions !
LA CHEVILLETTE, au commandant.
Les dernières dispositions !
LE COMMANDANT.
Oui, je vois.
Ils remontent.
GÉLIDON, à Larnois à demi-voix.
Qu’est-ce que tu veux, mon vieux, je vais foutre le camp !
LARNOIS.
Tu retournes à Paris ?
GÉLIDON.
Non, non, plus loin... Je vais dans l’Amérique du Sud, le plus au sud possible...
Au baron.
Alors, baron...
À Madeleine.
Mademoiselle... il ne me reste plus qu’à prendre congé de vous... jusqu’à demain...
LE COMMANDANT.
Mais où allez-vous ?
GÉLIDON.
Je rentre chez moi.
LE COMMANDANT, lui mettant la main sur l’épaule.
Oh ! mais non, vous restez ici, je ne vous laisse pas partir...
Ému.
Jusqu’à demain, mon cher enfant, vous m’appartenez !
LE BARON, lui mettant la main sur l’autre épaule.
On va vous faire préparer une chambre...
LE COMMANDANT.
Installez-lui un lit dans mon cabinet de toilette.
MADAME DE TRÉMOUSSIN.
J’y vais.
Elle monte l’escalier.
LE COMMANDANT.
Il faudra surveiller sa nourriture : un petit dîner léger.
MADAME DE FIFTY.
Je vais m’en occuper.
Elle monte l’escalier.
LE COMMANDANT, entraînant Gélidon.
Venez avec moi, nous allons faire un peu d’épée pour vous mettre en train... Après, vous vous étendrez sur votre lit et je veillerai sur votre sommeil... Je suis votre frère d’armes : votre grand frère...
Il va pour l’embrasser.
GÉLIDON.
Non, non, commandant, pas d’attendrissement !... J’irai où l’on voudra... je ferai ce que l’on voudra... à présent je suis dans le bal, advienne que pourra ; mais je vous en supplie, commandant, pas d’attendrissement inutile et surtout ne m’embrassez plus ! ne m’embrassez plus !
Il se dégage et monte l’escalier avec précipitation.
LE COMMANDANT, en le suivant.
Il est un peu énervé.
LE BARON, à La Chevillette et à Larnois.
Nous allons faire l’article pour annoncer le duel !
Ils suivent les deux autres. Madeleine reste seule en scène.
Scène XX
MADELEINE, puis LÉONTINE et AMÉLIE
MADELEINE.
Il va se battre !
LÉONTINE, paraissant fond avec Amélie.
Non, laissez-moi !... laissez-moi...
Elle entre dans le salon. Amélie reste au dehors.
Mademoiselle ?
MADELEINE.
Qu’est-ce que c’est ?
LÉONTINE.
Mademoiselle, c’est vous que je voulais voir.
MADELEINE.
Comment, madame, après cette scène ridicule de tout à l’heure ?
LÉONTINE.
Précisément, après cette scène ridicule de tout à l’heure. Mademoiselle, je viens d’apprendre des choses que je ne savais pas ; d’abord c’est que M. Montillac se battait avec M. Gélidon... Mais ça, je me doutais que cela arriverait... Ensuite, j’ai su, par des indiscrétions, qu’il y avait... comment dirais-je ?... un flirt entre vous et M. Montillac...
MADELEINE.
Madame, vous me gênez...
LÉONTINE.
Mademoiselle, vous me ravissez... Figurez-vous que j’avais cru,... enfin j’avais conçu toutes sortes de doutes quand j’avais trouvé votre portrait entre les mains de M. Gélidon... Je vous l’ai dit tout à l’heure...
MADELEINE.
Vous l’avez même crié...
LÉONTINE.
Je vous en demande pardon.
MADELEINE.
Je ne connais pas M. Gélidon, je ne l’ai jamais vu.
LÉONTINE.
C’est ce qu’il m’avait dit ; il ne m’avait pas menti. D’ailleurs un mensonge de sa part m’étonnerait : c’est un homme tout à fait loyal.
MADELEINE.
Oui, il paraît. Je le sais, je vous dirai, parce que, quand M. Montillac parle de lui, il rend toujours hommage à son caractère et à son talent.
LÉONTINE.
C’est comme M. Gélidon. Il ne m’a jamais dit de mal de M. Montillac, au contraire.
MADELEINE.
Comment se fait-il alors qu’il se soit laissé aller à l’injurier d’une façon aussi violente ?
LÉONTINE.
Mademoiselle...
Après une hésitation.
Voilà... j’ai commis une grande faute...
MADELEINE, baissant les yeux.
Oui... je sais...
LÉONTINE.
Vous savez ?
MADELEINE.
Vous avez été infidèle à M. Béjun.
LÉONTINE.
Non, ce n’est pas ce que j’appelle une faute !... c’est-à-dire si, si... mais ce n’est pas de cette faute-là que je veux parler... Je ne peux pas vous dévoiler ce que j’ai fait... mais je suis la cause de ce duel... et ce serait un remords pour moi s’il arrivait quelque chose de grave à l’un de ces messieurs. M. Gélidon est un homme charmant...
MADELEINE.
M. Montillac aussi !
LÉONTINE.
Ah ?... Comment est-il M. Montillac ? Un tout jeune homme ?
MADELEINE.
Non. Je ne sais pas l’âge qu’il a exactement, mais il n’est pas tout jeune, tout jeune.
LÉONTINE.
M. Gélidon est très jeune.
MADELEINE.
Ce qui me plaît dans M. Montillac, c’est qu’il est tellement attentif, tellement prévenant !...
LÉONTINE.
On ne peut pas dire précisément ça de M. Gélidon. Il est assez distrait, lui, il s’absorbe, il pense à autre chose...
MADELEINE.
Et puis, M. Montillac a cette qualité charmante ; il est si réservé... je dirai presque respectueux.
LÉONTINE, riant.
Oh ! M. Gélidon, pas du tout, par exemple !
MADELEINE.
Madame, vous ne trouvez pas monstrueux que ces deux hommes aillent se faire du mal demain ?
LÉONTINE.
D’autant plus qu’ils ne s’en veulent pas véritablement. Il faut que nous agissions l’une et l’autre ! Il est trop tard pour empêcher ce duel ; la politique s’en est mêlée, mais obtenons d’eux qu’ils se ménagent.
MADELEINE.
Merci, madame.
LÉONTINE.
Mais c’est moi qui vous remercie. Je suis contente de vous rendre service... et aussi d’empêcher qu’il arrive quelque chose à M. Montillac... votre ami... que je ne connais pas... mais que je devine...
S’exaltant peu à peu.
cet amoureux discret... inquiet... à la fois tendre et énergique... chez qui l’on sent une ardeur contenue, d’autant plus attirante qu’elle ne peut s’exprimer... je le vois, je le vois !...
Madeleine lui tend la main. Léontine la lui serre.
MADELEINE.
Je vous remercie, madame.
LE BARON, au dehors appelant.
Madeleine ! Madeleine !
MADELEINE.
Voilà, papa !
À Léontine, en mettant un doigt sur ses lèvres.
Entre nous.
LÉONTINE.
Entre nous.
Madeleine monte l’escalier.
AMÉLIE, entrant du fond.
Madame ?...
LÉONTINE.
Oui, oui !...
AMÉLIE.
Vous venez ?
LÉONTINE.
Je viens ! Je viens !...
Après un temps. Rêveuse.
Ce qu’il doit être bien, ce Montillac !
Elles sortent par le fond pendant que le rideau tombe.
ACTE III
La scène représente un coin du parc du château. Au premier plan, à gauche, le pavillon occupé par les Floche, dont on aperçoit, face au public, la porte d’entrée surélevée de quelques marches et une fenêtre du premier étage. À gauche et à droite, premier plan, deux petits bâtiments où l’on met les outils de jardinage. Au fond, à droite, une vieille tour en ruines, couverte de feuillages, avec une porte n’ouvrant que du dehors par un gros loquet de fer. Un banc à droite.
Scène première
LE JARDINIER chante, en ratissant une allée, AMÉLIE entre, puis FLACHE
LE JARDINIER, avec des pots de fleur dans les bras.
Bonjour Madame.
AMÉLIE.
Bonjour mon garçon.
LE JARDINIER.
Vous ne me reconnaissez pas, Madame ?
AMÉLIE.
Non.
LE JARDINIER.
Il n’y a pas d’offense : vous ne m’avez jamais vu. Je suis le jardinier du château. Et vous, madame, qui c’est-y que vous êtes ? C’est au moins la personne qui habile le petit pavillon ?
AMÉLIE.
Oui, mon garçon, depuis hier.
LE JARDINIER.
Ah ! mais, vous vous êtes levée de bien bonne heure ! Il est à peine six heures.
AMÉLIE.
Mais vous, vous travaillez de bonne heure aussi !
LE JARDINIER.
Oui. Monsieur le baron m’a commandé de préparer le sol de l’allée ici, parce que deux messieurs ils vont se rencontrer en duel.
AMÉLIE.
Moi, j’attends mon mari, M. Flache, qui devrait être rentré de l’imprimerie. D’habitude, le travail est bouclé à deux heures du matin.
LE JARDINIER.
Tenez, ce barbu qui vient par là...
AMÉLIE.
Ah ! C’est lui... Il a l’air de mauvaise humeur...
Entre Flache.
LE JARDINIER.
Aussi, ce n’est pas des heures pour rentrer de son travail.
Il sort avec les pots de fleurs.
Scène II
AMÉLIE, FLACHE
AMÉLIE.
C’est à cette heure-ci que vous rentrez ?
FLACHE, furieux.
C’est ce duel qui nous a retardés ! On avait égaré au journal les procès-verbaux d’envoi de témoins. Bref, nous avons bouclé deux heures plus tard.
AMÉLIE.
Ah ! C’est bien la peine ! Pour ce qu’il est lu, votre canard !
FLACHE.
Il est aussi lu que le vôtre ! Et il a au moins cet avantage de ne pas être rédigé, comme le vôtre, par des sagouins et des voyous.
AMÉLIE.
Des sagouins et des voyous ! Ah ! je vous conseille de faire le fier avec vos noblaillons et vos barons gâteux !
FLACHE.
Amélie !...
AMÉLIE.
Qu’est-ce qu’il y a ?
FLACHE.
Le devoir conjugal !
Il entre dans le petit pavillon.
AMÉLIE, après un grognement.
Voilà ! Voilà !
Elle sort à la suite de Flache.
Scène III
LA CHEVILLETTE, LE BARON, puis LE COMMANDANT, GÉLIDON et LARNOIS
LA CHEVILLETTE, entrant du fond à gauche, suivi du baron.
Je suis très ennuyé, mon cher baron. Figurez-vous que je n’ai pas de chapeau melon.
LE BARON.
Et alors ?
LA CHEVILLETTE.
Comment, et alors ? Mais vous oubliez que je suis témoin.
LE BARON.
Ah ! c’est pour ça ? Le commandant a un chapeau haut de forme.
LA CHEVILLETTE.
Oui, mais je ne voulais pas mettre de haut de forme. Restait le chapeau mou et le chapeau de paille... Ah ! que faire ? Ma foi, je me suis jeté à l’eau et j’ai pris un chapeau mou.
Entre le commandant, portant deux épées dans une housse, et suivi de Gélidon et de Larnois.
LE COMMANDANT.
Ah ! nous sommes les premiers. Votre adversaire n’est pas encore là.
GÉLIDON.
Non, je ne l’aperçois pas.
LE COMMANDANT, à Gélidon.
Asseyez-vous, mon fils !
Il lui montre le banc et va déposer les épées.
GÉLIDON, à Larnois.
Je suis son fils, maintenant ! Ah ! mon vieux ! quelle nuit j’ai passée ! Il m’a fait faire des armes jusqu’à deux heures du matin et, ensuite, sous prétexte de veiller sur mon sommeil, il s’est installé dans un fauteuil, dans ma chambre, et il n’a cessé de ronfler.
LARNOIS.
Comment vas-tu te tirer de là ?
GÉLIDON.
Je vais tâcher de me débiner.
LE COMMANDANT, s’approchant.
Vous vous sentez bien, mon fils ?
GÉLIDON.
Oui, papa.
Se reprenant.
Oui, mon commandant.
À part.
Ah ! foutre le camp !
LE COMMANDANT, au baron.
Vous avez pris des dispositions, baron, pour que personne n’assiste au combat ?
LE BARON.
Le parc est gardé : Alfred, mon maître d’hôtel, et Théodore, mon valet de chambre, sont à la grille avec une consigne formelle : jusqu’à la fin du combat, ils ne laisseront ni entrer, ni sortir.
GÉLIDON, bas à Larnois.
Bonne idée !
LE COMMANDANT.
On ne peut pas escalader le mur de clôture ?
LE BARON.
Il est hérissé de tessons de bouteilles, et j’ajoute que, tous les cinq ou six pas, il y a un piège à loups... de quoi s’abîmer sérieusement les jambes.
Gélidon se tâte les jambes.
LE COMMANDANT.
Bon, nous n’aurons pas de curieux.
LE BARON.
Non, pas de curieux, pas de curieux sous aucun prétexte. Simplement un opérateur du cinéma...
Faisant un signe en coulisse.
Venez, monsieur.
Entre l’opérateur du cinéma tenant son appareil.
Scène IV
LA CHEVILLETTE, LE BARON, LE COMMANDANT, GÉLIDON, LARNOIS, L’OPÉRATEUR
LE BARON, à l’opérateur.
Ah ! Vous avez votre appareil ?
L’OPÉRATEUR.
Oui, monsieur.
Il installe son appareil.
LE COMMANDANT.
Un cinéma ?
LE BARON.
Si ça vous gêne...
LE COMMANDANT.
Qui nous prendra tous ?
LE BARON.
Dame !
LE COMMANDANT.
Ce sont des mœurs, nouvelles !...
D’un air résigné.
Résignons-nous aux mœurs nouvelles !
Il rajuste sa cravate, met son chapeau droit, tortille sa moustache et tire sa redingote.
LA CHEVILLETTE, au baron.
Je me demande s’il n’y a pas là quelque chose d’immoral et d’indécent... Et puis, j’ai un chapeau mou.
L’OPÉRATEUR, au baron.
Voulez-vous que je prenne ces messieurs ?
LE BARON.
Mais oui.
L’OPÉRATEUR, au commandant, en le faisant passer à gauche.
Vous permettez... Vous y êtes ?... Allez ! Je tourne !
La Chevillette passe devant l’appareil avec le commandant.
L’OPÉRATEUR.
Attention, messieurs, vous n’êtes plus dans le champ.
LE COMMANDANT.
Le champ ?
L’OPÉRATEUR.
Il faut rentrer dans le champ de l’appareil... Là, je vous remercie, messieurs.
LE COMMANDANT, au baron.
Le médecin va arriver tout à l’heure... Figurez-vous qu’il n’y en a qu’un de disponible à Valmoutiers : l’autre est malade. Alors, nous n’aurons qu’un médecin : ce sera un peu irrégulier.
GÉLIDON, à Larnois.
Ce ne sera toujours pas plus irrégulier que d’avoir un seul combattant !
LE COMMANDANT, qui essaie du pied le terrain.
Ce n’est pas un mauvais sol !
LE BARON.
Il y a un autre emplacement par là-bas ; allons l’essayer, puisque nous avons le temps ; mais celui-ci me paraît bien.
LE COMMANDANT, à Gélidon.
Restez, mon fils, ce n’est pas la peine de vous fatiguer.
Désignant le petit pavillon.
Tenez, entrez là avec Larnois.
Plein de sollicitude.
Je reviens, je reviens.
Il sort par le fond avec le baron, La Chevillette et l’opérateur.
Scène V
GÉLIDON, LARNOIS
GÉLIDON.
Qu’est-ce qui va se passer, maintenant ? Les autres vont arriver, je vais être obligé de me cacher !... Le commandant ne me lâche pas ! Si mes témoins de la ville m’aperçoivent avec mes témoins du château, et, inversement, si mes témoins du château m’aperçoivent avec mes témoins de la ville...
LARNOIS.
Il arrivera bien un moment où il faudra te montrer devant les quatre témoins à la fois.
GÉLIDON.
Je ne ferai jamais qu’un seul adversaire. Je ne peux pas me dédoubler !
LARNOIS.
Enfin, décide-toi ! Il est grand temps, je t’assure. Opte une bonne fois pour Gélidon ou pour Montillac.
GÉLIDON.
Je ne peux pas.
Il se prend la tête dans les mains. Entre le docteur, portant une grande quantité de boîtes et d’instruments divers.
Scène VI
GÉLIDON, LARNOIS, LE DOCTEUR, puis MADELEINE, puis FLACHE, à la fenêtre
LE DOCTEUR, à Larnois.
Je suis le médecin que l’on a fait demander pour le duel.
LARNOIS.
Parfaitement.
LE DOCTEUR, bas, désignant Gélidon assis sur le banc.
Monsieur est un des combattants ?
Larnois fait signe que oui. À Gélidon.
Monsieur Montillac ou monsieur Gélidon ?
GÉLIDON, absorbé.
Je ne sais pas.
LE DOCTEUR.
Plaît-il ?
LARNOIS.
Laissez-le.
LE DOCTEUR.
Il paraît un peu nerveux.
À Gélidon.
C’est peut-être la première fois que vous vous battez ?
GÉLIDON.
Oui, dans ces conditions-là.
LE DOCTEUR.
Voilà mes instruments de chirurgie. J’ai apporté ce que j’ai pu trouver en ville.
LARNOIS.
Donnez, je vais déposer tout ça dans la vieille tour.
Il débarrasse le docteur et pose les boîtes dans la tour.
GÉLIDON.
Mais il y a de quoi opérer tout un régiment !
LE DOCTEUR.
Que voulez-vous ? je n’ai pas l’habitude. C’est mon premier duel... Vous savez, à Valmoutiers... Et j’avoue que je ne suis pas très rassuré. Je voudrais bien que ce soit fini.
GÉLIDON.
Moi aussi !
LE DOCTEUR.
D’autant plus, figurez-vous, que j’étais au chevet de mon confrère, l’autre médecin de la ville. Il est constamment malade. C’est mon meilleur client. J’étais en train de lui faire une ponction.
GÉLIDON, vivement.
Retournez-y donc.
LE DOCTEUR.
Comment ? Mais le duel ?
GÉLIDON.
Mais le duel n’a pas lieu maintenant !... Il manque quelqu’un.
LARNOIS.
Quelqu’un d’indispensable.
LE DOCTEUR.
Alors, vous pensez que j’ai le temps d’y retourner ?
GÉLIDON.
Vous avez tout votre temps. Allez vite ! Allez vite ! Il faut soigner votre malade... Il faut soigner votre malade.
Il pousse le docteur au fond à droite, avec Larnois.
MADELEINE, entrant par la gauche, entre le petit bâtiment et le pavillon de Flache.
Monsieur Montillac ?
GÉLIDON, à part.
Cette fois, c’est moi !
Haut.
C’est moi.
MADELEINE.
Je sais bien que c’est vous, monsieur Montillac... Figurez-vous que papa m’a défendu d’assister au duel et je n’ai pu vous voir hier soir, mais j’ai tenu à vous parler ce matin... Je ne vous dis pas : « Bonne chance ! » Ça ne se dit pas !... Mais je veux vous demander quelque chose qui va vous étonner... Monsieur Montillac, épargnez M. Gélidon... ne lui faites pas trop de mal.
GÉLIDON.
Ah ! mademoiselle, que vous êtes bonne !...
MADELEINE.
Monsieur Montillac, vous ne m’en voulez pas de vous demander d’épargner votre adversaire ?
GÉLIDON.
Je suis heureux que vous aimiez Montillac et je suis content que vous ne détestiez pas Gélidon.
MADELEINE.
Au revoir. Aussitôt qu’il y aura du nouveau, le jardinier viendra me prévenir.
Elle sort, au fond, à gauche.
LARNOIS, revenant du fond à droite.
Voici Béjun... Qu’est-ce que tu vas faire ?
GÉLIDON.
Il n’y a qu’à calter !
Il se dirige vers la gauche.
FLACHE, paraissant à sa fenêtre.
Quel raffut ! Impossible de fermer l’œil !
LARNOIS.
Mais non, les autres sont par là !
GÉLIDON.
Alors entrons là dedans !
Ils entrent dans le bâtiment de droite.
FLACHE, apercevant Gélidon.
Tiens ! Eh bien ! il est retrouvé, leur Gélidon. Il n’était pas perdu. Ils étaient tous à se lamenter cette nuit parce qu’ils ne savaient pas où il était.
Il referme la fenêtre. Entrent du fond, à droite, Béjun et Moreau, vieillard de soixante-dix ans. Tous deux sont en redingote et chapeau haut de forme. Béjun tient à la main deux épées dans une housse.
Scène VII
MOREAU, BÉJUN
BÉJUN.
Donnez-vous donc la peine de venir par ici, monsieur Moreau. Vous n’êtes pas trop fatigué ?
MOREAU.
Oh ! j’ai encore de bonnes jambes !... Il faudrait tout de même mettre la main sur notre client.
Il s’assied sur le banc.
BÉJUN.
Évidemment. Où a-t-il pu passer, cet animal-là ?
MOREAU.
C’est très grave, Béjun, pour notre organe, pour notre parti, c’est très grave. Je sais bien qu’en pareil cas, le combattant défaillant peut être remplacé par un des témoins... vous, par exemple...
BÉJUN.
Oh ! non, il faut écarter cette supposition.
MOREAU.
Et puis l’effet moral serait déplorable, même si vous remplaciez Gélidon.
BÉJUN.
Il n’en est pas question. Pour moi, il n’y a qu’un parti à prendre : aller trouver ces messieurs et leur raconter la chose.
MOREAU.
Ils vont carencer notre client.
BÉJUN.
Qu’est-ce qu’ils vont faire ?
MOREAU.
Ils vont le carencer, signer contre lui un procès-verbal de carence, qui lui interdira de se battre à l’avenir.
BÉJUN.
Bonne affaire !
MOREAU.
Vous avez un point de vue spécial !
BÉJUN.
Alors, on ne peut plus se battre une fois qu’on est... Comment que vous dites ?...
MOREAU.
Carence.
BÉJUN, avec complaisance.
Carence ! Carence !
MOREAU.
Ce n’est pas le commandant qui vient là-bas ?
BÉJUN.
C’est lui-même, avec ce petit fourneau de La Chevillette. Eh bien ! vous allez l’entendre, le commandant !... Ah ! il n’y a pas d’erreur, il va nous traiter comme du pain pourri !
MOREAU.
Ah ! ces situations sont insupportables !...
Entrent le commandant et la Chevillette.
Scène VIII
BÉJUN, MOREAU, LE COMMANDANT, LA CHEVILLETTE
Salutations. Béjun et Moreau saluent très bas. Le commandant soulève à peine son chapeau.
LE COMMANDANT.
Eh bien, messieurs, vous êtes plutôt en avance !
BÉJUN.
Commandant, c’est parce que... il y a du nouveau.
LE COMMANDANT.
Ah ! Quoi donc ?
BÉJUN, intimidé.
Eh bien !...
Il fait passer Moreau devant lui pour l’explication.
MOREAU.
Commandant, nous sommes un peu ennuyés ? Figurez-vous que notre client devait être à l’imprimerie ce matin à six heures ; nous l’avons attendu jusqu’à six heures et demie... nous pensions le retrouver ici...
LE COMMANDANT.
Et il n’y est pas ? Et il n’y est pas !... Eh bien, messieurs, il n’y a qu’une chose à faire : nous allons attendre encore un quart d’heure et, au bout d’un quart d’heure, nous serons obligés de signer un procès-verbal où nous constaterons qu’il a fait défaut.
BÉJUN.
Carence !
LE COMMANDANT.
Oui, nous allons le carencer... Citoyen Béjun, ça n’a pas l’air de vous émouvoir... Vous appartenez à un parti pour qui ces choses-là n’ont aucune importance...
LA CHEVILLETTE, bas.
Modérez-vous, commandant !
LE COMMANDANT.
Vous avez raison, pas d’incorrections ! Mais que voulez-vous ! Je suis tellement révolté de ces façons d’agir de ces gens qui insultent et qui disparaissent après...
À Béjun.
Ce sont des habitudes de mufles...
BÉJUN, à Moreau.
Comme du pain pourri, je vous le disais...
LE COMMANDANT, à Moreau.
Tout ce que j’ai dit, bien entendu, n’atteint pas vos cheveux blancs. Je respecte les cheveux blancs, à quelque parti qu’ils appartiennent.
BÉJUN, se découvrant.
J’en ai quelques-uns.
Bas, à Moreau.
Jamais je ne serai l’ami de cet homme-là !
LE COMMANDANT.
Nous allons préparer, mon co-témoin et moi, le procès-verbal de carence, que nous vous montrerons tout à l’heure.
LA CHEVILLETTE.
Nous trouverons tout ce qu’il vous faut pour écrire dans le petit chalet du garde-chasse.
LE COMMANDANT.
À tout de suite, messieurs.
En remontant, à La Chevillette.
C’est une affaire magnifique pour notre parti.
LA CHEVILLETTE.
Épatante !
Ils sortent au fond, à gauche.
MOREAU.
Vous direz ce que vous voudrez, Béjun, c’est déplorable. Nous sommes tous atteints. Et votre élection est fichue.
BÉJUN.
Eh bien, vous voyez, moi, je me fais une raison.
Flache paraît à la fenêtre.
Scène IX
BÉJUN, MOREAU, FLACHE à la fenêtre, puis GÉLIDON et LARNOIS
FLACHE.
Décidément, il n’y a pas moyen !
BÉJUN.
Tiens ! voilà l’ex-citoyen Flache !
FLACHE.
Ah ! vous voilà, monsieur l’imprimeur ! Eh bien, l’avez-vous retrouvé, votre client ?
BÉJUN.
Carence !
FLACHE.
Qu’est-ce que vous dites ?
MOREAU.
Il n’est pas là, et les témoins de M. Montillac sont en train de préparer contre M. Gélidon un procès-verbal de carence.
FLACHE.
Comment ! Comment ! Mais il est là, votre Gélidon !
Béjun pose les épées à gauche.
MOREAU.
Il est là ?
FLACHE.
Mais il vient d’entrer, il y a un instant, dans ce petit bâtiment.
Moreau va à la porte du bâtiment et l’ouvre. Paraît Gélidon.
MOREAU.
Il est là !
GÉLIDON, sortant.
Bonjour !
BÉJUN, d’un air réjoui.
Enfin, il est là ! Le voilà !
Flache referme sa fenêtre, en haussant les épaules.
MOREAU.
Qu’est-ce que vous faisiez là dedans ?
GÉLIDON.
Eh bien... je... je vous attendais.
MOREAU.
Nous avions déjà prévenu nos adversaires que vous étiez absent. GÉLIDON.
Absent, moi ! Ah ! fichtre non ! Je n’étais pas absent !
MOREAU, à Béjun.
Allez les avertir, Béjun.
BÉJUN.
Oh ! ça ne presse pas.
Ils remontent. Gélidon va chercher Larnois dans le petit bâtiment de droite et l’attire vivement à l’avant-scène.
GÉLIDON.
Tu as ton auto à la grille ?
LARNOIS.
Oui, à cent pas d’ici.
GÉLIDON.
Il n’y a qu’une ressource : tu vas filer à Valmoutiers. Préviens les autorités, le brigadier de gendarmerie... Amène-le avec toi. S’il se trouve sur le terrain, il n’y a plus de duel possible.
Larnois tire de sa poche ses lunettes d’automobile, qui se terminent par un protège-joues.
Tu mets tes lunettes pour aller là ?
LARNOIS.
Oui, oui, j’ai la peau très sensible.
BÉJUN.
Voilà le commandant et La Chevillette !
GÉLIDON.
Oh !
Il prend le pardessus et les lunettes de Larnois et les met. Larnois se sépare vivement de Gélidon et remonte, puis sort à droite. L’opérateur du cinéma rentre par le fond.
Scène X
LE COMMANDANT, LA CHEVILLETTE, GÉLIDON, BÉJUN, MOREAU, L’OPÉRATEUR
L’OPÉRATEUR.
Je voudrais prendre maintenant les témoins de M. Gélidon.
BÉJUN.
Tout à l’heure.
LE COMMANDANT.
Voici le procès-verbal de carence.
BÉJUN.
Plus besoin, commandant : notre client est retrouvé.
Gélidon, tourné de trois quarts, s’incline.
LA CHEVILLETTE.
Ah ! le voilà ?
LE COMMANDANT.
Il arrive en auto ?
BÉJUN.
Non, il vient de mettre ses lunettes.
LE COMMANDANT.
Des lunettes ?... Eh bien, voulez-vous lui dire qu’il se prépare, que M. Montillac doit être en tenue.
Il gagne l’avant-scène de gauche, avec La Chevillette. Béjun et Moreau restent à droite, avec Gélidon.
BÉJUN, à Gélidon assis sur le banc.
Déshabillez-vous !
GÉLIDON, à Béjun, à demi-voix.
Non, je reste comme ça.
MOREAU.
Comment, vous restez comme ça ?
GÉLIDON.
Je veux combattre avec des lunettes.
BÉJUN, allant au commandant.
Il veut combattre avec des lunettes.
LE COMMANDANT.
Singulière prétention !
LA CHEVILLETTE.
Mais ça ne se fait jamais !
BÉJUN.
Ah !
Allant à Gélidon.
Il paraît que ça ne se fait pas !
GÉLIDON.
Moi, je veux combattre avec des lunettes !
MOREAU.
Mais pourquoi ?
GÉLIDON.
Pourquoi...
L’OPÉRATEUR, du fond.
Ces messieurs sont prêts ?
GÉLIDON, subitement.
À cause du cinéma !... Je trouve indécent, immoral, de combattre devant un cinéma...
BÉJUN.
Ah ?
Au commandant.
C’est rapport au cinéma. Il trouve indécent et... Je vous demande pardon.
Allant à Gélidon.
Comment avez-vous dit ça ?
GÉLIDON.
Indécent et immoral !
BÉJUN, revenant au commandant.
Il trouve indécent et...
Cherchant le mot.
et... pas comme il faut de combattre devant un cinéma...
LE COMMANDANT.
Mais c’est tout ce qu’il y a de plus simple : on va prier l’opérateur de s’en aller.
BÉJUN.
Oui, c’est ça.
Allant à Gélidon.
On va prier l’opérateur de s’en aller.
GÉLIDON, vivement.
Non, non, non, je ne veux pas qu’il s’en aille !... Je veux qu’il reste.
Embarrassé.
Moi, journaliste... je... je ne peux pas empêcher un cinéma de travailler... Non, je veux combattre avec des lunettes.
MOREAU.
D’ailleurs il n’y a qu’à soumettre le cas à M. Montillac.
GÉLIDON.
C’est ça, demandez à M. Montillac. Si M. Montillac ne veut pas, eh bien, je combattrai sans lunettes.
BÉJUN, retournant auprès du commandant.
Commandant, il demande qu’on soumette le cas à M. Montillac.
LE COMMANDANT, entre ses dents à La Chevillette.
Quels polichinelles que ces gens-là !... Enfin, je vais en parler à Montillac.
Il s’avance auprès du petit bâtiment de droite, appelant.
Monsieur Montillac !... Tiens, il n’est pas là !
Il ouvre la porte.
Personne ! Monsieur Montillac ! Tiens ! mais où est-il donc passé ?
À La Chevillette.
Regardez par là-bas si vous le voyez.
Gélidon est passé de droite à gauche.
LA CHEVILLETTE.
Je ne vois personne.
BÉJUN.
Hé ! hé !
LE COMMANDANT.
Qu’est-ce qu’il y a ?
BÉJUN.
Vous ne retrouvez plus votre client ?
Triomphalement.
Carence !
LE COMMANDANT.
Qu’est-ce que vous racontez ?
BÉJUN.
Comment, qu’est-ce que je raconte ? Mais je vous réponds bien que, s’il n’est pas là dans un quart d’heure, nous allons... Comment que vous dites ?
MOREAU.
Signer un procès-verbal de carence.
BÉJUN.
Nous allons lui dresser procès-verbal !... Où y a-t-il des plumes et du papier ? Ah ! oui, je sais, dans le petit pavillon là-bas... Monsieur Moreau, monsieur mon collègue-témoin, allons dresser procès-verbal !
L’OPÉRATEUR, au fond.
Peut-on prendre les témoins de M. Gélidon ?
BÉJUN.
Pour le cinéma ? Allez-y !
Il passe devant l’appareil en dansant, puis sort, suivi de Moreau.
LE COMMANDANT.
Quelle tenue !
L’OPÉRATEUR.
Pour le duel, je vais m’installer derrière la tour : la lumière est meilleure.
Il sort.
LA CHEVILLETTE.
Mais où est donc Montillac ?
LE COMMANDANT.
Nous allons le retrouver tout de suite, voyons.
LA CHEVILLETTE.
Je pense bien !
LE COMMANDANT.
Prenons chacun de notre côté ! et retrouvons-nous ici.
LA CHEVILLETTE.
C’est ça !
Ils sortent en appelant chacun Montillac. Le commandant à gauche, La Chevillette à droite.
Scène XI
GÉLIDON et LARNOIS, puis LE JARDINIER
LARNOIS, reparaissant à droite.
Eh bien, tu vois, tout s’arrange bien. Tout à l’heure, il paraît qu’ils carençaient Gélidon : maintenant, ils vont carencer Montillac.
GÉLIDON, soulevant ses lunettes.
Carencer Montillac ?
LARNOIS.
Eh bien, oui, forcément. Tu ne penses pas qu’ils vont le retrouver ?
GÉLIDON.
Mais, nom d’un chien ! il ne faut pas que Montillac soit carencé ! Gélidon, je veux bien : personne ne connaît Gélidon... Et puis, Gélidon, je m’en fiche ; mais je suis connu de presque tout le monde sous le nom de Montillac, surtout de Madeleine ! Elle ne me le pardonnerait jamais. Elle serait perdue pour moi ! Ah ! non ! Je ne veux pas que Montillac soit déshonoré.
LARNOIS.
Mais que veux-tu y faire ?
GÉLIDON.
Je me le demande.
LARNOIS.
Enfin, faut-il que j’aille chercher le brigadier de gendarmerie ?
GÉLIDON.
À quoi ça servirait-il, maintenant ? Ça n’empêcherait pas Montillac d’être carencé... Tu pourrais peut-être aller le chercher tout de même...
LARNOIS.
Donne-moi mes lunettes, alors...
GÉLIDON.
Oh ! non, je ne veux plus me montrer le visage découvert.
LARNOIS.
J’en ai une autre paire sur moi. J’en ai toujours deux paires en cas de besoin.
Il met les autres lunettes.
GÉLIDON, le regardant.
Attends ! Attends ! Mais oui, mais oui, il nous faut deux adversaires : Gélidon et Montillac. Eh bien, les voilà !
LARNOIS, soulevant ses lunettes.
Qu’est-ce que tu me racontes là ?
GÉLIDON.
Gélidon a demandé à se battre avec des lunettes... Montillac va accepter. Je garantis l’acceptation de Montillac. Je vais retourner là-bas, je vais dire au commandant : « Moi aussi, je veux me battre avec des lunettes. »
LARNOIS.
Très bien. Je vois que tu vas redevenir Montillac. Mais qui est-ce qui va remplacer Gélidon ?
GÉLIDON.
Mais toi, te dis-je !
LARNOIS.
Moi ?
GÉLIDON.
Mais oui, toi, sous des lunettes... et nous nous battrons. Je pense que tu n’auras pas peur ?
LARNOIS.
Mais comment ça finira-t-il ?
GÉLIDON.
Très simplement. Nous ferons une ou deux reprises à la flan et, à un moment donné, je te piquerai au bras.
LARNOIS.
Ah ! non !
GÉLIDON.
Eh bien, à la jambe, ça m’est égal !
LARNOIS.
Non, non !... Je consens, à la rigueur, à me battre, mais c’est moi qui te piquerai.
GÉLIDON.
Mais non, toi, tu es Gélidon ; il vaut mieux que le beau rôle reste à Montillac. Ça fera mieux, je t’assure.
LARNOIS.
Oh ! je me moque de ça !
GÉLIDON.
Tu n’aimes pas à rendre service !... Enfin, soit, je serai blessé.
LARNOIS.
Je te blesserai, bon !
GÉLIDON.
Ah ! non, pas toi.
LARNOIS, se tenant la tête.
Écoute, écoute, je ne te comprends plus... Tu vas me rendre malade.
GÉLIDON.
Il faut une piqûre légère, une piqûre qui mette fin au combat, mais qui ne nous oblige, ni l’un ni l’autre, à retirer nos lunettes... Avant d’arriver ici, je me donnerai un petit coup sur une piqûre de moustique que j’ai à l’avant-bras, et, à un moment donné, je crierai : « Touché ! » Je crierai tout de suite, au bout de quelques secondes...
LARNOIS.
Ah ! tu es embêtant avec tes combinaisons !
GÉLIDON.
Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?
LARNOIS.
Promets-moi, en tout cas, de te tenir loin de moi, afin que je ne rencontre pas, par hasard, la pointe de ta lame ; car tu es parfaitement capable de me toucher, sans le faire exprès... Beaucoup plus capable, d’ailleurs, qu’en le faisant exprès.
GÉLIDON.
Sois tranquille, je resterai loin, car je ne tiens pas, moi non plus, à rencontrer ton épée... Entre dans ce petit bâtiment... te mettre en tenue de duelliste... Tiens ! reprends ton pardessus. Et, surtout, ne parle pas, ou parle le moins possible. Non, ne parle pas. Moi, je vais me mettre à l’abri là-dedans !
Larnois entre dans le bâtiment de gauche.
GÉLIDON, au jardinier, qui passe.
Dites donc, si le commandant me demande, je suis là.
Il entre dans le petit bâtiment de droite.
LE JARDINIER.
Oui, monsieur Montillac.
Il s’éloigne. Entre Léontine, du fond à droite tandis qu’Amélie sort du pavillon.
Scène XII
LÉONTINE, AMÉLIE
LÉONTINE, apercevant Amélie.
Ah ! madame Flache ! madame Flache ! Quelle nuit j’ai passée !
AMÉLIE.
Vous avez tremblé pour M. Gélidon ?
LÉONTINE.
Hein ?... oui, pour M. Gélidon, c’est entendu ça ; mais je n’étais pas inquiète. M. Gélidon m’avait fait dire hier soir qu’il ne pouvait pas me voir, qu’il passait la nuit dans un monastère... Mais si vous saviez quelles pensées j’ai roulées dans ma tête... Je n’ai pas fermé l’œil...
AMÉLIE.
Voulez-vous vous reposer ici, dans le pavillon ? Notre chambre est au premier, mais nous avons au rez-de-chaussée un divan très confortable... et vous serez aussi bien que dans un lit.
LÉONTINE.
Merci, merci... Je ne dormirais pas et, si je dormais, je retrouverais mes cauchemars de cette nuit...
AMÉLIE.
Vous disiez ne pas avoir fermé l’œil.
LÉONTINE.
Je fermais l’œil de temps en temps pour faire des rêves affreux... si affreux que ça me réveillait chaque fois.
AMÉLIE.
Et qu’est-ce qui se passait ?
LÉONTINE, se cachant les yeux.
Un blessé qu’on emportait.
AMÉLIE.
M. Gélidon ?
LÉONTINE.
Je ne sais pas... Peut-être M. Montillac...
AMÉLIE.
Alors, tout va bien !
LÉONTINE.
Madame Flache !... je vais vous révéler quelque chose d’épouvantable... Il faut que j’aie une grande confiance en vous, car j’ai beaucoup de peine à faire des confidences... Écoutez ça, madame Flache... Une curiosité étrange m’attire vers ce M. Montillac... vers cet inconnu... Jadis, j’avais aimé M. Gélidon avant de le connaître... Je vous l’ai déjà dit...
AMÉLIE.
Pas à moi !
LÉONTINE.
À qui ai-je pu dire ça ?... J’avais aimé Lucien d’imagination, et maintenant il me semble qu’une sorte de passion perverse me pousse du côté de M. Montillac. C’est terrible ! Vous pensez bien que j’y résiste autant que je peux !
AMÉLIE.
Pourquoi ça ?
LÉONTINE.
Mais parce que c’est abominable d’avoir un sentiment pareil ! Comprenez bien, au moment où mon amant va se battre, de me sentir attirée vers son ennemi... Mais je suis une femme effrayante !
AMÉLIE, toujours placide.
Mais non, non. Vous aviez l’habitude de passer la nuit avec M. Gélidon... Cette nuit vous ne l’avez pas vu : ça vous a manqué. C’est ça qui vous fait travailler l’imagination.
LÉONTINE.
Peut-être... En tout cas, il faut que je voie M. Montillac, que je le supplie d’épargner M. Gélidon. Qu’est-ce que vous en pensez ?
AMÉLIE.
Je pense que vous tenez surtout à voir M. Montillac. Eh bien, vous avez peut-être raison. Une fois que vous l’aurez vu, ça vous calmera.
LÉONTINE.
Oui, oui, vous parlez juste. Il faut que je le voie !... pour me calmer.
Le jardinier repasse.
Scène XIII
LÉONTINE, AMÉLIE, LE JARDINIER, puis GÉLIDON
LÉONTINE, au jardinier.
Mon ami, vous connaissez M. Montillac ?
LE JARDINIER.
Très bien, madame.
LÉONTINE.
Vous ne l’avez pas aperçu ?
LE JARDINIER.
Si fait, madame. Je sais qu’il est par là, dans la petite cabane où c’est que je mets mes outils.
LÉONTINE, à Amélie.
Si je lui dis que c’est moi qui veux lui parler, il ne voudra peut-être pas, parce que je suis dans le camp de ses ennemis.
AMÉLIE.
Eh bien, ne dites pas votre nom.
LÉONTINE.
Non, non. En somme, j’ai promis hier à la demoiselle du château de tout faire pour que le duel ne soit pas grave... Je peux bien dire que je viens de sa part.
Au jardinier.
Dites à M. Montillac qu’on le demande de la part de Mlle Madeleine... que c’est très pressé.
LE JARDINIER.
On y va.
Il frappe à la porte du hangar.
GÉLIDON, du dehors.
Qu’est-ce que c’est ?
LE JARDINIER.
Monsieur Montillac ! On vous demande. C’est de la part de Mlle Madeleine. C’est très pressé.
Amélie s’éloigne.
GÉLIDON, ouvrant la porte.
Mlle Madeleine ? J’y vais.
Il met dans sa poche les lunettes qu’il avait à la main. Le jardinier sort par le fond.
Léontine !
LÉONTINE, aussi embarrassée.
Lucien !... Oui... Ce jardinier n’a pas bien compris... il s’est trompé... Je lui avais demandé...
GÉLIDON, s’étend sur cette explication.
Oui... Oui... il s’est trompé... il m’avait dit que c’était Mlle Madeleine... J’étais étonné... Je ne savais pas ce qu’elle me voulait... D’autant plus qu’il m’appelait Montillac... Il confondait... Il aura su que je le rencontrais en duel avec Monsieur Gélidon... je veux dire avec M. Montillac... Alors, il a cru que j’étais monsieur Gélidon... C’est pour cela qu’il m’appelait Montillac... au lieu de Gélidon...
LÉONTINE.
Je vois... Tu étais étonné que je demande M. Montillac...
GÉLIDON.
Non... Il m’avait dit que c’était Mlle Madeleine.
LÉONTINE.
C’est vrai.
GÉLIDON.
Autrement je ne serais pas venu... C’est-à-dire Montillac ne serait pas venu... Ou plutôt si, il serait venu, puisque c’était Mlle Madeleine...
LÉONTINE.
Mais oui, mais oui. Je n’avais aucune raison de demander M. Montillac.
GÉLIDON.
Ni moi de parler à cette jeune fille, que je ne connais pas.
LÉONTINE.
Ni moi de parler à ce monsieur que je n’ai jamais vu.
GÉLIDON.
Bien sûr. ...
LÉONTINE.
Bien sur
Silence.
GÉLIDON, d’un ton un peu forcé.
Je suis content de te voir, Léontine.
LÉONTINE, de même.
Et moi aussi, Lucien.
Avec élan.
Lucien, tu sais que je t’aime toujours, que je n’aime que toi !
Elle l’embrasse avec un parti pris fougueux.
GÉLIDON.
Mais oui, mais oui.
Il lance des regards inquiets autour de lui.
LÉONTINE, à part.
Oh ! je mens ! Je mens !
AMÉLIE, venant entre eux.
Je vais faire le guet, en cas que M. Béjun arrive.
GÉLIDON.
C’est ça, c’est ça, j’allais vous en prier.
Amélie remonte au fond à gauche.
LÉONTINE.
Lucien, j’ai quelque chose à te demander.
GÉLIDON, craignant toujours d’être surpris.
Voyons, parle.
LÉONTINE.
Écoute, j’ai fait un rêve épouvantable ! J’ai vu le duel. Un blessé qu’on emportait !
GÉLIDON.
Ça n’ira pas jusque là. Sois tranquille. Montillac ne me fera pas de mal... Montillac ne fera pas de mal à Gélidon. C’est Montillac qui sera touché.
À part.
Voyons, est-ce Montillac ?... Oui.
Haut.
C’est Montillac, je te le garantis... tu es contente ?
LÉONTINE.
Ah ! Mon Dieu ! mon Dieu ! Quelle chose affreuse que le duel ! Tu me dis que cet homme sera touché et il faut que je m’en réjouisse !... Écoute, Lucien !... Je vais te demander quelque chose qui va te surprendre... Tu vas me croire folle ; mais c’est une sensibilité de femme... Ne fais pas trop de mal à Montillac !
GÉLIDON, à part.
Ah ! Elle aussi !
Haut.
Je ne lui ferai pas de mal, je te le promets...
LÉONTINE.
Oui, mais, on ne sait pas... on ne sait jamais... les hasards du duel sont si grands !
AMÉLIE, revenant du fond.
Il vient du monde par ici. Mais ce n’est pas M. Béjun, ce n’est que le baron, avec le commandant et l’autre témoin.
GÉLIDON, affolé.
Tu ne peux pas rester. Va-t’en !
LÉONTINE.
Je veux te parler encore !
Elle jette des regards autour d’elle et aperçoit la vieille tour.
GÉLIDON.
Non, non ! Il faut que j’aille me battre !
LÉONTINE.
Cinq minutes.
Il résiste.
Cinq minutes, ou je fais un scandale ! Tiens, entrons là.
GÉLIDON.
Dans la tour ?
LÉONTINE.
Oui, dans la tour.
GÉLIDON.
Soit, mais pas plus de cinq minutes !
Sur le seuil de la porte.
Passe !
LÉONTINE.
Non, passe !
Elle le fait entrer.
Attends-moi, je reviens.
Elle pousse la porte et enferme Gélidon dans la tour au moyen du gros loquet de fer.
Comme ça, on gagnera toujours du temps !
AMÉLIE.
Quelle audace vous avez, madame, de l’enfermer là dedans.
LÉONTINE.
Ah ! madame Flache ! quel tourment ! Je suis une femme coupable... J’avais beau tromper Béjun, je ne savais pas ce que c’était que l’adultère... Je le sais, maintenant. Tout à l’heure, plus je parlais à Lucien, plus ma passion pour l’autre augmentait... C’est fini, c’est fini, je suis une femme perdue !
Le jardinier sort de la cabane.
LE JARDINIER.
Eh bien, vous l’avez vu, M. Montillac ?
LÉONTINE.
M. Montillac ?... Imbécile !
Elle entre avec Amélie dans le pavillon des Flache.
LE JARDINIER.
Eh bien, elle est polie, cette dame ! Il fait bon de lui faire ses commissions !
Il sort par la droite. Entrent La Chevillette, le baron, le commandant.
Scène XIV
LA CHEVILLETTE, LE BARON, LE COMMANDANT
LE COMMANDANT.
Alors, pas de Montillac ?
LA CHEVILLETTE.
Pas de Montillac !
LE BARON.
Et les autres sont en train de préparer le procès-verbal de carence !
LE COMMANDANT.
Ah ! non ! pas ça ! pas ça ! pas cette honte !... Moi, je me battrais bien à sa place, mais ça n’empêcherait pas la carence.
LE BARON.
Montillac est le porte-drapeau du parti, il ne faut pas qu’il soit dit qu’il a reculé. Tout le parti en serait atteint.
LA CHEVILLETTE.
Ah ! ça oui ; mais que voulez-vous ?
LE COMMANDANT.
Rappelez-vous seulement la joie que nous avons pu avoir tout à l’heure quand nous avons eu l’occasion de carencer Gélidon. Il faut empêcher ça, il faut empêcher ça !
LE BARON.
Je ne vois qu’un moyen.
LE COMMANDANT.
Dites ! Dites !
LE BARON.
Il est un peu... comment dire... un peu risqué.
LE COMMANDANT.
Ça ne fait rien, nous n’avons pas le choix.
LE BARON, baissant la voix.
Eh bien, il faut que l’un de nous se fasse passer pour Montillac.
LE COMMANDANT.
Hum !
LA CHEVILLETTE.
Mais ils le connaissent !
LE BARON.
Mais non, ils ne le connaissent pas. Du reste, avec une paire de limettes sur la figure...
LE COMMANDANT.
Oh ! c’est une combinaison un peu louche, ça.
LE BARON.
Pourquoi ? Gélidon en met bien, à cause du cinéma. Et puis, qu’est-ce que vous voulez ? Il faut absolument en sortir.
LE COMMANDANT.
Vous avez raison !... Moi je marcherais avec plaisir, mais je suis beaucoup trop grand et beaucoup trop fort. Même s’ils n’ont fait qu’apercevoir Montillac, ils ne reconnaîtront plus sa carrure.
LA CHEVILLETTE.
Et puis, vous êtes témoin, vous. On ne peut pas être à la fois témoin et combattant.
LE COMMANDANT.
Pourquoi ça ? Il n’y a qu’à remplacer un témoin.
LE BARON.
Oui, oui, ça ne souffre pas de difficultés.
LE COMMANDANT.
Saint-Amour ne peut pas passer pour Montillac...
Le Baron et le commandant regardent La Chevillette.
LA CHEVILLETTE.
Non, décidément, ça ne s’arrange pas. Il vaut mieux y renoncer.
LE BARON.
Il y aurait La Chevillette.
LA CHEVILLETTE.
Je suis beaucoup plus petit que lui.
LE COMMANDANT.
Pas sensiblement.
LA CHEVILLETTE.
J’ai au moins cinq centimètres de moins.
LE COMMANDANT.
Je vous assure que ça ne se voit pas.
LE BARON.
Ça ne se voit pas du tout. Oh ! avec des lunettes, on s’y méprendrait. Eh bien, la voilà, la combinaison !
Faisant passer La Chevillette au milieu.
La Chevillette, il faut que vous marchiez.
LA CHEVILLETTE.
Mais... je ne demande pas mieux... Je croyais seulement que, comme témoin...
LE COMMANDANT.
Saint-Amour sera témoin à votre place.
LA CHEVILLETTE, d’une voix étranglée qu’il veut rendre dégagée.
Vous croyez, vraiment, que ça se fait ?
LE COMMANDANT.
Il ne s’agit pas de savoir ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, il faut sauver la situation.
LE BARON.
Je cours jusqu’à la remise. Je vais prendre toutes les lunettes qui sont dans la voiture.
Il sort au fond à gauche.
LE COMMANDANT, à La Chevillette.
Vous paraissez un peu nerveux.
LA CHEVILLETTE.
Non, non, pas du tout... Je suis plutôt calme... J’aimerais mieux avoir plus de colère, mais, n’est-ce pas ? je n’ai pas été offensé personnellement.
LE COMMANDANT.
Oh ! je vous envie. Je serais content de marcher à votre place ; mais vous ne me la céderiez pas.
LA CHEVILLETTE.
Non... non...
LE COMMANDANT.
Mon enfant, vous avez été un peu pris au dépourvu, dans cette histoire, et vous n’avez pas eu le temps de prendre vos dispositions... Avez-vous quelque mission à me confier... au cas improbable où il vous arriverait quelque chose ?
LA CHEVILLETTE.
Je ne sais pas... je n’y songeais pas il y a un quart d’heure... alors... je n’ai pas présent à l’esprit tout ce qu’il faudrait que l’on fasse... en cas d’accident...
LE COMMANDANT.
Votre fortune ? Avez-vous des héritiers naturels ?
LA CHEVILLETTE.
J’ai des neveux.
LE COMMANDANT.
Bien, bien. Vous n’avez pas une personne que vous voudriez avantager ?
LA CHEVILLETTE.
Je ne vois pas, je ne vois pas...
LE COMMANDANT.
Mon enfant, il y a longtemps que vous n’avez pas fait d’armes ?
LA CHEVILLETTE.
Il y a pas mal de temps.
LE COMMANDANT.
Il faut que je vous dise un peu ce qu’il faut faire.
LA CHEVILLETTE.
Laisser venir, le bras tendu ?
LE COMMANDANT.
Non ! non ! Il s’agit surtout de donner l’impression que vous êtes Montillac. Or, Montillac a la réputation d’être impétueux. Alors, il faudra combattre très impétueusement.
LA CHEVILLETTE.
Ah !
LE COMMANDANT.
Parce que vous savez, pour le résultat moral, il importe que ce soit l’autre qui soit blessé.
LA CHEVILLETTE.
Oui, je ne demande pas mieux.
LE COMMANDANT.
Pourtant, ce n’est pas indispensable et si vous faites preuve de courage, de témérité même, ce sera assez bien aussi d’attraper une glorieuse blessure. Ah ! vous avez une belle mission !
Il l’embrasse.
LE BARON, revenant avec plusieurs paires de lunettes.
Tenez, voilà tout ce que j’ai trouvé... Mettez ça vite, vite. Dites donc, il faut annoncer aux autres que nous avons Montillac et que je remplace La Chevillette comme témoin.
La Chevillette met les lunettes.
LE COMMANDANT.
Nous allons leur dire !... Nous allons leur dire... Nous leur dirons que La Chevillette est indisposé. Ah ! c’est embêtant de mentir !
LA CHEVILLETTE.
Vous ne mentez pas complètement. Le docteur ne vient pas ?
LE COMMANDANT.
Vous êtes impatient ?
LA CHEVILLETTE.
Ce n’est pas ça... Mais j’ai un peu mal à l’estomac.
LE COMMANDANT.
Ça passera dans la chaleur du combat. Du reste, je vais aller au-devant du docteur pendant que le baron ira prévenir les témoins que Montillac est retrouvé.
LE BARON.
Je m’en charge.
Il sort à gauche au fond. La Chevillette s’assied sur le banc.
LE COMMANDANT.
J’aime autant que ce soit vous que moi.
À La Chevillette.
À tout à l’heure, La Chev...
Il se reprend en apercevant Léontine.
Montillac ! À tout à l’heure, mon cher Montillac !
Il sort par le fond à gauche.
Scène XV
LÉONTINE, AMÉLIE, LA CHEVILLETTE
LÉONTINE, qui vient de sortir du pavillon avec Amélie.
Montillac !... Ah ! madame Flache, voilà Montillac ! Je vais lui parler, madame Flache, laissez-moi seule avec lui.
AMÉLIE.
Je vais retrouver M. Flache.
LÉONTINE.
C’est ça.
Amélie rentre dans le pavillon.
LÉONTINE, s’approchant de La Chevillette.
Monsieur Montillac !
LA CHEVILLETTE, assis, après un moment d’hésitation.
C’est moi, madame.
LÉONTINE, s’arrête, oppressée.
Monsieur, vous allez juger ma démarche bien extraordinaire... je suis madame Béjun...
Elle essaie de dévisager La Chevillette, toujours masqué par ses lunettes.
Monsieur Montillac, je ne vous ai jamais vu, mais il y a quelques jours que j’entends parler de vous... Tout le monde autour de moi vous déteste et vous craint ; mais je sens que vous représentez pour eux quelque chose de considérable... Alors, n’est-ce pas ? malgré moi, j’ai pensé... j’ai beaucoup pensé à vous... et quand j’ai appris que j’allais vous voir, je me suis sentie émue, tout émue... Mais vous jugez de ma déception en apercevant ce masque impénétrable... Et puis, monsieur Montillac, vous ne me dites rien...
LA CHEVILLETTE.
Madame... je n’ai pas l’honneur de vous connaître... Et puis, vous parlez tout le temps...
LÉONTINE.
Monsieur Montillac, si vous saviez comme c’est gênant, comme c’est odieux de vous parler ainsi... sans voir votre visage... sans voir vos yeux... Il me semble que je parle à un mur... Vous ne pouvez pas retirer vos lunettes ?
LA CHEVILLETTE, timidement.
C’est défendu, à cause du cinéma. Nous devons combattre masqués...
LÉONTINE.
Mais, maintenant, vous ne combattez pas : retirez vos lunettes.
LA CHEVILLETTE, se levant.
Je n’en ai pas le droit, madame.
LÉONTINE.
Qu’est-ce qui vous le défend ?
LA CHEVILLETTE, traversant la scène.
Mes témoins.
LÉONTINE, le suivant.
Ils ne le sauront pas... C’est une prière singulière que je vous adresse, mais exaucez-la et retirez vos lunettes.
LA CHEVILLETTE, hésitant.
Eh bien, une question d’abord, madame ? Est-ce que vous connaissez monsieur La Chevillette ?
LÉONTINE.
Monsieur La Chevillette ? Non, monsieur. Je ne savais même pas qu’il existait.
LA CHEVILLETTE.
Il existe, madame, il existe... Je vais retirer mes lunettes.
LÉONTINE.
Ah ! merci ! Quelle émotion !
La Chevillette retire ses lunettes. Léontine le regarde et ne peut réprimer une grimace de désappointement.
Merci, merci bien... Vous pouvez les remettre...
Pendant que La Chevillette fait le geste de les remettre et les approche simplement de son visage, Léontine continuant, comme à elle-même.
La demoiselle du château vous trouve joli garçon.
LA CHEVILLETTE, surpris.
Moi ? Ah ! Que me dites-vous ?
LÉONTINE.
Elle me le disait hier : « Il est très joli garçon, M. Montillac. »
LA CHEVILLETTE.
Ah ! bon ! bon ! Ah ! c’est vrai !
LÉONTINE, changeant de ton.
Écoutez, monsieur Montillac, aimez-la bien... C’est une charmante jeune fille... Je vous souhaite de vivre très unis...
LA CHEVILLETTE.
Je vous remercie, madame... Vous n’avez plus besoin de me parler ?
LÉONTINE.
Non, monsieur, je vous remercie...
Tombant sur le banc.
Ah ! quel écroulement ! Quel écroulement !
LA CHEVILLETTE, qui était un peu remonté.
Plaît-il, madame ?
LÉONTINE.
Je ne puis vous expliquer... mon esprit s’était détaché de M. Gélidon pour se rattacher... à quelqu’un d’autre... Et me voici doublement désenchantée... Il me semble que je suis seule, seule... Monsieur Montillac, est-ce possible ? Vous êtes l’âme, le chef du parti du château ? On disait de vous que vous étiez un homme énergique...
LA CHEVILLETTE.
Heu ! énergique !...
LÉONTINE.
Mais, alors, qui est-ce qui dirige votre parti ? Ce n’est pas le baron ?
LA CHEVILLETTE.
C’est le commandant, madame.
LÉONTINE.
Le commandant ?
LA CHEVILLETTE.
Un tyran ! à qui tout le monde doit obéir... un homme terrible !
LÉONTINE.
Un homme terrible ? De quel âge ?
LA CHEVILLETTE.
Quarante-cinq ans.
LÉONTINE.
Et il est encore si terrible que ça ?
LA CHEVILLETTE.
Effrayant !
LÉONTINE.
Pas sentimental du tout ?
LA CHEVILLETTE.
Il l’a peut-être été, mais on ne lui connaît pas d’histoires... Il ne s’attendrit jamais, sauf quand il s’agit de conduire un de ses amis sur le terrain... C’est lui qui a organisé ce duel.
LÉONTINE.
Je vois, je vois... C’est un homme indomptable. Peut-être a-t-il eu dans son passé une aventure douloureuse. Il a refoulé ses sentiments au fond de lui-même. Il a juré que désormais il aurait un cœur de bronze.
LA CHEVILLETTE.
Je n’en sais rien. Tenez, le voilà qui vient par ici.
LÉONTINE.
Monsieur Montillac, pensez-vous que je puisse lui parler ?
LA CHEVILLETTE.
Pourquoi lui parler ?
LÉONTINE.
Eh bien, mais... C’est lui qui dirige le combat, n’est-ce pas ? Je pourrais lui demander de le diriger doucement, prudemment, pour qu’il n’y ait pas de résultats graves.
LA CHEVILLETTE.
L’idée n’est pas mauvaise, je vous prierai même d’insister sur ce point... Je vous demande pardon, madame ; je rentre là-dedans.
Il rentre dans le bâtiment de droite. Entre de gauche le commandant.
Scène XVI
LÉONTINE, LE COMMANDANT, puis L’OPÉRATEUR du cinéma
LÉONTINE.
Mon commandant ?
LE COMMANDANT.
Madame ?
LÉONTINE.
Mon commandant, j’ai une requête à vous adresser. Mais, d’abord, je dois me présenter : je suis la femme de M. Béjun.
LE COMMANDANT.
Ah ! tant pis ! tant pis ! madame. Mais, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ?
LÉONTINE.
D’autre part, M. Gélidon, qui va se battre, est un de mes amis...
LE COMMANDANT.
Je sais, madame, je sais. Mais toutes vos histoires ne me regardent pas.
LÉONTINE.
Commandant, vous devez tout de même comprendre que je suis très effrayée par ce duel...
LE COMMANDANT.
C’est possible, madame, mais pourquoi venez-vous m’en parler, à moi, qui suis le témoin de M. Montillac... Est-ce que vous trouvez ça régulier !
LÉONTINE.
Mon commandant, dans ces cas-là, quand on est affolée comme je suis, on ne se demande pas si c’est régulier ou si ça ne l’est pas.
LE COMMANDANT.
Mais moi, madame, qui suis moins affolé que vous, je vois tout de même ce qui se fait et ce qui ne se fait pas.
LÉONTINE.
Enfin, commandant, vous n’allez pas refuser à une pauvre femme de l’écouter.
LE COMMANDANT.
Madame, vous êtes une femme, c’est entendu... Vous êtes même une femme plutôt agréable à voir... je vous le dis franchement. Je n’ai pas l’habitude de faire des compliments... mais je vous le dis... Tout ça n’est pas une raison pour que je n’écoute pas mon devoir, pour vous écouter...
LÉONTINE.
Mais, commandant, vous pourriez tout de même avoir égard à ma situation.
LE COMMANDANT.
Mais je vous répète, madame, que votre situation ne me regarde pas. Vous avez un bon ami, que vous aimez...
LÉONTINE.
C’est-à-dire que j’ai pour lui beaucoup d’affection, de l’affection plutôt que de l’amour...
LE COMMANDANT.
Vous avez tort. Du moment que c’est votre bon ami, il faut avoir de l’amour pour lui ; autrement vous n’avez pas d’excuse...
LÉONTINE.
Oh ! commandant, est-ce qu’on est maître de ses sentiments. Moi, ce qui m’attire dans la vie, et ce qui m’attire infailliblement, c’est l’énergie, c’est la force... Mon rêve eût été d’avoir un ami vigoureux, presque violent, tout d’une pièce, brutal même, un homme martial, enfin !
LE COMMANDANT.
Ça ne prend pas, madame. Je vous voir venir. Vous me faites mon portrait, à seule fin de m’amadouer.
LÉONTINE, s’emportant.
Oh ! mon Commandant, vous êtes insupportable ! Écoutez, maintenant je ne parle plus de rien, je ne vous demande plus de grâce pour personne... Mais je n’admets pas que, lorsque je viens vous dire quelque chose de vrai, de sincère, vous ayez l’air de ne pas me croire. Vous m’ennuyez, à la fin ! avec vos airs d’avalé tout cru ! Pourquoi m’insultez-vous en me disant que je veux vous amadouer !... C’est odieux de vouloir me prêter des sentiments pareils !...
Sanglotant.
C’est odieux !
LE COMMANDANT.
Eh bien, moi, madame, je vous prie de me laisser tranquille avec vos larmes. Qu’est-ce que c’est que ces manières de venir pleurer comme ça auprès d’un homme qui ne vous a rien dit, ni rien fait ? Est-ce que j’ai été vous chercher, moi ? Pourquoi me reprochez-vous de vous insulter ? Et puis, faites-moi le plaisir de ne plus pleurer !
LÉONTINE.
Je pleurerai si je veux. Vous n’avez pas le droit de me commander.
Elle le saisit par la manche.
LE COMMANDANT.
Madame, voulez-vous me lâcher le bras, maintenant ? Je ne veux pas vous brutaliser et vous en profitez !... Voulez-vous me lâcher ?
LÉONTINE.
Non ! Vous êtes trop brutal !
Elle passe son bras sous le sien.
LE COMMANDANT.
Voulez-vous me faire le plaisir de me lâcher ?
LÉONTINE.
Non ! Vous êtes trop sec, trop insensible !
LE COMMANDANT.
Voulez-vous me lâcher, petite vilaine !
LÉONTINE, pleurant.
Oh ! Voilà qu’il m’appelle petite vilaine !
Elle met la tête sur son épaule.
LE COMMANDANT.
Petite... gentille !...
D’une voix douce.
Mais lâchez-moi... Et puis, je ne sais pas ce que vous vous fourrez dans les cheveux... Lâchez-moi... Je ne voulais pas vous brutaliser ; mais je vais y être forcé...
LÉONTINE.
Embrasse-moi !
LE COMMANDANT.
Jamais de la vie, par exemple !
LÉONTINE.
Embrassez-moi une fois et je m’en irai !
LE COMMANDANT.
Eh bien, une seule fois.
Il l’embrasse longuement dans le cou.
LÉONTINE.
Ah ! j’ai les jambes brisées... Asseyons-nous sur ce banc.
Elle l’entraîne vers le banc.
LE COMMANDANT, la suivant.
Ah ! Jamais de la vie, par exemple !
Long baiser.
L’OPÉRATEUR, sortant du taillis fond à droite.
Vous n’êtes plus dans le champ !
LE COMMANDANT.
Tonnerre de nom d’un chien !
L’OPÉRATEUR.
Le baiser y était bien. Mais pourquoi sortez-vous ?
LÉONTINE, au commandant.
Venez par là !
Elle l’entraîne du côté de la maison de Flache.
LE COMMANDANT.
Mais non ! Mais non !
LÉONTINE.
Mais si ! Mais si !
Ils entrent dans la maison.
L’OPÉRATEUR.
Oh ! quel dommage ! Quel dommage !
Il s’éloigne au fond à droite. La Chevillette sort du petit bâtiment de droite. Un moment après Larnois sort de celui de gauche. Ils sont en tenue de combat, avec des lunettes.
Scène XVII
LARNOIS, LA CHEVILLETTE
LA CHEVILLETTE.
Mais ce docteur ne vient donc pas !
LARNOIS, de loin, à La Chevillette, qu’il prend pour Gélidon.
Lucien !...
La Chevillette recule, effrayé.
Pstt !... Tu n’as pas froid ?
LA CHEVILLETTE, à part.
Il me tutoie ! Ces gens d’extrême gauche !
LARNOIS, à demi-voix.
Tu entends ce que je te dis ! Tu n’as pas froid ?
LA CHEVILLETTE, après une hésitation, à demi-voix.
Non, je te remercie.
LARNOIS.
Dis donc, mon vieux, ne te trompe pas de bras.
LA CHEVILLETTE, à part.
Qu’est-ce qu’il dit ?
LARNOIS.
Parce que si tu montres une écorchure au bras gauche on se demandera comment j’ai pu te toucher. Et puis, ce qui est essentiel, c’est que tu sois blessé au bout de dix secondes.
LA CHEVILLETTE, à part.
Qu’est-cc qu’il raconte ?
Timidement.
Mais j’espère bien que ce n’est pas moi qui serai blessé...
LARNOIS.
Qu’est-ce que tu dis ?
LA CHEVILLETTE, s’enhardissant.
Je ne t’en veux pas, je ne chercherai pas à te faire du mal, mais je me défendrai...
LARNOIS, qui entend mal.
Qu’est-ce que tu dis ?
LA CHEVILLETTE, élevant la voix, avec énervement.
Et puis, ne nous parlons pas comme ça, ce n’est pas régulier.
LARNOIS, atterré.
Ce n’est pas la voix de Gélidon !
LA CHEVILLETTE.
Je me battrai, puisqu’il faut que je me batte... Je me battrai avec impétuosité... Il arrivera ce qu’il arrivera !
LARNOIS.
Eh bien, merci !
Le Baron et Béjun viennent du fond à gauche ; l’opérateur, du côté opposé.
Scène XVIII
LARNOIS, LA CHEVILLETTE, L’OPÉRATEUR, LE BARON, BÉJUN, puis LE DOCTEUR et MOREAU
L’OPÉRATEUR.
Ah ! voici ces messieurs, j’aperçois le docteur là-bas au bout de l’allée... le duel va pouvoir commencer. Monsieur le baron, ce sera un film intéressant ! Il n’y a pas beaucoup de combat jusqu’à présent, mais les à-côtés sont curieux.
À Béjun.
J’ai un baiser, vous m’en direz des nouvelles !
Au docteur, qui arrive du fond, à gauche, avec Moreau.
Monsieur le docteur, aussitôt qu’un de ces messieurs sera touché, je vous demande de ne pas le masquer en lui faisant son pansement et surtout de ne pas masquer la blessure avec vos mains.
LE DOCTEUR.
Mais il est impossible de faire un pansement dans des conditions pareilles !
L’OPÉRATEUR.
Mais si, très bien, très bien. Vos confrères ne travaillent pas autrement : ils font des pansements bien plus soignés quand ils sont devant le cinéma.
MOREAU, à Larnois, qui a toujours ses lunettes d’automobile.
Ça va, monsieur Gélidon ?
Larnois, effondré, ne répond pas. À Béjun.
Il n’est pas très bavard.
BÉJUN.
Je crois qu’il a la venette !...
À Larnois.
Moi, je m’avancerais comme ça...
Il fait mine de donner de grands coups d’épée en tous sens.
C’est très bon.
Larnois fait de violents signes de dénégation.
Enfin, vous ferez à votre idée.
L’OPÉRATEUR.
Ce serait le moment de prendre le groupe. Je ne vous demande pas de vous masser comme une société chorale, mais ne vous séparez pas trop.
LE BARON.
Si ces messieurs veulent bien...
L’OPÉRATEUR.
Mais il manque un témoin !
BÉJUN.
Ah ! oui, le commandant.
MOREAU.
C’est un peu étonnant tout de même qu’on n’arrive pas à réunir tout son monde. Où est le commandant ?
BÉJUN.
Carence !
MOREAU.
Non, il n’y a pas lieu à carence ; c’est un témoin. Mais il faudrait lui faire des observations.
BÉJUN.
Allez-y, vous !
MOREAU.
Vous êtes le premier témoin.
BÉJUN.
Vous n’êtes pas fou ! Que j’aille faire des reproches à un homme pareil ! Trop heureux encore s’il ne m’engueule pas !
LE BARON.
C’est tout de même curieux ! Où est-il passé ?
Criant.
Commandant !
Il remonte.
MOREAU, remontant.
Commandant !
BÉJUN, d’une toute petite voix.
Commandant !
Flache paraît à sa fenêtre.
Scène XIX
LES MÊMES, FLACHE, à sa fenêtre, puis LE COMMANDANT
FLACHE, désignant la porte de sa maison.
Le voilà qui vient.
Sardoniquement.
Vous allez le voir, citoyen Béjun...
BÉJUN.
Oh ! je ne suis pas pressé.
FLACHE.
Le voilà qui ouvre la porte.
Entre le commandant, très rouge, les cheveux en désordre. Il descend jusqu’à l’avant-scène en marchant à petits pas, les yeux baissés.
LE COMMANDANT, d’une voix douce.
Je vous fais toutes mes excuses, messieurs... Toutes mes excuses, baron, je suis désolé ! Monsieur Moreau, je suis désolé ! Monsieur Béjun...
BÉJUN, à part.
Moi, il va m’engueuler !
LE COMMANDANT, humblement.
Monsieur Béjun, je suis navré de vous avoir fait attendre... Une circonstance indépendante de ma volonté...
MOREAU, à Béjun.
Il est très gentil pour vous...
BÉJUN.
Je me méfie... Commandant, je ne vous fais aucun reproche...
LE COMMANDANT.
Vous pourriez m’en faire, vous seriez en droit de m’en faire, monsieur Béjun... Et je les accepterais... Pensez-vous que nous puissions commencer le combat ?
BÉJUN.
On n’attendait que vous, commandant.
Béjun donne une épée à Larnois, le baron une à La Chevillette.
LE COMMANDANT.
Vous m’en voyez confus...
S’adressant aux deux adversaires, qui sont poussés à l’avant-scène par leurs témoins respectifs et paraissent fort troublés.
Monsieur Gélidon, monsieur Montillac.
D’un ton pénétré.
Vous allez vous rencontrer en un combat loyal. Je suis sûr de votre bravoure ; je fais appel à votre calme. N’oubliez pas qu’il ne s’agit là que d’une discussion politique.
La Chevillette et Larnois manifestent une agitation croissante.
Ce serait très triste si un accident enlevait un jeune homme de votre âge à la vie... à la vie charmante... et parfumée... Docteur, avant que nous donnions le signal, veuillez aller chercher vos instruments.
LE DOCTEUR.
Ils sont là, dans la tour.
Il va à la tour, ouvre la porte. Gélidon sort, en tenue de combat, avec ses lunettes. Il prend l’épée que tenait Moreau et s’avance au milieu de la scène.
Scène XX
LES MÊMES, GÉLIDON
BÉJUN.
Un troisième combattant ?
LE BARON.
C’est Montillac, ça !
BÉJUN.
Tout à l’heure, il manquait du monde, voilà qu’on est trop maintenant !
MOREAU.
Qu’est-ce que c’est que celui-là ?
BÉJUN.
Carencé !
MOREAU.
Vous êtes stupide avec votre « carencé » !
BÉJUN.
C’est vous qui m’avez appris ce mot-là !
LE COMMANDANT, au baron.
Laissez-moi faire.
Haut, désignant La Chevillette.
Qu’est-ce que c’est messieurs ?
On les ramène.
LE COMMANDANT.
Un mauvais plaisant avait pris la place de M. Montillac. Nous en voilà débarrassés.
Bas, à La Chevillette.
Foutez le camp, vous !
Il le fait sortir à droite.
LARNOIS, à part.
Ah ! J’aime mieux ça !
Léontine sort de la maison.
Scène XXI
LES MÊMES, moins LA CHEVILLETTE, GÉLIDON, LÉONTINE
LÉONTINE.
Je mourais d’impatience, là-dedans.
LE COMMANDANT, allant à Léontine.
Oh ! Madame, vous ne pouvez pas rester là.
Galamment.
Je m’oppose absolument à ce qu’aussi jolis yeux soient offusqués par un tel spectacle...
LÉONTINE.
Je me retire.
Bas.
Mais rappelez-vous ce que vous m’avez promis, Edmond. Il faut demander à Montillac d’épargner Gélidon.
LE COMMANDANT.
Mais...
LÉONTINE.
Vous pouvez tout lui dire : il est laid mais il est discret.
LE COMMANDANT.
Soit !
Léontine rentre dans la maison.
LE COMMANDANT, prenant Gélidon par le bras.
Mon cher Montillac, d’homme à homme, rendez-moi service. J’ai promis à une jolie femme, à Mme Béjun, que vous épargneriez Gélidon.
GÉLIDON.
Vous avez promis ça à Mme Béjun ?
LE COMMANDANT.
Ah ! Montillac, c’est une femme adorable, et je suis le plus heureux des hommes !
GÉLIDON.
Qu’est-ce que vous me racontez là ?
LE COMMANDANT.
Je vous raconte le plus grand bonheur de ma vie !
GÉLIDON, avec éclat.
Eh bien, elle est forte celle-là ! Oh ! mais, alors, bas les masques !
Il retire ses lunettes.
Comment ! Je passe par des transes abominables, je fais des prodiges pour ménager Léont...
Il aperçoit Béjun tout près de lui, s’arrête et veut remettre ses lunettes.
BÉJUN, lui prenant le bras.
Tiens ! Gélidon ! On est trompé de client.
Il attire Gélidon et pousse Larnois vers le baron.
Voilà le vôtre !
LE BARON, repoussant Larnois.
Mais non ! Qu’est-ce que vous chantez ? Puisque voilà Montillac !
BÉJUN.
Ah ! La bonne blague ! Alors, où est-il, Gélidon ?
LE BARON, désignant Larnois.
Mais ici.
MOREAU.
Oh ! Assez plaisanté, messieurs !
Il enlève les lunettes de Larnois.
LE BARON et LE COMMANDANT.
Larnois !
LE BARON.
Quoi ! C’est vous, Larnois, qui écrivez sous le nom de Gélidon et qui nous attaquez ?
LANOIS.
Mais non !
GÉLIDON.
Mais non ! Mais non !
Léontine reparaît, attirée par le bruit.
Scène XXII
LES MÊMES, LÉONTINE puis MADELEINE et LA CHEVILLETTE, puis FLACHE et AMÉLIE
LÉONTINE, sur le seuil de la maison.
Qu’est-ce que ça veut dire ?
GÉLIDON.
Oh ! À vous, madame, je ne dirai rien ! Je ne vous connais plus !
MADELEINE, accourant du fond à gauche, suivie de La Chevillette.
Qu’est-ce qui se passe ?
LE BARON.
Gélidon n’existe pas. C’est Larnois !
MOREAU.
Non, c’est Montillac qui prétend être Gélidon !
FLACHE, à la fenêtre.
Non, c’est Gélidon qui se faisait passer pour Montillac... je connais bien Gélidon, moi !
LA CHEVILLETTE.
Avec ça que nous ne connaissons pas Montillac !
GÉLIDON.
Ah ! Nous n’en sortirons pas !
Il s’avance au milieu de la scène.
Je vais tout expliquer. Il n’y a pas de Gélidon !
LE BARON, LE COMMANDANT, LA CHEVILLETTE et MADELEINE.
Bravo !
GÉLIDON.
Il n’y a pas de Montillac !
BÉJUN et MOREAU.
Bravo !
GÉLIDON.
Il n’y a qu’un pauvre jeune homme qui a voulu faire plaisir à trop de monde à la fois.
Il regarde Léontine.
Non !
Il regarde Béjun.
Il a voulu pousser à la mairie un brave homme d’imprimeur...
Regardant le baron.
Et il a rencontré un gentilhomme dont il voulait contenter les ambitions... Seulement, je n’ai pas réussi... Que voulez-vous, je n’ai pas réussi : j’ai dérouté les uns... j’ai ahuri les autres...
Regardant Léontine, qui cause tendrement avec le commandant.
Voilà que mon passé me trahit...
Se tournant vers Madeleine.
L’avenir me sourit... Je n’ai pas dormi de la nuit... je ne sais plus exactement ce que je vais dire...
S’emparant des gants que La Chevillette s’apprêtait à mettre.
C’est pourquoi, monsieur le Baron, j’ai l’honneur de vous demander la main de votre fille...
LE BARON.
La main de ma fille ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Tous s’exclament. Amélie et Flache sont sortis de leur maison.
GÉLIDON.
Mais à qui ai-je fait du tort dans tout ça ? Ce n’est pas à vous, monsieur Béjun, à qui j’ai donné un journal que vous avez vendu très cher...
BÉJUN.
Je ne réclame pas !
GÉLIDON.
Et à vous, Baron ! Est-ce que je ne vous ai pas rendu service ?
LE BARON.
Que vous m’ayez rendu service, j’en conviens et je me reconnais votre débiteur ; mais la main de ma fille !...
MADELEINE.
Accorde-la-lui, papa, je ne veux rien devoir à cet homme-là.
LE BARON.
Soit !...Mais je renonce à la politique !
BÉJUN.
Moi aussi !
MOREAU.
Alors, plus de candidat ?
LÉONTINE.
Si, j’en ai un !
Elle désigne le commandant et l’attire au milieu de la scène.
LE COMMANDANT.
Mais je...
LÉONTINE.
J’y tiens... Edmond !
BÉJUN, au commandant.
Edmond ?... Eh bien, Edmond, nous allons commencer par douze mille affiches !