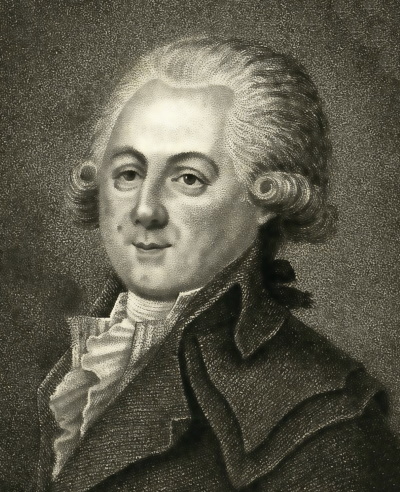La Maison de Molière (Louis-Sébastien MERCIER)
Comédie en cinq actes.
Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Odéon, le 20 octobre 1787.
Personnages
MOLIÈRE, auteur dramatique
CHAPELLE, ami de Molière
LA BÉJART, comédienne, demeurant dans la maison de Molière
ISABELLE, comédienne, fille de la Béjart
LATHORILLIÈRE, comédien et ami de Molière
PIRLON, ennemi de Molière
LE MARQUIS DE ***
LE COMTE DE ***
LA FOREST, servante de Molière
LESBIN, domestique de Molière
La Scène se passe à Paris, rue de Richelieu, chez Molière.
PRÉFACE
En lisant le Théâtre de Goldoni, j’ai pensé que la Pièce intitulée, Il Molière, passerait avec avantage sur notre Scène, parce que le sujet étant National et rappelant la mémoire d’un de nos Grands-Hommes, et peut-être le plus regrettable de tous, devait nous plaire et nous intéresser de préférence. L’on n’a donc point vu, sans quelque plaisir, le père de la Comédie Française, monter à son tour, sur ce même Théâtre[1], qu’il a rendu si illustre, et figurer parmi les personnages, enfants de son génie. Il a paru revivre sous de fidèles crayons, et d’ailleurs il à offert par ses mœurs, peintes au naturel, un tableau de la vie privée de l’homme-de-lettre. Ce point-de-vue n’est point à dédaigner ; il devient surtout très piquant, lorsqu’il s’agit d’un de ces Écrivains célèbres dont l’admiration publique aime à s’entretenir ; la curiosité alors devient inépuisable, tant sur les traits de leur caractère que sur les aventures particulières de leur vie
Comme la langue italienne est familière aux Littérateurs, ils apercevront d’un coup d’œil, ce que j’ai emprunté de la pièce originale, et ils pourront apprécier en même-temps les Scènes les Personnages, et surtout les détails que j’ai cru devoir y ajouter.
Molière est, parmi nous, le Poète qui a consulté davantage la Nature, et qui a mis sur notre Scène le plus d’expression et de vérité. Peintre fidèle et franc, il a caché l’art que les autres montrent trop ; chez lui on ne voit, on n’entend que les Personnages ; et le tableau ne paraît si vrai, que parce que la manière est ingénue. Aussi conserve-t-il parmi les Poètes Dramatiques, la physionomie que Lafontaine a parmi les Fabulistes ; et l’homme instruit, qui, vers sa quarantième année, le dégoûte ordinairement de la Tragédie française, qu’il aperçoit peuplée d’êtres factices, découvre une certaine profondeur dans les pièces de notre Poète ; il quitte volontiers le romanesque pour porter son attention sur des passions plus naturelles, et des caractères qu’il peut retrouver dans le monde. D’ailleurs la Tragédie nous accoutume à ne pleurer que sur les grands désastres, et ce n’est point-là un léger inconvénient.
Son chef-d’œuvre, sans contredit, est le Tartuffe, et dans cette Pièce à la fois hardie, morale et comique, il me paraît supérieur à lui-même.
Le Philosophe a sans doute plus d’un reproche à lui faire ; mais ce n’est pas ici le lieu d’examiner le but et la moralité de chacune de ses pièces et quelle influence utile ou dangereuse elles ont pu avoir tour-a-tour sur son siècle. Cet examen formerait un Ouvrage sérieux et peut-être neuf à bien des égards. L’Art de la Comédie consiste un peu trop à exercer notre âme à la moquerie, à la dérision de nos semblables.
Molière mérite notre hommage, pour avoir corrigé son siècle de plusieurs ridicules qui importunaient sans doute la société, encore plus que certains vices, puisqu’elle lui en a su tant de gré. Mais on ne peut se dissimuler en même-temps, que dans plusieurs endroits de ses ouvrages, il alarme la décence et les mœurs ; et toutes ses pièces, osons le dire, ne sont pas également irréprochables. Il a manqué à cet esprit observateur, à ce Peintre étonnant, de méditer plus profondément le but moral, qui donne un nouveau mérite à l’ouvrage même du génie, et qui, loin de rien dérober à la marche libre de l’Écrivain, lui imprime plus de véhémence et d’énergie, et lui commande ces impressions majestueuses et bienfaisantes qui agissent sur une Nation entière. Que n’eût-il point fait, de nos jours, environné d’idées plus faines ? Car l’Art dramatique, rassemblant et parlant à tout un peuple, est une espèce d’instruction publique qui est de la plus grande importance dans ses effets.
Il eût été à souhaiter, qu’à son exemple, on eût envisagé l’Art dans une imitation fidèle et précise de la Nature. Il la voyait, il la sentait, il la poursuivait ; et plein de la chaleur qu’elle inspire, il travaillait sur des caractères vivants et non sur des livres ; de-là la ressemblance frappante de ses personnages avec les hommes que nous connaissons, et cette variété qui prouve l’étude de toutes les situations. Il n’avait point ce dédain que des Écrivains si inférieurs à lui, ont osé affecter, lorsqu’ils ont méconnu le véritable attribut de leur art pour s’adonner à des touches raffinées et légères, à de petites formes élégantes et maniérées, à tout l’effort de l’esprit, qui éblouit et fatigue. Il savait que tout mouvement du cœur humain est intéressant à voir, précieux à saisir, aimable à fixer, et que sa peinture fera, toujours noble, si ce n’est devant le for orgueil de quelques particuliers, qui demain vont disparaître, du moins devant l’Humanité entière et l’œil des siècles futurs.
On a resserré depuis lui la Scène qu’il tendait visiblement à agrandir ; on n’a plus voulu y admettre que certains hommes choisis et distingués par leurs titres et leur naissance c’est-à dire, les seuls que le Poète était censé pouvoir fréquenter décemment. La vanité et l’insuffisance ont également trouvé leur compte à ce rétrécissement puéril. Le Poète s’est cru responsable, pour ainsi dire, de ses personnages ; il ne les a introduits qu’avec la plus grande réserve : mais dès ce moment il a celle de voir les objets les plus faits pour être représentés ; il a pris le vêtement pour l’homme ; il n’a point su mettre à profit ce qui devait parler si éloquemment à tous les yeux. Enfin, au nom de la bonne compagnie, on le vit subtiliser le trait large et vigoureux que Molière ‘avait rendu parlant. Comme ce trait était délicat et délié, il crut l’avoir rendu plus parfait ; mais il devint imperceptible, et de jolies miniatures, brillantes, pointillées et froides, remplacèrent le vaste tableau de la Nation, mine inépuisable qu’on désapprit à fouiller. Les Auteurs se concentrant dans un point unique, à raison de leur incapacité, s’admirant dans leur jargon étudié ; devinrent de jour en jour plus aveugles et oublièrent la multitude, qui, en revanche, ne les aperçut point.
Un goût exquis pour les petites choses, et, par-là même, étroit et pusillanime, amena donc des beautés conventionnelles, et fit disparaître ces touches hardies et fortes, qui peignent l’homme dans toutes ses attitudes. On voulut embellir, sous de faux agréments, ce qui avait tant de charme sous des traits un peu grossiers si l’on veut, mais nus et saillants ; et il se trouva à la fin que tous ces raffinements de société ne laissaient plus reconnaître l’empreinte de l’âme humaine.
Ainsi la Comédie, à qui le bon Molière avoir su donner une figure animée, un rire franc, un front populaire, dégénéra sous les habits brillants et dorés dont on l’affubla à tout propos. Les Marquis modernes, en expulsant les Bourgeois, chassèrent le naturel et la simplicité. Le jargon brillante succéda au langage naïf ; on eût dit que la Nation avait changé d’idiome et n’avoir plus de physionomie, parce qu’il ne se trouvait plus que des Peintres maniérés et des Écrivains fantasques. L’impuissance, toujours féconde en discours, mit tout en œuvre pour se justifier, et accusa solennellement le peuple de n’avoir plus rien de pittoresque ; et le peuple ignora le reproche et la justification. De-là naquirent ces copies rebattues qui vont encore en s’affaiblissant ; le trait original s’éloigna et disparut. Nos Pièces tracées d’après des êtres, que le Poète seul soutient avoir vu dans le monde, n’eurent aucun caractère de vérité, et se réduisirent au mérite du style ; à quelques dialogues élégants, à quelques traits d’esprit, pâles et mourantes étincelles ; mais ces personnages sans physionomie, créés de fantaisie frappés dans tout leur ensemble du vice héréditaire de leur origine, ne laissèrent point dans la mémoire de trace distincte. Que le luxe, père de cette vaine Comédie, vante après cela le poli de l’expression ; que me sont ces idées rétrécies et froides, images du cœur dont elles émanent ?
Ô Molière ! Molière, tu n’est plus ! et à mesure que les années s’accumulent sur ta cendre, ton génie s’enfonce plus avant dans la tombe ; la même Nature que tu peignis en sous nos yeux, et nous sommes allez dégénérés, pour la voir basse et ignoble, où tu l’apercevais vivante et riche ; c’est notre couleur qui est trompeuse et non la tienne. Au milieu de tant d’observations fines délicates et multipliées, et avec notre esprit tout en épigrammes et en saillies, nous ne savons plus mettre la figure en mouvement, et la placer dans le tableau. C’est que nous courons après l’enluminure, et que nous laissons-là la fierté du dessein.
Le talent est donc un instinct supérieur au raisonnement, et qui supplée à toutes les combinaisons des critiques. Les Auteurs s’épuisent en réflexions innombrables, et leur théorie transcendante, aboutit à de petites créations languissantes, semblables à ces pauvres enfants à demi ébauchés, qui portent, sur un front pâle, l’image d’un père efféminé. Molière possédait cet instinct qui crée sans disserter, et qui imprime la vie pour différentes générations. C’était peu, il savoir le reconnaître en autrui. Il devina le génie de La fontaine, alors presqu’universellement méconnu. Despréaux et Racine se croyaient de bonne foi, supérieurs à Lafontaine ; ils le jugeaient, ils le raillaient, ils allaient même jusqu’à une espèce de dédain ; ces deux Écrivains, si loin de la naïveté, ne sentirent pas son extrême mérite, Molière, génie original, sentit Lafontaine, et dit de La fontaine et d’eux, ils ont beau faire, ils n’effaceront pas le bonhomme. Jugement remarquable, et qui décèle un esprit clairvoyant, car une erreur générale fait illusion aussi aux hommes supérieurs. Où est l’Écrivain de nos jours qui sache apprécier un Auteur contemporain d’une manière aussi décidée et avec un tact aussi sûr ? On est plus souvent encore injuste par insensibilité, que par envie.
En 1661, Paris avait cinq Théâtres, et c’était le moyen de donner à l’Art tout son développement. Aussi, ce furent les beaux jours de la Scène française. Les circonstances ne créent point le génie, niais elles aident à son essor. Molière avait un théâtre à ses ordres ; il pouvait essayer ses ouvrages, en voir préalablement les effets et les corriger à plusieurs reprises. Il avait la protection du Monarque, dont le coup d’œil était fait pour l’enflammer. Il avait des amis illustres qui chérissaient son Art. Il était encouragé par ces applaudissements journaliers, qui soutiennent le Poète, et lui ordonnent de nouvelles compositions. Il ne se faisait imprimer qu’après avoir été joué vingt ou vingt-cinq fois ; et les Lecteurs favorablement disposés par le succès, en lisant les pièces, revoyaient le jeu des Acteurs. Il touchait le revenu légitime de ses honorables travaux, et cela montait à près de trente mille livres par an. Il n’avait pas à ses oreilles, le bourdonnement monotone et continu de ces insectes folliculaires qui troublent plus qu’ils ne nuisent, qu’on écrase et qui renaissent. Aujourd’hui, quiconque s’abandonne à cette carrière devenue plus difficile, espérerait vainement quelques-uns de ces avantages.
P. S. J’ai rendu à la mémoire de Montesquieu le même hommage qu’à celle de Molière ; la Pièce est intitulée : Montesquieu, à Marseille, son impression a précédé de deux années la représentation du Bienfait anonyme de M. Pilhes. J’avoue que je ne me suis pas vu sans peine prévenu par un Ouvrage inférieur au mien, et où l’on n’a dérobé plus d’une intention. Il m’en avait coûté de faire parler, Montesquieu, le langage de ce rare Penseur étant un des plus difficiles à saisir ; M. Pilhes ne s’y est nullement attaché.
ACTE I
Scène première
MOLIÈRE, seul, assis devant une table, la plume à la main
Combien la carrière de l’Homme-de-Lettres est encore rétrécie par les usages tyranniques, auxquels on veut l’assujettir ! On attend de lui de nouveaux Ouvrages, et on le subordonne à toutes les misères des sociétés ! On veut qu’il représente dans le monde, et qu’il compose au cabinet, c’est-à-dire, dire, que l’on exige tout-à-la-fois qu’il soit auteur et homme oisif, deux choses incompatibles... Quand je ne voudrais pas écrire, le genre humain m’y forcerait par ses extravagances... Il me faut rêver à mon Malade Imaginaire, à mon Envieux, à mon Homme de Cour... Oh ! je garde celui-ci pour le dernier... Si la mort ne me surprend point, on verra un miroir... Il est des choses que l’on pense quelquefois trop fortement pour pouvoir les écrire, et ce sont celles-là qui sont ordinairement perdues pour la postérité. J’oserais dire ce qu’on n’a pas encore dit. Il faut pour cela : du courage ! Oh ! j’en ai. Une voix secrète me dit que : je dois livrer la guerre aux vices. Toujours libre et maître de ma pensée... Le silence me favorise... Voici le vrai temps de la méditation. Revoyons mon plan, car c’est du plan surtout que dépend tout le reste... Ah ! j’allais oublier... j’ai trouvé, pour ma chère traduction, une image heureuse qui rend bien mieux...
Il cherche dans ses papiers.
Où donc est mon cahier ?... Il était-là... Je ne le trouve point.
Il appelle...
Lesbin, Lesbin, Lesbin !... Ce drôle-là est fait pour tourmenter ma vie... Lesbin, Lesbin, Lesbin !
Scène II
MOLIÈRE, LESBIN
LESBIN, accourant.
Monsieur...
MOLIÈRE, en colère.
Tu es entré dans mon cabinet ?
LESBIN.
Oui, Monsieur.
MOLIÈRE.
Eh quoi y faire, dis moi ?
LESBIN.
Eh ! pardi, Monsieur, ranger vos livres, vos papiers, qui sont-là jetés pêle-mêle.
MOLIÈRE.
Mes papiers !... Tu t’es donc avisé d’y toucher ?... Réponds-moi ?... Tu m’as pris un cahier comme celui-ci.
LESBIN, riant bêtement.
Ne voilà-t-il pas un grand mal ?... Si c’était du papier blanc, à la bonne heure, vous pourrez gronder comme vous faites : quoique nous ne sachions pas lire, nous apercevons bien ce que c’est qu’une belle écriture...
MOLIÈRE.
Eh bien ! pendard ! me diras-tu si tu as pris ?...
LESBIN.
Eh bien, oui, Monsieur, nous avons pris un papier comme celui-là, parce que nous l’avons trouvé par terre, sous votre bureau, et qu’il était partout griffonné...
MOLIÈRE.
Eh ! qu’en as-tu fait, malheureux !... Où est-il, où est-il ?...
LESBIN.
Ne vous mettez pas en colère : il n’est pas perdu ; nous l’avons bien employé...
MOLIÈRE.
Finiras-tu, bourreau, de me dire ce que tu en as fait ?... J’en suis dans un tremblement !...
LESBIN.
Comme vous êtes pâle, pour si peu de chose !... faire un train pareil à un pauvre domestique !... et vous êtes philosophe !...
MOLIÈRE.
Mais voyez un peu ce drôle-là.
LESBIN.
Eh bien, vous allez le revoir, votre beau cahier où il n’y a pas tant seulement grand comme doigt de blanc... vous allez le revoir.
Il sort.
Scène III
MOLIÈRE, seul
L’imbécile ! il en aura fait quelqu’enveloppe... Au moins je respire ; j’appréhendais fort qu’il ne s’en fût servi pour faire du feu... Un Poème, auquel je travaille depuis tant d’années !...
Scène IV
MOLIÈRE, LESBIN, entrant avec une perruque toute papillotée
LESBIN.
Le voilà ; le voilà votre papier, bien employé, je m’en vente... Grondez, grondez présentement, si nous sommes en faute.
MOLIÈRE, dans la plus grande colère.
Ah le bourreau ! le bourreau ! je ne m’y retrouverai jamais... J’en perdrai la tête... Pour cela je suis bien malheureux... Que de temps, que de soins ! que de peines perdues.
LESBIN.
Il est vrai que nous avons été plus de deux heures à cette besogne ; mais allez-vous nier à présent que vous ne m’avez pas dit vous-même ici tantôt, de la mettre en papillotes ?
MOLIÈRE.
Va-t’en butord, esprit bouché... va-t’en... Retire-toi sur le champ, de peur que je ne t’assomme.
LESBIN, à part.
Il a le diable ad corps, avec son chiffon de papier.
MOLIÈRE.
Ah ! quelle perte !...je me ne possède plus : puisque c’est ainsi
Dans son dépit, il déchire son cahier et le jette au nez de Lesbin.
tiens, tiens, ôte-moi tout cela de dessous les yeux... Brûle, brûle tout, que je n’en revoie jamais un seul morceau... pas un seul morceau, entends-tu ? ou je te chasse... Et si jamais tu oses toucher au moindre de mes papiers... Mais j’aurai toujours la clef sur moi...
LESBIN.
Monsieur.
MOLIÈRE, le menaçant.
Si tu ne t’en vas pas tout de suite... prends garde... Réplique. Réplique un seul mot.
LESBIN, ramassant les morceaux de papier.
Mais attendez du moins que j’emporte tout...
À la porte.
Donnez-vous bien de la peine à mettre la perruque en papillotes !... voilà comme on vous traite.
Scène V
MOLIÈRE, seul
C’en est donc fait de mon Poème chéri... Je faisais cette traduction avec tant de volupté ! j’avais rendu plusieurs morceaux si heureusement... dans ce Lucrèce, une si belle philosophie, si bien d’accord avec mes pensées... Ah ! qu’il me faut de courage pour supporter cet accident... Mais je me suis trop abandonné à ma première vivacité... Il ne m’eût peut-être pas été impossible d’en retrouver la plus grande partie... Oui, en rassemblant avec patience les fragments... Et d’ailleurs, à quoi sert de brûler l’autre moitié, Lesbin, Lesbin...
Scène VI
MOLIÈRE, LESBIN
LESBIN, derrière le Théâtre.
Monsieur.
MOLIÈRE.
Rapporte-moi tout ce que tu as ramassé, et jusqu’au moindre petit morceau ; entends-tu ? que rien ne se perde ?
LESBIN, entrant.
Quoi, Monsieur, ce que vous venez de déchirer tout à l’heure ?
MOLIÈRE.
Oui, oui, dépêche-toi de tout rapporter.
LESBIN.
Ah ça, Monsieur, si vous le faites exprès, vous n’avez qu’à le dire... Vos lubies à la fin me feront tourner la cervelle.
MOLIÈRE, avec une colère concentrée.
Je parie qu’il a déjà tout brûlé.
LESBIN.
Mais n’ai je pas bien fait ?... d’après votre ordre.
MOLIÈRE.
Est-il possible ! ah ciel !
LESBIN, à part.
Ah ! quel homme, quel homme !
Haut.
Comment, ne m’avez-vous pas dit de brûler tout, et sous peine ?...
MOLIÈRE.
Oui, oui, maraud, oui je te l’ai dit : tu as bien fait ; à merveille, butord... Va-t’en et laisse-moi en repos : sortiras-tu bien vite ?
LESBIN, en sortant.
Oh ! que de patience il faut avoir.
Scène VII
MOLIÈRE, CHAPELLE
CHAPELLE.
Bonjour, Molière...
MOLIÈRE.
Bonjour, Chapelle.
CHAPELLE.
Qu’est-ce donc ? vous voilà de bien mauvaise humeur ?
MOLIÈRE.
Il est vrai.
CHAPELLE.
Tous les jours un visage plus sombre. Mais quel contraste, mon ami, entre votre personne et vos écrits ! :... Tandis que votre génie divertit toute la France, il ne vous inspire pour votre compte que des idées mélancoliques... Allons, prenez sur vous de la gaieté... Il n’y a que cela de bon.
MOLIÈRE.
Croyez-vous que je puisse être comme vous, toujours disposé à la joie et à la dissipation ?
CHAPELLE.
Et qui vous en empêche ?
MOLIÈRE.
Ce que j’ai en tête.
CHAPELLE.
Eh bien, n’écrivez plus... Laissez-là le Théâtre. Je ne voudrais pas, moi, de la gloire d’Homère, s’il fallait cesser d’être libre et heureux.
MOLIÈRE.
Oh ! si je n’étais pas engagé dans la carrière... Mais je vous le dis, s’il fallait recommencer, j’aimerais mieux, voyez-vous, porter le mousquet, traîner une besace, que de continuer la cruelle vie d’avoir des Comédies à faire, et des Comédiens à conduire.
CHAPELLE.
Mais quel motif vous a inspiré ce prompt dégoût ? qu’avez-vous, Molière ?
MOLIÈRE.
J’ai... Comment vous le dire, vous qui riez de tout !
CHAPELLE.
Et voilà ce que valent à-peu-près les choses de ce monde.
MOLIÈRE.
Le Public devient plus que jamais inconcevable dans les jugements ; il obéit à des mouvements aveugles dont il ne se rend pas compte.
CHAPELLE.
Il est ainsi.
MOLIÈRE.
Et puis les persécutions de mes ennemis, leurs sourdes intrigues, leurs cabales, leur triomphe enfin, malgré qu’on les connaisse pour ce qu’ils sont.
CHAPELLE.
Ah ! j’entends... La défense de représenter l’Imposteur est un poids, dont vous ne pouvez vous délivrer.
MOLIÈRE.
Eh ! prétendez-vous que je demeure calme à un pareil revers ? une pièce annoncée depuis si longtemps, le Public assemblé, la salle éclairée ; un quart-d’heure avant la représentation, arrive, comme un coup de foudre, l’ordre fatal, l’ordre du Roi.
CHAPELLE.
Mais le Roi, à ce qu’il me semble, avait déjà interdit une fois cette Comédie : il y avait donc une témérité inouïe à violer son ordre, et vous êtes coupable...
MOLIÈRE, vivement.
Je ne suis point coupable. Le Roi, après la défense ; avait voulu lire la Pièce : l’ayant lue ; il l’avait approuvée ; sa justice avait daigné lever l’interdiction. Malheureusement la permission n’était que verbale : il partit pour la Flandre, où ses conquêtes l’occupent tout entier, mes ennemis ont profite de son éloignement pour m’opposer de nouveaux obstacles. Mais j’ai dépêché vers Sa Majesté un homme intelligent et zélé, et j’attends, d’un moment à l’autre, la permission telle qu’on l’exige.
CHAPELLE.
À la bonne heure, il faut... attendre.
MOLIÈRE.
Que vous parlez fort à votre aise ! S’il y à tant de mauvais consolateurs, c’est que chacun console selon son caractère, et non félon le caractère de malheureux.
CHAPELLE.
Mais vous avouerez aussi que vous avez été bien imprudent, en allant démasquer d’une main violente, cette espèce d’hommes dangereux, que vous auriez dû ménager.
MOLIÈRE.
Ménager, dites-vous ! ménager ! Oh ! que je suis loin de vos idées !... Eh ! contre qui écrire avec force, s’il vous plaît ? Ce sont-là les vrais ennemis de la société. Ils le glissent jusques chez moi ; un Pirlon me calomnie dans mes propres foyers. C’est presque se ranger dans la classe des méchants que de leur pardonner. Il est bien incroyable qu’on me blâme par où je mériterais quelques louanges. Qu’y a-t-il de plus funeste au monde, que l’hypocrisie ?
CHAPELLE.
Vous avez raison, mais je voudrais vous voir plus calme : vous nous donnez au Théâtre des scènes plaisantes, et dans l’intérieur de votre maison, vous n’enfantez pour votre compte que des pensées lugubres.
MOLIÈRE.
J’étudie les hommes, et depuis que j’apprends à les connaître, et à lire dans leurs cœurs, je puis faire rire sans doute ; mais, s’il faut l’avouer, je n’ai plus envie de rire.
CHAPELLE.
Tant-pis ; il n’y a que cela de bon ici bas. J’ai trop d’esprit, moi, pour me sacrifier à des hommes qui sont au moins ingrats, quand ils ne sont pas cruels.
MOLIÈRE.
Vous auriez tort... N’êtes-vous pas l’oracle des soupers ?
CHAPELLE.
Je m’en vante... Le plus beau jour de ma vie fut celui, où j’enivrai le sévère Despréaux qui déclamait contre le vin... Oh ! je n’obtiendrai jamais sur vous cette victoire.
MOLIÈRE.
Je n’ai n’y vos loisirs, ni vos goûts.
CHAPELLE.
On se les donne : moi, né pour l’indépendance et la liberté, plus sensible aux plaisirs qu’à la gloire, j’ai préféré les douceurs, d’une vie libre et voluptueuse à la contention, ou plutôt à l’inutilité de l’étude. Imitez-moi... la promenade, la conversation, la table ; voilà ce qui s’appelle vivre... Le reste est folie. Quelle sorte de jouissance trouvez-vous dans cette gloire, que vous me vantez à tout propos.
MOLIÈRE, souriant.
Oh ! c’est-là notre secret.
CHAPELLE.
Pauvre ami ! que vous achetez cher cette réputation, qu’on vous conteste encore. Livré d’un côté aux critiques impitoyables, harcelé de l’autre par la satyre insolente, tout, jusqu’à l’histoire de votre maison devient l’objet de la maligne curiosité du Public.
MOLIÈRE.
Comment ?
CHAPELLE.
On parle des femmes que vous avez chez vous, de la mère, de la fille ; la mère est jalouse, la fille est amoureuse...
MOLIÈRE.
Paix, mon ami, de la discrétion !
CHAPELLE.
Ne craignez rien ; mais comptez-vous vous marier... là, sérieusement ?
MOLIÈRE.
Oui... J’aime...
CHAPELLE.
Vous voulez épouser pour autrui.
MOLIÈRE.
Cruel ami !
CHAPELLE.
On épouse la beauté ; son charme disparaît bientôt, mais son danger subsiste aussi longtemps qu’elle... Point de femmes, point de vers, que ces vers inspirés qu’on fait là malgré loi. Liberté, bonne table, propos joyeux, telles sont les jouissances de la vie, c’est bien assez pour l’infortune que d’être auteur ; mais vouloir encore épouser !... Oh ! il n’y a plus de veux à faire pour votre bonheur, mon cher Molière !... Adieu, Horace buvait le salerne, qu’il vous en souvienne... On n’est heureux que le verre à la main. Apollon n’est qu’un vendeur de fumée.
MOLIÈRE.
Oui, mais de cette fumée-là, n’en a pas encore qui veut.
Scène VIII
MOLIÈRE, seul
Et nous sommes amis quoique aussi opposés dans nos goûts !... Mais on passe si rapidement sur la terre, qu’on n’a que le temps de prendre ses amis, et non de les choisir... Isabelle ne vient point... Elle seule écarte les chagrins qui m’assiègent ; et quand je la vois, il me semble que tout s’éclaire autour de moi.
Scène IX
MOLIÈRE, ISABELLE
ISABELLE, se montrant.
Puis-je entrer ?
MOLIÈRE, allant à elle.
Hé ! je ne désire, je ne veux, je n’appelle que vous... Mais qu’y a-t-il ?... Vous tremblez ?...
ISABELLE.
Oui, je crains toujours que maman ne nous surprenne... Elle est sans cesse sur mes pas... Si elle allait découvrir que nous nous aimons.
MOLIÈRE.
Qui le lui dirait ? d’où s’apercevrait-elle ?...
ISABELLE.
Si elle ne devine pas vos sentiments, elle pourra pénétrer les miens.
MOLIÈRE.
Eh ! pourquoi lirait-elle plutôt dans votre cœur ?
ISABELLE.
Parce que j’aime plus que vous n’aimez.
MOLIÈRE.
Je vous ai fait le serment que je n’aurai point d’autre femme que vous ; je le remplirai...Mais j’ai à ménager votre mère : elle est d’un caractère emporté, violent, et jalouse de vos charmes ; pour tout dire en un mot, je la crois votre rivale.
ISABELLE.
Je le fais, et voilà ce qui m’alarme.
MOLIÈRE.
Aller, vous êtes une enfant... Ne fûtes-vous pas dans tous les temps l’objet de ma tendresse ?
ISABELLE, effrayée.
Ô ciel !... je vous l’avais bien dit, qu’elle était toujours sur mes pas... Je l’entends... elle va me maltraiter, si elle nous rencontre tête-à-tête.
MOLIÈRE.
Ne vous troublez point... Avez-vous un rôle dans votre poche ?
ISABELLE.
Oui, j’ai celui de Marianne.
MOLIÈRE.
Bon !... Vite, commencez vers le milieu... Je vous gronderai un peu, autant que je le pourrai du moins.
Scène X
LA BÉJART, dans le fond, MOLIÈRE, ISABELLE, faisant le rôle de Marianne
MOLIÈRE, faisant le rôle d’Orgon.
C’est parler sagement ; dites-moi donc, ma fille,
Qu’en toute la personne un haut mérite brille,
Qu’il touche votre cœur, et qu’il vous serait doux,
De le voir par mon choix devenir votre époux.
Eh !...
MARIANNE.
Eh !
ORGON.
Qu’est-ce ?
MARIANNE.
Plaît-il ?
ORGON.
Quoi ?
MARIANNE.
Me suis-je méprise ?
ORGON.
Comment ?
MARIANNE.
Qui voulez-vous, mon père, que je dise
Qui me touche le cœur, et qu’il me serait doux
Devoir, par votre choix, devenir mon époux ?
MOLIÈRE, du ton de la réprimande.
Mademoiselle, Mademoiselle, vous avez une tête une tête !... Soyez donc, je vous prie, plus attentive et appuyez davantage... : Votre étourderie pourrais se rendre jusques sur la scène, et le parterre alors... Vous le savez, il prend de l’humeur... Recommencez ; je ne suis pas content de ce ton-là... Allons, point de mine ; longez mademoiselle, que c’est pour votre bien.
MARIANNE.
Qui voulez-vous, mon père, que je dise
Qui me touche le cœur, et qu’il me ferait doux
De voir, par votre choix, devenir mon époux ?
MOLIÈRE.
Bien. Tartuffe...
Se retournant comme par hasard et saluant la Béjart.
Pardon, Madame, je ne vous avais point aperçue... Nous répétions la scène entre Marianne et Orgon... Voici le rôle qu’elle ne tient pas encore à ma fantaisie, mais cela viendra...
LA BÉJART.
Mais quelle nécessité, je vous prie, de répéter un rôle pour une Comédie défendue, et qu’on ne jouera jamais.
MOLIÈRE.
Madame, y pensez-vous ? D’un moment à l’autre elle peut être représentée ; nous en avons du moins l’espérance. Ne m’ôtez pas l’agréable certitude, qu’au retour de notre cher camarade, la justice et la bonté du Roi auront donné un libre cours à nos talents... Il est donc de la prudence d’être en état de répondre à l’attente du Public, toujours avide de nouveautés.
LA BÉJART.
Et vous, Mademoiselle, qui vous a permis de venir ici répéter, avec Monsieur, un rôle sans mon aveu ?
MOLIÈRE.
Ah ! pardonnez-lui, Madame ; je n’ai que ma pièce en tête, et j’avais fait prier. Mademoiselle de vouloir bien descendre, afin qu’en cas de succès auprès du Roi, rien ne pût retarder la représentation.
LA BÉJART, à sa fille.
Sortez, Mademoiselle.
ISABELLE, à voix basse.
Vous me grondez, et c’est assurément pour rien.
LA BÉJART.
Que dites-vous-là ? vous murmurez, je crois.
ISABELLE.
Maman, je continuais tout bas mon rôle.
LA BÉJART.
Je vous défends dorénavant de répéter vos rôles avec d’autres qu’avec moi.
ISABELLE.
Mais, maman, Molière est l’auteur de la pièce ; hé, qui donc pourra m’enseigner mieux que lui ce que je dois faire ?
LA BÉJART.
Sortez, raisonneuse, et ne répliquez pas.
Scène XI
MOLIÈRE, LA BÉJART
LA BÉJART.
Mais avez-vous entendu, comme elle répond ?
MOLIÈRE.
Faites-lui grâce, Madame : pourquoi voulez-vous aussi m’ôter la gloire de la former à la déclamation ?
LA BÉJART.
Je crains que ma fille ne soit pas aussi simple que vous le dites ; et je pense vous connaître enfin l’un et l’autre.
MOLIÈRE.
Je ne comprends point...
LA BÉJART.
Puisqu’il faut vous parler plus clairement, vous commencez à la regarder avec trop de tendresse.
MOLIÈRE.
Je l’aimai dès son enfance.
LA BÉJART.
Votre conduite avec elle a pris un nouveau caractère, et qui me ferait penser...
MOLIÈRE.
Je l’ai toujours regardée comme si elle était ma fille.
LA BÉJART.
Soyez franc ; et si vous l’aimez en galant homme ; déclarez-le à la mère.
MOLIÈRE, à part.
Quelle ruse de femme...
Haut.
Moi, vous le savez, je la vois, je la chéris, je la traite en père.
LA BÉJART.
Si vous la chérissez, pourquoi tardez-vous à lui assurer un sort ?
MOLIÈRE, vivement.
Vous voulez la marier, Madame ?
LA BÉJART, à part.
Comme il m’échappe !
Haut.
Non ; elle est trop jeune.
MOLIÈRE.
Je crois qu’elle est dans l’âge, où l’on peut accepter un époux... Je l’établirai... Que puis-je faire de plus ?
LA BÉJART.
Mais vous pourriez lui servir de père.
MOLIÈRE.
C’est bien-là mon dessein... Nommez-moi celui qui pourrait lui convenir.
LA BÉJART.
Vous êtes un ingrat ; Molière ; vous ne voulez pas m’entendre : gardez-vous de la première jeunesse. Il vous faut, croyez-moi, une femme qui ne soit pas un enfant ; une femme sensée, qui vous apporte dot de fidélité, de tendresse et de flexibilité dans l’humeur : vous n’êtes pas un homme aisé à vivre.
MOLIÈRE.
Aussi, Madame, le mariage me fait peur !...
LA BÉJART.
C’est-là un autre tort... Le lien ne doit pas vous épouvanter, mais bien le choix. À quoi vous sert cette raison, que vous déposez dans vos ouvrages, si elle ne vous apprend pas à discerner les cœurs qui vous sont vraiment attachés ?... Égaré par une fantaisie passagère, vous pourriez faire une folie, qui ferait le malheur de toute votre vie prenez y garde. Ce conseil que je vous donne, est dicté par le désir de vous voir heureux : je sais mieux que vous peut-être ce qu’il vous faudrait.
MOLIÈRE.
Eh bien, Madame, lorsqu’il s’agira de faire un choix, je vous consulterai.
LA BÉJART, à part.
Avec quelle adresse il élude sans cesse !
Haut.
Vous n’aurez jamais à vous repentir de m’avoir écoutée.
MOLIÈRE.
J’en suis convaincu : plus l’on avance dans la vie, plus on est en état d’apprendre aux autres l’art de vivre.
LA BÉJART, piquée.
Il ne s’agit point ici de la prudence que donne le nombre des années ; Molière, beaucoup d’hommes avancent en âge, sans devenir plus sages ni plus prudents.
MOLIÈRE.
J’aime ce trait d’enjouement ; il me fait sortir du sérieux où je tombais...
Avec exclamation.
Ah ! Madame, voici notre cher Lathorillière.
Scène XII
MOLIÈRE, LA BÉJART, LATHORILLIÈRE, en habit de campagne
LATHORILLIÈRE, embrassant Molière.
Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles !
Tirant un portefeuille.
Tenez, voici l’ordre signé de la main du Roi, qui révoque et anéantit la fatale interdiction.
MOLIÈRE, lui sautant au cou.
Vous me rendez l’âme, la vie, le courage... Ah ! mon cher ami ! ah ! le grand Monarque ! je consacre ma vie entière à ses divertissements... Je suis payé, récompensé de tous mes travaux... Holà quelqu’un.
Lesbin paraît.
Scène XIII
MOLIÈRE, LA BÉJART, LATHORILLIÈRE, LESBIN
MOLIÈRE, à Lesbin.
Allez vite ; que l’on arracha les : affiches, que l’on en fasse de nouvelles, que l’on annonce pour ce soir la représentation de l’Imposteur... Ah ! Messieurs les fourbes, je vous tiens ! Voici mon tour !... Quelle rumeur dans leur sainte cohorte ! Eh, va donc.
LESBIN.
Oui, Monsieur, nous allons arracher les vieilles affiches, et crier au coin des rues, de toutes nos forces, Ce soir on donnera l’imposteur et par ordre du Roi ; en criant, par ordre du Roi : N’est-il pas vrai, Monsieur, que je ferai bien de répéter cela à tous les passants, afin que tout le monde le sache ?
MOLIÈRE.
Oui ; cours, cours ; que ta voix perce l’oreille et le cœur de mes ennemis ; qu’ils pâlissent à cette annonce imprévue.
Lesbin sort.
Scène XIV
MOLIÈRE, LA BÉJART, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE.
Je ris déjà en voyant leurs physionomies s’allonger, quand ils liront les affiches nouvelles.
À la Béjart.
Et vous, Madame, ne perdez pas un seul instant ; allez répéter votre rôle avec votre fille... Songes sur tout à notre dernière conversation ; elle roulait sur les convenances toujours trop oubliées sur la scène.
LA BÉJART, un peu piquée.
Je sais... je sais, Molière...
MOLIÈRE, frappant du pied.
Vous savez... vous savez... de grâce songez y ; point de parure, point d’ajustement : le Public n’a pas besoin de vos atours ; ne savez-vous pas que vous êtes incommodée dans la pièce ?
LA BÉJART.
Mais, a-t-on jamais pris garde, avant vous, à de pareilles minuties ?
MOLIÈRE.
Madame, tout ce qui altère la vérité est de la plus grande conséquence. Le costume aide à l’illusion autant que le jeu, et comme un rien détruit cette illusion précieuse, rien n’est à négliger.
LA BÉJART.
Vous avez raison, Molière ; je vais tout employer pour vous satisfaire et vous prouver mon attachement.
À part.
Que je m’estimerais heureuse, si, à force de soins, je pouvais épouser cette homme illustre, et porter bientôt le nom de Molière !
Scène XV
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE.
Mon ami, je suis au comble de mes vœux ; mais je brûle d’entendre quelques détails.
LATHORILLIÈRE.
J’ai présenté votre requête au Roi ; il l’a reçue, et après l’avoir lue, il a souri, et voici les paroles : Dites à Molière qu’il sera content ; que je déteste l’hypocrisie ; et que je ne trouve pas mauvais que les coupables soient immolés en plein théâtre.
MOLIÈRE.
Ces paroles me consolent ; j’en avais besoin, mon ami ; j’étais abattu sous l’effort de cette cabale abominable... Et puis cette foule d’envieux... de détracteurs.
LATHORILLIÈRE.
Bravez tous ces ennemis, qui disparaîtront demain. Vous avez créé la Comédie ; vous en avez fait un miroir immortel, devant lequel le vice et le ridicule one reculé de surprise et d’effroi. Eh ! ne vous rappelez vous plus ces applaudissements, qui ont soutenu, encouragé vos premiers efforts ?
MOLIÈRE, avec une joie concentrée.
Ce dont je me souviendrai toujours avec une douce émotion, mon ami, c’est la voix de ce vieillard, qui ; perçant le bruit tumultueux du parterre, me cria, à ma première pièce : Courage, courage, Molière ! voilà la bonne comédie. En vérité, c’est à cet homme là que je dois tous mes succès.
LATHORILLIÈRE.
Eh bien donc je vous répéterai, comme le vieillard, du parterre, et à plus juste titre encore : Courage, courage.
MOLIÈRE.
Oui, oui, courage ; il me manque en vérité... Les indignes rivaux qui m’opposent de viles parades, que le Public applaudit, tout en les méprisant...
LATHORILLIÈRE.
Il n’est pas possible que ces rivaux l’emportent, après les modèles que vous avez tracés.
MOLIÈRE.
Je frappe ceux que les lois ne peuvent atteindre ; j’aide à leur impuissance. C’est pour l’intérêt général que je combats ; et quand l’Écrivain a pour foi la vérité, l’honneur, la vertu, que les armes sont fortes et puissantes !
LATHORILLIÈRE.
Armes dignes de vous, dignes de l’homme qui ne reçut du Ciel le talent de peindre, que pour imprimer au vice les plus odieuses couleurs... Venez, et soyez sûr que c’est un laurier plus vert encore que les précédents, qui va ceindre votre tête.
ACTE II
Scène première
PIRLON, LA FOREST
PIRLON s’avance à pas de loup sur la pointe du pied, regarde de côté et d’autre, écoute à une porte, regarde par le trou de la serrure, et revient précipitamment à la porte, où il frappe quelques coups, à petit bruit.
Holà quelqu’un !... Y a-t-il quelqu’un ici ?
La Forest paraît.
J’ai frappé avant d’entrer... Me préserve le ciel de vouloir surprendre !...
LA FOREST.
Votre servante, Monsieur Pirlon. Voilà tantôt un Carême qu’on ne vous a vu...
PIRLON.
Avec votre permission, honnête et belle demoiselle... Votre maître est-il sorti ?
LA FOREST.
Oui, Monsieur ; tous les marins à cette heure-ci, notre maître va au théâtre faire des répétitions...
PIRLON.
L’intérêt que je prends à lui... Ô ciel !... Pauvre infortuné !
LA FOREST.
Que voulez-vous dire, Monsieur ? que lui serait-il arrivé ?
PIRLON.
Si vous aimez votre maître...
LA FOREST.
Si je l’aimons !... de tout notre cœur.
PIRLON.
Hélas ! c’est un homme perdu !
LA FOREST.
Notre maître, un homme perdu !
PIRLON.
Oui, ma fille... je l’ai vue cette affiche scandaleuse, qui offense le ciel. Il ose jouer des gens de bien, sous le non d’hypocrites... Le ciel aveugle ceux qu’il veut frapper en la colère...
LA FOREST.
Mais, Monsieur, si c’est pour cette nouvelle Pièce qu’on va donner aujourd’hui, que vous le regardez comme tant coupable, je vous assurons bien qu’il n’y a point de mal dans tout cela. Il nous l’a lue, afin que vous le sachiez, et le tour d’un bout à l’autre ; et c’est bien bonnement dit.
PIRLON.
Ah ! la Forest, la Forest !... Vous ne connaissez pas le monde... vous êtes loin de soupçonner les scélérates ruses de votre maître. Sachez qu’il est agité de l’esprit malin qui l’inspire nuit et jour...
LA FOREST.
Oui, il est malin, c’est bien vrai ça ; il est malin, mais il n’est pas du tout méchant.
PIRLON.
Lui, c’est un démon.
LA FOREST.
Comment entendez-vous cela ?
PIRLON.
Semer de porte en porte de pieux conseils, et se mettre au fait de l’intérieur des maisons, pour mieux appliquer le remède au mal, c’est, selon lui, chercher à brouiller les maris et les femmes, à séduire les épouses et les filles ; prêter de l’argent à ceux qui en ont besoin, et s’assurer qu’ils le rendront exactement, afin d’être en état de le prêter à d’autres, c’est usure ; prendre les intérêts du ciel, si fréquemment blessés dans ces jours de corruption, c’est servir ses propres intérêts ; donner des avis salutaires aux pères sur le dérèglement de leurs enfants, c’est vouloir, par un adroit coup de main s’approprier leur héritage... Un peuple volage l’écoute, l’environne, applaudit à ses bons mots. L’esprit, ma très chère fille, est si dangereux, quand la soumission du cœur ne l’accompagne point. Plut à Dieu qu’il eût celle-ci ! Je n’en dirai point davantage ; le zèle seul me transporte... Que le ciel l’éclaire, le change, et lui fasse miséricorde.
LA FOREST.
Mais, Monsieur, vous nous faites vraiment peur, en nous parlant de ce ton-là... Vous roulez des yeux terribles... Ah ! mon Dieu !
PIRLON, d’un ton véhément.
Tremblez, tremblez pour votre maître : non-seulement il irrite le ciel, mais il va tomber encore sous la colère du Roi.
LA FOREST.
Sous la colère du Roi !... Ah ! tout mon sang se fige...
PIRLON.
Cet ordre dont il se vante, il a eu l’audace de le supposer. Oh ! il la paiera de la tête cette témérité, et les personnes qui viennent à lui, feront toutes enveloppées dans sa disgrâce.
LA FOREST, jetant un cri.
Miséricorde !... ah ! Monsieur, je vous assurons que nous sommes bien innocente de tout ce qu’il a fait.
PIRLON.
Pas tan, pas tant que vous l’imaginez, ma fille... vous le servez à table ?
LA FOREST.
Oui.
PIRLON.
Vous contribuez à l’entretien de la personne ?
LA FOREST.
Oui.
PIRLON.
Vous le soulagez quand il est malade ?
LA FOREST.
Oui ; c’est bien notre devoir.
PIRLON.
De votre propre aveu vous avez pris goût à la lecture de ses pièces ?
LA FOREST.
Oui, il aime par fois à nous les lire, et je lui disons notre avis, franc et net.
PIRLON.
Et cela ne vous fait pas de peine à entendre ?
LA FOREST.
Oh ! tout au contraire, je rions ; et notre maître... allez, il est bien content, quand il nous voit rire.
PIRLON.
Vous avez ri ?
LA FOREST.
Eh ! qui s’en empêcherait ?... c’est parfois si drôle.
PIRLON, avec véhémence.
Allez, vous êtes la complice de ses œuvres.
LA FOREST.
Nous !... Est-il possible, bon Dieu !
PIRLON.
Vous êtes coupable d’avoir ri... Et quelle pièce vous a-t-il lue ? Voyons. Serait-ce cette abominable Comédie, où il joue un honnête personnage, sous le nom d’imposteur ?
LA FOREST.
Ah, ah ! n’est-ce pas celle-là où il y a un homme qui dit tout ce qu’il n’a pas dans le cœur ? j’avons dit : Celui-là ressemble à des gens de notre connaissance.
PIRLON.
Le scélérat !... Vous êtes sous un bien funeste toit... Je veux vous en tirer, afin que le châtiment ne s’étende pas jusqu’à vous, et vous placer chez un homme très riche, qui ne tardera pas à faire son testament, et qui en attendant vous donnera de bons gages.
LA FOREST.
Mais, notre maître nous en donne de fort bons.
PIRLON.
Ce vieillard, dont je vous parle, écoutez-bien, n’a ni enfant, ni héritier... Vous devez le préférer à Molière, qui mène une vie si scandaleuse.
LA FOREST.
Je ne voyons point cela... Il est parfois un peu grondeur, le cher homme ; mais pardi ! c’est-là son seul défaut... Du reste, bon, humain, charitable.
PIRLON.
Molière, charitable !
LA FOREST.
Pardi ! nous le savons bien peut-être... Il y a toujours dans son cabinet des gens bien misérables, presque nus, à qui il baille de l’argent et des habits... Dernièrement encore, en revenant d’Auteuil, il rencontre un pauvre ; ne voilà-t-il qu’il lui met dans la main on louis ? Celui ci tout émerveillé, court après lui : Ah ! mon bon Monsieur, vous vous êtes surement trompé ; ce n’est pas-là du cuivre, c’est de l’or... Tiens, en voilà un second, répartit bravement notre maître ; et tout le long du jour il ne cessait de dire : Où la vertu va-t-elle se nicher !
PIRLON, lui présentant une bague.
Voici une bague, ma fille, dont je veux vous faire présent ; prenez... Je vous assure que tout le monde ost révolté de sa conduite.
LA FOREST, prenant la bague.
Il est bien vrai que le monde jase un tantinet.
PIRLON.
Ne vous a-t-il pas fait quelquefois quelques petites agaceries ?
LA FOREST.
Qu’est-ce que cela veut dire, s’il vous plaît ?
PIRLON, d’un air cossard.
Là, de ces petites caresses ?...
LA FOREST.
Non, non, Monsieur ; il a toujours respecte notre vertu ; et d’ailleurs, quoique pauvre servante, j’aurions...
PIRLON, lui présentant un étui.
Prenez cet étui... Je vous dispense de répondre sur ce chapitre... toute fille... je m’entends... Mais ces deux femmes, la mère, la fille ? songez-y bien, ne mentez point ici ; ce n’est plus pour votre compte. Rappelez-vous tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez soupçonné ; tout ce qu’on a pu dire, imaginer, répéter...
LA FOREST.
Mais il les aime toutes deux, à ce qu’on dit autour de nous.
PIRLON, avec exclamation.
Toutes deux !... Ah l’infâme !... le pécheur !
LA FOREST.
Cependant, Monsieur, je n’avons aucun témoignage.
PIRLON.
Point de cependant, ma fille, l’inceste est prouvé... Eh, dites-moi, Molière ne crie-t-il pas souvent dans sa maison, ne gronde-t-il pas ses domestiques, comme vous me le disiez tout à l’heure ?
LA FOREST.
Oui, cela arrive par fois... si l’on vient à l’interrompre, lorsqu’il est rencogné dans son cabinet, où il griffonne des heures entières ; allez, allez, c’est alors un beau train.
PIRLON, avec emphase.
Le voilà, le voilà l’homme atrabilaire, misanthrope, insociable, fougueux, emporté, irascible, qui ne sait point mettre un frein à sa colère, et qui veut gourmander les passions d’autrui... Mon enfant, où êtes-vous ? Bon Dieu ! dans quel séjour ! Il vous arriverait avant peu quelque grand malheur... Et vos profits sont de combien ?...
LA FOREST.
Cela va à quatre écus par mois.
PIRLON, en levant les épaules.
Quatre écus par mois ! Vous en aurez dix dans la sainte maison où je veux vous faire entrer dès ce soir...
LA FOREST.
Dix écus par mois ! bien vrai ? oh ! je vas demander mon congé. Dix écus par mois !... Hé ! tenez, entre nous, je sommes lasse d’obéit aux caprices de deux femmes qui, tant que la matinée dure, ne font que considérer leur figure dans le miroir, et qui nous grondent après, quand par hasard je nous y regardons... Dix écus de profits par mois !... Il faut que je vous disions encore quelque chose pour cela... Il m’est avis que notre maître n’aime point la mère, mais beaucoup, beaucoup la fille...
PIRLON.
Le pécheur ! et comment distinguez-vous qu’il la préfère ?
LA FOREST.
C’est que nous les entendîmes l’autre jour par mégarde, qui parlementaient tous bas pour se marier ensemble, mais il faut qu’ils attendent, disaient-ils, à cause de la mère qui voudrait se marier en place de sa fille... N’allez rien dire de tout ceci, au moins,
Elle fait quelques pas, et revenant.
dix écus par mois !...
PIRLON.
Oui, mort enfant, sans compter les étrennes.
LA FOREST.
Oh ! quel plaisir !
À part.
Servir un homme cousu d’or, qui est seul ; un vieux sans dent, un béquillard qui fera bientôt son testament... Notre fortune est faite, et de ce coup-ci j’épouserons un rat-de-cave. Votre servante, Monsieur, bien obligé, bien obligé.
Scène II
PIRLON, seul
Molière nous met audacieusement sur la scène, et nous resterions les bras croisés ! Vous en serez puni, Monsieur l’Auteur !... Disons d’abord que c’est un impie, un réprouvé, un scélérat, un débauché : ensuite semons la discorde entre les deux femmes ; mais pour blesser Molière par l’endroit le plus sensible dans son orgueil effréné, diabolique, empêchons, empêchons surtout que sa pièce ne soit représentée, ou si elle l’est, faisons-la tomber sous les sifflets d’une sainte cabale.
Scène III
PIRLON, ISABELLE
ISABELLE, en entrant.
Ah ! c’est vous, Monsieur Pirlon ?
PIRLON.
Vous voyez devant vous, Mademoiselle ; le plus humble de vos serviteurs.
ISABELLE.
Il y a longtemps qu’on ne vous a vu : c’est ce que maman disait encore hier au soir.
PIRLON.
La charité agissante consume bientôt le peu de temps qu’on peut avait à soi : si vous me voyez ici, c’est pour votre bien, Mademoiselle, pour votre salut.
ISABELLE.
Pour mon salut, Monsieur ? qu’avez-vous donc à me dire ?
PIRLON.
Écoutez, ma chère enfant, les moments sont précieux ; fasse le ciel qu’éclairée par mes discours, vous sachiez en profiter... Si Molière rentrait...
ISABELLE, avec intérêt.
Que dites-vous de Molière ?
PIRLON.
Vous avez quelque penchant pour lui ?
ISABELLE.
Qui vous a dit cela, Monsieur ?
PIRLON.
Ne prenez pas la peine de vous déguiser ; vous vous tromperiez vous-même, en voulant tromper.
ISABELLE.
Eh bien, quand ce que vous dites serait fondé...
PIRLON.
Ce serait pour vous un grand malheur ; car il ne vous aime point, lui.
ISABELLE.
Comment le savez-vous ?
PIRLON.
C’est un adroit corrupteur.
ISABELLE.
Mais, Monsieur, vous outragez indignement Molière ; ses intentions sont droites et pures.
PIRLON.
Que vous êtes crédule !
ISABELLE.
Et c’est m’offenser de plus en plus, Monsieur, car je suis honnête fille ; et Molière est un homme de bien.
PIRLON.
Qui vous abuse, qui vous trompe... Je vous connais une rivale...
ISABELLE.
Une rivale ! Est-il possible ! Molière serait un perfide, un traître !
PIRLON.
C’est un grand Comédien... Quand vous aurez augmenté la liste de celles qu’il a abusées, il sera trop tard alors de gémir... Prévenez, prévenez...
ISABELLE.
Qu’entends-je !... je me sens mourir, mais c’est à moi de l’emporter sur mes rivales par ma constance et par ma tendresse.
PIRLON.
Et si votre mère venait à connaître votre passion, l’approuverait-elle ?
ISABELLE.
De grâce, ne lui révélez pas mon secret... Si elle le devinait, je serais perdue.
PIRLON.
On peut tout me confier... D’autres secrets bien plus importants m’ont eu pour fidèle dépositaire... Je ne dirai donc rien ; mais c’est à une petite condition.
ISABELLE.
Une condition ! et quelle est-elle ?
PIRLON.
Elle est fort légère, et de plus, facile à remplir : j’exige que vous me donniez votre parole de ne point représenter aujourd’hui dans la Comédie de l’Imposteur, sans quoi je cours à votre mère, lui faire un tableau de votre conduite, et lui donner des conseils à ce sujet.
ISABELLE.
Vous seriez assez perfide !... Hélas ! je ne crains que cela dans le monde.
PIRLON.
Choisissez... Vous gardez le silence ?... Adieu...
ISABELLE, l’arrêtant.
Monsieur Pirlon, Monsieur Pirlon, je ne jouerai point dans la comédie de l’Imposteur ; je vous le promets ; mais promettez-moi aussi que vous ne direz rien à ma mère.
Scène IV
LA BÉJART, PIRLON, ISABELLE
LA BÉJART.
Mais, ma fille, vous vous conduisez avec une indépendance choquante !... il vous faut donc sortir de chaque instant, et n’être jamais dans votre chambre !
ISABELLE.
Maman.
PIRLON.
Pardon, Madame ; j’ai pris la liberté de converser avec Mademoiselle : je ne lui parlais que de choses que l’honnêteté avoue... Vous savez qui je suis.
LA BÉJART.
Ce que je dis-là, Monsieur, n’est pas pour vous ; je sais trop qu’il ne sort de votre bouche qu’une morale épurée ; mais si je l’eusse trouvée avec un autre, je vous l’aurais souffletée d’importance.
PIRLON.
Ah, Madame ! c’est dans la chaleur même d’un zèle, d’ailleurs aussi louable, qu’il faut réprimer avec soin ces premiers mouvements...
LA BÉJART.
Allez, Mademoiselle, allez, ne perdez point de temps ; repassez encore votre rôle. Si vous marquez de mémoire, vous me trouverez sur votre chemin...
Scène V
PIRLON, LA BÉJART
LA BÉJART.
Soyez le bien venu, mon cher monsieur Pirlon. Que vous disait ma fille ? Elle vous contait à son ordinaire des enfantillages, car elle est si peu formée !
PIRLON.
La jeunesse, dans ce siècle corrompu, est livrée au vice de bonne heure ; heureusement pour vous et pour elle, que je suis venu ici. Il semble que la providence me fasse entrer partout où je puis être de quelque utilité... J’ai l’art de lire un peu au fond des cœurs. J’ai découvert ici des choses étranges, et que vous ignorez... Mariez, mariez promptement votre fille, Madame !... voilà tout ce que je puis vous dire.
LA BÉJART.
Comment ! elle voudrait un mari ! Elle y songerait !... à son âge ?
PIRLON.
À son âge ! elle a fait mieux, elle l’a trouvé.
LA BÉJART, vivement.
Hé ! quel est-il ?
PIRLON.
C’est Molière.
LA BÉJART.
Molière !
À part.
Ah, traître !
PIRLON.
Ce n’est pas tout.
LA BÉJART.
Que dites-vous ? vous me faites frémir, Monsieur Pirlon.
PIRLON.
Elle sera à lui, ce soir même.
LA BÉJART.
Cela ne se peut pas ; sans mon consentement ?... Il est indispensable.
PIRLON.
Bon ! vous ne savez que cela ? il vous l’enlève ce soir après la Comédie, comptant sur le succès de sa pièce, et fort d’une éminente protection à la Cour, dont il se vante hautement.
LA BÉJART.
Hélas, oui ! il n’a que trop de protection dans ce funeste pays... !
PIRLON.
À l’issue de la Comédie, une chaise de poste les attend tous deux, nuit tombante ; ils partiront comme l’éclair pour se rendre d’un trait jusqu’à Lille. Là, ils séduiront Sa Majesté, qui, comme vous le savez, a un faible étonnant pour cet homme-là... Voilà pourquoi ils ont me égale impatience de donner la Pièce aujourd’hui.
LA BÉJART.
Ah, Monsieur Pirlon ! que de grâces j’ai à vous rendre ! je me suis toujours si bien trouvée de vos conseils ; mais ce dernier avis est au-dessus de tout. Soyez bien persuadé que ni moi, ni ma fille ne toucherons ce soir les planches du Théâtre. Je l’enferme sous cette clef, et si Molière veut divertir le Public, il en fera seul tous les frais.
PIRLON.
Adieu, Madame ; si Molière me rencontrait, il serait furieux de se voir démasqué ; il devinerait mon zèle ; je me retire. Remerciez le ciel de ce que j’ai toujours eu les yeux ouverts sur vos intérêts.
Scène VI
LA BÉJART, seule
Le perfide ! et je pourrais conserver de l’amitié pour lui ! il faut que je m’en sépare, que j’abandonne son Théâtre... Cruelle enfant !... Holà, la Forest... la Forest...
Elle crie avec emportement.
la Forest...
Scène VII
LA BÉJART, LA FOREST
LA FOREST, derrière le théâtre.
Un moment, Madame, un moment...
LA BÉJART.
Mais venez donc, la Forest, quand on vous appelle.
LA FOREST.
Mais pardi, Madame, vous criez à tue-tête ; et comptez-vous que je soyons sourde ?... Non Dieu merci, j’avons encore l’ouïe bonne.
LA BÉJART.
Insolente !... voilà un ton nouveau.
LA FOREST.
Insolente, insolente ; c’est bientôt dit ça... Je n’avons que faire, Madame, de tous vos beaux compliments...Gardez-les pour d’autres, s’il vous plaît.
LA BÉJART.
Allez dire à ma fille, que je ne veux pas qu’elle s’habille pour la Comédie, et que je lui défends de sortir de sa chambre.
LA FOREST.
Oh, pour ça je le voulons bien, car cela ne nous dérange pas... Bon, allons d’un plein faut chez l’homme au testament.
Scène VIII
LA BÉJART, seule
Je l’avais toujours craint que Molière ne prît de l’amour pour ma fille ; mais sa raison ne devait-elle pas le garantir d’un tel sentiment ? Quel bonheur pourrait-il attendre de son union avec une enfant, qui ne connaît point son mérite, qui n’aime, ne désire que l’indépendance, qui ne sentira jamais tout le prix d’un homme tel que lui ? J’ai dû compter sur les réflexions, et je me flattais qu’elles l’amèneraient enfin à un dessein plus raisonnable. Tantôt encore il a affecté un ton de sincérité qui en eût imposé à la défiance même. Je l’ai donc mal connu !... non, je ne l’aurais jamais soupçonné d’une telle noirceur.
Scène IX
LA BÉJART, ISABELLE
LA BÉJART.
Apprêtez-vous, ingrate, à sortir de cette maison, et pour n’y plus rentrer... Vous m’avez trompée, mais vous en porterez la peine ; allez vous ne reverrez plus Molière, du moins de mon vivant...
ISABELLE, à part.
Ah ! le traître !
D’une voix timide.
Maman, mais qu’ai-je donc fait ?
LA BÉJART.
C’est à votre conscience à vous le dire, s’il te reste encore quelque sentiment d’honneur... Je répugnais toujours à te croire un mauvais cœur, fille dénaturée !... va, sors, épargne-moi le tourment de ta présence.
ISABELLE, se retirant au fond du Théâtre.
Que je suis malheureuse d’avoir ajouté foi à ce méchant homme !
Scène X
LA BÉJART, MOLIÈRE
MOLIÈRE, en entrant.
Qu’ils menacent, qu’ils tonnent, qu’ils cabalent ; ces hommes Hardis et souples. Que la haine la plus ardente s’allume dans leurs âmes charitables, je brave leur calomnie et leurs artifices ; c’est aujourd’hui le jour de mon triomphe : dans une heure, en plein théâtre, je les livre au mépris universel... Quel que soit le succès, on me saura gré au moins de mon courage. Non, aucun de mes ouvrages ne me flatte autant...
Saluant la Béjart.
Ah ! je me recommande à vous, Madame... Vous êtes en possession de faire la destinée du pauvre Auteur ; il attend tout de votre zèle...
LA BÉJART.
Ma fille a la migraine, ne comptez pas sur elle. Je vous avertis que vous pouvez charger quelqu’autre de son rôle ; et quant au mien, je ne le remplirai point, je vous le jure... Allez, Monsieur, allez chercher des Actrices à vos ordres... Je n’ai pour vous ni parole, ni mémoire.
MOLIÈRE.
Madame !... mais vous me tuez, vous m’assassinez, vous me poignardez un million de fois. Perdez-vous le sens ? Quoi donc ! vous choisiriez l’époque de ma vie la plus importante, la plus glorieuse, pour faire échouer ma réputation !... Mais y songez-vous bien ? Ils diront encore que l’Imposteur est défendu, que la permission était supposée. Cette calomnie d’un jour vivra des années...
LA BÉJART.
Trouvez le secret de nous forcer à jouer, quand nous ne le voulons pas.
MOLIÈRE.
Mais, Madame, avez-vous oublié vos engagements ?
LA BÉJART.
Mes engagements !
MOLIÈRE.
Oui, Madame, vos engagements. Et le Public, lui manque-t-on à ce point ? Répondez...
LA BÉJART, d’un ton goguenard.
Le Public !... Je vais me trouver mal, m’évanouir pendant trois heures, me faire saigner du bras, du pied ; j’aurai une attestation du Médecin... J’ai déjà un mal de tête affreux, épouvantable, qui m’empêche de voir et d’entendre.
Elle appelle.
Qu’on aille avertir le Docteur, et qu’on bassine mon lit bien chaudement.
Elle sort en se plaignant comme si elle était malade.
Ahi, ahi, ahi, ahi !
Scène XI
MOLIÈRE, LA FOREST
LA FOREST, à part.
Me voilà bien embarrassée, moi.
MOLIÈRE.
Je demeure anéanti... Écoute, la Forest ; dis-moi, mon enfant, sais-tu la cause de tout ceci ?
LA FOREST.
Monsieur...
MOLIÈRE.
Eh bien ?...
LA FOREST.
Monsieur...
MOLIÈRE.
Après ?
LA FOREST.
Monsieur...
MOLIÈRE.
Hé bien, Monsieur, Monsieur ; Finiras-tu. ?
LA FOREST.
Monsieur c’est que je venons vous prier de nous donner notre congé.
MOLIÈRE.
Et toi aussi ?... tu veux quitter ma maison, où il ne te manque rien, où tu es traitée comme mon enfant ? pourquoi veux-tu sortir ?... Dis-moi la vérité, et je te pardonne.
LA FOREST.
Monsieur.
À part.
Je n’ai pas la force de lui en dire davantage...
Haut.
Votre servante.
Elle sort.
Scène XII
MOLIÈRE, seul
Mais ceci devient sérieux !... Trois femmes révoltées et d’accord entre elles... Quoi ma Pièce serait retardée dans le moment de l’attente universelle, dans ce moment favorable au succès, et qui ne revient plus quand on lui échappe !... Quel métier ! quels tourments !... Ce n’est donc rien d’avoir composé une Pièce de Théâtre ! Après tant de veilles, l’affaire de la représentation est une autre cercle de travaux ; pour un moment flatteur, je suis contrarié des années entières !... Et je m’attacherais encore cet Art, qui enfante tant de désagréments !... Non, non, rentrons dans une sage obscurité... Chapelle a raison, je me tourmente pour des ingrats, et j’oublie follement à vivre pour l’intérêt d’un Art, dont tout le monde veut jouir, et que personne ne seconde.
Scène XIII
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
LATHORILLIÈRE, avec empressement et avec joie.
C’est un tintamarre à la porte de l’Hôtel, comme on n’en a jamais vu ! On n’entend que ces mots : Aujourd’hui la première représentation de l’Imposteur ; allons prendre place, ne soyons pas des derniers. Les Portiers et des barrières suffisent à peine... on se coudoie, on se heurte, on s’écrase...
MOLIÈRE.
Je voudrais être à la Chine, jeté dans quelque île déserte...
LATHORILLIÈRE.
Que dites-vous ?
MOLIÈRE.
Je voudrais être sourd ; je voudrais être mort ; enseveli à cent pieds sous terre !
LATHORILLIÈRE.
Mais vous parlez comme un homme désespéré.
MOLIÈRE.
C’est que je suis vraiment au désespoir.
LATHORILLIÈRE.
Eh ! que vous est-il arrivé ?
MOLIÈRE.
La Béjart qui s’imagine pouvoir disposer d’elle-même et de la fille, au mépris de leurs engagements, a osé me dire en face, qu’elles ne joueraient ni l’une, ni l’autre ; qu’elles ne joueraient point, oui... Je lui demande la raison de cet étrange refus, je lui objecte son devoir ; elle répond avec une ironie amère, m’insulte, et me plante-là.
LATHORILLIÈRE.
Mais croient-elles se moquer de nous impunément ! Quoi, il faudrait donner le démenti à toute une ville et cette irrévérence retomberait sur nous ! oh ! je vais de ce pas leur parler ferme... Vous êtes trop indulgent aussi vous... Il dépendrait, de leurs caprices de s’opposer au plaisir du Public, et de nous ruiner par dessus le marché ! Nous verrons, si elles oseront braver ainsi la décence et le contrat formel qui les lie... Laissez... je vais les faire rentrer dans leur devoir.
Scène XIV
MOLIÈRE, seul
Puisse-t-il les ramener à la raison !... Car les femmes ! souvent plus on les prie, moins on en obtient...
Scène XV
MOLIÈRE, CHAPELLE
CHAPELLE.
Eh bien, mon ami, il se répand un bruit sourd que l’on ya remettre la Pièce à un autre jour.
MOLIÈRE.
J’en tremble, à vous dire vrai... Ces femmes ! ces incompréhensibles femmes !
CHAPELLE.
Oh ! de la colère !... Dès que vous sortez de votre rêverie habituelle, point d’autre état.
MOLIÈRE.
Mais vous m’impatientez, mon cher ami.
CHAPELLE.
Qu’importe un autre jour, ou celui-ci ? À bien considérer, cela devient pour vous un avantage réel.
MOLIÈRE.
Comment cela ?
CHAPELLE.
Vous aurez tout le loisir de la corriger, et elle en sera meilleure.
MOLIÈRE.
Qu’elle soit bien, qu’elle soit mal, elle est faite, ce n’est plus le temps de reculer...
CHAPELLE.
Je dois en conscience vous le dire : il y a beaucoup de changements à y faire, si vous voulez qu’elle réussisse : et je venais pour en raisonner avec vous ; votre réputation qui a un côté terne, serait plus brillante, si...
MOLIÈRE.
Brillante ou terne... elle est ce qu’il a plu au sort... Que l’on condamne le plan, le style de ma Comédie, j’y consens ; mais il faudra rendre justice au but que je me suis proposé... Je le soutiens excellent ; je n’ai point la prétention d’être un sublime Auteur, mais je tâche d’être un Auteur honnête.
CHAPELLE.
Honnête !... Vous auriez dû adoucir des traits violents, et qui respirent la passion.
MOLIÈRE.
Je ne sais comment on écrit sans se passionner.
CHAPELLE.
Ensuite vous vous permettez trop de mauvaises plaisanteries, des choses basses et triviales, des charges ; car vous avez beau faire, vous ne pouvez quitter le goût de la farce.
MOLIÈRE.
Le peuple l’aime ; je travaille aussi pour lui, il faut le compter pour quelque chose ; j’ai un Théâtre à soutenir, et environ cinquante personnes à faire vivre chaque jour : que répondrez-vous à cela ? Voyons...
CHAPELLE.
Mais...
MOLIÈRE.
Mais... il faut attirer la foule, et j’espère par cette complaisance rappeler le Public au bon goût, que je connais tout aussi bien qu’un autre... Vous me blâmez aujourd’hui ; mais savez-vous l’époque, où je serai apprécié, où l’on m’honorera peut-être de quelques regrets ? Mon ami, ce sera lorsque couché dans la tombe, je ne pourrai plus entendre les témoignages d’une justice tardive... Et voilà les hommes de tous les temps !
CHAPELLE.
Je vous parle pour votre bien ; vous ne corrigez pas assez.
MOLIÈRE.
Apprenez de moi que les choses qui coûtent trop, sont ordinairement imparfaites.
CHAPELLE.
Oh ! si je voulais, moi...
MOLIÈRE.
Vous auriez tort ; votre vie libre et paresseuse vous tend heureux ; restez-en là : puis autre chose est, mon ami, de faire de jolis vers, ou d’imaginer on personnage, de soutenir un caractère.
CHAPELLE.
Je vous parle pour votre bien, consultez davantage ; qu’est-ce que cela coûte ? Je n’entends autour de moi, je ne vois, je ne lis, je ne rencontre que des gens qui vous reprochent des fautes.
MOLIÈRE, impatienté.
Eh ! ces gens-là n’en font même pas de ces fautes !... qu’ils parlent, qu’ils écrivent... Sachez que si j’écoutais tous les beaux avis que me donnent sans cesse les conseillers du Théâtre, prétendus juges, prétendus connaisseurs, il me faudrait recommencer toutes mes Pièces d’un bout à l’autre au moins sept à huit fois. Mais si je prête volontiers l’oreille à tout le monde, apprenez que je ne fais ensuite qu’à ma tête, et voilà pourquoi je réussis... Adieu.
Il sort brusquement.
Scène XV
CHAPELLE, seul
C’est bien-là un Auteur qui parle. On lui donne mille traits excellents, dont il ne profite seulement pas. Il faudrait se couper la gorge avec lui pour lui faire faire un chef-d’œuvre. Au fond, c’est un bon humain. Sa Comédie tombera infailliblement : j’en serais fâché ; mais cela le rendra moins entêté... Si ces diables d’hommes-là, quoiqu’on les aime, réussissaient toujours, il n’y aurait plus moyen de vivre avec eux.
ACTE III
Scène première
MOLIÈRE, seul
Je vais... je viens... Je ne sais plus ce que je dis... ni ce que je fais... Quoi ! après une si longue attente, ma Pièce ferait encore remise !... Oh ! je la ferai plutôt jouer les rôles à la main.
Scène II
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE.
Eh bien, mon ami, l’avez-vous emporté ?
LATHORILLIÈRE.
Oui, mais ce n’a pas été sans peines soyez tranquille.
MOLIÈRE, l’embrassant.
Que je me plais à vous devoir tout, mon cher Lathorillière !
LATHORILLIÈRE.
La mère est en courroux, la fille est affligée, mais elles feront leur devoir...
D’un ton embarrassé.
La Béjart exige seulement une chose...
MOLIÈRE.
Quoi ?
LATHORILLIÈRE, sur le même ton.
Que vous ne direz rien à sa fille... que vous la respecterez.
MOLIÈRE, avec surprise.
Eh ! qui longe, mon ami, à offenser cette aimable enfant ?
LATHORILLIÈRE.
Mais elle dit que vous voulez l’enlever dans une chaise de poste, après la Comédie.
MOLIÈRE.
Moi !
LATHORILLIÈRE.
Et que vous vous faires fort de la protection du Roi, pour l’épouser malgré sa mère.
MOLIÈRE.
Pouvez-vous seulement répéter cela, mon ami ? Mais... mais c’est un rêve !...
LATHORILLIÈRE, haussant les épaules.
Il fallait entendre la véhémente déclamation lancée contre vous... Vous ignorez néanmoins le dessous des cartes. J’ai interrogé votre servante ; elle m’a conté le tous bien naïvement... Le perfide Pirlon, en votre absence s’est introduit chez vous.
MOLIÈRE.
Pirlon ! ah ! je ne m’étonne plus de rien... Bon dieu ! venir corrompre jusqu’à ma pauvre servante, qui m’a demandé son congé... Ah, il faut...
LATHORILLIÈRE.
Cette bonne fille a fait d’elle-même de sages réflexions. Elle se repent beaucoup de sa faute, et vous supplie, par ma bouche, de vouloir bien la garder.
MOLIÈRE.
Qu’elle reste... c’est un fort bon sujet... Oh, l’hypocrite me le paiera...
Errant sur la scène comme un homme qui rêve.
Il me vient une bonne idée... oui, oui, plaisante... comique... neuve...
LATHORILLIÈRE, à part, et le regardant avec complaisance.
Sa tête travaille... Respectons le moment du génie.
MOLIÈRE, s’applaudissant.
C’est cela même... voilà ce qu’il me faut... et la Forest a bien assez d’esprit et d’adresse pour cela.
LATHORILLIÈRE.
Quel est donc votre dessein ?
MOLIÈRE.
Je veux avoir le chapeau de Pirlon et son manteau.
LATHORILLIÈRE.
Son manteau, son chapeau ?
MOLIÈRE.
Oui, ce large feutre, sous lequel il tourne son œil louche et faux... Cela sera excellent, en teignant un peu mes cheveux et mes moustaches, ne le voyez-vous pas d’ici copié trait pour trait ?
LATHORILLIÈRE.
Mais comment lui enlever son manteau de dessus ses épaules, et lui ôter ce feutre, qui semble cloué sur son chef ?
MOLIÈRE.
Il m’est venu un expédient, qui, je crois, réussira. Je vais trouver la Forest, et lui faire sa leçon. Les ruses de l’hypocrite lui sont connues... Elle fera de son mieux pour s’en venger.
Avec un signe expressif.
Ah ! mon ami, parlez à Isabelle... et calme-là ; échappe-t-on aux grâces ? en voulant arracher le trait, je n’ai fait que l’enfoncer plus avant. Je vous en prie, calmez cette aimable enfant.
Scène III
LATHORILLIÈRE, seul
Tout à l’amour, et tout à son génie. Arracher un grand homme au commerce des Muses, l’humilier aux pieds d’une Actrice enfant, tourner cette tête, qui donne des leçons à l’Univers, Amour, voilà ton plus beau triomphe !
Scène IV
LATHORILLIÈRE, LESBIN
LESBIN.
Monsieur, voici Monsieur le Comte et Monsieur le Marquis qui demandent après mon maître.
LATHORILLIÈRE.
Dis-leur que je tiens ici sa place.
À part.
Je vais ni sauver cette visite.
Scène V
LE MARQUIS DE ***, LE COMTE DE ***, LATHORILLIÈRE
LE MARQUIS, en entrant.
Où est l’Auteur ?
LE COMTE.
Où est Molière ?
LATHORILLIÈRE, les saluant profondément.
Messieurs, il sera bientôt de retour.
LE MARQUIS.
Mais pour avoir place, il n’y a plus d’autres moyens que de s’adresser à lui... Mon Coureur, qui est de fer, n’a jamais pu fendre la presse... Plus de loges... Je voudrais être cependant sur le théâtre, afin de ne rien perdre.
LE COMTE.
J’arrive du siège de Lille, je repars ce soir en poste ; je dois voir la pièce, afin de pouvoir en instruire la Cour : on fait que je n’en juge pas mal, et l’on attend là-bas ma décision.
LATHORILLIÈRE.
Messieurs, on fera l’impossible pour que vous soyez placés.
LE MARQUIS.
Ma foi, il est de l’intérêt de l’Auteur que nous y soyons ; vous m’entendez ?...
LE COMTE.
J’ai vu tomber tant de Pièces... et celles qui réussissent ne valent guère mieux.
LE MARQUIS.
Molière a du bon, mais il charge trop ses caractères ; il force la Nature, elle grimace sous ses pinceaux. Il plaît au Parterre. Ah ! je le crois ! Mais a-t-il notre suffrage, Comte, le suffrage par excellence, le suffrage des hommes de qualité ?
LATHORILLIÈRE.
Messieurs, Molière fait par expérience que les miniatures ne réussissent point au Théâtre. Ces traits délicats, affaiblis n’arrivent point jusqu’à l’âme des spectateurs. Pour les frapper, il faut des touches larges, à-peu-près semblables à celles des décorations, et le tout, à raison de l’optique.
LE MARQUIS.
Mais que n’étudie-t-il davantage les airs, le ton le langage des hommes de Cour ? il y trouverait des nuances fines, des délicatesses, un choix d’expressions, il aurait un tout autre style... Voilà ce que c’est que de ne point assez fréquenter le grand monde... La bonne compagnie lui fournirait des couleurs plus brillantes.
LATHORILLIÈRE.
La bonne compagnie du Poète comique, Messieurs, sont les originaux de toute espèce, et dans tous les rangs. Le plus grand nombre, il faut l’avouer, se trouve répandu dans le gros des Sociétés, où le mélange et la franchise des caractères leur donnent une physionomie vivante. C’est-là que les traits sont plus saillants, plus vrais, plus marqués, plus précieux à saisir ; et comme au spectacle on parle à la multitude, il faut qu’elle soit à portée de juger de la ressemblance, afin de pouvoir en rire facilement. Un ridicule particulier ne ferait pas généralement aperçu ; d’ailleurs, c’est une observation de Molière, que parmi les hommes, il y en a peu qui soient vraiment originaux.
LE COMTE.
Des originaux, ils fourmillent ; mais ils sont à la Cour, et non ailleurs ; là ils sont piquants, délicieux d’un ridicule décent... Vos Bourgeois, fastidieux personnages, sont aussi insupportables sur la scène que dans le monde... J’ai là des tablettes pleines d’observations : c’est pour Molière que je les réserve. Sur ma parole, il aura des Comédies à faire d’ici à trente ans, et d’un ton exquis... qu’il soit discret... entendez-vous ? je ne lui demande rien pour ce présent-là, pas même qu’il me nomme.
LATHORILLIÈRE.
Il vous aura une grande obligation, Monsieur le Comte, car il est toujours à l’affût d’un caractère naïf.
LE COMTE.
Du naïf... du noble ! morbleu, du noble ; dites lui de ma part, qu’il renonce aux Bourgeois, où je me brouille avec lui...
LE MARQUIS.
Vous avez raison, Comte ; qu’il ennoblisse ses pinceaux.
LE COMTE, répondant au Marquis.
Il n’est point dans le tourbillon, le cher homme.
LE MARQUIS.
Autant vaudrait pour lui vivre à la Chine... Il en saurait, ma foi, tout autant.
LE COMTE, d’un air important.
Molière ira-t-il à la postérité ?
LE MARQUIS.
J’en doute...
LE COMTE.
Comme il a souvent traduit plusieurs morceaux de Plaute et de Térence, il pourra vivre par ces endroits-là.
LE MARQUIS.
Je ne le crois pas, les modèles l’écraseront toujours. Il n’y a que les modèles qui subsistent... On ne lira pas Molière dans vingt-cinq ans.
LE COMTE.
Il ira un peu plus loin.
LE MARQUIS, affirmativement.
Il n’ira pas : j’ai là-dessus un tact... Si jamais un de nous déroge jusqu’à écrire, en se jouant le marin je vous garantis qu’il tracera seulement de mémoire des caractères, que nos Messieurs les Auteurs de Paris, avec leur vue courte ne soupçonnent même pas. Molière sera anéanti de manière qu’on n’en parlera plus. Il pourra rouler encore entre les mains de l’épaisse Bourgeoisie, qui aime la grosse gaieté ; mais il ne sa lira pas dans l’antichambre.
LATHORILLIÈRE.
En ce cas, le cœur humain aura donc bien changé.
Scène VI
LE MARQUIS, LE COMTE, CHAPELLE, LATHORILLIÈRE
LE MARQUIS, à Chapelle.
Arrivez, arrivez, vous qui êtes l’amide Molière, mais qui n’êtes point son adulateur, nous le savons... mettez-nous d’accord... Molière vivra-t-il dans la postérité ?
CHAPELLE.
Je distingue, Messieurs ; le bon y parviendra, le mauvais n’y parviendra point.
LE MARQUIS.
Mais qui l’emporte du bon ou du mauvais ?
CHAPELLE.
À vous dite vrai, je ne sais trop... S’il voulait m’écouter ; mais il est d’une obstination, dont on n’a point d’idées... C’est toutefois un bon homme, un peu triste, mais ayant un cœur excellent...
LE MARQUIS.
Tant-pis !... un Auteur conique devrait toujours avoir une pointe de malice. Quand nous nous mêlons de peindre nous autres, vous le savez, vous m’entendez ? C’est un caustique, qui laisse une empreinte ineffaçable... Il faut se pendre où s’exiler.
CHAPELLE.
Plaute est plus gai.
LE COMTE.
Térence plus sage.
LE MARQUIS.
Scarron plus plaisant.
LATHORILLIÈRE.
Ah ! Messieurs, Messieurs !... Scarron !... est-il possible ?... Parler de Scarron, lorsqu’il est question de Molière.
CHAPELLE.
Ah ! je prends le parti de mon ami. Lathorillière a raison de le récrier. De la justice, Messieurs, Molière vaut mieux que, Scarron... mais l’heure s’avance. Voulez-vous venir à la Comédie dans ma loge ? nous y seront ferrés, mais l’on s’arrange.
Scène VII
LATHORILLIÈRE, seul
Hé voilà donc les juges des œuvres du génie !
Scène VIII
LATHORILLIÈRE, LA FOREST
LA FOREST, arrivant avec précipitation.
Entrez, Monsieur, entrez dans cette chambre-là, vous écouterez. Il a machiné contre notre bon Maître ; mais j’allons lui jouer d’un tour...
LATHORILLIÈRE.
Bon, je te laisse.
LA FOREST, le faisant sortir par une porte opposée.
Entrez donc vite, pour qu’il ait liberté plénière. Ah, ah ! damné d’hypocrite, avec ton air pénitentieux, tu y viendras.
Scène IX
PIRLON, LA FOREST
LA FOREST.
Entrez, entrez tout de go, Monsieur Pirlon, il n’y a plus personne : j’allons fermer la porte... Elles sont allées toutes deux à la campagne, au lieu de jouer la Comédie.
PIRLON.
Les voilà dans la bonne route, ma chère enfant... Et Molière, où est-il ?
LA FOREST.
Un homme noir est venu demander après lui ; cela avait l’air d’un Huissier... La justice lui en veut.
PIRLON, à part.
Mon accusation a réussi, bon !
Haut.
Je vous l’avais bien dit qu’il ferait une mauvaise fin...Voilà se que l’on gagne à calomnier les gens de bien... la prison.
LA FOREST.
Puis notre congé est venu ; j’avions fait tout ce qu’il fallait pour cela : rien ne nous empêche à présent d’entrer dans cette sainte maison, où l’on gagne de si bons gages.
PIRLON.
Eh bien, à tantôt... tantôt... ma fille... Mon dieu ! je crains...
Il regarde à la porte.
LA FOREST, d’une voix haute.
Parlez haut, parlez, sans crainte... tout le monde est dehors, vous dis-je.
PIRLON, après s’être assis.
Tout le monde est dehors ?
LA FOREST.
Oui ; nous sommes tous deux seuls dans la maison.
PIRLON.
Seuls ? Asseyez-vous près de moi... prenez ce siège.
LA FOREST.
Oh ! cela ne nous appartient point, Monsieur.
PIRLON.
Obéissance, ma fille, obéissance ; c’est-là votre premier devoir... Approchez, approchez encore ; encore. Quelle chaleur il fait aujourd’hui !
Il s’essuie le front.
LA FOREST.
Mais pardi, ôtez votre chapeau.
Elle prend son chapeau, et l’attache à sa chaise.
Ah ! comme ça vous êtes mieux... on vous voit le front et les yeux... Si vous permettez que je vous le disions, vous ayez ma foi un front charmant, les cheveux bien plantés, très bien.
PIRLON.
Je ne les ai pas mal, il est vrai.
Riant.
J’ai donc meilleure mine comme cela ?
LA FOREST.
Sans comparaison, vraiment... vos yeux ne sont plus cachés... diantre, comme ils brillont vos yeux ! en vérité, si j’osons vous le dire, je ne voyons qu’à vous cet air de santé.
PIRLON.
Ceux qui vivent pieusement se portent toujours bien.
LA FOREST.
Cependant je vous trouvons un peu rouge ; qu’avez-vous ?
PIRLON.
Il fait une chaleur pour la saison...
LA FOREST, vivement.
Que n’ôtez-vous aussi ce lourd manteau de dessus vos épaules...
PIRLON, se défendant.
Non, non.
LA FOREST, lui arrachant le manteau.
Mais vous serez bien plus à votre aise : les hommes sont bien gauches, en vérité ; ils ne savent point s’arranger. Demandez-moi à quoi bon porter un manteau qui déguise une aussi belle taille ?... On ne la voyait pas là dessous... Laissez, laissez donc, M. Pirlons, vous êtes fait à peindre au moins !
PIRLON.
Ce n’est pas pour moi que je parle ; mais j’ai toujours remarqué que la vertu se plaisait à habiter les corps les moins imparfaits.
On entend frapper.
Mon Dieu. ! on frappe... Qu’est-ce ?
LA FOREST.
Ô ciel ! c’est Molière...
PIRLON.
Molière...
LA FOREST.
Il revient sur ses pas chercher quelque chose qu’il aura publié.
PIRLON.
Il n’est donc point en prison ?
LA FOREST.
Pas encore... Mais vous êtes un homme perdu, s’il vous rencontre ici, après tout ce que vous avez dit et fait contre lui ; songez, songez bien...
PIRLON.
Que je m’enfuie par l’autre escalier.
LA FOREST.
Ils l’ont fermé, je n’en avons pas la clef.
PIRLON, effrayé.
Où me fourrerai-je ?
LA FOREST.
Venez par ici, j’allons vous cacher quelque part.
PIRLON, errant sur la Scène.
De quel côté ?... Eh vite donc.
LA FOREST.
Venez par ici, par ici.
PIRLON.
Quoi ! dans ce bouge ?...
LA FOREST.
Allons vite, dépêchez.
PIRLON.
Et mon manteau, et mon chapeau ?
LA FOREST.
Vous n’en avez pas le temps... Je serrons tout cela dans le coffre... Entrez donc...
Elle le pousse.
PIRLON.
Que l’on ne voie rien de moi... car les méchants sont si à craindre !
Scène X
LATHORILLIÈRE, LA FOREST
LATHORILLIÈRE, entrant sur la scène, en riant.
Ah ! ah ! ah ! je n’aurais jamais cru que la Forest eût tant d’esprit.
LA FOREST, revenant sur la scène.
Reste-là, Cagot... tu as tendu le piège, et t’y voilà pris, comme le rat dans la ratière.
LATHORILLIÈRE.
Où l’as-tu mis ?
LA FOREST.
Nous l’avons enfermé sous l’escalier, révérence parles, tout au milieu du charbon... Ah ! ah ! ah !... il faudra qu’il s’y tienne tapi et tout courbé ; il ne sortira point sans notre permission, car voilà la clef, qui est dans notre poche... Voyez à présent le manteau et le chapeau du pèlerin.
Éclatant de rire.
Ah ! ah ! ah ! quel habillement, bon Dieu ! quelle tournure de chapeau !
LATHORILLIÈRE.
Te voilà avec les dépouilles de l’ennemi.
LA FOREST.
Aussi, je crions victoire... Pour tout l’or du monde, je ne voudrions pas qu’un autre eût l’honneur de les offrir en triomphe à notre bon maître. J’m’en vais les lui porter. Ah ! ah ! ah !
Scène XI
LATHORILLIÈRE, seul
Molière ne néglige rien pour la gloire de son art... Attentif à tous les détails, qui impriment la vérité et la vie, il ne dédaigne point ce que d’autres. rejetteraient avec orgueil...Que la France doit être fière de pouvoir le compter parmi ses enfants... La nature avare de grands hommes, semble l’être surtout d’un Poète comique.
Scène XII
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE, habillé en Tartuffe avec le manteau et le chapeau de Pirlon, la chevelure et les moustaches, semblables aux siennes.
Suis-je bien, à votre avis ?
LATHORILLIÈRE.
Oh la bonne figure !... Je défie à un Peintre de faire un portrait plus ressemblant ; c’est Pirlon en personne...
MOLIÈRE.
Qu’il reste enfermé ici, le fourbe, tandis que je vais produire sur la scène son âme, son langage hypocrite et jusqu’à ses vêtements. Ce chapeau a une physionomie !... On verra le portrait de l’homme tout entier... Voyez, mon ami, si ces Dames consentent à venir, et si cette toilette qui s’achève toujours, pourra finir enfin.
LATHORILLIÈRE.
Elles s’avancent vers nous : la colère étincelle dans les regards de la mère, et le tendre amour brille dans les yeux timides de la fille.
Scène XIII
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE, LA BÉJART, ISABELLE en habit de Théâtre
LA BÉJART.
J’irai au Théâtre Molière ; j’ai bien voulu ne consulter que l’intérêt général, mais si je m’aperçois d’un regard, tremblez ! La Comédie, je vous le jure, pourrait finir par une scène tragique.
MOLIÈRE, prenant le ton hypocrite.
Madame, puisque le Ciel vous a révélé cet amour qui me rend si coupable, j’avoue à vos pieds toute l’énormité de mon crime, il est épouvantable !... j’aurais dû commander à mon œil de ne point voit, à mon cœur de ne point sentir ; mais je dompterai cet ennemi invisible de mon salut, cet ennemi caché que je porte en mon sein...
LATHORILLIÈRE, à part.
Qu’il est plaisant !
LA BÉJART.
Tu n’auras pas de peine à soutenir le rôle d’Imposteur, lâche... Tu as écrit d’après ton cœur.
MOLIÈRE.
Je souffre patiemment les outrages que mes longs forfaits m’ont attirés ; il est juste que fois humilié.
LA BÉJART.
Tu n’as pas besoin de feindre, traître ! Tu représentes au naturel.
MOLIÈRE.
Que le ciel miséricordieux vous pardonne vos injures.
LA BÉJART.
Et qu’il te punisse...
MOLIÈRE.
J’allume votre colère, je vous fais pécher... Je me retire, Madame ; que le ciel vous fasse paix.
Scène XIV
LA BÉJART, LATHORILLIÈRE, ISABELLE
LATHORILLIÈRE.
Il se moque de vous, et voilà tout ce que vous y gagnez.
LA BÉJART.
J’aurai mon tour ; il ne me connaît pas encore : il saura si l’on brave impunément une femme irritée.
À sa fille d’un air menaçant.
C’est toi, fille ingrate et dissimulée, qui...
LATHORILLIÈRE, l’arrêtant.
Ah ! je voudrais que vous vous vissiez, comme je vous vois, émue, hors d’haleine, livrée à la fureur... Et comment pourrez-vous jouer le rôle d’une femme douce, modérée, raisonnable, tranquille ? de grâce calmez-vous.
LA BÉJART.
Maudit métier, qui m’oblige à montrer un visage serein, quand la colère, me suffoque... Ah ! quel supplice !... Mais j’ai laissé mon rôle sur la table.
LATHORILLIÈRE, poliment.
Je vais...
LA BÉJART.
Non, vous ne le trouveriez pas... Restez avec ma fille ; je reviens.
Scène XV
LATHORILLIÈRE, ISABELLE
LATHORILLIÈRE.
Laissez passer le ressentiment de votre mère. Sa colère s’apaisera ; je la connais, elle vous aime, et vous serez l’épouse de Molière...
ISABELLE.
Les mauvais traitements que sa jalousie lui inspire ; deviennent plus durs de jour en jour ; elle est vraiment cruelle à mon égard, elle me poussera au désespoir. Je voudrais pouvoir ne point aimer, en éprouvant tout ce que j’éprouve.
Tirant un mouchoir.
Quand cesser à donc la triste gêné, où se consume ma vie ?
Scène XVI
ISABELLE, MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE, revenant sur la pointe du pied.
Vous pleurez, adorable Isabelle, ah ! séchez vos larmes... Soyez persuadée que je ne songe qu’aux moyens de terminer votre esclavage, et de commencer mon bonheur.
ISABELLE.
Dites le nôtre... Mais les jours les plus malheureux se succèdent avec une lenteur désespérante, et les jours fortunés n’arrivent point.
MOLIÈRE.
Unique et cher objet de ma tendresse, souffrez encore avec courage, seulement, jusqu’au retour du Roi ; et je vous jure qu’alors nous serons unis.
ISABELLE.
Le Roi sera-t-il bientôt ici ?
MOLIÈRE.
Dans un mois au plus tard...
ISABELLE.
Ah Molière ! vous n’imaginez pas ce que c’est que de vivre sous l’empire d’une mère jalouse !
LATHORILLIÈRE.
La voici... Séparez-vous, et affectez la plus froide indifférence.
Scène XVII
ISABELLE, MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE, LA BÉJART
MOLIÈRE, présentant la main à la Béjart d’une matière polie et ferme.
Allons, Madame, en haïssant l’Auteur, ne punissez point le Public. Si votre jeu allait se ralentir, il s’en apercevrait ; consultez votre gloire, que je crois inséparable de la mienne. Allons.
La Béjart lui donne la main sans répondre.
Scène XVIII
LATHORILLIÈRE, seul
Fasse le Ciel que ces femmes ne gâtent point, par leur discorde, l’éclat d’une représentation, qui intéresse, à la fois, le Spectateur et la recette de la Comédie.
ACTE IV
Scène première
LA FOREST, seule
Je vais, je viens, je monte, je descends, sans savoir, ce que j’ faisons... La tête me tourne. Oh ! si cela dure, je deviendrons folle.
Scène II
LA FOREST, LESBIN
Lesbin tient le manteau et le chapeau de Pirlon.
LA FOREST.
Te voilà... On sort donc de la Comédie ?
LESBIN.
Oui.
LA FOREST, avec impatience.
Oui !... mais voyez le nigaud : hé bien, parle-nous donc, afin de nous tirer d’inquiétude, car nous ne sommes point tranquille depuis deux heures... La-pièce a-t-elle été comme il faut ?...
LESBIN.
Non, non, non pas comme il faut.
LA FOREST.
Comment non ? cela me fait une peine...
LESBIN.
Eh ! ce n’est pas cela... Cela s’appelle tout autrement... Attends ; ah, j’y suis ; elle n’a pas été comme il faut ; non, je le sais bien, moi. Il disont qu’elle a été dans les nues ; m’y voilà...
LA FOREST.
Eh bien, pécore, c’est-là réussir... Tu m’as fait une frayeur.
LESBIN.
C’est-là réussir ! Que ne disais-tu ?... Ah ! oui.
LA FOREST.
On a beaucoup applaudi ?
LESBIN.
Beaucoup ; c’était à chaque mot des battements de mains, dont la salle était toute ébranlée.
LA FOREST.
Notre pauvre Maître, une fois en la vie, il sera donc bien content...
LESBIN, joyeux.
J’étais présent-là, moi, car tiens, je mouchais bravement les chandelles... Je n’ai jamais vu tant de monde dans la salle. Collé contre une des coulisses de-là je voyais tout, fort étouffé, mais n’importe ; y avait des gens huppés qui auraient voulu ma place, et qui pestaient tout leur saoul à la porte... Oh ! quel plaisir de voir aller les mains, et d’entendre rouler les applaudissements... Ils ont redoublé comme un tonnerre, tout à la fin de la Comédie, et comme pour faire la part à l’Auteur. C’était un bruit à rendre sourd, et j’en suis encore tout étourdi.
LA FOREST.
Et le manteau et le chapeau ?
LESBIN.
Ils ont fait merveille. Le Public n’a pas tardé à reconnaître Pirlon. Notre Maître le représentait si naïvement qu’on le nommait tout haut. Si tu avais vu comme et il invitait son air hypocrite, son col tors, le roulement de ses yeux, la voix, son geste, les manières cafardes : c’était lui tout craché... Le Public riait mais en même temps était indigné, et plusieurs même se sont écriés à différentes reprises : Ah ! le maudit Tartuffe ! ah, le coquin, le coquin !
LA FOREST.
D’entendre cela, ça nous rafraîchit le sang... Quand nôtre Maître réussit, il est alors si gracieux, si plaisant... mais quand les Comédies ne vont pas à la guise, il est chagrin, inquiet, rêveur ; il boude, et fait grande peine à voir : alors je devenons triste comme lui, car il est si bon Maître !... En passant, il prend toujours l’occasion de nous dire, à propos de rien, quelque chose de divertissant pour nous faire rire ; et il ne rit pas lui... Mais que fera-t-on de cette friperie ?
LESBIN.
Mon Maître, à son retour, ne veut pas voir la face de Pirlon... Rends-lui son chapeau, son manteau et que le diable qui l’a fait, l’emporte, s’il en a le courage.
LA FOREST.
Que ne garde-t-il ces plaisantes nippes, qui ont si bien fait leur effet ?
LESBIN.
Il en achètera demain de toutes pareilles... Va, va, la race de ces gueux-là ne manque pas.
LA FOREST.
Sors... J’allons tirer ce vieux reître de la prison.
LESBIN.
Moi, je vais me cacher sous la tenture de la porte, et en le voyant passer, je croirai voir encore la Comédie... Oh ! s’il était à ma discrétion !...
LA FOREST.
Laisse faire cela à notre Maître ; il a le fouet en main, lui.
LESBIN.
Pardi tu as raison ; quelqu’un disait qu’il l’avait bien fustigé, sans lui écorcher la peau.
Il se cache.
Scène III
LA FOREST, PIRLON
PIRLON, entrant le dos courbé.
Miséricorde ! ouf... Je n’en pois plus... J’ai les os brisés, disloqués ; je ne pourrai me relever de six semaines... Me tenir deux heures d’horloge dans un misérable bouge, où j’étais forcé d’avoir le dos tout courbé... Ahi, ahi, ahi !...
LA FOREST.
Dame, c’est que nous n’avons pas pu vous délivrer qu’après la fin de la Comédie.
PIRLON.
Comment, comment ! après la Comédie ! Expliquez-vous... On aurait joué l’Imposteur ?
LA FOREST.
Tout en plein ; et on le jouera encore demain, après demain, et encore l’autre après-demain, jusqu’à ce que le Public dise, assez.
PIRLON.
La pièce aurait réussi ?
LA FOREST.
Mieux que cela, elle a été dans les rues.
PIRLON.
Ô ciel ! quoi ! on a représenté l’Imposteur, avant que j’eusse rassemblé ma cabale, on a représenté l’Imposteur, et je n’y étais pas !
LA FOREST.
Si fait bien, vous y étiez... votre chapeau, votre manteau ont fait une peinture parlante. Tout le monde criait, c’est Pirlon, c’est Pirlon.
PIRLON.
On m’a joué ! Tout est perdu, tout est bouleversé dans l’État ; il n’y a plus ni mœurs, ni lois, ni décence ni Religion... Scélérat de Molière ! va, va, nous nous réunirons aux Médecins, et nous nous vengerons de toi et des tiens !
LA FOREST.
Tenez, prenez vos nippes : peste, Monsieur l’enjôleur, comme vous êtes dangereux avec votre raille bien faite.
PIRLON, furieux.
Je sors, car je n’étranglerais.
LA FOREST, les poings fermés.
Vous !...
PIRLON.
Je reconnais ton sexe maudit ; mais tu verras ce qui revient à qui ose se jouer à nous.
LA FOREST, prend un balai et le chasse.
Attends, attend.
Pirlon se fauve ; elle éclate de rire.
Ah, ah, ah !...
Scène IV
LESBIN, LA FOREST
LESBIN, éclatant de rire.
Bon ! il était grotesque à voir... Il écumait de rage : cela m’a fort diverti...
LA FOREST.
Tu ne sais pas toutes ses méchancetés : il a voulut me débaucher de cette maison.
LESBIN.
Ah le monstre !... En ! que ne m’as-tu dit cela plutôt ?... je l’aurais assommé sur la place.
LA FOREST.
Va, il y a encore d’honnêtes gens dans le monde. Lathorillière nous à découvert tout son artifice ; et sans lui, vois-tu, je faisions la sottise.
LESBIN.
Quoi tu nous aurais quittés !... Oh ! il faut, te dis-je, que je l’assomme... Mais ne voilà-t-il pas qu’il revient ?
Scène V
PIRLON, LA FOREST, LESBIN
PIRLON, suppliant.
Au nom de Dieu, la Forest, accordez-moi, de grâce, la permission de rentrer dans mon étroite et obscure prison... que je m’y réfugie.
LA FOREST.
Eh ! que vous est-il donc arrivé ?
PIRLON.
L’impiété triomphe. L’irréligion a passé jusques dans le cœur de la populace. On insulte les gens de bien avec scandale... Ô siècle ! ô temps ! ô mœurs !
LA FOREST.
Ah, ah ! je croyons deviner : on s’est moqué de vous ?
PIRLON.
Ils sont là-bas... une foule de libertins... Ils viennent sans doute pour féliciter le coupable auteur... À peine ai-je paru qu’ils se sont écriés, en faisant un chorus de ris indécents : le voilà, le voilà ; et l’on m’a poursuivi avec des huées... Les impies !
LA FOREST.
Eh bien, Monsieur, Pirlon, que voulez-vous que j’y fassions ? Est-ce que je pouvons rendre le sérieux de tout un Peuple qui veut rire ? il a ses raisons sans doute.
PIRLON, les mains jointes.
Honnête, douce, belle et bonne la Forest, laissez-moi me renfoncer plus avant dans ce misérable bouge : j’irais me cacher jusqu’au centre de la terre.
LA FOREST.
Est-ce qu’un homme comme vous doit rougir de l’insulte des méchants... Il faut être brave avec la conscience.
PIRLON.
La Forest, voilà ma bourse.
LA FOREST.
Fi donc !... Nous ne voulons point tant seulement la regarder... À propos, tenez, reprenez votre bague et votre étui.
PIRLON, reprenant la bague et l’étui.
Mes amis.
LESBIN, fièrement.
Nous ne sommes point de vos amis... Rayez cela de vos papiers.
PIRLON.
De grâce, cachez-moi, autrement cette foule me lapiderait. Je sortirai quand les lumières seront éteintes, et que tout le monde dormira... Vous me sauverez la vie ; et cette bonne action, qui vous fera comptée, ne vous coûtera pas beaucoup.
LA FOREST.
Vous nous faites pitié, tout méchant que vous êtes.
PIRLON.
Soit... Mais hâtez-vous de me tirer d’embarras... j’ai une peur, car la populace un fois en train, est si méchante.
LA FOREST.
Tenez, entrez dans cette chambre : on ne s’y tient jamais le soir. Quand il ne fera plus jour, vous partirez, pour ne plus revenir, bien entendu.
La Forest le fait entrer dans la chambre voisine.
PIRLON, entrant dans la chambre.
Ne me trahissez pas, et le ciel vous bénira...
Scène VI
LESBIN, LA FOREST
LESBIN.
Toujours le ciel, le ciel ! Il ne peut pas dire un mot sans faire intervenir le ciel. Pardi le ciel s’embarrasse bien d’un pareil homme... Il ne mérite guères ce que tu as fait pour lui ; mais tu es si bonne.
LA FOREST.
Que veux-tu ? je ne pouvons entendre quelqu’un se plaindre, sans nous sentir la de l’attendrissement.
LESBIN.
Au reste, tu as bien fait. La charité, dit-on, est toujours bonne ; n’importe envers qui.
LA FOREST.
Chut, chut, voilà nos deux Dames.
Scène VII
LESBIN, LA FOREST, LA BÉJART, ISABELLE
LA BÉJART, donnant son mantelet et les gants.
Prenez cela et sortez.
Lesbin et la Forest sortent.
Scène VIII
LA BÉJART, ISABELLE
LA BÉJART.
Tu crois donc échapper à mes regards, fille dissimulée ; tu te trompes. Je devine tes moindres mouvements, malgré la feinte que tu t’imposes. Je t’ai vu exprimer l’amour que tu as pour lui : tu faisais parler des yeux que tu croyais indifférents ; l’accent de ta voix change, dès qu’il approche.
ISABELLE.
On interprète tout à mal dans une fille, tandis que l’on ne trouve rien d’indécent dans tout ce que fait une femme. Il me faut bien exprimer le sens de mes rôles... Si j’étais mariée, on ne me ferait point ces reproches injustes et toujours déplacés.
LA BÉJART.
Il ne tient qu’à toi d’avoir un époux. Choisis l’honnête Lathorillière : voilà l’homme qu’il se faut ; à coup-sûr il te rendra heureuse.
ISABELLE.
Je ne sais si Lathorillière a pensé à moi ; mais, s’il faut le dire, jamais je n’ai pensé à lui...
LA BÉJART.
Toujours rebelle à ce que je désire ! Tu résistes à ma juste autorité ; hé, comment veux-tu recouvrer ma tendresse ?... Désobéis encore pour mériter ma haine.
ISABELLE.
Eh, puis-je vous obéir ?... Non, cela n’est plus en mon pouvoir... Quel sujet vous ai-je donné de me haïr ? Vous m’aimiez autrefois ?
LA BÉJART.
Qui, je t’aimais ; mais tu as payé mes plus tendres soins Par la plus noire ingratitude... Retire-toi dans ta chambre, et sauve-moi la peine que me cause ta vue.
ISABELLE, à part, en sortant.
Il me faut tout souffrir d’elle... Mais une fois l’épouse de Molière, je serai à l’abri de les duretés.
Scène IX
LA BÉJART, seule
Je veux parler à Molière, le faire expliquer, l’obliger à renoncer à ma fille, ou de ce pas, je m’engage avec elle pour la Province... Il a l’orgueil d’un Auteur ; mais il apprendra à ses dépens, que c’est notre jeu qui fait tout le prix de ses ouvrages...
Scène X
MOLIÈRE, L A BÉJART
MOLIÈRE, arrivant à pas lents, et d’un air content et recueilli.
Ah, Madame ! que de charmes dans le succès ! de quel poids je suis soulagé ! Heureux travaux, moments délectables ! On ne regrette point ses veilles, quand elles sont ainsi payées. L’amour de la gloire, malgré ses amertumes, a donc enfin ses douceurs.
LA BÉJART.
Molière, il est temps de parler... Expliquez-vous...
MOLIÈRE.
Ah, Madame ! laissez-moi jouir en paix de ce moment, et ne le troublez point ; je goûte si rarement la joie dont mon âme s’enivre. Je pardonne à tous, mes ennemis, et mon triomphe en devient plus doux. La critique se tait pour cette fois devant l’approbation universelle. La patience est donc aussi nécessaire que les travaux pour jouir du fruit de nos veilles, et il faut savoir attendre le jour de la justice, car le Public est juste enfin. Il est donc aussi un point de maturité où le suffrage public malgré les cris des envieux, ne saurait nous échapper ; il faut donc savoir attendre, et se bien persuader que la gloire est un beau fruit, qui ne se cueille et ne se détache du rameau, que dans l’automne de notre vie.
LA BÉJART.
Je partage votre joie, Molière, car mon cœur n’est pas froid et indifférent comme le vôtre ; vous ne prisez que l’avantage de la renommée : mais me serait-il permis de parler à cœur ouvert, non pour troubler votre triomphe, mais pour apprendre enfin quelles sont vos vues...Vous m’entendez ?... Il est temps de s’expliquer.
MOLIÈRE.
Eh bien, Madame, nous ayons vécu dix années dans la confiance de la plus pure amitié. Notre état, nos goûts nous réunissaient, et nos intérêts confondus furent les mêmes... Votre fille parvient à l’âge de la beauté ; tout à-coup la jalousie s’empare de votre âme ; vous la traitez inhumainement ; vous vous rendez malheureuse en la tourmentant, vous qui, étrangère à de tels sentiments, devriez plutôt affurer, confirmer le bonheur qu’elle mérite...
LA BÉJART.
J’entends ; c’est parler sans contrainte ; mais pourquoi ce déguisement dans votre amour ? vous sentiez donc que c’était-là une trahison ?
MOLIÈRE.
Qui n’a rien promis, ne saurait trahir.
LA BÉJART.
Molière, je ne ferai point avec vous assaut de vaines paroles : je quitte votre théâtre, qui me devient odieux, et dès demain j’emmène ma fille avec moi ; je l’emmène vous dis je, et pour jamais.
MOLIÈRE, avec force.
Contre la volonté, Madame !... contre son engagement... Elle doit rester ; elle restera... c’est moi qui vous l’assure.
LA BÉJART.
La retenir ! je lui donnerai plutôt la mort...
MOLIÈRE.
Comment, la mort ! quelles folles menaces ! Que signifie ce ton despotique ? La patience m’échappe à la fin. Une mère tendre mérite l’obéissance et la soumission de sa fille. Une mère furieuse et emportée détruit elle-même son autorité, surtout lorsqu’elle s’oppose au choix légitime de son enfant par un intérêt qu’il me répugne ici de développer. Une fille en âge de raison a droit de choisir l’époux qui lui convient : c’est un privilège que le ciel, la nature et les lois lui accordent également. Vous pouvez vous opposer au dérèglement de votre fille, mais non venir traverser son bonheur. Respectez les lois qui assurent à chacun sa tranquillité ; respectez le Monarque qui veille à leur exécution ; craignez que je n’aille implorer sa justice, lui porter mes plaintes... J’ai le cœur de votre fille ; soyez sure que j’aurai sa main.
LA BÉJART.
Molière, je vous ferai connaître qu’elle m’appartiendra dans tous les temps, et que j’aurai seule le droit de disposer d’elle.
Scène XI
MOLIÈRE, seul
Eh quoi ! pas un moment de tranquillité ! toutes mes jouissances seront troublées par les clameurs d’une femme impérieuse ! Je tremble que la colère ne s’étende sur l’innocente Isabelle... Elle a déjà tant à souffrir... Ah ! c’est à moi de la délivrer de tout ce qu’elle en dure... Mais qui peut au monde racheter une seule de ses larmes ?
Scène XII
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
LATHORILLIÈRE.
Toutes les places retentissent de votre nouveau succès, votre nom vole de bouche en bouche jusqu’aux extrémités de la Ville...
MOLIÈRE.
Quelle femme !... quel démon !... Bonsoir, mon cher Lathorillière... bonsoir... Comment le conjurer ?
LATHORILLIÈRE.
Qu’avez-vous donc ? je vous parle de votre triomphe, et vous n’écoutez pas ?
MOLIÈRE.
Pardon, mon ami... mais la Béjart...
LATHORILLIÈRE.
Quoi, la Béjart encore !... Vous êtes faible à ce point !... Vous ne savez pas en imposer à cette femme ?
MOLIÈRE.
Allons, oublions... La cruelle mère !... Vous dites donc, mon cher ami, que le succès est complet ?
LATHORILLIÈRE.
Oui, on repère déjà plusieurs de vos vers, qui sont devenus proverbes en naissant.
MOLIÈRE.
Elle la fera mourir de chagrin !... Entendez-vous quelques critiques ?
LATHORILLIÈRE.
Aucune. Les détracteurs sont muets ; on ne balbutie que des sottises, que personne n’écoute, et que l’envie elle-même méprise.
MOLIÈRE.
Il faudra que je prenne un parti !... On est donc généralement content ?
LATHORILLIÈRE.
Au-delà de ce que je puis vous exprimer.
MOLIÈRE, frappant du pied.
C’est un diable !... Voilà la première fois que cela m’arrive, mon cher ami ; j’ai toujours fait les mêmes efforts, en conscience, mais je n’ai pas toujours eu la même victoire... Ah ! ma chère Isabelle !
LATHORILLIÈRE.
Il n’y a qu’une seule voix ; et c’est le cri de l’admiration.
MOLIÈRE.
Elle pleure à présent !... qui peut au monde racheter une seule de ses larmes ? Un si beau jour ne peut me rendre heureux.
LATHORILLIÈRE, attendri.
Je le vois trop, hélas !
MOLIÈRE.
Je tremble pour elle... Permettez que je vous quitte.
LATHORILLIÈRE, d’un ton pénétré.
Est-il possible !... vous si faible !...
MOLIÈRE, se jetant dans ses bras.
Ah, mon ami !
En se relevant.
je vais appeler... La Forest, la Forest...
Scène XIII
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE, LA FOREST
LA FOREST.
Monsieur, qu’ordonnez-vous ?
MOLIÈRE.
Ma chère fille, que fait Isabelle ?
LA FOREST.
La pauvre enfant est allée s’enfermer dans la chambre, pour obéir à sa mère...
MOLIÈRE.
Elle l’a maltraitée ?...
LA FOREST, pleurant à moitié.
Oh ! pour cela oui, Monsieur... beaucoup.
MOLIÈRE, ému.
Vous l’entendez ? il faut que j’implore le Roi... Est-elle au lit ?
LA FOREST.
Oui, Monsieur ; nous l’avons déshabillée : elle pleurait en vous nommant tout bas.
MOLIÈRE, avec transport.
Elle pleurait !... Oh ! je vais prendre la poste ! Des chevaux...des chevaux... je n’y peux plus tenir... Que fait la Béjart ?
LA FOREST.
Elle veut se coucher sans souper, par dépit.
MOLIÈRE.
Oh ! elle se couperait un doigt, pour faire une égratignure à sa fille... Qu’elle laisse là mes Comédies et mon Théâtre, et qu’elle ne persécute plus mon Isabelle... Que m’importe après tout, ma gloire et mon Théâtre, s’ils servent à rendre infortunée cette pauvre enfant ?...
La Forest sort.
Scène XIV
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE.
Puissé-je, demain à son réveil, la consoler des rigueurs qu’elle éprouve, et effacer dans son cœur les moindres traces du chagrin.
LATHORILLIÈRE, soupirant.
Est-il possible que cet homme célèbre, né pour des travaux illustres, fait pour occuper toutes les bouches de la renommée, s’abandonne, comme un homme vulgaire, aux soins minutieux qu’entraîne une passion amoureuse.
MOLIÈRE, vivement.
Mon ami, la gloire est pour l’imagination, et non pour le cœur : je veux un sentiment qui remplisse le mien, j’en ai besoin. Hé ! pourquoi serais-je ennemi de l’amour, et rebelle à la plus douce loi de la Nature !... Oui, je me choisirai pour la vie une douce compagne qui me consolera dans mes revers, qui me soutiendra dans mes travaux... Quand la critique amère ou injuste s’acharnera contre moi, un sourire de sa bouche me rendra la gaieté. La gloire est belle, mais elle altère et ne rafraîchit point. Oui, je veux un sentiment qui remplisse le mien, j’en ai besoin. Eh ! pourquoi ne pas mélanger l’étude du commerce des grâces ? Je crois devoir aux hommages que j’ai rendus à la beauté, les traits les plus délicats et les plus profonds qui se trouvent dans mes ouvrages.
LATHORILLIÈRE.
Je vous admire et je vous plains.
Scène XV
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE, LESBIN
LESBIN, entre, portant deux flambeaux.
Monsieur, voilà M. Chapelle ; M. le Marquis et M. le Comte.
LATHORILLIÈRE.
Ils vont encore étaler ici leurs grands airs, car la présomption est toute la richesse des fats. Ils sont dénigrants par ton, ou louangeurs par forme de protection.
MOLIÈRE.
Qu’est-ce que cela fait, mon ami ? il faut tout écouter dans la vie... S’ils parlent nous les jugerons. On est obligé dans ce monde de capituler avec l’ignorance et la sottise, comme avec un ennemi supérieur en nombre.
Scène XVI
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE, LESBIN, CHAPELLE, LE MARQUIS, LE COMTE
LE MARQUIS, étendant les bras.
Que je vous embrasse, homme admirable ! ma foi vous avez surpassé mes espérances. Je n’attendais pas cela de vous, je l’avouerai...Vous, un auteur unique, un homme à part... Je veux que tout Paris retentisse de votre éloge.
À part.
Il est heureux ; il faut s’attacher à lui.
MOLIÈRE.
Monsieur, je suis très reconnaissant...
LE COMTE.
Eh ! quel style ! mon ami, que de force et de vérité dans le pinceau ! Quelle chaleur ! quel dialogue !... Que quelqu’un s’avise de vous critiquer, il aura affaire à moi.
À part.
Flattons-le : qu’est-ce que cela coûte ?
MOLIÈRE.
Monsieur, vous êtes trop bon.
LE MARQUIS.
C’est qu’il y a dans cette Pièce des traits inimitables.
CHAPELLE, à part.
Ils ne sentent pas ce qu’ils disent ; c’est pure forfanterie.
LE MARQUIS.
On n’a jamais dessiné un caractère de cette vigueur-là... Oh ! les cagots ne s’en relèveront pas ; ils sont diffamés pour trois siècles...
MOLIÈRE.
Vous me confondez...
LE COMTE.
Je n’ai jamais vu de Comédie qui m’ait fait autant de plaisir. J’ai ri, j’ai frémi... aussi n’étais-je pas des derniers à applaudir.
MOLIÈRE.
On ne saurait être plus obligeant, Messieurs.
CHAPELLE, à part.
Les ignorants, suivent toujours à la file d’un succès ; ils n’ont point d’avis à eux.
LE MARQUIS.
Je n’ai point perdu une seule parole ; il n’y en a pas une qui ne soit un coup de burin profond.
MOLIÈRE.
Ah ! Monsieur, épargnez-moi...
LE COMTE.
L’Acteur n’a pas fait un geste que je n’aie saisi. Ce n’est plus une Comédie ; c’est un tableau d’une vérité qui fait peur.
MOLIÈRE.
Arrêtez... vous me donneriez de l’orgueil.
LE MARQUIS.
Mais c’est qu’il n’est pas plus en moi d’étouffer le sentiment d’admiration que j’ai pour les belles choses, que de triompher de l’antipathie excessive que j’ai pout les mauvaises.
CHAPELLE.
Mais, Monsieur le Marquis, vous avez voulu prendre place sur le Théâtre, au lieu d’accepter ma loge, et mon Valet m’a dit que vous n’aviez pu trouver une banquette ; il vous a rencontré dehors comme on jouait la Pièce.
LE MARQUIS.
Oui, j’ai pris un peu l’air un instant : c’est assez me coutume, quand il y à cinq actes... J’ai trouvé dans les foyers le Comte qui lutinait cette petite Danseuse...
LE COMTE.
Je suis rentré l’instant d’après... on en était au plus bel endroit ; l’Exempt paraissait, De par le Roi... Beau moment ! Situation frappante ! Le rôle de l’Exempt est supérieurement fait ; ce morceau est admirablement écrit... les rimes riches, heureuses, sonores, faciles, étonnantes.
Remettez-vous, Monsieur, d’une alarme aussi chaude,
Vous vivons sous un Prince ennemi de la fraude,
Je les citerai au Roi, ces vers-là.
CHAPELLE.
Voilà ce que vous trouvez de plus beau, Messieurs.
MOLIÈRE, à Chapelle.
Je vois... L’un a entendu la Pièce au foyer, et l’autre dans la rue.
CHAPELLE, bas à Molière.
Et puis fiez-vous aux éloges !
LE MARQUIS.
Je parlerai de vous au coucher du Roi, infailliblement, et je ferai l’analyse de la Pièce, de manière qu’il n’y aura qu’une voix sur son compte.
LE COMTE.
Je veux que tout le monde, et jusqu’au satyrique Boileau, si je le rencontre, vous rendent la justice qui vous est due... Il bataille toujours contre tout ce qui n’est pas d’Homère, ou de son ami Racine... Mais nous nous verrons.
LE MARQUIS.
Je reste ici à dessein, et pour voir si l’on ne viendrait pas vous faire quelques insidieuses critiques.
LE COMTE.
Parbleu, je serais curieux d’entendre les objections que la chicane pourrait inventer... Je ne saurais moi-même en imaginer une seule ; et plus j’y rêve, moins je vois de prise pour tous nos Aboyeurs.
MOLIÈRE.
Vous me ferez donc l’honneur, Messieurs, de souper chez moi : vous savez que Molière n’est pas riche ; vous ne serez pas magnifiquement traités, mais...
LE MARQUIS.
Volontiers, mon cher Molière... Nous passerons la soirée avec vous... Prenez vos tablettes. Je veux vous parler d’un certain fat, qu’il faut mettre absolument sur la scène ; il croit être habile à prononcer ; il pense que chacun doit adopter son ton, ses manières, ses jugements, il regarde en pitié tout ce qui n’a point son approbation, et le trait excellent, c’est qu’il n’approuve rien au monde que la personne.
LE COMTE.
Je connais un autre original bien plus plaisant, mais par un côté tout contraire... C’est un homme qui varie du matin au soir, qui change d’idées selon le vent, qui ne sait ni ce qu’il doit louer, ni ce qu’il doit blâmer, qui parle de tout au hasard, et qui a la folle prétention de s’imaginer influer sur la renommée d’autrui, et même sur l’opinion publique... Concevez-vous une pareille bizarrerie ?... Prenez, prenez vos tablettes.
MOLIÈRE, les tirant de sa poche.
Elles sont déjà bien garnies, Messieurs.
LE COMTE.
Notez ceci de préférence, vous dis-je... Vous avez le coup d’œil juste ; vous ferez le pendant de votre Pièce... Vous entrez déjà dans l’inspiration sur ce sujet, n’est-il pas vrai ?
MOLIÈRE, d’un ton légèrement ironique.
Oui, oui, Messieurs... je vois du bon comique, du bon comique, en vérité.
LE MARQUIS.
Laissons-le, Comte : ne troublons point le premier jet ; c’est le moment créateur.
À Molière.
Allez, Molière allez ; nous vous fournirons d’excellents sujets de comédie, et tout aussi caractérisés qu’il vous les faudra.
MOLIÈRE.
Par tout ce que je viens d’entendre, je n’en doute point, Messieurs, je n’en doute point assurément.
LE COMTE.
N’allez point négliger ce que je vous ai donné ; songez-y. Je vous verrai souvent, pour suivre votre travail...
Ils sortent.
CHAPELLE, bas à Molière.
Je ne les quitte pas ; je veux me divertir de leur impertinence... Ils sont curieux en vérité.
Scène XVII
MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE
MOLIÈRE.
Et voilà les têtes que je redoute si fort, pour qui je veille, je corrige, j’efface... Mais que nous sommes sots !
LATHORILLIÈRE.
Comment pouvez-vous aussi faire accueil à des fats, qui vous volent votre temps, et vous excédent de tels propos ?
MOLIÈRE.
Ils me servent à les peindre ; d’ailleurs, il faut avoir des amis partout... On a déjà allez d’ennemis, qu’on ne s’est point faits, et qui vous en veulent sans savoir pourquoi. Ils vont à la Cour, parlent, décident, sont répétés par des femmes que d’autres répètent à l’infini ; avec une pointe, un mauvais bon mot, ils vous débusquent un Ouvrage ; il faut ensuite dix ans pour en revenir... Vous êtes jeune, mon ami, instruisez-vous. On doit ménager toutes sortes de personnes. Sans doute, il y aurait de la vanité, et une vanité misérable à vouloir se faire prôner, mais il n’y a que de la prudence à empêcher qu’on ne dise du mal de nous : cela vient assez tôt sans aller au-devant. Feindre pour tromper est une infamie, mais on peut dissimuler honnêtement son avis, surtout dans les disputes littéraires, afin de ne point blesser trop vivement des ridicules, qui s’irritent par la contradiction, et qui ne se corrigent pas, quand l’amour propre est une fois offensé : il ne m’est permis de les combattre qu’au Théâtre. Dans la société, il faut du liant dans l’esprit et dans le caractère, et ne point faire de la Littérature une arène de Gladiateurs, lorsqu’il ne s’agit au fond que de prose et de vers... Adieu, mon ami ; ne tardez point à les rejoindre... Vous souperez avec nous ?...
Scène XVIII
LATHORILLIÈRE, seul
Quelle connaissance des hommes ! Il la doit à la philosophie ; chaque jour je l’admire davantage, et cependant je le vois de bien près.
ACTE V
Le Théâtre représente le cabinet de Molière.
Scène première
MOLIÈRE, seul, assis devant une table
Tandis qu’ils disputent sur des matières odieuses mille fois rebattues, mettons à profit les instants... Il me faudrait des jours de soixante-douze heures, pour tout ce que j’ai à faire ; un Théâtre à soutenir ! Et l’Art !... qu’il est profond !... Chapelle fera les honneurs de ma table... L’oracle des soupers n’est point l’homme de la postérité. Il y a à Paris mille gens qui n’ont d’autre occupation que celle d’importuner ceux qui travaillent. Ils viennent vous assommer de visites éternelles, sans s’apercevoir qu’ils vous tuent, ils vous entretiennent de fadaises. Je vous dérange, Monsieur, disent-ils, et ils restent : Je vous dérange assurément, dires-le moi ; et ils restent encore... Voilà le malheur d’un peu de célébrité ; on n’est plus seul...
Peu-à-peu il tombe dans une réflexion profonde. On frappe à deux ou trois reprises, mais doucement ; Molière n’entend rien. On frappe un peu plus fort, il s’éveille et s’étonne.
Qui frappe ici à cette heure ? Depuis longtemps j’entends un bruit sourd... Oui, l’on frappe et doucement, comme si l’on craignait... Ce n’est point Chapelle. Voyons...
Molière va ouvrir.
Scène II
MOLIÈRE, ISABELLE
MOLIÈRE, extrêmement surpris.
C’est vous, Isabelle ! est-il possible !
ISABELLE, tremblante.
Vous me voyez dans la situation la plus cruelle... Écoutez-moi...
MOLIÈRE.
Mais vous êtes d’une imprudence, d’une imprudence extrême. Il a là de quoi nous perdre tous deux. Vous n’avez donc pas réfléchi.
La porte étant restée ouverte.
Attendez que j’aille fermer la porte... Que vous est il arrivé de sinistre ?
ISABELLE.
Ma mère...
MOLIÈRE.
Eh bien, ma chère enfant, votre mère ?... Ne vous ai-je pas dit tantôt de patienter ? ne me l’aviez vous point promis ? et vous exposez ainsi votre renommée tandis que nous sommes environnés d’argus... vous le savez.
ISABELLE.
Ayez pitié de moi.
MOLIÈRE.
On vous calomniera ; on me représentera, moi comme un homme sans mœurs, qui vous séduit sous les yeux de votre mère ; et l’innocence aura beau régner dans nos cours, on supposera entre nous une intelligence coupable.
ISABELLE.
N’augmentez point mes peines. Les tourments qui m’obsèdent vous sont inconnus ; mais, la nuit comme le jour, je n’ai plus de repos. Savez-vous de quelles fureurs, de quels emportements ma mère ?...
MOLIÈRE.
Ah ! mère cruelle !... Sa tyrannie ne sera pas de durée, je vous le proteste ; mais, qu’y a-t-il enfin de nouveau ?
ISABELLE.
J’étais couchée ; ma mère entre en fureur, et me prodigue les noms les plus outrageants. Je t’ordonne dit-elle, d’une voix menaçante, de te lever demain au point du jour. J’ai disposé de toi ; ton amour pour Molière t’assure ma haine, et tu en seras l’objet éternel, tant que tu ne changeras point. Tu m’appartiens ; songe à obéir, ou je te ferai sentir toute mon autorité... Elle me laisse sans réponse, et accompagne sa sortie de reproches encore plus injurieux... Ah ! c’en est fait, me suis-je dit, demain ma mère me rend captive, m’emmène, m’éloigne de tout ce que j’aime. Je me mets à pleurer, roulant mille desseins confus dans ma tête ; tout-à-coup l’amour m’inspire son courage : Non, me suis-je dit, on ne m’ôtera point à Molière ; il doit être mon époux, et je puis respirer dès ce mo ment sous sa protection ; je puis me regarder dès-à présent comme sa femme...Je me lève, je m’habille à la hâte ; menacée du plus horrible malheur, de celui de vous perdre, je ne prends conseil que de mon désespoir ; je marche à pas sourds, je traverse la chambre de ma mère, j’ouvre doucement les verrous, je me précipite sans mule le long de l’escalier, j’arrive à cette porte sans que personne m’ait vue, et je viens implorer un asile que vous ne me refuserez pas.
MOLIÈRE.
Vous avez oublié vos devoirs... Retournez dans votre appartement, ma chère Isabelle, et effacez jusqu’aux apparences qui pourraient déposer contre vous... Je vous parle plutôt en père qu’en amant ; mais c’est la tendresse que j’ai pour vous, qui m’oblige à vous tenir ce langage. La décence vous ordonne...
ISABELLE.
Quoi, vous me refusez ! et vous ne songez pas que demain nous serons séparés pour jamais.
MOLIÈRE.
Je préfère à tout votre honneur, qui m’est plus cher que ma vie...
ISABELLE.
Donnez-moi votre main, que je puisse m’écrier : Molière est mon époux. Je suis à vous depuis que je vous luis promise ; défendez votre bien. Qui désapprouvera notre amour, lorsqu’il n’a pour but qu’un légitime ?
MOLIÈRE.
Étrange aventure que je n’ai pu prévoir !... Vous ne songez donc pas que toute surprise est illicite, que vous paraîtrez coupable ; qu’il y a une marche ordonnée et prescrite par les Lois, qu’on ne saurait enfreindre sans remords et sans crime ? que toute apparence de séduction doit être enfin aussi loin de ma conduite qu’elle l’est de mon cœur ? De grâce, reprenez le chemin de votre appartement.
ISABELLE.
Non, vous ne m’aimez pas, ingrat ! et je me suis trompée. Votre amour est bien faible, si ma mère en triomphe. Moi seule ai le courage, et vous n’avez que la crainte... Que m’importent les discours du monde ! De vous seule dépend ma renommée. Si vous balancez, lorsqu’il s’agit de mon bonheur et du votre quel fonds puis-je faire sur le sentiment qui vous anime ? Quand je vous montre mon amour, c’est vous qui tremblez, voilà toute votre réponse !... Ah ! dites plutôt que vous n’aimez pas, que les paroles dont vous m’avez flattée sont fausses, que vous avez changé, et que j’ai été trop crédule en ajoutant foi à vos serments. J’ai perdu le repos que je goûtais avant de connaître l’amour. Eh bien, que mon malheur s’achève : je vais suivre la route que me trace mon désespoir ; je ne prends plus loin de ma gloire, de mon repos, de ma vie : je ne cherche plus qu’a m’éloigner d’un lieu où une mère jalouse me tyrannise, où mon amant me trahit, où il résiste à mes larmes, insensible qu’il est à toute la tendresse que j’ai pour lui...
MOLIÈRE.
Arrêtez, Isabelle, et demandez ma vie.
ISABELLE.
Et vous, cruel, et vous, donnez-moi plutôt la mort.
MOLIÈRE.
Vous n’écoutez plus la raison... Je vous protégerai contre la colère ; mais je demeurerai inflexible sur l’article des bienséances.
ISABELLE.
Toujours des reproches !... Eh ! l’Amour en connait-il ?... Dieu ! j’entends du bruit.
MOLIÈRE.
On vient, vous voyez... Voilà le fruit de votre imprudence... J’avais des amis à souper, qui se retirent, ils vont peut-être entrer ici. Réfugiez-vous dans cette chambre... Je vais appeler La Forest.
Il appelle la Forest.
Scène III
MOLIÈRE, ISABELLE, PIRLON, LA FOREST
ISABELLE, entre dans la chambre, y fait quelques pas, et pâle d’effroi, elle revient sur la Scène en désordre, et jetant un long cri.
Ah Ciel ! qu’est-ce que je sens ?... Un homme de caché, un voleur ! je me meurs...
MOLIÈRE.
Un voleur !
À La Forest.
Soutiens-la, La Forest ; elle va s’évanouir.
La Forest la soutient dans ses bras. Apercevant Pirlon qui sort de la chambre où il était caché.
Que vois-je ?... Ah ! traître, infâme ! pour être délateur tu te fais un vil espion !... As-tu assez scruté ma vie domestique pour en composer les noirs poisons de la calomnie ?... Parle, méchant, parle, si tu l’oses ; dis le contraire de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu ? Ta bouche, vouée au mensonge, ne fait que flétrir l’innocence. Poursuis ton rôle affreux... Mais, tremble devant moi ; je n’ai pas tout die sur con compte, et...
PIRLON.
Je tombe à vos genoux, Molière... mais n’imaginez pas que je sois entré ici pour surprendre vos secrets... Puisqu’il faut l’avouer, je fuyais la colère du peuple, soulevé contre moi par la chaleur de vos pinceaux... C’est à la commisération de La Forest que j’ai dû cet asile. Je vois clairement combien je suis en exécration à tout le monde. Oui, je suis trop ressemblant pour pouvoir m’abuser moi-même. N’étendez pas plus loin votre vengeance... Me haïrez-vous au point ?...
MOLIÈRE, vivement.
C’est le vice que je hais et non le vicieux. Pour celui-ci je me contente de le plaindre... L’hypocrisie est un vice détestable, et que je combattrai sous toutes ses formes : croyez-moi, abjurez votre infâme métier, il ne tardera pas à devenir inutile ; bientôt il ne trompera plus personne, je vous en avertis... Vous pourriez encore si vous le vouliez véritablement, par un sincère repentir, regagner avec le temps la confiance et l’estime des hommes.
LA FOREST, à part.
On a beau prêcher à qui n’a cœur de bien faire.
PIRLON.
J’aspire à me corriger. Trêve, trêve, Molière, la paix, la paix : épargnez-moi dorénavant... Oui, je veux me réconcilier avec vous, désarmer vos rigueurs, devenir enfin votre ami.
MOLIÈRE.
Mon ami ! cela est fort... Mais, vous changeriez donc beaucoup ?...
PIRLON.
Je l’espère, et le Ciel m’en fera la grâce...
MOLIÈRE.
Ah ! commencez d’abord par ne point prendre le nom du Ciel en vain. Que ce nom sacré soit plus révéré, respecté dans votre bouche. Soyez vrai devant votre conscience : c’est-là le premier pas vers la vertu. Dites-moi plutôt, je vous hais ; je veux me venger de vous ; j’en chercherai les occasions et les moyens ; je vais, sortant d’ici, vous accuser partout de troubler l’État, de renverser la Religion, de corrompre les mœurs ; dites-moi cela, plutôt que de déguiser bassement votre fureur sous les dehors de ce qu’il y a de plus saine au monde... Rien ne vous forcé à me ménager. Je vous le dis sans détour, car je ne crains plus un ennemi à front découvert.
Scène IV
MOLIÈRE, ISABELLE, PIRLON, LA FOREST, LA BÉJART
LA BÉJART, entrant en furie, à sa fille.
Tu m’échappes !
À Molière.
Et toi, traître, tu m’enlèves ma fille ! elle se dérobe pendant mon sommeil, vante encore ta probité !... homme indigne de toute confiance, fais la satyre des méchants pour mieux les imiter ; ils sont tes modèles ; tu ne les as étudiés que pour leur ressembler !... Séducteur de ma fille, n’es-tu donc protégé par le Roi, que pour la soustraire à l’obéissance ?
MOLIÈRE.
Je ne l’ai point séduite, Madame, et j’en suis incapable. Je n’emploie la protection dont le Roi m’honore, que pour servir autrui... Elle fuyait vos mauvais traitements, votre violence ; vous l’avez poussée à cette extrémité, mais elle est aussi en sureté avec moi qu’avec vous-même.
LA BÉJART.
Traître ! tu parles de violence, et tu déshonores, mon enfant !...
MOLIÈRE.
Elle est loin du déshonneur... Elle porte en ce moment le titre de mon épouse.
Courant à son bureau, prenant une plume et signant une promesse de mariage.
Voilà la promesse solennelle, la promesse sacrée, gage inviolable de mon amour, de mon estime, et témoin irrécusable du serment que j’ai fait de la conduire au pied des autels.
Il donne la promesse de mariage à Isabelle, qui la met dans son sein.
LA BÉJART.
Perfide ! oses-tu, sans mon consentement ?...
MOLIÈRE.
Il nous est dû ; nos cours sont libres ; un courroux aveugle ne sera point écouté : c’est ma femme, et je le publie...
LA BÉJART.
Elle ne l’est pas encore ; mais tu aimes à couvrir de ce nom l’opprobre de ta conduite.
PIRLON, à part.
Allons, Pirlon, fais un effort ; montre-toi tout autre que tu n’as été, et rends justice une fois à la vérité.
À la Béjart.
Madame, j’ai tout entendu, et l’on ne me soupçonnait pas présent. Je publierai partout, que Molière est un honnête homme. Il a vivement reproché à votre fille sa démarche in considérée ; il l’a suppliée, à plusieurs reprises, de rentrer chez sa mère ; il a joint les prières les plus vives aux plus pressantes raisons, il l’a respectée, et l’amour qu’il a pour elle est aussi pur qu’il puisse l’être.
LA BÉJART.
Quoi ! Monsieur Pirlon, vous étiez-là ? et vous êtes bien sûr que Molière a parlé à ma fille de la soumission qui est due à mon autorité ?
PIRLON.
Assurément, Madame, je dois rendre hommage à la pureté de ses intentions, et quand je parle ainsi de Molière, je puis être cru.
MOLIÈRE.
Voyez, si un tel témoignage est suspect, Madame ; je n’ai jamais voulu braver votre autorité, mais seulement la contraindre dans de justes bornes, pour votre propre repos.
PIRLON, à part.
Il vient encore du monde, il fait nuit ; l’occasion est favorable... Vite, sauvons-nous.
Il s’enveloppe de son manteau et s’enfuit.
Scène V
LE MARQUIS, LE COMTE, CHAPELLE, MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE, LA BÉJART, ISABELLE, LA FOREST
LE MARQUIS, en entrant.
Mais quel vacarme chez notre Philosophe !... Qu’y a-t-il donc ?... L’étude est bien bruyante.ee soir... Fait-il répéter des rôles de comédies ?
LE COMTE.
Quoi, Mesdames ! pendant la nuit venir relancer un Auteur solitaire jusques dans la silencieuse retraite des Muses !...
CHAPELLE, entre deux vins.
Ah, Mesdames ! que je vous fais bon gré de venir l’égayer ! Voilà ce qu’il lui faut, il attrapera parce moyen le vis comica des Anciens... car il est par fois si triste, que je me donne au diable pour deviner comment il peut nous faire rire.
LE MARQUIS.
Molière, vous dispensez bien votre temps.
LE COMTE.
C’est à vous qu’il appartient d’unir en un seul jour la gloire et les plaisirs.
LE MARQUIS.
Et vous, charmante Isabelle, vous venez l’inspirer... Je ne m’étonne plus de ses chefs-d’œuvre.
MOLIÈRE.
Messieurs, trêve de badinage... C’est pour la première fois de sa vie que le pied d’Isabelle a touché le seuil de mon cabinet ; mais Madame, malgré les témoignages les plus positifs, s’obstine à penser que j’ai voulu séduire la fille.
LE MARQUIS.
Non, cela ne peut pas être... Je réponds de la probité de Molière...
CHAPELLE.
Oh ! Molière n’est pas un scélérat on amour ; je le certifie.
LE СOMTЕ.
Molière est un honnête homme, et dans toute la force du terme.
MOLIÈRE.
Messieurs, je ne me pique que de cette qualité. J’abandonne mon talent à qui voudra le juger, mais je veux conserver le titre d’homme d’honneur ; j’en suis jaloux, très jaloux ; je le préfère à tous les titres de bel esprit, de grand écrivain, d’homme de génie, si l’on veut. La pro bité, voilà le caractère essentiel de l’homme ; le reste vient après comme il peut... J’aime Isabelle, je la demande en mariage, Isabelle y consent ; d’où naîtrait le refus de sa mère jugez-nous, Messieurs, je vous en supplie.
LE СOMTЕ.
Ah, Madame ! vous devriez vous féliciter de marier votre fille à un homme tel que Molière.
LE MARQUIS.
Quelle raison auriez-vous de la refuser à celui qui est l’honneur du théâtre, la gloire de la France, le protégé du Roi ?
LE СOMTЕ.
Mais cela ne souffre aucune difficulté. Tout le monde applaudira à cette union, et la beauté deviendra la ré compense du génie.
LE MARQUIS.
Le Roi ne désapprouvera point ce mariage ; je veux être un des premiers à le lui annoncer.
CHAPELLE, à la Béjart.
Croyez-moi, donnez-lui votre fille ; il l’aurait toujours. Faites-vous un mérite de votre complaisance ; tout le monde aujourd’hui ne fait pas la sottise de se marier...
À part.
Elle le mènera avec tout le sublime de la coquetterie.
LA BÉJART, à part.
Malheureuse que je suis ! faut-il que tout conspire contre moi.
MOLIÈRE.
Mes amis, je ne rougirai point devant vous de vous révéler l’intérieur de ma maison. La mère d’Isabelle, malgré les apparences, est en discorde avec sa fille ; ma joie ne sera pure et complète ; que lorsqu’elle lui aura pardonné... Isabelle, suppliez votre mère, avec tendresse et respect, supplice-la devant témoins de consentir à notre union. Je ne veux vous devoir qu’à elle, et je ne puis être heureux qu’à ce prix.
ISABELLE.
Pardonnez à votre fille, ma mère ! elle suit le mouvement de son cœur en vous demandant grâce ; pardonnez-lui ce qu’un excès d’amour lui a fait entreprendre ; il ne dérobe rien à d’autres sentiments. Ma tendresse et mon respect pour vous, seront toujours les mêmes... Vous m’avez maudire dans votre colère, révoquez ce dur arrêt ; je serai toujours malheureuse, si ma mère ne m’aime point.
LA BÉJART, attendrie.
Vous le voulez, Molière... Viens ma fille, je t’embrasse et te pardonne.
ISABELLE.
Ma mère, j’embrasse vos genoux.
LE MARQUIS.
Voilà une fort bonne femme, quoiqu’on en dise...
À Molière.
Songez à notre sujet.
LE COMTE.
Mais elle n’est pas si méchante qu’on la faisait...
À Molière.
N’oubliez pas les idées que je vous ai données.
CHAPELLE, bas.
Vous ne la voyez pas toujours... Les femmes ne sont bonnes que par instants.
LATHORILLIÈRE, embrassant Molière.
Ah, mon cher ami ! soyez aussi heureux que vous méritez de l’être.
CHAPELLE, à Isabelle.
S’il vous promet de la constance, il vous tiendra parole ; mais je dirai toujours que le mariage est, surtout pour un homme d’esprit ; une étrange bévue...
Bas à Molière.
Vous vous en repentirez, Molière.
MOLIÈRE, haut.
Oui, tout comme d’avoir fait des Comédies.
CHAPELLE, malignement.
Oh ! il est des accidents singuliers à l’égard desquels il suffit d’être né sage pour ne pouvoir s’en garantira.
[1] M. Fleuri a joué supérieurement le rôle de Molière et n’a rien laissé à désirer ; mais j’exhorte les Comédiens à représenter la Pièce telle que je la leur ai donnée, et telle qu’elle est imprimée ici. Je leur déclare que j’y suis intéressé, car leurs changements, leurs mutilations, leurs coupures, rien de tout cela ne m’a paru heureux. La Pièce doit gagner au rétablissement de mes leçons.