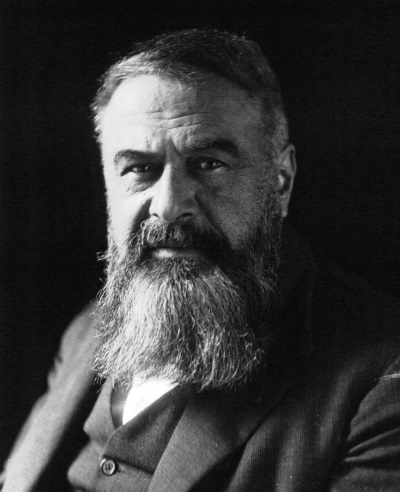Les Petites curieuses (Tristan BERNARD)
Pièce en trois actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre des Boulevards, le 11 février 1920.
Personnages
BRÉGANCE
GEORGES DULAURIER
LÉNORE
DIANA
ACTE I
La scène représente un petit fumoir élégant. Quelques détails d’un raffinement très actuel. Brégance et Dulaurier sont en smoking, la tête nue. Ils sont censés venir de la salle à manger. Brégance fume un cigare et tient à la main un petit verre.
BRÉGANCE.
Eh bien ! Voilà de petites soirées comme je les aime. Votre cousine Lénore organise un dîner chez son amie madame Lambel. Lénore et la maîtresse de maison arrivent à neuf heures...
DULAURIER.
Si vous disiez neuf heures un quart... J’étais malade de faim !
BRÉGANCE.
Eh bien ! pour moi, ça tombait bien : je commençais seulement à me sentir en appétit. Je craignais toutefois un dîner trop cuit. Heureusement que la cuisinière de madame Lambel est bien stylée : elle sait que, lorsque Lénore dîne ici, il n’y a plus d’heure d’été, d’heure d’hiver, ni d’aucune saison. Elle prévoit toujours le retard, même quand il n’est pas annoncé ; de sorte que le dîner est toujours à point.
DULAURIER.
Oh ! ma cousine Lénore est tout de même d’un manque de ponctualité insupportable !
BRÉGANCE.
Mon ami, elle aime le fox-trot... Elle pouvait difficilement quitter son dancing... c’est bien compréhensible ! Elles sont arrivées rouges et décoiffées, elle et la petite Diana, et nous les avons forcées à se mettre à table tout de suite. Alors, maintenant, elles vont employer un bon moment à se recoiffer et à se repeindre le visage. Tout est pour le mieux : moi, j’adore digérer entre hommes.
DULAURIER.
Je ne vous cache pas que, d’une façon générale, je trouve cette vie un peu scandaleuse.
BRÉGANCE.
Dites carrément votre façon de penser : vous la trouvez, non pas un peu, mais très scandaleuse... Vous avez vingt-cinq ans : ayez l’austérité de votre âge. Monsieur l’attaché d’ambassade, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, c’est très bien ! Comment faisiez-vous à la guerre ?
DULAURIER.
Je fumais et je buvais. Maintenant, j’ai renoncé au tabac et à l’alcool.
BRÉGANCE.
Pourquoi venez-vous chez Lénore, dont l’existence répond si peu à votre conception de la vie ?
DULAURIER.
Lénore est ma cousine et une amie d’enfance ; je ne peux vraiment pas cesser toutes relations avec elle.
BRÉGANCE.
Et puis, vous aimez la petite madame Lambel qui, pendant que son mari est absent, essaye de se consoler de son veuvage...
DULAURIER.
Je vous assure...
BRÉGANCE.
Je ne vous demande rien... Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, jeune homme accompli, et vous attachez de l’importance aux femmes ; vous leur faites la cour...
DULAURIER.
Je vous assure...
BRÉGANCE.
Je ne vous demande rien... Ce que je vous dirais ne vous persuaderait pas. J’attendrai quinze ou vingt ans que vous soyez de mon avis. Alors, qui sait ? Je serai peut-être redevenu du vôtre ! Mais retenez bien ce que je vous ai dit : dans vingt ans, jour pour jour, vous viendrez me dire qu’aujourd’hui j’avais raison. D’ici là, vous allez jouer à ce petit jeu que j’ai joué suffisamment à votre âge. Les avertissements ne m’ont pas manque : j’ai fait comme vous, je n’en ai pas tenu compte. Vous irez répéter à une dame qui vous plaira que vous l’aimez... Elle vous répondra : « Ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas vrai ! » jusqu’au moment où ce ne sera plus vrai. Vous allez prêter à une personne toutes sortes de qualités qu’elle n’a pas et, quand vous la connaîtrez mieux et que vous vous apercevrez qu’elle ne les a pas, vous lui en voudrez de vous avoir déçu ! Alors que ce sera vous-même qui vous serez exalté à faux sur son compte... Mon cher ami, les femmes sont de petits êtres sauvages : pourquoi vous obstinez-vous à les considérer comme nos semblables ? Elles ne nous comprennent jamais, vous ne les comprendrez pas davantage. Quand elles commencent à nous comprendre, elles ne nous intéressent plus. Petite anecdote symbolique : Je suis propriétaire d’un petit hôtel à Neuilly. Un individu m’a fait des propositions de location en me laissant entendre qu’il resterait de longues années... Je l’ai laissé emménager avant de signer le bail. Au bout de quinze jours, il ne se plaisait plus dans la maison ; il a affirmé qu’il n’avait entendu louer que pour trois mois... C’est ce qui se passe avec les femmes. On marche toujours au début pour un bail de longue durée. Seulement, de part et d’autre, on évite de préciser les conditions, et ça finit par une pauvre petite location verbale... Et dire que c’est ce malentendu qui fait vivre’le monde ! Car on médit beaucoup du malentendu. Les gens se séparent parce qu’ils ne s’entendent pas, parce qu’ils ne se comprennent pas. Mais, s’ils s’étaient compris tout de suite, ils ne se seraient jamais mis ensemble. Le malentendu fait des divorces ; il fait encore plus d’unions.
DULAURIER.
C’est terrible, d’avoir ces idées-là sur les femmes ! Mais qu’est-ce qui vous plaît dans la vie ?
BRÉGANCE.
Les femmes... Je n’ai jamais vu aussi clairement le peu qu’elles valaient, mais je les aime plus que jamais. Seulement, c’est plus librement. Je sais que je suis presque un vieux monsieur... Je suis encore capable d’être leur amant et je-ne suis pas obligé moralement de le devenir. Bien entendu, quand je leur parle, je leur fais toujours entendre que je les désire, parce qu’il faut être considéré. La vérité est que je ne les désire pas tout le temps, mais j’ai de l’expérience et je me dis qu’il arrivera un moment, dans la semaine, où je serai parfaitement capable de les désirer. Seulement, mon petit, n’ayez pas peur, je ne vais pas sur vos brisées. Ma spécialité, ce n’est pas les femmes du monde... J’aime les petites modistes, les petites employées des postes, de jeunes personnes pas trop mal élevées, soignées, souvent instruites... Une dame du monde fait toujours trop de chichi. Les délits d’usage pour succomber sont trop longs, précédés de formalités, de rencontres à des thés, à des dîners, rendez-vous au théâtre... Ça n’en finit plus. On a beau être sincère, elles épuisent votre sincérité. On est obligé de la prolonger par du chiqué. Je n’ai plus la patience de faire du chiqué pendant si longtemps.
DULAURIER.
Avec vos petites amies, vous êtes plus satisfait ? Je dis : « vos » petites, car je suppose bien que vous en avez plusieurs à la fois ?
BRÉGANCE.
Y pensez-vous ? Je ne pratique que la polygamie occidentale : plusieurs femmes, mais successivement. La polygamie simultanée des Orientaux, c’est du gâchage et de la barbarie : on ne profite pas de ses maîtresses, on est comme un enfant dans un magasin de jouets... Et puis nos budgets occidentaux ne supporteraient pas de semblables charges...
DULAURIER.
Et quand votre amie vous trompe ?
BRÉGANCE.
J’en prends une autre. De cette façon, j’ai toujours à moi une femme fidèle, puisque je me sépare d’elle aussitôt qu’elle ne l’est plus.
Silence.
L’exposé de ma vie sentimentale ne vous plaît pas ?
DULAURIER.
J’aime mieux ne pas vous donner mon opinion.
BRÉGANCE.
Bien entendu ! Et vous avez raison ! Il faut avoir les idées de son âge...
DULAURIER.
Je dois vous paraître ridicule ?
BRÉGANCE.
Non, touchant. Vous aimez la petite Diana, et vous parlez en amoureux.
DULAURIER.
Sincèrement, je ne peux pas dire que je l’aime... Si cela était, je n’aurais aucun scrupule à vous en faire la confidence, parce qu’il n’y a eu que des entretiens amicaux entre cette jeune femme et moi... La vérité est que j’ai pour Diana une grande affection, et aussi de la pitié... Vous savez qu’après un an de mariage son mari a dû partir en Australie pour une affaire de haute importance... Ma cousine Lénore a pris Diana sous sa tutelle...
BRÉGANCE.
Avec son autorité considérable de femme divorcée...
DULAURIER.
Elle n’a pas eu de peine à l’entraîner dans la vie excentrique, artificielle qu’elle mène... Je voudrais tout de même lui faire concevoir une existence – je ne dirai pas plus austère – mais simplement plus saine.
BRÉGANCE.
En en faisant votre bonne amie ?
DULAURIER.
On ne peut pas parler d’une façon un peu grave avec vous...
BRÉGANCE.
Oui, j’ai un défaut : j’aime à préciser...
DULAURIER.
Vous ne croyez pas au dévouement ?
BRÉGANCE.
Je vous demande pardon, je crois toujours à la sincérité des braves gens qui se dévouent pour de jolies femmes.
DULAURIER.
Évidemment, je ne peux pas me faire plus désintéressé que je le suis... Il est fort possible que, dans mon zèle amical, il entre un autre sentiment... encore inexprimé, et qui ressemble à l’amour...
BRÉGANCE.
Ce qui ressemble à l’amour est toujours de l’amour... Mais je ne dis plus rien... Vous êtes à l’âge où l’on vit dans l’imprécision, où l’on en goûte les charmes. Moi, je suis un quinquagénaire bien tassé... J’aime, au contraire, les joies précises. Je suis à l’âge où l’on goûte le mieux le plaisir d’aimer, et où l’on apprécie le plus la satisfaction de ne pas aimer. C’est pour moi un très grand agrément qu’une tendre conversation avec une jolie femme. Il n’y en a qu’un de plus grand : c’est d’être seul dans un bon lit où l’on est bien tranquille. D’ailleurs, cessons de blasphémer, car j’entends venir ces dames...
Lénore entre, suivie de Diana. Elles sont en chapeau.
BRÉGANCE.
Qu’est-ce que ça veut dire ? On sort maintenant ?
LÉNORE.
Mais oui ! Nous l’avons pourtant dit pendant le dîner.
DULAURIER, morne.
On sort ?
DIANA, un peu agacée.
Cela vous dérange ?
LÉNORE.
J’ai pris rendez-vous dans un bar de Montmartre, un bar assez extraordinaire.
DULAURIER.
Où l’on danse, naturellement ?
LÉNORE.
Pas si naturellement que cela : on n’y voit que de beaux jeunes gens au pur visage arcadien, qui dansent entre eux. Ils sont admirables d’élégance !
BRÉGANCE.
Je vois... la Grèce antique... Alcibiade... Platon...
LÉNORE.
Ça n’a pas l’air de vous emballer ! Mais je suis obligée, en tout cas, d’y aller, moi, parce que j’ai donné rendez-vous à des amis. Ils savent que je suis une femme de parole ; ils resteraient toute la nuit à m’attendre.
DULAURIER.
On pourrait téléphoner ?
LÉNORE.
Le bar n’a pas le téléphone.
BRÉGANCE.
Vous ne voulez pas que l’on puisse téléphoner à la Grèce antique ?
LÉNORE.
Il y a un moyen bien simple : je vais faire un saut jusque là ; c’est à trois minutes en auto. Je m’excuserai, je dirai, par exemple, Diana, que tu es souffrante et que nous ne pouvons passer la soirée avec eux.
DIANA.
Ce serait encore plus simple d’y aller tous, puisque c’était convenu.
LÉNORE.
Non, puisque cela contrarie Georges.
DIANA, ironique.
Ah ! c’est bien regrettable !
LÉNORE.
Reste plutôt avec lui, en m’attendant. Brégance m’accompagnera.
DIANA.
Monsieur Dulaurier, bien entendu, ne veut pas se compromettre dans dés endroits pareils.
BRÉGANCE.
Ça se comprend : lui, il est trop jeune. Moi, une vieille réputation de coureur de femmes me crée tout de suite une sorte de respectabilité.
DIANA, à Lénore.
Je vais avec toi.
LÉNORE.
Je t’en prie : ne sois pas méchante. Reste avec Georges. Nous ne serons pas longtemps. Venez, Brégance. Ça ne vous ennuie pas d’aller là ?
BRÉGANCE.
Du moment que vous ne m’obligez pas à danser avec les Arcadiens... À tout à l’heure !
Ils sortent. Pendant quelques instants, Dulaurier et Diana, chacun assis de son côté, gardent le silence. À la fin, Dulaurier se lève.
DULAURIER.
Pourquoi êtes-vous si peu gentille avec moi ?
DIANA.
Parce que vous êtes insupportable.
DULAURIER.
Mais vous devriez sentir que c’est parce que je vous aime ! Tout à l’heure, quand Lénore vous a proposé de rester avec moi, vous n’avez pas vu votre air de résignation !
DIANA.
Je ne l’ai pas vu, mais je m’en suis bien rendu compte ; et, d’ailleurs, je n’ai rien fait pour le dissimuler.
DULAURIER.
Si j’avais eu la moindre dignité, je n’aurais pas accepté votre sacrifice. Mais j’avais un tel désir de rester seul avec vous que je n’ai plus songé à ma dignité...
DIANA.
Oh ! votre dignité ! votre dignité ! Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse, votre dignité ! Et puis, soyez plus franc. Ce n’est pas simplement parce que vous vouliez rester avec moi, c’est aussi parce que ça vous gêne que j’aille là-bas ?
DULAURIER.
Eh bien, oui ! ça me gêne que vous alliez là-bas ! Ces curiosités m’écœurent, vous le savez bien !
DIANA.
Oh ! vous me l’avez assez dit ! Vous devriez bien vous rendre compte que c’est inutile de me le répéter, puisque vous voyez le peu d’effet que cela me fait. Vous prétendez m’aimer ? Aimez-moi telle que je suis, avec mes curiosités, comme vous dites, pour ne pas dire mes vices !
DULAURIER.
Oh ! je sais bien, moi, que ce ne sont pas des vices. Mais tout le monde ne le sait pas comme moi.
DIANA.
Je me fiche bien de ce que le monde peut croire et peut penser !
DULAURIER.
Eh bien ! moi, je ne m’en moque pas ! Une mauvaise opinion qu’on a de vous, c’est un peu de boue qui vous éclabousse... Et c’est comme une offense douloureuse que je ressens...
DIANA.
Eh bien ! mon cher ami, je regrette beaucoup. Mais il faudra vous faire à cela.
DULAURIER, suppliant.
Diana !
DIANA.
Non, mon ami. Je ne suis pas votre maîtresse : Je ne vous appartiens pas. Je vous trouve absurde et odieux quand vous êtes comme cela. L’affection... la sympathie que j’ai pour vous, je la perds tout à fait. Je vous déteste quand vous êtes rigoriste, quand vous voulez me modifier, me diriger.
Énervée et presque pleurant.
C’est vrai ! Est-ce que c’est moi qui suis allée vous chercher ! Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille ?
DULAURIER, énervé à son tour.
Eh bien ! je vous laisserai tranquille ! Vous savez que je pars ce soir pour huit jours ?
DIANA.
C’est votre seule excuse.
DULAURIER.
Je serai cruellement malheureux de vous avoir quittée fâchée !
DIANA.
Calmez-vous ! Aussitôt que vous serez parti, je ne serai plus fâchée.
DULAURIER.
Comme vous êtes méchante avec moi... Mais j’ose me dire que, si vous pensiez vraiment ce que vous me dites, vous ne me le diriez pas aussi crûment...
DIANA.
Je vous dis exactement ce que je pense...
DULAURIER.
Méchante fille ! Je vais partir affolé ! Ah ! les Affaires étrangères ont choisi un bel envoyé ! Je ne sais pas comment je vais m’acquitter de cette mission... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ! Ça vous est bien égal ! Oh ! mais ; vous savez, j’ai encore confiance en moi ! Je ferai tout ce que je pourrai pour me ressaisir. Je ne sais pas si j’y parviendrai, mais je vous assure, du fond du cœur, que si j’ai assez de force pour ne pas revenir, pour rester là-bas, j’y resterai !
Il tombe assis sur un fauteuil, en proie à une violente surexcitation, les yeux pleins de larmes... Long silence. Diana va pour sortir, puis s’approche de lui et lui met la main sur le front.
DIANA.
Méchant !
DULAURIER, lui prenant la main.
Diana, comprenez-moi ; je sais ce que vous êtes mieux que vous. Je sais ce que vous valez. Vous n’êtes pas fa.ite pour être la compagne de cette folle de Lénore. Vous êtes capable, vous, de vivre en vous-même, pour vous-même... Vous n’avez pas besoin de cette existence turbulente et d’aller chercher à droite et à gauche, comme un frelon, de pauvres petites sensations, que vous appelez des sensations rares ! Les vraies sensations rares, celles que bien peu d’êtres sont capables de goûter, ce sont celles que l’on trouve en soi-même, par de la sensibilité et de la réflexion.
DIANA.
Mais est-ce que j’en suis capable, moi ?
DULAURIER, avec élan.
Vous, plus que toute autre !... Croyez-en un ami plein de dévotion qui vous connaît mieux que personne, parce qu’il vous a regardée avec toute sa ferveur.
DIANA.
Avec des yeux qui se font illusion...
DULAURIER.
Non, chérie, il n’y a que les gens amoureux qui savent voir ! Il n’y a que l’amour qui fasse connaître les êtres ! J’ai discerné en vous, parce que je vous aime passionnément, un être d’exception...
DIANA.
Vous êtes le seul à le croire...
DULAURIER.
Parce que je suis le seul à savoir vous aimer ! Vous-même, ma petite Diana, vous ne vous aimez pas comme je vous aime ; c’est pour cela que vous ne vous connaissez pas ! Je veux que vous vous regardiez en moi, comme dans un miroir clair et pur... Alors vous vous rendrez compte que vous n’avez pas le droit, ma chère idole, que vous n’avez pas le droit de vous profaner !...
DIANA, d’une voix un peu languissante.
Je vous assure que votre amour vous abuse...
DULAURIER.
Non, Diana, je vous le répète, mon amour est plus sûr et plus véridique que vous... Quel bonheur que nous ayons eu une explication avant mon départ ! Je vais passer huit jours d’impatience... mais de fièvre adorable.
DIANA.
Vous m’avez dit tout à l’heure que vous feriez tous vos efforts pour m’oublier...
DULAURIER.
Diana, je n’aurais pas pu... Je suis à vous pour la vie... Il n’y a pas d’autre femme au monde... Je penserai avec ivresse qu’à mon retour notre union s’accomplira, à l’insu de ce qu’on appelle le monde, de tout ce qui n’est pas nous deux, de tout ce qui n’existe plus pour moi ! Le monde ne comprendrait pas tout ce qu’au-dessus des lois, au-dessus des préjugés, il y aura de pur, de nuptial dans notre rapprochement... C’est dans un chez moi nouveau, que nulle autre présence n’a jamais profané, que je veux recevoir le don de vous-même...
DIANA.
Georges, vous verrez quelle amie docile je serai pour vous... comme je me laisserai guider, diriger, comme j’aurai confiance en vous pour m’apprendre la vraie beauté de la vie... Il me semble maintenant que, si je me suis montrée rebelle, c’est par un besoin inconscient de mieux vous éprouver, pour être sûre de votre désir de devenir mon maître... Mais vous verrez, Georges, quelle heureuse esclave vous aurez... C’est vrai que vous aviez bien lu dans mon âme, plus clairement que je n’avais fait moi-même ! Vous avez su discerner tout ce qu’il y avait de superficiel de ma vie frivole, et qu’avec toutes ces curiosités puériles, je ne faisais que tromper l’appétit, de grand bonheur que je n’osais sentir en moi ! Cher, cher Georges !...
DULAURIER.
Chère, chère Diana...
Dulaurier et Diana restent un instant à se regarder en silence. Bruit de coulisse. On entend Lénore et Brégance.
DIANA.
J’entends Lénore qui rentre. Ne restez pas si près de moi.
Il s’éloigne d’elle. Entrent l’instant d’après Lénore et Brégance.
LÉNORE.
Eh bien ? Vous n’êtes plus fâchés ?
DIANA.
Nous n’étions pas fâchés...
LÉNORE, à Diana.
Bien, bien...
DIANA.
Nous avons causé gentiment en vous attendant...
LÉNORE, à Diana.
Je regrette tout de même que tu ne sois pas venue... N’est-ce pas, Brégance, que ce n’était pas ordinaire ?
BRÉGANCE.
Non, heureusement... heureusement que la vie ordinaire est tout autre chose...
LÉNORE.
Ne faites pas le dégoûté ! Vous vous amusiez beaucoup, là-bas.
BRÉGANCE.
Je ne m’ennuyais pas. Ces jeunes gens ont de bonnes manières. Ils ont un air doux et ingénu. Et puis, ils ne font pas attention aux visiteurs, j’allais dire aux profanes. Je dois dire que ça ne me vexe pas...
LÉNORE.
Ni moi non plus...
BRÉGANCE.
En somme, comme fléau public, ils sont moins dangereux que les rats ou les sauterelles. Ils ne repeuplent pas.
LÉNORE.
Enfin, c’était bien amusant... Je sais que j’indigne mon cousin...
DULAURIER.
Non, je t’assure que ton cousin est très calme...
LÉNORE.
Mais Diana t’en voudrait peut-être de l’avoir retenue ici, si elle savait combien c’était curieux...
DIANA, d’un air de doute.
Était-ce si curieux que cela ?
LÉNORE, à Diana.
Nous y retournerons quand Georges sera parti...
DIANA, regardant Georges en souriant.
Nous verrons cela...
LÉNORE, à Brégance.
Un peu de chartreuse, Brégance ?
En la lui versant, à demi-voix.
Il me semble que l’apôtre n’a pas perdu son temps...
BRÉGANCE.
J’ai toujours eu confiance dans les apôtres de vingt-cinq ans...
ACTE II
Chez Diana.
Au lever du rideau, elle achève le changement de son salon. Elle retire un tableau d’une école assez avancée et le remplace par un paysage très sage. Entre Lénore.
LÉNORE.
Qu’est-ce que tu fais ?
DIANA.
Tu vois. Je modifie la décoration de mon salon... Je retire, après tous les autres, ce dernier tableau. Je ne l’aimais plus, je te l’avoue.
LÉNORE.
Je t’ai souvent entendue l’admirer...
DIANA.
Je ne l’aimais pas, voilà la vérité. Et maintenant, il m’est impossible de le voir. Alors je le remplace par celui-ci...
LÉNORE.
Et celui-ci, tu l’aimes ?
DIANA.
Non, je ne le supporte plus. C’était pourtant celui qui se trouvait là il y a quelques mois. Je ne suis pas arrivée à aimer l’autre. Mais, d’avoir essayé d’aimer l’autre, il arrive cette chose singulière que je ne supporte plus celui-ci...
LÉNORE.
Ma pauvre petite Diana, quelle admirable métamorphose !
DIANA.
Voilà la boîte magique à qui je la dois.
Elle ouvre un coffret plein de lettres.
Tu vois... Il est parti depuis huit jours et j’ai reçu de lui plus de vingt lettres.
LÉNORE.
Et il continue à diriger ta vie, à corriger tes gouts ?
DIANA.
Non. Il me parle de son amour. Il sent très bien qu’il n’a pas à me donner de ses conseils et qu’il suffit, pour agir sur moi, de son influence lointaine, mais toujours présente. Car il me semble qu’il est là ; je sais quels sont ses vœux...
LÉNORE.
Et ils deviennent des ordres pour toi...
DIANA, simplement.
Oui. C’est comme s’il m’avait laissé sa conscience. Il est mon ange gardien invisible. Je sais maintenant comment il souhaite que je sois. Et je m’achemine vers la perfection, pour mériter son amour !... Je suis heureuse qu’il revienne, mais je suis tremblante aussi, car je ne suis pas encore assez changée.
LÉNORE.
Oh ! si, je t’assure...
DIANA.
Oui, je suis assez changée pour toi, mais pas assez pour lui ! Et pourtant, je vois déjà la vie d’une tout autre façon... Ainsi, tiens, j’ai reçu hier une lettre de mon mari. Les lettres de mon mari, je les lisais rapidement, distraitement, avec frivolité. Il me semblait qu’elles ne disaient rien. Et maintenant, depuis quelques jours, depuis que Georges a élargi mon âme, même pour mon mari qui m’était indifférent, je sens en moi comme une sorte de respect...
LÉNORE.
Et tu vas le tromper tout de même avec Georges ?
DIANA.
Oh ! comme tu as des expressions !...
Chastement.
Je serai à Georges, bien qu’appartenant légalement à un autre, parce que Georges le veut !
LÉNORE.
Mais si Georges s’avisait de penser que tu ne dois pas, sans attenter à ta pureté morale, trahir ton mari ?
DIANA.
Je ferai ce que Georges voudra.
LÉNORE.
D’ailleurs, je ne crois pas que son désir de t’améliorer aille jusqu’à t’empêcher de devenir sa maîtresse... D’autant que tu es jolie comme tout ! Tu as un charme, peut-être un peu moins capitaux, peut-être un peu plus sérieux, qui va affoler notre jeune apôtre. Je suis contente de t’avoir coiffée ainsi.
Diana prend une glace à main et contemple longuement son visage.
Es-tu contente de toi ?
DIANA, après un temps.
Non... je crois que je vais me coiffer autrement.
LÉNORE.
Tu es folle ?
DIANA.
Georges estimera que c’est trop de recherche, pas assez de simplicité...
LÉNORE.
Il te trouvera délicieuse...
DIANA.
Non, Lénore, non. Tu ne sais pas, aussi bien que moi, ce qu’il pense. Tu ne sens pas à tes côtés cette action constante de lui-même que crée auprès de moi l’amour fervent que j’ai de lui... Ma petite Lénore, ne m’en veuille pas si je ne suis pas tes conseils. C’est à ses souhaits, à lui, à ses souhaits que je crois entendre, c’est à ses vœux que je tiens à me Conformer...
On sonne. Moment d’émotion.
Non, ce n’est pas encore lui. Il ne peut être ici avant une demi-heure. C’est sans doute Brégance, qui devait venir me voir aujourd’hui.
BRÉGANCE, entrant.
Bonjour !...
Poignées de main.
Dulaurier n’est pas là ?
DIANA.
Non. D’après l’heure d’arrivée de son train, il ne peut être encore ici... Excusez-moi, Brégance. Je vous laisse un instant.
Elle sort.
LÉNORE.
Vous savez où elle va ? Elle va se recoiffer. Elle se trouve trop excentrique !
BRÉGANCE.
Quelle métamorphose, hein !
LÉNORE.
C’est extraordinaire ! Déjà, ici, tout est changé...
BRÉGANCE.
Moins changé encore que Diana.
LÉNORE.
L’amour de Georges a fait d’elle une véritable puritaine. Vous savez qu’elle aura de la peine, maintenant, à tromper son mari !
BRÉGANCE.
Georges l’y décidera. Il l’amènera à l’adultère comme il l’a amenée à la vertu. C’est la toute-puissance de l’amour !
LÉONORE, elle s’assoit.
Croyez-vous qu’il l’aime vraiment ?
BRÉGANCE.
Je n’en sais rien. Mais elle l’aime, j’en suis sûr. Ce n’est pas l’amour qu’il a pour elle qui fait ces miracles. C’est l’amour qu’elle a pour lui. L’amour qu’il a pour elle, c’est la torche qui a mis le feu à la maison. La flamme de la torche allume des incendies cent fois plus amples qu’elle...
Il s’assoit. Après un temps.
C’est curieux, quand je suis arrivé, il y a six semaines, chez vous, quand, à la suite d’un petit souper que nous avons fait tous les quatre, nous avons senti croître notre amitié, je ne pensais pas que ça tournerait de cette façon-là. Je croyais bien à un rapprochement, mais ce n’était pas celui-là. Je pensais que vous aimiez Georges...
LÉNORE, très franchement.
Quelle idée ! Voilà plus de vingt ans que nous nous connaissons, Georges et moi, puisque nous sommes cousins. Et vraiment jamais une pensée de ce genre ne nous est venue ni à l’un ni à l’autre.
BRÉGANCE, haussant les épaules.
Qu’est-ce que ça signifie ? Plusieurs fois, il m’est arrivé brusquement de désirer une personne que je connaissais depuis des années, et pour qui je n’avais jamais eu aucune pensée équivoque. Et le désir, dans ce cas, est d’autant plus violent qu’il est plus soudain. Il se déclare avec frénésie, comme une maladie qu’on a couvée longtemps sans s’en douter.
LÉNORE.
Vraiment, en ce qui me concerne, il y a des indices certains que je n’aurai jamais le moindre sentiment pour Georges.
BRÉGANCE.
Quels indices ?
LÉNORE.
Mais le soin même que j’ai mis à le rapprocher de Diana...
BRÉGANCE, souriant.
Mais ça ne veut rien dire ! Et ça veut plutôt dire le contraire ! Oui, il y a eu de votre part un gentil proxénétisme mondain, et gratuit. Car le métier de procureuse, si mal vu quand il est rémunéré, est pratiqué à l’œil par des quantités de jeunes femmes du monde. Il arrive souvent que, chez ces aimables petites proxénètes – oh ! comme c’est ennuyeux de ne pouvoir employer un mot plus expressif et plus cru ! – il arrive souvent qu’elles ont une inclination, presque toujours inconsciente, pour le jeune homme à qui elles veulent du bien, le jeune homme dont elles souhaitent le bonheur physique ; elles finissent par le lui procurer, en lui procurant une maîtresse. Quand certain visage vous plaît, on désire lui voir prendre une expression amoureuse. Évidemment, c’est plus agréable quand c’est à notre intention et à notre profit. Mais, faute de mieux, on se contente que ce soit à la santé d’autrui.
LÉNORE, riant.
Enfin, je vous suis reconnaissante de me révéler mes propres sentiments.
BRÉGANCE.
Riez ! Riez ! Vous allez peut-être penser à cela pendant quelques jours et, quand vous vous apercevrez que j’avais raison, vous ne rirez plus, et vous n’oserez plus m’en reparler.
LÉNORE.
Oh ! je parie bien que non !
BRÉGANCE.
Ne pariez pas d’argent, en tout cas, ne pariez que l’honneur.
Entre Diana. Elle est coiffée très sévèrement, et regarde avec un peu d’inquiétude Lénore et Brégance, qui sourient.
DIANA.
Eh bien ?
LÉNORE.
Eh bien, ça te va...
BRÉGANCE.
Ça vous va à merveille !
DIANA, prêtant l’oreille.
Attendez !
Elle va dans la chambre à côté, suivie des yeux par Brégance et Ignore. Elle revient, l’instant d’après, très émue.
Le voici qui vient... Je l’ai vu par la fenêtre. Il est en train de payer son taxi.
LÉNORE.
Nous allons te laisser...
DIANA, vivement.
Non ! De quoi ça aurait-il l’air ? Si vous sortez, vous allez le rencontrer dans l’escalier.
BRÉGANCE, souriant.
Oui, nous serions alors forcés de lui parler et nous l’empêcherions d’être là tout de suite. Eh bien, soit ! nous restons. Mais nous irons, Lénore et moi, dans la chambre à côté. Il faut que vous vous voyiez d’abord seule à seul... Quand vous voudrez de nous, vous nous appellerez. Venez, Lénore !... Eh bien, vous ne venez pas ?
LÉONORE.
Je pense à une chose : je me demande si Georges ne va pas être un peu étonné de la transformation qui s’est opérée chez Diana...
DIANA.
Tu crois qu’il me trouvera moins bien ?
LÉNORE.
Non, mais il a emporte de toi un certain souvenir... Il te voyait sous un autre aspect ! Il vaudrait peut-être mieux qu’il fût préparé...
À Brégance.
Vous allez le recevoir.
BRÉGANCE.
Vous croyez ?...
LÉNORE.
Mais oui, il faut le préparer...
BRÉGANCE.
Mais qu’est-ce que je vais lui dire ?...
LÉNORE.
Comme si vous n’étiez pas capable de le trouver !
BRÉGANCE.
Je vous assure...
LÉNORE.
Si, si, vous trouverez !
Elles sortent, Brégance reste seul. Au bout d’un instant, entre Dulaurier.
BRÉGANCE, à Dulaurier.
Bonjour, mon cher.
DULAURIER.
Bonjour, cher ami...
BRÉGANCE.
Vous vous dites : « Quel est ce gêneur, ce fâcheux ? » Vous vous attendiez à trouver ici la jeune Diana. Mais vous allez la voir, mon garçon ! Elle est avec Lénore, et je suis chargé de vous faire prendre patience... Ah ! on peut dire que vous êtes aimé ! Vous avez opéré une métamorphose extraordinaire... Regardez d’abord cet appartement où vous étiez venu jadis... Tout ce qui attestait un certain raffinement a été déménagé... On s’est conformé à vos désirs. On a bien profité de vos leçons.
DULAURIER.
Je suis très touché de cela.
BRÉGANCE.
Mais qu’allez-vous penser quand vous allez voir votre amie ? Elle est presque méconnaissable...
DULAURIER.
Je suis très ému de ce que vous me dites là... Car je l’aime, Brégance, je l’aime ! Et je n’ai fait que penser à elle avec fièvre pendant ces huit jours !... Écoutez, Brégance. Puisque je vous trouve ici et que vous paraissez au courant de tout, vous allez me rendre un service... délicat. Vous savez que je suis parti, il y a huit jours, précipitamment, et qu’avant mon départ, je n’ai pu m’occuper de rien... Or, j’habite dans ma famille. J’ai bien, ailleurs, un petit appartement-bureau, mais je n’y puis recevoir personne. Ce n’est pas commode à trouver, en ce moment.
BRÉGANCE.
Vous vous figurez que je vais pouvoir vous procurer un appartement ? Mais il me faudrait un pouvoir surnaturel... Il n’y a qu’une chose à faire, c’est que je vous en donne un à moi.
DULAURIER.
Comment, un à vous ?
BRÉGANCE.
Oui, j’ai bien mon chez moi où je reçois parfois des amies, mais, en dehors de cela, pour une personne intermittente et qui, pour des raisons spéciales, ne peut venir à la maison... parce qu’on la connaît un peu autour de chez moi... pour cette personne, donc, j’ai loué un pied-à-terre, où je la vois très rarement. Il est meublé à l’orientale, mais je n’en suis pas responsable... Je l’ai pris tel que je l’ai trouvé : 92, rue des Mathurins. Au rez-de-chaussée, comme il convient.
Il tire un trousseau de sa poche.
Tiens ! je n’ai pas pris la clé dans mon trousseau... Mais vous en trouverez une autre chez la concierge.
DULAURIER.
Mais me la donnera-t-elle ?
BRÉGANCE.
Vous direz que vous venez...
DULAURIER.
De votre part ?
BRÉGANCE.
De la part du duc de Saint-Simon...
DULAURIER.
Le duc de Saint-Simon ?
BRÉGANCE.
Oui, c’est moi. Pour des raisons spéciales, je, ne voulais pas donner mon nom. Elle me l’a demandé, pour la quittance. Alors, j’ai pris un nom audacieux : duc de Saint-Simon !
DULAURIER.
Grande impression sur la concierge ?
BRÉGANCE.
Non, elle a ri... Elle a dit : quel drôle de nom !... Vous lui donnerez votre nom, à vous, à cette concierge... car il est inutile que votre amie soit obligée de demander après le duc de Saint-Simon...
DULAURIER.
Je vous remercie. Bien entendu, ornais Diana ne saura que vous m’avez prêté votre appartement ?
BRÉGANCE.
Ça m’est égal...
DULAURIER.
Je préfère qu’elle ne le sache pas.
BRÉGANCE.
Elle ne le saura pas. Seulement, si vous lui dites que c’est vous-même qui avez préparé ce petit refuge, elle s’étonnera peut-être de le voir meublé ainsi...
DULAURIER.
À l’orientale ?
BRÉGANCE.
Oui, après tout...
DULAURIER.
Je ne puis vous dire toute ma gratitude...
BRÉGANCE, protestant.
Voyons !
Il va à la porte par où est sortie Diana.
Au revoir, Diana...
Il sort. Dulaurier, un peu ému, attend Diana qui entre l’instant d’après. Il va vers elle, dans un mouvement assez passionné, mais, à mesure qu’il s’approche d’elle, il se calme, la prend tendrement dans ses bras et la baise religieusement sur le front.
DULAURIER.
Diana ! Chère Diana ! Je ne puis vous dire à quel point je suis ému de vous trouver aussi transformée. Quand je pense à la petite rebelle que vous étiez...
DIANA, tendrement.
Et que je ne suis plus, mon cher Georges...
DULAURIER.
Et que vous n’êtes plus, chère petite Diana ! Quand je pense à vos petites révoltes, gentilles, certes, gracieuses... Vous n’en aurez plus, chère Diana. Ah ! je suis tout pénétré de reconnaissance.
DIANA, très émue.
Oui, oui, Georges.
Le regardant dans les yeux.
Vous aussi, vous êtes tout à fait changé...
DULAURIER.
Comment ne le serais-je pas ?
DIANA.
Vous étiez dur, presque méchant. Certes, je ne détestais pas cette dureté et cette méchanceté, car, au fond, je vous aimais déjà et c’était encore quelque chose de vous... Mais comme je suis émue et attendrie de vous voir ainsi changé...
DULAURIER.
Ma chère petite Diana !...
DIANA.
Mon cher Georges !
Ils restent un instant embrassés. Au bout d’un instant.
DULAURIER.
Il s’est opéré en chacun de nous une modification profonde ; nous en sommes encore tout étonnés.
DIANA.
C’est vrai, Georges.
DULAURIER.
Il faut le temps de nous réhabituer l’un à l’autre. Nous nous sommes dépouillés de tout ce que nous avions d’artificiel, et nous voici aussi purs l’un que l’autre... Vous savez que je vous attends demain ?
DIANA, pudique.
Oh ! demain !
DULAURIER.
Ce soir, hélas ! je suis obligé de rendre compte de ma mission à mon chef, au ministère des Affaires étrangères. J’ai encore un rapport à faire mettre au net, et puis... demain, je serais tout à vous...
DIANA, émue.
Mon cher Georges...
DULAURIER, bas.
Il faut vous dire où est mon chez moi, votre chez vous, notre chez nous, qui nous attend... C’est 92, rue des Mathurins, au rez-de-chaussée. À trois heures, voulez-vous ? Je serai dévoré d’impatience... Ma chère petite Diana !... Nous sommes heureux, Diana ?
DIANA.
Oui, nous sommes heureux !
DULAURIER.
Et ce n’est pas du bonheur ordinaire ! C’est du bonheur profond !
DIANA.
Avec une sorte de gravité...
DULAURIER.
Nous sommes gravement heureux...
Silence.
Ma chère Diana !
DIANA.
Mon cher Georges !
DULAURIER.
Nous nous suffisons l’un à l’autre ! Le monde n’existe plus en dehors de nous deux.
Ils restent un instant embrassés.
DIANA.
Voulez-vous dire bonjour à Lénore ?
DULAURIER, avec empressement.
Avec un grand plaisir...
Se ravisant.
Mais j’ai peur d’être en retard. Embrassez-la pour moi... Maintenant, je cours au ministère. Il faut absolument que je rencontre mon chef ce soir pour n’avoir plus rien à faire avec lui... Si j’arrive tard, il ne sera plus au bureau et je serais convoqué pour demain. Embrassez bien Lénore. Excusez-moi auprès d’elle.
DIANA.
Mon cher Georges !
DULAURIER.
Ma chère Diana !
Il sort ; Diana va à la porte de la chambre où est Lénore, et l’appelle.
DIANA.
Lénore ! Viens ! Il est parti ; en me priant de l’excuser auprès de toi... Il voulait absolument voir son chef aujourd’hui, pour ne pas être retenu demain.
Elle embrasse Lénore en se blottissant la tête contre son épaule.
Demain, je dois le voir, demain...
LÉNORE.
Eh bien, tu es heureuse ?
DIANA.
Oui...
Levant la tête.
Oui, oui !
LÉNORE.
Mais pourquoi dis-tu : « Oui ! Oui ! », comme ça ?
DIANA.
Parce que... c’est parce que je ne suis pas heureuse...
Pleurant.
Ma petite Lénore, j’aurais voulu que ça ne soit pas tout de suite, demain... Pourquoi a-t-il demandé que ce soit demain ?
LÉNORE.
Eh bien, je le comprends, ce garçon ! Il te quitte il y a huit jours ! Il vit, pendant ce temps, dans cette espérance... Bien des gens n’auraient même pas attendu jusqu’à demain !
DIANA.
Léonore ! Léonore ! Oh ! il me semble que ce n’est pas du tout ce que j’avais pensé...
LÉNORE.
Mais tu l’aimes ?
DIANA.
Bien sûr, je l’aime ! Si je ne l’aimais pas, ce serait trop horrible ! Je me suis trouvée devant lui toute désorientée. Tu te souviens de ce que je te disais... Je me disais : ma transformation n’est pas achevée... Quand il reviendra, il ne sera pas content encore ! Je vais le retrouver avec des yeux sévères qui me diront : ce n’est pas suffisant... Ah ! Il ne m’a rien-dit de tout cela ! Il y a en lui un être bon, un être plein d’indulgence que je ne connaissais pas. Il faut que je m’habitue à lui.
LÉNORE.
Oui, tu aimais sa méchanceté et tu n’es pas encore arrivée à aimer sa bonté.
DIANA.
Suis-je déjà digne de la comprendre ?... Lénore, Lénore, ce n’est pas du tout ce que j’avais pensé... J’aurais voulu lui parler des lettres que j’avais reçues de mon mari... Puis je n’ai pas osé... j’ai eu peur de le fâcher... Puis, tout de même, ces lettres, je les ai dans la tête... J’oublierais tout cela si je me sentais poussée par quelque chose d’irrésistible... Mais ça n’est pas ça... ça n’est pas ça...
LÉNORE.
Je te comprends ! C’est cet étonnement de ne pas sentir plus de bonheur. Mais ça viendra, va, ça viendra. Tu ne seras pas la première qui sera allée à un rendez-vous sans entrain. Une fois qu’on y est... Quand il te serrera tendrement dans ses bras, tu ne tarderas pas à te sentir heureuse.
DIANA, triste.
Je n’en sais rien...
LÉNORE.
Tu ne peux pas te l’imaginer maintenant.
DIANA.
Justement, je ne peux pas me l’imaginer maintenant ! Mais maintenant, c’est maintenant ! Et, maintenant, je suis malheureuse !
Pleurant.
Lénore !
LÉNORE.
Qu’est-ce qu’il y a ?
DIANA.
Je suis malheureuse que ce soit demain ! Il m’a dit qu’il allait passer une nuit d’impatience... Moi, je vais passer une nuit affreuse...
LÉNORE.
Eh bien, mon petit, si tu es si ennuyée que cela, n’y va pas !
DIANA.
Mais si, je suis obligée d’y aller !
LÉNORE.
Pourquoi ?
DIANA, en plein désespoir.
Il m’aime, comprends-tu, il m’aime !
LÉNORE.
Mais tu l’aimes aussi ?
DIANA, pleurant.
Oh ! oui... je crois... je crois... je crois... Ah ! si demain ne pouvait arriver jamais...
ACTE III
La scène représente le pied-à-terre dont il est parlé au deuxième acte : une sorte de boudoir meublé à l’orientale.
Au lever du rideau, Brégance a son chapeau sur la tête.
BRÉGANCE.
Je vous demande pardon, j’étais un peu inquiet... L’appartement n’a pas été habité pendant de longues semaines et je me demandais si la concierge, mal surveillée, avait fait régulièrement son ménage. Je craignais que ce ne fût un nid de poussière.
DULAURIER.
Mais non, c’est très propre, je vous assure... Vous avez décidément impressionné cette femme avec votre titre de duc et elle vous a servi comme on servait sous l’ancien régime.
BRÉGANCE.
Eh bien ! cher ami, c’est tout ce que j’avais à vous dire ! Je vous laisse, je me dépêche de vous laisser...
DULAURIER.
Vous n’avez pas à vous presser. Il est deux heures. Je n’attends personne encore...
BRÉGANCE, après un silence.
Ah ! mon vieux, ce sont ces moments-là que j’envie ! Le premier rendez-vous n’est pas toujours le plus beau ni le plus charmant, mais il est précédé d’une impatience délicieuse... Je ne m’en suis jamais blasé. C’est pour ça que je suis toujours en quête de nouvelles aventures...
DULAURIER.
Écoutez, Brégance... Au point où nous en sommes, ce serait ridicule de jouer à la discrétion, et je ne suis pas fâché d’avoir un ami à qui dire mes impressions. Quand on se parle à soi-même, on se parle confusément, et avec un peu d’incohérence. Les paroles sont plus fermes et plus justes quand on les profère... Un raisonnement intérieur est paresseux et ne va jamais droit... Depuis hier, ma tête est un chaos d’idées... Il faut que je vous dise d’abord qu’hier, en revoyant Diana transformée, je n’ai pas eu la joie que j’espérais de cette transformation qui, pourtant, était mon œuvre. Il me semble que j’aurais dû m’en réjouir comme d’une victoire...
BRÉGANCE.
Ah ! c’est que la victoire, mon cher ami, c’est moins émouvant que la conquête : la conquête, c’est de l’activité, c’est de la passion ; la victoire, c’est du bonheur immobile... La conquête, c’est de la variété... L’apôtre est une manière de conquérant. Quand la conversion est accomplie, l’apostolat perd beaucoup de son intérêt. Vous dominiez peu à peu Diana, vous aviez raison de ses résistances...
DULAURIER.
J’aimais son indocilité. Sans doute, il y a huit jours, quand je l’ai quittée, je l’avais déjà vaincue. Mais, tout de même, il me semblait que mon œuvre n’était pas terminée... Elle était bien terminée, cependant !... Je me suis trouvé en présence d’un petit être soumis...
BRÉGANCE.
Maté...
DULAURIER.
Annihilé, Brégance, annihilé !... Que l’âme humaine est bizarre ! La curiosité de Diana, ses petites perversités que je blâmais tant, je me demande maintenant si ce n’est pas ce que j’aimais en elle ! Évidemment, j’exagérais tout cela ! Elle n’était pas si perverse que je le croyais, cette pauvre petite : elle n’aurait pas été si vite convertie.
BRÉGANCE.
Voilà maintenant qu’il l’appelle « pauvre petite » ! Quel ingrat !
DULAURIER.
C’est vrai, je suis un ingrat !
S’animant.
Et, vraiment, c’est infâme de ma part !
BRÉGANCE.
Elle vous aime !
DULAURIER, s’animant de plus en plus.
Elle m’aime ! Vous avez raison. Et j’ai le devoir de l’aimer.
BRÉGANCE.
Oh ! bien, si c’est un devoir maintenant ! Voilà qui me fait peur ! L’amour ne peut pas être accompagné d’un devoir... C’est un libre chemineau qui va où il veut et non un touriste de l’agence Cook à qui le devoir, employé rigoureux, trace son itinéraire...
DULAURIER.
Ah ! mon ami, mon cher ami, comme c’est désespérant ! Évidemment, je dois désormais ma vie à Diana ! Même si je l’aimais moins, je devrais lui faire croire que je l’aime. Mais apporterai-je à cette petite assez de passion ? Brégance, je suis très malheureux, très malheureux !... Dites-moi, cher ami, elle et moi, qu’allons-nous devenir ?
BRÉGANCE, avec force.
Mais, mon vieux, envoyez donc promener tous ces raisonnements et dites-vous simplement que vous allez recevoir la visite d’une jolie fille, bien faite, que vous aurez un grand plaisir à serrer dans vos bras ! Quand le proverbe nous dit de ne pas chercher midi à quatorze heures, il nous enseigne par là à bien profiter du présent, de ce qui arrive et à ne pas nous demander ce qui arrivera ou ce qui aurait pu arriver. Vous êtes jeune ! Vous avez été chaste pendant quelques jours... Au revoir, Georges ! Bon appétit ! À propos, il v a ce qu’il faut
comme porto blanc dans la petite armoire...
Il sort. Après le départ de Brégance, Dulaurier marche avec agitation. Il va machinalement vers la petite armoire et en retire une bouteille de porto blanc. Au bout d’un instant, on sonne.
DULAURIER, ému.
La voilà !...
Entre Lénore.
Comment, c’est toi ?
LÉNORE.
C’est moi. Je viens excuser Diana.
DULAURIER.
Ah !
LÉNORE.
Oui, écoute, elle était énervée, presque malade. Elle s’est dit que cette entrevue allait être gâtée par sa nervosité... Il n’y avait aucun moyen de te prévenir... Alors, que veux-tu ? Elle a eu recours à sa fidèle amie... Eh bien ! mon pauvre vieux, qu’est-ce que tu dis de ça !... C’est une fâcheuse nouvelle que je t’apporte ! Je suis une mauvaise messagère...
DULAURIER, un peu déconfit.
Que veux-tu ? Ce n’est pas de ta faute...
LÉNORE.
Je vois que tu avais déjà sorti le porto blanc ? Eh bien, offre-m’en un verre, comme à un commissionnaire...
Souriant.
Oh ! comme tu fais une figure !
DULAURIER.
Tu comprends, ça n’est pas drôle... Ne te fiche pas de moi, au moins !...
LÉNORE.
Mon vieux, je ne pense pas du tout à me moquer de toi, je t’assure !
DULAURIER.
Oh ! tu peux te moquer de moi, tu sais ! Entre nous, il n’y a pas besoin de se gêner !... Nous sommes de vieux camarades. Écoute, Lénore, je veux te faire une confidence au sujet de Diana. Tu es aussi bien mon amie que la sienne. Mais j’ai peur que, si je te dis quelque chose, tu le lui rapportes...
LÉNORE.
Est-ce que je n’ai pas la réputation d’une personne discrète ?
DULAURIER.
Oui, oui. Tu n’es pas particulièrement indiscrète. Mais c’est tellement tentant de révéler un secret !
LÉNORE.
Je crois que je résisterai à la tentation.
DULAURIER.
Ah ! tu désires trop que je le dise... Une confidente ne doit pas être aussi avide de confidences. Je sens que tu attaches trop d’importance fi, ce que je vais te révéler et que tu seras d’autant plus tentée de le rapporter à Diana. Plus un secret est important, plus il est difficile à porter.
LÉNORE.
Alors, ne me dis rien.
DULAURIER.
Si ! Je veux te parler, Lénore. Tiens, assieds-toi là.
Ils s’assoient sur deux chaises assez près l’une de l’autre.
Tout à l’heure, encore, j’ai été très tourmenté au sujet de Diana. Je me demandais, à l’approche du moment décisif, si j’étais sûr de mes sentiments. Est-ce que j’ai suffisamment réfléchi avant de lui dire : je vous aime ?
LÉNORE.
Si on réfléchissait, on le dirait bien rarement.
DULAURIER.
Je n’ai pas eu tort de le dire sans réfléchir. C’est de réfléchir que j’ai eu tort !
LÉNORE.
Alors, tu ne sais plus si tu aimes Diana ?
DULAURIER.
Je ne sais plus...
LÉNORE.
C’est terrible... Alors, quand je suis venue pour te dire que tu ne la verrais pas aujourd’hui, tu n’as pas été aussi déçu que je le pensais ?
DULAURIER.
Si, j’ai été déçu tout de même...
LÉNORE.
Je comprends. Tu n’étais pas sûr de tes sentiments, mais tu n’étais pas fâché de passer un moment avec elle.
DULAURIER.
Eh bien, oui ! Qu’est-ce que tu veux !
LÉNORE.
Ah ! les hommes !
DULAURIER.
Lénore, si je t’ai parlé ainsi avec abandon, c’est que je te considère comme un autre moi-même. Je ne te parle pas comme à une femme ! Tu es ma camarade. Nous sommes des camarades de toujours. C’est tout de même curieux, hein ? de nous trouver tous les deux dans une garçonnière !
LÉNORE.
Oui, le hasard a des idées bien étranges !
Un grand temps.
DULAURIER.
Et, après tout, pourquoi est-ce curieux ? Je suis un homme et tu es une femme...
LÉNORE, souriant.
Nous n’y avons jamais songé ! On a été élevés ensemble, comme deux garçons.
DULAURIER, songeant.
Quand j’avais dix ans, et toi onze, je me souviens que j’avais un certain plaisir à te prendre sur mes genoux. On disait : « On va jouer, je suis ton père, tu es ma fille... » Je ne savais pas que ça me faisait plaisir : je ne te l’avouais pas, ni à moi non plus... Quand nous avons été un peu plus grands, j’avais douze ans et toi treize, nous nous racontions toutes les choses pas convenables que-nous pouvions dénicher.
LÉNORE.
Je me souviens...
DULAURIER.
Nous disions des choses indécentes sans penser à en faire, de la façon la plus innocente, comme deux, petits chercheurs de vérités qui découvrent la vie ensemble...
Silence.
Puis on a été séparés pendant deux ou-trois ans.
LÉNORE.
Quand tes parents sont allés en Angleterre...
DULAURIER.
À mon retour, tu étais une grande fille de dix-sept ans, et tu te faisais courtiser par les jeunes gens... Tu me regardais comme un gosse...
Songeur.
En somme, il m’est arrivé bien rarement de penser que tu étais une femme...
Silence.
Mais, maintenant, je me demande si cela m’est arrivé aussi rarement que cela... Dis donc, Lénore, on s’est peut-être aimés, sans s’en douter ?
LÉNORE.
On ne s’aimait pas... Pour s’aimer, il faut se le dire...
DULAURIER.
C’est vrai.
Un silence. Il la regarde.
Qui est-ce qui m’empêcherait de te le dire un jour ?
LÉNORE.
Tu es bête !
DULAURIER, s’approchant d’elle.
Si je te le disais...
LÉNORE.
Ne me le dis pas...
DULAURIER.
Pourquoi ça ?
LÉNORE.
Tu m’ennuies, Georges... Je n’ai jamais eu peur de toi... C’est tellement gentil d’être camarades...
DULAURIER.
Mais s’en aperçoit-on jamais que c’est gentil ?... On n’en profite pas... Lénore, donne-moi ta main...
LÉNORE.
Non, non !
DULAURIER.
Tu ne veux pas donner la main à ton vieux camarade ?
LÉNORE.
Ce n’est pas mon vieux camarade qui me la demande...
DULAURIER.
Ah ! Lénore, prends garde ! Si tu me refuses la main, je vais maintenant te regarder comme une femme... Lénore, donne-moi la main !
LÉNORE, lui tendant la main.
Je veux te prouver que je n’ai pas peur de toi.
DULAURIER, lui prenant la main.
Tu veux essayer de te le prouver à toi...
Silence. Il lui caresse la main.
Je ne connais pas de camarade qui ait une main aussi douce...
Lui baisant la paume de là main.
C’est exquis de découvrir chez une femme que l’on connaît depuis toujours une femme que l’on ne connaissait pas... Lénore, je t’en prie !
LÉNORE.
Georges, tu vas te taire !... Georges, tais-toi !
DULAURIER.
Je t’en prie, Lénore ! Je me demande quel mal il y a à te dire tout cela ? Ne sommes-nous pas libres l’un et l’autre ?
LÉNORE.
Non. Il y a les deux camarades que nous étions ; il me semble qu’ils nous regardent...
DULAURIER.
Non, Lénore, ils s’effacent peu à peu... Tu dis toi-même : les deux camarades que nous étions...
LÉNORE.
Et puis, je sais bien à quoi m’en tenir : tu attendais Diana, elle n’est pas venue... Alors, tu étais disposé à adopter la première qui viendrait...
DULAURIER.
Oh ! te voilà coquette, maintenant ! Bravo ! la camarade a tout à fait disparu... Non, Lénore, je n’attendais pas Diana... J’attendais quelqu’un qui s’appelait-Diana, mais qui, dans mon esprit, était autre chose que Diana... J’espérais que-Diana arriverait à être celle que j’attendais... Je ne te dirai pas que c’était toi que j’attendais... Je crois pourtant que je te le dirai tout à l’heure... bientôt... et ce sera vrai quand je te le dirai... Car celle qu’on aime dans le présent, on n’est pas seulement sûr de l’aimer dans l’avenir, on est certain qu’on l’a aimée dans le passé, même ne l’aurait-on jamais vue...
Il s’est approché d’elle davantage, mais elle se lève.
LÉNORE.
Tais-toi, je ne veux pas me fâcher. Tais-toi...
Elle va s’asseoir assez loin de lui, songeuse.
C’est curieux... Je pense à une conversation que j’ai eue hier avec Brégance. Il prétendait...
DULAURIER.
Il prétendait ?
LÉNORE.
Je ne veux pas te le dire !
DULAURIER, pressant.
Si, dis-le moi !
Il vient s’asseoir à côté d’elle.
LÉNORE.
Il prétendait que je t’aimais.
DULAURIER.
Tu vois !
LÉNORE.
Et, comme je lui disais qu’au contraire je faisais tout mon possible pour te rapprocher de Diana, il répondait que cela n’était pas une raison... Georges, crois-tu ? Pourquoi disait-il cela ?
DULAURIER.
Parce que cela était, ma chère Lénore...
LÉNORE, incrédule encore.
Tais-toi... Quand tu faisais de la morale à Diana, quand tu paraissais exaspéré de l’existence qu’elle menait, j’aurais dû être jalouse que tu ne t’occupes pas de mon existence à moi. Il t’était indifférent de me voir faire des bêtises... Depuis quelques instants, je t’en veux de cela... Tu prétends que tu tiens à moi et tu ne t’es jamais occupé de ma vie...
DULAURIER.
C’est cette espèce d’aveuglement mutuel qui nous séparait l’un de l’autre. Mais tout a changé, Lénore. Aujourd’hui change la face d’hier...
LÉNORE.
Georges, si tu avais essayé d’avoir de l’influence sur moi, peut-être t’aurais-je écouté ? N’étais-je pas capable, comme Diana, de profiter de tes leçons ?
DULAURIER, vivement.
Non, non, ne fais pas comme Diana ! Reste ce que tu es, chère, chère Lénore, reste ce que tu es ! Je ne veux pas risquer de te perdre en te modifiant.
Avec ardeur.
Ce que j’aime en toi, c’est toi, et je ne fais pas attention à les manières d’être ! J’ai découvert, Lénore, une autre femme en toi... mais les autres sont restées ! Je veux serrer dans mes bras toutes les Lénore : ma compagne d’enfance, celle que j’asseyais innocemment et sournoisement sur mes genoux, la petite fille curieuse qui bavardait dans les coins avec moi, la dédaigneuse jeune fille qui m’abandonnait pour des grands garçons de vingt ans et aussi la Lénore d’hier, avec ses perversités et ses curiosités qui me plaisent en elle... Car tout me plaît en toi : je ne veux rien modifier, rien retrancher de toi, et je suis bien guéri de ma vocation d’apôtre...
Il la serre dans ses bras longuement.
LÉNORE.
J’ai eu tort de venir...
DULAURIER.
Puisque tu es venue, maintenant...
LÉNORE.
Tu penses que je ne me doutais pas de ça !
DULAURIER.
Je pense bien !
LÉNORE.
Tu penses bien, mais... Je ne veux pas te mentir. J’avais la vague idée qu’il allait se passer quelque chose. Et puis, en te voyant, je me suis dit : il ne va rien se passer. Et j’en ai été bien soulagée d’abord. Puis, peu à peu, tu m’as parlé... Oh ! Georges !
Long baiser.
DULAURIER, hypocrite.
J’ai peur que Brégance ne vienne ici et ne nous surprenne.
Montrant la porte de gauche.
Il faudrait aller par là.
LÉNORE.
Non, mon petit, non !
DULAURIER.
Si, ma petite, si !
Il l’entraine lentement vers la porte de gauche.
Viens, Lénore, viens !
Elle se défend. À ce moment, on entend du bruit. Il la fait entrer à gauche, et reste en scène.
BRÉGANCE, entrant. Il voit Dulaurier gêné. D’un ton confus.
Je vous demande pardon, je vous croyais seul... Figurez-vous qu’il y a cinq minutes j’étais chez moi et Diana m’a téléphoné qu’elle ne sortait pas de chez elle... Alors, je vous croyais seul...
DULAURIER.
Non, non, ça ne fait rien. Vous êtes très bien arrivé, au contraire... Cher ami, puisque vous êtes là, voulez-vous me rendre le service de téléphoner chez moi... J’avais fait venir, pour copier un rapport, quelqu’un du ministère qui devait m’attendre pour me montrer son travail. Voulez-vous lui dire que je ne rentrerai qu’assez tard et qu’on revienne demain matin ?... Excusez-moi...
BRÉGANCE.
C’est moi qui m’excuse...
Sort Dulaurier. Brégance décroche le récepteur.
Hé ! hé ! il y a quelqu’un là ! Ce n’est pas Diana. Qui ça peut-il être ?... Allô ! Wagram 02-11 ?... Est-ce que j’aurais gagné mon pari ? Je crois que j’ai gagné mon pari... Allô !... C’est chez M. Dulaurier ? Qui est à l’appareil ?... Ah ! une sténographe du ministère.
À lui-même.
Jolie voix !
Dans l’appareil.
Vous avez une jolie voix, mademoiselle ! Êtes-vous jolie ?... On le dit ?... On doit avoir raison !... C’est une commission que j’ai à vous faire de la part de M. Dulaurier... Au fait, je vais passer chez lui et je vous ferai cette commission de vive voix... À tout à l’heure, mademoiselle.
Il raccroche l’appareil.
Mon innocence enfin commence à me peser...-Je me sens en humeur d’apostolat...
Il va pour sortir.