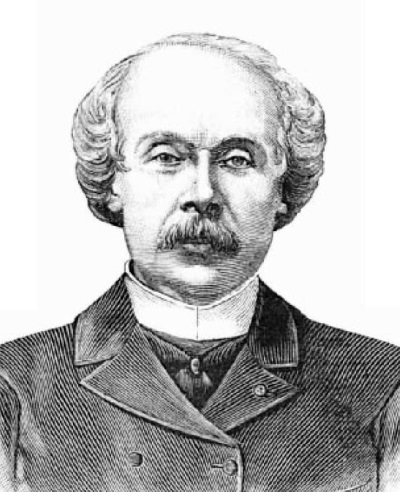Les Garçons de recette (Adolphe D’ENNERY - Élie BERTHET)
Drame en cinq actes.
Représenté pour la première fois, sur le théâtre de l’Ambigu-Comique, le 23 mai 1840.
Personnages
MARIGNON
JOSEPH DUVAL
DOMINIQUE
FAGEROLLES
MOULINET
CHAMBORAN
JULES BIDAUT
DURAND
TRUBERT, adjudant
MARIE
LOUISE MARIGNON
HENRIETTE
UN MÉDECIN
UN SERGENT de chiourmes
PREMIER GARÇON
DEUXIÈME GARÇON
IVAN, domestique
UN COMMISSAIRE
ACTE I
Le théâtre représente la grande salle des garçons de la Banque. Au lever du rideau, plusieurs garçons, chargés de sacs d’argent, entrent dans les bureaux, tandis que d’autres en sortent. Quelques individus viennent solder des effets.
Scène première
DURAND, JEUNES HOMMES, GARÇONS
UN JEUNE HOMME.
M. André, s’il vous plaît ?
DURAND.
Le septième bureau, rangée du milieu.
LE JEUNE HOMME.
Merci
Il remonte la scène.
DEUXIÈME JEUNE HOMME.
Numéro 3 ! c’est ici le bureau de M. Durand ?
DURAND.
C’est moi, Monsieur.
DEUXIÈME JEUNE HOMME.
Il s’agit d’un billet que je viens acquitter pour la maison Rouvière et compagnie.
DURAND.
Il est trop tard ; le billet n’est plus entre nos mains.
TROISIÈME JEUNE HOMME, à un garçon.
Voudriez-vous m’indiquer le bureau de monsieur Marignon ?
LE GARÇON.
Numéro 2.
Désignant le premier bureau sur le devant de la scène.
Le voilà.
DURAND.
Revenez dans un quart-d’heure, Monsieur Marignon n’est pas encore arrivé, mais il ne peut tarder. Marignon est le plus exact des garçons de recette.
LE JEUNE HOMME.
On m’avait dit pourtant... J’attendrai.
Il s’éloigne.
DURAND.
C’est la première fois que Marignon n’est pas le premier à son poste.
DEUXIÈME GARÇON.
Il faut qu’il lui soit arrivé quelque chose.
DURAND.
Oui, certes ; car depuis vingt ans que nous sommes employés tous les deux à la Banque, jamais une plainte ne s’est élevée contre lui, jamais un reproche ne lui a été adressé, et je m’étonne souvent qu’il ne soit pas devenu brigadier comme moi.
PREMIER GARÇON.
Il a toujours eu du malheur.
DURAND.
C’est vrai ; depuis quelque temps, surtout, il a fait de grandes pertes d’argent, et au lieu d’avoir cette aisance dont nous jouissons presque tous, le pauvre Marignon est, je le crains, bien près de la misère.
PREMIER GARÇON.
Il est vrai qu’il a eu tant de charges... D’abord, son fils Dominique qui commence à peine à gagner quelque chose, et dont l’apprentissage lui a tant coûté... Ensuite, Mlle Marie, sa nièce, une bien jolie fille, ma foi !
DURAND.
Mais aussi bien vertueuse, et par conséquent bien pauvre... Et notre confrère Joseph Duval, que vous ne comptez pas ! Marignon a pris soin de lui depuis la mort du père Duval, c’est à-dire depuis vingt ans, jusqu’au jour où il a fait obtenir à Joseph une place parmi nous. Oh ! dans le temps, Marignon a rendu de fameux services au père Duval ! il l’a empêché d’être déshonoré ! Ce fut tout une histoire, à la Banque... Vous êtes trop jeunes, vous, pour avoir entendu parler de cela !
DEUXIÈME GARÇON.
Ce que je sais, c’est que Joseph est un brave garçon, quoiqu’un peu fier peut-être, et surtout un peu trop triste.
DURAND.
Cette tristesse est causée par le souvenir des malheurs de sa famille !... Mais Marignon, Marignon qui n’arrive pas !
PREMIER GARÇON.
Tenez, voici sa nièce, Mlle Marie.
DEUXIÈMEGARÇON.
Et elle est accompagnée d’un jeune drôle qui demeure dans sa maison, et qui paraît tout fier de donner le bras à une aussi jolie fille.
Scène II
LES MÊMES, MARIE, MOULINET
Marie et Moulinet vont droit au bureau de Marignon et s’arrêtent, étonnés de ne pas voir le garçon de recette à sa place ordinaire ; Moulinet entre en donnant le bras à Marie, avec des apparences un peu comiques du plus profond respect.
DURAND.
Vous veniez voir Marignon, Mademoiselle ?
MARIE.
Oui, Monsieur ; je voulais parler à mon oncle. Il a laissé, ce matin, sa femme assez souffrante, et il m’a prié de venir ici lui donner de ses nouvelles... Je m’étonne qu’il ne soit pas encore arrivé.
MOULINET.
Mademoiselle et moi, nous nous étonnons qu’il ne soit pas encore...
DURAND.
Il avait sans doute quelques billets à recevoir en route... il ne tardera pas,
MARIE.
Alors, je vais l’attendre.
MOULINET.
Mademoiselle et moi, nous allons l’attendre.
DURAND.
Est-ce que vous êtes déjà de la famille, jeune homme ?
MOULINET.
Moi ?... au contraire.
DURAND.
Comment, au contraire ?
MOULINET.
Je le voudrais, que je ne le pourrais pas ; et je le pourrais, que je ne le voudrais pas.
DURAND.
Vous ne le voudriez pas ?
MARIE, à Moulinet.
Que signifie, Monsieur ?...
MOULINET.
Minute ! on demande à exhiber le motif... Pour faire partie de cette honorable famille, à laquelle je suis étranger, il faudrait nécessaire ment que je m’y mariasse...
Marie s’assied à l’écart.
DURAND.
Eh bien ?
MOULINET.
Eh bien ! la branche féminine ne se compose, pour la moitié, que de la demoiselle Marie, ici présente, qui est déjà chérie de son cousin Dominique et de votre confrère Joseph Duval, qui veut l’épouser entièrement ; donc, celle-là je le voudrais, que je ne le pourrais pas... l’autre personne de la famille, est la nommée Mme Marignon, atteinte d’une quarante-neuvaine d’an nées, celle-là je le pourrais, que je ne le voudrais pas ; donc, aucun moyen de m’allier aux Marignon.
DURAND.
Alors, vous êtes une connaissance, un ami ?
MARIGNON.
Connaissance, jamais ! ami, toujours !... Je suis le nommé Moulinet Folichon, dit Belle Boule, ainsi appelé à l’atelier, à cause de mon regard enchanteur, de mon nez séducteur et de ma bouche... en cœur.
TOUS, riant.
Ah ! ah ! ah !
MOULINET.
On peut rire à son aise, on ne paie rien pour ça.
DURAND.
Et votre état, jeune homme ?
MOULINET.
Fabricant de passe-lacets et auteur dramatique.
DURAND.
Ah bah ! Vous faites donc des pièces ?
MOULINET.
Toujours.
DURAND.
Et on les joue ?
MOULINET.
Jamais.
PREMIER GARÇON, à Marie.
Voici votre oncle, Mademoiselle.
TOUS.
Marignon !
PREMIER GARÇON.
Il vient avec Duval.
Scène III
LES MÊMES, MARIGNON, DUVAL
MARIGNON.
Ah ! te voilà, Marie ! eh bien ?
DUVAL.
Votre tante, comment se trouve-t-elle, ce matin ?
MARIE.
Mieux, beaucoup mieux... Elle sommeillait paisiblement quand je l’ai quittée pour venir vous rassurer un peu.
MARIGNON.
Merci, ma bonne enfant !...
Il l’embrasse.
Cette nouvelle va me donner du cœur pour toute la journée... les sacs de mille francs ne pèseront pas un quarteron. Et maintenant,
Allant à son bureau.
excuse-moi, ma nièce ; parce que, vois-tu, il y a là quelque chose de sacré qui m’appelle.
DUVAL, à Marie.
Et vous avez laissée seule votre tante malade ?
MARIE.
Non, Joseph ; j’ai prié Henriette de rester près d’elle.
DUVAL.
Encore Mlle Henriette !
Avec un accent de reproche.
Je vous avais prié, Marie, de ne plus la voir !
MARIE.
Mais... après tous les services qu’elle m’a rendus, puis-je, sans ingratitude, rompre avec elle ?
DUVAL.
Des services... Convenez plutôt, Marie, que vous aimez Henriette, parce qu’elle flatte vos rêves de grandeurs, de coquetterie, de luxe !...
MARIE.
Ce soupçon, M. Duval...
DUVAL.
Est injuste, peut-être !... soit ; pardonnez-moi ma sévérité.
L’examinant.
Comme vous êtes parée, aujourd’hui, Marie !... Qui penserait, à vous voir ainsi, que vous êtes une pauvre ouvrière ?
MARIE, embarrassée.
C’est que... c’est que je devais aller...
Duval se dirige vers son bureau sans l’écouter.
MARIGNON, sortant de son bureau, à Moulinet.
Eh bien ! et toi, garçon, tu ne dis rien... qu’est-ce qui t’amène ?
MOULINET.
D’abord, père Marignon, j’ai accompagné votre pièce en qualité de porte-respect, pour la garantir des regards des gants serins, et des cannes à pommes d’or...
MARIGNON.
Je comprends. Jamais.
MOULINET.
Ensuite, j’attends votre fils Dominique, pour la chose de la mairie.
MARIGNON.
Oui, c’est aujourd’hui que vous tirez tous les deux à la conscription.
MOULINET.
Il m’a donné rendez-vous ici... Dans une heure, je plonge ces cinq doigts-là dans le chapeau de Monsieur le Maire.
MARIGNON.
Tu ne crains donc pas de devenir soldat ?
MOULINET.
Je ne l’ai jamais craint.
MARIGNON.
Tu es brave, mon ami !
MOULINET.
Je suis brave... et exempt du service. Mon père m’a fait assurer le jour de ma naissance.
MARIGNON.
C’est une précaution que j’ai prise à l’égard de mon Dominique.
MOULINET.
Il ne se presse guère, le Dominique en question !... Je vais me promener en l’attendant ; je vais regarder les piles d’écus, ça me divertira... Moi, il n’y a que deux sortes de boutiques devant lesquelles je m’arrête, les changeurs et les marchands de comestibles ; deux états qui m’auraient bien convenus ! les comestibles, surtout !
Il remonte la scène.
MARIE, regardant du côté de Duval, à part.
Il est fâché contre moi... Je ne voudrais pourtant pas m’en aller sans lui parler.
À Marignon.
Allons, mon oncle, je retourne auprès de votre femme.
MARIGNON.
Va, mon enfant ; ne la quitte pas, surtout.
Elle s’éloigne en regardant toujours du côté de Duval.
Eh bien ! tu ne dis rien à ce pauvre Duval ?
MARIE, timidement.
Il paraît bien occupé... je crains de le déranger...
MARIGNON.
Bah ! Joseph !...
DUVAL, sortant d’une profonde rêverie.
Hein ?... que me veut-on ?
MARIGNON.
Eh ! pardieu ! c’est Marie qui s’en va, et cette enfant est toute chagrine de voir que son fiancé ne lui dit rien.
DUVAL.
Mlle Marie !... oui, me voilà... je croyais...
Il sort de son bureau.
MARIGNON.
Va donc, mais va donc... Moi, je vais examiner ta caisse... Je sais bien qu’il n’y a pas d’erreur, mais c’est égal.
Bas.
Ça me donnera une contenance plus respectable pour moi, et...
Souriant avec bonhomie.
et moins gênante pour vous...
Il va au bureau de Joseph et compte de l’argent avec préoccupation. Duval se dirige vers Marie, puis s’arrête étonné en voyant Bidaut qui s’approche d’elle et lui parle cavalièrement.
Scène IV
LES MÊMES, BIDAUT
BIDAUT, à Marie.
Eh ! je ne me trompe pas, c’est la charmante Mlle Marie que j’ai l’honneur de saluer !
MARIE, à part.
Ciel ! M. Bidaut !
Haut.
En effet, Monsieur ; mais, veuillez m’excuser, il faut que je m’éloigne...
DUVAL, à part.
Quel est cet homme ?
BIDAUT.
Déjà ! quand je m’applaudissais de rencontrer un plaisir, un bonheur, où je ne venais chercher que des affaires !
MARIE.
C’est par hasard, Monsieur, que je me trouve ici. Mon oncle est...
BIDAUT.
Garçon de recette, je sais cela... Mon frère est un des principaux administrateurs de la Banque, et si vous désirez obtenir par sa position, par son crédit...
DUVAL, se plaçant entre eux deux.
Mlle Marie n’a rien à solliciter, Monsieur. Son oncle n’attend d’avancement que de ses services, et non de la faveur...
MARIE
Joseph !...
BIDAUT, le regardant avec son lorgnon.
Qui êtes-vous, mon ami ?
DUVAL.
Je suis...
BIDAUT.
Ah ! je vous reconnais ! vous êtes un de nos employés, le numéro un, je crois... Eh bien ! monsieur le numéro un, vous aurez à toucher aujourd’hui chez nous une très forte somme, et je vous recommande...
DUVAL.
Je ne reçois, Monsieur, de recommandations que de mes chefs. Je me nomme Joseph Duval et je suis le fiancé de Mlle Marie.
BIDAUT.
Son fiancé ! je vous en félicite.
DUVAL.
Trêve de compliments, Monsieur !
BIDAUT, à Marie.
C’est la première fois, Mademoiselle, que j’entends parler de ce mariage ; Henriette, notre amie commune, me l’a toujours laissé ignorer.
DUVAL.
C’est qu’apparemment, Monsieur, Henriette, votre amie commune, a sagement pensé que cela ne vous intéressait pas.
BIDAUT.
Tout le monde n’est peut-être pas de votre avis, monsieur le numéro un !
DUVAL, avec colère.
Encore une fois, Monsieur, je me nomme Joseph Duval.
MARIE, se plaçant entre eux.
Messieurs !...
À Bidaut.
J’ignore ce qu’a pu vous dire Henriette... C’est une bonne fille, dont le cœur est excellent, mais dont la tête est souvent légère... et sans la reconnaissance que m’imposent des services...
DUVAL, à part.
Encore !
BIDAUT, avec empressement.
Des services que votre noblesse d’âme exagère. Vous ne devez rien à Henriette, je vous jure !...
MARIE.
Que voulez-vous dire, Monsieur ?
BIDAUT.
Rien, sinon qu’elle est assez payée par le bonheur de vous être utile...
Bas.
et que je m’estimerais trop heureux de pouvoir faire pour vous... mille fois plus... que n’a fait Mlle Henriette.
MARIE.
Monsieur, je ne sais...
DUVAL.
Marie, vous oubliez que votre tante est malade et qu’elle vous attend. Vous désirez, j’en suis sûr, que cet entretien finisse ; et je désire, moi,
À Bidaut.
qu’il ne se renouvelle pas.
Il prend Marie par la main, Bidaut la salue.
BIDAUT, à part.
Décidément monsieur le numéro un est jaloux !... Tant mieux ! j’aime les obstacles ; c’est plus piquant !... Maintenant, vienne cet homme qui m’a promis son aide, et je suis sûr du succès !
Il sort après avoir salué de nouveau.
Scène V
MARIE, DUVAL
DUVAL.
Marie, vous connaissez cet homme ?
MARIE.
Je l’ai rencontré une ou deux fois... chez...
DUVAL.
Chez Mlle Henriette, n’est-ce pas ?
MARIE.
Non.
DUVAL.
Où donc, alors ?
MARIE.
Chez la dame à qui appartient le magasin de lingerie où travaille Henriette ; elle donne de brillantes soirées,
DUVAL.
Et... et vous avez assisté à ces bals, à ces fêtes, vous, Marie ?
MARIE, avec hésitation.
Une fois seulement...
DUVAL.
Cette fête était bien brillante, n’est-ce pas ? Il y avait là sans doute des femmes bien belles, bien parées, des hommes bien riches, bien élégants ?
MARIE, naïvement.
Et comme ce monde est différent de celui que nous voyons tous les jours !... comme il est aimable, gracieux !... Oh ! je n’oublierai jamais cette soirée passée dans ce beau salon ! on y respirait un parfum de joie et de bonheur qui enivrait !
DUVAL, avec un peu d’amertume.
Vous avez raison, Marie ! il enivre !
Reprenant le ton caressant.
Et au milieu de cet entraînement de la fête, vous écoutiez sans colère les propos galants, les paroles d’amour de quelqu’adorateur ?
MARIE.
Un seul a osé se permettre...
DUVAL, souriant.
M. Bidaut, n’est-ce pas ?
MARIE.
Oui ; mais je vous jure que je l’ai toujours mal accueilli.
DUVAL.
Mais les autres... ces hommes si polis et si riches, attachaient aussi sur vous des regards d’admiration.
MARIE.
Ce n’était que pour vous que j’en étais fière, Joseph !
DUVAL.
Et les femmes enviaient votre beauté, comme peut-être vous enviiez leur toilette.
MARIE, avec chaleur.
Et leur envie me rendait si heureuse ! Oh ! si un seul moment j’avais eu leur robe si belles et leurs bijoux, pour les éclipser tout-à-fait... je le sens, mon ami, rien n’eût manqué à mon bonheur, à mon triomphe !
Duval s’éloigne d’elle brusquement et porte une main à ses yeux.
DUVAL, d’un ton déchirant.
Oh ! mon Dieu ! voilà ce que je craignais pour elle !
MARIE, effrayée.
Mon ami, qu’avez-vous ?... mais il n’y a pas de mal à tout cela, n’est-ce pas ?... Qu’importe que le souvenir de ce monde éblouissant, que je n’ai vu qu’une fois, revienne par moments à ma pensée, si je vous aime de toute mon âme, si...
DUVAL.
Ce qu’il importe, Marie, c’est que votre vie tout entière ne soit pas malheureuse ou coupable.
MARIE.
Coupable !
DUVAL.
C’est que notre union ne devienne jamais funeste à l’un et à l’autre.
S’approchant d’elle, d’une voix sourde.
Pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être, l’amour de votre époux éteindra cet amour de plaisir et d’éclat qui vous dévore ; puis, viendront les souvenirs, puis, les regrets, puis, les larmes... Et vos larmes, Marie, je mourrais rien que de les voir couler.
MARIE.
Duval !
DUVAL
Oh ! vous n’avez pas encore su me connaitre. Élevé à l’école du malheur, j’ai appris à renfermer dans mon cour toutes mes passions, tous mes désirs, toutes mes souffrances... et quand, tremblant de fléchir, je détournais mes regards de ce monde qui me fascinait... vous vous disiez : « Heureux Duval ! qui n’a pas de désirs ! » Et lorsque je vous reprochais, avec une froideur calculée, votre ambition, votre amour pour les plaisirs et les grandeurs, vous vous disiez encore : « Il est sévère et cruel, lui ; il ne connaît ni cette ambition, ni cet amour. »
MARIE.
Eh bien ?
DUVAL.
Eh bien ! vous vous trompiez, Marie. Ils se trompaient tous ceux qui, s’arrêtant à la surface, admiraient le calme apparent de mon âme ! car c’est la main de la misère qui m’a enchaîné à cette profession que j’exerce ; car je rêvais à vingt ans toutes ces joies, tout ce bonheur que vous rêvez aussi... car maintenant ma pauvreté me pèse, m’écrase... Vous aimez le luxe, et je ne puis pas vous donner de luxe ; vous aimez l’éclat et les richesses, et je ne puis vous donner ni éclat, ni richesse, moi qui suis obscur, pauvre !... pauvre... Oh ! prenez pitié de moi, Marie ; car j’avais mes propres douleurs qui m’accablaient depuis long-temps, et voilà que les vôtres sont venues mettre le comble à mon supplice.
MARIE.
Duval ! Duval... oui, je vous méconnaissais, oui, j’étais bien injuste envers vous.
DUVAL.
Ce n’est pas tout encore : dans cette salle, sans relâche, une nouvelle torture se joint à mes tortures secrètes... j’entends le bruit de l’or et de l’argent ; ce bruit, je l’entends le soir quand je suis seul dans ma chambre, je l’entends la nuit, quand je rêve ; il me réveille en sursaut !... Ce bruit, Marie, il me poursuit ici, dehors, dans mes douleurs, dans mes plaisirs, partout, toujours !... Quand je suis pauvre, quand je songe à votre pauvreté... autour de moi de l’or, sous ma main de l’or, toujours de l’or !... Il éblouit mes yeux ; plusieurs fois le jour, il fatigue mes deux mains à le compter, il pèse sur mes épaules comme un fardeau... et je suis pauvre ! Et pour compenser tant de supplices, j’ai seulement le droit de porter la tête bien haute et de dire avec orgueil : « Voyez ! voyez ! je suis un honnête homme ! »
MARIE.
Et cette récompense, Joseph, vous suffira, j’en suis certaine... Moi, je vous promets de ne plus m’abandonner à mes folles illusions, à mes désirs insensés !... Bon courage, Duval ! et puis, qui sait, vous pourrez peut-être devenir riche !
DUVAL.
Riche ! Mais songez donc à ce que je suis !... Riche ! c’est impossible ! jamais !
MARIE.
Jamais !... Eh bien ! nous nous résignerons... Mais l’heure me presse ; adieu, adieu, mon ami.
DUVAL, accablé.
Adieu, Marie !
MARIE.
Adieu.
À part.
Jamais !
Scène VI
LES MÊMES, moins MARIE
DUVAL.
Se résigner, mais c’est dévorer ses larmes, c’est toujours souffrir.
MARIGNON, venant à lui gaiment.
Eh bien ! garçon, à quand ce mariage ? avez-vous arrêté ça, toi et ma nièce ? Vous venez de causer un bon bout de temps, j’espère. Mais cela ne prouve rien, les amoureux, après onze heures de conversation, ça ne s’est encore dit qu’une chose : Je t’aime !... À moins qu’ils ne se disent rien du tout... C’est pourtant comme ça que j’étais, il y a vingt ans, avec ma pauvre femme, qui répondait en rougissant jusqu’aux oreilles... ce qui ne nous a pas empêché de bien nous aimer ; ce qui ne l’a pas empêché, elle, de me rendre bien heureux et de me donner, après quelques années de mariage, le grand garçon qui vient là... mon Dominique.
Scène VII
LES MÊMES, DOMINIQUE, MOULINET
DOMINIQUE.
Bonjour, mon père... M. Duval, je vous salue.
DUVAL.
Bonjour, Dominique.
MARIGNON.
M. Duval ! qu’est-ce que c’est que ce ton-là ? Tu ne peux pas l’appeler Duval tout court, et lui serrer la main ?
MOULINET, bas.
Le papa ne se doute pas de la rivalité d’amour.
MARIGNON.
Eh bien ?
DUVAL.
En effet. Auriez-vous quelque sujet de m’en vouloir, Dominique ?
DOMINIQUE.
Moi ! aucun, aucun assurément.
DUVAL, lui tendant la main.
Mais, pourquoi donc, alors ?...
MOULINET, bas à Dominique.
Mais prête-lui donc ta main... il te la rendra, bêta !
Ils se donnent une poignée de main ; Moulinet en donne une aussi à Duval.
MARIGNON.
À la bonne heure... Ainsi, vous allez à la mairie ?
DOMINIQUE,
Oui, mon père.
MOULINET.
Nous y allons au pas de charge, comme des braves qui n’ont rien à craindre.
MARIGNON.
Ah ça, n’allez pas tirer de bons numéros, dites donc ?
DUVAL.
Comment ! pourquoi ?
MOULINET.
Au fait, oui, comment ! pourquoi ?
MARIGNON.
D’abord, parce que ça me ferait presque regretter d’avoir fait assurer Dominique, s’il doit être exempt, par le sort... et ensuite parce qu’il faut laisser les gros numéros pour les pauvres diables qui ne peuvent payer de remplaçants.
MOULINET.
C’est juste ! Mon choix est fait, le premier après le zéro, autrement dit, le un. Voilà ce que je veux.
DOMINIQUE.
Vous avez eu tort, mon père, de consacrer à mon rachat une si forte somme. Il eut mieux valu peut-être me laisser partir.
DUVAL.
Que dites-vous, Dominique ?
MARIGNON.
Partir !
MOULINET, à part.
À cause de sa malheureuse amour !
DOMINIQUE.
Vous ne comprenez pas, M. Duval, ce désir de quitter Paris, vous qui êtes heureux ici, vous qui aimez et qui êtes aimé ?
MOULINET, à part.
Allusion du même à la même !
MARIGNON.
Ah ça ! qui donc ne t’aime pas, ingrat ?
DOMINIQUE.
Demandez plutôt de qui je suis aimé, mon père ?
MARIGNON.
Hein ? eh bien ! et moi donc ! et votre mère, Monsieur, votre pauvre mère !... Vous parlez de vous faire soldat, mais ne savez-vous pas que la séparer de vous ce serait la tuer ? ne sais-tu pas que je mourrais, Dominique, si tu n’étais plus près de moi ?
DOMINIQUE.
Oui, vous avez raison ; maudissez-moi, mon père, car vous l’avez dit, je suis un ingrat !
MARIGNON.
Allons, je te pardonne ; mais plus de ces idées-là, mon garçon, je t’en prie.
MOULINET.
Certainement ! imite mon exemple. Est-ce que j’ai des idées, moi ?... jamais. Image du pin son, j’en ailes meurs et la chanson.
MARIGNON.
Allons, en route ! ne faites pas attendre le gouvernement ; les affaires de la Banque nous réclament.
DOMINIQUE.
Adieu, mon père.
MOULINET.
En avant, marche ! Allons-nous en voir des mines déconfites et des nez allongés, des nez de vingt-cinq centimètres. Adieu, père Marignon et la compagnie.
DUVAL.
Adieu, mes amis, adieu.
Scène VIII
MARIGNON, DUVAL
DUVAL.
Votre fils a quelque chagrin secret ?
MARIGNON.
Je m’en suis aperçu, et il faudra que j’en découvre la cause... quelque amourette, sans doute ? car du reste, il est comme son père, qui s’est toujours contenté de son sort, et à qui son travail a toujours suffi pour vivre tranquille et heureux, jusqu’au jour où j’ai perdu mon plus cher ami ton pauvre père, Joseph... Ce n’est pas pour te le reprocher, garçon, mais il m’a fallu faire de grands sacrifices pour conserver intacts son honneur et son nom.
DUVAL, ému.
Oh ! oui, je le sais, Marignon ; et si, quelque jour, vous aviez besoin de ma vie...
MARIGNON.
Ta vie ! que veux-tu que j’en fasse ?... Enfin, mon garçon, pour en revenir à mes affaires, tout est réparé maintenant... Grace au ciel, j’ai fait des économies, et si je n’ai pas, comme tous nos confrères, une petite fortune, j’ai pu du moins compléter hier, chez M. Dermont le banquier, le prix de l’assurance de mon fils Dominique, et les douze cents francs pour lesquels j’ai été poursuivi, il y a trois mois.
DUVAL.
Ainsi, vous ne craignez plus rien ?
MARIGNON.
Non ; et sans la maladie de ma femme, je serais aussi complètement heureux que tous nos camarades.
DUVAL.
La probité, voilà toute notre gloire.
MARIGNON.
Et cette réputation de probité est bien connue, bien méritée. Depuis vingt ans, je n’ai pas vu un seul d’entre nous la démentir... pas un !... tiens, excepté cet homme qui vient là.
Scène IX
LES MÊMES, FAGEROLLES, qui se dirige vers un bureau au fond, où il s’arrête et paie
DUVAL.
Cet homme ! Mais il n’est pas garçon de recette ; c’est Fagerolles ; il est, je crois, clerc d’huissier.
MARIGNON.
Et c’est une profession qu’il déshonorera, sans doute, comme il a déshonoré la nôtre.
DUVAL
Lui !
MARIGNON.
Dix mille francs ont manqué un jour dans ses comptes et il a soutenu qu’il avait perdu cette somme. Nous nous sommes cotisés et nous avons remplacé ces dix mille francs, en le renvoyant de notre corps
FAGEROLLES, venant à eux.
Ah ! Marignon, je désirais te parler.
MARIGNON.
Et moi je m’en allais ; je désirais ne pas vous voir.
FAGEROLLES.
Ah ça ! mais un autre que moi pourrait appeler cela une impolitesse.
MARIGNON.
Un autre, c’est possible.
À Duval.
Pour lui, c’est une justice.
FAGEROLLES.
M’expliqueras-tu, du moins...
MARIGNON.
Rien du tout. Quand le passé n’est flatteur pour personne, je n’aime pas à en parler.
FAGEROLLES.
Bon ! tu as sur le cœur la part que tu as four nie lors de la perte que j’ai faite il y a quatre ans ! mais je compte te rendre bientôt cela.
MARIGNON.
Cette part, je l’ai oubliée il y a longtemps, et je donnerais encore autant pour que cette perte n’eût pas eu lieu.
FAGEROLLES.
Douterais-tu par hasard de la réalité de l’accident qui m’est arrivé, de ma probité, enfin ?
MARIGNON, à part.
Sa probité !
Haut.
Écoutez, je vais vous dire une bonne fois mon opinion. Perdre son propre argent c’est une maladresse, une bêtise ; perdre l’argent d’un camarade, d’un ami, c’est une faute... mais perdre l’argent de la Banque, pour nous autres, Monsieur... c’est un crime.
FAGEROLLES.
Un crime !
MARIGNON.
C’est un crime !... voilà mon opinion.
Il lui tourne le dos et cause bas avec Duval.
FAGEROLLES, bas.
Toujours le même ! toujours de l’insulte et du mépris pour moi ! patience ! je me vengerai.
Haut.
M. Marignon, si je suis venu vous trouver, ce n’est pas pour écouter votre morale, encore moins pour vous tendre la main. Je voulais seulement vous prévenir que nous avons reçu l’ordre de reprendre les poursuites pour les douze cents francs que vous devez...
DUVAL.
Que dit-il ?
MARIGNON.
Demain, Monsieur, l’effet sera soldé.
FAGEROLLES, à part.
Demain ; aujourd’hui peut-être il apprendra le coup qui le menace.
MARIGNON.
J’irai porter moi-même les fonds à M. Delahaye.
FAGEROLLES.
Ce n’est plus entre les mains de M. Delahaye que se trouve l’effet.
MARIGNON.
Comment ?
FAGEROLLES.
Quelqu’un a payé, et c’est au nom de cette per sonne que je poursuis...
MARIGNON.
Et qui donc ?
FAGEROLLES.
Qu’importe ! puisque vous êtes prêt à payer.
Scène X
LES MÊMES, DURAND, LES GARÇONS DE RECETTE
DURAND.
Attention, messieurs !... M. André, voici les traites, les billets que vous aurez à toucher dans votre quartier... total, 32 000 francs.
ANDRÉ.
C’est bien.
DURAND.
Vous, Jovinet, voici les vôtres.
Il lui donne une liasse de papiers.
Vous, Duval, 60 000 francs, dont trente dans la maison Bidaut.
DUVAL, à part.
Chez cet insolent qui, tout à l’heure...
DURAND.
Pour toi, mon viril ami Marignon, c’est autre chose... 50 000 francs chez divers banquiers, et 120 000 chez un seul... rue Lafitte... aux autres, maintenant.
Il remonte la scène et parle bas aux garçons qui l’entourent. Chaque garçon va à son bureau faire ses préparatifs de départ.
MARIGNON.
170 000 ! rien que cela !
Regardant Fagerolles.
n’importe, tout ça rentrera sans erreur et surtout sans perte.
Passant devant lui.
On ne perd pas l’argent de la Banque.
DURAND.
Allons, partons.
TOUS.
Partons, partons !
Scène XI
LES MÊMES, MARIE, accourant
MARIE.
Mon oncle ! mon oncle ! ah ! venez, venez cite !...
DUVAL.
Marie, pourquoi ce trouble ?
MARIGNON.
Qu’y a-t-il ?
MARIE.
Depuis ce matin, vous le savez, ma pauvre tante se trouvait mieux ; elle était plus calme surtout, et mes frayeurs commençaient à se dissiper, quand, tout à l’heure, on a apporté une lettre. À peine en avait-elle parcouru quelques lignes, que je l’ai vue pâlir... puis des larmes se sont échappées de ses yeux. Elle s’est tournée vers moi, elle a voulu parler, mais il semblait qu’une grande douleur l’oppressât et elle n’a pu prononcer que des mots entrecoupés et sans suite... « Marignon... mon ami... mon fils, mon pauvre fils... » disait-elle. Et elle est enfin tombée à mes pieds, froide, inanimée, presque morte.
MARIGNON.
Grand Dieu ! qu’est-il donc arrivé ?
MARIE.
J’ai fait appeler le médecin ; je l’ai supplié, à mains jointes, de ne pas la quitter, et je suis accourue, mon oncle, car elle veut vous voir ; et je tremble qu’à chaque instant...
MARIGNON.
Ma pauvre Louise ! oui, oui, me voilà... me voilà !... mais cette lettre... que peut-elle donc contenir ?
FAGEROLLES, à part.
Je le sais, moi.
DUVAL
Hâtez-vous, mon ami ; il faut courir près d’elle.
MARIGNON.
Oui, oui ; mais mon devoir !... ma tournée à commencer ! que faire, que devenir ? oh ! ma tête, ma tête !... écoute, Duval... mon ami, il faut que tu le charges d’une partie de mes courses... il n’y a que toi au monde à qui je confierais une pareille mission, au moins ! il y a surtout les 120 000 francs de la rue Laffitte... pour recevoir une si forte somme, il faut avoir toute sa raison, tout son sang-froid, et moi, vois-tu, Duval, ma femme... ma pauvre femme malade... mourante, peut-être... je ne sais plus, je ne vois plus ce que je fais, et si j’allais me tromper ! oh ! tu te chargeras de cette somme, n’est-ce pas.
DUVAL.
Je m’en charge.
MARIGNON.
Moi, je vais courir chez moi, voir ma pauvre malade ! puis je ferai les recouvrements du quartier... tout ce que je pourrai enfin... ce n’est pas assez, peut-cire, mais on ne doit pas exiger davantage d’un malheureux dont la femme se meurt !... tiens, tiens, mon garçon !
Il lui donne les lettres de change.
Scène XII
LES MÊMES, BIDAUT
MARIGNON, à Duval qu’il conduit à son bureau.
120 000 francs, tu vois !... ah ! prends aussi ce portefeuille.
BIDAUT, bas à Marie.
Mademoiselle, veuillez lire cette lettre, quand vous serez seule.
MARIE.
Une lettre ! de vous, Monsieur ?
Elle la repousse.
BIDAUT.
Un grand malheur semble menacer votre famille ; prenez, Mademoiselle, c’est d’elle aussi qu’il s’agit, el songez que vous avez un ami prêt à secourir ceux qui vous sont chers.
MARIE.
Un grand malheur les menace, dites-vous ? mais, Monsieur...
DUVAL.
Encore lui !
Duval vient se placer entre eux et regarde Bidaut avec défiance, tandis que Marie cache la lettre.
MARIGNON, à Duval.
Tu ne négligeras rien, n’est-ce pas, Joseph ? une si forte somme ! aie du sang-froid, de la tête, tout ce qui me manque, enfin, dans ce cruel moment.
DUVAL.
Soyez tranquille.
MARIGNON.
Allons, viens, viens, Marie ; courons près de notre pauvre malade... Mon Dieu, mon Dieu pourvu que nous arrivions encore à temps.
Ils sortent.
FAGEROLLES.
Tout marche comme je l’avais prévu.
BIDAUT.
Silence.
FAGEROLLES.
Quand recevrai-je vos ordres, Monsieur ?
BIDAUT.
À l’instant... suis-moi.
ACTE II
Le théâtre représente une chambre chez Marignon.
Scène première
LE MÉDECIN, LOUISE, MARIE, DUVAL, HENRIETTE, MARIGNON
Le Médecin écrit une ordonnance à l’écart, tandis que Duval, Marie, Henriette, Marignon, entourent Louise évanouie dans un fauteuil.
MARIGNON.
Monsieur le Docteur, est-ce que cc long évanouissement ne va pas cesser ?
LE MÉDECIN.
Calmez votre inquiétude, elle reprendra bientôt ses sens.
HENRIETTE.
En effet... son cœur bat avec plus de force... ses joues se colorent...
MARIE.
Elle rouvre les yeux...
MARIGNON.
Enfin... enfin... ah ! j’ai eu bien peur, ma pauvre Louise, ma pauvre femme !
LE MÉDECIN.
Silence, cachez-lui vos craintes et surtout vos larmes...
MARIGNON.
Oui, Docteur, oui... d’ailleurs, je ne crains plus rien... je ne pleure plus, le danger a cessé, n’est-ce pas ?...
LE MÉDECIN.
Peut-être...
MARIGNON.
Comment ?
HENRIETTE.
Attendez, père Marignon, ôtez-vous de là... que je fasse boire la malade.
MARIGNON.
Oui, Henriette... vous êtes une bonne fille.
HENRIETTE.
Je le sais bien ; mais tout le monde ici ne dit pas ça.
MARIGNON, s’approchant du médecin.
Monsieur, vous semblez douter de son rétablissement... que craignez-vous donc ?
LE MÉDECIN.
Je suis loin de désespérer de son état... mais souvenez-vous bien de mes paroles. Cette ordonnance, que je viens d’écrire, peut certainement contribuer à sa guérison... mais ce qui doit surtout la sauver, ce que je vous recommande, Monsieur, c’est le plus grand calme, l’absence de toute émotion pénible ou violente. C’est une organisation que le chagrin n’a que trop affaiblie, et que l’annonce d’un malheur pourrait briser.
MARIGNON.
Heureusement, je n’ai plus rien à redouter... mes affaires sont arrangées... et...
LOUISE.
Marignon... mes amis... Dominique... mon fils... mon pauvre fils.
MARIGNON.
Tout à l’heure, Louise, tout à l’heure, il va revenir...
MARIE.
Il n’était pas instruit de votre état, sans cela, il serait déjà de retour.
LOUISE.
Comme il tarde, mon Dieu !
LE MÉDECIN.
Souvenez-vous de ma recommandation.
MARIGNON.
Soyez sans inquiétude, Docteur, je m’en sou viendrai.
LE MÉDECIN.
Et s’il survenait quelqu’accident, venez me chercher ; mais du calme surtout, ne l’oubliez pas.
Il sort.
Scène II
LOUISE, MARIE, DUVAL, HENRIETTE, MARIGNON
MARIGNON, revenant près de Louise.
Eh bien, Louise, comment te trouve-tu ?
LOUISE.
Mieux, bien mieux...
DUVAL.
Votre état ce matin était si rassurant... qui donc a pu causer cette nouvelle crise ?
HENRIETTE.
Cette lettre qu’elle a reçue.
MARIGNON.
Mais, cette lettre, que contenait-elle donc de si terrible ? tu te seras effrayée à tort.
LOUISE.
À tort, dis-tu... mais tu ne l’as donc pas lue ? tu ne sais donc pas quels malheurs nous menacent ?
MARIGNON.
Non.
LOUISE.
Tu ne sais pas que ces 1 200 francs que nous devons, on les exige aujourd’hui même.
MARIGNON.
Je les ai réalisés.
LOUISE.
Mais on nous les vole.
MARIGNON.
Comment ?
TOUS.
Que dit-elle ?
LOUISE.
Tu ne sais pas, enfin, que Dominique, mon fils chéri, mon seul enfant, est peut-être en ce moment condamné par le sort, que la conscription peut me l’arracher pour sept ans, pour toujours, car s’il revient alors... je serai morte.
MARIGNON.
Mais je l’ai assuré contre le sort... et cet argent, comme celui de mon billet, est déposé depuis plusieurs jours chez le banquier Dermons.
LOUISE.
Et le banquier Dermons a pris la fuite.
MARIGNON.
Grand Dieu !... qui dit cela ? quelle preuve ?
LOUISE.
Tiens, lis.
Elle lui remet une lettre.
MARIGNON, lisant.
« Le banquier Dermons a déposé son bilan, hier, et depuis ce matin il est en fuite... » Oh !...
LOUISE.
Et, maintenant, crois-tu que mes craintes soient vaines, que je me sois alarmée à tort... ton premier cri, à toi, a été pour ton honneur compromis... le mien a été pour mon fils.
DUVAL
Ah ! que de malheurs, mon Dieu !
MARIGNON, pleurant.
Mon pauvre Dominique.
LOUISE.
Oh ! il est perdu, va... car le ciel est sans pitié pour nous ! tout à la fois... tout en un seul jour... et on me demande qui a pu me désespérer, me briser ainsi ; je me demande moi, comment il se fait que j’existe encore.
MARIE.
Oh ! ne dites pas cela ma tante, le ciel peut vous venir en aide.
MARIGNON.
Non, non ; tout est fini.
DUVAL, bas.
Songez aux paroles du docteur ! et n’ajoutez pas vous-même un malheur à tous ceux qui vous frappent.
MARIGNON.
Tu as raison, Duval, je serai courageux pour elle !... pour elle, je lutterai jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de nous secourir ou de m’écraser tout-à-fait.
S’approchant de Louise.
Louise, nous avons tort de nous alarmer ainsi, rien n’est encore désespéré.
LOUISE.
Tu veux me tromper, pour me rendre de la force et du courage.
MARIGNON.
Non... d’abord, mon nouveau créancier ne sera peut-être pas inexorable... et puis il me reste des ressources... des amis.
LOUISE.
Des amis... à nous qui sommes malheureux ! et quand cela serait, quand tu parviendrai obtenir des délais pour cet argent... n’ai-je pas un autre sujet de craintes mille fois plus cruel... le départ de notre fils.
MARIGNON.
Le sort lui sera favorable.
LOUISE.
Non... le malheur est entré dans cette pauvre demeure, il n’en sortira que lorsqu’il n’y trouvera plus de victimes à frapper.
MARIGNON.
C’est impossible ; chaque jour, dans nos prières, ne demandons-nous pas à Dieu de nous laisser à nous tous les chagrins, toutes les douleurs, et de garder pour notre enfant tous les bonheurs et toutes les joies... eh bien, le ciel nous a entendus, il exauce nos veux, et tandis que nous pleurons ici, j’en suis certain, Louise, Dominique est heureux là-bas.
LOUISE.
Puisses-tu dire vrai ! puissent tes espérances se réaliser bientôt.
MARIE.
Cette crise funeste vous a fatiguée, ma tante... et il faudrait...
Elle fait signe à Duval de tâcher de l’éloigner.
LOUISE.
Quoi donc ?...
DUVAL.
Il faut rentrer dans votre chambre, tâcher de prendre un peu de repos... le médecin l’a recommandée.
LOUISE.
Soit, j’obéis.
MARIE, bas à Henriette.
Attends-moi, il faut que je te parle.
HENRIETTE.
C’est bon !
LOUISE.
L’espérance me soutiendra jusqu’à ce que je sache l’arrêt de mon fils... le mien !
MARIGNON.
Tout peut se réparer... nous serons heureux encore.
LOUISE.
Heureux !...
MARIGNON.
Oui, oui, heureux...
À part.
Si vous voulez, mon Dieu, faire un miracle pour une pauvre mère !...
On conduit la malade jusqu’à sa chambre.
Scène III
HENRIETTE, puis MARIE
HENRIETTE.
Pauvres gens ! leur désespoir me navre le cœur !... oh ! la misère, la misère !... ce mot me fait peur... je ne connais rien de plus affreux.
MARIE, entrant.
Rien, excepté la honte !
HENRIETTE.
Encore les grandes phrases de M. Duval ! Ma chère, on est moins en danger de se déshonorer, lorsqu’on est à l’abri du besoin, lorsqu’on est riche.
MARIE.
Mais on s’avilit souvent pour le devenir ! Mais... Écoute-moi, Henriette ; aujourd’hui, je ne veux rien entendre de tes conseils de chaque jour... Duval est bien grave, bien sévère, mais je l’aime... il est pauvre enfin, mais je te le répète, je l’aime, et je préfère la misère avec lui...
HENRIETTE.
À l’opulence avec un autre.
MARIE.
Oui, et surtout à l’opulence que je paierais de mon honneur.
HENRIETTE.
Mais qui te parle de cela ? M. Bidaut ne peut...
MARIE.
C’est pour t’entretenir de M. Bidaut que je t’ai priée de rester.
HENRIETTE.
Eh bien, je t’écoute.
Scène IV
HENRIETTE, MARIE, DUVAL
DUVAL, à part.
Ensemble ! je m’en doutais.
MARIE.
Jusqu’ici, cet homme que je rencontrais par hasard, disais-tu, chaque fois que j’allais te voir, cet homme ne s’était montré qu’empressé ou galant.
HENRIETTE.
Et malgré son amour, il a toujours été plein de respect et soumission.
MARIE.
Oui, jusqu’aujourd’hui qu’il a osé m’écrire et me contraindre, pour ainsi dire, à prendre sa lettre, afin de la soustraire aux regards de mon oncle et de Duval !
HENRIETTE.
Et cette lettre ?
MARIE.
Je l’ai lue, car il m’avait dit qu’un malheur menaçait ma famille...mais il n’avait pas osé me dire quel sacrifice il m’imposait pour la sauver. Cette lettre, la voici ; je veux que tu la lui rendes, que tu lui dises que je repousse avec horreur ces brillantes parures qu’il met à mes pieds, ce luxe dont il veut m’entourer de le lui dire si tard.
HENRIETTE.
Soit ; je lui remettrai sa lettre. Cependant, pourquoi exiger ?...
MARIE.
Pourquoi ?... Parce que cette richesse, que j’aurais repoussée naguère avec mépris, pourrait m’éblouir, me rendre folle, maintenant que la misère vient à nous terrible et menaçante, maintenant que tous ceux que j’aime sont en proie aux plus affreux malheurs. Henriette, il faut, entre cette fortune et moi, une barrière infranchissable.
HENRIETTE.
Et tu veux que je dise à monsieur Bidaut ?...
MARIE.
Que toutes deux, désormais, nous refusons de le voir.
HENRIETTE.
Mais...
MARIE.
Tu hésites ?
HENRIETTE.
C’est que, je te le répète, c’est impossible.
MARIE.
Et pourquoi... pourquoi ?
HENRIETTE.
Parce que... au fait, il faudra toujours que tu le saches... parce que M. Bidaut m’avait, depuis long-temps, prise pour confidente de ses chagrins, de son amour ; parce que je lui avais avoué, moi, votre misère et tes besoins.
MARIE.
Eh bien !
HENRIETTE.
Et ces services que je te rendais souvent...
MARIE.
Achève... je crains de deviner !
HENRIETTE.
Tu sais bien, Marie, que je ne suis qu’une simple ouvrière ; mes économies n’auraient pu suffire à mes dépenses et aux tiennes ; et ces robes, ces bijoux, ces toilettes, dont le prix s’élève à près de mille francs, et que tu croyais ne devoir qu’à moi seule...
MARIE.
Malheureuse ! c’était...
HENRIETTE.
Eh bien oui, je te l’avoue, c’était lui.
DUVAL, avec désespoir.
Infâme !
MARIE.
Duval !...
DUVAL, s’approchant, à Henriette.
Veuillez vous retirer, Mademoiselle.
MARIE, bas.
Duval...
DUVAL.
Vous ne craignez plus, je pense, de vous montrer ingrate envers elle, de blesser cette amie si dévouée, si généreuse... vous savez bien que c’est à un autre qu’appartient votre reconnaissance ; c’est un autre qui l’a payée.
MARIE.
Oh ! mon Dieu !
HENRIETTE, sortant.
Pauvre Marie ! j’ai eu tort de lui dire cela, ou de le lui dire si tard.
Scène V
DUVAL, MARIE
MARIE.
Joseph, vous avez tout entendu ?
DUVAL.
Oui, tout ; et vous disiez vrai, Marie, cet homme creuse sous vos pas un abîme dans le quel vous poussera la misère de votre famille.
MARIE.
Non, tout n’est pas perdu encore ! Duval, je serai toujours digne de vous ; car vous ne m’abandonnerez pas, et vous soutiendrez mon courage. À chaque nouveau malheur qui viendra nous frapper, c’est près de vous, mon ami, c’est dans vos bras que je chercherai un refuge contre leurs larmes, contre moi-même ! et puis, il reste encore des chances de salut : mon oncle le disait tout à l’heure, le sort peut sauver Dominique, et on lui donnera du temps, à lui, pour payer ces douze cents francs qu’on lui vole.
DUVAL.
Et vous, Marie, qui vous sauvera ?
MARIE.
Moi !
DUVAL.
Mais vous ne songez donc plus à ce qu’a fait pour vous l’hypocrite générosité de cet homme ? vous ne songez plus, Marie, qu’il peut à chaque instant vous aborder avec un sourire de bienveillance et de protection sur les lèvres, si vous vous montrez humble et reconnaissante, ou avec un air de dédain et de raillerie insolente, si vous le repoussez ?
MARIE.
Comment ! il oserait me reprocher ?...
DUVAL.
Il le peut, Marie ; il a payé ce droit, et, si vous voulez vous éloigner de lui, il vous retiendra de force par cette robe qu’il ne craindra pas de froisser ; car il l’a payée !... Mais il faut lui rendre cet argent, à cet homme... fût-ce au prix de mon sang, de ma vie... je ne sais pas comment, mais il le faut, il le faut.
MARIE.
Oh ! oui, sauvez-moi, mon ami, sauvez-moi !
Scène VI
DUVAL, MARIE, MARIGNON
MARIGNON.
Ça va mieux ; elle est plus tranquille, plus calme... mais toujours attentive au moindre bruit.
DUVAL.
Elle attend le retour de Dominique, n’est-ce pas ?
MARIGNON.
Et, si lui aussi allait être frappé par le sort... j’en suis sûr, vois-tu, ma pauvre Louise en mourrait.
DUVAL.
Mais, que faire ?
MARIGNON.
Il faudrait du moins lui laisser ignorer, pendant quelque temps, ce nouveau coup... jusqu’à ce que sa santé...
DUVAL.
Et pour cela...
MARIGNON.
Pour cela, tu vas courir au-devant de Dominique, à la mairie ; tu lui apprendras tout ce qui se passe ; et, si la chance a été contre nous, s’il doit partir, que je le sache seul, moi, que je sois seul à souffrir, et qu’il la trompe pour la sauver... Va vite.
DUVAL.
Oui, je cours...
Scène VII
DUVAL, MARIE, MARIGNON, LOUISE
LOUISE, entrant précipitamment.
Le voilà... je l’ai vu, mon fils, mon Dominique. Écoutez... il monte l’escalier.
MARIGNON.
Déjà.
DUVAL.
Il est trop tard.
MARIGNON, allant à elle.
Du courage, Louise.
LOUISE.
Oh ! j’ai de la force... il m’en reste pour en tendre mon arrêt.
Scène VIII
DUVAL, MARIE, MARIGNON, LOUISE, DOMINIQUE, MOULINET
Tous deux tiennent, en entrant, leurs chapeaux à la main et les jettent sur une table. D’un coup d’œil, Marignon a distingué les numéros qu’ils portent.
DOMINIQUE, s’élançant vers Louise.
Ma mère, qu’ai-je appris ? Depuis mon départ, une crise funeste... oh ! mais tu es mieux, n’est-ce pas ?
LOUISE.
Oui, mieux... mieux... mais parle, parle vite, toi... le sort... mais réponds-moi, parle donc : ton silence me tue !
MARIGNON, à part.
Perdu ! tout est perdu !
DOMINIQUE.
Pourquoi ce trouble, ma mère ? qu’importent les numéros qui nous sont échus, puisque...
MOULINET.
Certainement, puisque nous sommes exempts ! pas par le physique au moins, mais par le quibus.
LOUISE.
Ah ! oui... tu ne sais rien encore... enfin, ces numéros, dites-les moi ; je veux les connaître...
MOULINET.
À nous deux, nous avons extrait presque les deux extrêmes, le 5 et le 423... un bon et un mauvais.
MARIGNON.
Ah ! quelle idée !
Il s’approche sans être vu, des deux chapeaux et change furtivement les numéros.
LOUISE.
Mais à qui le 423 ? à qui l’autre, enfin ?
MOULINET.
À qui ?...
MARIGNON.
Parbleu ! montrez-nous-les, et nous verrons bien...
Leur présentant leurs chapeaux.
Allons, allons, dépêchez-vous.
MOULINET.
Ça va !
Ils mettent leurs chapeaux.
Vous voyez, père Marignon, j’ai fait la boulette, je n’ai pas tenu ce que je promettais.
LOUISE.
Oui, mon fils, mon Dominique, a été plus heureux... sauvé... sauvé... Ô mon Dieu ! merci !... qu’importe nos autres malheurs, tout le reste est juste, tout le reste est bien, mon fils est sauvé !... Oh ! tenez, je me sens mieux, je ne souffre plus, mes forces reviennent... mon fils est sauvé !
Elle l’embrasse.
MOULINET.
Lui, il a amené le beau numéro...
Regardant le chapeau de Dominique.
Tiens !...
Il ôte le sien et le regarde.
Ah ça !...
DUVAL, s’approchant de lui.
Silence, malheureux.
MOULINET.
Quoi donc ? mais c’est qu’il a...
MARIGNON, de l’autre côté.
Tu ne voudrais pas la tuer ! n’est-ce pas ?
MOULINET.
La tuer... jamais de sa vie.
DOMINIQUE.
Mais expliquez-moi, ma bonne mère...
LOUISE.
Tu ne sais donc pas que le banquier Dermons a pris la fuite avec l’argent que nous lui avions remis pour ton assurance, et si tu n’avais pas été favorisé par le sort, tu aurais été obligé de partir.
DOMINIQUE.
Le banquier Dermons... lui !... oh ! c’est un affreux malheur !
MOULINET.
Dermons !... mais c’était mon assureur aussi, à moi.
MARIGNON, bas à Moulinet.
Tu comprends donc, alors...
MOULINET, de même.
La crémisette de nos numéros ! Oui, père Marignon, vous ne pouvez pas conter la parabole à la pauvre vieille, et vous voulez lui faire croire... suffit.
DOMINIQUE.
Ma mère, si cependant le sort...
MARIGNON, bas à Dominique.
Il faut la tromper, à tout prix.
LOUISE.
Maintenant que le danger est passé, oublions-le, mes amis, car je frémis rien que de penser...
À Dominique.
Mon Dominique ! mon fils chéri ! ton père disait vrai, pour nous les larmes, pour toi le bonheur. Dieu nous a entendus.
MARIE, à part.
Pauvre femme !
MOULINET, s’approchant.
Eh bien ! et moi, Mme Marignon ! vous ne me dites rien, à moi qui vais partir... J’ai pourtant une vieille mère aussi, moi, et à qui j’apporte de temps en temps quelques secours pris sur mon travail.
LOUISE.
Je plains sincèrement votre mère, M. Moulinet, et je voudrais pouvoir...
MARIGNON, à part.
Elle va tout découvrir.
Bas à Moulinet.
Tais-toi donc.
MOULINET, parlant plus haut.
Eh bien ! si le sort eût voulu (ce qu’il n’a pas voulu) que ce fût Dominique qui fût soldat et moi qui fusse pékin, rien qu’à voir combien vous aimez votre fils et combien il vous aime, rien qu’à voir votre désespoir à tous lorsque vous craigniez de le perdre, j’aurais dit au conscrit susnommé : « Voyons, mon garçon, il paraît que les grands parents ne veulent pas te lâcher ; si tu pars, ils se livreront à un chagrin indéterminé ; eh bien ! les amis ne sont pas des Turcs... il y a du cœur là-dessous, vois-tu... de puis longtemps, la mère Moulinet désire entrer à la Vieillesse, voilà une bonne occasion pour et moi de la rendre heureuse... trouve-moi seulement cinq cents francs, et je pars pour toi ! »
DUVAL.
Pour Dominique ?
MARIGNON.
Pour mon fils ?
DOMINIQUE.
Comment, tu aurais fait cela ?
MOULINET.
Cinq cents francs, ce n’est pas cher un homme au grand complet ! Je crois, sans me flatter que, vue prise du physique, on mettrait un chiffon de mille de plus, sans trouver aussi bien.
LOUISE, souriant.
Brave jeune homme ! et cependant, dans un cas pareil, nous ne pourrions profiter de vos bonnes intentions... Où trouverions-nous cinq cents francs, nous qui sommes ruinés ?
MOULINET.
Aussi, n’est-ce qu’une supposition.
Bas à Dominique.
Songe à ce que je viens de dire, cinq cents francs et tu restes... mais il faut les trouver... ce soir même.
DOMINIQUE, bas.
Impossible !
MOULINET, de même.
Et la caisse commune des garçons de recette ?
MARIGNON, de même.
Nous y avons eu trop souvent recours.
MOULINET, bas.
Et vos amis ?
DOMINIQUE, bas.
Nous n’en avons plus.
MOULINET.
Et votre cautionnement ?
MARIGNON.
Il appartient à un tiers, et d’ailleurs, en dis posant de ce cautionnement je perdrais ma place.
DUVAL, à part.
Aucun moyen de les sauver !
MOULINET.
Allons ! il est temps que j’aille annoncer à la mère Moulinet le résultat.
On entend un coup de sonnette.
MARIGNON.
Qui peut venir ici dans un pareil moment ?
Il va ouvrir et se trouve face-à-face avec Fagerolles, qui entre suivi de deux hommes.
Scène IX
DUVAL, MARIE, MARIGNON, LOUISE, DOMINIQUE, MOULINET, FAGEROLLES, DEUX HOMMES
TOUS.
Fagerolles !...
DUVAL.
Un nouveau malheur, sans doute.
MOULINET, à part.
Encore ! Ça peut devenir contagieux, je file.
Il sort.
FAGEROLLES.
Vous m’avez dit, M. Marignon, que vous étiez en mesure d’acquitter cet effet de douze cents francs, et je viens en toucher le montant.
LOUISE.
Ô mon Dieu !...
MARIGNON.
Ah ! tu savais, ce matin, le coup qui devait me frapper... et j’aurais dû le deviner à tes paroles railleuses dont je me souviens en ce moment.
FAGEROLLES.
Ce matin, je savais qu’un débiteur a la voix bien haute le jour d’un paiement et le ton bien humble le jour de la saisie... et c’est pour opérer une saisie, dans le cas où vous refuseriez de payer, que je me suis fait accompagner par ces Messieurs.
DUVAL
Une saisie !
DOMINIQUE, se plaçant devant la porte de la chambre.
Ici, en présence de ma mère ! non, non, vous ne le ferez pas.
FAGEROLLES.
Oseriez-vous résister à la loi ?... Il faut que nous voyions, que nous estimions tout par nous mêmes.
LOUISE.
Malheureux enfant ! que vas-tu faire ?
DOMINIQUE, à Marignon.
Eh quoi ! mon père, vous souffrirez que ces misérables portent les mains sur ce qui a appartenu à votre femme, qu’ils souillent sa chambre de leur présence !...
À Fagerolles.
Et moi je te dis, Fagerolles, que tu n’entreras pas, que tu ne verras rien... et si tu avances d’un pas...
MARIGNON.
Arrête !... Mon fils, tes menaces sont inutiles, car cet homme manquera de courage pour te répondre ; un misérable tremble toujours devant un honnête homme, un fripon est toujours un lâche !
FAGEROLLES.
Monsieur !...
Les deux hommes se rapprochent de lui, en même temps que Marignon et Duval de Dominique.
LOUISE, s’élançant entre eux.
Messieurs, entrez si bon vous semble, et faites votre devoir.
À Dominique.
Mon fils, tu as tort de redouter pour moi la présence de ces Messieurs... c’est un malheur, sans doute, qu’une saisie faite chez nous... mais, que m’importe que ces hommes prennent tout ce qui se trouve ici, maintenant que je sais que tu me reste !...
FAGEROLLES.
Si vous avez le moyen de faire d’exempter votre fils, M. Marignon, il vaudrait mieux peut être acquitter cet effet ; il y a de l’honneur à être soldat, il n’y a que de la honte à ne pas payer une dette.
MARIGNON.
Que vous importe !
LOUISE.
La fuite de Dermons nous a tout enlevé, Messieurs, et le hasard seul pouvait sauver mon fils.
FAGEROLLES.
Mais le tirage, auquel j’assistais, lui a fait échoir le numéro...
DUVAL.
Silence ! Monsieur.
LOUISE.
Achevez... lequel ?...
À part.
M’aurait-on trompée ?
FAGEROLLES.
Je l’ai déploré pour vous ; mais c’est le numéro 5 que votre fils...
DOMINIQUE.
Malheureux...
LOUISE.
Que dites-vous ?
MARIGNON.
Silence, infâme ! tu es ici pour nous dépouiller, et non pour assassiner.
LOUISE.
Ainsi, on m’avait abusée... et toi aussi, Dominique, perdu... perdu pour moi... Oh ! j’en mourrai, j’en mourrai !...
Elle tombe dans un fauteuil.
DOMINIQUE.
Ma mère, reprends courage... peut-être...
LOUISE.
Oh ! pas de consolations, elles n’arriveraient pas jusqu’à mon cœur... Mais aussi, mon ami, pas de désespoir, pas de larmes ! moi, je vivrai jusqu’à ce qu’on vienne m’arracher mon enfant !... toi, Marignon, tu seras fort jusqu’à ce que tu aies accompli tout entière ta tâche d’honnête homme... C’est l’heure de la recette, Marignon, ton devoir t’appelle... Messieurs, faites votre métier, nous sommes prêts.
Marie et Duval se sont rapprochés l’un de l’autre.
MARIE.
Que de malheurs !...
DUVAL, lui prenant la main.
Et pas un espoir !
MARIGNON.
Oui, il faut que je te quitte ; Marie, mes enfants, je vous la confie... ce n’est plus l’instant de songer à nous... je vais faire quelques courses dans le quartier. Louise, dans quelques instants je serai de retour. Adieu... adieu.
Scène X
DUVAL, MARIE, LOUISE, DOMINIQUE, FAGEROLLES, DEUX HOMMES
FAGEROLLES.
Messieurs, procédons à la saisie.
Lisant un papier.
« Au nom de la loi, de parle tribunal de commerce, et à la requête de M. Jules Bidaut... »
Il inspecte les meubles et écrit.
MARIE.
Jules Bidaut !...
Mouvement de Duval qui la regarde avec anxiété.
Jules Bidaut, dites-vous... Mais il ignore que vous venez saisir ici ; dans ma famille !... il ignore cela, Monsieur.
DOMINIQUE.
Vous le connaissez donc, cet homme ?
MARIE.
Oui, et je sais que pour lui c’est une misérable somme que celle que nous lui devons, je sais qu’il peut vous racheter, Dominique, et sauver votre mère.
LOUISE.
Racheter mon Dominique, me le rendre ! qui dit cela ? qui donc nous prendrait ainsi en pitié ? Mais non, on veut me tromper encore et prolonger ma vie avec un peu d’espoir... Tu ne peux rien pour nous, n’est-ce pas ?
MARIE.
Je peux... je peux vous sauver tous.
Elle s’approche de la table et saisit une plume.
DUVAL, allant à elle.
Et qui portera cette lettre, Marie... Sera-ce votre oncle ou votre fiancé ?
MARIE.
Duval !
Elle rejette la plume.
Mais je ne peux pas la laisser mourir, voir son fils arraché de ses bras, et son mari déshonoré... je vous jure que toute pensée de fortune pour moi-même me fait horreur en ce moment... mais au prix de mon avenir, je voudrais les tirer de l’abîme ! Ma vie, ma vie tout entière, je la donne à qui les sauvera...
DUVAL.
Souvenez-vous de ces paroles, Marie ; moi, je ne les oublierai pas !... et maintenant achevez.
MARIE.
Vous voulez...
DUVAL.
Oui, mettez l’adresse, « à M. Jules Bidaut... » bien... ce sera moi qui lui porterai cette lettre.
MARIE.
Vous !...
DUVAL.
Oh ! ne redoutez de ma part, ni emportement ni violence ! Avant de la remettre à son adresse, j’aurai frappé à la porte de tous mes amis, j’aurai imploré la pitié de l’homme dont l’argent répond à la Banque de ma fidélité, j’aurai épuisé enfin tout ce qui me reste de ressources et d’espérances ; et si tout me fait faute, si ce recours est le dernier, le seul qui nous reste, je me soumettrai, Marie ; j’irai trouver Bidaut, je lui donnerai votre lettre ; mais comme je le connais bien, moi ! comme je le sais sans cœur et sans miséricorde, dès qu’il aura franchi le seuil de cette maison, j’aurai cessé de vivre !
MARIE.
Cette lettre, Duval, rendez-moi cette lettre !
DUVAL.
L’un de nous deux vous la rapportera !... Priez Dieu, Marie, pour que ce soit moi !...
Il sort.
Scène XI
MARIE, LOUISE, DOMINIQUE, FAGEROLLES, DEUX HOMMES
FAGEROLLES, à part.
Si je ne m’abuse, tout marche au gré de M. Bidaut.
Haut.
Maintenant, nous pouvons, je suppose, entrer dans cette chambre.
LOUISE.
Entrez, Monsieur, entrez !
Ils entrent dans la chambre de Louise.
Que se passe-t-il donc, Marie ? Duval est sorti bien pâle, bien agité !...
MARIE.
C’est qu’il va dans ce moment tenter deux grandes chances de salut... les dernières !
DOMINIQUE.
Mais à quel prix, Marie ?
MARIE, à part.
Au prix de sa vie, ou de la mienne.
LOUISE.
Tu ne nous réponds pas...
MARIE.
Ma bonne tante, vous m’avez toujours tenu lieu de mère, votre tendre affection ne s’est jamais démentie, et, quoi qu’il arrive, vous ne cesserez pas de m’aimer ?
DOMINIQUE.
Que dites-vous là, Marie ?
LOUISE.
Ne plus t’aimer ! toi qui as partagé nos joies, si rares, et nos peines de chaque jour ?... Mais explique-toi ! parle, parle donc...
La porte s’ouvre et Marignon paraît.
MARIE.
Mon oncle ! oh ! pas un mot... pas un mot !...
Scène XII
MARIE, LOUISE, DOMINIQUE, FAGEROLLES, DEUX HOMMES, MARIGNON, chargé d’une lourde sacoche
MARIGNON.
Je suis remonté en passant, Louise, pour avoir de tes nouvelles, et puis pour mettre un peu d’ordre dans mes comptes... car mon esprit est bouleversé, et je crains qu’une erreur...
S’approchant de Marie et de Dominique.
J’ai revu ce pauvre Moulinet : « Père, Marignon, m’a-t-il dit, j’attendrai Dominique jusqu’à de main avec ses 500 francs ; passé ce délai, je serai forcé d’accepter les 1 500 francs d’un autre. »
MARIE.
Encore tout un jour ! j’ai bon espoir...
MARIGNON.
Où trouver cet argent ? je ne possède rien, moi...
Il secoue la sacoche et la dépose sur la table.
DOMINIQUE.
Et n’avoir pas même la ressource de me vendre ! car mon départ tuerait ma mère !
FAGEROLLES, en dehors.
Plus, une commode d’acajou en bon état...
UNE VOIX.
Une commode...
MARIGNON.
Ah ! encore là !... et Duval à sa recette ? Allons !
Il tire des billets de banque et les compte.
Sept, huit, neuf, neuf mille... neuf et quinze, vingt-quatre... vingt-quatre mille francs...
FAGEROLLES.
Un lit en noyer !
UNE VOIX.
Un lit en noyer !
LOUISE.
Le lit de mon pauvre fils !
MARIGNON.
Vingt-quatre et douze, trente-six... trente-six mille cinq cents.
FAGEROLES.
Plus, un secrétaire...
MARIGNON, se levant.
Oh ! ce misérable me rend fou !...
LOUISE.
Mon ami...
Marignon se rassied, essuie une larme et compte de nouveau, mais à voix basse.
FAGEROLLES, sortant.
Voilà qui est fini.
MARIGNON.
Comment... une erreur dans mes comptes !
FAGEROLES, s’approchant de Marignon.
Oh ! que d’argent !
MARIGNON, le repoussant violemment.
Arrière, Monsieur, c’est l’argent de la Ban que...
Se remettant à table.
Cette erreur, il faut que je la trouve...
Fagerolles s’éloigne.
FAGEROLLES, aux recors.
Je crois que nous avons oublié cette table ?
Scène XIII
MARIE, LOUISE, DOMINIQUE, FAGEROLLES, DEUX HOMMES, MARIGNON, DUVAL
DUVAL, s’approchant de Fagerolles.
Monsieur, à combien s’élève la somme qui est due ?
FAGEROLLES.
À quinze cents francs avec les frais,
DUVAL, lui prenant le dossier et lui donnant deux billets de banque.
Prenez, et partez.
TOUS, excepté Marignon.
Ciel !
FAGEROLLES.
Comment, Monsieur ?
DUVAL
Sortez d’ici.
Fagerolles sort avec ses recors.
LOUISE.
Mon ami...
DUVAL.
Silence ! pas un mot en ce moment à Marignon, je l’exige ; il refuserait peut-être un si grand service de moi.
LOUISE.
Soit, nous attendrons.
MARIE.
Vos amis ont donc écoutés vos prières ?
DUVAL, avec calme.
Oui... Dominique, prenez ces cinq cents francs, et courez chez ce jeune homme qui vous attend.
LOUISE.
Mon fils... sauvé !
DOMINIQUE.
Je vous resterai, ma mère.
Regardant Marie.
Duval, vous méritez tous les bonheurs, vous.
Il sort ; Louise le suit des yeux, de la fenêtre.
DUVAL.
Allez, allez vite !
Scène XIV
DUVAL, MARIE, LOUISE, MARIGNON
MARIGNON, à part.
J’ai enfin trouvé mon erreur.
Haut.
Ah ! te voilà, Duval, il est bientôt l’heure de rentrer à la Banque, n’est-ce pas ?
DUVAL.
Je vous suis.
MARIE, bas.
Et ma lettre ?
DUVAL, de même.
Je l’ai remise moi-même chez M. Bidaut.
MARIE.
Mais puisque le danger a cessé, pourquoi voulez-vous donc qu’il vienne, cet homme ?
DUVAL.
Vous le saurez. Chez vous, dans une heure.
MARIE.
Mais...
DUVAL
Il le faut, il y va de la vie !
MARIE.
J’y serai.
MARIGNON.
Allons, Duval, à la Banque !
DUVAL.
À la Banque !
Ils sortent tous les deux.
ACTE III
Une mansarde chez Marie dans la maison de Marignon. Il est nuit.
Scène première
MARIE, seule
Comme la nuit est noire et triste ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! que va-t-il se passer ? Duval devrait déjà être ici. « Dans une heure, m’a-t-il dit, il y va de la vie ! » Et ces terribles paroles résonnent sans cesse à mon oreille : Que fait-il ? où est-il maintenant ? Oh ! je ne sais pourquoi cette soirée, ce silence, ce retard de Joseph, tout m’inquiète, tout m’épouvante ! et pourtant, folle que je suis, il va venir ; il me l’a promis... Sans doute quelque affaire pressante l’a retenu... Le noble jeune homme ! il a sacrifié, pour sauver ma famille, ce cautionnement, sans lequel il ne peut plus conserver sa place à la Banque ; et, peut-être maintenant, il en recueille les restes, qui sont désormais toute sa fortune. Pauvre Duval !
Scène II
MARIE, HENRIETTE
MARIE.
Ah ! c’est toi, Henriette ?
HENRIETTE.
C’est moi, ma bonne amie ; je t’ai vue aujourd’hui si triste, si malheureuse, que je me suis échappée, aussitôt que je l’ai pu, pour venir passer un moment avec toi, pour te consoler.
MARIE, froidement.
C’est trop de bonté ; mais on n’offre de consolations qu’à ceux qui ont des chagrins ; et moi... je n’en ai plus.
HENRIETTE, piquée.
C’est-à-dire que tu ne me juges plus digne d’être la confidente de tes peines, depuis que tu sais l’affaire de M. Bidaut.
Étourdiment.
Eh bien ! Marie, vrai, tu as tort de m’en vouloir ; car tout ce que j’ai fait, ce n’était que par amitié ; pou vais-je penser que tu prendrais la chose si à cœur ? Je le voyais humiliée de porter de pauvres toilettes, et M. Bidaut semblait avoir des intentions si honnêtes, si délicates... Que veux-tu, j’ai cédé. Si j’ai mal fait, pardonne-moi.
MARIE, lui tendant la main.
Ce bon sentiment me réconcilie avec toi ; ne parlons plus du passé ; si tu as été trop légère, j’ai été peut-être trop imprudente.
HENRIETTE.
Maintenant, dis-moi comment s’est terminée cette entrevue, dont je souffrais presque autant que toi ? cette pauvre famille...
MARIE.
Cette pauvre famille, Henriette, est à présent au comble de la joie ; au moment le plus inattendu, un ange consolateur est venu à son secours.
HENRIETTE.
Et cet ange consolateur était...
MARIE.
Joseph Duval.
HENRIETTE.
Lui... Duval ! mais je croyais qu’il était pauvre aussi, et qu’il devait tout aux bienfaits de Marignon.
MARIE.
Mais il avait le cautionnement de sa place, et sans doute...
HENRIETTE.
Son cautionnement ? mais il me semble avoir entendu dire qu’il n’était pas à lui, qu’il avait été déposé en son nom, à la prière de Marignon, par Monsieur...
MARIE, vivement.
En es-tu sûre, Henriette ?
HENRIETTE.
Mais... je n’ose affirmer.
MARIE.
Oh ! cela n’est pas, cela ne peut pas être ! D’où aurait-il tiré tout l’argent nécessaire pour sauver ces malheureux ? à moins que ses amis, les connaissances que lui a acquises sa probité bien avérée...
HENRIETTE.
Mais, d’où vient ce trouble, Marie ? on dirait que tu crains...
MARIE.
Je ne crains rien... Duval ! une âme si noble, si généreuse ! Mon Dieu ! il ne vient pas ! lui seul peut m’expliquer...
Courant vers la poste.
Oh ! si c’était !...
Scène III
MARIE, HENRIETTE, DOMINIQUE, MOULINET
MARIE, tristement.
Non... ce n’est pas lui.
MOULINET.
Salut, mademoiselle Marie... et la compagnie !
MARIE.
Dominique, M. Moulinet...
MOULINET.
Eux-mêmes... qui viennent vous faire mes derniers adieux.
MARIE.
Déjà... et vous n’avez pas vu, M. Duval ?
MOULINET.
Néant, disparu, évanoui...
DOMINIQUE.
Il se cache sans doute, pour se dérober à nos remerciements.
MARIE.
Et votre mère, Dominique, ma bonne tante ?
DOMINIQUE,
Elle est calme ; je la quitte à l’instant. Le bonheur est le meilleur des médecins. Et, maintenant que, grâce à Duval, elle n’a plus rien à redouter, maintenant que je ne dois plus partir...
HENRIETTE.
Ah ! vous ne partez pas ?
MOULINET.
Eh ! non, il ne part pas, puisque c’est moi qui endosse, à sa place, l’habit du gouvernement constitutionnel et le pantalon garance de la nation française. Voilà pourquoi nous venons vous faire nos adieux, attendu que, d’un moment à l’autre, les fla et les ra du tapin peuvent m’appeler sous les drapeaux.
HENRIETTE, avec un sourire.
Déjà, monsieur Moulinet ?
MOULINET, minaudant.
Voilà, Mademoiselle, un mot qui vous acquiert à jamais mon estime... Et, puisque vous êtes si bien disposée en ma faveur, examinez ce physique.
Se posant.
Voyez si on peut trouver une plus belle tête de voltigeur, une plus jolie jambe et un plus magnifique torse de grenadier... enfin, un fantassin d’un plus beau modèle ? et tout ça pour la somme de cinq francs !
DOMINIQUE.
Moulinet, te repentirais-tu déjà de ton marché ?
MOULINET, pressant la main de Dominique.
De quoi ?... du tout. Vois-tu, Dominique, quand j’ai vu ta pauvre mère se désoler comme ça, et ton vieux bonhomme de père pousser des soupirs à fendre la butte Montmartre, j’aurais voulu pouvoir leur dire tout rondement : « Vous le voulez, votre Dominique, eh bien ! gardez-le ; je pars pour lui... une poignée de main, et bonjour ! à revoir. » Mais cela n’était pas possible ; il fallait cinq cents francs pour assurer l’existence de ma pauvre vieille mère. Ainsi, tu comprends... pour toi, n’en parlons plus.
MARIE.
Oui, vous êtes un bon fils, un bon ami.
MOULINET.
Quant aux avantages physiques que j’énumérais tout à l’heure, c’était histoire de faire comprendre à Mlle Henriette qu’on peut revenir caporal ou général...
HENRIETTE.
L’un des deux, c’est possible.
MOULINET.
Et comme, alors, plusieurs grandes dames pourraient bien aspirer à obtenir ma main, il n’y aurait pas de mal à prendre son rang tout de suite et à se faire inscrire... Si le cœur vous en dit, les bureaux sont ouverts.
HENRIETTE, souriant dédaigneusement.
En vérité, M. Moulinet, je ne me soucie pas de me faire écraser dans la foule...
MARIE, à Dominique.
La gaîté de votre ami me fait mal, ne pourriez-vous l’emmener ?
MOULINET, à Dominique, bas.
Eh bien ! lui as-tu dit la chose ?
DOMINIQUE, bas.
Non ; mais je vais...
Haut.
Marie, j’étais venu pour remplir un devoir sacré.
Timidement.
Vous vous souvenez peut-être que je vous aime...
MARIE, sévèrement.
Je l’ai oublié, monsieur ; et vous, vous, savez que j’aime Duval, votre ami... votre bienfaiteur ?
DOMINIQUE.
Je le sais, Marie ; et je ne viens pas vous parler d’un sentiment que je veux étouffer en silence dans mon cœur. Vous aimez, Duval, dites-vous ? oh ! aimez-le de toutes les forces de votre âme, car il est digne de toute affection, de tout respect. Cette journée, Marie, a changé bien des choses ! autrefois, je ne vous le cacherai pas, j’avais une haine profonde contre Duval ; moi qui vous aimais, je ne pouvais lui pardonner d’être aimé de vous ; mais depuis que je l’ai vu se sacrifier avec tant de noblesse et de générosité pour nous, depuis qu’il nous a rendu, à moi la liberté, à mon père l’honneur, à ma pauvre mère la vie, à tous la tranquillité, l’aisance, le bonheur... toute ma haine s’est brisée, et je suis venu vous dire : Marie... si vous vous souvenez encore que, quelquefois, en secret, je vous ai adressé tout bas des paroles cents d’amour, oubliez-les, Marie, et pardonnez moi...
HENRIETTE.
Pauvre garçon !
MOULINET.
Il me pourfend le cœur !...
MARIE.
Dominique, vous êtes un bon et honnête jeune homme ; vous savez que je n’ai jamais encouragé votre passion. Tout ce que je puis et dois vous dire, pour vous prouver combien j’apprécie votre générosité...
DOMINIQUE.
Marie, oh ! Marie, ne me donnez pas de regrets... des regrets seraient déjà de l’ingratitude envers notre bienfaiteur.
MOULINET, se rapprochant.
Allons, puisque M. Duval n’est pas ici... impossible de lui offrir la poignée de main de l’estime et les adieux de l’amitié... partons.
MARIE.
Il m’avait promis de venir, je ne puis prendre ce retard...
HENRIETTE.
Oh ! il viendra, j’en réponds...
DOMINIQUE, à part.
Il sait qu’on l’attend toujours, lui...
MARIE.
Ah ! le voici, enfin...
Scène IV
MARIE, HENRIETTE, DOMINIQUE, MOULINET, DUVAL
Duval est enveloppé dans un manteau ; il est rêveur et sombre.
DUVAL, à part, d’un air contrarié.
Elle n’est pas seule !...
MARIE.
Soyez le bienvenu, Duval ; je commençais à être inquiète...
DUVAL, d’un ton grave.
Inquiète, Marie ? pourquoi ?... tous vos vœux go ne sont-ils pas comblés ?
HENRIETTE, à Marie.
Il est bien mieux qu’avec son chapeau à trois cornes... mais comme il est pâle !
DOMINIQUE, tendant la main à Duval.
Oui, Joseph, grâce à vous, nous sommes tous heureux aujourd’hui et je veux vous remercier en ce qui me regarde.
DUVAL, brusquement.
Vous ne me devez pas de remerciements. Votre famille, Dominique, m’avait chargé de bien faits, je devais acquitter une dette, je l’ai acquittée, voilà tout.
DOMINIQUE.
Non, votre devoir ne pouvait vous prescrire un si grand dévouement, un si généreux sacrifice... mais, puisque votre modestie repousse les éloges et l’expression de notre gratitude, je ne vous dirai qu’une chose... vous vous êtes acquis aujourd’hui un ami sûr, fidèle, durable ; et si vous avez besoin de lui, appelez-le, il viendra.
Il lui serre la main.
DUVAL.
Bon Dominique !
À part.
Oh ! je ne croyais pas que mon supplice dût commencer sitôt !
MOULINET, à Duval.
Et moi, je veux vous dire, M. Duval, que si jamais vous aviez besoin de quelqu’un... là... pour un coup de main solide, voici mon adresse. Moulinet, dit Belle Boule, 3e régiment, 1er bataillon, 3e compagnie ; que je sois simple tapin, ou tambour-major, maréchal, ou caporal de France, vous n’aurez qu’à parler... présent !
Lui prenant la main.
Je n’ajouterai qu’un mot : c’est que la brave femme qui vous a donné la lumière n’a pas fait une bêtise.
MARIE, à part.
Ils ne partiront pas !
DUVAL, embarrassé.
Mes amis, merci, pour toutes ces marques d’intérêt, mais, excusez-moi... j’ai à m’entretenir avec Marie d’une affaire importante... ici... à l’instant même...
DOMINIQUE.
Alors, c’est à vous de nous pardonner, Joseph ; nous partons.
MOULINET, bas à Henriette.
Il ne faut pas lui en vouloir de nous mettre ainsi à la porte...
Désignant Marie.
Vous comprenez l’affaire importante.
DOMINIQUE.
Allons, adieu, Duval, adieu, Marie... à demain.
MARIE.
Bonsoir, messieurs... à revoir, Henriette.
HENRIETTE, bas à Marie qui les reconduit.
Il a l’air bien préoccupé !... oh ! il a quelque chose, bien sûr... tu me le diras.
MARIE.
Oui, oui.
Elle referme la porte et vient rapidement vers Duval, qui s’est mis à une table et écrit sur le devant de la scène.
Scène V
DUVAL, MARIE
MARIE.
Nous voici seuls enfin. Oh ! l’impatience me dévorait ! mais pourquoi ces traits bouleversés, cet air de mystère qui m’épouvante ?... et cette lettre ?...
DUVAL.
Vous la lirez, Marie.
MARIE, à part.
Oh ! mon Dieu ! quel ton froid et solennel ! jamais je ne l’ai vu ainsi, serait-il arrivé quelque nouveaux malheur ? les Marignon peut-être ne sont pas encore sauvés !
Courant vers Joseph.
Oh ! par pitié, mon ami, ne prolongez pas mes angoisses ! Dites-moi la vérité, telle qu’elle est ! je ne sais pourquoi, mais... je tremble... j’ai peur !
DUVAL, continuant d’écrire.
De cette lettre dépend l’honneur d’un honnête homme, la sûreté de toute une famille.
MARIE.
Je ne puis comprendre ?...
Bidaut dit quelques mots dans la coulisse.
C’est la voix de M. Bidaut.
Courant vers la porte.
Je vais fermer la porte... refuser de le recevoir...
DUVAL, se levant.
Arrêtez... oubliez-vous, Marie, que vous lui avez écrit aujourd’hui ? On ne peut chasser un créancier insolent, qu’après l’avoir payé et vous avez encore à acquitter votre dette envers M. Bidaut !... qu’il entre... nous réglerons nos comptes.
MARIE.
Tous me promettez du moins...
DUVAL.
Silence !...
Scène VI
DUVAL, MARIE, BIDAUT, entrant sans voir Duval
BIDAUT, à la cantonade.
Mais je vous dis qu’elle y est, moi, qu’elle m’attend, qu’elle désire me voir, entendez-vous !
Apercevant Marie.
Ah ! je vous trouve enfin ! ma charmante amie ! en revenant du bois j’ai reçu votre délicieux petit billet et je suis accouru avec toute la rapidité de Zéphirine, c’est ma jument que j’appelle ainsi... J’accourais donc, palpitant d’amour et de joie, quand votre concierge est venu m’arrêter dans votre escalier... il voulait à toute force me persuader que vous n’y étiez pas.
Il veut prendre la main de Marie qui la retire.
MARIE, froidement.
Il avait tort, monsieur...
BIDAUT, à part.
Elle est tout-à-fait apprivoisée !
Haut.
Ma toute belle, j’espérais bien que tôt ou tard mon amour, ma constance parviendraient à vous toucher ; mais je ne saurais vous peindre ma joie, lorsque j’ai reçu il y a quelques instants ce bienheureux billet dans lequel vous me priez de venir...
DUVAL, qui est resté dans l’ombre.
Pour recevoir l’argent qu’elle avait accepté à son insu, monsieur ? c’est bien... jamais créancier n’a été si ponctuel.
BIDAUT, à part.
Encore le numéro 1 ! d’où diable sort-il ?
DUVAL.
Avouez, monsieur, que vous ne vous attendiez guères à me trouver ici ? vous croyiez vos plans bien combinés, et vous espériez que la misère finirait par jeter dans vos bras cette pauvre jeune fille que vous aviez entourée de pièges ? Savez-vous, monsieur, que vous êtes bien lâche et bien infâme ? Ce n’est pas assez des avantages que vous donne l’usage du monde, l’éducation, la politesse menteuse de vos manières !... vous avez recours encore à cette richesse insolente, à cet or dont vous cherchez à éblouir nos femmes, pour leur faire commettre des fautes, et les flétrir après... mais du moins cette fois vos honteux projets seront déjoués ! on vous doit de l’argent !
Jetant une bourse sur la table.
Le voici, et maintenant, vous êtes payé !
BIDAUT.
Monsieur, je ne vous reconnais pas le droit de me chasser d’ici, et je ne sortirai pas,
Se tournant vers Marie.
avant de savoir...
DUVAL.
Si la somme qui vous est due est tout entière dans cette bourse ! comptez, comptez, monsieur, tout y est bien !
Marie s’approche lui.
BIDAUT, à part.
Mais où donc, monsieur le numéro 1 a-t-il trouvé cet argent ?... Allons, il paraît qu’il commande ici... la petite ne fait rien pour me retenir... partons !
Il s’approche de la table.
Mais prenons toujours cet argent, je me sens peu disposé à doter sa femme... où diable a-t-il pu trouver...
Regardant la lettre qui est reste sur la table.
Que vois-je... « à M. le régent de la Banque ! » Quelle est cette lettre...
Il lit le dos tourné à Duval et Marie.
DUVAL.
Eh bien, monsieur ?
BIDAUT, souriant.
Qu’ai-je lu...
Haut.
Je compte, M. Duval ; puisque je ne suis qu’un créancier, il faut que je m’assure au moins qu’on acquitte toute ma créance... vous devez savoir cela, vous qui êtes un fidèle garçon de Banque.
Il continue de lire.
DUVAL, à Marie.
L’âme d’un usurier et l’insolence d’un fat !
BIDAUT, à part.
Oh ! je vais prendre ma revanche !
Il met la lettre dans sa poche sans qu’on s’en aperçoive.
DUVAL.
Il n’y manque rien ?
BIDAUT, ironiquement.
Rien... et je me retire...
Il s’avance lentement vers la porte.
Mais je viens de contracter ici deux dettes dont je me souviendrai, l’une
Regardant Marie.
envers une personne folle et aveuglée qui a prêté la main à l’humiliation que l’on m’a fait subir ; l’autre
Regardant Duval.
envers un héros de probité... que je compte revoir bientôt...
Il entr’ouve la porte.
DUVAL.
Comment ? monsieur abaisserait son orgueil jusqu’à consentir à se battre avec moi, à m’appeler sur le terrain...
MARIE.
Duval, au nom du ciel...
BIDAUT, à Marie.
Rassurez-vous, mademoiselle, ce n’est pas là que lui et moi nous devons nous revoir ?
DUVAL.
Mais où donc, alors ?
BIDAUT, d’une voix éclatante.
À la Cour d’Assises... misérable...
Il s’élance dehors et tire sur lui la porte qu’il ferme à double tour.
Scène VII
MARIE, DUVAL
DUVAL.
Mon Dieu ! est-ce que déjà...
MARIE.
Duval... que s’est-il donc passé ? que signifient les terribles paroles de cet homme...
DUVAL, courant à la table.
Ah ! ma lettre... oui, disparue... oh ! c’en est fait, il sait tout.
MARIE.
Eh bien !... parlez, parlez vite.
DUVAL.
Marie, il n’y a pas un instant à perdre... il faut courir après cet homme... il faut fuir...
Secouant la porte.
Fermée ! fermée ! ah ! je suis perdu !
MARIE.
Perdu !... dites-vous... pourquoi ?
DUVAL.
Parce que dans un instant on sera sur mes traces... on viendra m’arrêter...
MARIE.
Oh ! vous me rendez folle... répondez donc, monsieur, répondez... qu’avez-vous fait...
DUVAL.
Ne me repoussez pas avec horreur Marie... C’est pour vous que j’ai été coupable.
Avec explosion.
J’ai volé la Banque...
MARIE.
Malheureux !
DUVAL.
Il fallait vous sauver... J’ai vainement épuisé ma dernière chance de salut ; j’ai vu s’évanouir mes dernières espérances... Je croyais avoir des amis ; mes amis n’ont repoussé.
MARIE.
Grand Dieu !
DUVAL.
Un seul moyen restait encore, cette lettre maudite pour votre insolent adorateur... la lui porter ct mourir, était la seule idée qui me restait en ce moment... Le cœur brûlé de jalousie, de désespoir et de rage, je sortis de chez cet homme... et seulement alors, je m’aperçus que j’étais écrasé sous le poids de l’or et de l’argent que je devais rapporter à la Banque... Je m’arrêtai, je regardai cet éblouissant trésor... Puis, ma tête s’est perdue... je me suis mis à courir, sans savoir où j’allais... sans projet... sans pensée... sans écouter je ne sais quelle voix de la conscience qui me parlait au dedans de moi même, et je suis arrivé assez à temps pour sauver mon père et ma mère adoptifs, pour vous arracher des bras de cet infâme !
Il veut s’approcher d’elle.
MARIE.
Un vol ! un vol horrible !... Mais bientôt tout sera découvert.
DUVAL.
Oui, car cette lettre qui était là, il n’y a qu’un instant, contenait l’aveu de mon crime ; je l’avais écrite pour mettre le vieux Marignon à l’abri de tout soupçon, pour qu’on n’accusât que moi... Cette lettre, Bidaut l’a lue, l’a emportée, et vous pouvez juger, par ses dernières paroles, de l’usage qu’il en veut faire.
MARIE.
Eh bien ! que faites-vous ici ? Partez, partez vite.
DUVAL.
Je ne partirai qu’avec vous.
MARIE.
Jamais !
DUVAL.
N’avez vous pas promis d’appartenir à celui qui sauverait votre famille et vous-même ?
MARIE.
Je ne savais ce que je promettais, dans ce moment affreux !
DUVAL, se rapprochant.
Écoutez, Marie... vous aimez la richesse, le luxe, et je puis maintenant vous donner luxe et richesse...
Tirant de sa poche un portefeuille et une bourse.
Voici de l’or, des billets de banque, toute une fortune... Voyez, voyez !
MARIE.
Laissez-moi !... plutôt mourir que vous suivre, que partager votre crime !
DUVAL.
Eh bien ! viennent la honte, l’infamie, le bagne ; je les attends !
Il s’assied.
MARIE.
Réfléchissez, Duval, puis-je partir avec vous, quand vous êtes encore chargé d’une somme volée...
DUVAL
Eh bien ! je jure solennellement que je restituerai cette somme à la Banque.
MARIE.
Et moi, Duval, je jure alors de n’appartenir jamais à un autre ! Dieu a entendu nos serments, qu’il vous pardonne vos fautes... et maintenant, fuyez !
Scène VIII
MARIE, DUVAL, MARIGNON
Marignon s’arrête sur le seuil de la porte et les regarde un moment.
MARIE et DUVAL.
Marignon !
MARIGNON.
C’est ça, mes enfant, ne vous gênez pas... un tête-à-tête... enfermés.
MARIE.
Mon oncle !
DUVAL, à part.
Il ne sait rien.
MARIGNON.
Allons, allons ! je ne veux pas gronder ce soir ; je suis trop heureux...
À Duval.
Ah ça, te voilà donc, enfin, mauvais sujet ? je te cherche depuis une heure, sans pouvoir te trouver... Monsieur rend à un pauvre vieillard les plus grands services qu’un homme puisse rendre à un autre, et il se réfugie chez sa fiancée, espérant qu’on ne sera pas assez hardi pour venir le chercher là... C’est mal, Joseph, c’est très mal ! de ne pas vouloir que ton vieil ami te dise tout le bonheur dont tu es la cause.
DUVAL, à part.
Mon Dieu ! mon Dieu !
MARIGNON.
J’avais laissé ma pauvre famille dans la désolation, et, en rentrant chez moi, je trouve que nos meubles sont à leur place, plus d’huissier ; Dominique me montre l’acceptation en bonne forme de son remplaçant... Ma pauvre femme elle-même est toute joyeuse, et la joie lui a presque rendu la santé... Et c’est toi qui a fait tout cela, et tu ne veux pas que je te dise que tu es un brave et généreux garçon, que j’aime au tant que mon fils. Tu ne veux pas que je te serre dans mes bras... que je t’embrasse enfin ?
DUVAL, embarrassé.
Mon ami...
MARIGNON.
Eh ! viens donc ! viens donc !
Duval se jette dans ses bras, après un mouvement d’hésitation.
MARIE, à part.
Comme il doit souffrir !
Haut.
Mon oncle, Duval allait sortir, lorsque vous êtes entré... une affaire pressante.
DUVAL.
En effet, mon ami, j’allais...
MARIGNON.
Je ne crois pas aux affaires pressantes...
Souriant.
Que diable, Marie, je te le rendrai, ton fiancé ! il ne faut pas que la femme fasse oublier les amis !...
À Duval.
Eh bien ! Joseph, explique-moi comment tu es parvenu...
MARIE.
Mon oncle, Duval vous expliquera tout cela demain... mais dans ce moment...
DUVAL.
En ce moment, il faut que je m’éloigne, il le faut.
MARIGNON.
Encore !...
Les examinant.
Au fait, qu’avez-vous donc tous les deux ? je vous trouve l’air tout bouleversé... Mais je devine,
À Duval.
tu crains des reproches, pour n’avoir pas rempli ton devoir avec ton exactitude ordinaire. J’ai arrangé cette affaire ; j’ai obtenu que tu ne rendrais tes comptes que demain matin ; j’ai répondu de tout, moi, le plus ancien des garçons de recette. Et sachant quelles sommes tu as dû toucher pour moi, j’ai écrit, comme reçus, sur mon registre, les cent-cinquante mille francs que je et t’avais confiés.
DUVAL, avec force.
Malheureux ! vous n’avez pas fait cela ! Oh ! dites-moi que vous n’avez pas fait cela ?
MARIGNON, tranquillement.
Eh bien ! pourquoi pas ? puisque ces fonds c’est à moi qu’on les avait confiés.
DUVAL, avec égarement.
Pourquoi ?... Mais ils vous accuseront d’être mon complice ! vous êtes perdu avec moi.
MARIGNON.
Perdu !... Tu es donc coupable ?... que signifie ?
MARIE.
Mon oncle, ne l’écoutez pas... il souffre... il ne sait pas mesurer ses paroles... les émotions de la journée...
MARIGNON.
Laisse-moi... tu ne sais pas quels horribles soupçons cette parole a fait naître.
On entend frapper violemment à la porte de la rue.
MARIE, avec terreur.
Joseph, fuyez !... les voici... la petite porte qui donne sur la cour.
MARIGNON.
Ciel ! on le poursuit, dis-tu ?
DUVAL, s’élance pour sortir.
Adieu, Marie.
MARIGNON.
Misérable ! tu as volé la Banque !
Il saisit Duval au collet et le terrasse.
MARIE.
Grâce ! grâce ! mon oncle.
MARIGNON.
Grace pour ce crime infâme ?
MARIE.
Mais s’il l’a commis, n’est-ce pas pour nous sauver tous ?... vous, votre femme, votre fils et moi-même ?
MARIGNON.
Malheureux... Oh ! pourquoi nous as-tu secourus au prix de notre honneur ?... Mais ne valait-il pas mieux nous laisser mourir de faim que de nous faire mourir de honte ?
DUVAL.
Le délire s’est emparé de mon esprit, ma tête s’est perdue... Et maintenant, que justice soit faite... Livrez-moi donc !
MARIGNON.
Te livrer ?... Eh bien...
MARIE.
Écoutez... ils accourent.
Elle s’élance vers la porte.
MARIGNON.
Eh bien ! que le ciel te châtie ou te pardonne, mais, moi, je ne peux pas le dénoncer, je ne peux pas livrer celui qui fut presque mon fils.
DUVAL.
Marignon !
MARIGNON.
Cet argent de la Banque ?
DUVAL, lui remettant les billets.
Le voici.
MARIE.
Hâtez-vous ! là, par la petite porte... hâtez-vous !
MARIGNON.
Mais fuis donc ! fuis donc !
DUVAL.
Mon père... Marie... adieu, adieu, pour toujours !
Il sort par la petite porte.
MARIGNON, accablé.
Pardonnez-moi, mon Dieu ! mais je ne pou vais livrer le fils de mon pauvre Duval.
Scène IX
MARIE, MARIGNON, DOMINIQUE, LOUISE, LE COMMISSAIRE DE POLICE, RECORS et SOLDATS
DOMINIQUE.
Mon père, que se passe-t-il donc ?... on vient de faire une perquisition chez vous.
LOUISE.
On parle de t’arrêter.
MARIGNON.
Moi ?
LE COMMISSAIRE, aux soldats.
Faites garder cette porte, cet homme est un des auteurs du vol commis aujourd’hui à la Banque.
MARIGNON.
Que dites-vous, Monsieur ?
LOUISE.
Mon mari ?
DOMINIQUE.
Mon père ?
MARIE.
Lui ?
MARIGNON, tranquillement.
Il y a ici une erreur, Messieurs, et je vous prie de m’entendre.
LE COMMISSAIRE.
Un faux matériel a été commis, sur les registres de la Banque, par vous, Marignon.
MARIGNON.
Ah ! ce soupçon infâme...
LE COMMISSAIRE.
Tout ce qu’a dit M. Bidaut est vrai...
Aux soldats.
Qu’on le fouille.
Les soldats obéissent.
MARIGNON.
Arrêtez !... j’ai en effet sur moi l’argent qui a été volé... le voici...
Il remet le billet au commissaire.
Mais cet argent, je l’avais arraché des mains de Duval, pour le restituer moi-même.
LE COMMISSAIRE.
Oui, il ne manque que les sommes employées à payer vos dettes... Allons, emmenez le prisonnier !
LOUISE.
Lui ! Marignon, coupable, déshonore !
Elle tombe accablée sur une chaise.
MARIE.
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
MARIGNON.
Ma pauvre Louise !
Avec force, en levant les yeux au ciel.
Ah ! Dieu sait bien que je n’ai pas volé la Banque.
ACTE IV
Le théâtre représente le bagne de Brest.
Scène première
PLUSIEURS FORÇATS, GARDES CHIOURMES, UN SERGENT et UN ADJUDANTDES CHIOURMES, FAGEROLLES
L’ADJUDANT.
Sergent, vous enverrez, après l’heure du repos, six rouges au grand chantier de la marine, et quatorze verts à la corderie.
LE SERGENT.
Oui, Adjudant.
L’ADJUDANT.
Qu’on surveille les bruns avec soin, plusieurs projets d’évasion m’ont été signalés.
LE SERGENT.
Par qui ?
FAGEROLLES, s’approchant.
Par moi, sergent ?
LE SERGENT.
Ah ! ah ! c’est bien... je sais qu’on peut compter sur toi.
FAGEROLLES.
Depuis quatre ans que je suis ici, je fais ce que je peux pour me rendre utile.
LE SERGENT.
Tu seras récompensé.
FAGEROLLES.
Sergent, je suis bien malade... j’aurais besoin de me refaire un peu à l’infirmerie.
L’ADJUDANT.
C’est bon, nous verrons ça après la visite du docteur.
FAGEROLLES.
Adjudant... c’est que je crains...
L’ADJUDANT.
Quoi ? que crains-tu ?
FAGEROLLES.
Je crains qu’on ne soupçonne les petits services que je vous rends, et vous connaissez les forçats... s’ils étaient sûrs de leur affaire...
LE SERGENT.
Eh bien ?
FAGEROLLES.
Je serais bientôt sûr de la mienne...
L’ADJUDANT,
Attention, voici de nouveaux pensionnaires qui reviennent du chantier.
Scène II
LES MÊMES, PLUSIEURS FORÇATS et GARDES, MARIGNON et CHAMBORAN
Quelques-uns sont chargés de divers fardeaux ; Marignon porte une poutre, il la laisse tomber et s’arrête accablé.
L’ADJUDANT.
Eh bien ! est-ce là qu’on t’a dit de porter cette poutre ?
MARIGNON.
La force m’abandonne.
L’ADJUDANT.
Allons, allons, recharge tes épaules et marche, ou sinon...
Il va pour frapper ; Chamboran vient se placer entre eux deux et reçoit le coup de canne.
CHAMBORAN.
Bravo !
L’ADJUDANT.
Que viens-tu faire ici, toi ?
CHAMBORAN.
Allez toujours, mon Adjudant ; lui, voyez-vous, c’est un brave et honnête homme... moi au contraire, je ne suis qu’un mauvais garnement fini, et puisqu’il faut que votre colère se passe, autant vaut que ça soit sur moi que sur ce vieux débile.
L’ADJUDANT.
Va-t’en !
MARIGNON.
Oui, retire-toi, malheureux... laisse-moi souffrir seul.
CHAMBORAN.
Non, ne vous gênez pas, mon Adjudant ; voyez-vous, vos coups de canne, ça ne me touche que les épaules, à moi, tandis que le vieux père chose ça lui retombe sur le cœur, et c’est plus malsain. Voyons, passons c’te petite colère, j’ai les reins solides...
L’ADJUDANT.
Encore une fois éloigne-toi, je ne châtie qu’avec justice, et tu n’es coupable de rien en ce moment.
CHAMBORAN, lui enlevant son mouchoir par la poche de derrière de sa redingote et le lui présentant.
C’est ce qui vous trompe, mon bon Adjudant, voilà un peu de mouchoir que je vous avais subjugué.
L’ADJUDANT.
Mon mouchoir...
CHAMBORAN, à Marignon.
Et toi, file donc, vieux... tu vois bien qu’il t’a oublié.
MARIGNON.
Je me rappellerai que tu m’as épargné cette honte...
Il s’éloigne.
L’ADJUDANT, à Chamboran.
Prends garde que je ne te mette à la double chaine et que je ne t’enferme au cachot.
CHAMBORAN.
Merci du petit cadeau, faut garder ça pour ceux qui l’adorent ; j’en mange pas, moi, du tout...
L’ADJUDANT.
Ah ! tu raisonnes... eh bien, demain...
CHAMBORAN.
Demain, mon Adjudant, si vous avez des commissions pour les Grandes-Indes, je m’en charge avec reconnaissance.
L’ADJUDANT.
Ce ne sera que dans dix ans que ton temps sera fini.
CHAMBORAN.
Oui, mais j’ai, pour dans trois mois, un rendez-vous d’amour avec une bayadère, et j’essaie rai de m’y rendre... d’ailleurs, ma santé s’altère ici.
L’ADJUDANT.
Vraiment !... et quand tu parviendrais à t’enfuir, crois-tu qu’on ne te reprendrait pas ?
CHAMBORAN.
Si fait... oh ! je sais bien que la justice a l’œil grand ct le bras très long... je sais bien qu’on nous repince toujours, et que chaque fois le châtiment s’aggrave... témoin moi, qu’un vol avait conduit ici pour cinq ans, et que mes tentatives de promenades ont fait condamner à vingt... mais enfin, c’est plus fort que moi, et malgré les obstacles sans nombre, et la peine qui m’attend au retour, j’ai toujours des espèces de fourmis dans les jambes... il faut que je déménage... l’évasion, c’est ma maladie, c’est mon infirmité ; le cachot, voilà le médicament ; par malheur le mal est plus fort que le remède.
L’ADJUDANT.
C’est bon ; merci de l’avis, nous te surveillerons.
LE SERGENT.
C’est qu’il tenterait de s’évader comme il le dit.
L’ADJUDANT.
On y aura l’œil.
Il s’éloigne suivi du sergent.
MARIGNON.
Espérez-vous réellement vous enfuir ?
CHAMBORAN.
Un peu... je dirai même beaucoup...
FAGEROLLES.
Alors, il n’est guère malin de les prévenir... demain, ils veilleront sur toi.
CHAMBORAN.
Demain, c’est possible, mais je file aujourd’hui.
TOUS.
Aujourd’hui ?
CHAMBORAN.
Ou du moins j’essaie encore une fois.
FAGEROLLES.
Et comment ?
CHAMBORAN.
Comment ? d’abord je...
MARIGNON.
Arrêtez... ne dites pas votre secret à cet homme.
FAGEROLLES.
Pourquoi donc !
MARIGNON.
C’est sa lâcheté, sa perfidie, qui l’ont conduit au bagne... comme il m’a trahi, moi, son collègue, son ami, il vous trahirait aussi, vous...
CHAMBORAN.
Ah ! ça se pourrait une infamie pareille... ah ! nous voudrions vendre les amis !... Fagérolles, Fagérolles, prends garde.
TOUS.
Vengeance ! vengeance !
On va l’entourer.
FAGEROLLES.
Non, grâce ! grâce ! je vous prie... au se cours !... au secours !...
Plusieurs gardes chiourmes s’approchent.
LE SERGENT.
Qu’est-ce ?... qu’y a-t-il ?
CHAMBORAN.
Rien du tout, mon Adjudant.
FAGEROLLES.
Sergent, on voulait...
CHAMBORAN, bas.
Silence !... ou nous te repêcherons.
FAGEROLLES, à part.
N’importe, je l’ai échappé belle.
Il s’esquive, et les gardes remontent la scène.
Et moi, je me vengerai, va.
Scène III
LES MÊMES, hors FAGEROLLES
CHAMBORAN.
Nous v’là débarrassés du Fagérolles ; c’est ce que je voulais... Écoutez tous, j’ai à vous parler...
TOUS.
Ah !
Ils s’approchent tous de Marignon avec les apparences du plus grand respect.
CHAMBORAN.
D’abord, vieux père chose, je vous dirai que, moi et les autres, nous vous avons pris en affectation... et pourtant il n’y a qu’un mois que vous êtes parmi nous.
MARIGNON.
Il est vrai, il n’y a qu’un mois que je suis au bagne de Brest, mais condamné à vingt ans, j’ai subi déjà huit années de fers à Toulon... j’ignore pourquoi on m’a transféré ici.
CHAMBORAN.
Je l’ignore également ; mais, en tout cas, vous faites disparate au milieu de l’assemblée... répondez franchement, la main sur le côté gauche de la veste... de quel droit êtes-vous au bagne ?
MARIGNON.
Un malheureux que j’avais élevé, que j’aimais presque autant que mon fils, avait commis un vol. Ce vol, je l’avais découvert et j’allais livrer le coupable à la justice, quand je me souvins que son père avait été mon meilleur ami... mon âme fut émue de compassion, j’arrachai de ses mains l’argent volé à la Banque... et je fis évader le coupable... Mais déjà on était sur ses traces... c’était moi qui l’avais laissé fuir... l’argent que je lui avais enlevé, on le saisit entre mes mains... et, par une circonstance fatale, des sommes inscrites sur mon registre avant leur rentrée, firent supposer un faux, et on m’accusa de complicité dans ce crime. Vainement, je protestai de mon innocence, vainement, j’invoquai le souvenir de trente années de services et de probité. Tant de preuves s’élevaient contre moi, que je dus subir un arrêt infamant. J’ai vu mon pauvre fils, la tête courbée sous notre déshonneur commun, leur demander la grâce de partager mon sort ; j’ai vu la jeune fille à qui je tenais es lieu de père, se trainer aux pieds de mes juges... et ma Louise, ma femme, la compagne de toute ma vie, elle, qui avait eu le courage de partager mes longs combats contre la misère et la douleur... la force lui a manqué pour supporter l’infamie, et je l’ai vue mourir... mourir de désespoir et de honte...
CHAMBORAN, essuyant une larme.
Vieux père... chose, vous m’attendrissez !
MARIGNON.
Et j’ai pu, durant huit années, supporter cette vie affreuse, résister à ces terribles souvenirs !
CHAMBORAN.
Huit années, en voilà assez... Il faut vous en aller, père Marignon ; allez-vous-en ! allez-vous-en !...
MARIGNON.
Partir !... mais je suis pour douze années encore enchaîné dans ce bagne... et ce n’est que dans douze ans...
CHAMBORAN.
Allons donc ! j’ai encore mes dix ans à faire, c’est vrai... mais j’ai pas le temps de payer, je fais faillite aujourd’hui... Faut m’imiter... enfin, voulez-vous êtes libre ?
MARIGNON.
Si je le veux !... revoir mon fils, embrasser ma pauvre Marie... Mais comment parvenir ?
CHAMBORAN.
Je m’en charge... Je n’ai besoin de sortir que dans un mois... et d’ici là...enfin, suffit !... Mes petits moyens d’évasion, tout ce que j’avais préparé à mon usage... eh bien ! eh bien... je vous l’offre... ça vous va-t-il ?
MARIGNON.
À moi... la liberté, l’air, la vie !...
CHAMBORAN.
Et trois francs dix sous que j’ai là, dars le tiroir de mon secrétaire... voilà.
Les gardes chiourmes redescendent ; le Sergent, l’Adjudant et Fagerolles entrent en scène.
Scène IV
LES MÊMES, FAGEROLLES, L’ADJUDANT, LE SERGENT, GARDES CHIOURMES
FAGEROLLES, à part.
Ils ont causé bien longtemps... il se prépare quelque chose...
MARIGNON.
Silence ! on vient.
L’ADJUDANT.
Monsieur l’Inspecteur accorde, pour aujourd’hui, une heure de repos aux travailleurs.
TOUS.
Ah !
L’ADJUDANT.
La ration de vin sera doublée si, pendant la visite qui va avoir lieu, on observe le silence et une tenue convenable...
CHAMBORAN.
Des visiteurs !... fameux... Des milords, peut-être ?...
MARIGNON.
Encore une nouvelle humiliation !
L’ADJUDANT.
Il s’agit de deux grands personnages : un consul de Russie, et son ami, M. Arthur de Barloff.
CHAMBORAN.
Oui, oui, des milords russes ! compris...
Tous les forçats se placent, les uns debout, d’autres assis ou couchés.
Scène V
LES MÊMES, LE CONSUL, entouré de nombreux VALETS, il donne le bras à JOSEPH DUVAL, qui est richement vêtu, mais son visage pale, ses cheveux rares, sa taille courbée accusent de longs chagrins
L’ADJUDANT, désignant les forçats.
Jean Mardoché !
CHAMBORAN.
Dit le gai Chamboran.
L’ADJUDANT.
Il a déjà tenté de s’évader quatre fois.
CHAMBORAN.
Cinq, si ça vous est égal, mon Adjudant.
LE CONSUL.
Passons, Monsieur, passons !
L’ADJUDANT.
Pierre Marignou !
DUVAL.
Marignon !...
Il s’éloigne avec épouvante.
L’ADJUDANT.
Ancien garçon de recette... Il a volé la Banque.
MARIGNON.
Non, cela est faux ! cela est faux !...
DUVAL, à part.
Lui... lui, ici !
L’ADJUDANT.
Allons, silence !... Si on les croyait, ils seraient tous innocents.
MARIGNON.
Mon Dieu ! mais n’est-ce donc pas assez de mes tortures de chaque jour... faut-il qu’on m’accable sans cesse de honte et d’infamie... et que je n’aie pas le droit de crier : Je ne suis pas coupable !... je ne suis pas coupable !...
L’ADJUDANT.
Silence, encore une fois !
DUVAL, s’élançant de manière à dérober ses traits à Marignon.
Arrêtez !... et... si en effet ce malheureux... avait été injustement condamné ?...
L’ADJUDANT.
C’est ce qu’ils disent tous, Monsieur.
MARIGNON, à Duval, qui détourne la tête.
Je vous remercie, Monsieur, de l’intérêt que vous daignez me témoigner... Vous êtes le premier, le premier depuis plus de huit ans !... Entouré de respects et d’honneurs, vous prenez pitié du pauvre galérien... c’est au ciel seulement qu’il appartient de vous récompenser !...
DUVAI, à part.
Oh ! quelle épreuve, mon Dieu !... je sens que la force et le courage m’abandonnent.
LE CONSUL, allant à Dural.
Qu’avez-vous donc, mon ami ?
DUVAL.
Rien... je suis si souffrant, Monseigneur ! et puis la vue de ces malheureux... me fait mal
LE CONSUL.
Celui-ci surtout paraît produire sur vous une impression étrange...
DUVAL.
C’est que le sort de cet homme me touche en effet bien vivement... Je vous ai dit qu’autre fois, avant mon voyage en Russie, avant que les services que j’ai rendus à votre pays m’eussent enrichi, je vous ai dit que je n’étais qu’un pauvre enfant du peuple, et que j’avais vu condamner injustement...
LE CONSUL.
Un galérien dont je sollicite la grâce près du gouvernement français... Mais ce galérien était, il me semble, à Toulon.
DUVAL.
Et c’est ici que je le retrouve... Le voilà !... Oh ! comme la douleur l’a brisé ! voyez, cette grâce arrivera trop tard.
LE CONSUL.
Mais il faut relever son courage, lui apprendre que bientôt il sera libre peut-être... libre par vous...
DUVAL
Oh ! non... non !
LE CONSUL.
Que craignez-vous donc ?
DUVAL.
Je ne veux pas lui donner un espoir qui peut encore s’évanouir... et puis... et puis je vous le répète, l’horrible mal qui me tue est trop violent en ce moment... Oh ! emmenez-moi, Monseigneur, emmenez-moi !...
L’ADJUDANT.
Si ces Messieurs désirent continuer...
LE CONSUL.
Non...
À un valet.
Faites avancer la voiture, votre maître est souffrant...
Le domestique sort.
Venez, venez, mon ami...
DUVAL.
Oh ! nous le sauverons, n’est-ce pas, Monseigneur ?...
LE CONSUL, à l’Adjudant.
Monsieur, nous nous retirons.
Il lui donne une bourse.
DUVAL, à part.
S’il m’avait reconnu, mon Dieu ! je sens que je serais mort à ses pieds.
LE CONSUL, à l’Adjudant.
Veuillez distribuer ceci aux plus nécessiteux, et aux moins coupables
Il sort avec Duval et les valets.
Scène VI
LES MÊMES, hors DUVAL et LE CONSUL
CHAMBORAN.
La visite a été courte, mais fructueuse, que je crois...
Il regarde la bourse.
L’ADJUDANT, la mettant dans sa poche.
Aux moins coupables, a dit le seigneur russe.
CHAMBORAN.
Et aux plus nécessiteux, a ajouté l’idem, mon Adjudant... et je le suis fièrement, nécessiteux ! J’aurai besoin de monnaie pour mon voyage des Grandes-Indes.
L’ADJUDANT.
Tu viendras m’en demander au moment de ton départ.
CHAMBORAN, à part.
C’est ça... prends garde de le perdre...
L’ADJUDANT.
Allons, rentrons dans la grande salle, et après... aux travaux du port !
CHAMBORAN, bas.
Père Marignon, j’emporterai mes petits ouvrages en coco, pour augmenter le boursicot de voyage... À tout à l’heure, je vous expliquerai mes plans...
MARIGNON, sortant d’une profonde rêverie.
Hein ?... vos plans... que voulez-vous dire ?...
CHAMBORAN.
Chut donc... Est-il bête, il est trop maladroit ! Décidément, c’est un honnête homme.
Tous les galériens sortent de scène.
FAGEROLLES, sortant.
Il lui a parlé bas !...
Marignon se dispose à les suivre ; l’Adjudant l’arrête.
L’ADJUDANT.
Reste ici, toi.
MARIGNON.
Comment ?
L’ADJUDANT.
Il y a là quelqu’un qui a sollicité et obtenu l’autorisation de te voir, de te parler... Je vais donner l’ordre de laisser entrer.
Il sort.
Scène VII
MARIGNON, puis MARIE, DOMINIQUE et MOULINET, en uniforme de soldats
MARIGNON.
Quelqu’un pour moi, a-t-il dit ?... Et qui peut donc s’intéresser à mon sort ?... ceux qui me sont chers gémissent accablés sous le poids de la honte, bien loin d’ici. Quelque curieux, peut être... ou plutôt cet homme se sera trompé, ce n’est pas de moi qu’il s’agit...
L’ADJUDANT, reparaissant suivi de Dominique et de Marie.
Tenez, le voilà.
MARIGNON.
Ciel ! qu’ai-je vu ?...
DOMINIQUE.
Mon père !...
MARIE.
Mon oncle !...
Ils se jettent dans ses bras.
MARIGNON.
Vous... vous, mes enfants !... ce n’est pas un rêve... une illusion... oui, ce sont eux... ce sont eux !... Je vous revois, je vous embrasse, après huit années... Oh ! de la force, mon Dieu !... donnez-moi de la force pour supporter ce bonheur !...
DOMINIQUE.
Calmez-vous, mon père...
MARIGNON.
Oh ! tu ne sais pas, Dominique, tu ne peux pas savoir ce que j’éprouve... Ce n’est pas seulement une famille que je retrouve, que j’embrasse... mais il n’y a que vous au monde devant qui je n’ai pas à rougir, devant qui je ne courbe pas honteusement la tête...
MARIE.
Vous... vous, si généreux, si pur...
MARIGNON.
Oui, mes enfants ; oui, depuis huit ans que je suis ainsi confondu au milieu des criminels, la foi et le courage m’ont abandonné ; la foi s’est éteinte sous cet habit flétrissant ; le courage s’est anéanti sous les coups de nos gardiens... que vous dirai-je, hélas ! les erreurs de la loi sont si rares, que nul ne pouvait croire que je fusse innocent... Ils m’ont tant prodigué d’insultes et de railleries, ils se sont moqués tant de fois de mes protestations, qu’ils ont presque vaincu ma mémoire et ma raison, et que j’ai fini par me demander si je n’étais pas réellement coupable, si je n’avais pas commis ce crime que j’expie depuis si longtemps.
MARIE.
Oh ! non, non, je le sais bien, moi !
DOMINIQUE.
Nous le savons tous !
MOULINET, pleurant.
Oui... tous ! cré coquin !... J’en mettrais ma main... partout où on voudrait, père Marignon.
MARIGNON.
Ah ! c’est toi, mon garçon... Moulinet !...
MOULINET.
Oui, Moulinet... vous savez... Ah ! vous avez de la peine à me reconnaître ! Je suis grandi de trois pouces, au régiment.
MARIGNON.
Au régiment ?... en effet...
Les examinant.
Et toi aussi, Dominique, soldat !
DOMINIQUE.
Il l’a bien fallu, mon père ; j’espérais que dans un régiment, confondu dans la foule, on ne connaîtrait pas notre cruelle histoire ! Car vous n’étiez pas le seul qui proclamiez votre innocence, et dont la voix était étouffée par l’incrédulité... « C’est le fils d’un forçat, » disait-on, et peu à peu j’ai vu s’éloigner de moi tous ceux qui me serraient la main, puis après, tous ceux qui me fournissaient les moyens de vivre... Je demandais du travail, et il ne s’en trouvait plus pour moi... j’aurais demandé une aumône qu’ils me l’eussent aussi refusée, peut-être, en me repoussant avec mépris et en disant : C’est le fils d’un forçat !...
MARIGNON.
Mon pauvre Dominique !... Oh ! Joseph Duval... nous aurons un terrible compte à régler devant Dieu !...
DOMINIQUE.
Alors, je retrouvai Moulinet...
MOULINET.
Présent !... C’est moi qui lui ai conseillé d’endosser le pantalon garance... et nous sommes partis pour Alger, où nous avons mangé un peu de Bédouins.
MARIGNON.
Et ma bonne Marie ?
DOMINIQUE.
Oh ! oui... toujours bonne, toujours vertueuse, comme autrefois... Lorsqu’elle sut que notre régiment venait à Brest : « Je serai du voyage, » s’est-elle dit...
MOULINET.
Et alors, elle passait les jours, les nuits et tout le reste du temps, à tricoter de l’aiguille, pour amasser son voyage.
MARIE.
Le ciel a secondé mes efforts !
MOULINET.
Le ciel et votre travail... c’est-à-dire que l’abeille et la fourmi n’étaient que des flâneuses auprès de vous...
MARIE.
Et ne suis-je pas aujourd’hui bien payée de mes peines ?
MARIGNON.
Chère enfant !...
Scène VIII
MARIGNON, MARIE, DOMINIQUE, MOULINET, CHAMBORAN
CHAMBORAN.
Excusez... si je vous dérange.
DOMINIQUE.
Que nous veut cet homme ?
MARIGNON.
C’est le seul qui s’intéresse à mon sort... qui n’a pas douté de mon innocence ; et, bien qu’enchaîné comme moi, son dévouement a souvent adouci mes souffrances.
CHAMBORAN.
Nous avons de la société... je m’évapore.
MARIGNON.
Ce sont mes enfants.
CHAMBORAN.
Ah !... vous m’aviez dit que vous n’aviez qu’un fils... un fils qui se compose de deux garçons et d’une fille... c’est rare.
MARIGNON.
Ce jeune homme est un ami... et voilà...
Il montre Marie.
CHAMBORAN.
Votre amour de nièce... je devine... dans ce cas...
À Moulinet.
Jeune homme... pist.
Il lui fait signe de s’éloigner.
MOULINET.
De quoi ?
CHAMBORAN.
Je vous dis : Jeune homme... pist.
MOULINET.
Je ne sais pas parler étranger.
CHAMBORAN.
Alors, je vais m’expliquer... j’ai à causer d’objets que vous êtes libre de ne pas entendre, et pour jouir entièrement de cette liberté... je vous engage...
MOULINET.
Ah oui !... pist... j’y suis... ça veut dire : Allez vous promener.
CHAMBORAN.
C’est ça même... vous y êtes.
MARIGNON.
Mais, ne pouvez-vous, devant lui ?...
CHAMBORAN.
Jamais, c’est des secrets de famille.
MOULINET.
Ne vous gênez pas, je rentre au poste et je reviendrai.
CHAMBORAN.
À votre aise, guerrier... à votre aise.
Moulinet entre dans le corps-de-garde.
Scène IX
MARIGNON, MARIE, DOMINIQUE, CHAMBORAN
CHAMBORAN, vivement.
À présent, père Marignon du bon Dieu... c’est l’instant, c’est le moment, c’est la véritable heure... à ce soir l’école buissonnière.
DOMINIQUE.
Que voulez-vous dire ?...
CHAMBORAN.
Que ce vieil âgé ne peut pas rester plus longtemps dans le bocal... il commence à moisir, il lui faut du grand air.
En ce moment Fagerolles paraît au fond, les observe, et se blottit derrière un bloc de pierre.
MARIGNON.
Mais le moyen de fuir ?...
FAGEROLLES, à part.
Un projet de fuite !... écoutons.
CHAMBORAN.
Le moyen ! je vas vous l’octroyer... tout était prêt pour moi, il ne me manquait plus qu’un ami au dehors, vous le tenez dans la personne de votre fils... à la besogne donc.
MARIGNON.
Mon fils... mais s’il y avait du danger !...
DOMINIQUE.
Ne craignez rien, mon père ; il s’agit de vous, de votre liberté.
CHAMBORAN.
Du danger... jamais... au contraire, les sentinelles ôtent respectueusement leur bonnet à ceux qui s’évadent, et les gardes chiourmes leurs souhaitent des bons voyages. Ah ça ! père chose, voudriez-vous pas sortir du bagne les mains dans les poches... et en disant tout bonnement au concierge : Cordon, s’il vous plaît ?... ça serait trop commode.
MARIE.
Mais enfin, ce moyen, Monsieur ?
CHAMBORAN.
M’y voici... écoutez bien... vous savez qu’au bagne nous n’avons tous qu’une seule pensée, la liberté !... on la préfère généralement aux coups de bâton...or, je m’étais dit la nuit, en rêvassant sur mon banc... s’il existait un souterrain, qui, traversant toute la largeur de la cour, aurait une issue sur le port, il ne serait pas impossible avec un peu d’hardiesse de faire dans la muraille une petite saignée qui me donnerait la clé des champs.
TOUS.
Eh bien ?
CHAMBORAN.
Eh bien ! le souterrain n’existait pas.
MARIGNON.
Mais alors...
CHAMBORAN.
Alors, je me mis à le confectionner moi-même.
MARIE.
Il se pourrait !
CHAMBORAN.
Trente-cinq pieds de long à creuser, rien que ça, et pour outil un vieux clou à crochet... Marcot était défunt, c’est sous son banc que je me glissais chaque nuit, et que, chaque nuit pendant cinq mois, j’avançais d’un pas dans ma besogne qui, à cette heure, est achevée.
FAGEROLLES, à part.
Bon ! j’en sais assez.
Il rampe jusqu’au fond et disparaît.
DOMINIQUE.
Ainsi, maintenant... en se glissant sous le banc...
CHAMBORAN.
En soulevant la dalle...
MARIGNON.
En pénétrant dans ce souterrain...
CHAMBORAN.
On arrive tout droit à la guérite n. 3, où le garde chiourme vous empoigne, ou bien vous descend, à son choix.
MARIE.
Comment ?...
CHAMBORAN.
Je m’étais trompé dans mon calcul.
MARIGNON.
Mais alors, pourquoi nous dire...
CHAMBORAN.
Pourquoi ?...
Se retournant.
Parce que le Fagérolles était là qui nous espionnait... vous n’avez pas vu ça, vous autres ?... Mais ce gredin-là sent une odeur de pendu que je flaire de très loin.
MARIGNON.
Ce passage n’existe donc pas ?
CHAMBORAN.
Si fait, mais l’endroit où il mène m’a contraint d’y renoncer... le Fagérolles a pris le change, il emporte le vieux plan que j’ai lâché, à c’t’heure voilà le nouveau, le bon,
Lui remettant un papier.
je l’ai écrit là... lisez-le avec attention, vous verrez où se trouvent des limes, un passe port, des habits pour remplacer ceux qu’on vous a donnés, et des cheveux pour remplacer ceux qu’on vous a ôtés.
DOMINIQUE.
Mais, moi...
CHAMBORAN.
Vous, ayez une échelle de six mètres soixante huit millimètres, et à huit heures sonnant, après la rentrée générale, trouvez-vous au bas du grand mur, derrière la corderie... c’est de là qu’il faudra faire descendre Monsieur votre père.
MARIGNON.
Mais s’il était découvert... mon fils serait perdu.
DOMINIQUE.
Qu’importe, mon père... le devoir du fils avant tout ; vienne après le châtiment du soldat.
CHAMBORAN.
Il sera prudent et adroit, d’ailleurs il n’y a plus à reculer... dans deux heures, père chose, vous serez dehors, vous serez libre, enfin.
MARIGNON.
Libre, mon Dieu... mais lui... oh ! non, non, je ne dois pas accepter...
MARIE.
Vous devez vivre, mon oncle, pour nous qui vous chérissons tous.
MARIGNON.
Mes enfants !...
CHAMBORAN.
Allons, c’est dit, c’est convenu... mais, silence... v’là du monde.
À part.
Diable d’honnête homme, va... je me donne autant de mal pour le faire filer à ma place que s’il s’agissait de lui faire finir mon temps ici.
Scène X
MARIGNON, MARIE, DOMINIQUE, CHAMBORAN, LES GARDES CHIOURMES, L’ADJUDANT, LES FORÇATS, FAGEROLLES
L’ADJUDANT.
L’heure de la rentrée est sonnée.
À Dominique et Marie.
Éloignez-vous.
DOMINIQUE, bas.
À huit heures, mon père.
MARIGNON.
Eh bien !... eh bien ! soit, à huit heures.
MARIE.
Adieu...
Bas.
Au revoir, mon oncle.
MARIGNON, leur faisant un signe d’adieu.
Mon Dieu !... frappez-moi, s’il le faut, d’un nouveau malheur, mais épargnez mon fils... veillez sur lui, mon Dieu !
L’ADJUDANT.
Allons, allons, en route...
CHAMBORAN.
Bonne nuit, compère Fagérolles.
FAGEROLLES,
Merci, l’ami Chamboran.
CHAMBORAN.
Fais pas de mauvais rêves, mon garçon... c’est malfaisant pour la santé.
Les Forçats sortent par la droite ; Marie s’éloigne par la gauche ; Dominique entre au corps-de-garde. La nuit vient graduellement.
Scène XI
LE SERGENT et DUVAL, entrant par le fond
LE SERGENT.
Veuillez m’attendre un instant ici, Monsieur, je vais savoir si l’on peut vous accorder votre demande.
DUVAL.
Comptez, Monsieur, sur ma reconnaissance.
Le Sergent entre au bagne.
Je n’ai pu résister au désir d’intercéder en faveur de ce pauvre Marignon... oui, je veux obtenir un adoucissement à son sort, pendant le temps de captivité qu’il doit subir encore en attendant sa grâce.
Le Sergent reparaît, accompagné de l’Adjudant.
Eh bien, Monsieur ?
LE SERGENT.
Personne, en ce moment, ne peut approcher des condamnés.
DUVAL.
Comment ?
L’ADJUDANT.
Excusez-nous, Monsieur, mais le temps est mal choisi ; une tentative d’invasion vient de nous être signalée, c’est l’instant de sévir et non d’être indulgent.
DUVAL.
Une évasion !...
L’ADJUDANT.
Sergent, vous allez vous rendre dans la petite corderie, accompagné de deux hommes ; vous y attendrez le coupable, et vous le saisirez au moment où, revêtu d’un costume d’emprunt, il se dirigera vers l’infirmerie ; vous le mettrez aux fers, c’est le nommé Marignon.
DUVAL.
Marignon... Marignon !... ce malheureux qui, tout à l’heure...
L’ADJUDANT.
Avait eu l’adresse de vous intéresser, grâce à sa feinte résignation... depuis longtemps nous savions que le nommé Chamboran se ménageait des moyens de fuite ; nous connaissions le lieu où se trouvaient déposés par lui des habits, des limes et un faux passeport... depuis plus de huit jours, un de nos gardiens était là, toujours en observation, épiant le moment où le coupable se livrerait lui-même en s’emparant de ces objets.
DUVAL.
Mais Mari... ce Marignon dont vous parliez...
L’ADJUDANT.
C’est lui qui tout à l’heure, de concert avec son complice, est venu tout enlever, c’est à lui, sans doute, que doivent servir ces moyens d’évasion... nous attendons maintenant qu’il les mette en usage, et alors il paiera cher cette tentative.
DUVAL.
Grand Dieu !... mais... mais ne serait-il pas plus humain, Monsieur, de lui dire que son plan est divulgué, de lui faire reconnaître sa faute ?
L’ADJUDANT.
Impossible !
DUVAL.
Enfin, personne ne peut-il lui parler ?
À part.
Oh ! si je pouvais le revoir... dût-il me reconnaître !
L’ADJUDANT.
Je viens de recevoir les ordres les plus formels, les instructions les plus sévères... nul ne pénétrera dans le bagne sans l’ordre du Commandant.
DUVAL.
Eh bien ! ce Commandant sera plus humain, sans doute. J’irai le trouver, et, s’il le faut, j’emploierai l’influence du Consul...
L’ADJUDANT, sans l’écouter.
Sergent, vous ordonnerez qu’en même temps trois hommes veillent au dehors près de la corderie ; un jeune soldat, le fils du coupable, doit, dit-on, seconder son projet.
Saluant.
Monsieur...
Il sort.
DUVAL.
Un soldat... son fils... son fils, a-t-il dit... non, Dominique n’est pas ici, Dominique n’est pas soldat... mais, s’il était vrai, pourtant. Oh ! que faire, que résoudre, mon Dieu !
Il ya pour sortir.
Scène XII
DUVAL, UN CAPORAL, MOULINET
LE CAPORAL.
Numéro 5.
MOULINET.
Présent.
DUVAL, à part en s’arrêtant.
Ciel ! Moulinet !
LE CAPORAL.
En faction.
DUVAL.
Moulinet !... je ne m’abuse pas.
Il l’observe, tandis que le Caporal relève le factionnaire et met Moulinet à sa place.
Oui, c’est bien lui ; la nuit est venue, il ne pourra me reconnaître... et ? puis ne dois-je pas tout entreprendre pour les sauver ?
Le Caporal et le soldat rentrent ; Duval s’approche de Moulinet.
Camarade...
MOULINET.
Hein ?... de quoi, qui vive !... Capo...
DUVAL.
Silence, je suis votre ami.
MOULINET.
Mon ami... que je ne connais pas... mon ami, à l’heure qu’il est... n’approchez pas, ou j’appelle... Capo...
DUVAL.
Silence, vous dis-je... un malheur menace ceux que vous aimez, et je viens les sauver.
MOULINET.
Ceux... que j’aime.
DUVAL.
Un mot d’abord, car le temps presse... Dominique, qu’est-il devenu ?
MOULINET.
Do... Dominique... c’est drôle, j’ai entendu c’te voix quelque part.
DUVAL.
Mais parles donc.
MOULINET.
Dominique est ici au poste, soldat comme moi.
DUVAL
Il est donc vrai... Veux-tu le préserver d’un grand malheur ?
MOULINET.
Toujours.
DUVAL.
Eh bien ! dans un instant il se rendra derrière la corderie, sous les murs du bagne... c’est là que l’attend ce danger, c’est là qu’il faut l’empêcher d’aller... car, au soldat qui favorise une évasion, c’est la dégradation, c’est la peine du boulet qu’on inflige.
MOULINET.
Hein ?... Dominique dégradé, condamné au boulet.
DUVAL.
Et tu peux, toi, l’arracher à ce péril.
MOULINET.
Moi !
DUVAL
Écoute, Moulinet...
MOULINET.
Il sait mon nom.
DUVAL.
Celui qui te parle est un pauvre mourant usé par la souffrance et le malheur... Eh bien ! c’est l’espoir de sauver ton ami, d’arracher Marignon à son supplice, qui ranime en ce moment son courage, qui lui donne assez de force pour courir au-devant du coup qui les menace... mais toi, tu me seconderas, n’est-ce pas ?
MOULINET, à part.
Encore...la satanée voix.
Haut.
Mais si vous me trompez ?
DUVAL.
Quoi ! tu doutes encore ?
MOULINET.
Non, je vous crois... je ne sais pas trop pour quoi ; mais enfin je vous crois.
DUVAL.
Tu feras ce que tu m’as promis ?
MOULINET.
Oui.
DUVAL.
Tu l’empêcheras de s’éloigner, n’est-ce pas ?
MOULINET.
Oui.
DUVAL.
Fut-ce au prix de ta vie.
MOULINET.
Oui... c’est-à-dire, non... si, si... enfin, je vous jure qu’il ne passera pas. DUVAL.
Oh bien ! bien, mon ami, puissions-nous les sauver tous deux... je cours chez le Consul, chez le Gouverneur... et le ciel fera le reste.
Il sort.
Scène XIII
MOULINET, puis DOMINIQUE
MOULINET.
Oui, le ciel fera le reste... quoi ?... je n’en sais rien, mais enfin c’est égal, je suis convaincu de la chose, et Dominique restera ici...
Regardant du côté du corps-de-garde.
Tiens, l’homme à la voix ne m’a pas trompé... le voilà déjà qui sort en tapinois... Qui vive ?
DOMINIQUE.
Eh ! c’est moi... Dominique.
MOULINET.
Eh ! c’est toi, Dominique... possible, mais on ne sort pas du poste à c’t’heure.
DOMINIQUE.
Qui te dit que je veux sortir ?...
MOULINET.
Ah ! tu ne vas donc pas sous les murs du bagne, derrière la corderie.
DOMINIQUE.
Comment, tu sais cela ?
MOULINET.
Oui, je sais cela !
DOMINIQUE.
Et d’où le sais-tu ?
MOULINET.
D’où je le sais ? je ne sais pas.
DOMINIQUE.
Explique-toi.
MOULINET.
M’expliquer, impossible.
DOMINIQUE.
Alors, ôte-toi de là, il faut que je passe.
MOULINET.
Du tout, rentre là-dedans ; faut que tu reste.
DOMINIQUE.
Tu voudrais t’opposer...
MOULINET.
À tout... car si tu vas là-bas... c’est la dégradation, la peine du boulet qui t’attendent...
DOMINIQUE.
Si on me découvre, peut-être ; mais qui me verra ?
MOULINET.
Ah ! c’est donc vrai... il ne me trompait donc pas ?... Alors, à présent, je n’hésite plus... et tu ne passeras, et tu ne bougeras pas, et tu ne t’en iras pas !
DOMINIQUE.
Eh bien ! oui, oui, je veux sortir... mais il le faut, entends-tu, il le faut ! il y va de ma vie, de mon honneur...
MOULINET.
Il y va de ta vie que tu te fasses tuer ? il y va de ton honneur que tu te fasses dégrader ? allons donc ! l’homme à la voix m’a dit que tu te perdais en y allant... je le crois, et tu resteras.
DOMINIQUE.
Mais de quel homme parles-tu donc ?
MOULINET.
Est-ce que je sais ! Je ne connais qu’une chose, faut que tu passes par là, et je ne le veux pas !
DOMINIQUE.
Et moi... moi, je le veux !
MOULINET.
Cré coquin ! je ne le veux pas ! quand je devrais te fourrer ma baïonnette n’importe où... quand je devrais faire feu sur n’importe quoi !...
DOMINIQUE.
Encore une fois, passage, passage ! te dis-je !...
MOULINET.
Non, sept fois non ! quatre-vingt-dix-neuf fois non !
DOMINIQUE.
Malheureux !...
Un bruit d’arme à feu.
Ah !...
MOULINET.
Qu’est-ce que c’est que cela ?
DOMINIQUE.
Il est trop tard ! mon père, mon pauvre père ! c’est toi qui l’auras tué !...
MOULINET.
Moi ? qu’est-ce qu’il dit donc ?...
Scène XIV
MOULINET, DOMINIQUE, GARDES, FORÇATS, L’ADJUDANT, puis LE SERGENT, puis TOUT LE MONDE
L’ADJUDANT.
Qu’y a-t-il ? d’où vient ce bruit ?
LE SERGENT, entrant.
Adjudant, un forçat vient en effet de tenter de s’évader, la sentinelle a vainement essayé de l’arrêter... elle a été contrainte de faire feu, et le malheureux expire en ce moment.
TOUS.
Grand Dieu !...
DOMINIQUE.
Mon père !...
CHAMBORAN, vêtu d’un uniforme d’officier, s’approchant de lui.
Eh ! non, pas Marignon, jeune homme ; c’est Fagérolles.
DOMINIQUE.
Fagerolles ; que dites-vous ?
MARIGNON, sortant du groupe des forçats.
Mon Dominique !...
DOMINIQUE.
Mon père ! il est donc vrai ?...
MOULINET.
Marignon !...
MARIGNON.
Oui, le courage m’a manqué pour braver un danger qui te menaçait aussi...
DOMINIQUE.
Et ce coup de feu ?...
CHAMBORAN, bas.
C’est le Fagérolles qui s’est pris au traquenard...
MARIGNON.
Chamboran !
CHAMBORAN.
Motus, je file à mon rendez-vous d’amour, je vais rejoindre ma bayadère, le tumulte me favorise ; si je réussis, vous entendrez bientôt les trois coups de canon qui annonceront mon départ.
Il va pour s’éloigner, mais l’Adjudant qui l’observait l’arrête.
L’ADJUDANT.
Halte-là, mon gaillard !
CHAMBORAN.
Bon ! pincé !... Ça me fait trois ans de plus !...
MARIGNON.
Du moins, mon fils, je n’ai pas exposé tes jours...
DOMINIQUE.
Mais vous restez enchaîné dans ce bagne...
DUVAL, qui s’est approché de Moulinet, lui parlant bas et faisant signe de répéter ses paroles.
Ce ne sera plus pour longtemps.
MOULINET.
Hein ? encore la voix... Ce... ce ne sera plus pour longtemps...
DOMINIQUE.
Comment ?
MARIGNON.
Que dis-tu ?
DUVAL, même jeu.
Bientôt, peut-être, il obtiendra sa grâce.
MOULINET.
Bientôt, peut-être, il obtiendra sa grâce.
DOMINIQUE.
D’où le sais-tu ?
MARIGNON.
Qui dit cela ?...
MOULINET.
Qui ?... parbleu ! c’est...
Il se retourne, Mais Duval a disparu, il est prés de sortir, lorsqu’il se rencontre face à face ave Marie qui entre.
MARIE, poussant un cri.
Ah !...
ACTE V
Le théâtre représente un riche appartement chez Duval. Un bureau, une table, fauteuils, etc.
Scène première
DUVAL, seul
Il est placé devant le bureau et cesse d’écrire.
Aurai-je la force d’accomplir jusqu’au bout ce dernier sacrifice ? Mon Dieu ! que de remords pour une seule faute, que de tortures pour un seul jour d’égarement et de délire ! Allons, du courage : ne laissons pas inachevée l’œuvre de mon expiation.
Il sonne. Ivan paraît.
Scène II
DUVAL, IVAN, qui entre
Deux valets se tiennent à la porte.
IVAN.
Monsieur a sonné.
DUVAL.
Écoute-moi bien, Ivan... regarde ces lettres que je place là, dans ce bureau : l’une est pour le régent de la Banque ; l’autre pour mon notaire ; la dernière, enfin, pour monseigneur le Consul... Eh bien ! lorsqu’un jour... bientôt sans doute... l’horrible mal qui me consume aura fini de me tuer...
IVAN.
Comment !
DUVAL.
Alors, tu prendras ces lettres et tu feras porter chacune à son adresse.
IVAN.
Mais, Monsieur...
DUVAL.
Ah !... Il se présentera un jeune soldat du nom de Moulinet... tu l’introduiras.
IVAN.
Il s’est déjà présenté ; mais, n’osant déranger Monsieur, je lui ai dit d’attendre ; il est là, dans l’antichambre.
DUVAL.
Qu’il entre ; je veux le voir... à l’instant, à l’instant même.
Ivan sort.
Il me parlera de Marignon, de son fils... de... oh ! de Marie, surtout de Marie, dont le cri déchirant retentit encore à mon oreille ! elle seule m’a reconnu... Mais ce cri, est-ce l’épouvante, l’horreur qui le lui ont arraché ?... ou bien, mon Dieu, avez-vous gardé un peu de bonheur au pauvre proscrit ? est-ce la pitié qui a touché l’âme de Marie, est-ce une plainte qui s’exhalait de son cœur ?
Scène III
IVAN, suivi de MOULINET, DUVAL à la cheminée
Ivan fait signe à Moulinet d’entrer et sort.
MOULINET.
Me voilà chez le bienfaiteur des Marignon, et avec qui j’ai causé sans le voir... heureusement qu’aujourd’hui je vais l’envisager... Excusez, c’est un peu mieux ficelé qu’à la caserne Mouffetard, ici... comme c’est doré sur tranches ! des robes de soie le long des murs... et on marche sur des châles de cachemire !... Ah ça ! où est-il donc, le propriétaire de la chose ?...
Allant à la cheminée et apercevant Duval.
Ah ! voilà son dos !
Il tousse.
Hum ! hum !
DUVAL, sans se retourner.
Ah ! c’est vous, Moulinet ?
MOULINET.
Présent... mon Colonn... mon Génér... Monseigneur...
À part.
Ça me fait de l’effet de me trouver comme ça devant un riche étranger !... je vais donc voir sa figure...
DUVAL.
Je vous ai fait venir pour vous demander des renseignements qui sont pour moi du plus haut intérêt.
MOULINET.
Des renseignements ?...
À part.
Un Russe... s’il allait me demander les secrets de la France !... heureusement que je ne les sais pas...
DUVAL.
Marignon est libre enfin ?
MOULINET.
Comme vous et moi ; il est arrivé de Brest hier au soir, et nous avons obtenu une permission de quinze jours, son fils et moi, pour l’accompagner.
DUVAL.
Vous voyez que j’ai tenu ma promesse... mais, dites-moi, il y a bien longtemps que vous connaissez la famille Marignon ?...
MOULINET.
Y a mieux que ça, Monsieur...
À part, et cherchant à le regarder.
Et je voudrais bien te connaître aussi, toi...
DUVAL.
Vous assistiez à la mise en liberté de Mari gnon ?...
MOULINET.
Oui, j’y assistais... fallait voir les larmes du père, la joie des enfants et les houras des autres condamnés !
À part.
Je dis houras pour le flatter, le Russe ; c’est un mot de son climat.
Haut.
Car, voyez-vous, tout le monde connaissait l’innocence du brave homme ; tout le monde savait qu’il était là à la place de ce scélérat de Duval.
Mouvement de Duval, qui se lève.
MOULINET.
Ah ! je vas donc le dévisager...
Il s’approche.
Pour lors, Monsieur...
Duval lui tourne le dos et va s’appuyer sur la cheminée.
Impossible !... faut qu’il ait quelque avarie dans la figure.
DUVAL.
Et vous ne me parlez pas de Mlle Marie ?
MOULINET.
Mlle Marie ? Pauvre fille, elle a rendu bien malheureux mon camarade Dominique !
DUVAL.
Comment... Dominique ?
MOULINET.
Figurez-vous qu’il l’aimait... à pierre fendre.
DUVAL.
Et Marie ?
MOULINET.
Ah dame !... bien sûr qu’elle ne pensait plus au flou... c’est-à-dire non... au voleur... mais cependant, toutes les fois qu’il se présentait un monsieur à canne à pomme d’or, comme vous, ou bien un simple tourlourou comme moi, elle fourrait tout à la porte, et, quand mon Dominique lui racontait son chagrin et ses amours, elle lui disait avec sa petite voix douce et triste : Dominique, je ne puis que vous plaindre... je ne puis pas être à vous... je suis engagée à un autre par serment.
DUVAL.
Par serment ?... Oh ! pauvre Marie !
Il pleure.
MOULINET, à part.
Tiens, qu’est-ce qu’il a donc ? il paraît que mon éloquence l’impressionne. J’aurais dû être avocat, moi ; j’aurais fait larmoyer les jurés comme des moulins à eau !
DUVAL.
Je vous remercie, mon ami, des renseigne mens que vous m’avez donnés.
Il sonne. Ivan paraît à la porte.
MOULINET.
Il n’y a pas de quoi, Monsieur.
DUVAL.
Je sais que vous avez une mère pauvre et âgée ;
Lui donnant une bourse.
offrez-lui cela de ma part.
MOULINET.
De l’argent... jamais. Tiens, c’est de l’or... C’est différent, j’accepte pour ne pas l’humilier...
À part.
Plus que ça de louis d’or russes... je suis vexé de n’avoir pas aperçu sa figure.
DUVAL, à Ivan.
Reconduisez... Adieu, mon ami ; nous nous reverrons.
MOULINET, à part.
Nous revoir... mais je ne l’ai pas vu du tout. Faut qu’il soit borgne ou qu’il n’ait qu’un œil, c’est sûr.
Il sort.
Scène IV
DUVAL, seul
Elle m’a attendu huit ans, en proie à la misère, sourde à l’amour de ce bon Dominique ! Oui, le serment est resté gravé dans sa mémoire ; mais l’amour, elle l’a chassé de son cœur... elle ne peut plus, elle ne doit plus m’aimer. Allons, il faut la rendre libre ; il faut achever l’œuvre.
Scène V
DUVAL, MARIE, qui paraît au fond, repoussant les domestiques qui veulent la retenir
MARIE.
Laissez-moi, il faut que je le voie, que je lui parle...
DUVAL.
Ciel ! Marie.
MARIE, entrant et déguisant son émotion sous une apparence de froideur et de respect.
Pardonnez-moi, Monsieur, si je pénètre jusqu’à vous, malgré vos valets... votre porte, m’a-t-on dit, est ouverte à tous les malheureux... je suis bien malheureuse, moi... et j’ai voulu vous voir.
IVAN.
Qu’ordonnez-vous, Monsieur ?...
DUVAL.
Un siège... que tout le monde s’éloigne...
Les valets sortent.
Marie !
MARIE.
Duval !... pauvre Duval !...
Regardant son visage.
Oh ! comme vous avez souffert !...
DUVAL.
Votre première parole a été une parole de consolation et de pitié... Marie, oh ! que Dieu vous accorde autant de bonheur que vous m’en donnez en cet instant...
MARIE.
Je vous ai plaint, Duval, quand out le monde vous maudissait... et cependant en vous voyant revenir riche et honoré, vous que j’ai vu partir pauvre et fugitif...
DUVAL.
Arrêtez, Marie, ne souillez pas votre bouche par de cruelles paroles de défiance et de soupçon !...
MARIE.
Expliquez-moi donc...
Elle s’assied.
DUVAL.
Vous vous souvenez de cette épouvantable soirée où je pris la fuite... je partis sans savoir où j’allais, car je voyais toujours la misère et l’infamie au bout de mon voyage... et je ne pouvais revenir sur mes pas crier au juges de Marignon : je suis seul coupable ! trop de preuves l’accablaient... je n’eusse fait que partager sa captivité et sa honte, et je n’aurais pu revenir, comme aujourd’hui, l’enrichir et le sauver.
MARIE.
Continuez, Joseph !
DUVAL.
Errant pendant deux années dans des contrées dont j’ai même oublié le nom, enfin je parvins à Orembourg, à l’autre extrémité de l’Europe... là vivait un riche et puissant seigneur qui venait d’organiser de vastes entreprises ; je me présentai à lui... je ne sais comment le sceau de la fatalité, empreint sur mon visage, ne l’a pas effrayé comme tant d’autres... il daigna m’accueillir. Grace à lui, j’amassai l’argent nécessaire pour rembourser la Banque ; et de ce jour, je ne sais comment le succès est venu couronner une entreprise où le désespoir m’avait jeté, je ne sais enfin comment la fortune est venue me chercher, moi qui ne la cherchais plus... mais ils m’ont entouré d’honneurs, accablé de richesses. Cependant au milieu de ces biens, de cette opulence que j’avais tant désirés, je gardais le souvenir de mon crime, et mes nuits restaient sans sommeil. Sans cesse j’entendais une voix sévère qui me demandait compte de ma faute et prononçait sur moi des malédictions... vainement je cherchais à me réfugier dans le travail ; je devenais plus riche et jamais plus heureux ! et j’ai mené cette vie pendant huit ans... huit ans sans vous voir, Marie, huit ans avec la pensée du pauvre Marignon, mourant sous le poids de ma propre honte... huit ans qui ont fait de moi un vieillard usé par la souffrance et tout prêt pour la tombe, car le fatal souvenir usait à la fois mon corps et mon âme... car ce que j’entendais dans mes nuits d’insomnies, ce n’était plus comme autre fois le bruit de l’or de la Banque, c’était le bruit des fers de Toulon.
MARIE.
Tant de douleurs, tant de remords pourront peut-être effacer vos fautes, Duval... et l’avenir.
DUVAL.
Il n’y a pas d’avenir pour moi, Marie ; pour moi, il n’y a plus que la mort.
MARIE.
La mort, dites-vous ? et moi...
DUVAL.
Vous, Marie ! il y a huit ans, vous vous êtes donnée à moi par un serment aussi solennel que celui prononcé devant un prêtre à la face des autels ?
MARIE.
Je m’en souviens...
DUVAL.
J’ai pu briser les fers de Marignon, mais je n’ai pas effacé la honte empreinte au front de cette famille... quelles joies leur ai-je préparées dans l’avenir pour racheter les douleurs passées ?... Marie, vous seule pouvez rendre le fils au bonheur et rattacher le père à la vie... eh bien, il faut que vous, qui avez été une des causes de mon crime, vous en soyez aussi l’expiation... Dominique vous aime, Marie, et je vous demande votre main pour Dominique Marignon.
MARIE.
Ma main !...
DUVAL.
Oh ! laissez-moi espérer que la veuve d’Arthur de Barloff respectera la dernière volonté de Joseph Duval !...
Il s’approche de la cheminée et agite le cordon de la sonnette.
MARIE.
Que dit-il ?...
Ivan paraît.
DUVAL.
Faites porter ces lettres... une à chacun de mes gens... à l’instant, à l’instant même.
IVAN, qui a pris les lettres sur le bureau.
Oui, Monsieur ; mais il y a là un vieillard qui demande instamment à entrer ; il se nomme Marignon.
DUVAL.
Lui, oh ! non, non, qu’il n’entre pas.
MARIE.
Songez à ce que ce refus a de cruel ; il vient plein de reconnaissance bénir celui qui l’a rendu à la vie, à la liberté.
DUVAL.
Mais s’il allait me reconnaître...
MARIE.
Non, ses yeux sont usés par les larmes, et vous êtes vous-même si changé, que mon cœur seul pouvait vous reconnaître, un ennemi ne vous eût pas deviné.
DUVAL.
Ainsi, vous voulez...
MARIE.
Un refus déchirerait son cœur... et il est le seul homme au monde à qui vous ne puissiez rien refuser.
DUVAL.
Qu’il vienne donc...
Ivan sort.
Après tout, c’est encore un châtiment... c’est encore une justice...
Scène VI
LES MÊMES, MARIGNON et DOMINIQUE, paraissant sur le seuil de la porte du fond
DUVAL, tombant assis et se cachant la figure dans ses deux mains.
Le voilà... oh ! mon courage, mon courage !
MARIGNON, à Marie.
Et toi aussi, mon enfant, tu es venue payer à notre bienfaiteur ton tribut de bénédictions.
Il cherche Duval des yeux ; d’un geste, Marie le lui montre ; allant à lui.
Monsieur, excusez un pauvre vieillard qui vient vous importuner de sa reconnaissance... mais... mais c’est que, voyez vous, il n’y a pas d’homme si flétri, si honteusement dégradé par l’injustice, qui ne conserve un peu d’orgueil, et j’ai voulu que vous sachiez que celui que vous avez arraché à l’infamie était innocent.
DUVAL, à part.
Innocent... oh ! oui, oui...
MARIGNON.
Oh ! Monsieur, je vous le jure, ils m’ont injustement condamné... j’ai subi la peine d’un malheureux que j’ai abrité sous mon toit et nourri de mon pain...
DUVAL.
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
MARIE,
Mon oncle, Monsieur sait déjà...
MARIGNON.
Il ne sait pas combien sont douloureux les supplices qu’on n’a pas mérités, combien est écrasante la honte qui devait tomber sur un autre... et cet autre, je l’aimais tant... j’aurais donné ma vie pour racheter la sienne. Eh bien ! il n’a pas eu le courage de revenir sur ses pas, de proclamer mon innocence ; il nous a lâchement abandonnés !
DUVAL.
Assez, Monsieur, assez !
MARIGNON.
Ah ! je le vois bien, l’arrêt terrible, solennel, qui me frappe, est toujours là, plus puissant que mes paroles, plus imposant que mes protestations.
Avec douleur.
Vous ne me croyez pas... Du moins, Monsieur, ne me refusez pas une dernière consolation ; je suis vieux, brisé par les chagrins, et je mourrai bientôt... que je puisse, à mon heure dernière, me rappeler les traits de l’homme généreux qui m’a rendu à mes enfants, à la liberté.
Se mettant à genoux près de lui et lui touchant le bras qu’il dérange peu à peu.
Monsieur, fussé-je réellement coupable, vous ne sauriez me refuser cette consolation... Ah ! j’ai senti une larme tomber sur ma main. Vous pleurez ; mais vous me croyez donc enfin...
Examinant la figure de Duval.
Ah !
Duval se lève précipitamment.
IVAN, entrant.
M. le Consul attend M.de Barloff.
MARIGNON.
Un Consul !
Duval jette sur Marignon et Marie un dernier regard, puis entre précipitamment dans la chambre à droite, où Ivan le suit.
Ce luxe... cette richesse... Oh ! non, non, je suis fou !
MARIE, à part.
Et lui aussi, il l’a reconnu.
Scène VII
LES MÊMES, MOULINET
MOULINET, entrant précipitamment.
Ouf ! me voilà... Tiens, les Marignon.
MARIE.
Vous ici ?
MOULINET.
Moiz-ici, oui.
DOMINIQUE.
Que viens-tu y faire ?
MARIGNON.
Qui t’amène ?
MOULINET, montrant une lettre.
Voilà !
TOUS.
Une lettre !
MOULINET
Et ce qu’il y a de plus drôle, c’est que je l’ai reçue au moment où je sortais d’ici.
DOMINIQUE.
Comment ?
MOULINET.
Le colonel russe, car c’est un colonel au moins, m’avait déjà fait appeler.
MARIGNON.
Toi ?
DOMINIQUE.
Que pouvait-il y avoir de commun entre vous ?
MOULINET.
Voilà : Le Général, car c’est un général, désirait des renseignements sur vous, les Marignon ; je lui ai fait mon rapport dans les règles, si bien qu’en m’écoutant ce brave maréchal pleurait comme un enfant.
MARIE, à part.
Pauvre Duval !
MOULINET.
Après quoi, il m’a renvoyé en me donnant un tas de louis d’or cosaques, pour Mme veuve Moulinet, et je venais de quitter le prince russe, quand je trouve ceci cacheté de grandes armes, je me transfère à l’hôtel, et je trouve à la porte je ne sais combien de garçons de recette.
TOUS.
Des garçons de recette ?
MOULINET.
En uniforme, même que j’en ai reconnu plusieurs ; ils ont reçu des lettres comme moi... Eh ! tenez, les voilà qui montent.
MARIGNON.
Oh ! partons, mes enfants, partons !
IVAN, entrant.
M.de Barloff vous prie de demeurer.
DOMINIQUE.
Que signifie ?
Scène VIII
LES MÊMES, LES GARÇONS DE RECETTE
La famille Marignon et Moulinet remontent la scène et se tiennent à l’écart.
IVAN, aux garçons.
Veuillez attendre ici, Messieurs.
Il sort.
DURAND.
Eh bien ! que pensez-vous que nous soyons venus faire chez ce riche étranger ?... Il s’agirait de transporter à la Banque tous les millions de la Russie qu’on n’aurait pas mis plus d’importance et de mystère à nous faire venir.
PREMIER GARÇON.
Je pense qu’il faut un bien puissant motif, puisque cet ordre nous est venu de M. le Régent.
DURAND.
Et nous sommes ici toute l’ancienne quatrième brigade.
DEUXIÈME GARÇON.
Oui, tous, excepté deux.
DURAND.
Joseph Duval... et ce pauvre Marignon...
MARIGNON.
Mon nom... ils se sont souvenus de moi.
PREMIER GARÇON.
L’un a pris la fuite, et l’autre...
DURAND.
Le malheureux est mort peut-être de désespoir.
MARIGNON, s’approchant.
Non, non, mes amis !...
S’arrachant des mains de son fils et de Moulinet.
Me voilà !... j’existe encore !
TOUS.
Marignon !
MARIGNON.
Je vous revois... Oh ! vous ne m’avez pas condamné, vous ?...
Ils détournent la tête et s’éloignent de lui.
Ils s’éloignent de moi... ils ne veulent plus me croire... Et je pensais, en revoyant cet habit que j’ai porté vingt-cinq ans avec honneur... en retrouvant ceux que j’appelais mes frères ; je pensais qu’eux, du moins, me rendraient justice... et pas une main n’a pressé la mienne... Ils me repoussent, ils me croient coupable... Oh ! ce coup est le plus terrible de tous !
DURAND, bas à Marignon.
Marignon, innocent ou coupable,
Lui tendant la main de côté, et sans être vu des autres qui causent entre eux.
je n’ai jamais été que ton ami, ton frère, et non pas ton juge.
MARIGNON, embrassant sa main qu’il baigne de ses larmes.
Oui, mon ami, mon frère... Oh ! merci ! merci !
Scène IX
LES MÊMES, LE NOTAIRE, LE CONSUL
Tous deux vont s’asseoir près d’une table, les garçons de recette font demi-cercle autour ; les Marignon et Moulinet forment un groupe à part.
LE CONSUL, déposant sur la table un paquet.
Messieurs, mon ami, M. de Barloff, a déposé entre mes mains des papiers importants, dont la communication doit vous être donnée par le plus ancien des garçons de recette de la quatrième brigade, par le nommé Pierre Marignon.
MARIGNON.
Moi !... je suis à vos ordres, Monsieur.
Il prend le paquet et déchire l’enveloppe.
DOMINIQUE.
Que signifie ?...
MARIGNON, lisant.
« Testament de Joseph Duval, ancien garçon de recette de la Banque... »
TOUS.
Joseph Duval !
MARIE.
Un testament !...
MARIGNON.
« Au moment de paraître devant Dieu, je déclare que je suis seul coupable du vol commis à la Banque... Pierre Marignon était innocent. »
TOUS.
Innocent !
MARIGNON.
« En attendant la réhabilitation légale de celui qui a été injustement condamné, vous pouvez, vous, ses anciens camarades, trouver pour Pierre Marignon une réhabilitation aussi grande, aussi respectable que celle de la loi, en le recevant encore une fois parmi vous, en l’appelant encore votre ami. Et pour que tout soupçon disparaisse, pour que nul doute ne subsiste, je dépose ici toute la relation exacte de mon crime. »
Leur donnant un papier qu’ils parcourent entre eux.
Tenez, lisez, lisez, camarades... Il se pourrait ! oh ! mon Dieu ! je ne resterai donc pas couvert de honte, écrasé de leur mépris ?
DURAND.
Ah ! je le disais bien, moi, qu’il était innocent !...
Il embrasse Marignon ; tous s’empressent autour de lui et lui serrent la main.
MARIGNON.
Oh ! mes amis, mes frères ! j’en mourrai de joie et de bonheur !...
MOULINET.
Non, non, pas de bêtises, père Marignon ! on pleure, mais on ne meurt pas.
DOMINIQUE.
Mon père réhabilité, rendu à l’honneur !...
MARIE.
Mais lui, lui ! mon Dieu ?...
MARIGNON.
Attendez, il y a encore quelques lignes... « Je supplie mes anciens camarades de me pardonner ma faute, je l’ai expiée par de cruels remords, et quand on lira cet écrit, justice sera faite du malheureux Joseph Duval. Arthur de Barloff. »
TOUS.
Arthur de Barloff !...
On entend un coup de pistolet ; Duval paraît, la poitrine ensanglantée, il vient tomber aux genoux de Marignon.
Ah !...
DUVAL.
Vous ne pouviez plus être à moi, Marie, j’a vais perdu l’honneur, je ne pouvais plus vivre ! Dominique, je vous confie son bonheur !...
MARIGNON.
Ah ! qu’as-tu fait, malheureux ?...
DUVAL.
Pardonnez-moi, Marignon, pour que Dieu ce me pardonne !...