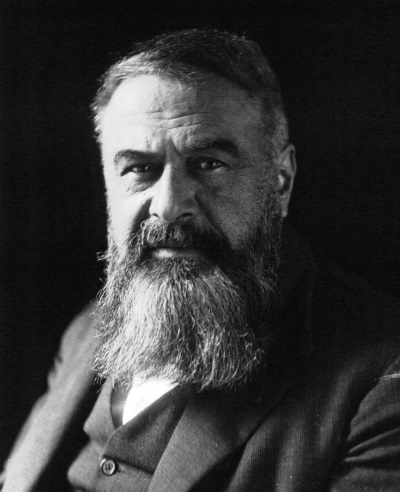Jules, Juliette et Julien (Tristan BERNARD)
Sous-titre : l’école du sentiment
Comédie en trois actes et un prologue.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Œuvre, le 10 mai 1929.
Personnages
JULES, 40 ans
LE COUSIN LEBLEU, 55 ans
JULIEN MÉRAND, 25 ans
GEORGES, 23 ans
MONSIEUR MOREILLE, 55 ans
ALBERT, garçon d’hôtel
JULIETTE, 24 ans
CATHERINE SORLON, 26 ans
LA CAISSIÈRE, 25 ans
MADAME MOREILLE, 50 ans
IRMA
LA FEMME DE CHAMBRE
PROLOGUE
La scène représente un salon dans un hôtel assez élégant. Porte au fond donnant sur le couloir. À gauche, second plan, une autre porte donnant sur une chambre à coucher. Il peut y avoir d’autres portes, il n’y a que ces deux-là qui « jouent ».
Au lever du rideau, la scène est vide. Un monsieur sort de la chambre à coucher. Il est en costume gris clair et porte à la main un chapeau mou qu’il met en sortant de la chambre. C’est un homme grand, d’aspect assez commun, de quarante ans environ. Il tire de sa poche un carnet qu’il consulte et prend une note au crayon, puis il va de nouveau à la porte de la chambre et parle à la cantonade.
JULES.
Au revoir, ma petite chérie... Vous m’excuserez...
Il se reprend.
Tu m’excuseras auprès de ta mère, si elle arrive avant mon retour... Je serai ici dans une demi-heure. Je monte à l’étage au-dessus d’abord, parce que j’ai su, par le portier de l’hôtel, qu’il y a justement ici un client anglais que je ne serais pas fâché de voir.
Posément.
Ensuite... je ferai les deux courses dont je vous ai parlé au chemin de fer et à ma maison, et après je reviendrai vous chercher...
Il se reprend.
te chercher... pour aller déjeuner chez tes parents...
Il envoie un baiser dans la direction de la chambre.
Au revoir, ma petite...
Il ferme la porte et va sortir par la porte du fond quand entre la Femme de chambre.
LA FEMME DE CHAMBRE.
Madame n’a besoin de rien ?...
JULES.
Demandez-le-lui.
Jules sort. La Femme de chambre se dirige vers la porte de la chambre à coucher quand le téléphone sonne.
LA FEMME DE CHAMBRE, au téléphone.
Qu’est-ce que c’est ?...
Elle écoute.
Eh bien ! je vais dire à cette dame que sa mère est en bas.
Sans raccrocher le récepteur, elle va jusqu’à la porte de gauche et frappe, puis ouvre la porte.
Madame, la mère de madame est en bas.
Elle entend une réponse.
Bien, madame...
Et revient au téléphone.
Voulez-vous dire à cette dame de monter ?...
Elle raccroche et retourne à la porte de gauche. Même jeu : elle frappe et ouvre la porte.
Madame n’a besoin de rien ?...
Elle écoute.
Pour ouvrir l’armoire, il faut tourner la clef à gauche au lieu de la tourner à droite. Je ne sais pas comment la serrure est faite, mais tous les voyageurs se trompent.
Elle écoute.
Madame s’en va ce matin ?... Alors, je ferai la chambre après le départ de madame.
Elle referme la porte et se dirige vers la porte du fond. À ce moment, on frappe. Elle va ouvrir la porte. Entre Madame Moreille.
Si madame veut se donner la peine d’entrer, madame va venir.
MADAME MOREILLE.
Je viens peut-être de trop bonne heure.
LA FEMME DE CHAMBRE.
Mais non, madame est toute prête... D’ailleurs, elle n’aurait pas été prête qu’elle aurait tout de même pu recevoir madame, puisque madame est sa mère.
MADAME MOREILLE.
Oui, je suis sa maman.
LA FEMME DE CHAMBRE.
J’étais là quand madame est arrivée hier soir dans sa robe de mariée. Elle était bien jolie...
MADAME MOREILLE.
Pauvre petite !
LA FEMME DE CHAMBRE.
Parce que madame s’est mariée ?... Je voudrais bien qu’on dise ça de moi : pauvre petite !... Voici madame.
À ce moment, la porte de gauche s’ouvre et Juliette, en costume de ville, vient embrasser sa mère. Pendant qu’elle va à elle, la Femme de chambre s’en va par la porte du fond.
JULIETTE.
Bonjour, ma petite maman !
MADAME MOREILLE, émue.
Bonjour, mon enfant !...
Après l’avoir embrassée, elle la reprend dans ses bras et l’embrasse de nouveau.
Ton mari est sorti ?...
JULIETTE.
Il est allé au chemin de fer. Tu sais qu’il avait demandé un billet circulaire... Il paraît que l’employé s’était trompé et l’avait mal établi...
MADAME MOREILLE.
Heureusement que ton mari était là pour le vérifier. Il vérifie tout.
JULIETTE.
Et puis il avait à faire au siège social de sa maison. Il m’a expliqué qu’il allait chez l’administrateur délégué pour avoir une lettre, parce qu’au cours de notre voyage, il doit voir de nouveaux clients, des usiniers, et qu’il préfère avoir une lettre d’introduction de sa société... Je ne dis peut-être pas ça très clairement...
MADAME MOREILLE.
Si ! Si !
JULIETTE.
Il m’a exposé cela ce matin, mais j’étais encore dans un demi-sommeil.
Silence.
MADAME MOREILLE.
Tu n’as rien à me dire ?
JULIETTE.
Non, maman.
MADAME MOREILLE.
Il est gentil ?...
JULIETTE.
Très gentil !
On frappe à la porte.
Qu’est-ce que c’est ?
LA FEMME DE CHAMBRE, entrant.
C’est une dame qui est dans le couloir, une amie de madame, qui me dit comme ça qu’elle avait rendez-vous.
JULIETTE, à madame Moreille.
C’est Catherine ! Elle m’avait dit qu’elle viendrait me voir ce matin... Faites entrer !
La Femme de chambre s’efface pour faire entrer Catherine.
CATHERINE.
Bonjour...
Elle tend la main à madame Moreille, puis va embrasser Juliette. Silence.
MADAME MOREILLE.
Eh bien ! puisque ton amie est là, je vais te laisser avec elle.
JULIETTE, mollement.
Mais non, maman, tu n’es pas de trop !
MADAME MOREILLE.
Je ne dis pas que je suis de trop, mais j’ai à faire avant de rentrer à la maison. Ton mari est bien prévenu que vous venez déjeuner à la maison, tout à l’heure ?
JULIETTE.
Oui, maman, mais tu m’as promis qu’il n’y aurait absolument personne...
MADAME MOREILLE.
Bien entendu... Adieu, ma petite Catherine !
CATHERINE, en lui tendant la main.
Au revoir, madame !
JULIETTE.
Écoute, maman, je vais te donner un petit paquet... Tu as un taxi ?
MADAME MOREILLE.
Non, j’ai lâché le mien, mais je vais en prendre un autre.
JULIETTE.
Je préfère te donner ce petit paquet, parce que je suis sûre que je l’oublierais ici ! Oh ! ça ne pèse rien, ce sont des petits mouchoirs en dentelle... C’est un cadeau des Molinier, tu sais ? Ils étaient en retard... Ils m’ont joint une petite lettre pour me dire qu’on n’avait pas livré ce paquet à temps... alors, qu’ils me l’envoient ici. De très jolis petits mouchoirs...
Elle entre dans sa chambre sans refermer la porte.
MADAME MOREILLE, à Catherine.
J’espère qu’elle sera moins réservée avec vous qu’avec moi ! Il n’y a rien à tirer d’elle.
CATHERINE.
Que voulez-vous ? ça se comprend.
MADAME MOREILLE.
Oh ! je comprends très bien...
JULIETTE, rentrant en scène.
Voilà le petit paquet, maman.
MADAME MOREILLE.
Ton père m’a dit qu’il passerait te voir tout à l’heure... Il savait que vous veniez déjeuner à la maison, mais il n’a pu attendre jusque-là.
JULIETTE.
Eh bien ! il me trouvera... Je n’ai pas l’intention de sortir avant d’aller déjeuner... D’ailleurs, mon mari doit passer me prendre.
MADAME MOREILLE.
Alors, au revoir, mes enfants !...
Elle sort.
JULIETTE, à Catherine.
Asseyez-vous, madame.
Elles s’embrassent, puis s’assoient sur le canapé, Juliette souriant faiblement.
Tu ne me demandes rien, hein ?... Tu as raison, parce que si tu me demandais quelque chose, il faudrait que je m’interroge, et je ne tiens pas du tout à me rendre compte de ce qui se passe en moi.
Silence.
CATHERINE.
Vous partez ce soir ?
JULIETTE.
Oui, nous prenons le train jusqu’à Toulon d’abord. Il a à faire à Toulon pour deux jours. Oh ! c’est un garçon très travailleur. Il ne faut pas lui refuser ça... Nous faisons un voyage de noces, mais il s’est arrangé pour que ce soit en même temps un voyage d’affaires... Comme ça il ne perd pas de temps et, au point de vue des frais, il y trouve toutes sortes d’avantages. C’est une considération qui n’est pas sans intérêt pour lui.
CATHERINE.
Mon pauvre chou, ça va te fatiguer horriblement de voyager de nuit...
JULIETTE.
Oh ! non, je t’en supplie, ne dis pas ça... Je sais bien qu’il ne pourrait pas changer ses projets, puisque les billets sont pris... Mais ne parle pas de ma fatigue possible... Je suis enchantée de cette combinaison, car, de cette façon, c’est toujours une nuit de gagnée. Nous aurons des couchettes... Il paraît qu’il n’y avait plus de sleeping quand il a retenu les places... Avec des couchettes, nous serons quatre dans le compartiment : il y aura deux personnes étrangères, alors je serai tranquille... Tu ne peux pas te faire une idée du soulagement que j’éprouve à penser que, d’ici demain soir, je vais être libre.
Silence.
CATHERINE, l’embrassant.
Ma pauvre chérie, ça m’ennuie de te voir comme ça...
JULIETTE.
Oh ! mais, il ne faut pas t’apitoyer, je ne suis pas malheureuse... seulement...
Elle s’arrête.
CATHERINE.
Quoi, seulement ?...
JULIETTE.
Seulement, la nuit de noces, la nuit nuptiale, c’était pour moi quelque chose de vague, d’attirant, d’effrayant... J’étais pendant des années à me dire qu’un des bonheurs le plus émouvants de la vie, c’était la première nuit de mariage ! Oh ! mais, tu sais, cette idée, il y a déjà quelques semaines que je ne l’ai plus... à partir du moment où ce mariage a été décidé...
Résignée.
Eh bien ! quoi, qu’est-ce que tu veux ? ma nuit nuptiale n’a pas été une nuit de bonheur... Comme dirait papa, ce n’est pas une perte, c’est un manque à gagner, voilà tout !
CATHERINE.
Mais, enfin, quoi ? il est gentil, ce monsieur ?...
JULIETTE.
Oui, il n’y a pas à dire le contraire, il est gentil... Je crois que c’est un excellent homme. Enfin, il y a un certain nombre d’hommes excellents dans la vie, avec qui on ne tient pas à passer la nuit...
Silence.
Il m’appelle son petit enfant... Il a quarante ans et j’en ai vingt-quatre. C’est un peu âgé pour un petit enfant. Mais je préfère ça que s’il m’appelait sa petite femme... Ah ! j’aurais ça en horreur... Je n’ai aucun plaisir à penser que je suis sa petite femme... D’être son petit enfant, ça fait tout de suite une séparation entre nous, tu comprends ?...
CATHERINE.
Tu sais qu’il y a bien des femmes qui sont dans ton cas et pour qui cette première nuit de noces est une déception.
JULIETTE.
Oh ! ça n’a pas été précisément une déception pour moi, puisque, depuis quelques semaines que je connais mon mari, j’avais déjà renoncé au grand bonheur en question...
Silence.
Il a été très gentil, plein de ménagements... trop de ménagements. J’aurais préféré que ce soit plus vite fini... Une fois les formalités accomplies, il m’a dit : « Dors ! dors, mon enfant... » Je me suis dépêchée de faire semblant de dormir pour qu’il s’endorme à son tour. Puis j’ai fini par dormir pour de bon... Quand on a été bien endormis tous les deux, on s’est séparés machinalement... Et quand on a été séparés, en dormant, et même quand je me réveillais, comme la chambre était sombre, je pouvais me figurer que je n’étais pas mariée... Jusqu’au moment où il remuait une jambe qui touchait une des miennes... Enfin, je finirai par m’y habituer.
CATHERINE.
On aurait dû te parler avant... Moi j’aurais dû te parler, parce que ce que ta maman a pu te dire...
JULIETTE.
Oui, des choses vagues que je n’ai même pas écoutées...
CATHERINE.
J’aurais dû te dire, moi, que très souvent on nous marie trop brusquement pour que nous en ayons du plaisir, et qu’il fallait penser surtout au plaisir que tu lui donnerais... Enfin... ça a dû t’être agréable qu’il soit heureux...
JULIETTE.
Pas du tout.
Silence.
Papa et maman m’avaient bien dit quelque chose comme ça, comme ce que tu me racontes... Quand le mariage a été décidé, on s’est bien douté qu’il ne me plaisait pas énormément... Alors, comme papa et maman tenaient beaucoup à ce mariage, j’avais vingt-quatre ans... et ils avaient une peur de me voir rester vieille fille... ils m’ont répété à satiété que je plaisais beaucoup à ce monsieur... et que c’est une grande chose dans la vie de faire le bonheur d’un être. C’est possible que mon mari soit heureux de m’avoir, mais, c’est curieux, je n’arrive pas à trouver que son bonheur m’est agréable... Vois-tu, précisément, je me disais cela ce matin pendant qu’il était levé et qu’il s’habillait et que, moi, je faisais semblant de dormir profondément afin qu’il me laisse bien tranquille. Je me disais : Je ne suis pas méchante, mais il faut croire que je ne suis pas spécialement bonne... Je n’ai aucune espèce de joie à faire le bonheur des gens quand ils ne me plaisent pas.
CATHERINE, l’embrassant.
Ma pauvre petite !
JULIETTE.
Mais il ne faut pas me dire : Ma pauvre petite ! Je te répète que je ne suis pas malheureuse... Je suis même très soulagée maintenant, en pensant que mon mariage est fini, que tout ce tintouin des derniers jours, des invitations qu’il fallait faire ou ne pas faire, les retards des couturières, les rendez-vous chez le notaire pour le contrat, les lectures interminables que je n’écoutais pas... je suis ravie que tout cela soit fini. Et puis, ce matin, je suis particulièrement enchantée, parce que j’ai vacances jusqu’à demain soir... Tout à l’heure, je vais déjeuner chez mes parents et je suis très contente de penser que je ne déjeune pas toute seule avec lui. Je n’aurai pas à chercher des sujets de conversation, je ne le verrai pas se torturer l’esprit pour trouver quelque chose à me dire... Il parlera affaires avec papa ; pendant ce temps, je prendrai un air souriant, mais surtout fatigué, je tâcherai qu’on ne s’occupe pas de moi. Au fond, je me fais une raison, je veux prendre de la vie ce qu’il y a de bon et me dire que je m’en vais en voyage sur la Côte d’Azur... Je suis persuadée qu’il y aura des moments agréables, malgré la présence de mon mari... Là-bas, j’espère que je danserai... je danserai d’autant plus volontiers qu’il ne danse pas. Mais il ne m’empêchera pas de danser. On ira dans des restaurants amusants. Je lui dirai que j’y tiens, parce que lui-même n’a pas un besoin naturel d’aller dans les endroits très cher...
Riant.
Il faut que je te raconte... Il avait dit à maman qu’il connaissait un très bon hôtel à Paris, pour passer notre première nuit... Ce n’était pas dans un quartier élégant, mais il paraît que c’était très confortable. Maman, qui se méfiait un peu, lui a dit : « Nous allons y passer le voir. » Et, quand elle a vu la façade, elle lui a dit : « Vous n’allez pas conduire cette petite dans une maison aussi triste ! » Je crois qu’il trouvait cet hôtel très confortable parce que le patron est un ancien camarade à lui qui lui fait des prix !
CATHERINE.
C’est un homme pratique.
JULIETTE.
Merveilleusement. Rien que cette idée de faire coïncider son voyage de noces avec un voyage d’affaires... Je crois qu’il est arrivé à ce que sa société me paie mes frais à moi en sus de ses frais à lui : voyage, hôtel, tout compris. Voilà à quoi il s’est occupé pendant ces derniers huit jours... Et, quand il a réussi, il m’a annoncé ça comme une victoire !
CATHERINE.
Mais enfin, c’est un homme qui a vécu... Il a eu des maîtresses ?
JULIETTE.
Je te dirai que je n’en sais rien, et, ce qu’il y a de plus terrible, c’est que je ne tiens même pas à le savoir. Je ne tiens pas à plonger le moindre regard dans sa vie sentimentale.
CATHERINE.
Combien de temps allez-vous rester absents ?
JULIETTE, avec un soupir.
Quatre semaines, mais j’espère bien que ça se réduira à trois. Je pense déjà au plaisir que j’aurai quand nous rentrerons à Paris et que je retrouverai mes parents et surtout toi, ma petite Catherine !
Un instant de silence. La porte du fond s’ouvre. Entre Jules.
JULES.
Permettez-moi de vous montrer le chemin. Juliette, voici votre papa.
Entre Moreille.
Et voici votre cousin Lebleu...
Entre également Lebleu, quinquagénaire à l’œil paisible et au front dégarni. À Catherine.
Oh ! madame, je ne vous voyais pas...
Il lui baise la main. À Juliette.
Votre cousin Lebleu ne voulait pas monter, mais je lui ai dit que ça vous ferait plaisir de lui dire au revoir...
JULIETTE.
Je crois bien. Bonjour, papa !...
Elle lui met un baiser sur le front.
Bonjour, Désiré !...
Elle baise également monsieur Lebleu sur le front.
Désiré, tu as doublement bien fait de monter, car je veux que tu viennes déjeuner à la maison... et Catherine aussi, d’ailleurs.
MOREILLE.
Mais tu as dit à ta maman que tu ne voulais personne !
JULIETTE.
Catherine et Désiré ce n’est pas quelqu’un. Voici ce que nous allons faire : nous allons partir tous ensemble pour la maison.
CATHERINE.
Je me laisse faire.
LEBLEU.
Moi aussi.
JULIETTE.
Papa a son auto ?
MOREILLE.
Oui, oui, j’ai l’auto.
JULIETTE.
Moi, j’ai encore quelques petites choses à emballer dans ma chambre...
À Jules, en s’adressant à lui avec un peu d’hésitation.
Vous serez bien gentil de faire téléphoner par le concierge chez nous, pour prévenir qu’il y aura deux convives de plus... Oh ! ça ne gênera pas maman : elle a toujours peur que les repas soient trop courts et on en fait trois fois plus qu’il ne faut... Mes enfants, je suis à vous tout de suite.
Elle entre dans sa chambre.
JULES, à Catherine.
Vous êtes bien gentille d’être venue voir votre amie, madame Sorlon.
CATHERINE.
Oh ! mais c’était entendu, monsieur !
JULES.
Ah ! j’espère bien que maintenant vous allez m’appeler Jules ? Vous tutoyez Juliette, vous ne pouvez pas dire monsieur à son mari. Je vous demande pardon ; je m’en vais voir où elle en est.
Il entre dans la chambre.
MOREILLE, à Lebleu qui va s’asseoir sur un fauteuil.
Eh bien ! ça a l’air de se passer très bien entre eux.
LEBLEU.
Écoute, mon vieux, ça serait tout de même un peu malheureux si, après un jour de mariage, ils étaient déjà à couteaux tirés !
MOREILLE.
Si tu veux avoir mon opinion, je trouve que c’est un garçon très, très gentil.
LEBLEU.
Je ne t’ai pas demandé ton opinion, mais je ne te dirai pas le contraire.
MOREILLE.
Oh ! toi, tu es toujours le même, n’est-ce pas, Catherine ?
CATHERINE.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
MOREILLE.
Je veux dire que c’est un pessimiste. Depuis deux mois bientôt que nous connaissons ce garçon, nous avons tous pu juger de ses qualités. Il n’y a que toi qui te sois tenu sur la réserve. Et tu m’as même dit qu’il ne t’emballait pas.
LEBLEU.
Qu’est-ce que ça peut faire ?... Est-ce que c’est moi qu’il devait emballer ?... C’était ta fille qu’il épousait... Je souhaite de tout mon cœur que la petite soit heureuse avec lui, puisque maintenant ils sont destinés à vivre ensemble... Tu ne m’obligeras pas, moi, à passer quinze heures par jour avec ce garçon-là... Je le verrai à dîner chez toi, une fois par semaine... Je ne suis pas exigeant, ça suffira à mon bonheur.
MOREILLE.
Veux-tu que je te dise ?... On voit que tu es un ancien professeur... Il faut toujours que tu sois méprisant pour les gens d’affaires...
LEBLEU.
C’est complètement idiot ce que tu dis là. Je ne méprise personne. Seulement, tu ne m’empêcheras pas de distinguer entre les gens avec qui j’aime me trouver et dont la compagnie m’est agréable et d’autres gens pour qui je n’ai aucune espèce d’antipathie, mais qui ne m’intéressent pas. Le monsieur que tu as désormais pour gendre appartient à cette dernière catégorie. Mais faut-il te répéter que ça n’a aucune importance, puisque ce n’est pas moi qui l’ai épousé ? Ce n’est pas votre avis, Catherine ?...
CATHERINE, qui s’était assise à une table, en train de lire son journal.
Oh ! moi, je n’ai rien à dire.
LEBLEU.
La petite a bien dû vous faire ses confidences... Mais, soyez tranquille, je ne vous demande rien.
CATHERINE.
Et vous faites aussi bien, mon cher monsieur Lebleu, car si on m’avait confié quelque chose, je me garderais bien de vous le dire.
LEBLEU.
Oh ! vous finiriez bien par me le dire tout de même. Seulement il ne faut pas que je vous le demande avec trop d’insistance, parce que, alors, ou par taquinerie ou pour garder votre supériorité d’une personne qui sait sur une personne qui ne sait pas, vous vous amuseriez à être discrète...
CATHERINE.
Monsieur Lebleu, si vous n’étiez pas un homme sympathique, vous seriez bien insupportable.
LEBLEU.
Je ne crois pas, parce que les gens qui sont vraiment insupportables, on ne leur dit pas. On les sème, on les sème en douce. Mais moi, dans les occasions trop rares où nous nous rencontrons, vous me supportez très bien, comme je vous supporte, d’ailleurs.
CATHERINE, ironique.
Vous êtes tout à fait aimable.
JULES, entrant.
Juliette me chasse ; elle veut faire sa valise toute seule.
MOREILLE.
Oh ! oui, elle est très entendue pour ces choses-là.
JULES.
Monsieur Moreille, permettez-moi de vous embrasser.
Il l’embrasse.
Vous m’avez donné une charmante enfant.
MOREILLE.
Ce n’est pas encore aujourd’hui que vous direz le contraire.
JULES, quittant ce sujet de conversation.
Mon cher beau-père, votre gendre vient de sortir pendant une heure et il n’est pas mécontent de lui. J’ai obtenu confirmation de ce que l’administrateur m’avait promis : le défraiement complet pour ma femme et pour moi, plus un petit supplément de commission qui ne fera pas mal... Nous allons faire un voyage de noces délicieux qui ne nous coûtera pas un sou et qui, même en dehors des affaires que je ferai, me laissera un petit bénéfice, du fait que la somme qui m’est allouée pour mes frais est largement supérieure à ce que nous dépenserons en réalité...
LEBLEU.
Oui, mais, méfiez-vous, vous savez qu’on dépense beaucoup d’argent sur la Côte d’Azur...
JULES.
Nous faisons la Côte d’Azur, mais je n’ai pas besoin de vous dire que je ne m’arrêterai pas dans les villes de villégiature chics... Pour déjeuner, ça va... Mais quand il s’agira de s’installer quelques jours pour rayonner, je m’arrangerai pour que ce soit dans une localité bien tranquille et sans fla-fla.
CATHERINE.
Mais, dites donc, monsieur Jules, votre femme risque de ne pas se plaire énormément dans ces localités tranquilles et sans fla-fla !...
JULES.
Chère madame et amie, n’ayez crainte, ma femme se plaira certainement dans les hôtels que je choisirai. Je n’ai jamais de ma vie gaspillé l’argent et j’ai toujours tenu au confortable... Je crois très bien connaître le caractère de votre amie, bien que nos relations ne remontent qu’à deux mois... Mais vous m’accorderez que je ne suis plus un jeune homme et que je puis avoir l’expérience des caractères... Juliette est une charmante enfant, mais c’est une enfant...
CATHERINE, d’un ton quelconque.
Oui !
JULES.
D’ailleurs, je ferai mon possible pour l’intéresser à mes préoccupations. Vous savez que nous allons faire une tournée magnifique...
CATHERINE.
Votre affaire bat son plein, je crois ?
JULES.
Oui, vous savez de quoi il s’agit ?...
CATHERINE.
Une sorte de bitume pour les sols d’usine...
JULES.
À proprement parler, ce n’est pas tout à fait du bitume : c’est une pâte de goudron et de silicate qui durcit très vite et qui présente une surface très unie... On la lave chaque jour avec la plus grande facilité à l’aide d’un balai spécial qui fait disparaître les poussières. C’est nous qui fournissons ce balai. Le produit revient assez cher, mais sa qualité est très bonne, de sorte que nous avons de nombreuses demandes et, vous savez, le sol de ces grandes usines, ça chiffre sérieusement en mètres carrés. Vous ne connaissez pas ça, monsieur Lebleu ?
LEBLEU.
Si ! Si ! Vous nous en avez parlé à plusieurs reprises et j’entends toujours votre exposé avec intérêt.
JULES.
C’est une affaire de premier ordre. Aussitôt que je m’en suis rendu compte, j’ai cédé immédiatement, dans de bonnes conditions d’ailleurs, une représentation de semelles chromées qui ne me rapportait pas moins de quatre-vingts billets par an. Si je l’ai donc lâchée, c’est que je comptais faire un chiffre très supérieur avec cette « dallite artificielle ». C’est ainsi que le produit en question a été baptisé.
MOREILLE.
Enfin, j’espère que ma fille prendra un grand intérêt aux progrès de votre affaire, puisque maintenant c’est la sienne.
JULES.
Juliette est une enfant, monsieur Moreille, je la crois pleine de docilité, et, du moment que je lui ferai part de mes préoccupations, je suis sûr qu’elle les suivra...
LEBLEU, interrompant.
Assidûment...
JULES.
C’est à peu près ce que je voulais dire...
Regardant sa montre.
Mais je vais vous demander la permission de m’en aller un peu avant vous... je vous rejoindrai à la maison, parce qu’il ne serait pas mauvais que je passe au siège. J’ai demandé qu’on tape à la machine une lettre circulaire annonçant ma visite aux clients, et je voudrais savoir si ç’a été fait en temps utile...
MOREILLE.
Vous prenez un taxi ?... C’est inutile, nous allons prendre ma voiture. Nous pourrons tous tenir dedans, et Juliette va être prête tout de suite, je suppose...
JULES.
C’est que je ne trouverai plus personne au siège passé midi et demi...
CATHERINE.
Eh bien ! il y a quelque chose de plus simple encore, c’est que vous partiez, monsieur Moreille, avec votre gendre. Moi, j’attendrai Juliette, j’ai ma voiture en bas...
MOREILLE.
Ah ! vous avez votre voiture en bas ? Oh ! c’est parfait...
CATHERINE.
Je me charge de Juliette et de monsieur Lebleu.
JULES.
En effet, voilà ce qu’il y a de plus pratique. Vous venez, mon cher beau-père ?...
MOREILLE.
Eh bien ! oui, nous descendons. À tout à l’heure !... On ne se dit pas adieu, puisqu’on va se revoir pour déjeuner...
Sortent Jules et Moreille.
CATHERINE, qui est allée à la porte de gauche.
Juliette, mon petit, on t’attend... Dépêche-toi, tu sais ! Si on veut déjeuner à une heure convenable...
Elle revient à Lebleu.
Elle était en train d’essayer toute seule, pour elle-même, cinq ou six chapeaux de voyage, qu’elle m’a déjà montrés hier, d’ailleurs...
LEBLEU.
C’est une enfant, comme dit ce pauvre homme, c’est une enfant ! Mais j’ai bien peur que cette enfant, avant peu, le trompe comme une grande personne !
ACTE I
La scène représente un vestibule-salon assez modeste, dans un hôtel de province.
Au lever du rideau, une caissière est à son comptoir. Elle fait des comptes. Jules, entre par une porte intérieure. Il a son chapeau sur la tête et un pardessus léger.
JULES.
Madame, il est possible que nous partions demain. Alors, vous seriez bien aimable de préparer la note pour ce soir...
LA CAISSIÈRE.
Votre train est de bonne heure, demain ?... Vous allez sur Paris ?...
JULES.
Non, nous allons sur Montpellier.
LA CAISSIÈRE.
Alors, c’est à sept heures trente. Je ne serai donc pas arrivée. Je ferai donc la note ce soir...
JULES.
C’est ce que je vous demande... Si, par hasard, il y a un changement et que je sois obligé d’ajourner mon départ, je vous préviendrai en temps utile...
LA CAISSIÈRE.
Ça ne sera pas du travail perdu. Je n’aurai qu’à compléter la note quand vous partirez...
JULES.
Je vous ai fait remarquer, n’est-ce pas ? que, depuis trois jours que nous sommes ici, nous n’avons pris chaque matin, ma femme et moi, qu’un seul petit déjeuner...
LA CAISSIÈRE.
Oui, monsieur, c’est noté. Est-ce que monsieur et madame prendront leur repas aujourd’hui à midi ?...
JULES.
Oui. À midi trente.
LA CAISSIÈRE.
C’est très bien ainsi, nous servons entre midi et une heure trente.
JULES.
Je ne serai pas ici avant midi trente, d’après mes calculs... À propos, il faut que j’aille prévenir madame pour lui dire que je serai peut-être en retard...
LA CAISSIÈRE.
Mais, monsieur n’a pas besoin de se déranger ; on peut le lui dire...
JULES.
Non, non, j’ai des papiers encore à prendre dans ma chambre. Vous avez bien commandé la voiture, madame ?...
LA CAISSIÈRE.
Oui, monsieur, l’auto de location est ici à côté. Seulement, monsieur, je dois vous prévenir que, pour aller aux usines de Bellebaut et ensuite à celles de Vieufontaine, le loueur prétend que ça fait plus de quinze kilomètres... Dans ce cas, il faudrait donc lui donner un peu plus que ce que l’on avait convenu...
JULES.
Le loueur se trompe complètement. J’ai mesuré sur la carte et ça ne fait pas plus de quatorze kilomètres au grand maximum. Enfin, je m’expliquerai de ça avec lui... Il faut que j’aille prévenir ma femme...
Entre Juliette.
Tiens ! la voilà, justement.
LA CAISSIÈRE.
Je vais prévenir le chef que monsieur et madame déjeunent.
Elle sort.
JULES.
Mon chéri, je voulais justement te dire que je ne rentrerai pas avant midi et demi...
JULIETTE.
Oh ! ça ne fait rien. Prenez votre temps.
JULES.
Quand me diras-tu : « Prends ton temps » ?
JULIETTE.
Non, je vous assure, ne me demandez pas encore de vous dire « tu »... Je vous promets que ça viendra, mais il ne faut pas que vous me le demandiez...
JULES.
Ça serait tellement plus gentil si tu me tutoyais...
JULIETTE.
Je vous dis que ça viendra...
JULES.
Eh bien ! écoute ce que j’avais à te dire. Je voulais monter dans la chambre pour prendre des papiers, mais je n’en aurai pas besoin ce matin... Je te disais que j’avais à faire deux courses, à discuter par conséquent deux affaires possibles. Je préfère ne pas être bousculé et pouvoir prendre mon temps...
JULIETTE.
Mais oui, je vous dis de prendre votre temps...
JULES.
À Vieufontaine, je te mets au courant, jusqu’à présent ils ne veulent me donner qu’une seule commande de dallage pour l’usine de tréfilerie... Mais je voudrais également le sol de leur clouterie qui présente encore plus de surf ace... Si j’ai à daller leurs deux usines, ça ira chercher dans les quinze mille mètres carrés. Même si je dois leur consentir une réduction de prix, tu vois un peu ce que ça donne...
JULIETTE.
Oui, je vois...
JULES.
Non, tu ne peux pas voir exactement. Il faudra que je te fasse des calculs, papiers en main...
JULIETTE, résignée.
C’est entendu.
JULES.
Encore autre chose à te dire. Si je traite mes affaires ce matin, on part demain à la première heure. Mais il y a encore une circonstance possible. L’administrateur de Vieufontaine, qui a les pouvoirs pour traiter, était encore absent hier soir. On m’affirme qu’il sera de retour ce matin, mais s’il ne revient que dans quatre ou cinq jours, ça ne sera pas drôle, parce qu’il faudra l’attendre ici, et surtout ça ne sera pas amusant pour toi, ma petite...
JULIETTE.
Ah ! non, ce n’est pas une perspective très amusante...
JULES.
Alors, dans ce cas-là, qu’est-ce que tu veux, mon petit ? comme tout de même je ne peux pas t’obliger à mener cette vie d’attente assommante, j’en profiterai pour faire la région entre ici et Montpellier. Dans ce cas-là, donc, je ferais un grand sacrifice : tu prendrais le train pour Paris toute seule et je te rejoindrais aussitôt débarrassé de tout cela. Qu’est-ce que tu en penses ?
JULIETTE.
Eh bien ! ça sera comme vous voudrez.
JULES.
Qu’est-ce que tu vas faire ce matin, en m’attendant ?...
JULIETTE.
Oh ! j’ai des lettres à écrire. Je vais m’installer ici, parce que le jour n’est pas très bon dans la chambre... Je vais monter chercher mon papier à lettres.
JULES.
Mais pourquoi ?... Il y a du monde ici pour aller te le chercher...
JULIETTE.
Non, non ! J’aime mieux aller le chercher moi-même, ça passe le temps...
JULES.
À tout à l’heure, mon chéri !...
Il l’embrasse.
Tu m’excuseras de te quitter ainsi...
JULIETTE.
Je vous excuse.
JULES, implorant.
Je vous excuse ?
JULIETTE.
Plus tard...
Elle sort.
LA CAISSIÈRE, entrant.
J’ai commandé le déjeuner... Vous aurez de bonnes petites truites... On vient de les apporter toutes vivantes...
JULES.
C’est parfait, madame, c’est parfait !
LA CAISSIÈRE.
Mais je ne crois pas que vous soyez très gourmand !
JULES.
Non, je ne me dérangerais pas tout exprès pour faire un bon déjeuner, mais je n’aime pas quand c’est mauvais. Au revoir, madame ! Je vais passer chez le loueur.
LA CAISSIÈRE.
Au revoir, monsieur !
Il sort. Elle appelle le garçon.
Albert !...
LE GARÇON, entrant.
Madame Tourin...
LA CAISSIÈRE.
Je suis en train de faire la note du dix-sept... C’est bien exact, n’est-ce pas, que vous ne leur avez servi chaque matin qu’un déjeuner ?...
LE GARÇON.
Oui, madame, soi-disant un café au lait complet pour madame. Mais comme il ne reste jamais rien, je crois bien que le petit déjeuner leur sert à tous les deux...
LA CAISSIÈRE.
Oui, je vois : c’est un monsieur qui sait voyager... Vous pouvez compter sur le pourboire minimum...
LE GARÇON.
Oh ! j’ai vu ça dès les premiers jours, et je ne l’ai pas taxé bien haut...
La porte donnant sur la rue, et par où Jules est sorti, livre passage à Julien et à Georges. Ils sont en uniforme d’aviateurs.
GEORGES.
Bonjour, madame !
LA CAISSIÈRE.
Bonjour, messieurs !
GEORGES.
Nous venons pour une affaire importante... Une commande de deux cafés nature, très chauds, que nous paierons comptant et sans marchander, au tarif de la maison... Il y aura même un petit supplément pour le nommé Albert...
LA CAISSIÈRE.
Albert, vous entendez ?
LE GARÇON.
Tout de suite ! Tout de suite...
GEORGES.
Nous descendons des nuages, madame.
JULIEN.
Où il ne faisait pas très chaud.
Il sort.
LA CAISSIÈRE.
Il me semble que vous montez en avion tous les matins en ce moment ?...
GEORGES.
Oui, madame ; ce n’est pas absolument par plaisir, mais nous sommes obligés de totaliser, d’ici la fin du mois, un certain nombre d’heures de vol... Alors, il n’y a qu’à voler...
LA CAISSIÈRE.
Mais ça doit être très amusant...
GEORGES.
On s’y fait, madame, on s’y fait... Je ne vous propose pas de vous emmener avec moi dans les airs, parce que, vous savez, quand je suis en train de piloter, il me reste peu de temps à moi pour faire la cour à une dame... Mais si vous voulez remplacer ça par un tour dans la campagne, au bord d’un petit ruisseau, vous n’avez qu’un tout petit signe à faire et je me mettrai à votre disposition...
LA CAISSIÈRE.
Oui, oui, oui !
GEORGES.
Qu’est-ce que ça veut dire : « Oui, oui, oui » ?
LA CAISSIÈRE.
Vous me proposez de faire un petit tour dans la campagne, mais, en admettant que je vous écoute, vous seriez bien attrapé...
GEORGES.
Comment, je serais bien attrapé ?...
LA CAISSIÈRE.
Oui, oui, vous seriez attrapé par une demoiselle de ce pays-ci que je connais...
Entre le garçon, avec la verseuse et deux tasses à café.
GEORGES.
Madame ! Madame ! Je vous en supplie, un peu de discrétion !
LA CAISSIÈRE.
Monsieur, monsieur, je ne crois pas être indiscrète, puisque vous m’avez raconté l’autre jour vos histoires de cœur devant votre camarade, ici présent...
GEORGES.
Comment, je me serais laissé aller à des confidences aussi intimes ?... C’est possible.
LA CAISSIÈRE.
Et puis, je vais me montrer tout à fait discrète, je vais m’en aller...
GEORGES.
Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ?
LA CAISSIÈRE.
Ce n’est pas du tout une plaisanterie, je vais m’en aller parce que j’ai des courses à faire...
Elle met son petit chapeau qui se trouve à côté d’elle et se prépare à s’en aller.
GEORGES.
Mes amitiés à monsieur votre amant.
LA CAISSIÈRE.
Qui est-ce qui est indiscret à son tour ?...
GEORGES.
Je ne suis pas indiscret du tout, je n’ai prononcé aucun nom, et, d’ailleurs, je n’ai prononcé aucun nom parce que je ne sais pas qui c’est.
LA CAISSIÈRE.
Au revoir, messieurs !
GEORGES.
Vous ne voulez pas me dire son nom ?
LA CAISSIÈRE.
Au revoir, messieurs !
GEORGES et JULIEN, ensemble.
Au revoir, madame !
Elle sort. Le garçon sort aussi, après avoir versé les deux cafés. Georges et Julien s’assoient.
GEORGES.
Tu fais une tête épouvantable, toi. Qu’est-ce qui t’arrive ?
JULIEN.
Il y a qu’il ne m’arrive rien et que je m’embête royalement. Pourquoi veux-tu que je m’amuse ?... La caissière a un amant ; toi, tu as une maîtresse. Chacun s’embrassera, il n’y a que le pauvre Julien qui restera. Ce n’est pas tout ça qui peut réjouir un jeune homme. Depuis que je suis dans ce patelin, tu sais que le nombre de mes bonnes fortunes a été bien restreint...
GEORGES.
Le fait est qu’ici il n’y a pour ainsi dire aucune ressource. Mais il ne faut pas désespérer...
JULIEN.
Enfin, c’est le marasme. On vole le matin. Le restant de la journée, on est là à ne rien faire...
GEORGES.
Et les joies de la lecture ?
JULIEN.
Depuis que j’ai tant de temps à moi pour lire, je ne lis plus. Ah ! je la retiens, cette ville-là ! Je la retiens ! Il faut connaître une femme, parce que, sans cela, on n’en rencontre jamais.
GEORGES.
Eh bien ! mon vieux, hier à dîner, ici même, dans la salle du restaurant, il y en avait une très, très gentille...
JULIEN.
Hier ?
GEORGES.
Oui, mon ami. Tu ne pouvais pas la voir, tu lui tournais le dos... Elle est arrivée pendant que nous dînions, et son type et elle sont partis avant nous. Ils sont entrés et partis par la porte du fond. Et, comme tu étais placé face à la fenêtre, tu n’as pas pu les voir.
JULIEN.
Pourquoi est-ce que tu ne me l’as pas montrée ?
GEORGES.
Parce qu’il n’y avait que nous quatre dans la salle à manger. Leur table n’était pas loin de la nôtre et c’était pas facile de te la signaler... Il aurait fallu te retourner complètement pour la voir.
JULIEN.
Non, vraiment, ça n’est pas bien de ta part. Ça n’est pas chic du tout.
GEORGES.
Si, mon ami, je suis très chic pour toi, et je vais t’en donner la preuve. Après le dîner, pendant que tu allais acheter tes journaux, j’ai pris mes informations auprès de la caissière. Ce monsieur et cette dame habitent l’hôtel. Et je sais même qu’ils sont mariés depuis quinze jours.
JULIEN.
Oh ! bien, alors, il n’y a rien à faire. Tu penses que je peux essayer de lever une femme qui est dans son premier mois de mariage ?
GEORGES.
Théoriquement, ça n’est pas impossible. Pratiquement, il se peut que ça présente des difficultés. Si tu avais le choix, je te dirais de diriger tes batteries d’un autre côté...
JULIEN.
Le fait est que je n’ai pas le choix. Le mari, comment est-il ?
GEORGES.
Impartialement, il est moche. Elle, elle est très, très gentille... Il n’y a qu’une chose qui m’ennuie pour toi, c’est qu’il est question qu’ils s’en aillent demain.
JULIEN.
Ils s’en vont demain ?... Et c’est cela que tu as à me proposer ?
GEORGES.
Je propose ce que j’ai, mon vieux...
Brusquement.
Tiens !...
JULIEN.
Qu’est-ce qu’il y a ?
GEORGES.
Bouge pas, tu vas la voir...
Entre Juliette, qui se dirige vers la caisse. Voyant que la Caissière n’est pas là, elle se dirige vers la porte de l’office.
JULIETTE.
Garçon !
ALBERT.
Madame ?
JULIETTE.
La caissière n’est pas là ?
ALBERT.
Non, madame. Elle est sortie pour faire des courses. Qu’est-ce que madame désirerait ?
JULIETTE.
Je voudrais écrire des lettres ici, parce que, dans ma chambre, il fait sombre et ça m’ennuie d’allumer l’électricité en plein jour.
ALBERT.
C’est bien simple, madame. Vous n’avez qu’à vous installer à une de ces tables. Je vais vous donner de quoi écrire.
JULIETTE.
De l’encre, une plume et un buvard. Ah ! bon, que je suis étourdie !... Il faut que je remonte chercher mes cartes postales que j’ai complètement oubliées.
ALBERT.
Que madame ne se dérange pas. Je vais monter les chercher.
JULIETTE.
Non, non... vous ne les trouveriez pas. Elles sont enfermées dans une valise. Mettez-moi donc de quoi écrire là.
Elle sort.
GEORGES, à Julien.
Eh bien ?
JULIEN.
Tu n’as pas mauvais goût.
GEORGES.
Eh bien ! chasseur, vite en campagne ! Du cor n’entends-tu pas le son ?
JULIEN.
Mon vieux, qu’est-ce que tu veux ! Elle s’en va demain !...
GEORGES.
Qu’est-ce que ça coûte d’essayer de faire sa connaissance ?... C’est en tout cas une manière d’occuper ton temps... Et puis, il faut avoir confiance dans la providence... Peut-être ne s’en ira-telle pas demain. Moi, je sais bien ce que je ferais. Demain, je lâcherais la chambre que tu as en ville et je viendrais m’installer ici. D’abord, tu serais mieux qu’à l’endroit où tu es, et je suis sûr que l’hôtel ici te ferait d’aussi bonnes conditions. Ils n’ont pas énormément de monde en ce moment...
JULIEN.
Je puis toujours essayer de faire sa connaissance, mais qu’est-ce que je vais lui dire pour entrer en conversation ?
GEORGES.
N’importe quoi. Tu ne manques pas tout de même d’imagination... Raconte-lui que tu es seul dans la vie...
JULIEN.
C’est vrai.
GEORGES.
Eh bien ! tant mieux, il se trouve que c’est vrai. Mais ça ne serait pas vrai que tu pourrais toujours le dire. Et puis, sais-tu ce que je ferais, moi, à ta place ? Ne prépare rien. Quand on prépare quelque chose, on cherche ce qu’on avait préparé et puis on bafouille.
JULIEN.
Ah ! quoi que je dise, j’aurai l’air d’un maladroit...
GEORGES.
Il y a des femmes avec qui ça n’est pas mauvais d’avoir l’air un peu maladroit... Elles mettent ça sur le compte de l’émotion qu’elles vous donnent... Et puis, tu sais, on se figure qu’on est maladroit et on ne l’est pas tant que ça... Sur ce, je te laisse la route libre. Je m’en vais.
JULIEN.
Non, mon vieux, ne t’en va pas... Tu vas rester ici pour me rendre le service d’engager la conversation. Après, tu t’en iras...
GEORGES.
Alors, quoi, il te faut un maître nageur pour te mettre à l’eau ?...
JULIEN.
J’aime mieux ça que de me noyer...
GEORGES.
Voilà l’ennemie.
JULIEN, entre ses dents.
Pourquoi l’ennemie ?...
GEORGES.
L’adversaire, si tu veux, dont il faut arriver à faire une partenaire...
Décidé, à mi-voix.
Allons-y...
À Juliette, qui entre.
Pardon, madame... Excusez-moi si je me trompe, est-ce que je n’ai pas eu le plaisir de vous apercevoir une fois au camp d’aviation du Bourget ?...
JULIETTE.
Oh ! ça m’étonnerait, monsieur, je n’y suis jamais allée.
GEORGES, à Julien.
Eh bien ! tu vois ! C’est surtout mon ami qui m’affirmait que nous vous avions vue...
Julien ouvre des yeux étonnés.
Moi, au contraire, je croyais qu’il se trompait et j’avais raison... Je vous demande mille fois pardon, madame, de mon indiscrétion....
JULIETTE.
Mais, monsieur, il n’y a aucune indiscrétion et vous êtes tout excusé...
GEORGES.
Merci, madame. Vous êtes très bonne et vous pardonnerez à deux jeunes aviateurs qui sont exilés dans cette ville et qui n’ont pas souvent le bonheur de rencontrer une Parisienne... Mais je m’excuse encore une fois, madame, parce que je vous ai entendu dire, madame, que vous aviez à écrire des lettres et nous vous retenons...
JULIETTE.
Oh ! non, monsieur, j’ai toute ma journée... Si j’utilisais ainsi les loisirs que j’ai ici, je crois que je n’aurais pas assez de connaissances pour leur envoyer de mes nouvelles.
GEORGES.
D’ailleurs, le courrier de Paris ne part qu’à cinq heures...
JULIEN.
Deux heures quinze...
GEORGES, le regardant sévèrement.
Mais non, voyons, tu ne sais pas... C’est deux heures quinze pour le bureau de poste, mais, à la gare, on a jusqu’à cinq heures. Madame, je vous présente mes devoirs...
À Julien.
Cher ami, je vais te laisser ici, tu sais que je suis attendu. Madame, je ne crois pas qu’il m’en voudra de le laisser seul avec vous, car je n’oserais certainement pas vous répéter ce qu’il me disait de vous tout à l’heure...
JULIEN, vivement.
Mais qu’est-ce qu’il raconte ?... C’est un fou ! Madame je vous assure que je ne me serais jamais permis de dire quoi que ce fût de vous...
GEORGES.
Allons, bon diable, allons !... Mes respects, madame !
Il sort.
JULIEN.
Madame, vous savez, je vous prie encore une fois de m’excuser, mais je n’ai pas du tout parlé de vous à mon ami...
JULIETTE.
Mais, monsieur, il n’y a rien qui m’offense là dedans.
JULIEN.
Vous êtes encore ici pour quelque temps, madame ?
JULIETTE.
Eh bien ! pour très peu de temps encore, car mon mari m’a dit tout à l’heure que nous partirions probablement demain matin.
JULIEN.
Oh ! comme c’est ennuyeux !
JULIETTE.
Oh ! vous êtes bien gentil, monsieur.
JULIEN.
Je vous demande pardon, madame, mais ici, dans ce trou, quand il vient des gens agréables, ils repartent tout de suite. En revanche, toutes les autres personnes de la ville, qui n’offrent aucun agrément, ne s’en vont jamais. Vous êtes de Paris, madame ?
JULIETTE.
Oui, monsieur. Je suis née, si ça peut vous faire plaisir, rue Lafayette, tout près du square Montholon.
JULIEN.
Et moi, rue Raynouard, à Passy. C’est Paris tout de même.
JULIETTE.
Oh ! ce n’est pas tant Paris que la rue Lafayette.
JULIEN.
Nous n’allons pas nous disputer pour ça ?
JULIETTE, riant.
Non. Je veux bien vous faire une concession.
JULIEN.
J’ai entendu dire que vous étiez jeune mariée.
JULIETTE.
Dites que je suis mariée depuis peu. Mais je ne suis pas une jeune mariée. J’ai vingt-quatre ans.
JULIEN.
Oh ! alors, vous me devez le respect. J’ai vingt-cinq ans.
JULIETTE.
Et vous faites votre carrière militaire, monsieur ?
JULIEN.
Non, madame, je ne suis parti qu’à vingt-trois ans passés, parce que j’ai eu des sursis. Je suis ingénieur. Ça n’est pas tout à fait régulier, mais j’ai obtenu des faveurs.
JULIETTE.
Vous avez probablement de hautes relations ?
JULIEN.
Oh ! non, madame, pas du tout. Seulement, mon patron d’usine avait besoin de moi et il m’a gardé le plus longtemps possible. Au fond, j’aurais préféré être soldat plus tôt pour m’en débarrasser, mais, que voulez-vous, j’étais aussi bien à l’usine qu’au régiment. Je n’ai plus de famille. J’ai eu le malheur de perdre mes parents il y a sept ans, la même année ; et je n’ai ni frère ni sœur. Je ne vous dis pas ça, madame, pour que vous vous apitoyiez sur mon compte, mais parce que c’est la vérité. J’ai deux ou trois amis, mais je n’ai plus de famille. On a beau être seul dans la vie, on sent moins sa solitude à Paris. Vous avez encore votre papa et votre maman, madame ?
JULIETTE.
Oui, j’ai ce bonheur.
JULIEN.
D’ailleurs, vous êtes mariée.
JULIETTE.
Oh ! je connais mon mari depuis si peu de temps ! Je ne me détacherai jamais de ma famille, mais, si j’avais dû m’en détacher, ça n’aurait pas été en quinze jours. Je suis encore comme si j’étais chez moi.
JULIEN.
Vous êtes bien heureuse.
JULIETTE.
Mais vous allez bien vous marier un de ces jours ?
JULIEN.
Je ne crois pas, parce que je suis très difficile. Il y a très peu de personnes à qui je voudrais unir ma vie. Je n’en ai pas rencontré beaucoup.
Tournant la tête.
Et celles que j’ai rencontrées n’étaient jamais libres.
Silence.
Je vous demande pardon, madame, je vais vous dire une chose, mais, pour que je me permette de vous la dire, il faut que vous soyez bien assurée du respect que j’ai pour vous. Je ne voudrais pas que ça ait l’air d’une déclaration, mais voilà cinq mois que je suis ici et je vous assure qu’il ne m’est pas arrivé de causer aussi longtemps avec quelqu’un. Je ne parle pas de mon ami Georges qui est un camarade et avec qui nous échangeons des propos sans consistance, des bêtises. Il ne lui vient jamais à l’idée de m’interroger sur ce que j’appellerai mon état d’âme. Et, de mon côté, je n’ai aucune envie de lui dire des choses que je sens très profondément. Je suis seul dans la vie, j’en ai de la tristesse, mais je n’y pense pas toujours et je n’ai aucune envie de le dire aux gens. Il me semble que ça ne les intéresserait pas. Eh bien ! je vous assure que ça me soulage de vous le raconter, à vous. Vous allez rentrer à Paris. Il se peut que nous ne nous revoyions jamais, et je ne me permettrai pas d’aller vous rendre visite...
JULIETTE.
Mais, monsieur, c’est moi qui vous en prierai. Je suis comme vous, je ne me lie pas vite avec les gens. Il y a des gens avec qui je ne me lierai jamais, mais il y en a d’autres avec qui je me sens assez vite en confiance. Et je puis dire que je ne me sens pas en défiance avec vous.
JULIEN.
Vous êtes bonne, madame. Mais je vous assure que votre bonté ne fait pas fausse route et que je mérite tout à fait la confiance que vous voulez bien m’accorder. Comme la vie est curieuse ! Ce matin, je vous assure, je ne veux pas jouer au romantique, ce n’est pas mon caractère, mais vraiment j’étais le plus désespéré des hommes. La vie me paraissait sans saveur. Et tout à coup, de voir se lever une petite lueur d’amitié, je me sens complètement transformé. Je suis navré de penser que vous vous en allez demain. Mais, puisque je puis avoir l’espoir... que ça ne sera pas indiscret... d’aller vous présenter mes devoirs à Paris – j’y vais d’ailleurs d’ici une quinzaine de jours – eh bien ! je vous assure que je vais passer quinze jours heureux, et ce que je vous dis, vous savez, c’est la vérité vraie. Je ne suis pas du tout un garçon qui s’exalte facilement...
JULIETTE.
Mais vous êtes très sensible !
JULIEN.
Oui, madame. Je l’ai toujours été. J’étais enfant unique, très gâté par mes parents. J’ai eu le malheur de les perdre. Ç’a été pour moi des moments douloureux auxquels j’étais préparé, parce qu’ils étaient l’un et l’autre malades et condamnés depuis deux ans. Oh ! ce n’est pas une maladie héréditaire, et moi je me porte très bien ! Seulement, au cours d’un voyage, ils avaient attrapé l’un et l’autre une espèce de pneumonie qui avait été mal soignée et dont ils ne se sont jamais remis... Ils m’avaient beaucoup gâté et, comme je vous le disais, je suis très sensible. Seulement, je suis très difficile dans ma sensibilité. Il y a très peu de gens avec qui je sois vraiment sensible. Le monde est peuplé pour moi de beaucoup d’indifférents, je veux dire de gens qui me sont indifférents. Je suis plutôt renfermé. Je tiens à vous le dire, parce que, depuis le temps que je bavarde, vous auriez pu vous apercevoir du contraire. Je vous demande pardon d’être aussi sans gêne avec vous.
JULIETTE.
Mais, monsieur, je ne puis pas dire que ça me soit désagréable ; je suis aussi très flattée de constater que vous avez confiance en moi.
JULIEN, avec élan.
Madame, j’ai en vous une confiance éperdue ! Ça ne se raisonne pas. Il me semble que je vous connais depuis toujours.
JULIETTE, attendrie.
Vous êtes gentil...
JULIEN.
C’est tout de même ennuyeux que vous partiez demain. Dans combien de temps serez-vous à Paris ?
JULIETTE.
Si mon mari rencontre les personnes qu’il devait voir aujourd’hui, nous devons encore passer par Montpellier et je pense que nous serons à Paris dans cinq ou six jours...
JULIEN.
Eh bien ! moi, je vais tâcher de me faire remplacer et de prendre ma permission un peu plus tôt. Mais, si vous ne partez que demain matin, je pourrai peut-être vous voir cet après-midi, à moins que vous n’ayez à sortir avec monsieur votre mari ?
JULIETTE.
Oh ! je ne crois pas, parce qu’il doit encore avoir des visites à faire dans les usines des environs. Au début, il m’emmenait, mais j’attendais quelquefois une heure dans la voiture, à la porte de l’usine, et vraiment j’aime autant attendre ici.
JULIEN.
Je n’ai pas de service cet après-midi. Je tâcherai de passer ici vers trois heures.
JULIETTE.
Tiens ! voilà une auto qui s’arrête. C’est peut-être mon mari qui revient.
Julien se lève machinalement. Entre Jules. Juliette, le montrant.
Mon mari.
Présentant.
Monsieur...
JULIEN, l’interrompant.
Julien Méraud.
JULIETTE.
Monsieur est aviateur au camp, ici, à côté. C’est un Parisien comme nous.
JULIEN, s’inclinant.
Monsieur, vous avez là une belle profession, un peu dangereuse...
JULIETTE.
Oh ! monsieur, on n’y pense pas.
JULES.
Jusqu’au moment où il arrive... Enfin, je souhaite et je suis persuadé qu’il ne vous arrivera rien.
JULIEN, s’inclinant pour prendre congé.
Monsieur...
JULIETTE.
Je crois que nous aurons l’occasion de nous rencontrer avant mon départ.
JULIEN.
Je le crois, madame, d’autant que j’habite ici tout près et que je viens très souvent prendre mes repas à l’hôtel. Au revoir, monsieur ! Au revoir, madame !
Il sort.
JULES.
Dis donc, mon petit ?
JULIETTE.
Qu’est-ce qu’il y a ?
JULES.
Une nouvelle qui n’est pas réjouissante pour moi, mais qui le sera sans doute pour toi. Tu seras probablement obligée de rentrer seule à Paris. Monsieur le baron Herpin, l’administrateur délégué, ne sera ici que dans trois jours. Alors, je suis obligé de l’attendre. Mais, comme je te l’ai dit, tu peux rentrer à Paris toute seule.
JULIETTE.
Oui, oui.
JULES.
Tu veux que je fasse retenir ta place ?
JULIETTE.
Écoutez, je ne suis pas encore décidée. Ça ne serait pas gentil de vous laisser comme ça.
JULES.
Je ne veux pas que tu te sacrifies.
JULIETTE.
De quoi ça aurait-il l’air, si je rentrais à Paris sans vous ?...
JULES.
C’est bien réfléchi ?... Tu ne t’en repentiras pas ?
JULIETTE.
Non, non, je vous attendrai.
JULES la regarde.
Je vous attendrai ?
Il insiste sur vous.
JULIETTE, condescendante, à mi-voix.
Je t’attendrai.
JULES.
Ah ! comme elle est gentille !
Il l’embrasse.
ACTE II
La scène se passe dans l’hôtel de l’acte premier. Elle représente une chambre d’hôtel sans lit.
Au lever du rideau, le garçon d’hôtel est en scène avec Georges. Albert, machinalement, déplace des chaises et passe un coup de torchon sur un guéridon. Georges est debout. Il vient d’entrer depuis peu dans la pièce.
ALBERT.
Madame ne va pas tarder à rentrer, monsieur. Elle m’a dit comme ça, si vous veniez, de vous dire d’attendre un peu. Elle n’a qu’une course à faire tout près et elle sera là bientôt.
GEORGES, s’asseyant auprès d’un guéridon.
Je ne savais pas que vous aviez des salons dans cet hôtel.
ALBERT.
Oh ! monsieur, c’est l’exception... L’hôtel n’a que des chambres. Il vient ici des petits voyageurs de commerce... On ne vient pas les voir... Eux autres, au contraire, vont voir les clients chez eux. Seulement, comme cette chambre où c’est que nous sommes était libre et qu’elle se trouve par le fait à côté de la chambre de ce monsieur et cette dame... Vous savez, ils étaient pour partir, il y a huit jours, et puis ils ont ensuite de ça reculé leur départ...
GEORGES.
Oui, oui, je sais... Quand j’ai fait leur connaissance, c’était il y a huit jours...
ALBERT.
Alors, ce monsieur et cette dame étant pour rester un peu plus longtemps dans la ville, ils ont demandé à la patronne de leur aménager cette pièce en salon. C’est plus agréable censément pour eux, s’ils veulent recevoir des amis... La patronne a donc fait enlever le lit et puis elle a mis un guéridon et divers autres objets qui se trouvaient dans d’autres chambres... Si, comme ils ont dit, ils s’en vont demain, alors on remettra le lit. Ce n’est pas que ce lit nous fasse défaut, parce que la foule ne se précipite pas à l’hôtel, du moment...
GEORGES.
Alors, vous m’avez dit que madame allait bientôt venir...
ALBERT.
Elle est descendue à la poste pour mettre un télégramme à ses parents, qu’elle a dit. Et puis elle a dit à la femme de chambre qu’elle avait encore une petite course à faire chez le parfumeur... C’est donc pourquoi qu’elle a bien recommandé que, si une personne venait, qu’elle veuille bien l’attendre un peu, vu qu’elle ne serait pas longue... Un instant, monsieur l’aviateur, je crois qu’on marche dans le couloir... Ce serait cette dame que j’en serais pas plus étonné que ça...
Il va à la porte, l’ouvre. À Georges.
C’est justement cette dame.
Il s’efface pour laisser entrer Juliette, et sort.
GEORGES, se levant.
Madame...
JULIETTE.
Monsieur Georges, vous vous demandez pourquoi je vous ai dérangé ?... Je vous prie de m’excuser, mais j’étais affolée par cette dépêche de votre ami Julien... Il me dit qu’il est retenu à Montauban... Il sait que je rentre à Paris demain matin, puisque c’est convenu et que, mon mari et moi, nous avons pris nos places... Et, tout de même, il me dit qu’il lui est impossible d’être ici avant après-demain...
GEORGES.
J’ai reçu le même télégramme, madame. Hier, quand il a été commandé de service pour aller à Montauban, il était impossible de croire que cet appareil n’était pas arrivé là-bas... Eh bien ! par suite d’un retard de fabrication, l’appareil en question n’est pas parvenu en temps utile...
JULIETTE.
C’est inimaginable...
GEORGES.
Mais ça arrive souvent, madame ; ça arrive tellement souvent que je me méfiais du coup. J’avais demandé d’y aller à sa place. Seulement, le commandant l’avait désigné ; il est un peu obstiné, le commandant, vous savez. Et puis, avec ça, je ne crois pas qu’il nous ait à la bonne, ni mon camarade ni moi... J’avais un autre appareil à réceptionner ici, ce que Julien aurait très bien pu faire à ma place... On l’a demandé au commandant, qui a répondu : « On fera comme j’ai dit... »
JULIETTE, remuant la tête de droite à gauche.
Je ne peux pas m’imaginer, tout de même, qu’il n’ait pas trouvé un moyen de s’arranger autrement.
GEORGES.
Oh ! je vous assure, madame, qu’avec le commandant c’était impossible !
JULIETTE.
Ah ! monsieur Georges, je sais que vous êtes l’ami de Julien, vous ne pouvez pas faire autrement que de le défendre !
GEORGES.
Je ne le défends pas, madame, je vous dis exactement ce qu’il en est. JULIETTE, hésitant.
Monsieur Georges...
Se décidant.
Monsieur Georges, je n’ai rien à vous cacher... Je sais que vous êtes au courant de tout...
GEORGES, un peu confus.
Madame...
JULIETTE.
Je le sais. Votre ami Julien est comme moi, il n’est pas dissimulé... C’est tout à fait mon caractère... J’ai beaucoup de peine à cacher les choses. Comme je savais que vous étiez son ami intime et que je pensais qu’il serait gêné de vivre avec vous en vous cachant quelque chose, c’est moi-même qui l’ai autorisé à vous confier, sous le sceau du secret, tout ce qui s’était passé entre nous.
GEORGES.
Madame, vous n’avez pas tort de compter sur ma discrétion.
JULIETTE.
Ce n’était pas seulement une affaire de discrétion... Je n’aurais jamais permis à Julien de le dire à une personne que je n’aurais pas su très discrète, mais je savais surtout que vous ne me jugeriez pas mal.
GEORGES.
Madame, comment auriez-vous pu penser...
JULIETTE.
Oh ! il y a bien des personnes qui m’auraient mal jugée... Mais, d’après ce que Julien m’avait dit de vous, j’étais sûre que vous sentiriez qu’il y avait entre lui et moi un très grand sentiment... et j’étais sûre que vous comprendriez qu’un sentiment comme celui-ci purifie tout.
GEORGES.
Vous aviez raison, madame. C’est exactement ce que j’ai compris.
JULIETTE.
Oui, mais maintenant je me demande si je ne me suis pas trompée sur la sincérité de votre ami... En ce qui me concerne, je sais très bien que ce qui m’a attirée vers lui, c’était quelque chose de très tendre, très pur, presque une idée de protection, parce que je le savais, au point de vue du sentiment, un peu seul dans la vie... Je m’imaginais que ce qui l’attirait vers moi, c’était quelque chose d’aussi pur et d’aussi grand. Je me demande maintenant si je ne me suis pas trompée et j’en suis malheureuse...
GEORGES, avec une certaine solennité.
Madame, je puis vous assurer du plus profond de mon âme que vous ne vous êtes pas trompée. C’est un garçon d’une parfaite loyauté, d’une nature absolument franche et très sensible... Je puis le dire, madame, parce que je reconnais moi-même qu’il est beaucoup plus sérieux que moi et capable de sentiments beaucoup plus profonds. Je puis vous certifier qu’il a pour vous un grand amour...
JULIETTE.
Mais, monsieur Georges, comment puis-je le croire ?... Rien que ce qu’il me fait aujourd’hui, mais c’est abominable !... Je m’en vais demain et il ne sera pas là quand je partirai !...
GEORGES.
Non, madame, il ne sera pas là, mais vous savez qu’il a demandé sa permission, qu’il sera de retour après-demain et que, dans trois jours, il sera à Paris.
JULIETTE.
Mais est-ce que je puis le croire, maintenant ?
GEORGES.
Je vous assure que c’est la vérité !
JULIETTE.
Oh ! je ne crois plus rien et j’en suis à me demander des choses terribles... si je n’ai pas été un jouet entre ses mains...
GEORGES.
Oh ! madame, comment pouvez-vous dire une chose pareille !... Un jouet entre ses mains ! Que faut-il faire pour que vous ayez ma conviction : c’est le garçon le plus sincère de la terre.
JULIETTE.
Il a peut-être été sincère un moment... et peut-être s’est-il trompé lui-même sur ses véritables sentiments...
Elle se met à pleurer.
C’est abominable !...
GEORGES.
Vous vous trompez, madame... vous vous trompez !
JULIETTE.
Ah ! non, je ne me trompe pas maintenant. Je me suis trompée, voulez-vous dire, quand je l’ai écouté...
GEORGES, protestant.
Madame ! Madame !
JULIETTE.
Je l’ai écouté, j’ai fait ce qu’il a voulu... Ah ! j’ai honte de moi quand j’y pense... Je suis une créature odieuse ! J’ai trahi mon mari et qu’est-ce que je suis, monsieur, qu’est-ce que je suis ?... Je me déteste... J’ai horreur de moi !
GEORGES.
Madame, je vous en supplie, écoutez-moi !... Vous vous exaltez à tort. Pourquoi vous exaltez-vous ?... Parce que Julien n’est pas là aujourd’hui ? Mais vous avez affaire à un homme qui n’est pas libre de ses mouvements... N’oubliez pas qu’il est soldat.
JULIETTE.
Oh ! s’il avait voulu, s’il m’aimait vraiment, il se serait bien rendu libre.
GEORGES.
Mais puisque je vous dis, madame, que vous le verrez dans trois jours !
JULIETTE.
Il viendra peut-être dans trois jours, parce qu’il ne pourra pas faire autrement... Mais, comment pourrai-je oublier ce qu’il me fait aujourd’hui ?...
GEORGES.
Mais il y est forcé, madame !... Je suis sûr qu’il est aussi malheureux en ce moment que vous pouvez l’être...
JULIETTE.
C’est vous qui le dites...
GEORGES.
C’est ce que je pense au fond de moi-même...
JULIETTE, après avoir remué la tête de droite à gauche.
Voyons, s’il était si malheureux que ça, est-ce qu’il ne serait pas venu tout de même ?...
GEORGES.
Mais ç’a été pour lui une impossibilité absolue, radicale...
JULIETTE, se levant.
Monsieur Georges, laissez-moi... Je vous demande pardon, mais je veux rester toute seule, je veux pleurer toute seule… Vous essayez de défendre votre ami, c’est votre rôle… Mais, malgré tout ce que vous me dites, je ne fais que me persuader de sa trahison...
GEORGES.
Qu’est-ce que je pourrais vous dire pour vous prouver que vous vous trompez ?...
JULIETTE.
Plus rien, monsieur Georges, plus rien... Je vous demande mille pardons de vous avoir fait venir et maintenant je vous demande pardon encore si je vous dis que je veux rester seule... Laissez-moi, monsieur Georges...
GEORGES, résigné.
Je vous laisse, madame, puisque vous l’ordonnez...
JULIETTE.
Au revoir, monsieur !
GEORGES, avec un dernier effort.
Madame !
JULIETTE.
Au revoir, monsieur !
Elle le conduit jusqu’à la porte et la referme. Elle est debout contre la porte, comme une femme désespérée, puis elle revient à pas pressés jusqu’au fauteuil où elle tombe accablée. Elle fond en larmes, elle a des spasmes de douleur... Au bout d’un instant, la porte s’ouvre et Jules entre.
JULES, stupéfait.
Qu’est-ce que tu as ?... Qu’est-ce qui t’arrive ?...
Elle se met à pleurer sans répondre.
Mais qu’est-ce que tu as ?...
Il s’approche d’elle. Elle lui prend la main, pose son front contre le dos de cette main et se met à sangloter nerveusement.
JULIETTE.
Pardon ! Pardon !
JULES.
Qu’est-ce qui s’est passé, Juliette ?...
JULIETTE.
Je ne peux pas te le dire... Je ne peux pas te le dire...
Jules regarde autour de lui d’un air égaré, puis il a l’air de faire une supposition qu’il écarte.
JULES.
Ce n’est pas possible !... Ce n’est pas possible... tu ne m’as pas...
D’une voix blanche.
trompé ?... Dis, Juliette ?... Ce n’est pas possible !... Ce n’est pas possible... tu ne m’as pas trompé ?...
Elle incline simplement la tête. À voix basse.
Ce n’est pas possible !... Ce n’est pas possible...
Comme à lui-même.
Elle m’a trompé... Elle m’a trompé... avec
À elle et pressant.
avec ce petit...
Elle incline la tête. Jules, lui lâchant la main.
Où est-il ?...
JULIETTE.
Oh ! il n’est pas dans la ville, il est loin d’ici...
Haussant les épaules.
Et puis, qu’est-ce que vous lui diriez ?...
JULES, d’un ton décidé.
Ce que je lui dirais !...
JULIETTE.
À quoi ça avancerait-il, ce que vous lui diriez ?... D’abord, c’est moi qui suis coupable... C’est moi, c’est moi qui n’aurais pas dû... Il ne vous est rien, lui... C’est à peine s’il vous connaît. Moi, je suis votre femme, il n’y a que moi de coupable là-dedans !...
JULES, tomba assis sur une chaise ; comme à lui-même.
Oh ! J’étais loin de ça !... Oh ! j’étais loin de ça !... Comment pouvais-je supposer une chose pareille ?... Oui, j’aurais dû faire attention... Mais, pour faire attention, il faut se méfier d’abord, et j’étais à cent lieues de m’imaginer... de m’imaginer... Je sais bien ce que c’est que les femmes... les autres femmes... Est-ce que je pouvais attendre cela... de Juliette ! Juliette !... Il me semblait qu’elle n’était pas comme les autres...
JULIETTE.
Je vous demande pardon !...
Silence assez prolongé. Elle répète.
Je vous demande pardon...
JULES, répétant.
Pardon...
Il lève les épaules.
Pardon... À quoi ça m’avance-t-il ?... Tout est perdu maintenant, tout est perdu !... Qu’est-ce que j’ai maintenant dans l’existence ?...
JULIETTE.
Je l’ai abîmée, c’est moi qui l’ai abîmée, mais je n’y resterai pas. Vous reprendrez votre liberté...
JULES.
Je sais bien...
JULIETTE.
Nous divorcerons...
Silence.
Nous divorcerons...
JULES.
Divorcer ?... Il faudra que nous divorcions ?... Nous allons divorcer après trois semaines de mariage !... Nous n’avions pas besoin de ce scandale-là... C’est affreux, les choses qui peuvent arriver du jour au lendemain !... Mais qu’est-ce que c’est que ce petit rien du tout... avec son uniforme de soldat ?... C’est du propre !
JULIETTE.
Mais puisque je vous dis que c’est de ma faute à moi, c’est de ma faute !
JULES, sans l’écouter.
C’est un bandit que cet être-là...
JULIETTE.
Non ! Non ! Il ne faut pas dire cela... Il souffrait beaucoup de cette situation fausse... C’est un jeune homme qui n’a pas de famille, qui se trouve seul dans l’existence...
JULES.
Moi aussi, je suis seul dans l’existence.
JULIETTE.
C’est pour vous dire que, s’il s’est approché de moi, ce n’est pas d’abord avec les idées que vous pensez... Il m’a raconté sa vie qui était pitoyable... Je vous demande pardon de vous dire cela, mais j’ai eu beaucoup de sympathie pour lui... Pourquoi ne l’ai-je pas connu plus tôt... C’est un jeune homme avec qui j’aurais fait ma vie et je n’aurais pas abîmé la vôtre... Il souffrait surtout de ne pouvoir m’aimer librement... Mais il a pour moi un sentiment très sincère... Ce n’est pas l’homme que vous croyez... Je vous répète qu’il avait en horreur cette situation irrégulière... Il est comme moi, il déteste mentir...
JULES.
Eh bien ! quoi ? Il a l’intention de vous épouser ?...
JULIETTE.
Il m’épousera certainement. Je sais bien que ça ne fera aucun plaisir à mon père et à ma mère, car il n’a pour le moment aucune situation... Mais on peut avoir confiance dans son intelligence pour s’en créer une... Il a fait des études d’ingénieur et il est très sérieux...
JULES.
Alors, en rentrant à Paris, il faudra annoncer à votre père et à votre mère que nous divorçons ?...
JULIETTE.
Oui, et j’en ai d’avance une grande appréhension...
Silence.
Écoutez, nous ne sommes peut-être pas obligés de leur dire cela tout de suite, tout de suite... Ce que je vous demande, mon ami, si vous voulez bien y consentir, c’est de me garder encore quelque temps... Pas longtemps... une quinzaine de jours, afin que nous puissions chercher ensemble un moyen de leur annoncer cela et que ce ne soit pas trop pénible pour eux...
Silence.
JULES.
Oh ! je n’ai pas de chance, vous savez, je n’ai pas de chance... Je n’ai jamais eu de chance dans la vie... Je ne parle pas des affaires, car les affaires, ça a toujours bien tourné, mais, au fond, personne n’a jamais eu d’affection pour moi...
JULIETTE.
Vous n’aviez pas l’air d’en demander...
JULES.
Je sais bien. Je suis comme ça... Je ne demande pas d’affection aux gens... Alors, ils ne pensent pas à m’en donner. Chez mes parents, nous étions quatre enfants, j’étais le deuxième... On s’occupait surtout de l’aîné et puis des plus petits. Moi, je ne comptais guère... Plus tard, quand on a vu que je réussissais dans les affaires, on a commencé à faire attention à moi... Mais je n’accuse pas mes parents, c’est de ma faute... Vous savez, je ne parle pas aux gens... à vous, je me rends compte que je ne vous parlais pas beaucoup...
Silence.
C’est la première fois que nous parlons aussi longtemps.
JULIETTE.
C’est la première fois que nous avons un sujet de conversation...
Silence.
Vous m’en voulez beaucoup ?...
JULES.
Je ne sais pas. Je ne peux même pas dire que je vous en veux... Évidemment, vous m’avez fait beaucoup de mal, vous n’avez pas pensé que j’existais.
JULIETTE.
Oh ! je vous demande pardon.
JULES.
Oh ! oui, pourquoi voulez-vous que je ne vous pardonne pas !... Que je vous pardonne ou non, ça n’avance à rien. Je suis malheureux, voilà tout.
JULIETTE, avec un mouvement pour aller vers lui, mais elle s’arrête.
Mon pauvre Jules...
JULES.
Vous voyez, aujourd’hui, je rentrais content... Mon affaire a l’air de s’arranger de la façon la plus brillante... J’aurai certainement la commande des deux usines de Vieufontaine... Ça me faisait plaisir tout à l’heure ; maintenant, je n’en ai aucun plaisir... Je n’aurai plus jamais de plaisir à rien du tout...
JULIETTE.
Mais, enfin, vous teniez tant que cela à moi ?
JULES.
Oh ! je m’en rends compte maintenant que je tenais bien à vous ! Je m’en rendais compte avant aussi, mais j’avais peut-être le tort de ne pas vous le dire... Oh ! je vous l’ai dit... seulement, quand je vous le disais, vous ne répondiez pas... Ce n’est pas encourageant... Alors ! je ne vous le disais plus. Je ne sais pas parler, moi... Ça ne veut pas dire que je n’ai pas de sentiment... Je me dis maintenant que, lorsqu’on a du sentiment, il vaut mieux se forcer à en parler, parce que, autrement, les gens ne s’en douteront jamais.... J’ai été très heureux ces jours-ci, Juliette... Beaucoup plus même que je croyais... Maintenant, je me rends bien mieux compte du bonheur que j’ai perdu. J’étais si fier d’avoir une femme comme vous, si jolie, si élégante... de bonne famille... Il est probable que je ne le méritais pas...
Il porte malgré lui son doigt à sa paupière.
JULIETTE.
Mais si, vous le méritiez, mais je ne me doutais pas que vous le méritiez... Je sais depuis un instant que vous êtes très bon et très sensible...
JULES.
Je ne suis pas méchant.
Il essuie rapidement une larme.
JULIETTE.
Comme je sens maintenant le tort que j’ai vis-à-vis de vous !...
JULES.
Mais je vous dis qu’il y a beaucoup de ma faute là dedans... Je ne sais pas me montrer comme je suis. Les gens n’ont aucune idée que je peux m’attendrir... Quand j’ai perdu ma maman, c’est moi qui, de tous ses fils, pleurais le plus à la maison. Et les gens de ma famille me regardaient avec étonnement. Ils ne s’imaginaient pas que je pouvais éprouver autant de douleur... Moi, je ne m’en rends pas compte non plus, d’ailleurs, en temps ordinaire... Il faut un coup de chien comme ça pour que je m’en aperçoive...
JULIETTE, après un silence.
Eh bien ! on va divorcer...
JULES, après un silence.
Oui, il me semble qu’il faut divorcer...
JULIETTE.
On ne peut guère faire autrement. Nous rentrerons à Paris demain... Nous rentrerons comme si rien ne s’était passé. Dans quelques jours, je tâcherai de parler à maman... pas à mon père parce que je n’oserais pas... Il faudra que ce soit ma pauvre maman qui lui dise cela... Quelle peine ils vont avoir !...
JULES.
Oh ! oui, quelle peine !... Ils auront de la peine aussi... Les choses étaient si bien arrangées !... Tout le monde nous croyait si heureux !... Qu’est-ce que les gens vont dire en apprenant cette chose-là ?...
JULIETTE.
Ils ne sauront pas pourquoi on divorce.
JULES.
Alors, ils ne comprendront pas... Ils vont essayer de nous remettre ensemble...
JULIETTE.
Eh bien ! on résistera. On dira qu’on ne s’entend pas... On ne leur dira pas la vérité.
JULES.
Oh ! je ne tiens pas qu’on la leur dise !
Silence.
JULIETTE.
Ça me fait une grande peine que vous soyez malheureux... Désormais, dans la vie, je ferai mon possible pour que vous soyez heureux... Jules, je vous trouverai une femme qui vaudra mieux que moi.
JULES.
Oh ! il n’est plus question de refaire ma vie !
JULIETTE.
Mais il ne faut pas dire cela !
JULES.
Je tenais à vous... Je ne veux plus recommencer à tenir à une autre femme... Je ne pourrais plus... Je tenais beaucoup à vous, Juliette !
JULIETTE.
Je ne savais pas.
JULES.
C’est de ma faute ! C’est de ma faute !
JULIETTE.
En rentrant à Paris, je reviens toujours à mon idée : il faudra faire en sorte qu’on ne se doute de rien pendant quelque temps. Ainsi, il faudra que vous me disiez « tu » de nouveau, parce qu’en partant, le jour où nous avons déjeuné chez mes parents, vous me disiez « tu »... Et on se demandera pourquoi vous ne me tutoyez plus.
JULES.
J’aime autant vous tutoyer.
JULIETTE.
Malgré ce que je vous ai fait ?
JULES.
Ça ne m’empêche pas de tenir à vous...
D’un ton décidé.
À toi...
Il répète.
À toi !... C’est curieux, ça me soulage de dire « à toi » et, en même temps, ça me fait plus de mal... Parce que ça nous attache tous les deux et je sens davantage...
Il cherche le mot.
JULIETTE.
Vous sentez davantage le mal que je vous ai fait.
JULES.
Ce n’est pas cela que j’ai voulu dire...
JULIETTE.
C’est cela qui est vrai.
Silence.
JULES.
Si je vous tutoie, il faudra que je vous demande de me tutoyer aussi, comme vous avez fait ces jours-ci... Ça me fera mal, mais tout de même, quand vous me tutoyez, je me sens moins seul dans la vie.
JULIETTE.
Oui. Je vous...
Elle se reprend.
Je te tutoierai... parce que je veux te marquer la grande affection que j’ai pour toi.
JULES.
Merci, c’est très doux que tu me tutoies, bien que je me sente très malheureux...
Silence. Au bout d’un instant, il se lève.
Écoute, ne restons pas ici, maintenant... Si tu veux, nous allons sortir un peu... Il faut rester le moins possible dans cet hôtel.
JULIETTE.
Demain, nous serons à Paris.
JULES.
Sortons maintenant... Allons un peu en dehors de la ville... où l’on s’est assis hier soir... Tu te rappelles ?... Sur ce banc près du canal... On ne se parlait pas. Je ne me doutais pas, vraiment, à quoi tu pensais...
Confuse, elle ferme les yeux. Silence. Brusquement.
Allons, sortons... Emporte ta petite cape, il fait un peu frais dehors.
Il l’aide à mettre sa cape.
JULIETTE.
Mets ton pardessus.
JULES.
Oh ! moi, je n’ai jamais froid.
JULIETTE.
Si, si, je veux que tu l’emportes... Je le prends...
Elle prend le pardessus qui était sur un fauteuil et l’emporte sur son bras. Elle sort, suivie de Jules.
ACTE III
Le salon des Moreille.
Au lever du rideau, Madame Moreille et Catherine sont en train de causer.
CATHERINE.
J’ai téléphoné tout à l’heure chez vous, vers quatre heures, il y a environ une heure. J’arrivais de Bruxelles, où j’étais allée voir ma belle-sœur qui vient de faire ses couches et on me dit que Juliette est rentrée.
MADAME MOREILLE.
Mais oui, ils sont rentrés depuis douze jours environ.
CATHERINE.
Alors, ils habitent ici ?
MADAME MOREILLE.
Ils habitent ici provisoirement. Ils ont loué un appartement rue de Passy. Jules avait justement rendez-vous aujourd’hui avec le peintre... Quant à Juliette, elle doit être maintenant chez le tapissier, mais elle ne va pas tarder à venir, car elle a dit qu’elle rentrerait vers cinq heures et il n’en est pas loin.
CATHERINE.
Il est cinq heures. Et ça s’est bien passé, ce voyage de noces ?
MADAME MOREILLE.
Oh ! très bien, je crois. C’est un très gentil garçon, vous savez. Au point de vue mondain, ce n’est évidemment pas l’idéal, mais c’est un homme tellement sérieux et tellement raisonnable et intelligent en affaires !... Catherine, votre mari n’est pas ici ?
CATHERINE.
Mais non. Il est toujours au Sénégal. Je ne crois pas qu’il rentre avant six semaines.
MADAME MOREILLE.
Eh bien ! puisque vous êtes garçon, vous allez dîner avec nous ce soir.
CATHERINE.
J’ai l’air d’être venue là exprès pour ça.
MADAME MOREILLE.
Je crois bien !
Elle va vers la porte.
Irma !
CATHERINE.
Mais vous n’allez pas faire un dîner exprès pour moi !
MADAME MOREILLE.
Oh ! vous pensez, nous sommes déjà six... Irma, nous dînons tous les quatre, monsieur et madame Jules. Mon cousin, monsieur Lebleu, vient également, et alors madame Sorlon.
IRMA.
Et monsieur Julien Méraud dîne aussi, madame me l’a dit tout à l’heure.
MADAME MOREILLE, un peu froidement.
Oui, je sais.
Sort Irma.
CATHERINE.
Qui est-ce, monsieur Méraud ?
MADAME MOREILLE.
C’est un jeune homme dont ils ont fait connaissance au cours de leur voyage de noces.
Avec un besoin visible de changer la conversation.
Et vous avez de bonnes nouvelles de votre mari ?
CATHERINE.
Très bonnes, très bonnes.
MADAME MOREILLE.
Tenez, je crois que voilà Juliette qui rentre.
CATHERINE, se levant.
Oh ! ça me fait plaisir de la voir.
Entre Juliette. Catherine et Juliette s’embrassent.
Oh ! ma chérie, j’ai trouvé le temps bien long après toi !
JULIETTE.
Et moi donc !
MADAME MOREILLE.
Mes enfants, je vous laisse à vos épanchements... Juliette, ton amie dîne ici.
JULIETTE.
Je pense bien. Il ne manquerait plus que ça !
Exit Madame Moreille.
CATHERINE.
Eh bien ! dis donc, j’en apprends de belles !... Qu’est-ce que c’est que ce jeune homme, ce monsieur Julien dont vous avez fait connaissance en voyage ?
JULIETTE.
Ah ! voilà !...
D’un ton dégagé.
Eh bien ! c’est mon flirt !
CATHERINE.
Ton flirt... rien que ça ?
JULIETTE.
Tu es folle ! C’est un jeune aviateur que nous avons rencontré dans une ville du Midi... Nous avons été bloqués pour une affaire de Jules qui n’aboutissait pas...
CATHERINE.
Voyez-vous cela ! Et, pendant que monsieur allait à ses affaires, madame se distrayait avec ce jeune aviateur !
JULIETTE.
Tu es bête ! C’est un jeune homme très sérieux.
CATHERINE.
Je pense bien, d’ailleurs, que, si tu trompes ton mari, ça ne sera pas dans le premier mois de ton mariage.
JULIETTE.
Oh ! ça ne serait pas une raison. Suppose que j’aie eu le coup de foudre...
CATHERINE, qui ne croit pas à l’importance de ce qu’on vient de dire.
Et alors, raconte-moi tout ton voyage. Vous êtes allés sur la Côte d’Azur ?... As-tu bien dansé ?
JULIETTE.
Un peu, un peu...
Silence.
Écoute, Catherine, tu es trop mon amie pour que je te cache quelque chose... Il s’est passé dans ma vie... un événement... très grave.
CATHERINE.
Très grave ?... Avec ce jeune homme ?
JULIETTE, gravement.
Oui.
CATHERINE la regarde, étonnée.
Enfin, quoi ? tu n’as pas été sa maîtresse ?
JULIETTE, gênée.
Non, non... Comme tu y vas !
Silence.
Si !
CATHERINE.
Tu as été sa maîtresse ?
JULIETTE.
Je ne veux pas dire que c’est par un coup de folie... Non, tu verras ce garçon... Il avait, il a pour moi une passion profonde. Je ne crois pas qu’un homme ait pu aimer une femme avec une telle ferveur... J’ai compris que je le désespérais en lui résistant... Je ne suis pas une femme légère, tu me connais... J’aurais eu honte de moi si j’avais pu m’imaginer que je cédais à un entraînement des sens. Mais il était tellement malheureux ! Il m’a semblé un jour que, du moment que je l’avais rendu malheureux à ce point, je n’avais pas le droit de me refuser à lui.
CATHERINE.
Je suis stupéfaite de ce que tu me dis là !... Toi, Juliette, toi !
JULIETTE.
Écoute, ma petite, je ne suis pas la seule tout de même. Et si j’ai cru devoir te faire cette confidence, c’est que toi-même tu t’étais confiée à moi jadis.
CATHERINE, qui ne tient pas à ce qu’on remue ses souvenirs.
Oh ! moi, c’est de la vieille histoire.
JULIETTE.
Ce n’était pas une vieille histoire le jour où tu me l’as racontée... D’après ce que j’ai cru comprendre, il y a un mois encore, ça durait toujours...
CATHERINE.
Ça dure toujours, ça dure toujours... Mais ça n’a plus le même caractère... J’aime beaucoup mon mari, je l’aime profondément, et j’ai eu une grande peine quand je l’ai trompé. Maintenant, ça continue, évidemment, mais je n’ai plus l’impression que c’est la même chose et que je lui suis infidèle. C’est entré dans le traintrain de la vie. Je ne vois... l’autre que très rarement.
JULIETTE.
Il habite Londres ?
CATHERINE.
Le mois dernier, il est venu à Paris et nous ne nous sommes pas vus. C’est-à-dire que nous avons dîné ensemble chez des amis, mais nous ne nous sommes pas vus autrement. J’avais des cousins de Suisse à la maison, il a parfaitement compris que ça ne serait pas commode et que ça me créerait des complications... Ce n’est pas qu’il tienne moins à moi, il m’est très profondément attaché. Je te dirai même que c’est à cause des sentiments qu’il a pour moi que je tiens à lui...
JULIETTE, rêveuse.
Je te comprends parfaitement.
Elle répète.
C’est surtout à cause des sentiments qu’il a pour toi que tu tiens à lui.
CATHERINE.
Et ton mari ne se doute de rien ?
JULIETTE.
Oh ! tu penses... Eh bien ! merci !
CATHERINE.
Ce n’est pas un homme qui supporterait cela facilement.
JULIETTE.
Ah ! non, certes !...
Brusquement.
Écoute, Catherine, il faut vraiment que tu sois ma seule amie pour que je te confie un secret très grave... Mais pour toi seule, entends-tu... Ne laisse rien soupçonner de ce que je vais te dire à ton mari ni à Gaston.
CATHERINE.
Cela va de soi... D’ailleurs, je ne les reverrai ni l’un ni l’autre avant deux mois.
JULIETTE.
Eh bien ! mon mari sait tout !
CATHERINE.
Il sait tout ?
JULIETTE.
Oh ! ç’a été terrible le jour où il a appris cela ! Nous étions à l’hôtel là-bas... J’étais dans un état d’énervement... parce que ce jeune homme... enfin, Julien, qui était allé pour son service du côté de Montauban, se trouvait retenu là-bas et ne pouvait pas rentrer me voir avant notre départ... Je lui en voulais beaucoup de cela. Je me demandais s’il tenait toujours à moi... J’étais malheureuse comme tout. Je ne savais pas à qui me confier. Mon mari s’est trouvé là. Moi, je ne sais pas dissimuler... tout mon secret est parti comme cela... Ce pauvre Jules a eu une douleur effroyable !... Car tu ne peux pas t’imaginer l’adoration qu’il a pour moi ! Il était non seulement atteint dans ses sentiments, dans son amour, mais aussi, je le voyais bien, dans son orgueil. Il était perdu, il ne savait pas quelle attitude il devait adopter... Je voyais qu’il souffrait aussi beaucoup de cela... Alors, je lui ai dit que nous divorcerions...
CATHERINE.
Et vous allez divorcer ?...
JULIETTE.
En principe...
Silence.
Seulement, nous avons décidé qu’il valait mieux ne pas en parler tout de suite à mes parents. Ce sera un coup abominable pour eux, tu comprends...
CATHERINE.
Ils ne se doutent pas de ce qu’il y a entre toi et ce jeune homme ?
JULIETTE.
Ils se doutent de quelque chose, car ils lui font une tête ! Seulement, ils ne savent rien de positif. Et ils n’osent pas supposer que c’est sérieux. Maman n’a jamais trompé papa ; autour d’elle, il n’y a pas eu beaucoup d’histoires pareilles. Alors, elle n’imagine pas, tu comprends, qu’on puisse tromper son mari.
CATHERINE.
C’est comme ça chez moi.
JULIETTE.
Mais même si mes parents savaient ce qu’il y a vraiment entre Julien et moi, ça leur ferait de la peine certainement, ça leur ferait même honte... Il faut dire les choses comme elles sont... mais je crois que ça les impressionnerait moins qu’un divorce. Ils sont d’une époque où l’on ne divorçait pas. Pour eux, le divorce est le plus grand scandale qui puisse arriver. Nous sentons cela, Jules et moi, et nous remettons toujours pour leur en parler.
CATHERINE.
Mais ça ne doit pas être gai pour toi s’ils font la tête à ton jeune ami...
JULIETTE.
Je me suis disputée avec maman à ce sujet. Je lui ai dit que mon mari et moi, nous voulions recevoir qui nous plaisait. Et que si ça gênait papa et maman, eh bien ! nous irions habiter à l’hôtel ! Maman et papa, c’est encore bien eux, tu les connais, ils ne pourraient pas supporter l’idée que nous soyons à l’hôtel du moment qu’ils ont de quoi nous loger. Et comme nous n’aurons pas notre appartement avant un mois...
CATHERINE.
Votre appartement ?... Mais si vous divorcez ?...
JULIETTE.
Oh ! bien, que veux-tu ? nous avions commencé tous nos préparatifs pour emménager, nous ne pouvons pas les interrompre ; on se demanderait pourquoi...
CATHERINE.
Au fond, tu ne divorceras pas.
JULIETTE.
Ne dis pas cela, c’est absolument entendu avec Jules. Ce n’est pas qu’il y tienne, c’est une idée très douloureuse pour lui.
CATHERINE.
Mais, pour toi-même, il me semble que divorcer pour épouser ce jeune homme, ce serait une catastrophe... Est-ce qu’il a une situation ?
JULIETTE.
Aucune, et, par contre (c’est l’avis absolu de papa), mon mari aura, dans très peu de temps, avec ses affaires, une situation matérielle extraordinaire. Mais ce ne sont pas ces considérations qui m’arrêtent... Tu sais que je suis tout l’opposé d’une femme intéressée. Il suffirait qu’on me dise : vous avez intérêt à ne pas divorcer pour que je divorce tout de suite. Ce qui me retient, c’est la grande pitié, vraiment, que j’ai pour mon mari. Tu verras la façon dont il me regarde... Je suis pour lui une espèce d’idole... Si j’étais une femme vaniteuse, il y aurait de quoi perdre la tête... Si tu l’entendais discuter avec le tapissier ! Quand il a dit : « Ma femme a choisi cela », il a tout dit. Et il est d’une douceur avec moi ! Il cherche tout ce qui peut m’être agréable. Tous les cadeaux qu’il m’apporte timidement... Il y a des moments où je me dis : Je ne peux pas abandonner cet homme-là.
CATHERINE.
Et ton jeune homme, qu’est-ce qu’il dit de tout cela ?
JULIETTE.
Il attend.
CATHERINE.
Il sait que ton mari est au courant ?
JULIETTE, après une hésitation.
Oui. Mais mon mari ne sait pas qu’il le sait. J’ai dit à Jules : « Je vais dire à ce jeune homme que tu sais qu’il m’aime. »
CATHERINE.
Ah ! tu dis « tu » à ton mari ?
JULIETTE.
Oui. J’avais commencé, alors, je n’ai pas voulu changer. C’est à cause de mes parents, tu comprends ?... Ils se demanderaient pourquoi. J’ai donc dit à Jules : « Je dirai à ce jeune homme que tu sais qu’il m’aime et qu’il veut m’épouser. Mais je ne lui dirai pas que tu sais tout ce qu’il y a entre nous. » Tu comprends, pour la dignité de Jules, il valait mieux qu’il ne fût pas, devant Julien, censé savoir cela. Seulement, j’ai tout de même dit à Julien que Jules savait absolument tout. Mais je lui ai bien recommandé, à Julien, de ne pas avoir l’air de savoir que Jules était au courant.
CATHERINE.
Comment fais-tu pour t’y reconnaître là dedans ?
JULIETTE.
C’est plus simple que ça en a l’air. Il n’y a qu’à en parler le moins possible pour ne pas se couper.
CATHERINE.
Et tu continues... à voir ce jeune homme en dehors de chez toi ?
JULIETTE.
Oui. Mais cela, mon mari ne le sait pas. Parce que je lui ai juré que je ne reverrais pas Julien de cette façon-là avant notre divorce. Et puis, ça se passe si rarement !... Julien a loué un petit appartement meublé. Je n’ai pas voulu qu’il fasse de grandes dépenses parce qu’il n’en a pas le moyen et j’ai demandé que ça soit dans un quartier assez éloigné d’ici. Alors, la maison ne me plaît pas. Il y a un emballeur, il y a un marchand de fromages... J’ai horreur d’aller là. Une fois que j’y suis, que j’ai monté les deux étages, je suis contente d’être avec Julien, bien que, tu sais, on se dispute très souvent... Mais régulièrement, quand je dois aller là-bas, je suis malheureuse toute la matinée. S’il avait le téléphone, je lui donnerais des contre-ordres tout le temps. Aussi, quand il me téléphone d’un bureau de poste pour me demander si le rendez-vous tient, je suis ravie de lui dire que j’ai un empêchement. Mais, dans ces cas, je suis obligée de lui demander de venir dîner le soir. Ce qui me vaut une tête de maman ! C’est insupportable !
CATHERINE.
Ah ! oui, les parents ne se gênent pas ! En admettant que ça lui soit désagréable de voir ce jeune homme ici, ta mère devrait être assez gentille pour ne pas le montrer.
JULIETTE.
J’ai fini par dire à maman que monsieur Julien Méraud allait partir en voyage pendant quelque temps. Et je voudrais même qu’il s’en aille un peu pendant toute cette période. Il est en congé et, en attendant sa démobilisation, il a trouvé une place d’ingénieur à Levallois. Mais ce n’est pas grand-chose, et il ne gagnerait vraiment sa vie que s’il s’éloignait un peu de Paris.
CATHERINE.
Mais quelles sont leurs attitudes, à ton mari et à lui quand ils sont ensemble ?
JULIETTE.
Ils sont polis l’un pour l’autre, ni trop chauds ni trop froids. C’est curieux : mon mari, qui a des raisons de lui en vouloir, ne le déteste pas. Lui, Julien, supporte très bien Jules. Comme caractère, comme éducation, ils ne sont pas du tout faits pour s’entendre. Il n’y a qu’un point qui les rapproche : ils m’aiment bien tous les deux.
CATHERINE.
Eh bien ! mon chéri, maintenant que je suis au courant de tout cela, je verrai avec une certaine curiosité Julien Méraud.
JULIETTE.
Il est très bien.
CATHERINE.
Écoute : si nous nous trouvons seuls, lui et moi, je n’aurai pas l’air de savoir, je ne dirai pas que tu m’as raconté...
JULIETTE.
Non, je crois qu’il vaut mieux que je ne t’aie rien dit.
CATHERINE.
Je vais rentrer chez moi pour écrire à mon mari, puis je reviendrai tout à l’heure pour dîner.
JULIETTE.
Pourquoi rentres-tu chez toi ?... Tu peux aussi bien écrire ici. On fera porter ta lettre à la poste.
CATHERINE.
J’avais affaire chez moi, mais, enfin, ça peut se remettre.
JULIETTE.
Viens par là, tu vas écrire dans ma chambre, il y a tout ce qu’il faut.
Elle ouvre la porte.
Tiens, maman était justement en train d’écrire aussi.
CATHERINE.
J’attendrai que ta mère ait fini...
MADAME MOREILLE, apparaissant à la porte.
Non, je n’écris pas de lettres, je faisais des comptes. Catherine, installez-vous !...
Catherine sort.
MADAME MOREILLE, à Juliette.
Eh bien ! j’espère que vous en aviez des choses à vous dire...
JULIETTE.
Qu’est-ce que tu veux ! On ne s’était pas vues depuis longtemps...
MADAME MOREILLE, tout en tournant le dos à Juliette et en rangeant un guéridon.
Oui !
Juliette la regarde en faisant un signe d’agacement. On frappe.
Qu’est-ce que c’est ?
LA BONNE, entrant.
Madame, c’est monsieur Méraud, il est dans le bureau de monsieur. Je ne savais pas si je devais le faire entrer ici.
MADAME MOREILLE.
Bien. Qu’il attende un peu.
Sort la bonne.
Il n’est pas en retard... Il est six heures à peine et l’on ne dîne qu’à huit heures...
JULIETTE.
Maman, je t’en prie !... Je t’ai déjà dit que si ça te déplaisait que nous recevions nos amis comme bon nous semble...
MADAME MOREILLE.
Tu irais à l’hôtel, c’est entendu. Comme c’est gentil de me dire ça à tout bout de champ !... Il me semble que j’ai bien le droit de te faire une petite observation. Je suis persuadée que tu es une femme sérieuse, mais c’est pour les gens d’ici, les domestiques... Quand ils voient venir un jeune homme comme ça tout le temps dans la maison, tu penses s’ils se gênent pour faire des bavardages !
JULIETTE, impatientée.
Eh bien ! ils font des bavardages... S’il faut se priver de recevoir ses amis à cause des bavardages des domestiques !... Ce jeune homme a à me parler. Il vient avant le dîner, je ne vois pas ce qu’il y a d’extraordinaire...
MADAME MOREILLE.
Fais comme tu voudras, mon enfant.
Elle rentre dans sa chambre.
JULIETTE, seule.
Ah ! c’est agaçant ! c’est agaçant !
Elle sonne et marche avec agitation.
LA BONNE, ouvrant la porte.
C’est pour faire entrer monsieur Méraud ?
JULIETTE.
Oui.
LA BONNE.
Le voici, madame, j’ai pensé que c’était pour ça et j’ai été le prévenir...
Elle s’efface pour laisser entrer Julien et sort.
JULIEN, se dirigeant vers Juliette.
Juliette !
Elle l’arrête de la main.
JULIETTE, à mi-voix.
Faites attention, je vous en prie. Il y a du monde dans tout l’appartement... D’abord, vous venez beaucoup trop tôt... Vous devez venir dîner à huit heures et vous venez à six heures... De quoi ça a-t-il l’air ?...
JULIEN.
Mais, ma chérie...
Sur un coup d’œil de Juliette il se reprend.
Mais, Juliette, il y a deux jours que je ne vous ai vue...
JULIETTE.
Eh bien ! il faut faire attention tout de même... Il ne faut pas penser qu’à vous... Si vous croyez que de vous voir venir et me parler seul à seule comme ça, ça ne fait pas bavarder les domestiques !...
JULIEN, timidement.
Alors, pour ne pas faire bavarder les domestiques, vous préférez que je me prive de vous voir ?...
JULIETTE.
Il faut faire certains sacrifices. Je viens de me disputer avec maman à cause de vous. Et je trouve qu’elle a tout à fait raison... Il faut s’astreindre à prendre des précautions, que voulez-vous ? et ne pas compromettre les gens... Je vais vous présenter à ma meilleure amie Catherine, dont je vous ai parlé... Tâchez de vous tenir convenablement et de ne pas me dévorer des yeux comme vous le faites.
JULIEN.
Mais vous ne vous doutez pas du supplice que j’endure à être séparé de vous...
JULIETTE.
Maîtrisez-vous tout de même et pensez à ma réputation...
Elle va à la porte.
Catherine !...
Voix de CATHERINE, à la cantonade.
Qu’est-ce qu’il y a ?
JULIETTE.
Tu as fini d’écrire ?...
CATHERINE.
Tout de suite !
JULIETTE.
Je voudrais te présenter quelqu’un !
CATHERINE.
Voilà !
Juliette fait signe à Julien qu’il doit être discret. Julien fait signe qu’il comprend. Catherine apparaît un instant après.
JULIETTE.
Voici monsieur Méraud, dont nous avons fait connaissance en voyage... Madame Sorlon, ma meilleure amie...
CATHERINE.
Monsieur... Monsieur est aviateur, m’a dit mon amie Juliette.
JULIEN.
Oui, madame. Maintenant, je suis en congé, je vais d’ailleurs être démobilisé d’ici peu. Je suis ingénieur dans une usine à Levallois.
JULIETTE.
Si l’on s’asseyait...
Ils s’assoient tous les trois.
CATHERINE.
Et vous avez beaucoup à travailler ?
JULIEN.
Pas trop, madame, pas trop.
JULIETTE.
Oh ! que c’est insupportable, cette conversation !...
À Julien.
Mon amie Catherine est au courant de tout.
Julien la regarde, ne sachant que dire.
Oui, elle est au courant de tout. Elle sait ce qu’il y a entre nous. Elle sait que nous devons nous épouser... un jour... Je lui ai tout dit, entendez-vous ?
Silence.
CATHERINE.
Si tu crois que nous sommes moins gênés après ce que tu viens de nous dire là !...
JULIETTE.
Moi, j’ai horreur des cachotteries...
On frappe à la porte.
Qu’est-ce que c’est ?
LA BONNE.
Madame, monsieur vient de rentrer avec un clerc de notaire. Il a dit comme ça que madame vienne dans son bureau. Que c’est pour signer l’acte de la vente de l’appartement.
JULIETTE.
Ah ! Oui. Eh bien ! je vais m’occuper de ces formalités...
À ce moment, entre Jules.
JULES.
Tu viens ?...
Voyant qu’il y a du monde.
Oh ! je vous demande pardon !...
Voyant Catherine.
Tiens, mais c’est madame Sorlon ! Bonjour, madame Sorlon ! Mais vous voilà de retour ?... Eh bien ! Juliette n’en est pas fâchée, je suis sûr.
Il serre négligemment la main de Julien.
Bonjour, Méraud...
À Juliette.
Mon petit, je te demande pardon de t’enlever à ton amie, mais le principal clerc de notaire est là, avec l’acte de vente de l’appartement. Il doit nous le lire et nous le faire signer... D’ailleurs, si ça t’ennuie de l’écouter, tu pourras venir le signer simplement tout à l’heure.
JULIETTE.
Oh ! mais ça ne m’ennuie pas de l’écouter.
JULES.
C’est assez long, tu sais.
JULIETTE.
Ça ne fait rien.
JULES, à Catherine.
Vous savez que ça devient tout à fait une femme d’affaires... L’autre jour, chez le notaire, quand on faisait le projet d’acte, elle nous a fait une observation très juste...
JULIETTE.
Oh ! je crois bien... Il y a un grand mérite à cela. C’était simplement une chose de bon sens...
JULES.
Alors, tu viens, mon petit ?
JULIETTE.
Je viens.
Il la fait passer devant lui et sort.
CATHERINE.
Ils signent la vente de leur appartement ?...
JULIEN.
Oui. Et pourtant vous savez nos projets, puisque Juliette m’a dit que vous étiez au courant. Ils prétendent que, s’ils changeaient les dispositions qu’ils ont prises avant de partir, monsieur et madame Moreille se demanderaient pourquoi et se douteraient de quelque chose...
CATHERINE.
Il faudra tout de même qu’ils finissent par s’en douter.
JULIEN.
Évidemment. C’est un peu ce que je pensais. Mais je n’ose pas faire d’observations à votre amie. Elle a l’air de dire que ça ne me regarde pas...
CATHERINE, après un silence.
Évidemment, le jour où vous lui avez parlé pour la première fois, vous ne vous doutiez pas de la responsabilité que vous alliez encourir... en la détournant, comme on dit, de ses devoirs... Maintenant que le divorce est entré dans nos mœurs, au moment de faire la cour à une jeune femme honnête, un jeune homme bien élevé doit penser à ses responsabilités... comme s’il entrait en ménage. C’est pour cette raison qu’il y en a qui laissent les honnêtes femmes tranquilles et qui ne s’adressent qu’à des femmes mariées qui n’en sont plus à leurs débuts et qu’ils ne seront probablement pas forcés d’épouser.
JULIEN.
Oui ! Oui !
Après un silence.
Je dois vous dire, madame, que je n’ai pas du tout songé à cela. J’ai été porté naturellement vers votre amie par un sentiment très vif, je vous dirai même très grand. Je l’ai entraînée dans cette aventure, je puis dire, presque sans le vouloir. Il y avait quelque chose en moi de plus puissant qui le voulait...
CATHERINE, après un silence.
Vous êtes un garçon très généreux et très exalté. Est-ce que vous n’avez pas l’impression que Juliette est plus raisonnable que vous ?...
JULIEN.
Oh ! si, j’ai cette impression ! Et je ne dirai pas que je n’en ai pas souffert...
CATHERINE.
Juliette n’est pas une femme qui calcule, ce n’est pas du tout ce que je veux dire. Mais elle est très raisonnable. Elle peut parfaitement se lancer dans une aventure... Mais, après, elle réfléchit.
JULIEN.
Est-ce qu’elle vous a dit quelque chose ?
CATHERINE.
Oh ! rien de tout cela.
JULIEN.
Vous n’avez pas eu l’impression qu’elle tenait moins à moi...
CATHERINE.
Oh ! pas du tout... voyons !
JULIEN.
Je suis heureux que vous n’ayez pas eu cette impression, parce que, moi, je vous dirai que je l’ai eue. Il me semble, mais j’espère que je me trompe, que chaque jour elle se rapproche davantage de son mari... Je me dis que je me trompe, mais j’ai peur de ne pas me tromper... Qu’est-ce que vous voulez ! elle a beaucoup de sagesse. Et la sagesse lui dit qu’il vaut mieux rester avec cet homme qui a une situation considérable que de mener, avec moi, une vie peut-être difficile. Et je vous dirai même qu’à certains moments, je me demande si j’ai le droit de lui imposer une existence médiocre, alors que, pour la supporter, il n’y a pas en elle...
Il se cache les yeux et dit à mi-voix.
il n’y a pas en elle assez d’amour.
Silence.
CATHERINE.
Vous êtes un brave garçon, monsieur Méraud.
JULIEN.
Je le crois, madame.
CATHERINE.
Je vous comprends très bien.
JULIEN.
Je vous remercie.
CATHERINE.
J’aime beaucoup Juliette, elle est pleine de qualités... Mais ce n’est peut-être pas la femme que, pour votre bonheur, vous auriez dû rencontrer...
JULIEN.
Qu’est-ce qu’il faut que je fasse, madame ?
Catherine fait un geste évasif. On a l’impression qu’elle n’ose pas lui donner le conseil qu’elle voudrait.
Faut-il que je m’en aille ?
CATHERINE.
Mais non, je ne dis pas ça, monsieur Julien. Ça serait un coup de tête. Et vous seriez peut-être très malheureux après...
JULIEN.
J’en ai peur. J’ai été attiré par votre amie, non pas seulement à cause de son charme, mais aussi parce que j’étais dans la solitude... Je suis à peu près seul au monde et j’étais tellement heureux de trouver une amie !...
CATHERINE.
Évidemment, si vous partiez brusquement, ce serait une espèce de suicide. Il faudrait peut-être vous éloigner pour attendre les événements. En ce moment, votre situation à tous est très délicate. On n’a pas l’air très gentil pour vous dans cette maison... Je parle des parents de Juliette.
JULIEN.
Oh ! non, je ne dirai pas qu’ils me le font sentir, mais ils ne font pas de grands efforts pour me le cacher.
CATHERINE.
Évidemment, si vous vous éloigniez pendant quelque temps, ce serait peut-être le parti le plus sage... Mais vous ne savez peut-être pas où aller ?
JULIEN.
On m’a parlé d’autres situations qui seraient plus avantageuses pour moi que ma position actuelle, mais je n’ai pas eu de proposition ferme et je ne sais pas si je trouverais de quoi m’occuper du jour au lendemain...
CATHERINE.
Ça ne vous ferait pas peur d’aller un peu loin ?
JULIEN.
Oh ! j’irais n’importe où, vous savez. J’irais le plus loin possible.
CATHERINE.
Mon mari a, au Sénégal, une grande exploitation. On a découvert là-bas du minerai et c’est une très belle affaire. Je sais qu’il manque de personnel pour l’exploiter. Il y a là un ingénieur qui n’est pas extrêmement capable, et je crois qu’un jeune homme comme vous ne perdrait pas son temps à aller là-bas. D’ailleurs, il ne s’agirait pas de partir sans savoir exactement ce que vous feriez. Mon mari a un associé à Paris, je peux le voir demain. Il ne regardera pas à câbler là-bas et nous pourrons avoir la réponse tout de suite, c’est-à-dire avant trois jours. Vous n’êtes pas lié par un contrat à Levallois ?
JULIEN.
Si, mais je pourrai me dégager très facilement. J’ai un petit dédit, mais qui est assez faible.
CATHERINE.
Et la Société de mon mari pourrait vous le payer... Voulez-vous que nous essayions cela ?
Silence.
Je vois que c’est assez dur pour vous de prendre cette résolution, mais, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de ne pas vous torturer à réfléchir. Moi qui suis en dehors de la question et qui regarde les choses froidement, il me semble qu’il n’y a pas d’autre parti à prendre.
JULIEN, regardant sa montre.
Madame, savez-vous ce que je vais faire ?... Je vais faire un saut jusque chez moi... J’ai mon contrat à la maison et je verrai exactement dans quelles conditions je puis rompre mes engagements.
CATHERINE.
Faites ça, faites ça tout de suite. Comme nous dînons ensemble ici, nous trouverons bien un petit moment pour parler de la chose.
JULIEN.
Eh bien ! je vais tout de suite chez moi et je reviens.
Il s’approche de Catherine et lui baise la main.
Je ne puis pas vous dire, madame, à quel point je vous suis reconnaissant de m’avoir écouté...
CATHERINE.
C’est dans l’intérêt de tout le monde.
Il sort. Elle reste assise à sa place et paraît très songeuse. Un instant après, entre Lebleu.
LEBLEU.
Tiens ! madame Sorlon ! Comment allez-vous, madame Sorlon ?... Vous voilà de retour ?
CATHERINE.
Bonjour, monsieur Lebleu !
LEBLEU.
Je sais déjà que nous devons dîner ensemble en famille. En famille !... Vous savez que la famille s’est augmentée ?
CATHERINE.
Comment, la famille s’est augmentée ?
LEBLEU.
Avec ça que vous ne le savez pas ! Je viens de croiser dans l’antichambre un nouveau membre de la famille.
CATHERINE.
Jules ?
LEBLEU.
Non, je ne parle pas de lui ; celui-là était déjà incorporé il y a un mois... Non, je veux parler de la nouvelle et charmante recrue. Ce petit aviateur...
CATHERINE.
Oh ! mais vous êtes très bavard et très indiscret, monsieur Lebleu !
LEBLEU.
Je suppose que vous avez déjà vu votre amie. Si vous ne l’avez pas vue ou si, l’ayant vue, elle ne vous a rien dit, vous ne tarderez pas à être au courant après un séjour très court dans cet intérieur paisible... Mais tout le monde est au courant, ici... même les domestiques... surtout les domestiques. Mes cousins Moreille ne veulent pas croire à ce qui est, parce que ce sont des gens pour qui la vérité serait très désagréable à apprendre... Alors, ils se cachent les yeux pour ne pas voir la vérité... Ils remarquent bien qu’il y a un petit jeune homme qui s’est introduit dans le ménage, mais ils croient que c’est en tout bien tout honneur... Moi, j’ai d’autres sentiments là- dessus. Je sais qu’il y a des mariages blancs, mais je ne crois pas beaucoup aux adultères blancs.
CATHERINE.
Oh ! vous êtes insupportable, monsieur Lebleu !
LEBLEU.
Oui, je suis trop cru... Mais je vous parle de cela comme ça parce que vous êtes de la maison. Je sais que vous aimez Juliette comme vous aimez les Moreille, comme je les aime, moi, car, au fond, ce sont les seules gens à qui me rattachent des liens de famille et même d’amitié. Et puis, nous pouvons parler de ça parce que tout s’arrangera. Voilà trois fois que je dîne ou que je déjeune avec tout ce personnel : Jules, Juliette et Julien. Maintenant, je suis tranquille parce que je vois que ça n’ira plus très loin. Il n’y a pas eu de scandale. Tout le monde est plus ou moins au courant, c’est entendu, mais l’important n’est pas que les choses se sachent ou ne se sachent pas, c’est qu’on n’en parle pas. Moi qui suis ici, quand ça m’est arrivé d’être trompé, j’étais très jeune... j’ai trop bavardé. Évidemment, je ne suis pas allé raconter à tout le monde mes malheurs conjugaux, mais je les ai dits à trois ou quatre personnes parce que je préférais passer pour un infortuné que pour un jobard. Quand on est jeune, on ne veut pas passer pour un jobard... Quand on est vieux, on s’en f... royalement... J’ai pardonné à ma femme. C’était la seule chose que j’avais à faire. Il m’a semblé que j’étais très chic en lui pardonnant, mais, quand j’y songe, je me rends compte que c’était le seul parti possible et que j’ai été tout simplement acculé à la grandeur d’âme. Je ne suis pas au courant de l’affaire dans tous ses détails, mais ça m’étonnerait si Jules n’avait pas pardonné... Et, pourtant, ça n’est pas un être exceptionnel.
CATHERINE.
Et qu’est-ce qui va se passer, à votre avis ?
LEBLEU.
Eh bien ! j’espère que le petit jeune homme va être éliminé. Je crois qu’il n’y a pas d’enfant en perspective...
CATHERINE.
Je ne crois pas. Juliette m’avait dit qu’elle ne voulait pas avoir de bébé avant deux ans de mariage. C’est une femme sage et prévoyante.
LEBLEU.
Je la crois tellement sage que je suis à peu près sûr qu’elle ne recommencera pas. Même les gens tranquilles, comme sont ces gens-là, ont besoin d’aller faire un petit tour dans les pays d’aventures... Mais ce petit tour bien court leur suffit. Ils sont vaccinés maintenant contre l’inconnu.
CATHERINE.
Vous aimez mieux les passionnés, monsieur Lebleu ?
LEBLEU.
Ah ! non, par exemple ! ne me faites pas dire ça ! Les gens qui, chaque fois qu’ils sont tourmentés par un désir plus ou moins pur, appellent ça le grand amour et qui font des bouleversements, des cataclysmes autour d’eux... Non, j’aime encore mieux les atrophiés comme Jules et votre amie Juliette. Au fond, cette petite histoire leur aura fait beaucoup de bien. Ils ont l’air de former un ménage très uni, maintenant... Ça se comprend. Jules ne s’est rendu compte de l’importance de sa femme qu’à partir du moment où elle l’a trompé. D’autre part, Juliette s’est apitoyée sur le compte de son mari. Elle a découvert en lui une sensibilité qu’elle n’aurait jamais soupçonnée si elle ne l’avait pas vu souffrir. Le petit aviateur a réveillé la sensibilité endormie de ce couple. Maintenant son travail est fini, il n’a plus qu’à disparaître.
CATHERINE.
Eh bien ! monsieur Lebleu, je vois que nous sommes tout à fait du même avis. J’ai pensé qu’il devait disparaître et je viens de décider avec lui qu’il irait au Sénégal, soi-disant provisoirement...
LEBLEU.
Oui, oui ! Il faut toujours dire provisoirement.
CATHERINE.
Mon mari lui fera là-bas une situation.
LEBLEU.
On lui doit bien ça... Alors, c’est parfait. Après avoir accompli son œuvre, il devait être éliminé naturellement. Seulement, ça n’est pas mauvais d’aider un peu la nature.
JULIETTE, entrant.
Bonjour, Désiré ! Je vous annonce que nous venons de signer l’achat de notre appartement.
JULES, entrant.
Et je crois que ça sera une très bonne affaire. Bonjour, monsieur Désiré !
LA BONNE, ouvrant la porte.
Voici monsieur Méraud. Ces messieurs et dames seront bien gentils de passer tous à table, car monsieur et madame sont déjà dans la salle à manger.
LEBLEU.
Eh bien ! on va dîner.
Entre Julien.
JULIETTE, à Catherine.
Ah ! il fait toujours une tête, celui-là !
Elle s’approche de Jules.
Tu vois comme j’ai bien fait d’insister au sujet de la salle de bains.
JULES.
Je te crois. Moi, je t’avoue que je n’y pensais plus. Monsieur Lebleu, regardez donc ce plan...
Ils sont tous les trois au fond, en train d’examiner le plan. Julien et Catherine sont à l’avant-scène.
JULIEN, à Catherine.
Eh bien ! je viens de consulter mon contrat et je crois que je ne serai même pas obligé de payer un dédit.
CATHERINE.
Vous êtes un peu mélancolique, hein ?
JULIEN.
Oui, mais, tout de même, je me dis que c’est la vérité.
CATHERINE.
Pour bien faire, il faudrait que vous partiez par le bateau de la semaine prochaine. Vous verrez, il paraît que c’est un endroit où l’on s’acclimate très bien. D’ailleurs – mais je n’en parle encore à personne – j’ai l’intention d’y rejoindre mon mari le mois prochain.
JULIEN.
Oh ! ça serait charmant !
Il la regarde avec sympathie. Elle détourne les yeux.
LEBLEU.
À table, à table !
Ils se dirigent tous vers la porte du fond.