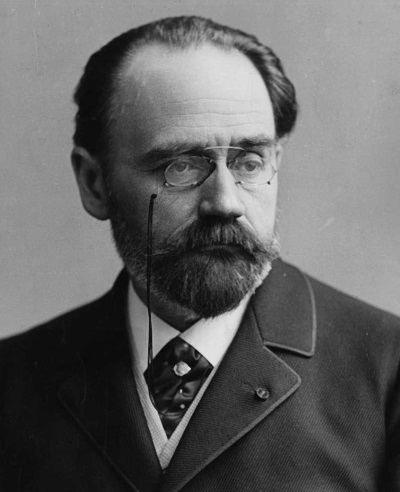Les Héritiers Rabourdin (Émile ZOLA)
Comédie en trois actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Cluny, le 3 novembre 1874.
Personnages
RABOURDIN
CHAPUZOT
LE DOCTEUR MOURGUE
DOMINIQUE
ISAAC
LEDOUX
CHARLOTTE
MADAME FIQUET
MADAME VAUSSARD
EUGENIE
La scène est à Senlis.
La mise en scène est prise de la salle. Le premier personnage inscrit tient la gauche du spectateur.
PRÉFACE
J’ai lu soigneusement tout ce que la critique a écrit sur les Héritiers Rabourdin. J’avais le désir de m’instruire. J’étais prêt à me corriger des erreurs qu’on allait me signaler. Je désirais une leçon profitable, des conseils dictés par l’expérience, une étude de mon cas dramatique, complète, raisonnée, magistrale. Et voilà que j’ai reçu la plus abominable « raclée » qu’on puisse rêver. Pas de raisons, des coups de bâton. L’un m’a mordu, l’autre m’a jeté sa plume entre les jambes pour me faire tomber, tandis qu’un troisième me fendait le crâne à coups de poing, par derrière. Les critiques du bon sens criaient : « Tue ! » et les critiques romantiques répondaient : « Assomme ! » Ah ! tu veux savoir ce que nous pensons de toi, tu souhaites qu’on te juge, tu attends de nous une opinion motivée ! Eh bien ! voici un croc-en-jambe, et voici, une pluie de taloches, et voici encore quelques coups de pied dans les reins. C’est parfait, je suis à cette heure suffisamment éclairé.
J’avoue que, d’abord, cet accueil m’a émotionné. Ce n’était plus de la discussion, c’était du massacre. Un débutant, tout neuf de sa province, qui débarquerait au théâtre avec quelque monstre dramatique, ne serait certainement pas accueilli par de telles huées. On lui accorderait au moins un coin de talent quelconque, on lui laisserait une espérance. Moi, j’étais appréhendé au collet, jugé, fusillé ; je n’avais plus qu’à me coucher sur les morceaux de ma pièce et à faire le mort. Cette grande critique théâtrale, que l’étranger nous envie, comme chacun le sait, cette école qui maintient si haut le goût public, et qui, par son rôle de bonne conseillère, a déjà doté la France de plusieurs dramaturges de génie, cette institution littéraire, en un mot, me chassait de la scène d’un seul coup de sa férule impeccable. Pendant vingt-quatre heures, j’en suis resté meurtri, la tête basse, très honteux de moi, me demandant si j’oserais jamais reparaître en public.
Cependant, malgré mon respect religieux pour la critique, des besoins de comprendre se sont bientôt éveillés en moi. J’étais écrasé, pulvérisé, fini, anéanti, cela était certain ; je n’avais ni style, ni idées, ni talent d’aucune sorte, je le comprenais le premier ; mais enfin j’aurais voulu quelque chose de moins sommaire, un mot d’explication, une parole pour l’avenir. La critique a-t-elle entendu me fermer le théâtre à jamais ? J’en ai peur. J’ai relu les articles, j’ai réfléchi, et je confesse qu’il me faudra faire preuve d’un entêtement déplorable pour tenter de nouveau la fortune des planches. On n’a pas mis en avant une seule circonstance atténuante. Je n’ai pas eu les consolations que l’on accorde au dernier des vaudevillistes sifflés. Une bousculade, rien de plus. Vous nous gênez, ôtez-vous de là. Et surtout ne revenez plus. Il y a des poètes de mirlitons, des fabricants de pièces à tant la scène, des auteurs suspects, qui sont nés, paraît-il, pour faire du théâtre. Moi, pas. Quand j’essaye, je commets une action si monstrueuse, qu’on parle de me conduire au poste de police voisin. Si tout ce qu’on a écrit sur les Héritiers Rabourdin veut dire quelque chose, ce quelque chose est un congé formel, une menace de prendre des triques, le jour où j’aurais l’audace de récidiver.
Je crois que la critique, cette fois, a vraiment dépassé le but. Elle a frappé trop fort pour frapper juste. Je parle de la critique dans son ensemble, car il est des poètes et des écrivains de talent, égarés dans l’ingrat métier de critique, qui ont eu la bonne grâce de me tendre amicalement la main, au milieu de la bagarre. Je les en remercie. Mes autres juges avaient tous sortis leurs gourdins des grands jours. Certes, ce n’est pas la passion qui me déplait. J’admets très bien les gourmades littéraires. Seulement, ce qui me plonge dans une stupéfaction profonde, c’est la parfaite innocence de ces messieurs en face de mon œuvre et de ma personnalité. On les aurait placés en présence d’un Mohican ou d’un Lapon, apportant de son pays quelque joujou barbare, qu’ils n’auraient pas ouvert des yeux plus ignorants, ni émis sur le mécanisme du joujou des jugements plus extraordinaires. Pas un d’eux n’a paru se douter un instant que j’avais fait, dans les Héritiers Rabourdin, une tentative dramatique d’un genre particulier. Ils n’ont pas même essayé de se rendre compte pourquoi ma pièce est ce qu’elle est, et non ce qu’ils voudraient qu’elle fût. Le comble est qu’ils sont allés jusqu’à découvrir que j’avais imité tout le monde. Là seulement ils se sont arrêtés, sans se demander quelles raisons avaient pu m’entêter dans le parti-pris d’imiter tout le monde. M’ont-ils cru réellement assez naïf et assez ignare pour ne pas savoir quel sujet je choisissais ? Ai-je l’habitude de détrousser mes confrères ? Ne me connaît-on pas, suis-je un débutant d’hier, et la franchise de mes emprunts à Molière et à un autre poète comique, que je nommerai plus loin, ne devait-elle pas mettre la critique sur ses gardes ? La pièce est telle que je l’ai voulue, qu’on en soit certain. Œuvre bonne ou mauvaise, peu importe ; mais œuvre raisonnée, avant tout.
Puisque la critique a, volontairement ou non, passé à côté des Héritiers Rabourdin, sans discuter le point de vue auquel je m’étais placé, je suis réduit à expliquer ici ce que j’ai entendu faire. Certes, j’aurais beau jeu, si je voulais simplement me défendre d’avoir pris pour sujet l’éternelle cupidité humaine, la comédie d’un groupe d’héritiers attendant l’ouverture d’un testament. Dans toutes les littératures, à toutes les époques, chez tous les auteurs comiques, cette comédie a été écrite, est écrite et sera écrite. Je n’ai fait que continuer une tradition que bien d’autres continueront après moi. Le drame de l’adultère n’est-il pas autrement usé, et n’y a-t-il pas des écrivains qui ne vivent absolument que sur ce drame, étudié dans toutes ses données, sans qu’on songe à leur reprocher leur pauvreté d’invention ?
Mais je n’ai aucun besoin de cet argument. J’avoue que mon intention très arrêtée a été d’écrire un pastiche ; j’entends un pastiche particulier, et fait dans un certain but d’expérience. J’ai voulu, en un mot, remonter aux sources de notre théâtre, ressusciter la vieille farce littéraire, telle que nos auteurs du XVIIe siècle l’ont empruntée aux Italiens. Afin que nul n’en ignore, j’ai pris à Molière des tournures de phrases, des coupes de scènes. Je me suis surveillé à chaque ligne pour que ma pièce restât simple, primitive, naïve même, si l’on veut. Une intrigue ténue comme un fil, pas un seul des coups de scène à la mode de nos jours, des peintures de caractères, une situation se développant avec ses péripéties jusqu’au dénouement, et ce dénouement amené par la logique même des faits sans expédients d’aucune sorte. Le seul rajeunissement que je me sois permis a été d’habiller les personnages comme nous et de les mettre dans notre milieu. J’ai entendu faire du réel contemporain avec le réel humain qui est de tous les temps.
J’insiste sur ce point de départ. Il n’est pas une scène dans la pièce, je le répète, qui n’aurait dû ouvrir les yeux de la critique et lui inspirer le soupçon qu’elle avait devant elle une protestation contre la façon dont nos auteurs comiques gaspillent l’héritage de Molière. Qu’a-t-on fait de ce beau rire, si simple, si profond dans sa franchise, de ce rire vivant où il y a des sanglots ? Nous avons, à cette heure, la comédie d’intrigue, un jeu de patience, un joujou donné au public. Elle règne comme type parfait, elle a imposé un code dramatique d’après lequel tout devient longueur. Vous posez un personnage, longueur ; vous cédez à une fantaisie littéraire, longueur. Et le pis est qu’elle a habitué le public à de telles histoires compliquées, que le public s’ennuie, en effet, lorsqu’on ne complique pas assez les histoires. Aujourd’hui, on conseillerait certainement à Molière de mettre le Misanthrope en un acte. Nous avons encore la comédie sentimentale, une larme niaise entre deux couplets de vaudeville, un genre bâtard qui fait la joie des âmes sensibles. Mais nous avons surtout la comédie à idées, le sermon mis au théâtre, l’art dramatique consacré à l’amélioration de l’espèce. C’est là le triomphe de l’époque. Nos auteurs ont abandonné le côté humain pour ne voir que le côté social. Ils étudient des cas sociaux particuliers, de façon que leurs pièces, au bout de dix ans, sont démodées, incompréhensibles pour les nouveaux spectateurs. Ils se bornent à la petite guerre des préjugés du moment, ils ne tentent pas l’absolu, ils ne cherchent que les vérités relatives sans éprouver le tourment de ces traits éternels de vérité qui éclatent chez les maîtres. Jamais les maîtres n’ont prêché, jamais ils n’ont voulu prouver quelque chose. Ils ont vécu, et cela suffit à faire de leurs œuvres d’éternelles leçons.
Voilà où on est l’héritage de Molière, et voila pourquoi j’ai rêve de remonter jusqu a ce modèle glorieux. Je suis indigne, je le sais. Mon essai n’a, si l’on veut, que le mérite d’avoir été tenté. Il n’en méritait pas moins, je crois, l’estime de la critique. J’espérais un examen, non sympathique, du moins poli et sérieux. Et j’ai dit avec quelle brutalité la critique s’est jetée sur moi et sur ma pièce. Maintenant, on peut s’imaginer sans peine quelle a dû être ma stupeur.
D’ailleurs, plusieurs de mes amis eux-mêmes ont hésité a m’applaudir. Une farce ! j’avais écrit une farce ! Eh ! oui, une farce, pourquoi pas ? Je ne me sens pas compromis, je vous jure. Les tréteaux sont plus larges et plus épiques que nos misérables scènes où la vie étouffe. Les tréteaux en plein air, les tréteaux sous le ciel, avec une farce franche, une farce violemment enluminée, une farce donnant un rire à la laide grimace humaine, se permettant tout, « blaguant » la mort ! Tel a été mon rêve. J’aurais voulu pour ma farce la place publique, une tente de toile, avec une grosse caisse et un trombone à la porte. Je la voyais jouée par des pitres, au milieu de culbutes, dans le tohu-bohu d’une foule se prenant le ventre. Alors on l’aurait comprise, peut-être ; on ne m’aurait pas fait l’injure de la comparer à un vaudeville. La farce n’est-elle pas immense ? Elle est la liberté illimitée de la satire. Sous le masque que le rire fend, on voit l’humanité pleurer. Aussi la farce a-t-elle toujours tenté les hommes aux fortes épaules : Aristophane, Shakespeare, Rabelais, Molière. Ceux-là sont des farceurs.
Je sais bien que notre temps sifflerait ces génies, s’ils se produisaient un beau soir sur une de nos scènes parisiennes. Que Molière donne demain le Malade imaginaire ou Georges Dandin, il sera conspué par la critique entière ; on lui reprochera, dans le premier de ces chefs-d’œuvre, de n’avoir mis que des tisanes, et de n’avoir peint, dans le second, que des gredins et des gredines. Même dernièrement, à une reprise de Georges Dandin, le beau monde de la Comédie-Française a failli se révolter. Il faut tout le respect de la tradition pour imposer ce rire superbe qui n’a peur de rien. En province, on ne peut jouer Molière. Je connais des avoués et des huissiers de petite ville, qui, lorsqu’ils viennent l’été à Paris en villégiature, ont bien soin de consulter l’affiche, avant de mener leurs épouses à la Comédie-Française, afin que ces dames ne s’y rencontrent pas avec l’auteur de Tartufe. Molière reste suspect. Et ce qui m’exaspère, dans tout cela, c’est le respect hypocrite pour les maîtres. Oh ! les maîtres ! il n’y a que les maîtres ! imitez les maîtres ! Avisez-vous un jour d’écouter ce conseil-là, faites une tentative, et vous verrez de quelle façon on vous arrangera. La vérité est que les maîtres épouvantent. Un jeune homme arrive à Paris ; il rêve la gloire d’auteur dramatique ; il va frapper à la porte d’un de nos critiques les plus consciencieux ; et il lui dit : « Je suis plein de bonne volonté. Indiquez-moi quel théâtre je dois étudier. Dès demain, je me mets au travail. » Vous croyez, peut-être, que notre critique répondra : « Étudiez le théâtre de Molière. » Ah bien ! oui. Il dira, avec la conviction de donner un conseil excellent et pratique : « Étudiez le théâtre de Scribe. » Voilà où nous en sommes.
Je ne voudrais pas mêler ma querelle personnelle aux réflexions que m’inspire l’état actuel de notre théâtre. Certes, je comprends à merveille qu’il faut des spectacles à la foule ; je comprends également qu’il serait injuste de se montrer sévère à l’égard des hommes qui consentent à fabriquer au jour le jour les quelques douzaines de pièces dont Paris a besoin pour passer son hiver. Cela rentre dans ce qu’on appelle l’article de Paris. On taille, on colle, on coud, on vernit, et l’on a des babioles charmantes qui durent une saison. Pour confectionner ces pièces-là, un atelier est nécessaire. Il est indispensable d’avoir des patrons communs, de pénétrer le fin du métier, de savoir ce qui plaît aux clients. Dès lors, il y a tout un manuel a consulter. On doit connaître Scribe par cœur. Il vous enseignera dans quelle proportion l’amour doit entrer dans une comédie ; ce qu’on peut y risquer de scélératesse ; de quelle façon on escamote un dénouement et de quelle autre on modifie un personnage d’un seul coup de baguette. Il vous apprendra, en un mot, ce « métier » du théâtre que Molière ignorait, mais que la critique déclare aujourd’hui de toute nécessité, si l’on aspire à l’honneur de faire rire ou de faire pleurer ses contemporains. Tout cela est parfait, utile, je le veux bien. Le public, en effet, ne peut plus supporter que les pièces d’une digestion immédiate. Il repousse tout ce qui ne sort pas de l’atelier dont je parle plus haut. Mais il y a de braves garçons qui ne peuvent s’astreindre au travail en commun. Ceux-là ont la folie de rêver des œuvres personnelles ; ils ne fabriquent pas pour une mode, ils tâchent de créer pour des siècles. Sans doute, leur présomption est grande ; sans doute encore, ils n’arrivent jamais à se satisfaire. Seulement je les estime dignes de respect, et je trouve odieuse la critique qui s’égaye de leur chute et qui a le besoin mauvais de les envoyer au bagne de la fabrication courante.
Et voyez quel manque de logique, dans les reproches qu’on m’a faits, à propos des Héritiers Rabourdin. À entendre certains critiques, je suis un esprit détraqué qui n’accepte aucune règle ; je rêve de mettre le feu aux œuvres de Scribe, je méprise ouvertement les conventions, je mûris je ne sais quel plan d’un théâtre abominable. Or, d’autres critiques m’ont accusé de m’enfoncer dans la convention jusqu’au cou, d’être en retard de deux cents ans sur le mouvement dramatique, d’avoir ressuscité une comédie mangée aux vers. Et ces derniers ont failli comprendre ce que j’ai voulu faire. Que conclure, en face de deux affirmations si opposées ? D’abord, que les critiques ne sont pas toujours d’accord entre eux. Ensuite que, si je suis un révolutionnaire en présence des œuvres imbéciles, je m’incline avec le plus profond respect devant les œuvres des maîtres. J’aime les maîtres, comme il faut les aimer, pour leur vérité. Je les aime, jusqu’à vouloir qu’on remonte droit à eux, en passant par-dessus la tête des nains dont les cabrioles amusent la foule. En cette matière, je nie le relatif du talent, je n’accepte que l’absolu du génie.
Je n’écris point cette préface pour défendre mon œuvre. Si elle a quelque force en elle, elle se défendra toute seule, plus tard. Aussi ne chercherai-je pas à répondre point par point aux violences qu’elle a soulevées. Je n’ai qu’une préoccupation : examiner mon cas, afin d’en tirer une leçon, s’il est possible, pour les jeunes écrivains qui tenteraient comme moi la vérité au théâtre. Parmi les reproches qu’on m’a adressés, il en est trois qui suffiront à caractériser l’esprit général contre lequel je me suis heurté. Ces trois reproches sont ceux-ci : ma comédie manque de gaieté ; on n’y rencontre aucun personnage sympathique ; la situation reste la même pendant les trois actes. J’admets qu’il y ait là trois gros défauts, au point de vue dramatique moderne. Il est évident que si l’on compare la pièce, ainsi qu’on l’a fait, à certains vaudevilles contemporains, on la trouvera naïve, trop simple et trop rude à la fois. Mais je n’accepte pas cette comparaison. Mon but a été autre, je le répète une fois encore. Je nie que dans Molière il y ait de la gaieté, j’entends de la gaieté telle qu’on en demande aujourd’hui. Dandin à genoux devant sa femme fait saigner le cœur ; Arnolphe aux petits soins pour Agnès mouille les yeux de pitié ; Alceste inquiète et Scapin donne peur. Sous le rire, il y a des gouffres. Je nie également que Molière se soit jamais inquiété de tempérer ses cruautés d’analyse, en peuplant ses pièces de personnages sympathiques ; à part son éternel couple d’amoureux, qui est une concession à la mode du temps, tous les types qu’il a créés sont humains, c’est-à-dire plutôt mauvais que bons. Dans l’Avare, d’un bout à l’autre, on se trahit et on se vole. Dans le Misanthrope, tous les personnages sont louches, si bien qu’on dispute encore pour savoir où est le véritable honnête homme de la pièce. Je ne parle pas des farces, où il n’y a que des sots et des sacripants. Enfin, je nie que Molière ait jamais soupçonné le besoin de compliquer une comédie pour la rendre plus intéressante ; son théâtre est d’une nudité magistrale ; une intrigue unique s’y développe largement, logiquement, en épuisant le long du chemin toutes les vérités humaines qu’elle rencontre. Je sais bien que, de nos jours, les faiseurs de vaudevilles déclarent que Molière ne savait pas un mot de théâtre. On devrait pousser la franchise jusqu’au bout et confesser nettement que Molière attriste, effraye et ennuie. Ce serait la stricte vérité.
On dira que nous ne sommes plus au XVIIe siècle, que notre civilisation s’est compliquée, et que le théâtre, aujourd’hui, ne peut avoir la même formule qu’il y a deux cents ans. Cela est hors de doute. Il ne s’agit point d’un décalque. Il s’agit simplement de retourner à la source même du génie comique en France. Ce qu’il est bon de ressusciter, ce sont ces peintures larges de caractères, dans lesquelles les maîtres de notre scène ont mis l’intérêt dominant de leurs œuvres. Ayons leur beau dédain pour les histoires ingénieuses ; tâchons de créer, comme eux, des hommes vivants, des types éternels de vérité. Et restons dans la réalité contemporaine, avec nos mœurs, nos vêtements, notre milieu. Il y a certainement là une formule à trouver. Ce serait, à mon avis, cette formule naturaliste que j’indiquais dans ma préface de Thérèse Raquin. Certes, le problème n’est point facile. C’est même parce que la formule m’échappe encore, que j’ai songé, en attendant, à tenter un décalque, les Héritiers Rabourdin, avec l’espoir que le commerce des maîtres me mettrait sur la voie du vrai. Pour moi, ma comédie n’est qu’une étude, une expérience. À part quelques bouts de scène, elle est en dehors de la formule que je cherche.
Maintenant, il est temps de dire où j’ai pris les Héritiers Rabourdin. La critique, qui connaît sur le bout du doigt les répertoires des petits théâtres, m’a jeté à la figure des poignées de vaudevilles. Elle en a exhumé de stupéfiants, dont j’ignorais jusqu’aux titres ; je dois confesser que je suis d’une grosse ignorance en cette matière. J’ai tout simplement pris l’idée première de ma pièce dans Volpone, comédie de Ben Jonson, un contemporain de Shakespeare. Pas un critique ne s’est avisé de cela. Il est vrai que la chose demandait quelque érudition, quelque souci des littératures étrangères. À présent que j’ai indiqué la source, je conseille aux critiques consciencieux de lire Volpone. Ils y verront ce que pouvait être une comédie au temps de la renaissance anglaise. Je ne connais pas de théâtre plus largement audacieux. C’est une crudité splendide, une violence continue dans le vrai, une rage admirable de satire. Imaginez la bête humaine lâchée, avec tous ses appétits. Et quand on songe au public qui applaudissait ce rire terrible ! Certes, il n’avait rien de commun, ni les nerfs ni les muscles, avec nos petits bourgeois qui viennent, gantés de blanc, digérer à l’aise dans un fauteuil d’orchestre. Vous pensez bien que j’ai expurgé Ben Jonson. Ma comédie pour laquelle on a épuisé les expressions de dégoût, est une berquinade à côté de Volpone. Il y a surtout, dans ce dernier, une scène belle jusqu’à l’épouvante, que je signale aux délicats : un des héritiers vient offrir au faux moribond sa femme, sa propre femme, les médecins ayant décidé qu’une jolie fille était nécessaire pour guérir le malade, dans aucune littérature, on ne trouverait un pareil soufflet donné aux passions. Sans doute, il faut accepter les affinements de son époque ; mais quel artiste n’a pas éprouvé un regret, au souvenir de ces beaux siècles libres et naïfs, qui ont vu croître toutes les floraisons hardies de l’esprit ?
Il me reste à réclamer hautement mon titre de romancier. Quand la critique dramatique a dit d’un débutant : « C’est un romancier », elle a tout dit. Cette phrase, sous sa plume, signifie que les romanciers sont incapables d’écrire pour le théâtre. Je trouve le dédain de la critique singulier. Les romanciers ont fait la gloire littéraire de ce siècle. Lorsqu’un d’eux eut bien tenter de porter ses facultés au théâtre, la critique ne devrait avoir pour lui que des encouragements. Certes, si le théâtre, à notre époque, jetait un vif éclat ; si les œuvres représentées étaient des chefs-d’œuvre ; si les auteurs dramatiques donnaient à l’art qu’ils représentent tout le resplendissement désirable ; enfin, s’il n’y avait pas place pour une renaissance, je comprendrais qu’on nous repoussât. Mais les planches sont vides, mais, quelles que soient nos chutes, elles n’égaleront jamais celles des hommes du métier ! Nous ne saurions faire tomber le théâtre plus bas qu’il ne l’est actuellement. Alors pourquoi ne pas autoriser tous nos essais ? Ce que nous voulons, en somme, c’est l’art agrandi. Nous tâchons d’apporter un sang nouveau, une langue correcte, un souci de la vérité. Les romanciers, qui sont les princes littéraires de l’époque, honorent nos scènes encanaillées, lorsqu’ils daignent y mettre les pieds.
Je le répète, ma cause n’est pas isolée. J’ai plaidé ici pour tout un groupe d’écrivains. Je n’ai pas l’orgueil de croire que ma mince personnalité a suffi pour soulever tant de colères. Je suis un bouc émissaire, rien de plus. On a frappé en moi une formule plutôt qu’un homme, la critique voit grandir devant elle un groupe qui s’agite fort et qui finira par s’imposer. Elle ne veut pas de ce groupe, elle le nie ; car, le jour où elle lui reconnaîtrait du talent, elle serait perdue. Il lui faudrait accepter l’idée de vérité qu’il apporte avec lui, ce qui la forcerait à changer son critérium. Ce n’est pas ma pièce, je le dis encore, qu’on a exécutée : c’est la formule naturaliste dont elle paraît procéder. Et je ne veux pour preuve du parti-pris de la critique, que sa mauvaise foi dans le compte rendu de la première représentation. Pas un critique n’a confessé que les Héritiers Rabourdin avaient été vigoureusement applaudis. À ce propos, je citerai un mot profond, que me disait, à la sortie du théâtre, un illustre écrivain ; il me serrait la main, il ajoutait pour tout compliment : « Demain, vous serez un grand romancier. » Le lendemain, en effet, des gens qui, depuis dix années, me refusent tout talent, exaltaient mes romans pour mieux assommer ma pièce. Je rapporterai ici un autre mot, terrible celui-là, prononcé par un romantique impénitent qui a entre les mains une feuille de grande publicité, dont il a fait une boutique politique et littéraire ; il endoctrinait son critique dramatique, il me désignait à ses foudres, en répétant tranquillement, à haute voix, sans se gêner : « Il a trop de talent, il est dangereux ; il faut l’enrayer. » Je n’ai rien mis dans ma pièce de plus abominablement cru, de plus sanglant contre la vilenie humaine.
D’ailleurs, qu’importait le succès ? Jamais moins qu’aujourd’hui le succès n’a été une preuve du mérite des œuvres. Une seule chose m’a touché. Un dimanche soir, je suis allé me mettre au beau milieu de la salle, pleine du public illettré des jours de fête. Le quartier Saint-Jacques était là. Les trois actes n’ont été qu’un long éclat de rire. Chaque mot était souligné, rien n’échappait à ce grand enfant de public pour lequel la pièce, primitive et naïve de parti-pris, semblait avoir été faite. Les enluminures un peu fortes le ravissaient, la simplicité des moyens le mettait de plain-pied avec les personnages. Le dirai-je ? j’ai goûté là le première heure d’orgueil de ma vie.
En finissant, je tiens à remercier M. Camille Weinschenk de sa courageuse hospitalité. Peu de directeurs auraient osé mettre ma pièce à la scène. Il fallait pour tenter l’aventure un esprit littéraire, enclin aux batailles de l’esprit, très décidé à chercher et à trouver du nouveau. Je tiens également à remercier les artistes qui ont mis tout leur talent et toute leur bonne volonté à interpréter mon œuvre. Et j’ai surtout à dire un grand merci à mademoiselle Reynard, dont la belle humeur pleine de finesse a certainement sauvé les côtés périlleux de la pièce, le premier soir. Elle a su rendre le personnage de Charlotte avec une grâce infinie ; elle n’est pas l’effrontée Dorine classique, elle est l’enfant que j’ai rêvée, moitié paysanne, moitié demoiselle, d’une humeur espiègle, vive, légère, ailée. Quant à M. Mercier, il a interprété avec une bonhomie rusée d’un grand effet ce rôle difficile de Rabourdin, qui est tout de nuances ; son expériences de la scène et son autorité sur le public ont grandement contribué au succès.
Et voilà l’aventure terminée. Un auteur dramatique qui connaît bien son public, me disait : « Estimez-vous heureux que votre pièce soit allée jusqu’au bout. Il y a cinq ans, jamais le public n’aurait consenti à entendre tant de vérités à la fois. » Je m’estime donc très heureux, si j’ai réellement fait faire un progrès à la patience des spectateurs. Je n’ai plus qu’à répondre à un critique, tout sympathique d’ailleurs, qui, parlant de Thérèse Raquin et des Héritiers Rabourdin, concluait en disant que cette dernière pièce était un pas en arrière ; et je réponds qu’à mon âge, dans la période de travail où je suis, il n’y a point de pas en arrière ; il y a seulement des pas dans tous les sens, des pas tentés à droite, à gauche, partout où il peut être curieux d’aller.
Maintenant, je fais un gros paquet de tous les articles qui ont paru sur les Héritiers Rabourdin. Je noue le paquet avec une ficelle et je le monte à mon grenier. Je ne saurais tirer aucun profit de ce paquet d’injures. Plus tard, il pourra être curieux d’y opérer des fouilles. Pour le moment, il ne me reste qu’à me laver les mains. Je suis habitué à n’attendre aucune récompense immédiate de mes travaux. Depuis dix ans, je publie des romans que je lance derrière moi, sans écouter le bruit qu’ils font en tombant dans la foule. Quand il y en aura un tas, les passants seront bien forcés de s’arrêter. Aujourd’hui, je m’aperçois que le combat est le même au théâtre. Ma pièce est massacrée, niée, noyée au milieu du tapage de la critique courante. Peu importe. Je pousse mes verrous, je m’exile de nouveau dans le travail.
1er décembre 1874.
ACTE I
Une salle à manger bourgeoise de petite ville. Au fond, par une large porte vitrée, on aperçoit un jardin clos de murs. Dans le coin, à gauche, un poêle de faïence, à coté duquel se trouve un petit guéridon. Au milieu du panneau, à droite, un buffet à étagère. À gauche, au second plan, une porte menant à la chambre à coucher de Rabourdin ; au premier plan, un coffre-fort scellé au mur. À droite, au second plan, une porte menant à la cuisine. Une table ronde au milieu ; un fauteuil devant la table, faisant face au public ; une chaise à gauche ; un canapé d’osier, garni de deux coussins de tapisserie, à droite ; une petite jardinière montée sur un pied, près du coffre-fort ; un baromètre pendu à côté du buffet, sur lequel se trouvent une cave à liqueurs, un plateau, une timbale, des tasses, etc. ; plusieurs chaises, dont une marquetée, près du poêle ; un coucou accroché au premier plan, à droite.
Deux heures du matin, au printemps.
Scène première
CHARLOTTE, RABOURDIN
RABOURDIN.
Alors, tu es sûre, Charlotte, la caisse est vide ?
CHARLOTTE, devant la caisse ouverte.
Vide, mon parrain, tout à fait vide.
Elle passe à droite, pendant que Rabourdin va regarder à son tour dans la caisse.
RABOURDIN.
C’est bien singulier.
CHARLOTTE.
Quoi ? qu’il n’y ait plus d’argent ?...
Riant.
Vous êtes drôle, mon parrain ! Il n’y en a pas souvent, de l’argent, dans la caisse.
Ils descendent tous deux à l’avant-scène.
RABOURDIN.
Ne ris pas, Charlotte... Il faut absolument que je paye à ce juif d’Isaac son ancienne note, cette armoire Louis XIII qu’il m’a vendue.
CHARLOTTE.
Il attendra. Il n’a pas peur pour son argent, peut-être !... Si je voulais, quand je sors, je vous rapporterais tout Senlis dans mon panier. Eh oui ! vous êtes le père aux écus. Monsieur Rabourdin, l’ancien drapier de la place du Marché, à l’enseigne du Grand Saint-Martin ; diantre ! il a dû se retirer avec dix mille francs de rentes... Les braves gens ! ils ne savent pas que la caisse est vide.
RABOURDIN, effrayé, regardant derrière lui.
Chut ! bavarde !...
Confidentiellement.
Mes neveux et mes nièces me paraissent moins tendres depuis quelques jours.
CHARLOTTE.
C’est grave.
RABOURDIN.
Ils me laisseraient crever comme un chien, vois-tu. Eux, que j’ai nourris pendant dix ans, et qui m’ont grugé jusqu’au dernier sou !
CHARLOTTE.
Eh ! ils vous rendent, aujourd’hui. Vous serez bientôt quittes... Il faut être juste, mon parrain, vos héritiers sont gentils. Ils se disputent votre héritage à coups de cadeaux, gros et petits... Vous êtes comme un coq en pâte, dorloté, baisé, chatouillé, adoré.
RABOURDIN.
Les gredins ! ils ont tout pris, et ils veulent le reste !... Si, au dernier écu, je n’avais joué l’avarice, je n’aurais pas eu d’eux un morceau de pain, ni un verre d’eau... Ah ! s’ils se doutaient ! plus de petits plats, ma pauvre Charlotte, plus de cajoleries, plus de vieillesse heureuse ! Je serais « ce vieux filou de Rabourdin ».
CHARLOTTE.
Il faut trouver l’argent du brocanteur, alors.
RABOURDIN.
Trouver l’argent ! tu ne doutes de rien, toi ! Où diable veux-tu que je le trouve ?... Si j’emprunte, tout Senlis le saura. Ma pauvre maison croule déjà sous les hypothèques.
CHARLOTTE.
Eh ! vos héritiers sont là.
RABOURDIN.
Hein ! tu crois que je pourrais... Ils ont beaucoup donné, dans ces derniers temps... Enfin, voyons toujours où nous en sommes. Prends le registre...
Charlotte passe à gauche et va chercher un registre, dans la caisse, pendant que Rabourdin remonte s’asseoir devant la table, sur le fauteuil qu’il a tiré à lui.
Peut-être qu’en demandant vingt francs à l’un, vingt francs à l’autre... Le tout est de ne pas les égorger.
CHARLOTTE, apportant la chaise placée à gauche, sur laquelle elle s’asseoit, en face de Rabourdin.
Ce que vous avez reçu depuis le premier du mois, n’est-ce pas, mon parrain ?
RABOURDIN.
Oui.
CHARLOTTE, ouvrant le registre, sur la table.
Voyons...
Lisant.
« Boucharain, le 2, un petit ballot contenant douze, paires de chaussettes, six pains de savon, une paire de rasoirs, quatre foulards et trois mètres de drap pour faire une redingote. »
RABOURDIN.
Bien, bien... Rien n’est précieux comme ces commissionnaires en marchandises... Mais je le ménage celui-là, Continue.
CHARLOTTE, lisant.
« Veuve Guérard, le 7, un gigot. »
RABOURDIN.
Ensuite.
CHARLOTTE.
Ensuite, rien !
RABOURDIN, se levant.
Comment, rien ! Est-ce que ma nièce Guérard se moque du monde ? Un gigot, le 7, et nous sommes au 18 ! À ce prix-là, j’aurai des nièces tant que je voudrai... Être une nièce Rabourdin, mais cela pose tout de suite une femme dans Senlis ! C’est cent mille francs d’espérances sur la planche.
CHARLOTTE, continuant.
« Lehudier, le 9... »
RABOURDIN, l’interrompant.
Non, saute les fournisseurs, arrive aux héritiers sérieux, à ceux que je vois tous les jours.
Il va s’asseoir sur le canapé.
CHARLOTTE, lisant.
« Le docteur Mourgue...»
RABOURDIN, l’interrompant.
Ce bon docteur ! Voilà un homme qui entend les malades ! Et qu’a-t-il donné !
CHARLOTTE.
Trois pots de confitures, le 7, et deux litres de sirop, le 13.
RABOURDIN.
Eh bien, mais c’est gentil, c’est convenable, n’est-ce pas, Charlotte ? Il n’est pas de la famille, on ne peut exiger davantage.
CHARLOTTE, continuant.
« Chapuzot... »
S’interrompant.
Votre ancien associé ; il n’est pas de la famille non plus, celui-là.
RABOURDIN, baissant la voix, d’un air effrayé.
Oh ! celui-là... Un cadavre qui tousse à rendre l’âme, qui a toutes sortes de maux incurables... Chapuzot a quatre-vingts ans. Je n’en ai que soixante, Dieu merci ! Et il veut ma maison ; il y a trente ans qu’il attend ma maison.
CHARLOTTE.
Il a donné une haie de framboisiers pour le jardin, trois poiriers, des plants de fleurs et de légumes.
RABOURDIN.
Parbleu ! il arrange son jardin, il se croit déjà chez lui.
CHARLOTTE, lisant.
« Madame Vaussard... »
RABOURDIN.
Ah ! ma bonne Olympe... Qu’a-t-elle donné ?
CHARLOTTE, lisant.
« Le 5, un rond de serviette en argent ; le 15, une timbale. »
RABOURDIN.
C’est juste, j’avais oublié la timbale... Je joue de malheur... Cette chère Olympe dépense gros en chiffons. Impossible de rien demander au mari, un grand bêta d’architecte qui se tue au travail et qui n’a jamais un sou... Autrefois, je leur ai prêté des sommes énormes.
CHARLOTTE.
Reste madame Fiquet qui a donné deux cents francs, le 6.
RABOURDIN, se levant.
Cette pauvre Lisbeth ! elle seule sait trouver de l’argent.
CHARLOTTE, se levant.
Bon, la veuve d’un huissier ! Elle vous en a mangé aussi de beaux billets de mille francs, celle-là.
RABOURDIN.
Elle veut trop entreprendre à la fois. Mais c’est une femme d’expédient, qui ferait pousser des pièces de cent sous sur les pavés... Et c’est tout, Charlotte ? Pas un neveu, pas une nièce, dans un coin ?
CHARLOTTE, qui a pris le registre sur la table.
Il n’y a plus que M. Ledoux, ce jeune homme qui doit épouser votre petite nièce Eugénie.
Montrant le registre à Rabourdin.
Ledoux... un bouquet... un bouquet... et un bouquet.
RABOURDIN.
Oui, des bouquets, toujours des bouquets !
Il passe à gauche.
Alors, personne ! Que faire, mon Dieu ! Isaac va venir justement à l’heure du déjeuner, lorsqu’ils seront tous là. Je suis un homme ruiné, s’ils ont le moindre soupçon.
CHARLOTTE.
Ne vous tourmentez pas ainsi. Combien vous faut-il ?
RABOURDIN.
Deux cent soixante-douze francs.
CHARLOTTE.
Eh bien ! prenez cet argent sur les trois mille francs que ma tante vous a confiés.
RABOURDIN, inquiet.
Sur ta dot ! Jamais, jamais ! J’aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles.
CHARLOTTE.
Comme vous vous défendez ! Hein ! pas de bêtises, n’est-ce pas, mon parrain ?
RABOURDIN, avec un rire forcé.
Tu me fais rire... Les titres sont dans un petit coin. Veux-tu les voir ?... Non, n’insiste pas, c’est inutile. Cet argent est sacré... Bast ! je trouverai… Est-ce que le déjeuner n’est pas prêt ?
CHARLOTTE.
Si, je vais mettre la table.
Elle monte prendre dans le buffet une nappe, qu’elle met sur la table.
RABOURDIN, allant regarder l’heure au coucou, droite.
Bientôt deux heures. Ils vont arriver…
Il se retourne et aperçoit la caisse.
Diantre ! c’est imprudent de laisser la caisse ouverte.
Il prend en passant le registre sur la table ; il le cache au fond de la caisse, qu’il referme, et dont il glisse la clef dans la poche de son gilet ; puis il redescend à l’avant-scène.
Deux cent soixante-douze francs. Ce sera dur, Je vais passer ma robe de chambre jaune ; elle me donne une mine de déterré...
Il se dirige vers la porte de sa chambre et revient vers Charlotte.
Est-ce que j’ai bonne mine, ce matin ?
CHARLOTTE.
Une mine superbe.
RABOURDIN.
Tant pis !... Et les yeux ?
CHARLOTTE.
Excellents, les yeux ! Ils rient et flambent comme braise.
RABOURDIN.
Tant pis, tant pis !... Alors, je n’ai pas l’air d’un homme à l’agonie ?
CHARLOTTE.
Vous !... On ne vous donnerait pas vingt ans.
RABOURDIN.
C’est épouvantable. Tu me nourris trop bien, Charlotte. Je rajeunis, je me mets sur la paille... Et j’ai faim, je suis capable de manger comme un ogre devant eux !... Je n’aurai rien, pas un sou, pas un sou !
Il sort par la porte de gauche. Charlotte remet le fauteuil en place et reporte la chaise à gauche. Dominique est entré doucement. Il tient un petit paquet au bout d’un bâton, qu’il laisse tomber derrière le canapé. Au bruit, Charlotte se retourne et se jette dans ses bras.
Scène II
CHARLOTTE, DOMINIQUE
CHARLOTTE, poussant un cri étouffé.
Dominique !...
Ils s’embrassent.
Toi, à Senlis !
DOMINIQUE, lui tenant les mains.
Hein ! C’est une fière surprise ! Je n’ai pas voulu t’écrire...
Ils se séparent et se regardent émerveillés.
Comme te voilà belle, et grande, et forte !
CHARLOTTE.
Comme te voilà beau, et grand, et fort !
DOMINIQUE.
Cinq ans sans nous voir. Je pensais à toi.
CHARLOTTE.
Oui, cinq ans. Moi, je t’attendais.
DOMINIQUE.
Va, c’est fini. Je suis un homme, maintenant. J’ai dit là-bas que je rentrais au pays. Et je viens te chercher, ma chère femme.
Il lui a donné le bras, ils vont lentement à droite, et reviennent au milieu de la scène pendant que Charlotte parle.
CHARLOTTE.
Mon cher mari... Tu te souviens du moulin de ma tante Nanon... La bonne veille, Dieu ait son âme !... Quand je descendais toute blanche de farine, je te trouvais au bord de l’écluse. Tu faisais une lieue pour venir m’aider à dénicher des nids de pies. Ah ! ces gueuses de pies ! Elles étaient tout en haut des peupliers. J’attachais mes jupes avec des ficelles pour monter. Je n’avais pas peur, je montais aussi haut que toi ; et, d’un arbre à l’autre, nous nous disions bonjour, en plein ciel... En bas, au fond du grand trou, le moulin faisait tic-tac.
DOMINIQUE, lui embrassant la main.
Oui, je me souviens, je me souviens.
CHARLOTTE.
Et le jour où nous avons emmené la Noiraude, la jument du moulin. Nous sommes allés sur la grand’route, tout loin. À la montée, tu te rappelles, quand tu m’as laissée seule sur la Noiraude, voilà que je lui donne des coups de talon dans le ventre et qu’elle part comme une dératée. Tu criais, tu avais peur qu’elle ne me jetât au fossé. Et ça me faisait tant rire, que j’avais pris la jument par le cou, pour rire à mon aise... Il était nuit, quand nous avons entendu, au bout des herbages, le tic-tac du moulin...
Dominique, qui l’a prise dans ses bras, lui baise le cou.
Tu te souviens, tu te souviens !
DOMINIQUE.
Oui, tu étais un garnement... La tante Nanon criait : « C’est un garçon, cette fille-là ! » Et moi, je t’aimais, parce que tu grimpais aux arbres et que tu n’avais pas peur de la Noiraude... Tu es une femme gaillarde, à présent.
CHARLOTTE.
Tu n’as pas l’air peureux non plus, toi.
DOMINIQUE.
Et savante, avec cela ! Tu me jetais des pierres, lorsque je voulais te faire manquer l’école. Si tu avais voulu devenir une demoiselle, tu serais devenue une demoiselle, tout comme une autre.
CHARLOTTE.
Ça m’aurait ennuyée, bien sûr... J’aime mieux être ta femme. C’est juré, d’abord.
DOMINIQUE.
Oui, c’est juré. Nous avons juré ça, un matin, par un beau soleil, derrière une haie... Quand tu voudras, maintenant ?
CHARLOTTE.
Eh ! tout de suite, dès que le curé pourra... La tante Nanon m’a laissé trois mille francs en mourant. Je vais redemander ma dot à mon parrain, et nous nous marierons.
DOMINIQUE.
Trois mille francs ! Tu es riche, toi, Charlotte... Je revenais tout fier. Mais je n’ose plus te dire...
CHARLOTTE.
Quoi donc ?
DOMINIQUE.
J’ai fait des économies... Trois cents francs, trois pauvres cents francs amassés sou à sou. Je les ai là, dans ma poche.
CHARLOTTE.
Mon cher Dominique ! Ce sera pour la chaîne et pour l’alliance... Mon Dieu qu’il fait beau aujourd’hui, et que la vie est bonne !...
Elle lui prend le bras.
Écoute, voici ce que j’ai rêvé. Je crois que le moulin de la tante Nanon est à louer. Lorsque nous serons mariés, nous irons voir, nous mettrons notre argent là, et je serai heureuse d’être meunière, d’être toute blanche de farine, comme au temps où je te retrouvais, près de l’écluse. Nous aurons une jument, nos galopins dénicheront des nids de pies. Veux-tu ? Nous nous aimerons toujours, toujours, au tic-tac du moulin.
DOMINIQUE, l’embrassant de nouveau sur le cou.
Si je veux !
CHARLOTTE, lui échappant et remontant vers le buffet.
Finis donc, tu m’empêches de mettre la table... Les nièces de mon parrain vont arriver.
DOMINIQUE.
Je reste, tant pis !
CHARLOTTE, redescendant avec une assiette qu’elle essuie.
C’est que ces commères bavarderont. J’aurais voulu ne dire qui tu es que plus tard, lorsque les choses seront terminées...
Elle pose l’assiette sur la table.
Il y a un moyen. Écoute. Quand ils seront tous là, tu arriveras carrément, et tu diras à mon parrain, qui ne t’a jamais vu : « Bonjour, mon oncle. »
DOMINIQUE.
Mais il n’est pas mon oncle.
CHARLOTTE.
Ça ne fait rien.
DOMINIQUE.
Il me demandera d’où je sors, quel est mon père, ce que je viens faire à Senlis.
CHARLOTTE.
S’il te demande cela, tu répondras ce que tu voudras, ce qui te passera par la tête.
DOMINIQUE.
Et cette histoire suffira ?
CHARLOTTE.
Parfaitement... Vite, va-t’en par la cuisine, et reviens dans quelques minutes. Voici la clique.
Elle le fait passer par la porte de droite et continue de mettre la table. Les héritiers arrivent successivement.
Scène III
CHARLOTTE, CHAPUZOT, LE DOCTEUR MOURGUE, puis MADAME VAUSSARD, MADAME PIQUET, EUGÉNIE, LEDOUX.
CHAPUZOT, entrant au bras du docteur et descendant à droite.
Vous dites, docteur, que la variole fait beaucoup de victimes dans Senlis ?
MOURGUE.
Sur trente malades, j’en ai une vingtaine atteints par le fléau.
CHAPUZOT.
C’est un joli chiffre... Et les décès, dans quelle proportion ?
MOURGUE.
Mais quinze sur vingt, à peu près... Est-ce que vous êtes vacciné, Chapuzot ?
CHAPUZOT.
Moi, non. Je n’ai pas besoin de ça... On a voulu me vacciner. Ça n’a pas pris. Je suis trop fort.
Il est pris d’un accès de toux qui le renverse sur un canapé.
MOURGUE.
Vous avez tort de négliger cette toux-là.
CHAPUZOT, se relevant, furieux.
Je ne tousse pas. J’ai quelque chose dans la gorge... Je n’ai jamais avalé une drogue de ma vie, docteur, tel que vous me voyez. Et solide ! Je vous enterrerai tous... Eh ! Eh !
Il passe à gauche.
J’en ai déjà vu partir pas mal. Senlis se nettoie.
MOURGUE.
Bah ! vous mourrez comme les autres, mon ami. On meurt pour un rien, sans y penser.
CHAPUZOT, baissant la voix et montrant la porte à gauche.
Chut ! Si ce pauvre Rabourdin vous entendait !
CHARLOTTE.
La nuit a été mauvaise... Il s’est levé tard, il s’habille.
Elle entre dans la chambre de Rabourdin.
CHAPUZOT.
Mauvais symptômes, à son âge, lorsqu’on se lève tard. Enfin, il faut nous faire une raison...
Il s’asseoit sur la chaise à gauche.
Il serait beaucoup plus heureux, s’il était mort.
MOURGUE,
qui est remonté au fond, près de la porte, pour poser son chapeau sur une chaise.
Eh ! c’est la belle madame Vaussard.
MADAME VAUSSARD, entrant.
Toujours galant, docteur.
Elle ôte son chapeau qu’elle accroche près du poêle.
MOURGUE.
Et vous, madame, toujours jeune, toujours superbe, la reine de Senlis !
Il lui baise la main.
Et cet excellent monsieur Vaussard ?
MADAME VAUSSARD.
Merci, il est à la maison, il travaille...
Elle descend.
Je vous annonce ma cousine Fiquet et son pensionnat.
MOURGUE.
Comment, son pensionnat ?
MADAME VAUSSARD, riant, passant à droite.
Oui, sa fille Eugénie et le jeune Ledoux.
Le docteur va s’asseoir sur un canapé, tire un journal et le lit attentivement.
MADAME FIQUET[1], entrant vivement, un panier au bras, ôtant son châle et son chapeau, qu’elle pose sur une chaise, près du buffet.
Eh bien ! et notre oncle, il n’est pas encore à table ?
CHAPUZOT.
Mais il paraît que Rabourdin n’a pas fermé l’œil de la nuit.
MADAME FIQUET, descendant.
C’est que la goutte l’aura travaillé.
Posant son panier sur la table et allant à madame Vaussard.
Bonjour, ma cousine, je vous demande pardon. Je suis tout émotionnée. Je cours depuis ce matin pour une de mes amies ; un procès en séparation, dont je m’occupe un peu ; la pauvre femme n’a pas la tête à elle. J’ai les pièces dans mon panier... Tiens, vous avez là une jolie robe, ma cousine. Combien avez-vous payé ça ?
MADAME VAUSSARD.
L’étoffe, je ne sais pas au juste.
MADAME FIQUET.
J’aurais été curieuse de comparer. J’ai là des échantillons.
Elle montre son panier.
Ça vient d’une faillite. Je place des coupons, par complaisance.
Elle va s’asseoir sur le fauteuil, derrière la table.
Ah ! mes bons amis, si vous saviez, que de peine pour mener à bien la moindre petite affaire !
MADAME VAUSSARD, s’asseyant sur une chaise, près du canapé.
Et n’aurai-je pas le plaisir d’embrasser notre chère Eugénie ?
MADAME FIQUET, surprise.
Hein ! Eugénie ?
CHAPUZOT.
Oui, votre fille, je la croyais avec vous.
MADAME FIQUET.
Ma fille... C’est vrai, elle était avec moi...
Se levant et appelant.
Minette ! Minette !
EUGÉNIE, entrant avec Ledoux.
Nous voici, maman. Nous étions sous le berceau, au frais. Bonjour, ma tante.
Elle descend embrasser madame Vaussard qui s’est levée.
CHAPUZOT[2], à Ledoux qui est venu lui donner une poignée de main.
Ah ! la jeunesse !... Ménagez-vous.
LEDOUX.
Je me porte bien, je vous assure.
CHAPUZOT.
On ne sait pas, on ne sait pas.
MADAME FIQUET.
Allons, mes enfants, retournez au jardin. Faites des bouquets pour votre oncle.
Eugénie et Ledoux sortent. Madame Fiquet et madame Vaussard s’asseoient de nouveau, l’une sur le fauteuil, l’autre sur la chaise.
Scène IV
MADAME FIQUET, MADAME VAUSSARD, CHAPUZOT, MOURGUE
MOURGUE, toujours assis sur le canapé, lisant son journal.
Tiens, l’ottoman est eh baisse d’un franc.
MADAME FIQUET.
Je crois que notre oncle a de l’argent dans ces fonds-là.
MADAME VAUSSARD.
Monsieur Chapuzot, savez-vous si notre oncle a de l’ottoman ?
CHAPUZOT.
Oui, il doit en avoir...
Il se lève et prend le milieu.
Rabourdin n’a jamais eu de flair pour ses placements. Il n’est pas fort.
Les deux femmes se sont levées, prises d’inquiétude.
MADAME VAUSSARD[3].
Il a fait une jolie fortune, pourtant.
CHAPUZOT.
Sans doute, je ne dis pas.
MADAME VAUSSARD.
Une des belles fortunes de Senlis.
CHAPUZOT.
Oui, oui.
MADAME FIQUET.
Pourquoi branlez-vous la tête ? Expliquez-vous ? Alors, il est ruiné ?
CHAPUZOT.
Eh ! non ; il n’est pas fort, voilà tout ! Je dis qu’il n’est pas fort !... Quand nous étions associés, ça me faisait hausser les épaules. La maison aurait été propre sans moi. Pas deux sous d’affaires. J’ai tout gagné. Allez, Rabourdin me doit, un beau cierge...
Il remonte et passe à gauche.
Tenez, c’est comme cette caisse. Eh bien ! elle n’est pas à sa place. Il ne l’a gardée et mise là que pour me vexer.
MADAME VAUSSARD, s’approchant.
Elle est respectable, cette caisse.
MADAME FIQUET, examinant la serrure.
Un bon système.
MADAME VAUSSARD, riant.
Que peut-il y avoir là-dedans ?... Tout en pièces de cent sous, je parie.
Elle remonte et va s’asseoir sur le fauteuil.
MADAME FIQUET.
Bah ! notre oncle a raison d’aimer l’argent, et la caisse est bien là.
Elle lui donne de petites tapes.
C’est une bonne caisse, une caisse heureuse, une caisse fidèle.
CHAPUZOT, qui est resté au fond, ricanant, marchant à petits pas.
Pour le plaisir que Rabourdin tirera de son argent maintenant... N’est-ce pas, docteur ?
MOURGUE, sans lever les yeux de son journal.
Certes.
MADAME FIQUET.
Je craignais quelque perte qui l’aurait affecté...
Elle vient fouiller dans son panier, y prend un petit paquet, puis se dirige vers la cuisine.
Ah ! j’oubliais, j’ai apporté pour lui une semoule digestive. Je vais lui en préparer un potage. Elle est très rafraîchissante et d’un goût exquis...
Sur le seuil de la porte, se retournant.
Vous devriez en manger une assiettée chaque matin, ma cousine, vous qui tenez à avoir le teint clair.
Scène V
CHAPUZOT, MADAME VAUSSARD, MOURGUE
MADAME VAUSSARD, se levant brusquement et regardant sortir madame Fiquet.
L’intrigante !... Elle finira par laver la vaisselle, ici !
CHAPUZOT, toujours dans le fond, furetant.
Eh ! eh !
MADAME VAUSSARD, passant à droite.
Elle étoufferait notre oncle, si elle pouvait, avec sa semoule. D’ailleurs, le laitage ne vaut rien pour les vieillards. N’est-ce pas, docteur ?
MOURGUE, lisant toujours le journal.
Certainement.
MADAME VAUSSARD, revenant à gauche.
Une femme de rien, qui vit d’on ne sait quoi ! Toujours en robe fripée ; pas peignée, à peine débarbouillée.
CHAPUZOT[4], qui est descendu près de la table, à droite.
Cette brave dame, elle a un panier inépuisable.
Soulevant le panier.
Diable ! il n’est pas léger.
Fouillant dans le panier.
Des pots de pommade, des protêts, des billets échus, des échantillons de vins...
MADAME VAUSSARD, fouillant à son tour.
Des photographies, un prospectus de dentiste, un paquet de vieilles dentelles, des lettres ficelées avec une faveur rose, une adresse de sage-femme, un bracelet en or...
CHAPUZOT, continuant.
Et le spécimen du corset en caoutchouc dont elle parle depuis huit jours... Elle peut ouvrir un bazar.
Il passe à gauche.
MADAME VAUSSARD[5].
C’est une honte ! Si l’on voulait parler.
À Chapuzot.
Enfin, c’est elle qui a fâché le percepteur avec sa femme.
À Mourgue.
C’est encore elle qui a marié cette pauvre mademoiselle Reverchon avec ce brutal de pharmacien qu’elle a été obligée de quitter il y a huit jours.
Entre Chapuzot et Mourgue.
Elle bouleverserait Senlis, si on la laissait faire... Il n’est pas possible que notre oncle avantage cette malheureuse, malgré la bassesse de ses cajoleries.
CHAPUZOT.
Moi, je crois, au contraire, qu’il lui laissera tout... Elle compte bien là-dessus pour marier sa fille. La petite est très recherchée.
MADAME VAUSSARD.
Allons donc ! jamais notre oncle ne sera assez fou... N’est-ce pas, docteur ?
MOURGUE, lisant toujours le journal.
Sans doute.
Chapuzot retourne en ricanant s’asseoir sur la chaise, à gauche.
MADAME VAUSSARD.
Ah ! tout le monde n’est pas comme moi ! Je suis bien trop fière. Je tiens mon rang. Ce n’est pas moi qu’on verra jamais à genoux. J’aimerais mieux ne pas avoir le moindre souvenir de mon oncle, que de m’abaisser à un de ces petits services intéressés qui dégradent la main qui les rend.
MADAME FIQUET, rentrant et prenant une assiette dans le buffet.
Maintenant, je vais cueillir des fraises.
MADAME VAUSSARD, montant brusquement et lui arrachant l’assiette.
Laissez ! je vais les cueillir, les fraises !
Elle sort par le fond.
Scène VI
CHAPUZOT, MADAME FIQUET, MOURGUE
MADAME FIQUET, stupéfaite, suivant des yeux madame Vaussard.
Hein ! Que lui prend-il ?... Je les cueille aussi bien qu’elle, les fraises !... L’intrigante !
Elle descend.
CHAPUZOT, ricanant.
Dame ! elle se rend utile.
MADAME FICHET.
Une femme comme il faut qui en fait voir de toutes les couleurs à son grand innocent de mari !... La belle madame Vaussard ! Elle a trente-cinq ans, et elle est mûre comme une poire tombée.
CHAPUZOT, se levant, et venant à elle.
Non, soyez juste, elle est encore très bien et faite pour donner beaucoup d’agrément à un homme.
MADAME FIQUET.
À un homme ! Dites donc à une ville entière. C’est connu. Elle a des jeunes gens dans toutes ses armoires... Je vous dis qu’elle porte des faux cheveux et qu’elle se peint la figure !... N’est-ce pas, docteur, qu’elle se peint la figure.
MOURGUE, lisant toujours le journal.
Oui, oui, elle se peint la figure.
MADAME FIQUET.
Et vous lui indiquez des huiles et des onguents ?
MOURGUE.
Parfaitement, des huiles, des onguents.
MADAME FIQUET.
D’ailleurs, avec des toilettes comme elle en porte, on a toujours l’air de quelque chose. Elles lui coûtent bon, ses toilettes... Tant mieux ! tant mieux ! Nous verrons sur quoi la belle madame Vaussard finira... Ah ! madame donne des dîners, mange aussi bien que le sous-préfet, promène chaque semaine une robe neuve, offre du thé aux jolis jeunes gens ! C’est parfait ! Elle n’aura pas toujours du pain à manger.
CHAPUZOT.
À moins que Rabourdin ne lui laisse sa fortune.
MADAME FIQUET.
Vous voulez rire !
CHAPUZOT.
Dame ! Ses créanciers patientent. Elle a du crédit. Il lui suffit de parler de son oncle pour trouver des prêteurs.
MADAME FIQUET.
C’est cela, de l’escroquerie pure !... Elle a je ne sais quels tripotages avec cet usurier d’Isaac, ce brocanteur qui prête à la petite semaine, et qui bat la contrée pour acheter toutes les vieilleries... Allez, allez, la belle madame Vaussard ne m’inquiète guère.
CHAPUZOT.
Comme vous voudrez... Du moment que vous ne voulez pas voir clair.
MADAME FIQUET.
Vous savez donc quelque chose ?
CHAPUZOT.
Eh ! vous ne devinez pas qu’elle veut empêcher le mariage de votre fille avec M. Ledoux... Elle était au mieux avec M. Ledoux, l’hiver dernier. Elle le nourrissait de petits fours, dans son cabinet de toilette.
MADAME FIQUET.
Si cela était vrai !
CHAPUZOT, remontant.
Tellement vrai, qu’elle est là-bas, en train de cueillir des fraises avec le jeune homme.
MADAME FIQUET, remontant.
Merci, monsieur Chapuzot. Prendre M. Ledoux à ma pauvre Minette !...
Regardant dans le jardin.
Je crois qu’elle lui fait embrasser sa main. Attendez, je vais les guetter par la fenêtre de la cuisine.
Elle sort vivement par la droite.
Scène VII
CHAPUZOT, MOURGUE
MOURGUE, à Chapuzot qui rit en se rasseyant sur la chaise, à gauche.
Vous finirez par les faire prendre aux cheveux.
Il plie son journal et se lève.
CHAPUZOT.
Tiens ! ça m’amuse... Elles sont drôles, quand elles sont en colère. Il faut bien rire un peu.
MOURGUE.
En somme, laquelle des deux héritera, selon vous ?
CHAPUZOT, se levant.
Laquelle des deux… Ni l’une ni l’autre donc ! Comment ! vous êtes encore à croire que Rabourdin laissera son argent à ces deux commères ! Il est bien bête, mais pas à ce point-là.
MOURGUE.
Elles sont ses nièces.
CHAPUZOT.
Une grosse femme qui a des appétits d’ogresse, qui deviendrait insupportable de prétentions, si elle avait de l’argent dans sa poche !
MOURGUE.
Elle est sa nièce.
CHAPUZOT.
Une vieille suspecte qui promène dans son panier toutes les affaires véreuses de Senlis, qui engloutirait dix fortunes, sans qu’on entendît seulement tomber un écu !
MOURGUE.
Elle est sa nièce, que diable !
CHAPUZOT, exaspéré, passant à droite.
Sa nièce ! sa nièce ! qu’est-ce que ça fait ? Est-ce qu’on laisse son bien à des nièces !...
Baissant la voix.
À quoi bon des nièces, quand Rabourdin a autour de lui des amis dévoués, des amis de coeur, qui ne manquent pas un jour de lui tenir compagnie ?
MOURGUE, confidentiellement.
Vous comptez alors que notre pauvre Rabourdin... ?
CHAPUZOT.
C’est une affaire convenue depuis longtemps. Pensez donc ! il y a quarante ans que nous nous connaissons... J’aurai la maison... Je pense réinstaller à l’automne.
Il est pris d’un accès de toux, qui le renverse sur le canapé.
MOURGUE, à part.
Oui, à là chute des feuilles...
Haut.
Soignez ça, entendez-vous. Ça vous jouera quelque mauvais tour.
CHAPUZOT, furieux, se relevant.
Laissez donc ! une simple démangeaison.
MOURGUE, baissant la voix.
Écoutez, entre nous, je dois vous prévenir que madame Fiquet a une promesse de son oncle.
CHAPUZOT.
Une promesse ?... Ce Rabourdin promet donc à tout le monde ?
MOURGUE.
Dame ! il se fait dorloter, c’est son droit. La maison sera au plus tendre, au plus aimant... Soyez tendre, Chapuzot.
CHAPUZOT.
Vous vous moquez ! Je n’irai pas tourner un potage, ni cueillir des fraises, peut-être ! Ah ! non, docteur, j’ai plus de dignité que cela...
Changeant peu à peu de ton.
La vérité est que je n’ai jamais pu voir souffrir personne. Rabourdin serait déjà mort sans moi. Voyez, la table n’est seulement pas mise ! Il manque le sel, le poivre, le pain, la serviette...
Il enlève le panier de madame Fiquet et achève de mettre la table.
MOURGUE, à part, riant.
Ils sont tous grotesques, ma parole d’honneur !...
Il s’assied sur la chaise à gauche.
Moi, je ne bouge pas. J’ai une promesse formelle de Rabourdin. Ce n’est pas moi que l’on surprendra à quelque vilenie.
Il aperçoit Charlotte qui est entrée et qui est allée prendre un des coussins du canapé ; il se lève et le lui arrache des mains.
Donnez, ceci est l’affaire du médecin. Vous le mettez toujours trop bas.
Il arrange le coussin dans le fauteuil.
Là, un vrai dodo.
À ce moment, Rabourdin parait à la porte de gauche, voûté, cassé, l’air agonisant. Mourgue donne de petites tapes sur le coussin. Chapuzot coupe du pain. Les autres personnages se présentent de la façon suivante : madame Fiquet, à droite, avec un potage, madame Vaussard, au fond, avec une assiette de fraises ; Eugénie et Ledoux également au fond, avec des bouquets.
Scène VIII
RABOURDIN, CHARLOTTE, MOURGUE, EUGÉNIE, MADAME VAUSSARD, LEDOUX, CHAPUZOT, MADAME FIQUET
TOUS.
Ah ! le voici !
MADAME VAUSSARD et MADAME FIQUET.
Notre cher oncle !
CHAPUZOT et MOURGUE.
Ce cher ami !
RABOURDIN.
Merci, merci, mes enfants.
MOURGUE, allant le chercher.
Là, venez vous asseoir, j’ai arrangé les coussins, vous allez être comme dans votre lit.
Il l’asseoit dans le fauteuil.
MADAME FIQUET, s’approchant, à droite de la table.
Et vous mangerez votre potage, une semoule au lait et au sucre, une vraie confiture... C’est moi qui l’ai préparée.
Elle pose le potage sur la table.
MADAME VAUSSARD, s’approchant, à gauche de la table.
Je les ai cueillies pour vous... Elles embaument.
Elle pose les fraises sur la table.
CHAPUZOT, s’approchant, en face de la table.
Moi, je vous coupais du pain, le croûton, le bout le plus cuit.
RABOURDIN.
Merci, merci, mes enfants.
EUGÉNIE[6], descendant avec Ledoux, pendant que madame Vaussard et madame Fiquet s’écartent un peu.
Si vous voulez nous permettre de vous offrir ces fleurs ?
RABOURDIN, se mettant debout.
Oh ! des fleurs !...
Il jette un cri étouffé.
Aïe ! j’ai les reins coupés en quatre.
MOURGUE, se précipitant, écartant Eugénie et Ledoux.
Vous le fatiguez...
À Rabourdin.
Je tiens les oreillers, n’ayez pas peur.
MADAME FIQUET, le soutenant, à droite.
Appuyez-vous sur mon bras.
MADAME VAUSSARD, le soutenant, à gauche.
Doucement, doucement.
CHAPUZOT, qui est remonté derrière le fauteuil.
Laissez-le glisser peu à peu, sans secousse. Il y est...
Rabourdin s’asseoit.
TOUS.
Ah ! le voilà assis !
MADAME FIQUET et MADAME VAUSSARD.
Notre cher oncle !
CHAPUZOT et MOURGUES.
Ce cher ami !
Eugénie et Ledoux retournent sournoisement dans le jardin, madame Vaussard passe les bouquets à Charlotte qui va les poser sur le poêle, et qui se retire ensuite par la porte de droite.
Scène IX
MADAME VAUSSARD, MOURGUE, RABOURDIN, MADAME FIQUET, CHAPUZOT
RABOURDIN, assis.
Je respire. J’ai les jambes si lourdes.
MOURGUE.
Diable ! nous avons une mauvaise mine, ce matin.
Il lui prend le pouls.
RABOURDIN.
N’est-ce pas, docteur ? une bien mauvaise mine. J’ai passé une nuit atroce.
MOURGUE.
Le pouls ne dit rien... Voyons la langue... Elle ne dit rien non plus... Je n’aime pas cette absence de symptômes. C’est toujours très grave.
RABOURDIN.
N’est-ce pas, docteur ?
MOURGUE.
Je vais faire une petite ordonnance.
Il remonte au fond et écrit l’ordonnance sur le guéridon, près du poêle.
MADAME FIQUET, debout près de Rabourdin.
Bah ! notre oncle vivra cent ans.
CHAPUZOT, assis sur le canapé.
Cent ans, c’est beaucoup.
MADAME VAUSSARD, assise sur la chaise, à gauche.
Les Rabourdin ont l’âme chevillée au corps.
CHAPUZOT, s’échauffant et se levant.
Eh ! c’est ridicule ! Il connaît son état aussi bien que vous... N’est-ce pas, Rabourdin ?
RABOURDIN, d’une voix dolente.
Oui, oui, mon ami.
CHAPUZOT.
Enfin, il traîne toujours, il est toujours dans les tisanes... Je crois qu’il y a en lui un vice de sang.
RABOURDIN, inquiet.
Mon ami, mon ami...
CHAPUZOT.
Ce que j’en dis, ce n’est pas pour vous effrayer... Là, vous n’êtes pas fort. Le moindre bobo vous flanquerait par terre. Vous savez ce qui vous attend, que diable !
RABOURDIN, se fâchant.
Permettez, Chapuzot, je ne suis pas encore mort... Vous êtes insupportable !
Chapuzot retourne s’asseoir sur le canapé.
MADAME FIQUET.
Eh ! notre oncle se porte à merveille.
MADAME VAUSSARD.
Il nous enterrera tous.
RABOURDIN, reprenant sa voix d’agonisant.
Non, non, Chapuzot a raison ; je suis bien faible... Ah ! mes pauvres enfants, vous ne me garderez pas longtemps au milieu de vous.
MOURGUE, qui a achevé son ordonnance, redescendant.
Voilà... Vous prendrez, d’heure en heure, une cuillerée de la potion ; puis, après chaque repas, un des petits paquets ; puis, le matin, trois des pilules ; puis, tous les deux jours, un grand bain alcalin... Si le mal empirait, envoyez-moi chercher cet après-midi.
Il va prendre son chapeau près de la porte.
RABOURDIN, haussant la voix.
Docteur, je puis manger, n’est-ce pas ?
MOURGUE, revenant.
Légèrement, mon ami très légèrement... Au revoir.
Il sort. Madame Vaussard approche la chaise à quelque distance de la table, et se met à éplucher les fraises. Madame Fiquet attache la serviette au cou de son oncle. Chapuzot est toujours assis sur le canapé.
Scène X
MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET, CHAPUZOT, puis CHARLOTTE
MADAME FIQUET.
Le potage va être froid... Voyons, mon oncle, forcez-vous un peu.
CHAPUZOT.
Il ferait mieux de ne pas manger... Hein ! mon pauvre Rabourdin, ça ne va guère, l’appétit ?
RABOURDIN.
Heu ! heu !
MADAME FIQUET.
Rien qu’une cuiller, mon oncle, pour nous faire plaisir.
CHAPUZOT, se levant.
Eh ! non, laissez-le tranquille, puisqu’il n’a pas faim.
RABOURDIN.
Cependant...
CHAPUZOT.
Il n’a besoin que de son lit, c’est visible.
RABOURDIN.
Permettez. !.... Je n’ai pas faim. Seulement je sens là, dans l’estomac, un creux...
Chapuzot se rasseoit.
MADAME FIQUET.
Oui, oui, faites un effort. Vous mangerez ce que vous mangerez.
RABOURDIN, mangeant.
Si peu, si peu... C’est fini, cette fois. Bientôt, je ne vous dérangerai plus, je vous laisserai la place.
MADAME VAUSSARD.
Oh ! mon oncle, s’il est permis de dire des choses pareilles !
Elle lui verse à boire.
RABOURDIN, mangeant gloutonnement.
Non, ne vous abusez pas... Je sens que je m’en vais.
CHAPUZOT, se précipitant pour lui enlever la tasse.
Rabourdin, vous allez vous faire du mal. Je vous surveille, moi !...
Rabourdin l’écarte et boit le restant du potage.
Voyez donc, il a vidé la tasse.
Il retourne s’asseoir.
MADAME FIQUET.
C’est qu’il a trouvé ma semoule bonne... Mais plus une bouchée... Buvez-moi ces deux doigts de vin, et je vais appeler Charlotte pour qu’elle enlève le couvert.
MADAME VAUSSARD, se levant brusquement, tenant l’assiette de fraises.
Ah ! pardon, je veux que mon oncle goûte mes fraises.
MADAME FIQUET, aigrement.
Il ne peut cependant pas s’étouffer pour vous faire plaisir.
MADAME VAUSSARD, se fâchant.
Je l’ai bien laissé se bourrer de votre potage, moi ! C’est très indigeste, cette pâtée !... N’est-ce pas, mon oncle, que vous allez manger des fraises ?
MADAME FIQUET, bousculant l’assiette.
C’est ce que nous verrons. Je ne permettrai pas qu’on l’oblige à se faire du mal.
RABOURDIN.
Lisbeth ! Olympe ! je vous en prie...
Madame Vaussard pose devant lui l’assiette de fraises.
Il me semblait qu’avant les fraises...
MADAME VAUSSARD.
Avant les fraises...
RABOURDIN.
Oui, Charlotte m’avait promis...
MADAME FIQUET.
Quoi donc ?
RABOURDIN.
Une petite côtelette.
CHAPUZOT.
Une côtelette ! mais il va se donner une indigestion !
RABOURDIN.
Oh ! toute petite, la noix seulement, rien que pour sucer... J’ai là ce creux dans l’estomac, vous savez ; pas la moindre faim, mais un creux atroce.
CHARLOTTE[7], entrant à droite, avec la côtelette.
Mon parrain, voici votre côtelette, bien saignante.
RABOURDIN.
Donne, ma fille... Encore un morceau de pain, Chapuzot.
CHAPUZOT, prenant le pain qu’il a posé debout contre le canapé, et coupant un énorme morceau à part.
Tiens ! si celui-là ne l’étouffé pas !
Il se rasseoit.
CHARLOTTE, passant le morceau de pain à Rabourdin.
Et maintenant, mon parrain, faut-il vous mettre deux œufs sur le plat ?
TOUS.
Ah ! non, non, par exemple !
RABOURDIN.
Hein ? des œufs sur le plat, pourtant... pas trop cuits, avec une pointe de poivre, c’est léger, ça se digère facilement.
TOUS, énergiquement.
Non !
RABOURDIN, résigné.
Eh bien ! non, Charlotte... Ils m’aiment bien, ils sentent que ça ne passerait pas.
Attaquant sa côtelette.
Ça ne pourrait pas passer. Je suis si faible, si faible !
Charlotte sort par le fond. Madame Vaussard va s’asseoir sur la chaise, à gauche. Madame Fiquet s’asseoit sur la chaise, près du canapé.
CHAPUZOT[8], à part.
Ça va l’achever.
RABOURDIN.
C’est de vous voir là, mes enfants. Je m’oublie, en causant ; je mange sans y penser... Est-ce qu’Eugénie n’est pas venue, ce matin ? Je croyais l’avoir vue.
MADAME FIQUET, surprise.
Hein ? Eugénie ?
RABOURDIN.
Votre fille ?
MADAME FIQUET, se levant.
Ah ! oui, ma fille.... Elle était là. Où a-t-elle pu passer ?
Elle va au fond.
Minette ! Minette !
CHAPUZOT, ricanant.
Il y a longtemps que Minette est retournée sous le berceau avec monsieur Ledoux.
RABOURDIN.
Laissez-la, Lisbeth.
Madame Fiquet revient s’adosser à son fauteuil.
Je suis content que cette petite vienne se faire embrasser le bout des doigts dans mon jardin !... Ah ! la famille, la famille ! On ne vit bien que par la famille !
CHARLOTTE[9], entrant par la droite.
Mon parrain, il y a là un jeune homme qui vous demande.
RABOURDIN.
Tu le connais?
CHARLOTTE.
Je ne l’ai jamais tant vu... Il a un panier.
RABOURDIN.
Un panier... Fais-le entrer.
Charlotte appelle du geste Dominique, qui entre par la droite, et qui marche droit à Rabourdin, la main tendue. Charlotte traverse au fond, et descend à gauche, riant et attendant.
Scène XI
MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET, CHAPUZOT, CHARLOTTE, DOMINIQUE
DOMINIQUE.
Bonjour, mon oncle.
Madame Vaussard se lève brusquement et accourt près de son oncle, que madame Fiquet couvre de son corps. Chapuzot s’est également levé, très inquiet.
RABOURDIN[10], surpris.
Hein !...
Se laissant prendre la main.
Bonjour, mon garçon.
MADAME FIQUET, écartant Dominique.
Vous êtes chez monsieur Rabourdin.
DOMINIQUE, posant son panier à l’avant-scène.
Pardi ! mon oncle Rabourdin, un des hommes les plus respectables de Senlis...
Écartant à son tour madame Fiquet.
Et vous allez bien, mon oncle ?
RABOURDIN, toujours surpris, hésitant.
Très bien, mon garçon... Je veux dire doucement, très doucement.
MADAME VAUSSARD, se penchant, bas.
Quelque intrigant !... Est-ce que vous le connaissez ?
RABOURDIN, bas.
Pas précisément... Je cherche à me rappeler sa figure.
DOMINIQUE.
Je suis Dominique, le fils du grand Lucas.
BABOURDIN.
Dominique, le grand Lucas... Certes !
DOMINIQUE.
Vous savez, le grand Lucas, de la ferme de Pressac.
RABOURDIN.
La ferme de Pressac... Oui, oui.
DOMINIQUE.
Et je vais à Paris pour acheter des semences. Alors, mon père m’a dit : « Donne donc le bonjour à l’oncle Rabourdin, en passant à Senlis. Tu lui porteras une paire de canards. » Attendez, les canards sont dans mon panier.
Il les prend et les pose sur la table.
Des canards joliment gras, mon oncle.
RABOURDIN, se frappant le front.
Parfait ! le grand Lucas, de la ferme de Pressac, qui avait épousé...
DOMINIQUE.
Mathurine Taillandier, la fille à Jérôme Bonnardel.
RABOURDIN.
C’est cela !..
Il se lève et donne une poignée de main à Dominique. Charlotte retient un rire et sort par le fond.
Ah ! mon neveu, que je suis donc heureux, de te voir !... Je me disais aussi : Je connais cette figure-là. Tu ressembles comme deux gouttes d’eau à une de mes pauvres tantes... Tout le monde est gaillard à la ferme ?
DOMINIQUE.
Merci. Ils vous disent tous bien des choses.
Il prend, son panier et va s’installer sur le canapé, à côté de Chapuzot.
RABOURDIN.
Tu es chez toi, mets-toi à ton aise...Nous sommes en famille, tous parents, tous amis. Je ne suis content que lorsque la maison est pleine.
Il retourne s’asseoir à la table et reprend sa voix de malade.
J’ai bien des consolations à mes derniers moments... Chapuzot, un morceau de pain, je vous prie. Je vais manger mes fraises.
CHAPUZOT, se levant.
Avec plaisir...
Il coupe un gros morceau de pain. À part.
Crève, crève, mon bon.
Il se rasseoit.
MADAME FIQUET[11], qui a pris à part madame Vaussard.
Mathurine Taillandier, Jérôme Bonnardel, est-ce que vous connaissez ces noms-là ?
MADAME VAUSSARD, bas.
Pas du tout... Le jeune homme a des yeux qui luisent comme des charbons.
MADAME FIQUET, bas.
Il faudra le surveiller.
CHARLOTTE, entrant par le fond.
Mon parrain, voici monsieur Isaac qui entre dans le jardin.
RABOURDIN, très inquiet.
C’est désagréable ! Nous étions si bien, là, en famille !
CHARLOTTE.
Le voici.
Elle sort par la porte à droite. Madame Fiquet dessert la table.
Scène XII
MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET, ISAAC, CHAPUZOT, DOMINIQUE
RABOURDIN, pendant que madame Fiquet lui enlève sa serviette du cou.
Eh ! c’est cet excellent monsieur Isaac ! Ça ne va pas, ça ne va pas, mon pauvre monsieur Isaac... Vous êtes fort comme un Turc, vous !
ISAAC.
Vous êtes bien bon. Je ne me porte pas mal. Je venais pour une petite note.
RABOURDIN.
Une petite note...
ISAAC.
Un ancien compte, deux cent soixante-douze francs, pour une armoire...
RABOURDIN.
Quoi ! l’armoire ne vous a pas encore été payée ? Vraiment, si vous ne me connaissiez pas...
ISAAC.
Oh ! je n’étais pas en peine, monsieur Rabourdin. On sait ce qu’on sait. Je voudrais que vous me dussiez cent fois davantage.
Il lui remet la note.
RABOURDIN.
Deux cent soixante-douze francs...
Il se lève. Madame Vaussard est montée s’asseoir devant le guéridon, où elle feuillette un album ; madame Fiquet achève de desservir la table, Chapuzot cause avec Dominique.
Je ne sais pas si je vais avoir de la monnaie...
Il fouille dans ses poches en se dirigeant vers la caisse.
Je suis pourtant bien sûr d’avoir pris la clef de la caisse sous mon oreiller.
Se fâchant.
Aussi c’est cette écervelée de Charlotte ! On ne retrouve rien dans la maison...
Appelant.
Charlotte ! Charlotte !
MADAME FIQUET, s’approchant, allongeant la main pour tâter la poche du gilet.
La clef est peut-être dans votre gilet.
RABOURDIN, fermant étroitement sa robe de chambre.
Ah ! non, non, je me souviens... Elle sera tombée hier de ma poche. Et j’ai une peur : on l’aura balayée et jetée à la rue...
Appelant.
Charlotte ! Charlotte !
Se fouillant de nouveau.
Mon Dieu, mon Dieu, que c’est contrariant !...
À Isaac.
Vous n’êtes pas pressé ? Autrement je vous aurais envoyé ça cet après-midi.
ISAAC.
J’ai le temps.
Les héritiers, flairant un emprunt, tournent tous le dos à Rabourdin. Madame Fiquet, qui a porté la table derrière le canapé, est remontée devant le buffet. Madame Vaussard met les bouquets dans des vases, sur le poêle. Chapuzot cause toujours avec Dominique, côte à côte, sur le canapé.
RABOURDIN[12].
Tant mieux ! tant mieux !... Quand on ne trouve pas, vous savez, on perd la tête.
Réfléchissant.
Pas le moindre souvenir. Tout se brouille. Va te faire lanlaire !... Chapuzot ?
CHAPUZOT, se tournant à regret.
Quoi, mon ami ?
RABOURDIN.
Vous n’auriez pas la somme sur vous, par hasard ?
CHAPUZOT.
Non...
Regardant dans son porte-monnaie.
J’ai trente-sept sous. Je ne prends jamais d’argent sur moi. Ça embarrasse.
Il reprend sa causerie avec Dominique.
RABOURDIN.
Vous avez bien raison. Je vous demandais cela en l’air, pour en finir... Asseyez-vous donc, monsieur Isaac. Ce sera peut-être long.
ISAAC.
Merci... Ne vous inquiétez pas de moi.
RABOURDIN.
Nous allons tâcher de trouver la somme, que diable !... Vous dites trente-sept sous, Chapuzot ?
Chapuzot gonfle le dos sans se retourner.
Ce ne serait- pas trente-sept francs ? Non. Tant pis !... Ma bonne Olympe, vous avez bien quelques louis ?
MADAME VAUSSARD, descendant, d’un air contrarié.
Mais non, mon oncle, pas dix francs seulement. J’ai payé ma modiste en venant ici, de sorte que je suis à sec.
Elle remonte.
RABOURDIN.
Deux cent soixante-douze francs... Nous n’y arriverons jamais... Et vous, Lisbeth ?
MADAME FIQUET, descendant avec son panier.
Attendez... Je regardais justement... Quelquefois, j’ai de l’argent qui traîne. L’argent, ça tombe toujours au fond, dans les miettes... Non, voilà trois pièces de quatre sous, avec des centimes, que la boulangère m’a rendus...
Elle remonte.
ISAAC, s’avançant.
Je ne vous cacherai pas que j’ai, ce matin, un petit paiement à faire.
RABOURDIN.
Un petit paiement ! Je sais ce que c’est qu’un petit paiement ! Il faut absolument que je retrouve cette clef... Mon Dieu ! mon Dieu !
Il remonte, la tête entre les mains.
DOMINIQUE, à part.
Il me fait de la peine, le bonhomme !...
Haut, quittant le canapé.
Vous dites deux cent soixante-douze francs, mon oncle ?
RABOURDIN, surpris.
Oui, mon garçon.
DOMINIQUE, lui remettant trois billets de banque.
Voici trois cents francs.
Tous les héritiers descendent, stupéfaits.
RABOURDIN[13], tenant les billets.
Ah ! ce cher neveu ! ce brave neveu !... Il a trois cents francs, à son âge ! C’est bien, cela, c’est très bien ! Ça fait honte aux grandes personnes... Embrassez-moi petit. Tu es un vrai Rabourdin !... Payez-vous, monsieur Isaac.
CHAPUZOT, ricanant, à demi-voix.
Est-ce bête, la jeunesse !
MADAME VAUSSARD, à madame Fiquet, bas.
Décidément, il me déplaît, ce gamin.
MADAME FIQUET, bas.
Quelque fripon.
ISAAC.
Eh ! eh ! les bons comptes font les bons amis... Voici vingt-huit francs, monsieur Rabourdin.
RABOURDIN.
Bien, bien...
Il serre la main que tend Dominique pour prendre la monnaie, et met cette monnaie dans sa poche.
Nous compterons, mon garçon, J’ai la mémoire du cœur. La famille, c’est ma vie.
S’attendrissant.
Mes pauvres enfants, vous retrouverez tout après ma mort.
Les héritiers, qui se sont rapprochés, baissent la tête et reculent.
ISAAC.
Je ne suis pas venu pour cette misère... Je voulais vous proposer des pendules... Vous en désiriez une pour votre chambre à coucher.
RABOURDIN.
Oh ! un caprice.
ISAAC, lui remettant des photographies.
J’ai là des reproductions...
RABOURDIN.
Voyons...
Tenant les photographies.
En effet, voilà de belles pendules... Nous pouvons toujours donner un coup d’œil à la cheminée... Venez tous, vous me direz votre avis.
Il sort au bras de Dominique. Tous le suivent. Au moment où Isaac va rentrer dans la chambre, il est arrêté par madame Vaussard.
Scène XIII
MADAME VAUSSARD, ISAAC
MADAME VAUSSARD, arrêtant Isaac.
Pardon, monsieur Isaac... Êtes-vous aussi méchant qu’hier ? Vous ne pouvez me refuser le renouvellement de ces billets.
ISAAC.
Je suis désolé, vraiment désolé. Vous avez déjà renouvelé les billets cinq fois... Pourquoi ne me faites-vous pas payer par votre oncle, qui vous aime tant ?
MADAME VAUSSARD, vivement.
Pas un mot de ceci à notre oncle !...
D’une voix pénétrée.
Si je vous ai reparlé des billets, c’est que je pensais qu’après avoir vu notre pauvre oncle...
ISAAC.
Eh ! eh ! il est encore gaillard.
MADAME VAUSSARD.
Oh ! gaillard.
ISAAC.
Mon Dieu, si l’on était sûr, je renouvellerais bien encore. Je vous avancerais même les trois mille francs que vous m’avez demandés hier... Vous savez que je ne suis pas un méchant homme...
Il passe à gauche.
Seulement, le père Rabourdin, eh ! eh ! je crois qu’on devra le tuer à coups de bonnet de coton, comme on dit. C’est un malade solide...
Voix de Rabourdin, dans la coulisse : Monsieur Isaac ! Monsieur Isaac !
Pardon, il m’appelle.
Il entre à gauche.
MADAME VAUSSARD, le suivant.
Quel misérable, cet Isaac ! Attendre ainsi le dernier soupir d’un vieillard.
Scène XIV
MADAME FIQUET, LEDOUX
MADAME FIQUET, à la cantonade.
Reste sous le berceau, Minette.
Entrant, poussant Ledoux devant elle.
Il est inutile que la pauvre chérie entende...
À Ledoux.
Oui, ma cousine vous faisait embrasser sa main.
LEDOUX.
Je vous assure, madame...
MADAME FIQUET.
Vous êtes ridicule, voilà que vous rougissez maintenant ! Je vous parle de cela uniquement au point de vue de notre affaire... Oui ou non, épousez-vous toujours ma fille Eugénie ?
LEDOUX.
J’aime mademoiselle Eugénie, et si les espérances que vous m’avez fait entrevoir se réalisent...
MADAME FIQUET.
Oh ! pas de phrases... Je donne à Eugénie cent mille francs de dot. En autre, si vous êtes gentils tous les deux, je vous laisserai la maison... Vous seriez bien, ici.
LEDOUX.
Je me permettrai de vous faire remarquer, madame, que nous n’y sommes pas encore. Monsieur Rabourdin...
MADAME FIQUET.
Il est au plus mal, mon cher... D’ailleurs, cette pauvre Minette ne saurait attendre davantage. Son oncle comprendra... Voici deux mariages déjà qu’il lui fait manquer, et elle aura bientôt vingt-deux ans.
LEDOUX.
Enfin, je crois qu’il serait bon d’attendre...
MADAME FIQUET.
Le mariage aura lieu en septembre, au plus tard. Voyez si cela vous arrange... Nous valons cent mille francs, au bas mot. Le dernier épouseur de Senlis sait, cela... Oh ! rompons, si vous voulez. Nous y gagnerions monsieur...
Remontant et désignant son panier.
J’ai là, en note, des partis : un de cent quatre-vingt mille, un de deux cent vingt mille, un de deux cent mille...
LEDOUX.
Eh ! non ! non ! j’épouse. L’affaire est conclue.
MADAME FIQUET.
Vous épousez ! L’affaire est conclue ! Touchez là... Vous pouvez aller retrouver Eugénie sous le berceau.
Ledoux sort.
Mon Dieu ! que ces enfants me donnent du mal !
Elle s’asseoit sur le canapé.
Scène XV
CHAPUZOT, RABOURDIN, MADAME FIQUET, DOMINIQUE, puis ISAAC et MADAME VAUSSARD
RABOURDIN, entrant avec Chapuzot, regardant les photographies, pendant que Dominique traverse au fond et descend à droite.
Je trouve la pendule Empire un peu grande... Quel est votre avis, Chapuzot ?
CHAPUZOT.
Eh ! eh ! j’aimerais à avoir la pendule Louis XVI, sur ma cheminée. Prenez la pendule Louis XVI, Rabourdin.
MADAME FIQUET, se levant.
Non, par exemple ! Je choisis la pendule Louis XV, moi ! Un vrai bijou pour la chambre d’une mariée, si vous voulez jamais en faire cadeau à une de vos petites-nièces.
Elle remonte à droite, et met son châle et son chapeau.
ISAAC, entrant avec madame Vaussard, qui reste au fond, à gauche, occupée à mettre son chapeau.
La garniture Louis XV est la plus chère... Douze cents francs.
RABOURDIN[14].
Bon Dieu !...
Il rend les photographies à Isaac.
Douze cents francs ! Si je faisais une pareille folie, je croirais ruiner mes héritiers.
MADAME FIQUET et MADAME VAUSSARD.
Oh ! mon oncle !
RABOURDIN, gagnant la porte avec Isaac.
Et votre dernier prix est vraiment douze cents francs ?
Ils disparaissent dans le jardin.
CHAPUZOT[15], près de la porte, bas.
Il en a une envie folle.
MADAME FIQUET, bas.
Non, non, il deviendrait d’une exigence !... Il faut nous jurer de ne pas courir la lui acheter en sortant d’ici.
MADAME VAUSSARD, bas.
Jurons, je le veux bien.
CHAPUZOT, bas.
Oh ! moi, je n’ai pas besoin de jurer... Méfiez-vous du petit-neveu.
RABOURDIN, du jardin.
Venez-vous, mes enfants ?
Ils sortent tous les trois. Au moment où Dominique va les suivre, il est arrêté par Charlotte, qui entre à droite.
Scène XVI
DOMINIQUE, CHARLOTTE
CHARLOTTE.
Bonjour, mon oncle ! Bonjour, mon neveu !... Hein ! que te disais-je ? Vous étiez joliment drôles, tous les deux.
DOMINIQUE.
Eh ! ton parrain me plaît. Ce pauvre vieux a l’air d’être si innocemment la proie de ces gens... Il a été bien embarrassé tout à l’heure, quand cet Isaac est venu. Il avait perdu la clef de sa caisse.
CHARLOTTE.
Ah ! il avait perdu la clef de sa caisse ?
DOMINIQUE.
Il fallait voir la figure des autres ! Ils n’avaient pas un sou sur eux... Alors, moi, j’ai fait le crâne, j’ai sorti mes trois cents francs.
CHARLOTTE.
Tu as prêté tes trois cents francs à mon parrain ?
DOMINIQUE.
Mais oui... Il m’a dit que nous compterions.
CHARLOTTE, éclatant.
Ah ! non, non, mon parrain ! je ne vous permets pas ça !...
À Dominique.
Aussi, tu es bien godiche, toi !
DOMINIQUE.
Puisqu’il avait perdu la clef de sa caisse !
CHARLOTTE.
La clef, la clef...Tais-toi, tiens ! ça me jette hors de moi.
DOMINIQUE.
Il me le rendra, cet argent. Je suis bien tranquille.
CHARLOTTE, exaspérée.
Tu es volé, là, comprends-tu ?... C’est ma faute. J’aurais dû t’expliquer tout de suite... Mais il faudra qu’il retrouve les trois cents francs, jour de ma vie ! Et je veux ma dot, mes trois mille francs, dès ce soir !
DOMINIQUE.
Chut !... Pas devant le monde.
RABOURDIN, à la cantonade.
Non, décidément, monsieur Isaac, ne comptez pas sur moi...
CHARLOTTE, qui est allée le chercher et qui le ramène violemment par le poignet.
À nous deux, maintenant, mon parrain !
ACTE II
La chambre à coucher de Rabourdin. Porte au fond, donnant sur la salle à manger ; elle est flanquée d’une armoire, à gauche, et d’un lit tendu de rideaux, à droite. À gauche, au second plan, une fenêtre donnant sur le jardin ; au premier plan, une porte. À droite, au premier plan, une cheminée garnie seulement de deux flambeaux. Meubles de chambre à coucher, table de nuit à la tête du lit, chaises, etc. Sur le devant de la scène : à gauche, un fauteuil, près d’un guéridon ; à droite, un autre fauteuil.
Scène première
RABOURDIN, CHARLOTTE
CHARLOTTE, ouvrant la porte du fond et amenant violemment Rabourdin par le poignet.
Vous n’avez pas honte, mon parrain ! Prendre les trois cents francs de ce pauvre garçon !
RABOURDIN.
Est-ce que je savais ?... Mets-toi à ma place. Il entre, il me dit : « Bonjour, mon oncle. » Naturellement, j’ai cru qu’il était mon neveu.
CHARLOTTE.
Et vous avez accepté les trois cents francs ?
RABOURDIN.
Tiens ! puisqu’il était mon neveu !
CHARLOTTE.
Vous avez même gardé la monnaie.
RABOURDIN.
Sans doute, puisqu’il était mon neveu !
CHARLOTTE.
Vous saviez pourtant que vous ne pourriez rendre cet argent.
RABOURDIN.
Mais puisqu’il était mon neveu !... On ne trompe pas les gens comme ça ! Tu l’exposais, ton amoureux, à toutes sortes d’histoires. Je lui aurais demandé la pendule, parbleu !
Il passe à gauche.
CHARLOTTE.
Ne nous fâchons pas... Vous allez toujours me donner ma dot.
RABOURDIN, inquiet.
Ta dot... Tu veux ta dot ?
CHARLOTTE.
Dame ! pour me marier.
RABOURDIN.
Pour te marier... Parbleu ! j’entends bien... Mon enfant, c’est une chose grave que le mariage. Il faut réfléchir. Tu es trop jeune, vois-tu.
CHARLOTTE.
J’ai vingt ans.
RABOURDIN.
Comme les petites filles grandissent vite ! Vingt ans déjà !... D’ailleurs, là, entre nous, ton prétendu ne me plaît pas. Il a l’air d’un mauvais sujet.
CHARLOTTE.
Lui ? Vous le trouviez charmant.
RABOURDIN.
Oh ! charmant... Je suis faible tu sais, pour mes neveux. Mais, du moment qu’il s’agit de toi, de ton bonheur... Il a un regard dont je me méfie. Tu serais malheureuse.
Il va s’asseoir sur le fauteuil, à droite.
CHARLOTTE.
Malheureuse avec Dominique ! Dites donc, mon parrain, ne vous moquez pas !... Je veux ma dot.
RABOURDIN.
Bien, bien, je te la remettrai... le jour de ton mariage.
CHARLOTTE.
Je veux ma dot tout de suite.
RABOURDIN, feignant de rire.
Tout de suite, voyez-vous ça ! Eh bien ! non, mademoiselle, vous ne l’aurez pas tout de suite.
CHARLOTTE.
Mon parrain...
RABOURDIN, se levant et passant à droite.
Tu es ridicule, enfin ! Tu fais les choses en coup de vent... Que diable ! on ne reprend pas de l’argent d’une façon si brutale... Je ne sais plus où j’en suis, moi... Et si j’en avais disposé, de ton argent ?
CHARLOTTE.
Mon parrain...
RABOURDIN, larmoyant.
Ils m’ont tout pris, ma pauvre. Charlotte, ils m’ont laissé nu comme un ver, mes gredins d’héritiers !
CHARLOTTE, le secouant.
Ma dot ! ma dot !
RABOURDIN.
Ce sont eux, je te jure.
CHARLOTTE.
Un argent sacré, n’est-ce pas ?... Vous auriez préféré, disiez-vous, gratter la terre avec vos ongles.
RABOURDIN.
Oui, oui, gratter la terre... Oh ! les gueux !
Il s’asseoit sur le fauteuil, à gauche.
CHARLOTTE.
Alors, c’est fini, nous n’avons plus un sou. Les trois cents francs de Dominique, escamotés ! Les trois mille francs de ma tante, envolés ! Et vous pensez que je vais accepter cela tranquillement ! Non, par exemple ! Je mettrais plutôt le feu aux quatre coins de Senlis.
RABOURDIN.
Tu aurais bien raison.
CHARLOTTE.
Je ne vous ai pas ruiné, moi ; je ne suis pas une de vos nièces, pour que vous vous vengiez en me prenant mes trois mille francs...
Allant à la porte du fond et appelant.
Dominique !
Dominique entre.
Et nous qui voulions louer le moulin. Cet argent était tout notre rêve.
Scène II
RABOURDIN, CHARLOTTE, DOMINIQUE
RABOURDIN, se levant.
Là, là, mes enfants, ne vous chagrinez pas... L’argent ne donne pas le bonheur... Quel couple de chérubins vous ferez !
CHARLOTTE, à Dominique.
Tu l’entends ?... Va, j’avais deviné. Plus un sou...
À Rabourdin.
Maintenant, mon parrain, je veux tout savoir.
DOMINIQUE.
Parle-lui doucement.
RABOURDIN.
Sans doute, elle me bouscule... Moi, quand on me bouscule, je perds la tête.
CHARLOTTE.
Ne plaisantons pas... À qui avez-vous donné les trois mille francs ?
RABOURDIN.
À qui ?
CHARLOTTE.
Oui, à quelle nièce, à quel neveu ? Dans quelle poche dois-je les reprendre, enfin ?
RABOURDIN.
Dame ! faudrait que je pusse me souvenir…
CHARLOTTE.
Le vieux Chapuzot,peut-être ?
RABOURDIN.
Oui, peut-être.
CHARLOTTE.
Cette bique de madame Fiquet ?
RABOURDIN.
Ça se pourrait.
CHARLOTTE.
Ou cette chipie de madame Vaussard ?
RABOURDIN.
Eh ! eh ! je n’en mettrais pas la main au feu.
Il traverse et remonte la scène.
CHARLOTTE[16].
Mais parlez, dites un oui ou un non bien net !...
À Dominique.
Crois-tu que j’aie besoin de patience !
DOMINIQUE.
Tu t’emportes, tu te fais du mal.
RABOURDIN, redescendant.
Eh ! je ne sais pas, je ne peux pas savoir ! Cent sous d’un côté, cent sous de l’autre, parbleu ! La caisse s’est vidée, sans que je devinasse par quelle fente ! Ils étaient une bande à m’emprunter, à me carotter, à me voler... Ce que je sais, c’est qu’ils ont emporté jusqu’au dernier liard.
CHARLOTTE.
Voilà. Nous sommes remboursés.
RABOURDIN.
Si je les avais, vos trois mille francs, je vous les rendrais tout de suite. Je n’ai jamais rien eu à moi. Vous le retrouverez tôt ou tard, cet argent...
S’attendrissant.
On retrouvera tout après ma mort.
CHARLOTTE.
Ah ! non, pas cette farce-là avec moi ! Je sais ce qu’on retrouvera... Alors, mon argent est allé à toute la clique ?
RABOURDIN.
Mes pauvres enfants !
CHARLOTTE.
Eh bien ! toute la clique paiera... Jour de ma vie ! ils rendront gorge ou je ne me nomme pas Charlotte...
Asseyant violemment Rabourdin sur le fauteuil, à gauche.
Vous d’abord, vous allez vous allonger là-dedans et ne plus bouger.
RABOURDIN.
Ne me brutalise pas... Pourquoi ne plus bouger ?
CHARLOTTE, à Dominique.
Toi, tu vas courir chez les amis, les neveux, les nièce, et me les envoyer tout de suite... Tu leur diras que l’oncle Rabourdin est à l’agonie.
RABOURDIN, effrayé.
À l’agonie ?
CHARLOTTE.
Oui, à l’agonie !... Ajoute qu’il crache le sang, qu’il râle, qu’il a perdu l’ouïe et la vue.
RABOURDIN.
Mais non, mais non !... Je voudrais savoir...
CHARLOTTE.
Ah ! pas d’explication, n’est-ce pas ? Vous allez trépasser, c’est convenu...
À Dominique.
Tu m’as comprise ?
DOMINIQUE.
Oui... Bonne chance.
Il se dirige vers la porte du fond.
CHARLOTTE.
Non, passe par là.
Elle lui indique la porte de gauche.
Et n’en oublie pas un, envoie-les-moi tous.
DOMINIQUE.
Ils seront ici avant un quart d’heure.
Il sort par la porte de droite.
Scène III
RABOURDIN, CHARLOTTE
CHARLOTTE joignant l’action aux paroles.
À présent, la toilette de chambre. Il faut un certain désordre... Les draps de lit tirés et traînant à terre... Des vêtements jetés au hasard... Ah ! une chaise renversée près de la porte. Cela fait très bien.
RABOURDIN, qui a regardé ces préparatifs, suppliant.
Si tu me disais pourtant ?...
CHARLOTTE.
Tout à l’heure... Je vais d’abord allumer du feu.
Elle apprête et allume du feu.
RABOURDIN.
Du feu, en juin ! Mais j’ai déjà trop chaud, je vais étouffer. Tu me rendras malade.
CHARLOTTE.
Tant mieux !
RABOURDIN.
Comment ! tant mieux !
CHARLOTTE.
Vous auriez une bonne fièvre que cela avancerait fort nos affaires... Là, songeons maintenant à la tisane.
Elle prend une bouillotte sur la cheminée et la met au feu.
RABOURDIN, se levant.
Je ne veux pas boire de tisane.
CHARLOTTE.
Laissez donc, vous en boirez...
Elle va regarder sur la table de nuit.
Qu’est-ce que c’est que cela ?... Du chiendent, à merveille !
Elle met le paquet de chiendent dans la bouillotte.
RABOURDIN.
Non, non, pas de chiendent ! C’est absurde, du chiendent, lorsqu’on a bien déjeuné ! Ça va me noyer l’estomac... Je n’en boirai pas, d’ailleurs.
CHARLOTTE.
Vous en boirez, vous dis-je !...
Regardant autour d’elle.
La mise en scène est encore un peu pauvre. Il faudrait des bouteilles, des potions, des drogues... Attendez, j’ai mis l’ordonnance du médecin dans le tiroir de la table de nuit.
Elle prend l’ordonnance.
RABOURDIN.
Je te défends d’aller chez le pharmacien.
CHARLOTTE.
Certes, je n’ai pas envie d’y aller... Vous avez toujours un tas de saletés dans votre armoire. Les premières drogues venues feront l’affaire.
Elle passe à gauche. Elle ouvre l’armoire, monte sur une chaise et consulte l’ordonnance.
Voyons... Une potion. En voici une... Des petits paquets. En voici une douzaine intacte parmi vos foulards... Des pilules. Diable ! où mettez-vous vos pilules ? Ah ! j’en aperçois une boîte sous vos caleçons...
Elle saute de la chaise.
Et un bain. C’est fâcheux que nous n’ayons pas un bain...
Elle vient poser les remèdes sur le guéridon.
En attendant, vous allez prendre tout ça.
RABOURDIN, s’approchant.
Moi ! jamais ! Es-tu folle ? Rêves-tu de m’empoisonner ? Des médecines qui sont lasses de traîner dans l’armoire !
Il passe à gauche.
CHARLOTTE.
Elles n’en sont pas plus mauvaises. Vous les avez entamées, vous pouvez bien les finir, j’imagine !
RABOURDIN.
Non, je me révolte, à la fin. Tu abuses de la situation.
CHARLOTTE, le poussant de nouveau dans le fauteuil.
Voulez-vous bien vous rasseoir !... À présent, un peu de désordre dans le col de votre chemise. C’est cela !... Je vais prendre la couverture de votre lit.
Elle va chercher la couverture.
RABOURDIN.
Mais j’étouffe, je te dis que j’étouffe ! J’aurai un coup de sang, c’est sûr.
CHARLOTTE, revenant.
Tant pis ! la couverture est de rigueur...
Elle l’enveloppe.
Là, allongez-vous...
Agenouillée devant lui.
Vous ne voulez donc plus rentrer dans votre argent, vous faire entretenir par vos héritiers ?
RABOURDIN.
Si ! si !... Les gueux ! je leur prendrai jusqu’à leur dernière chemise.
CHARLOTTE.
Eh bien ! je vais commencer par vous faire donner cette pendule dont vous avez une si grande envie.
RABOURDIN.
Vrai, j’aurais la pendule.
CHARLOTTE, se relevant.
Vous n’avez qu’à agoniser proprement. Je me charge du reste... La pendule, l’argent, je veux tout. J’entends que vos nièces se souviennent longtemps de moi.
RABOURDIN.
Hein ! ménage mes héritiers. Ne me les égorge pas. Je te les confie.
CHARLOTTE.
N’ayez pas peur !... La tête un peu renversée, les lèvres entr’ouvertes, les yeux fermés, l’air de ne plus entendre et de ne plus voir. Très bien, très bien !...
Reculant et l’examinant.
Oh ! le beau mourant que vous faites ! Vous êtes joliment laid, mon parrain... Attention !
Allant à la fenêtre.
C’est le Chapuzot.
RABOURDIN.
Le gredin ! va-t-il être content !
Scène IV
RABOURDIN, CHARLOTTE, CHAPUZOT
CHARLOTTE, arrêtant Chapuzot et se jetant dans ses bras.
Ah ! mon Dieu ! monsieur, c’est fini, hi ! hi ! hi !
Elle pleure.
CHAPUZOT.
Du calme, mon enfant... Tu vois que j’ai tout mon calme, moi !
CHARLOTTE, l’arrêtant de nouveau.
J’étais seule, j’ai eu une peur affreuse. Il m’a fallu le transporter, l’arranger. Et depuis une demi-heure, il est là, ha ! ha ! ha !
Elle pleure.
CHAPUZOT[17], se débarrassant d’elle et venant regarder Rabourdin.
Eh ! il respire encore !...
Emmenant Charlotte à droite, baissant la voix.
Enfin, que s’est-il passé ?
CHARLOTTE.
Ça l’a pris tout d’un coup, après le déjeuner.
CHAPUZOT.
Oui, il a mangé comme un ogre... Des morceaux de pain énormes.
CHARLOTTE.
Alors il est devenu tout pâle.
CHAPUZOT.
Bien !
CHARLOTTE.
Il avait les yeux retournés...
CHAPUZOT.
Bien !
CHARLOTTE.
Les joues glacées, la langue pendante...
CHAPUZOT.
Bien ! bien !
CHARLOTTE.
Et il ressemblait à un vrai noyé, sauf votre respect.
CHAPUZOT.
Très bien !.. Mais est-ce qu’il n’as pas craché le sang ?
CHARLOTTE.
Le sang, bon Dieu ! J’ai craint qu’il ne se vidât comme une cruche... Il ne serait pas capable maintenant de remuer le petit doigt.
CHAPUZOT.
Parfait !
Après un coup d’œil jeté sur Rabourdin.
Et la voix ? comment a-t-il la voix ? Très faible, n’est-ce pas ?
CHARLOTTE.
Hélas ! mon bon monsieur, il n’a plus parlé.
CHAPUZOT, ravi, très haut.
Dis-tu vrai ?
Baissant le ton.
J’ai le verbe si haut, que je l’incommode peut-être.
CHARLOTTE.
Non, ne vous gênez pas. Il a perdu l’ouïe et la vue.
CHAPUZOT, s’approchant de Rabourdin.
Il n’entend plus, il ne voit plus ! Ah ! le digne ami, l’excellent ami !...
Revenant vers Charlotte.
Moi qui ai des oreilles d’une finesse, des yeux d’une netteté ! Eh ! eh ! je suis son aîné pourtant.
CHARLOTTE.
Ne vous comparez pas à mon parrain. Vous en enterreriez dix comme lui... Quatre-vingts ans, la belle affaire ! C’est à soixante ans que les grosses maladies se déclarer, et qu’elles vous emportent...
Elle traverse et se place entre Rabourdin et Chapuzot.
Regardez-le donc, dans son fauteuil, et voyez comme vous vous tenez droit, comme vos jambes sont fermes, comme toute votre personne respire la fraîcheur et la santé !
CHAPUZOT.
Tu as raison, petite, je me porte bien. C’est bon, de se bien porter !... Ce vieux Rabourdin ! Est-il bête de se laisser tomber à ce point !
Baissant la voix.
Cette fois, d’après les symptômes, j’ai bien peur...
CHARLOTTE.
Dites que c’est une chose certaine.
CHAPUZOT.
N’est-ce pas ? Nous pouvons sans crainte nous abandonner à notre douleur.
CHARLOTTE.
Sans aucune crainte, hélas !
CHAPUZOT, venant examiner Rabourdin.
Les yeux morts, plus une goutte de sang...
S’éloignant, le dos tourné, avec un frisson.
Il est déjà froid.
RABOURDIN, entre ses dents.
Gredin de Chapuzot !
CHAPUZOT, se retournant, effaré.
Hein ! n’a-t-il point parlé ?
CHARLOTTE, le ramenant vivement à l’avant-scène.
Monsieur, on n’a pas retrouvé cette malheureuse clé ; je suis bien embarrassée pour les petites dépenses... Puis, je n’oserais ouvrir la caisse. L’argent est à vous, maintenant.
CHAPUZOT, radieux.
À moi ! C’est vrai, l’argent est à moi !... Chère petite !
CHARLOTTE.
Alors, j’ai pensé qu’au lieu d’enfoncer la caisse...
CHAPUZOT, violemment.
Je ne veux pas qu’on touche à ma caisse !...
D’une voix hésitante, et remontant, pour gagner la porte.
J’avancerai quelque chose, s’il le faut. Mets les factures de côté. Je payerai, oui, je payerai, plus tard...
Redescendant et prenant Charlotte à part.
Crois-tu qu’il ira jusqu’à ce soir ?
RABOURDIN, entre ses dents.
Infâme Chapuzot !
CHAPUZOT, se retournant, terrifié.
Je t’affirme qu’il a remué.
CHARLOTTE.
Eh ! non, c’est la couverture qui glisse...
Remontant la couverture, bas à Rabourdin.
Tenez-vous donc tranquille !
RABOURDIN, bas.
Je lui saute à la gorge, si tu ne le jettes à la porte !
CHAPUZOT.
Que te dit-il ?
CHARLOTTE.
Eh ! il ne dit rien, mon bon monsieur. Il râle, le pauvre cher homme...
Revenant.
Je vous priais donc de m’avancer quelques centaines de francs...
CHAPUZOT, gagnant la porte.
Non, non, ne parlons pas d’argent. J’ai trop de chagrin... Je cours chercher le docteur, pour qu’il nous rassure... Plus tard, plus tard.
Il se sauve, poursuivi par Charlotte.
Scène V
RABOURDIN, CHARLOTTE
RABOURDIN, se levant d’un bond et allant ouvrir toute grande la porte que Charlotte vient de refermer.
Ah ! misérable ! gueux ! scélérat !
CHARLOTTE, refermant la porte.
Taisez-vous, il est encore dans la salle à manger.
RABOURDIN.
Laisse-moi me soulager...
Rouvrant la porte.
Vaurien ! coquin ! assassin !
CHARLOTTE, refermant la porte.
Eh ! vous allez tout gâter... Vous voilà rouge comme une pivoine.
RABOURDIN, descendant la scène, gravement.
J’ai du sang sous la peau, bien sûr ?
CHARLOTTE.
Certes.
RABOURDIN.
Mes yeux sont vivants ?
CHARLOTTE.
Très vivants.
RABOURDIN.
Et ma langue est à sa place ?
CHARLOTTE.
Il me semble qu’elle s’acquitte joliment de sa besogne.
RABOURDIN, montrant le poing à la porte.
Canaille !....
À Charlotte.
Touche-moi un peu, pour voir. Comment me trouves-tu ? Suis-je froid ?
CHARLOTTE.
Vous êtes d’une bonne chaleur, mon parrain.
RABOURDIN, soulagé, s’abandonnant.
Ah ! tu me fais du bien ! Je renais... Ce brigand de Chapuzot a une façon si convaincue de vous croire mort et enterré ! J’agonisais sous la couverture, j’avais mal partout... Il a dit : « Ma caisse », ce cadavre ! Jamais tu ne tireras un sou de cette affreuse carcasse.
CHARLOTTE, qui regarde par la fenêtre.
Si, si, ayez quelque patience.
Elle revient vivement et le fait asseoir dans le fauteuil, à droite.
RABOURDIN.
Je ne fais plus le mort, ça m’attriste.
CHARLOTTE.
Bon !... Soupirez un peu, mon parrain...
Rabourdin soupire agréablement.
Ce n’est pas ça, c’est un soupir de demoiselle que vous faites là !... Tenez, plus fort, dans ce genre.
Elle jette un soupir douloureux.
Un râle, un beau râle.
Scène VI
CHARLOTTE, MADAME FIQUET, LEDOUX, RABOURDIN, EUGÉNIE
RABOURDIN, guettant la porte.
Ha ! mon Dieu ! ha ! que je souffre !
MADAME FIQUET, descendant rapidement la scène, suivie des deux jeunes gens.
C’est donc vrai ! notre pauvre oncle ! Et nous qui allions sortir pour une affaire !
Elle garde le milieu, après s’être débarrassée de son panier ; Ledoux et Eugénie s’adossent au fauteuil de Rabourdin, l’un a gauche, l’autre à droite.
RABOURDIN.
Ha ! mon Dieu !
EUGÉNIE.
Où avez-vous mal ?
LEDOUX.
Est-ce à la poitrine ? est-ce au ventre ?
RABOURDIN.
Ha ! ha !
CHARLOTTE.
Voilà ce qu’il me répond depuis une demi-heure. Il ne jette qu’un cri... Vous voyez dans quel état est la chambre. Une crise abominable. J’ai cru que j’allais devenir folle... Je suis brisée.
Elle s’assied sur le fauteuil, à gauche.
RABOURDIN.
Ha ! ha !
MADAME FIQUET.
Mais on ne peut le laisser passer ainsi !... Il faut se remuer...
À Charlotte.
N’avez-vous rien fait, des briques chaudes, des cataplasmes, de la tisane ?
CHARLOTTE.
Il y a de la tisane devant le feu.
MADAME FIQUET.
Vite, alors... Eugénie, donne une tasse de tisane.
Eugénie prend une tasse sur la cheminée et l’emplit de tisane.
RABOURDIN.
Ha ! ha !... Non, rien, je souffre trop.
EUGÉNIE, passant la tasse à sa mère.
Maman, elle est bouillante.
MADAME FIQUET.
Tant mieux !... Ouvrez la bouche, mon oncle.
RABOURDIN, serrant les lèvres.
Non, je ne puis pas, j’étouffe.
MADAME FIQUET.
Il la boira quand même...
Elle le fait boire malgré lui.
C’est vrai, elle était un peu chaude...
À Rabourdin.
Hein ! ça vous réchauffe ?
RABOURDIN.
Ha ! ha !
MADAME FIQUET.
Eugénie, une autre tasse.
RABOURDIN, épouvanté.
Je meurs, plus de tisane, par grâce !
MADAME FIQUET.
Les malades disent tous cela...
S’approchant du guéridon.
Et sa potion ?
CHARLOTTE.
Il y a plus d’une heure qu’il ne l’a prise.
MADAME FIQUET.
Bien...
Elle verse de la potion dans une cuiller.
Voilà une drogue qui ne sent pas bon.
RABOURDIN.
Ha ! ha !
MADAME FIQUET, à Ledoux.
Monsieur Ledoux, prenez-lui la tête...
Elle retourne à Rabourdin et lui enfonce la cuiller dans la bouche.
Là.
CHARLOTTE.
C’est aussi l’heure de ses pilules. Vous pouvez lui en donner trois.
MADAME FIQUET, revenant au guéridon.
Parfait.
À Ledoux.
Ne le lâchez pas.
Elle fait glisser les pilules dans sa main.
Il y en a quatre. Ça ne produira que plus d’effet...
Elle retourne à Rabourdin, auquel elle fait prendre les pilules.
Il avale ça comme un ange.
RABOURDIN.
Pouah ! j’étrangle !
Il tousse violemment.
MADAME FIQUET.
La tisane, la tisane ! Que fais-tu donc, Eugénie ?
EUGÉNIE, lui donnant la tasse de tisane.
Voici, maman.
LEDOUX, qui est allé regarder sur le guéridon.
Il y a là des petits paquets...
CHARLOTTE.
Les petits paquets sont pour mettre dans la tisane.
MADAME FIQUET.
Parfait !...
Ledoux vide un petit paquet dans la tasse.
Une drôle de couleur... Ça ne va plus être assez sucré. Regardez donc dans mon panier... Vous ne voyez pas des morceaux de sucre ?
LEDOUX, qui est remonté vers la table de nuit.
Deux morceaux, madame.
Il les lui apporte.
MADAME FIQUET, avec un sourire aimable.
C’est le sucre du café que vous nous avez offert dimanche...
Elle met les morceaux dans la tasse.
Eugénie, aide monsieur Ledoux à le tenir.
RABOURDIN, se débattant.
Je vais mieux, je vais tout à fait bien, laissez-moi !
MADAME FIQUET, après l’avoir fait boire.
Eh ! il en entrerait encore dix comme cela…
RABOURDIN.
Ha ! mon Dieu ! ha ! ha ! je suis mort !
Il laisse tomber la tête. Puis, il s’endort peu à peu.
EUGÉNIE.
Je crois qu’il est évanoui.
LEDOUX.
Il en a assez.
CHARLOTTE, se levant.
Oui, il me paraît en avoir assez... Son évanouissement le repose.
MADAME FIQUET.
Sans doute. La tisane lui a fait un bien énorme. Vous voyez, il ne souffle plus. C’est là que je voulais en venir...
À Eugénie et à Ledoux.
Gardez-le, mes enfants, et s’il se plaignait encore, n’hésitez pas, de la tisane !...
Les deux amoureux remontent doucement vers le lit, sans s’occuper davantage de Rabourdin. Madame Fiquet emmène Charlotte à gauche[18].
Quand il s’est vu si près de sa fin, ne vous a-t-il rien confié d’important ?
CHARLOTTE.
Non... Seulement, il n’a cessé de parler de cette pendule.
MADAME FIQUET.
La pendule Louis XV... Et que disait-il ?
CHARLOTTE.
Il en parlait comme d’une amie, comme d’une personne véritable, qu’il aurait vivement désirée voir à son lit de mort... Elle serait là, près de son lit. Cela le distrairait. Il regarderait les aiguilles marcher, il serait moins seul.
MADAME FIQUET.
Bon.
CHARLOTTE.
Il radotait ainsi qu’un amoureux, madame... Je vous dis ces choses, parce que vous êtes de la famille... Il est des détails si intimes...
MADAME FIQUET.
Continuez, mon enfant. Je comprends toutes les passions.
CHARLOTTE, très émue.
Enfin, il voudrait qu’elle sonnât sa dernière heure.
MADAME FIQUET.
Sa dernière heure...
CHARLOTTE.
Hélas ! madame, sa dernière heure.
MADAME FIQUET.
Et il laissera son héritage à la personne qui lui donnera la pendule ?
CHARLOTTE.
Évidemment, il laissera son héritage à la personne qui... Ah ! pour le coup, vous êtes plus futée que moi.
MADAME FIQUET.
L’habitude des affaires. Un mot me suffit.
Appelant.
Monsieur Ledoux !
LEDOUX.
Madame...
MADAME FIQUET, le prenant à part, au milieu du théâtre,
pendant que Charlotte remonte vers l’armoire, et qu’Eugénie reste devant le lit.
Cet argent que vous alliez placer, vous l’avez sur vous, n’est-ce pas ?... Prêtez-moi douze cents francs.
LEDOUX, inquiet.
Permettez...
MADAME FIQUET.
Une affaire que je vous expliquerai et qui assure votre mariage.
LEDOUX, hésitant, regardant Rabourdin.
Alors, vous croyez ?...
MADAME FIQUET, montrant Rabourdin.
Eh ! mon cher, regardez-le. L’affaire est claire, les pièces sont là... Vous devez comprendre qu’à cette heure ma fille n’est pas embarrassée.
LEDOUX.
Voici les douze cents francs.
Il lui remet l’argent.
MADAME FIQUET.
Bien...
À Eugénie et à Ledoux.
Mes enfants, gardez votre oncle. Je reviens tout de suite.
CHARLOTTE, l’arrêtant au fond, à demi-voix.
Vous allez chercher la pendule ?
MADAME FIQUET.
Pas encore... Je veux savoir, je cours chez le docteur.
Scène VII
CHARLOTTE, LEDOUX, EUGÉNIE, RABOURDIN
EUGÉNIE.
Comme il fait chaud, ici !
LEDOUX.
On étouffe, mademoiselle... Si l’on entr’ouvrait la fenêtre.
EUGÉNIE, traversant, allant à la fenêtre.
Oui, oui.
CHARLOTTE.
Non, pas de courant d’air !
LEDOUX, s’approchant, à demi-voix.
Nous pourrions aller au jardin, mademoiselle.
EUGÉNIE, regardant par la fenêtre.
Je ne veux pas, je ne veux pas... Enfin, voilà maman dans la rue ! Allons au jardin, monsieur Ledoux.
Ils sortent en se souriant.
Scène VIII
CHARLOTTE, RABOURDIN
CHARLOTTE.
Des gens commodes, ces amoureux ! On n’a pas besoin de les mettre à la porte...
S’approchant de Rabourdin.
Hé ! mon parrain !... Tiens ! il ne bouge plus. Serait-il mort pour tout de bon ?
Reculant.
Dites, pas de ces farces-là, c’était pour rire. Répondez donc, mon parrain, vous savez bien que j’ai peur des morts.
Rabourdin laisse échapper un ronflement formidable. Elle s’approche, en riant.
Ma parole ! il s’est endormi. Il ronfle comme un soufflet de forge... Hé ! mon parrain !
RABOURDIN, s’éveillant en sursaut.
Hein ! quoi ? pas de tisane !... Vous m’ennuyez à la fin, je me porte comme le Pont-Neuf !
Il se lève et passe à gauche.
CHARLOTTE, riant.
Mon pauvre parrain !
RABOURDIN.
Ah ! tu es seule, méchante gale... M’avoir fait avaler toutes ces saletés ! Pouah !
CHARLOTTE, courant à la fenêtre.
Silence !
RABOURDIN, revenant à droite.
C’est que cette sieste m’a ragaillardi. J’aurais volontiers fait un petit tour.
CHARLOTTE.
Silence...
Elle vient le rasseoir.
Les voici avec le docteur.
Scène IX
CHARLOTTE, MADAME FIQUET, MOURGUE, RABOURDIN, MADAME VAUSSARD
MOURGUE, accourant auprès de Rabourdin, suivi des deux femmes.
Quoi donc ! mon bon ami, vous souffriez, et je n’étais pas là !
RABOURDIN.
Ah ! docteur !
MOURGUE.
Calmez-vous, me voici, que diable ! Je suis tout à votre, chère santé.
Il lui prend le pouls.
MADAME VAUSSARD.
De grâce, docteur, rassurez-nous.
MOURGUE, galamment.
Je suis aux ordres de la reine de Senlis.
MADAME FIQUET.
Donnez-nous une bonne parole.
MOURGUE.
Tout de suite...
Après un silence.
Mais cela va aussi mal que possible, je crois.
RABOURDIN.
Plus mal que jamais.
MOURGUE.
Oui, tout à fait mal...
Aux deux femmes.
Tranquillisez-vous.
Madame Fiquet, songeuse, s’écarte vers la gauche, pendant que madame Vaussard reste près de Rabourdin.
CHARLOTTE[19], s’approchant, au docteur.
Je puis vous dire, monsieur, quels symptômes se sont déclarés.
MOURGUE.
Inutile, mon enfant... Il suffit qu’on ait veillé à ce que mon ordonnance de ce matin fût bien exécutée.
CHARLOTTE.
Certes, monsieur, il a tout pris... C’est alors que la crise s’est produite.
MOURGUE.
Évidemment. Les remèdes remuent toujours les malades. N’avez-vous pas une plume et une feuille de papier ?
Charlotte prend sur le guéridon une plume et un buvard qu’elle apporte au docteur.
RABOURDIN.
Encore une ordonnance, docteur ?
MOURGUE, écrivant.
Oh ! presque rien : un sirop,des pastilles, une eau minérale, un onguent et des sangsues... Je vous recommande les sangsues... Vingt-cinq, entendez-vous ?
RABOURDIN, inquiet.
Non, non.
CHARLOTTE.
Vingt-cinq sangsues. C’est comme s’il les avait déjà.
MOURGUE, revenant à Rabourdin.
Là, mon bon ami, je vous trouve déjà mieux. Rien ne ragaillardit un malade comme un petit bout d’ordonnance... À propos, on m’a dit que Chapuzot courait après moi. Je l’ai aperçu, en venant ici, nu-tête au soleil, l’air fou, riant et chantant comme un homme ivre. Son état m’inspire de sérieuses inquiétudes.
RABOURDIN.
Ce bon Chapuzot... C’est le chagrin de me voir dans un si triste état.
MADAME VAUSSARD, à Rabourdin.
Vous seriez beaucoup mieux dans votre lit, mon oncle.
CHARLOTTE, bas à madame Fiquet.
Madame, je crois que ce neveu, ce Dominique, pour la pendule…
MADAME FIQUET, bas.
Je l’avais oublié ! Et il n’est pas là, c’est vrai !... Je cours. Pas un mot.
Elle sort par la porte de droite, en évitant d’être vue.
CHARLOTTE, à part.
À l’autre.
Scène X
CHARLOTTE, CHAPUZOT, MOURGUE, RABOURDIN, MADAME VAUSSARD
MOURGUE, courant à Chapuzot qui entre, l’air hébété, balbutiant, chancelant.
Eh ! que disais-je ?...
À Charlotte.
Aidez-moi, mon enfant.
Ils amènent Chapuzot à gauche, sur le fauteuil.
CHAPUZOT.
Rien... ce n’est rien... le soleil... Ah ! ce cher Rabourdin ! Ça m’a fait un effet ! Tout dansait.
Il s’asseoit.
MOURGUE.
Je vais vous reconduire et vous mettre au lit.
CHAPUZOT.
Moi ? allons donc ! Jamais je ne me suis senti si gaillard... Laissez, fermez-lui les yeux, ne vous inquiétez pas de moi... Ouf ! cette joie, ce grand soleil !
Il s’évanouit.
MOURGUE.
J’attendais ça... Vite, de l’eau, un linge mouillé.
Il remonte au fond, cherchant.
RABOURDIN, entre ses dents.
S’il pouvait crever devant moi !
Gémissant.
Ha ! ha !
MADAME VAUSSARD, près de Rabourdin, à droite.
Mon Dieu, docteur, voilà mon oncle qui passe.
MOURGUE, allant à Rabourdin.
Il faudrait des sinapismes.
CHARLOTTE, près de Chapuzot, à gauche.
Docteur, il ne souffle plus, je crois bien qu’il étouffe.
MOURGUE, allant à Chapuzot.
Je vais le saigner.
MADAME VAUSSARD.
Mais, docteur, vous ne pouvez le laisser mourir ainsi.
MOURGUE, allant à Rabourdin.
Je suis à lui, belle dame.
CHARLOTTE.
Dites-moi au moins ce que je dois faire, docteur.
MOURGUE, allant à Chapuzot.
Tout de suite, mon enfant.
MADAME VAUSSARD.
Docteur...
CHARLOTTE.
Docteur...
MOURGUE, s’arrêtant au milieu et s’épongeant le front.
Grâce ! La science est impuissante. Je ne puis en sauver qu’un à la fois.
RABOURDIN, soupirant.
Ha ! ha ! Lui si gaillard ! s’en aller avant moi !
Mourgue s’empresse auprès de Rabourdin, madame Vaussard remonte devant le lit.
CHAPUZOT, sortant de son évanouissement.
Hein ! il parle !
CHARLOTTE.
Voilà les frissons qui vous prennent... Voulez-vous qu’on vous transporte chez vous ?
Elle remonte, guettant madame Vaussard.
CHAPUZOT.
Non, je suis très bien sur ce canapé...
Regardant Rabourdin, à part.
J’attendrai.
CHARLOTTE[20], au fond, bas à madame Vaussard.
Madame, je crois que madame Fiquet, pour la pendule...
MADAME VAUSSARD.
Elle n’est plus là, c’est vrai !... Et moi qui m’amuse !
Elle sort vivement par le fond.
CHARLOTTE, à part.
Et de deux... Celle qui rentrera les mains vides, rendra la dot.
Elle remonte et range du linge dans l’armoire.
Scène XI
CHAPUZOT, CHARLOTTE, MOURGUE, RABOURDIN, puis MADAME FIQUET, puis ISAAC
MOURGUE, allant de Chapuzot à Rabourdin.
Moi, j’aime mes malades... Chapuzot, mon ami, vous êtes menacé, je vous le dis une fois encore... Voulez-vous qu’on vous couvre davantage, Rabourdin ?... Vous ne sauriez croire combien je suis heureux d’être ainsi entre deux de mes plus chers clients !
RABOURDIN.
Le pauvre Chapuzot !
CHAPUZOT.
Le pauvre Rabourdin !
MADAME FIQUET[21], parlant à la cantonade.
N’entrez pas tout de suite. Je vous appellerai...
À Rabourdin.
Mon oncle, serez-vous bien sage, bien raisonnable ?
RABOURDIN.
Je suis doux comme un mouton, ma bonne nièce.
MADAME FIQUET.
M’aurez-vous de la reconnaissance, vous souviendrez-vous à toute heure de votre Lisbeth ?
RABOURDIN.
Certes.
MADAME FIQUET.
Une chose heureuse, que je crains de vous annoncer tout d’un coup....
À Mourgue.
Docteur, mon oncle peut-il supporter une grande émotion ?
MOURGUE.
Une grande émotion... Je serais curieux d’étudier sur lui l’effet d’une grande émotion.
Il lui prend le pouls.
Allez, madame.
CHARLOTTE[22], allant se mettre près de Chapuzot.
Attendez, je vais me placer à côté de monsieur Chapuzot, par prudence, dans le cas où l’émotion le gagnerait.
MADAME FIQUET, au fond, sur le seuil de la porte.
Bien... Je puis agir, n’est-ce pas ?...
À la cantonade.
Monsieur Isaac, veuillez entrer.
Entrée d’Isaac, qui porte la pendule. Il s’arrête au milieu de la scène.
RABOURDIN[23].
Ah ! la pendule, la chère pendule !
Il la regarde d’un air ravi.
CHAPUZOT, entre ses dents.
Ça va lui porter un coup.
CHARLOTTE, à Chapuzot.
Ménagez-vous, tournez la tête.
RABOURDIN, les yeux toujours fixés sur la pendule.
Et elle est à moi, elle couchera dans ma chambre !... Monsieur Isaac, je vous en prie, ne bougez pas.
ISAAC.
C’est qu’elle me casse les bras.
RABOURDIN.
Quelle finesse de ciselure !
MADAME FIQUET, derrière le fauteuil, bas.
Eh bien ! docteur ?
MOURGUE, très grave, tenant toujours le pouls.
Le pouls est plus vif, la chaleur revient.
RABOURDIN.
Quelle pureté dans les moindres détails !
MOURGUE.
Parfait, les muscles reprennent leur jeu, la vie déborde.
MADAME FIQUET, à part.
Hein ! il irait mieux !...
Haut.
Posez la pendule sur la cheminée, monsieur Isaac.
Isaac passe devant Rabourdin, qui suit la pendule des yeux.
CHAPUZOT, entre ses dents.
Il est rose comme une fille... La peste !
RABOURDIN[24], après qu’Isaac a posé la pendule sur la cheminée.
De près, oh ! de près elle est plus désirable encore !
MOURGUE, tenant toujours le pouls de Rabourdin.
Plus de fièvre, rien qu’un doux frisson, un cœur de quinze ans battant pour la première fois.
RABOURDIN, se tournant vers madame Fiquet.
Merci, Lisbeth.
MADAME FIQUET.
Attendez...
D’une voix navrée.
Elle sonne, mon oncle, elle sonne.
ISAAC, qui règle la pendule.
Oui, la sonnerie est en bon état.
MADAME FIQUET.
Hélas ! mon pauvre oncle !...
La pendule sonne.
Un son bien triste, mon Dieu !
RABOURDIN.
Une voix d’oiseau...
La pendule sonne de nouveau.
Une musique de printemps. Elle sonne la vie... Attendez, je vais la régler moi-même.
Il s’oublie et court à la cheminée.
MADAME FIQUET, stupéfaite.
Le voilà debout, maintenant !
CHAPUZOT, ahuri.
Debout !
Il a une crise, Charlotte lui tape dans les mains.
MOURGUE.
Très bien... Ce sont les pilules qui agissent.
RABOURDIN, très embarrassé, feignant de chanceler.
Pardon... la joie... J’ai cru que je pourrais... Menez-moi à mon lit. Cet effort m’a brisé.
Madame Fiquet et Mourgue le conduisent à son lit et restent auprès de lui.
Scène XII
CHAPUZOT, CHARLOTTE, MOURGUE, RABOURDIN, MADAME FIQUET, ISAAC, MADAME VAUSSARD
MADAME VAUSSARD, sur le seuil de la porte, à part.
C’est cela, la pendule est sur la cheminée... Quelle gueuse !
Arrêtant Isaac sur le bord de la scène[25].
Je pense que, devant la profonde affliction qui me menace, vous ne faites plus aucune difficulté pour le renouvellement des billets.
ISAAC.
Aucune, en effet, madame... Nous ajouterons les petits intérêts d’usage.
MADAME VAUSSARD.
Et vous me prêterez trois nouveaux mille francs.
ISAAC.
Oui, je pense pouvoir les prêter... j’irai voir votre mari.
MADAME VAUSSARD.
Inutile, il travaille, vous le dérangeriez... Revenez ici dans une heure. J’aurai les papiers nécessaires.
Elle remonte et l’accompagne jusqu’à la porte. Isaac sort.
CHARLOTTE, qui a entendu, tout en feignant de s’occuper de Chapuzot.
Trois mille francs, juste ma dot !
MOURGUE, toujours devant le lit.
Oui, mon ami, tournez-vous du côté de la ruelle, tâchez de dormir.
Il descend. Madame Vaussard s’approche.
MADAME FIQUET, descendant la scène, bas à Mourgue.
Un faux espoir, n’est-ce pas ? la dernière lueur de la lampe près de s’éteindre ?
MOURGUE.
Sans doute. Je reviendrai, dans la soirée, s’il le faut...
Il monte au fond prendre son chapeau et redescend vers Chapuzot. Charlotte est devant le lit. Madame Vaussard et madame Fiquet sont à droite, à l’avant-scène, où elles échangent des regards terribles.
Chapuzot, vous devriez aller vous coucher.
CHAPUZOT.
Eh ! non, fichtre ! on ne m’éloignera pas... Je consens à prendre l’air au jardin, mais c’est tout.
MOURGUE.
Eh bien ! venez au jardin.
Il veut lui donner le bras.
CHAPUZOT, se débattant.
Laissez donc, je vous porterais, si je voulais.
Il est pris d’une crise et manque de tomber. Mourgue l’emporte.
Scène XIII
MADAME VAUSSARD, MADAME FIQUET, CHARLOTTE, devant le lit, RABOURDIN, couché
MADAME VAUSSARD, furieuse, très haut.
Nous ne devions pas lui faire un tel cadeau. C’est vous qui aviez proposé de jurer...
CHARLOTTE, venant se mettre entre elles.
Eh ! doucement, mesdames, mon parrain s’assoupit.
Elle remonte près du lit dont elle ferme les rideaux.
MADAME VAUSSARD, continuant à voix basse.
Un simple guet-apens, n’est-ce pas ?
MADAME FIQUET, à voix basse.
J’ai été plus alerte que les autres, voilà tout.
MADAME VAUSSARD.
Dites moins délicate.
MADAME FIQUET.
Eh ! vous étiez sur mes talons !... Chacun pour soi... Tant pis, si vos falbalas vous ont empêchée de courir !
MADAME VAUSSARD, haussant la voix peu à peu.
Mes falbalas ! Ah ! des injures maintenant. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain... Je trouverai un autre cadeau pour mon oncle.
MADAME FIQUET, haussant la voix peu à peu.
C’est cela.
MADAME VAUSSARD.
Un cadeau plus beau que le votre, moins sot, de meilleur goût.
MADAME FIQUET.
Comme vous voudrez... Je lui en apporterai un plus cher.
MADAME VAUSSARD.
Moi, un plus cher.
MADAME FIQUET.
Et moi, un plus cher encore.
MADAME VAUSSARD, très haut.
Madame !
MADAME FIQUET, très haut.
Madame !
CHARLOTTE, venant de nouveau se mettre entre elles.
Eh ! de grâce, allez au jardin... Il dort.
MADAME FIQUET, prenant Charlotte à part.
C’est cette hypocrite !... Je ne m’en vais pas, si elle reste...
Bas.
Décidez votre parrain en ma faveur, et votre fortune est faite.
Elle remonte.
MADAME VAUSSARD, prenant Charlotte à part.
L’insolente !... Je ne consens à me retirer que derrière elle...
Bas.
Mon enfant, je compte sur vous, je vous récompenserai.
MADAME FIQUET, devant la porte.
Passez la première, madame.
MADAME VAUSSARD, même jeu.
Madame, passez la première.
CHARLOTTE, les poussant toutes les deux.
Eh ! sortez ensemble.
Scène XIV
CHARLOTTE, RABOURDIN, puis DOMINIQUE
CHARLOTTE.
Impossible de respirer avec de pareilles commères sur les bras !
RABOURDIN, passant la tête prudemment, entre les rideaux.
Personne... Eh ! Charlotte !
CHARLOTTE.
Quoi, mon parrain ?
RABOURDIN.
Plus une nièce, tu es sûre ? Hein ? derrière les fauteuils, sous les meubles ?
CHARLOTTE.
Non, non, ils sont tous dans le jardin.
RABOURDIN.
Alors...
Il saute du lit.
Attends, le verrou, pour plus de précaution.
Il va pousser le verrou et revient en battant des entrechats.
Houp ! houp ! ça fait du bien... Houp là ! J’ai les jambes rouillées, ma parole !
CHARLOTTE.
Prenez garde, ils vont vous entendre.
RABOURDIN.
Tant pis ! j’ai la pendule...
Il la prend, par la taille et, la force à valser avec lui, en chantonnant.
J’ai la pendule, j’ai la pendule...
CHARLOTTE.
Finissez donc... Je n’ai pas ma dot, moi ! Il faut que le Chapuzot et la Vaussard s’exécutent.
Elle entend frapper à la porte de droite.
Voici Dominique.
Elle va ouvrir la porte. Dominique entre.
RABOURDIN, qui est allé regarder la pendule.
Ravissante !... Il est vrai que je l’ai bien gagnée depuis ce matin.
DOMINIQUE[26], tranquillement.
Elle n’est pas encore à vous.
RABOURDIN, se retournant, très inquiet.
Hein ? que dit mon neveu ?
DOMINIQUE.
Je dis que je connais le marché conclu entre votre nièce Fiquet et le sieur Isaac.
RABOURDIN.
Eh bien !... elle a acheté la pendule douze cents francs ?
DOMINIQUE.
Non, elle l’a louée, jusqu’à ce soir, pour dix francs... Vous comprenez, mon oncle... ce soir, vous serez mort.
RABOURDIN, ahuri.
Ce soir, je serai mort...
Comprenant.
Ah ! la gredine ! je la reconnais bien là.
CHARLOTTE, riant.
Mon pauvre parrain !
RABOURDIN, exaspéré.
Je suis volé, je suis assassiné...
Traversant, et allant s’asseoir à droite.[27]
Écoute, Charlotte, torture-les, ruine-les, donne-leur quelque bonne maladie qui les emporte de rage... Je te fais cadeau de la pendule si tu la leur arraches.
CHARLOTTE.
C’est dit... Mais il faut contenter d’abord ces excellents parents.
RABOURDIN.
Les contenter !... Pas de mauvaise plaisanterie, n’est-ce pas ?
La pendule sonne.
CHARLOTTE, la main tendue vers la pendule.
Elle sonne votre dernière heure, mon parrain.
Rabourdin se lève brusquement d’un air d’épouvante. Puis, tous trois sont pris d’un fou rire.
ACTE III
Le même décor qu’à l’acte I.
Au lever du rideau, madame Fiquet et madame Vaussard sont assises aux deux côtés de la table ronde, l’une à gauche, l’autre à droite ; la première classe des papiers qu’elle tire de son panier posé a côté d’elle ; la second écrit. Chapuzot, adossé contre la caisse, à gauche, cause avec Dominique. Ledoux et Eugénie, côte a côte sur le canapé, à droite, parlent à voix basse en se souriant.
Scène première
CHAPUZOT, DOMINIQUE, MADAME FIQUET, MADAME VAUSSARD, LEDOUX, EUGÉNIE, puis CHARLOTTE
Toute cette scène se dit à demi-voix.
MADAME FIQUET, s’arrêtant dans son travail pour prêter l’oreille.
Il me semble que j’ai entendu un gros soupir.
TOUS, regardant la porte de la chambre, qui est grande ouverte.
Un gros soupir...
MADAME FIQUET.
Oui, c’est comme un souffle qui m’a passé dans le dos... Attendez.
Elle se lève et va à la porte ; elle appelle doucement.
Charlotte !
CHARLOTTE, paraissant sur le seuil de la porte.
Chut !
MADAME FIQUET.
Rien de nouveau ?
CHARLOTTE, d’une voix très basse.
Ah ! Seigneur ! c’est la fin... N’entrez pas, le moindre bruit l’exaspère.
MADAME FIQUET.
Et le docteur est toujours là ?
CHARLOTTE.
Oui, oui... Chut !
Tous les héritiers haussent les épaules et tournent le dos à la porte.
MADAME VAUSSARD, aigrement, à madame Fiquet, qui vient se rasseoir.
Voici la quatrième fois que vous nous émotionnez pour rien.
Elles se remettent toutes deux à la besogne.
CHAPUZOT.
Ça vous porte un coup, c’est bête.
DOMINIQUE.
Si nous nous asseyions.
CHAPUZOT.
Non, l’air m’a remis, je suis très bien, appuyé de cette façon...
Il caresse la caisse de la main, en parlant.
Je vous disais donc que la maison...
Dominique lui fait signe de parler plus bas.
Oui, oui... la maison...
Il continue à voix basse.
LEDOUX, tendrement.
Cette journée, mademoiselle, est la plus belle de mon existence.
EUGÉNIE, minaudant.
Ah ! monsieur Ledoux, ah! Vraiment !...
LEDOUX.
Je l’ai passée tout entière avec vous, et vous avez bien voulu me laisser entendre que vous m’aimiez.
EUGÉNIE.
Maman m’a permis cet aveu.
MADAME FIQUET, sans lever la tête.
Tiens ! elle lui donne à boire... Je viens d’entendre le bruit de la cuiller dans la tasse.
CHAPUZOT, sans regarder la porte.
C’est quelque chose de sucré... Elle a pris le sucrier sur la table de nuit.
MADAME VAUSSARD, sans cesser d’écrire.
Non, dans l’armoire... L’armoire a crié.
EUGÉNIE, continuant, à Ledoux.
Maman m’a autorisée à vous abandonner ma main, depuis que mon pauvre oncle...
LEDOUX.
Vous êtes un ange.
Il lui baise la main.
EUGÉNIE.
Maman assure qu’à nous deux nous réunirons près de vingt mille francs de rentes. J’ai des projets, oh ! des projets. Je veux un salon plus beau que celui de ma tante Vaussard ; je veux une femme de chambre ; je veux six toilettes par an, une petite voiture, un petit cheval, un petit château...
LEDOUX.
Certes, tout ce qu’il vous plaira, adorable Eugénie... Les bijoux, les dentelles...
EUGÉNIE, très joyeuse.
Oui, oui, des bijoux, des dentelles...
Changeant de voix.
Maman a dit que vous pouviez m’embrasser sur le front.
MADAME VAUSSARD, levant brusquement la tête.
Cette fois...
TOUS, se tournant vers la porte.
Hein ?
MADAME FIQUET, écoutant.
Eh ! non, c’est la petite qui souffle le feu.
CHARLOTTE, entrant d’un bond, traversant la scène, au fond.
Des serviettes chaudes ! des serviettes chaudes !... J’ai laissé le feu s’éteindre. Le pauvre homme est glacé !
Elle entre dans la cuisine.
MADAME VAUSSARD, après une hésitation.
Je n’ai plus que quelques lignes à écrire.
Elle se remet à son travail.
MADAME FIQUET, même jeu.
J’aurais pourtant bien voulu mettre un peu d’ordre dans ce panier.
LEDOUX, à Eugénie.
Votre front est pur comme une matinée de printemps.
Il l’embrasse de nouveau.
EUGÉNIE.
Doucement... Embrassez-moi doucement, pour que nous ne dérangions personne.
Ils continuent leur causerie à voix basse.
CHAPUZOT, haussant légèrement la voix et descendant à l’avant-scène avec Dominique.
Mais non, c’est très laid, des bordures de fonte... Je préfère le buis... Je mets du buis partout, je fais sabler les allées qui en ont besoin, je donne quelques coups de serpe dans les massifs de lilas... De la sorte, j’ai un joli jardin.
DOMINIQUE.
Un jardin charmant, en effet.
CHAPUZOT.
Rabourdin n’a jamais eu de goût...
Ils remontent.
Tenez, vous voyez d’ici, à droite, au bout de la tonnelle, ce grand orme, à l’ombre duquel rien ne pousse. Eh bien ! je le coupe, moi. Dès demain, il ne sera plus là. Je veux pouvoir jouir de mon jardin au soleil...
Ils redescendent.
C’est comme derrière la maison, je vais planter un grand verger. Dans dix ans, je mangerai les plus beaux fruits de Senlis.
CHARLOTTE, traversant la scène et entrant dans la chambre, une serviette pliée sur les mains.
Elle me brûle... Faites chauffer des serviettes. J’ai allumé trois fourneaux.
MADAME VAUSSARD, d’une voix fâchée.
Eh ! petite, quand vous aurez fini d’aller et de venir !... Vous faites un vent avec vos jupes !
MADAME FIQUET.
On ferme les portes, au moins…
Elle se lève et va fermer la porte de la cuisine.
Nous sommes entre deux airs, nous allons nous enrhumer.
Elle vient se rasseoir.
EUGÉNIE, souriant, la main dans celles de Ledoux.
Je rêve une chambre de satin bleu avec des appliques de dentelles... Des fleurs partout...
LEDOUX.
Oui, tout ce qu’il vous plaira, adorable Eugénie.
MADAME FIQUET, continuant l’inventaire de son panier, entre ses dents.
Je n’aurai jamais fini... Nous disons le dossier de cette petite dame, le billet échu de ce jeune homme, la requête du monsieur qui a trouvé sa femme...
CHAPUZOT, à Dominique avec lequel il remonte la scène.
Vous voyez, les murs sont bons, les boiseries ont peu souffert...
Ils disparaissent dans le jardin, aussitôt qu’Isaac est entré.
Scène II
MADAME FIQUET, ISAAC, MADAME VAUSSARD, LEDOUX, EUGÉNIE, et CHAPUZOT et DOMINIQUE, qu’on voit par instants dans le jardin
ISAAC, s’approchant de madame Vaussard, qui écrit toujours.
Madame...
MADAME VAUSSARD.
Une seconde, monsieur Isaac... Je termine notre petite affaire.
Elle continue à écrire.
MADAME FIQUET, remettant pêle-mêle dans son panier les papiers qu’elle en a tirés.
Tant pis ! je tâcherai d’y voir clair un autre jour...
Prenant Isaac à part, à gauche[28].
Venez reprendre la pendule ce soir.
ISAAC.
Très bien, madame.
MADAME FIQUET.
Si vous voulez même attendre... Vous savez que je marie ma fille. La chère enfant !...
Elle regarde Eugénie, juste au moment où Ledoux l’embrasse.
Les mains et le front seulement, Eugénie...
CHARLOTTE, dans la coulisse.
Quelqu’un !
TOUS, regardant la porte de la chambre à coucher.
Hein ! quoi !
CHARLOTTE, entrant en scène.
Quelqu’un ! vite, chez le pharmacien, pour une potion !
MADAME FIQUET.
Vous nous avez fait une peur !...
Les héritiers ont un geste d’ennui. Chapuzot et Dominique retournent dans le jardin. Ledoux, qui s’est levé, reste appuyé au dossier du canapé. Madame Fiquet continue en baissant la voix.
Eh ! ne dérangez personne... Au point où en est notre oncle.
Prenant la fiole et allant l’emplir d’eau, à l’aide d’une carafe qu’elle trouve sur le buffet.
À quoi bon dépenser de l’argent, n’est-ce pas ? Ça fera absolument le même effet.
CHARLOTTE.
Donnez...
Elle reprend la fiole et rentre dans la chambre.
MADAME FIQUET.
Si l’on écoutait les malades, ils avaleraient une pharmacie.
Elle remonte au fond et cause avec Chapuzot et Dominique.
MADAME VAUSSARD[29], se levant, amenant Isaac à l’avant-scène.
Voici... Mon mari était occupé. Je lui ai fait signer les billets en blanc, et je les ai remplis.
ISAAC.
C’est que je ne suis pas encore bien décidé...
MADAME VAUSSARD.
Comment ! J’ai votre parole !
ISAAC.
Sans doute, j’ai promis...
Regardant la porte de la chambre.
Mais il y a tant de risques à courir.
Il passe à droite.
MADAME VAUSSARD.
Oh ! gardez, je ne suis pas embarrassée maintenant. Je trouverai un autre prêteur. Les intérêts sont assez beaux.
MOURGUE, sur le seuil de la chambre.
Plus rien à faire, mon enfant... Attendre simplement le résultat.
ISAAC, retenant madame Vaussard.
Madame... Voici les trois mille francs.
Il lui remet les billets et sort. Chapuzot, Dominique et madame Fiquet descendent la scène avec Mourgue.
Scène III
CHAPUZOT, MADAME FIQUET, MOURGUE, MADAME VAUSSARD, LEDOUX, EUGÉNIE, et DOMINIQUE, dans le fond, à gauche, se cachant pour rire
TOUS.
Eh bien ?
MOURGUE.
Un cas des plus curieux, un mal incompréhensible.
CHAPUZOT.
Vraiment.
MOURGUE.
Un mal sournois montant de tous les membres à la fois, sans que je puisse le flairer au passage.
MADAME VAUSSARD.
Mon Dieu !
MOURGUE.
Un mal extraordinaire, qui m’échappe, à moi, vieux praticien... C’est très grave, très grave, très grave !
CHAPUZOT, s’approchant du docteur.
La vieillesse, docteur. Je me suis laissé dire qu’à l’âge de Rabourdin, les os grossissent et vous étouffent.
MOURGUE.
Très grave, très grave, très grave.
Chapuzot remonte.
MADAME FIQUET.
Alors, docteur...
MOURGUE.
Je m’y perds, la science a des profondeurs...
Regardant sa montre.
Bigre ! six heures, je vais dîner... Mesdames et la compagnie, tous mes compliments.
Il sort en saluant et en baisant la main de madame Vaussard.
Scène IV
CHAPUZOT, DOMINIQUE, MADAME FIQUET, MADAME VAUSSARD, EUGÉNIE, LEDOUX
DOMINIQUE.
Vous n’allez pas dîner, monsieur Chapuzot ?
CHAPUZOT.
Non, j’aurai du courage jusqu’au bout...
Il revient s’adosser à la caisse.
Je vous avoue cependant que mon estomac commence...
MADAME FIQUET, reprenant sa place auprès de la table, à gauche, tandis que madame Vaussard reprend la sienne, et droite.
Sans doute, il est l’heure de manger. Est-ce que tu as faim, Minette ?
EUGÉNIE.
Un peu, maman. Je goûterais volontiers... On aurait seulement des gâteaux...
CHARLOTTE, dans la coulisse.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
TOUS, se levant.
Hein !
CHARLOTTE, dans la coulisse.
Il est mort !
TOUS, droits, sans bouger, comme figés.
Mort !
Un grand silence.
MADAME VAUSSARD, poussant trois sanglots qu’elle étouffe dans son mouchoir.
Ha ! ha ! ha !
MADAME FIQUET.
Je ne puis pas pleurer.
CHAPUZOT.
C’est comme moi.
MADAME FIQUET.
Je garde tout en dedans.
CHAPUZOT.
Comme moi... On souffre bien davantage.
MADAME FIQUET, se dirigeant vers Eugénie.
Pleure, pleure, Minette, ça te soulagera.
EUGÉNIE, pleurant.
Hi ! hi ! hi !
MADAME FIQUET.
Que tu es heureuse de pouvoir pleurer !
À Ledoux.
Menez-la au jardin, monsieur Ledoux, tâchez de la distraire...
Madame Vaussard est passée à droite. Madame Fiquet rappelle Eugénie[30].
Eugénie ! malheureuse enfant, tu n’as plus d’oncle...
Plus bas.
Tu peux te laisser embrasser sur les joues.
Ledoux et Eugénie sortent.
DOMINIQUE, enlevant la chaise qui se trouve près de la table.
Il y a des formalités à remplir.
MADAME VAUSSARD.
Un homme si bon !
MADAME FIQUET[31], descendant.
Une tête si bien organisée pour les affaires !
CHAPUZOT.
Un ami de quarante ans !
DOMINIQUE.
Il faudrait aller à la mairie.
CHAPUZOT.
Et vous vous souvenez comme il était gai, avant que la maladie l’eût rendu insupportable !
MADAME FIQUET.
Il avait des manies attendrissantes. Il me semble encore l’entendre parler de sa fin prochaine.
MADAME VAUSSARD.
Et il s’est éteint comme il le disait, ce grand, ce généreux, cet excellent cœur.
DOMINIQUE, emportant la table qu’il met derrière le canapé.
Nous, devrions songer aussi aux lettres de faire part.
MADAME FIQUET, grimaçant.
Ah ! les larmes, voici les larmes...
Tous trois pleurent bruyamment, étalant leurs mouchoirs.
DOMINIQUE[32], descendant.
Eh ! calmez-vous. Il est mort, c’est fini... Soyons sérieux.
MADAME FIQUET, s’essuyant les yeux, d’une voix délibérée.
Vous avez raison, soyons sérieux.
Tous trois remettent leurs mouchoirs dans leurs poches.
CHAPUZOT.
Nous ne sommes pas des enfants.
MADAME VAUSSARD.
Nos larmes ne nous le rendront pas.
CHAPUZOT.
Ah ! non, non !... Je me charge des lettres de faire part.
Il remonte et s’arrête près du buffet.
MADAME FIQUET, à Dominique.
Vous, jeune homme, allez faire la déclaration à la mairie.
DOMINIQUE.
Bien, madame.
Il sort par le fond.
MADAME VAUSSARD.
Ma robe de deuil est toute prête, et je cours...
Elle sort par le fond.
MADAME FIQUET.
Moi, je vais voir à la cuisine... Il faudra du vin chaud pour la veillée.
Elle entre dans la cuisine.
Scène V
CHAPUZOT, puis CHARLOTTE
CHAPUZOT, près du buffet.
Voudraient-elles m’éloigner ?... Elles sont capables de mettre la maison dans leurs poches, ces commères-là !...
Prenant un couvert sur le buffet.
Tiens, le couvert d’argent que j’ai donné à Rabourdin... Je ne sais pas pourquoi je le laisserais traîner.
Il glisse le couvert dans sa poche, puis il descend en scène.
Il faudra que je surveille le panier de la Fiquet ; elle déménagerait les meubles dedans...
Regardant de nouveau autour de lui.
Et la canne à pomme d’or, je ne la vois pas ? Ah ! la voici.
Il va la chercher près de la caisse et revient à petits pas.
Elle m’a bien coûté soixante francs.
Charlotte entre en riant, pendant qu’il cherche à la cacher sous son paletot.
Diable ! le bout dépasse... Je vais toujours dévisser la pomme.
Au moment où il s’efforce à dévisser la pomme, Charlotte le touche à l’épaule. Il a un sursaut de peur et se retourne, grelottant.
Hein ! Rabourdin !... Ah ! c’est toi, petite. Que veux-tu ?
Il s’ingénie vainement à dissimuler la canne.
CHARLOTTE.
Maintenant que tout vous appartient, monsieur, j’ai pensé que vous me donneriez cet argent dont je vous ai parlé, au lieu d’enfoncer la caisse...
CHAPUZOT.
Bien, bien... Aurais-tu assez de cinquante francs ?
CHARLOTTE.
Oh ! non, il y a toutes sortes de dépenses... Donnez-moi trois cents francs.
CHAPUZOT.
Bon Dieu ! trois cents francs... C’est qu’il me faudrait aller chez moi.
CHARLOTTE.
Eh bien ?
CHAPUZOT.
Dame ! si je m’absentais d’ici, on n’aurait qu’à me voler.
CHARLOTTE.
Ne suis-je pas là ? Je vous promets de faire bonne garde.
CHAPUZOT.
Tu ne quitteras pas la caisse ?...
Il la pousse contre la caisse.
Tu resteras là ?
CHARLOTTE.
Je le jure.
CHAPUZOT, caressant la caisse.
Hein ! comme elle est tendre, comme elle est tiède !... Je cours et je reviens.
Il veut se hâter et trébuche.
CHARLOTTE.
Doucement, revenez entier.
Charlotte se laisse tomber sur la chaise, à gauche, prise d’un fou rire.
Ha ! ha ! ha !
Scène VI
CHARLOTTE, MADAME FIQUET
MADAME FIQUET.
Quoi donc ! J’ai entendu des rires...
CHARLOTTE, pleurant.
Hi ! hi ! hi !
MADAME FIQUET.
C’était vous qui pleuriez ?... Les larmes ont de loin un singulier son... La cuisine est dans un désordre ! Il faudrait du bouillon, du café, quelque chose de chaud, enfin !...
Elle fouille dans le buffet et en sort une bouteille.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
CHARLOTTE.
Du rhum, madame.
MADAME FIQUET.
Ma foi, je vais en prendre un petit verre... J’ai l’estomac d’un délabré !
Elle se verse et boit un petit verre, puis elle se dirige vers la chambre.
Et maintenant, il faut songer...
CHARLOTTE, se levant et passant à droite.
Entrez, madame. Vous lui devez bien ces derniers soins... Il vous a tout laissé.
MADAME FIQUET, sur le seuil de la chambre.
Vrai ?
Elle revient vers Charlotte.
CHARLOTTE.
Aussi vrai que le cher homme n’est plus là... Il a fait son testament tantôt, pendant que vous étiez au jardin. C’est moi qui trempais la plume dans l’encrier.
MADAME FIQUET.
Et j’ai tout, le mobilier, la maison, l’argent ?
CHARLOTTE.
Tout, madame... J’ai parlé en votre faveur. Vous m’avez promis de ne pas être ingrate.
MADAME FIQUET.
Voilà les demandes d’argent qui commencent, n’est-ce pas ? Parce qu’on sait que j’ai de la fortune, on veut mettre la main dans mes poches ?
Elle passe à droite.
Non, par exemple. Vous pensiez peut-être que j’allais vous entretenir votre vie durant ?... Écoutez, si vous continuez à me servir, je vous donnerai six belles chemises de toile. Ça, c’est sérieux.
CHARLOTTE.
Merci, madame.
MADAME FIQUET, traversant et se dirigeant de nouveau vers la chambre.
Et, maintenant, vous allez m’aider à enlever la pendule.
CHARLOTTE, la suivant.
La pendule... Pourquoi l’enlever ? Vous ne l’avez donc pas achetée ?
MADAME FIQUET, dédaigneuse.
Certes !
CHARLOTTE, se dirigeant à son tour vers la chambre.
Oh ! moi, je veux bien. Ça vous regarde... Allons chercher la pendule.
MADAME FIQUET.
Vous dites cela d’un singulier ton.
CHARLOTTE, revenant à droite.
Non ! non !... Vous payez trop mal les services qu’on vous rend.
MADAME FIQUET.
Voyons, je suis ronde en affaires, je mettrai la douzaine... Qu’y a-t-il ? dites-moi tout.
CHARLOTTE.
Non ! mille fois non !... Ça m’est bien égal que vous jetiez votre héritage à la rivière !
MADAME FIQUET.
Hein ?
CHARLOTTE.
Qu’est-ce que ça peut me faire si le testament est cassé ?
MADAME FIQUET.
Comment, cassé !
CHARLOTTE.
La clause est formelle, l’héritage est à la personne qui a acheté la pendule.
MADAME FIQUET.
Mais cette clause est stupide ! Mon oncle a toujours eu le cerveau fêlé ; tout Senlis en témoignera, s’il est nécessaire... Je plaiderai ! oui, je plaiderai !... Ce Rabourdin était un être malicieux.
CHARLOTTE.
Dame ! il avait de drôles de moments.
MADAME FIQUET.
Méchant, entêté, hypocrite... Que faire ?
CHARLOTTE.
Eh ! c’est fini. Vous n’aurez pas un sou.
MADAME FIQUET, furieuse.
Taisez-vous, sotte ! Quand on est rompue aux affaires...
Réfléchissant.
Pardi ! voilà le remède... Attendez-moi. Aurez-vous, au moins, l’intelligence de m’attendre ?...
En s’en allant.
Mon Dieu ! que cette fille est bête !
Scène VII
CHARLOTTE, MADAME VAUSSARD
MADAME VAUSSARD, en robe noire, très riche, suivant des yeux madame Fiquet.
Où ma cousine court-elle donc si vite ?
CHARLOTTE, la regardant, feignant d’être très émue.
Pardonnez-moi... l’émotion, en vous voyant avec ces vêtements noirs...
Changeant de voix.
Mon Dieu ! que le noir vous va bien !
MADAME VAUSSARD, se pavanant.
N’est-ce pas ?
CHARLOTTE.
Et quelle robe délicieuse !... Les petits volants sont d’un goût !
Elle tourne autour d’elle.
MADAME VAUSSARD, passant à droite.
J’ai voulu de la soie ; la laine était un peu triste... Et les dentelles ? Vous ne trouvez pas qu’il y ait trop de dentelles ?
Elle revient à gauche.
CHARLOTTE.
Non, certes. On ne prend pas le deuil pour s’enlaidir.
MADAME VAUSSARD, tristement.
Hélas ! le vrai deuil se porte dans le cœur.
Changeant de voix.
Depuis quinze jours, je m’enfermais avec ma couturière.
CHARLOTTE, tapant dans ses mains.
Adorable ! adorable ! Voilà une toilette qui fera sensation au convoi...
Larmoyant.
Au convoi, madame, au convoi, mon Dieu !
MADAME VAUSSARD, tirant un magnifique mouchoir brodé pour s’essuyer les yeux.
Au convoi, ma pauvre enfant !...
Changeant de voix.
Où courait donc ma cousine ? Elle avait l’air très émue.
CHARLOTTE.
Dame ! elle a lieu d’être fort inquiète.
MADAME VAUSSARD.
Alors, notre bon oncle ?...
CHARLOTTE, confidentiellement.
J’ai promis de vous servir... Il a déclaré dans son testament laisser toute sa fortune à celui de ses héritiers qui aurait la pensée généreuse de l’enterrer avec toute la magnificence possible... Avez-vous cette pensée généreuse, madame ?
MADAME VAUSSARD.
Sans doute, depuis des années...
À demi-voix.
Ça va coûter bien cher.
CHARLOTTE.
Oh ! par exemple, tout ce qu’il y a de mieux, tout ce qu’on peut voir de plus réussi... La messe au grand autel, trois cents francs de cire...
MADAME VAUSSARD, passant à droite.
Trois cents francs, grand Dieu !... Cent francs suffiront.
CHARLOTTE.
Cinq cents francs pour les pauvres.
MADAME VAUSSARD.
C’est une folie !... Il me ruine.
CHARLOTTE.
L’embaumement...
MADAME VAUSSARD, passant à gauche.
Le faire embaumer !... Jamais !
CHARLOTTE.
L’embaumement... En tout, trois mille francs. Le testament dit trois mille francs.
MADAME VAUSSARD, abasourdie.
Trois mille francs !... J’aime mieux ne pas hériter.
CHARLOTTE.
Alors, madame, je pense que vous serez satisfaite... Ce jeune homme, ce neveu tombé du ciel...
MADAME VAUSSARD.
Il a dit qu’il allait à l’état civil, le petit misérable !...
Désespérée.
Mais, alors, je suis dépouillée... On pourrait peut-être, en courant...
Tirant un petit portefeuille de sa poche.
Rendez-moi ce service, je vous en prie.
CHARLOTTE.
Il suffit de commander.
MADAME VAUSSARD.
Non, je veux payer tout de suite. Le neveu n’aurait qu’à me devancer... C’est épouvantable, tant d’argent, pour un mort !
CHARLOTTE, guettant les billets que madame Vaussard tient à la main.
Et Senlis, madame, Senlis qui parlera encore dans dix ans de votre générosité. Jamais Senlis n’aura vu un enterrement pareil. Vous allez être saluée, respectée, célébrée.
MADAME VAUSSARD, avec satisfaction, passant à droite.
En effet, je mériterai quelque égard, je serai accablée de visites... Pour le coup, la femme du notaire et les deux filles de l’adjoint crèvent de dépit...
Charlotte lui arrache les billets.
Prenez garde de perdre les trois mille francs.
CHARLOTTE, glissant les billets dans son corsage.
N’ayez pas peur, ils resteront là.
Elle va pour sortir, lorsque madame Fiquet entre et la prend à part.
Scène VIII
MADAME FIQUET, CHARLOTTE, MADAME VAUSSARD
MADAME FIQUET, menant Charlotte à droite, à demi-voix.
J’ai acheté la pendule. C’était d’une simplicité !... Ce qui est plus ingénieux, c’est ceci...
Elle lui remet un papier.
Prenez donc. Vous glisserez adroitement ceci dans les papiers de mon oncle.
CHARLOTTE, le papier à la main.
Ceci ?
MADAME FIQUET.
Mon Dieu ! que vous êtes bornée !... La facture, comprenez-vous ? une facture antidatée, au nom de Rabourdin.
CHARLOTTE.
Oh ! madame, cela est fort, plus fort que vous ne le pensez vous-même... N’ayez pas peur, la facture est bien là.
Elle met la facture dans son corsage.
MADAME FIQUET.
Bon !...
Regardant madame Vaussard.
Et ma cousine, que dit-elle ?
CHARLOTTE.
Elle est radieuse. Elle croit hériter.
Elle se dirige vers la porte du fond.
MADAME VAUSSARD, l’arrêtant et baissant la voix.
Que vous disait donc ma cousine ?
CHARLOTTE.
Elle s’imagine hériter. La chère dame est dans une joie !...
Elle se dirige de nouveau vers la porte ; puis elle redescend et se place entre les deux femmes.
Je vous engage, mesdames, à ne pas quitter cette pièce.
MADAME VAUSSARD.
Ah !... Pourquoi ?
CHARLOTTE.
Jurez-moi d’être discrètes... Le testament est ici.
MADAME FIQUET.
Ici !... Où donc ?
CHARLOTTE.
Dans la caisse.
MADAME VAUSSARD.
Mais la clef était perdue ?
CHARLOTTE.
La clef est retrouvée... Mon Dieu ! je vous dis tout cela par amitié, je sais que vous n’en ferez pas un mauvais usage... La clef est encore sous l’oreiller de mon pauvre parrain.
MADAME FIQUET.
Sous la tête du...
MADAME VAUSSARD, faisant écho.
Sous la tête...
CHARLOTTE.
Oui, silence et respect !
Elle remonte. Les deux femmes se retournent pour la suivre des yeux ; et, lorsqu’elle est sur le seuil de la porte, avant de disparaître, elle lève la main, dans un geste d’autorité bouffonne.
Scène IX
MADAME VAUSSARD, MADAME FIQUET
MADAME FIQUET, à droite, à part.
Cette buse d’Olympe qui compte sur l’héritage !
MADAME VAUSSARD, à gauche, à part.
Cette pie-grièche de Lisbeth qui se vante d’hériter !
MADAME FIQUET, s’avançant, haut, avec ironie.
Ma cousine, recevez mes félicitations.
MADAME VAUSSARD, s’avançant, même jeu.
Ma cousine, je vous présente les miennes.
MADAME FIQUET.
Vous me voyez ravie. Notre oncle a donc su récompenser vos rares qualités.
MADAME VAUSSARD.
Je suis enchantée qu’il se soit décidé à reconnaître votre long dévouement.
MADAME FIQUET.
Eh ! non, ma cousine, c’est vous qui héritez.
MADAME VAUSSARD.
Non, ma cousine, vous héritez, n’en doutez point.
MADAME FIQUET, passant à droite, à part.
Elle m’agace.
MADAME VAUSSARD, à gauche, à part.
Elle est énervante.
MADAME FIQUET, revenant, se fâchant peu à peu.
J’admets un instant que je sois héritière.
MADAME VAUSSARD, revenant, même jeu.
Vous êtes trop modeste... Mais je veux admettre comme vous que le testament soit en ma faveur.
MADAME FIQUET.
Je trouverais peut-être en moi des mérites suffisants pour expliquer le choix de notre oncle.
MADAME VAUSSARD.
Je découvrirais sans trop de peine les bonnes qualités qui me vaudraient cette distinction flatteuse.
MADAME FIQUET, furieuse.
J’hérite ! Entendez-vous, ma cousine.
MADAME VAUSSARD, passant à droite, furieuse.
Vous entendez mieux que moi, ma cousine, j’hérite !
MADAME FIQUET.
Vous ? laissez, donc ! on m’a récité le testament mot à mot !
MADAME VAUSSARD.
Vous ? la belle histoire ! je le sais par cœur !
MADAME FIQUET, montant vers la porte de la chambre.
Voulez-vous des preuves ?
MADAME VAUSSARD, la suivant.
J’allais vous en offrir.
Madame Fiquet entre vivement dans la chambre, tandis que madame Vaussard s’arrête à la porte. La première ressort presque aussitôt, terrifiée, tenant la clef.
Eh bien ?
MADAME FIQUET, adossée à la porte.
Rien, l’émotion...
Se remettant.
Un enfantillage...
S’approchant de la caisse.
Je connais le système.
MADAME VAUSSARD, s’effaçant derrière elle.
Il y a souvent des pistolets chargés dans les coffres-forts.
MADAME FIQUET.
Si vous avez peur, allez-vous-en...
Elle travaille la serrure.
Ah ! voilà.
Elle repousse madame Vaussard, qui allonge les mains.
Doucement. Nous jurons de ne pas déranger un écu, quelle que soit la teneur du testament ?
MADAME VAUSSARD, avec fièvre.
Oui, oui, c’est juré... tout ce que vous voudrez...
Religieusement.
Quel éblouissement attend nos yeux ! Quelle splendeur de tabernacle !
MADAME FIQUET, avec passion, tenant la caisse entre ses bras.
Mon Dieu, mon bien, mon tout !
Elle fait rouler doucement la porte de la caisse. Toutes deux restent un instant muettes, dans une attitude de dévotion profonde. Puis, peu à peu, elles s’effarent.
MADAME VAUSSARD.
Hein ?
MADAME FIQUET.
Qu’est-ce donc ?
MADAME VAUSSARD.
Suis-je aveugle ?
MADAME FIQUET.
Je ne vois rien !
MADAME VAUSSARD.
Pas un rayon, un trou de ténèbres !
MADAME FIQUET.
Un trou noir comme un four !
MADAME VAUSSARD, fouillant dans la caisse.
Mais la caisse est vide !
MADAME FIQUET, même jeu.
Vide !... la caisse est vide !
MADAME VAUSSARD, même jeu.
Rien sur les planches !
MADAME FIQUET, même jeu.
Rien dans les coins !
MADAME VAUSSARD, traversant, la scène, passant à droite.
Dépouillée !
MADAME FIQUET.
Volée !
Elle fouille de nouveau et pousse un cri en trouvant le registre.
Ah !
Elle se sauve au fond.
MADAME VAUSSARD, remontant, l’arrêtant.
Faites voir !... Ne mettez rien dans vos poches ou je crie à l’assassin !
Elle l’amène à l’avant-scène.
MADAME FIQUET.
Laissez donc, je n’ai pas envie de me voler moi-même... Ça doit être tout en billets.
MADAME VAUSSARD.
En billets et en titres... Faites voir !
MADAME FIQUET.
Ne me bousculez donc pas... Là, nous allons regarder ça tranquillement.
Madame Fiquet ouvre le registre. Madame Vaussard se hausse derrière elle pour mieux voir.
MADAME VAUSSARD.
Il y a quelque chose d’écrit sur la première page.
MADAME FIQUET, lisant.
« Ceci est mon testament... »
MADAME VAUSSARD, répétant.
« Mon testament... »
MADAME FIQUET, continuant.
« Je meurs profondément touché des soins dévoués que m’ont prodigués des mains amies... »
S’interrompant.
Ceci est pour moi... Ce bon oncle !... Hein ! ma cousine, êtes-vous convaincue ? J’hérite !
MADAME VAUSSARD, lui arrachant le registre, lisant à son tour.
« Je ne saurais avoir trop de reconnaissance pour le parfum de bonne compagnie qu’une société aimable a mis autour de mon lit de mort... »
S’interrompant.
Ce digne oncle ! Voilà qui est à mon adresse, je pense... Ma cousine, que vous disais-je ? J’hérite !
MADAME FIQUET, s’emparant du registre, que madame Vaussard continue à tenir par un coin.
« ...Et comme j’entends ne léser en rien mes héritiers, j’ai dressé ici la liste exacte de leurs cadeaux... » Se moque-t-il ?
MADAME VAUSSARD, tirant à elle le registre dont madame Fiquet continue à tenir un coin.
« ...Afin d’établir la balance entre ce qu’ils m’ont pris et ce que j’ai su me faire rendre... » Ah ! mon Dieu !
TOUTES DEUX, tenant le registre chacune par un côté, lisant ensemble.
« ...Je suis ruiné, et leur lègue ce qu’ils me doivent encore. »
MADAME VAUSSARD.
Jouée comme un enfant !...
Remontant vers la porte de la chambre.
Oncle sans foi !
Elle redescend et reprend le registre à madame Fiquet.
MADAME FIQUET[33].
Dupée ! moi dupée !...
Remontant vers la porte de la chambre.
Ce misérable oncle !
Elle redescend.
MADAME VAUSSARD[34], feuilletant le registre.
Que de richesses ! Que de regrets ! Mon nom partout !
MADAME FIQUET, jetant un coup d’œil sur le registre.
Mon nom à toutes les pages !...
Remontant vers la porte de la chambre, tandis que madame Vaussard va jeter le registre sur le canapé.
Et il a attendu d’être mort pour parler, le lâche !... Ah ! si je le tenais !
Un violent éternuement part de la chambre. Les deux femmes très effrayées se serrent l’une contre l’autre.
Hein ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
MADAME VAUSSARD.
Un bruit singulier... On a éternué.
Autre éternuement plus violent encore.
MADAME FIQUET.
Mais il n’est seulement pas mort !... Entrons.
Elle se précipite dans la chambre, suivie de madame Vaussard. Toutes deux reparaissent tenant chacune par une main Rabourdin, vêtu simplement d’un pantalon à pieds et coiffé d’un foulard.
Scène X
MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET
MADAME FIQUET, le tirant à elle.
Ah ! c’est tout ce qu’on devait retrouver après votre mort !
RABOURDIN, ahuri, suppliant.
Ma bonne Lisbeth...
MADAME VAUSSARD, le tirant à elle.
Ah ! la caisse était vide et vous vous moquiez de nous !
RABOURDIN.
Ma chère Olympe...
MADAME FIQUET, même jeu.
Vous vous faites dorloter depuis dix ans !
RABOURDIN.
Écoutez...
MADAME VAUSSARD, même jeu.
On vous comble de cadeaux !
RABOURDIN.
Laissez-moi vous dire...
MADAME FIQUET.
Comment voulez-vous que je marie ma fille, maintenant ?
MADAME VAUSSARD.
Comment voulez-vous que je paie mes dettes ?
RABOURDIN.
Par grâce... Lisbeth ! Olympe !
MADAME FIQUET.
Non, non... Ah ! il vous faut des pendules Louis XV ! Et moi je paie comme une bête !
MADAME VAUSSARD.
Ah ! il vous faut un bel enterrement, trois cents francs de cire, cinq cents francs pour les pauvres !
RABOURDIN.
Eh ! nullement... Si vous saviez...
MADAME FIQUET.
Vous vouliez que la pendule sonnât votre dernière heure.
MADAME VAUSSARD.
Vous vous êtes fait embaumer à mes frais !
RABOURDIN, se fâchant.
Mais pas du tout. Que diable ! un mot...
MADAME FIQUET, lui lâchant le poignet et le repoussant.
Taisez-vous !... Vous nous avez promis trop longtemps de mourir. Vous êtes mort !
MADAME VAUSSARD, le repoussant également.
Notre oncle est mort, nous n’avons plus d’oncle !
RABOURDIN, les implorant tour à tour.
Voyons, la paix, mes bonnes nièces... Les petits cadeaux...
MADAME FIQUET.
Plus de cadeaux, entendez-vous !
RABOURDIN.
Les petits cadeaux...
MADAME VAUSSARD.
Jamais, jamais !
MADAME FIQUET.
Et moi, j’emporte ce qui m’appartient...
Elle traverse et monte au fond, à gauche.
Attendez, tout ce que je retrouverai...
MADAME VAUSSARD.
Moi aussi.
Elle traverse et monte au fond, à droite.
MADAME FIQUET.
D’abord le tire-bouchon et la boîte de petites cuillers.
Elle les prend sur le guéridon et les met dans sa poche.
RABOURDIN, courant derrière elle.
Lisbeth ! Ah ! non, par exemple !
MADAME VAUSSARD, devant le buffet.
Le rond de serviette... la timbale...
Elle les met dans sa poche.
RABOURDIN, lâchant madame Fiquet pour courir à madame Vaussard.
Olympe, veux-tu bien laisser ça ?... Des cadeaux, c’est sacré.
Elle passe à droite.
MADAME FIQUET, qui est descendue à l’avant-scène et qui passe à gauche, se dirigeant vers le canapé.
Le coussin sous mon bras...
Elle remonte au buffet.
La cave à liqueurs sous mon autre bras.
RABOURDIN, lâchant madame Vaussard pour courir à madame Fiquet.
Finis donc, Lisbeth ! Je ne vous laisserai pas sortir d’ici.
Il barre la porte de son corps.
MADAME VAUSSARD, à gauche, se chargeant des objets.
Le plateau... la chaise... et la jardinière.
RABOURDIN, la poursuivant.
Pas de mauvaises farces, Olympe ! Tu vas casser quelque chose.
MADAME FIQUET, à droite.
Voyons, j’ai encore une main libre.
Regardant autour d’elle et apercevant le baromètre accroché au mur.
Ah ! le baromètre !
Elle le décroche.
RABOURDIN, la poursuivant.
Mon baromètre !
MADAME VAUSSARD, s’échappant.
Adieu, mon oncle !
Rabourdin tourne sur lui-même sans pouvoir la saisir.
MADAME FIQUET, s’échappant.
Adieu, mon oncle !
Même jeu de Rabourdin.
RABOURDIN, sur le seuil de la porte.
Voleuses ! voleuses !... Au secours ! arrêtez-les !...
Il revient en chancelant.
Ah ! misère, on me ruine !... Je suis ruiné, ruiné, ruiné ! Je n’ai plus d’héritiers !
Il se laisse tomber sur la chaise, à droite, en se lamentant. Charlotte, qui a assisté à la fin de la scène, de la porte de la cuisine, entre en riant aux éclats.
Scène XI
RABOURDIN, CHARLOTTE
RABOURDIN.
Ruiné !... C’est toi, petite gueuse, qui m’as ruiné !
CHARLOTTE, se laissant tomber sur une chaise, près du canapé, prise d’un fou rire.
Laissez-moi rire... Le rire est si bon !
RABOURDIN.
Plus de cadeaux, plus de douceurs, plus rien... Eh ! je ne t’avais pas permis de les maltraiter ainsi ! Tu me rends mes héritiers en morceaux.
CHARLOTTE.
Riez donc, mon parrain.
RABOURDIN.
J’ai tout perdu. Ils ne reviendront jamais.
CHARLOTTE, se levant.
Eux ! la bonne histoire !... Je vais vous les ramener humbles, repentants, caressants.
RABOURDIN, se levant.
Toi ?
CHARLOTTE.
Eh ! oui, tout de suite, si vous voulez ! Bon Dieu ! que seraient-ils donc, vos héritiers, s’ils n’étaient plus les héritiers Rabourdin ? Senlis entier les montrerait au doigt ; plus un coup de chapeau, plus la moindre estime, plus le moindre crédit. Comprenez donc que leur seule position sociale est d’attendre votre bien ! Que diable, ils ne peuvent se mettre eux-mêmes sur le pavé !
RABOURDIN.
Ma nièce Vaussard était bien furieuse.
CHARLOTTE.
Bast ! Elle ne saurait que dire à ses créanciers... Vous êtes sa garantie.
RABOURDIN.
Jamais je n’ai vu ma nièce Fiquet dans une telle colère.
CHARLOTTE.
Et sa fille, comment la marierait-elle ? Vous êtes sa dot, à cette enfant...
Allant au fond.
Elles ne sont pas loin. Elles ne savent comment revenir... Je vais vous les ramener, vous dis-je.
Elle les appelle de la main.
Les voici !
RABOURDIN.
Ah ! j’ai bien besoin d’être un peu gâté.
Il passe sa robe de chambre, qui se trouve jetée sur la caisse, et s’asseoit à droite.
Scène XII
RABOURDIN, CHARLOTTE, MADAME FIQUET, MADAME VAUSSARD, puis EUGÉNIE, LEDOUX et ISAAC
CHARLOTTE, bas à madame Vaussard, qui rentre, gênée, défiante, et qu’elle débarrasse des objets dont elle est chargée.
Vous avez eu tort, madame. Monsieur Isaac est là. Prenez garde... Je jurerais que votre cousine va manger votre oncle de caresses avant cinq minutes.
MADAME VAUSSARD.
Je ne suis pas plus sotte qu’elle, peut-être.
Elle va chercher un coussin sur le canapé.
CHARLOTTE, bas à madame Fiquet, qui rentre et qu’elle débarrasse à son tour des objets qu’elle rapporte.
Ah ! madame ! une femme de votre génie ! N’ébruitez rien. Songez à votre demoiselle. Monsieur Ledoux est là.
Montrant madame Vaussard qui s’approche de Rabourdin, un coussin à la main.
Eh ! regardez votre cousine. La voici déjà aux petits soins.
MADAME FIQUET, gardant le coussin dont Charlotte veut la débarrasser.
Bien, bien... Je n’ai pas cessé d’aimer notre bon oncle.
Elle se précipite vers Rabourdin et arrive juste à temps pour placer derrière son dos le coussin qu’elle a rapporté. Madame Vaussard cherche un instant ce qu’elle peut faire de celui qu’elle tient à la main, et finit par le mettre sous les pieds de son oncle.
ISAAC, entrant.
Comment ! il est levé !...
Madame Vaussard, inquiète, l’amène à droite.
Serez-vous au moins en règle aux échéances ?
MADAME VAUSSARD, bas.
Chut !... Fi ! parler de cela, quand vous me voyez encore tout en larmes... Plus tard.
LEDOUX, entrant avec Eugénie.
Déjà en convalescence !...
Madame Fiquet, effrayée, le retient à gauche, au fond.
Et le mariage, et mes douze cents francs ?
MADAME FIQUET, bas.
Chut !... C’est honteux, lorsqu’un miracle nous rend un parent si tendrement aimé... Plus tard.
Madame Vaussard revient près de Rabourdin, derrière lequel se tiennent également madame Fiquet et Eugénie. Ledoux et Isaac sont, au fond, l’un à gauche, l’autre à droite. Charlotte, appuyée au canapé, sourit en regardant la scène.
RABOURDIN, balbutiant.
Je suis touché, bien touché, mes enfants...
Scène XIII
RABOURDIN, CHARLOTTE, MADAME FIQUET, MADAME VAUSSARD, EUGÉNIE, LEDOUX, ISAAC, MOURGUE, DOMINIQUE, CHAPUZOT
MOURGUE, tenant un cure-dents dont il se sert à chaque membre de phrase.
Tiens ! tiens ! tiens ! Ce farceur de Rabourdin... La nature est un fameux médecin. Elle a des profondeurs... J’ai dîné comme un dieu, moi, ce soir.
Il s’approche de Rabourdin.
DOMINIQUE, à Charlotte, bas.
Voici le Chapuzot.
CHARLOTTE, allant à la rencontre de Chapuzot, qui s’avance péniblement sur deux cannes, et l’amenant à droite, en l’empêchant de voir Rabourdin.
Que vous est-il donc arrivé, mon bon monsieur ?
CHAPUZOT.
Rien, rien... Un faux pas. Je suis tombé. On m’a porté chez moi... Je serais plutôt revenu sur les genoux... Voici les trois cents francs. Cachez-les.
CHARLOTTE, prenant les billets qu’elle met dans son corsage.
Ils sont en sûreté.
CHAPUZOT, apercevant Rabourdin.
Que vois-je ? Il ressuscite !...
Il poursuit Charlotte.
Mes trois cents francs.
CHARLOTTE, bas.
Chut !... Vous êtes inconvenant... Plus tard.
MOURGUE, tenant le pouls de Rabourdin.
Parfait ! les émollients ne valaient rien, nous allons soigner ça par les purgatifs.
CHAPUZOT, assis sur le canapé, à part.
J’attendrai.
Haut.
Quand le coffre ne vaut rien, docteur, il serait préférable de s’en aller tout de suite... N’est-ce pas, Rabourdin ?
Il se lève et va se joindre au groupe formé autour de Rabourdin.
RABOURDIN, se levant, descendant à l’avant-scène, suivi des héritiers.
Oui, mon ami, oui... Je ne demande qu’à m’en aller, par un beau soir, entouré de vous tous, au milieu de ma famille.
CHARLOTTE, montrant l’argent à Dominique, à droite, où ils font tous deux un couple séparé.
Et, maintenant, quand le curé voudra !
[1] Chapuzot, madame Fiquet, madame Vaussard, Mourgue.
[2] Chapuzot, Ledoux, madame Fiquet, Eugénie, madame Vaussard, Mourgue.
[3] Madame Fiquet, Chapuzot, madame Vaussard, Mourgue.
[4] Madame Vaussard, Chapuzot, Mourgue.
[5] Chapuzot, madame Vaussard, Mourgue.
[6] Charlotte, madame Vaussard, Ledoux, Rabourdin, Eugénie, madame Fiquet, Chapuzot.
[7] Madame Vaussard, Rabourdin, madame Fiquet, Charlotte, Chapuzot.
[8] Madame Vaussard, Rabourdin, madame Fiquet, Chapuzot.
[9] Madame Vaussard, Rabourdin, madame Fiquet, Charlotte, Chapuzot.
[10] Charlotte, madame Vaussard, Rabourdin, madame Fiquet, Dominique, Chapuzot.
[11] Madame Vaussard, madame Fiquet, Rabourdin, Chapuzot, Dominique.
[12] Madame Vaussard, Rabourdin, Isaac, madame Fiquet, Chapuzot, Dominique.
[13] Madame Vaussard, madame Fiquet, Rabourdin, Dominique, Isaac, Chapuzot.
[14] Chapuzot, madame Vaussard, Isaac, Rabourdin, madame Fiquet, Dominique.
[15] Chapuzot, madame Vaussard, madame Fiquet, Dominique.
[16] Charlotte, Rabourdin, Dominique.
[17] Rabourdin, Chapuzot, Charlotte.
[18] Charlotte, madame Fiquet, Ledoux, Eugénie, Rabourdin.
[19] Madame Fiquet, Charlotte, Mourgue, Rabourdin, madame Vaussard.
[20] Chapuzot, Charlotte, madame Vaussard, Mourgue, Rabourdin.
[21] Chapuzot, Charlotte, madame Fiquet, Rabourdin, Mourgue.
[22] Charlotte, Chapuzot, madame Fiquet, Rabourdin, Mourgue.
[23] Charlotte, Chapuzot, Isaac, madame Fiquet, Rabourdin, Mourgue.
[24] Charlotte, Chapuzot, madame Fiquet, Rabourdin, Mourgue, Isaac.
[25] Chapuzot, Charlotte, madame Vaussard, Isaac ; et, dans le fond, madame Fiquet et Mourgue, devant le lit où Rabourdin est couché.
[26] Charlotte, Dominique, Rabourdin.
[27] Rabourdin, Charlotte, Dominique.
[28] Isaac, madame Fiquet, madame Vaussard, Ledoux, Eugénie ; et, dans le jardin, Chapuzot et Dominique.
[29] Isaac, madame Vaussard, Ledoux, Eugénie ; et, au fond, faisant groupe, Dominique, Chapuzot et madame Fiquet.
[30] Chapuzot, Dominique, Ledoux, Eugénie, madame Fiquet, madame Vaussard.
[31] Chapuzot, madame Fiquet, madame Vaussard, à l’avant-scène, Dominique, dans le fond.
[32] Chapuzot, madame Fiquet, Dominique, madame Vaussard.
[33] Madame Vaussard, madame Fiquet.
[34] Madame Fiquet, madame Vaussard.