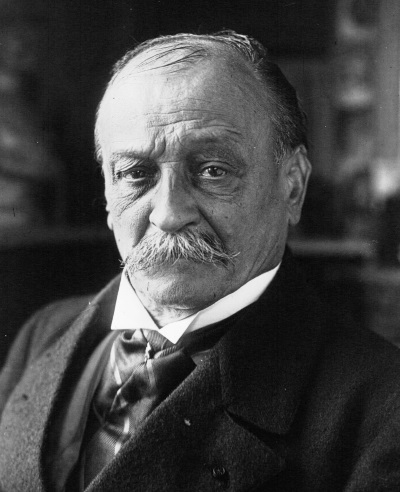La Cruche (Georges COURTELINE - Pierre WOLF)
Sous-titre : j'en ai plein le dos de Margot
Pièce en deux actes.
Représentée pour la première fois, à paris, sur le Théâtre de la Renaissance, le 27 février 1909.
Personnages
LAVERNIÉ
LAURIANE
MARVEJOL
UN GAMIN
MARGOT
CAMILLE
URSULE
ACTE I
À Chennevières ; un jardin planté d’iris et de roses, qu’une haie, au fond, sépare d’une allée banale sur laquelle donnent de petites villas. À droite du théâtre, la maison. À gauche, la barrière d’entrée. Au lever du rideau, assise, Margot se livre à un travail de femme. Lauriane, en bras de chemise, le chef coiffé d’un panama, et un arrosoir à la main, fait fonctionner le bras d’une pompe placée à gauche du théâtre.
Scène première
LAURIANE, MARGOT
LAURIANE.
Certes, je peux le dire à voix haute : je me soucie des palmes académiques comme de mon premier caleçon de bain. Il n’en est pas moins vrai que le doute où je vis de savoir si je les ai ou si je ne les ai pas me crée un odieux état d’âme. Tu es sûre qu’on ne trouve pas l’Officiel à Chennevières ?
MARGOT.
Sûre. Je te l’ai déjà dit cent fois.
LAURIANE.
À Champigny ?
MARGOT.
Pas davantage.
LAURIANE.
Et à La Varenne ?
MARGOT.
Pas plus.
LAURIANE.
Drôle d’idée que j’ai eue d’avoir choisi ce patelin pour y venir passer mes vacances !... Je la retiens, la banlieue ! En tout cas, tu pourrais me laisser passer ; tu vois bien que je vais tirer de l’eau.
MARGOT, qui se range.
Oh ! pardon.
LAURIANE, le bras en mouvement sur le levier de la pompe.
C’est comme Lavernié. Si jamais ma chienne fait des petits, tu parles, ma fille, non mais tu parles si je lui en mets un de côté.
MARGOT.
Qu’est-ce qu’il t’a fait ?
LAURIANE.
Il m’a fait que l’Officiel est mis en vente à six heures du matin, qu’il est près de cinq heures du soir, que ce grand imbécile me laisse sans nouvelles, et que quand on a dit aux gens : « Je t’enverrai une dépêche sitôt qu’il y aura du nouveau », on ne doit pas les laisser sur le gril comme de simples Saint-Laurent. C’est vrai, ça... Mais range-toi donc ! C’est curieux, ce besoin d’être toujours dans mes jambes !...
Il passe devant Margot, les arrosoirs à la main, gagne la haie qui isole son petit jardin de l’allée banale de la ville. Là, brusquement.
Tiens, Camille !...
MARGOT.
Qui, Camille ?
LAURIANE.
La femme de Marvejol.
MARGOT.
Eh bien, ne te gêne plus. Tu pourrais dire : « Madame ».
LAURIANE.
Tu n’as pas la prétention de me donner les leçons de savoir-vivre ?
MARGOT.
Je n’ai aucune prétention, tu le sais bien.
LAURIANE, ironique.
Tu as tort ; tu devrais en avoir, à la beauté, et même à l’intelligence.
MARGOT.
Pourquoi essaies-tu de m’humilier ? Je ne t’ai rien dit de blessant, moi. Simplement, je te fais remarquer que tu pousses un peu loin la familiarité avec des gens que tu connais à peine et auxquels nous ne sommes liés que par des relations de voisinage.
LAURIANE.
C’est ton avis ?
MARGOT.
C’est mon avis.
LAURIANE.
Eh bien, tu me rases, voilà le mien.
MARGOT.
N’en parlons plus.
LAURIANE, les yeux sur Camille qui vient d’apparaître par la droite et dont on voit le haut du corps par-dessus la haie de séparation.
Cette femme me ferait passer par un trou de souris.
Haut.
Belle dame...
Scène II
LAURIANE, MARGOT, CAMILLE
CAMILLE.
Bonjour, monsieur Lauriane ; bonjour, madame Lauriane.
MARGOT.
Bonjour, chère madame.
LAURIANE.
Madame Marvejol, je suis votre serviteur. Madame est allée à Paris ?
CAMILLE.
Oh ! Un saut entre deux trains ! Juste le temps qu’il faut à une Parisienne pour dépenser vingt francs au Louvre en acquisitions inutiles.
LAURIANE.
Bah ! quelles acquisitions ?
MARGOT.
Tu es indiscret, Charles.
CAMILLE.
Ne m’en parlez pas ! Je n’ai rien trouvé à mon goût. Ces grands magasins sont d’un pauvre !... Où est mon mari ?
LAURIANE.
Marvejol ? Il est où vous l’avez mis. Ayant reçu de vous une consigne qu’il observe, ce modèle des époux taquine le goujon, les jambes dans l’eau et la tête au soleil. Ah ! le gaillard est bien dressé...
Bas.
Si vous saviez comme votre chapeau vous va bien.
CAMILLE, à part.
Qu’est-ce qui lui prend ?
Fausse sortie.
LAURIANE.
Dites-moi, chère madame...
CAMILLE, redescendant.
Cher monsieur ?
LAURIANE.
Vous n’auriez pas eu par hasard l’idée d’acheter l’Officiel ?
CAMILLE, stupéfaite.
Ma foi, non.
MARGOT.
Charles !
LAURIANE.
Et après ?... Au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu ferais mieux d’engager madame à venir se reposer chez nous, en attendant le retour de M. Marvejol.
CAMILLE.
Vous êtes trop aimables.
LAURIANE.
Allons donc ! Des cérémonies ! Vous prendrez bien un verre de bière.
CAMILLE, hésitant.
Merci.
MARGOT.
Merci oui ?
CAMILLE, qui se décide.
Merci oui.
MARGOT.
À la bonne heure.
CAMILLE.
J’enlève mon chapeau et je reviens.
LAURIANE, à mi-voix, ému.
Vous êtes bonne.
CAMILLE, riant.
Il fait chaud, et j’ai soif, voilà tout. À tout à l’heure.
MARGOT.
C’est cela.
CAMILLE, à part, remarquant que Lauriane ne la perd pas des yeux.
Il m’agace !
LAURIANE, à part.
Elle m’excite.
Camille sort.
Scène III
LAURIANE, MARGOT
Lauriane reprend ses arrosoirs qu’il avait déposés à terre et commence à donner à boire à ses rosiers, tout en fredonnant un petit air.
LAURIANE.
Et, le plus joli de l’affaire, c’est qu’il en avait fait la sienne.
MARGOT.
Qui ?
LAURIANE.
Lavernié !... Tu as toujours l’air de ne pas savoir ce qu’on veut te dire.
Il hausse les épaules.
En a-t-il assez fait de l’esbroufe ! Et : « mes relations » par ci... et « mon crédit » par là... et « je vais t’enlever ça en cinq sec »... Vantard, va !... – Il crevait de soif...
MARGOT.
Lavernié ?
LAURIANE.
Le Maréchal Niel ! Tu n’es jamais à la question...
Tout en parlant, il a inondé d’un filet d’eau un rosier garni de magnifiques roses jaunes.
Est-il assez beau, ce gaillard-là ? On jurerait du beurre salé...
Poursuivi de son idée fixe.
Heureusement que ça m’est égal. Je me connais, je sais ce que je vaux, j’ai ma propre considération et ça suffit à mon bonheur. Quant aux hochets de la vanité, serviteur de tout mon cœur.
Il chante.
Tu, tu, tu,
La y tou la la !
Dieu que t’as l’air bête !...
MARGOT.
Merci. Tu es plein d’attentions pour moi, et je mène à tes côtés une existence pleine de charmes.
LAURIANE.
Veux-tu en changer ? À ton aise ! la porte est là, et la gare n’est pas loin. Nous ne sommes pas mariés, ma fille.
MARGOT.
Crie-le donc plus haut. Les voisins pourraient ne pas avoir entendu.
LAURIANE.
Les voisins ? Je m’en fiche, des voisins... Et puis, d’abord, pourquoi n’es-tu pas à la cave ?
MARGOT.
À la cave ?
LAURIANE.
Naturellement ! Non seulement tu devrais y être ; tu devrais en être revenue...
Camille réapparaît au fond.
Tiens ! voilà notre invitée. Grouille-toi un peu, sacrebleu !... Va chercher une bouteille de bière ! Quel malheur, bon sang, d’être rivé à une empotée pareille !
MARGOT.
Plains-toi.
LAURIANE.
C’est bon !
CAMILLE, de l’autre côté de la barrière.
Je vous fais fuir ?
MARGOT.
Je reviens.
Elle sort.
Scène IV
LAURIANE, CAMILLE
LAURIANE, ouvrant à Camille la barrière qui donne accès à son jardin.
Entrez donc !
CAMILLE.
Parions que je vous dérange.
LAURIANE, très aimable.
Vous plaisantez. Tenez, asseyez-vous là.
CAMILLE.
Merci.
Elle prend son ouvrage. Lauriane la regarde, l’air attendri.
LAURIANE.
Vous êtes bien ?
CAMILLE.
Je suis bien.
LAURIANE.
Très bien ?
CAMILLE.
Tout à fait bien. Mais vous étiez, je crois, en train de faire boire vos rosiers. Je vois d’ici un Maréchal Niel qui réclame votre assistance et une Gloire de Dijon qui souffre de la pépie.
LAURIANE.
Le Maréchal a bu comme un chantre de village et la Gloire de Dijon a les pieds dans la vase, comme un simple Marvejol.
CAMILLE.
C’est bien, ce que vous dites là.
LAURIANE.
Moins bien que ce que vous faites.
CAMILLE.
Tout de bon ?
LAURIANE.
Qu’est-ce que ça représente ?
CAMILLE.
Une maison dans des arbres.
LAURIANE.
Le fait est qu’il n’y a pas d’erreur. Ça, c’est les arbres, et ça, c’est la maison... C’est rudement bien imité. Et quand on songe, Seigneur, qu’un travail comme celui-là a pu sortir de petites menottes comme celles-ci. Donnez un peu la patte.
CAMILLE, lui donnant la main.
Vous lisez dans les mains ?
LAURIANE.
Des fois.
CAMILLE.
Qu’y voyez-vous ?
LAURIANE.
Des choses.
CAMILLE.
Quelles choses ?
LAURIANE.
Des choses...
CAMILLE.
Enfin, expliquez-vous...
LAURIANE.
Soit, je m’explique...
Il tombe à genoux.
Camille, je vous aime.
CAMILLE.
Hein ? Quoi ? Qu’est-ce ?
LAURIANE.
Camille, je vous aime.
CAMILLE.
C’est une plaisanterie !... Voulez-vous bien vous relever ? Oh ! mais nous allons nous fâcher.
LAURIANE.
Camille, écoutez-moi.
CAMILLE.
Encore une fois, monsieur Lauriane.
LAURIANE.
Je vous jure que ce n’est pas l’air de la campagne...
CAMILLE.
Mais relevez-vous donc.
LAURIANE.
Jamais !
CAMILLE.
Vous êtes ridicule ; prenez garde...
LAURIANE.
Cœur de roche !
CAMILLE.
En voilà assez ! Cette petite bouffonnerie champêtre a plus que suffisamment duré : l’instant est proche où elle deviendrait fastidieuse. Une dernière fois, debout ! D’ailleurs, voici Madame Lauriane.
LAURIANE.
Naturellement.
Scène V
LAURIANE, CAMILLE, MARGOT
MARGOT.
Tu es souffrant ?
LAURIANE.
Pourquoi ?
MARGOT.
Tu es rouge comme un coquelicot.
LAURIANE.
Tiens, j’en ai le droit, je suppose, depuis deux heures que j’use mon huile de bras à faire fonctionner la pompe !... Il n’y a pas de prise d’eau, ici. Si on m’y revoit, dans cette maison, j’ose dire que ce sera dans un songe.
MARGOT.
Tu as encore l’air de t’en prendre à moi !
LAURIANE.
Je sais ce que je dis.
MARGOT, les larmes aux yeux.
Oh ! Oh ! Oh ! Oh !
LAURIANE.
Et puis, pas de musique ! Je ne suis pas d’humeur à la supporter !... pas plus que tes airs de victime !... Aussi bien, je l’avais oublié, nous avons à causer.
CAMILLE.
Je vous gêne ?
LAURIANE.
En aucune façon, chère amie. Je vous prierai même de demeurer, car l’instant est venu pour moi d’ouvrir aux étrangers la porte de ma maison et de mettre ma vie au soleil.
MARGOT.
Vous allez voir que j’ai encore commis des crimes.
LAURIANE.
Pas de grands mots !...
Se fouillant.
Où l’ai-je fourré ?... Le voici... Qu’est-ce que c’est que ça ?
MARGOT.
Un pierrot.
LAURIANE.
Un pierrot... Je ne te l’ai pas fait dire !... l’espoir du printemps et l’amour d’une mère ! Au faîte de ce hêtre se balançait doucement un nid qui faisait mon attendrissement, où se battaient, s’ébattaient, se débattaient trois nouveau-nés, sans barbe et sans moustache encore !... Et c’était pour moi une fête de jeter en passant un sourire aux espiègleries de leur ingénuité. Total : l’appartement vide, et la mère en pleurs sur la branche !... Le chat de madame a passé par là !... Charmant animal !... Que je le chope au bout de mon fusil, et je lui colle deux balles dans la peau ; vous verrez si ça fera un pli. Pan ! Pan !
MARGOT, souriant.
Tu n’as pas de fusil.
LAURIANE.
C’est possible. Que je mette la main dessus alors ; et je lui fais sauter la queue d’un coup de hache. Bing !
MARGOT.
Tu n’as pas de hache.
LAURIANE.
Non ? Eh bien, je l’enverrai, la tête la première, voir au fond du puits si j’y suis.
MARGOT.
Il n’y a pas de puits.
LAURIANE.
Je me tue à le dire ! Encore un des avantages de cette extraordinaire maison. Ah ! je t’en aurai, des obligations... Je t’en dois des actions de grâces !... Allons ! plus un mot ! Silence ! Ne m’oblige pas à te rappeler qu’il n’y a qu’un maître chez nous.
MARGOT.
Croyez-vous, hein ?
CAMILLE.
Il plaisante... Voyons, monsieur Lauriane...
LAURIANE.
Chère madame, je n’ai pas l’habitude d’exposer au grand jour ni mes pleurs ni mes plaies. Mettons que je plaisante et n’en parlons plus.
Il remonte.
CAMILLE, bas, à Margot.
Il n’est pas méchant, au fond.
MARGOT.
Je sais bien... Mais tout de même... C’est à en tomber malade, voyez-vous...
LAURIANE, au fond, l’œil au loin parti à la découverte du facteur rural qui ne vient pas.
Toujours pas de dépêche !...
Un gamin entre en courant et hors d’haleine.
Qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’es pas le facteur, toi ?
LE GAMIN.
Non, m’sieu.
LAURIANE.
Eh bien ?
LE GAMIN.
M’ame Marvejol, s’il vous plaît ?
CAMILLE.
C’est moi, petit. Que me veux-tu ?
LE GAMIN.
C’est un monsieur qu’est là-bas, au bord de la rivière, qui pêche et qui a les pieds dans l’eau. Alors, il m’a dit comme ça de dire comme ça à madame que chaque fois qu’il allait pêcher, madame lui emportait ses chaussures ; alors que madame les lui rende, rapport qui peut pas revenir sans.
Lauriane rit.
CAMILLE, vexée.
Pourquoi riez-vous ? Simple distraction... Va à côté, petit, la bonne t’en fera un paquet.
LAURIANE.
C’est tout de même extraordinaire ce télégramme qui n’arrive pas !
À Ursule qui est venue sur le seuil de la porte y secouer son panier à salade.
Le télégraphiste n’est pas venu ?
URSULE.
Le télégraphiste ? Si, monsieur.
LAURIANE.
Le télégraphiste est venu ?
URSULE.
Y a au moins une heure.
LAURIANE.
Quoi faire ?
URSULE.
Apporter une dépêche.
LAURIANE.
Pour qui ?
URSULE.
Pour vous.
LAURIANE.
Eh bien, où est-elle ?
URSULE, la tirant de sa poche.
La voici. J’attendais que Monsieur me la demande.
LAURIANE.
Buse ! Brute !... A-t-on idée de ça !... et vous croyez que des êtres pareils, la Société ne ferait pas mieux de les détruire ?
URSULE, épouvantée.
Monsieur veut me détruire ?
LAURIANE.
Zut ! Silence ! Sortez de mes yeux, vous et votre panier à salade ! Vous m’exaspérez, tous les deux !
URSULE, disparaissant.
Eh bien, en voilà une affaire !
Lauriane, du doigt, fait éclater le pli ; il y jette un coup d’œil, pousse un cri et disparaît précipitamment à l’intérieur de l’habitation, laissant Margot et Camille stupéfaites.
CAMILLE.
Eh bien ?
MARGOT.
Comment ?
CAMILLE.
Qu’est-ce qu’il y a ?
MARGOT.
Je ne comprends pas... Il attendait une dépêche... mais... je ne sais...
CAMILLE.
Une mauvaise nouvelle, peut-être !
MARGOT.
J’espère que non... D’ailleurs, le voici...
Lauriane, en effet, apparaît, transfiguré, rajeuni de vingt ans. Il a passé une redingote qu’il achève de refermer sur lui. Margot s’est élancée, mais lui, sans violence, l’écarte de la main droite, va droit à Camille et se penche pour l’embrasser.
LAURIANE.
Belle dame...
CAMILLE.
Ah çà !...
LAURIANE, en l’embrassant.
Permettez !
CAMILLE.
Il m’effraye.
LAURIANE, en embrassant Margot sur les deux joues.
Et toi aussi, ma fille, toi aussi !... Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais une minute comme celle-ci fait oublier bien des mauvaises journées ! Enfin, ne parlons plus de ces choses attristantes ! L’éponge est passée. Tout est dit.
MARGOT, très étonnée.
Mon Dieu...
LAURIANE, lui tendant la dépêche.
C’est fait. Lis.
MARGOT, lisant.
« Vu le ministre. L’affaire est dans le sac. J’arrive. »
CAMILLE.
Quelle affaire ?
LAURIANE, badin.
Curieuse...
CAMILLE.
Les palmes ! Dieu me pardonne !
LAURIANE, modeste.
Elles-mêmes !
CAMILLE, à Margot.
Vous ne pouviez pas le dire plus tôt, cachottière !
MARGOT.
Si je m’étais trompée...
LAURIANE, de même.
Le mal n’eût pas été si grand... Pour l’importance que ça a...
CAMILLE.
Vous êtes trop modeste.
LAURIANE.
Allons donc !
CAMILLE.
Mes compliments !
LAURIANE.
Vous plaisantez !
CAMILLE.
Du tout !
LAURIANE.
Vraiment ?
CAMILLE.
Vraiment.
LAURIANE, désignant Margot.
Alors, merci pour elle.
À Margot.
Tu entends, on te complimente.
À Camille.
Je vous ferai d’ailleurs remarquer qu’elle affecte un manque évident d’enthousiasme.
MARGOT.
Moi ?
LAURIANE.
Et que, sans se lancer dans des démonstrations incompatibles avec sa nature de fer-blanc, elle pourrait accueillir d’un visage moins tragique la distinction dont je suis l’objet...
Margot veut parler.
...distinction, en somme flatteuse, et dont tout l’honneur est pour elle.
MARGOT.
Mais c’est un parti pris !... Mais cela devient odieux !
LAURIANE.
Ça va bien.
MARGOT, à Camille.
Lui ai-je dit quelque chose ?
CAMILLE.
Tenez, vous êtes un monstre... ! Pauvre petite !
Elle l’embrasse.
Courez donc l’embrasser, vous aussi.
LAURIANE, bas.
Devant vous ?
CAMILLE.
Pourquoi pas ?
LAURIANE.
Puisque vous l’ordonnez !...
Il embrasse Margot du bout des lèvres.
Sur ce, l’incident est clos... Fais voir la dépêche...
La relisant.
« Dans le sac ! » Sacré Lavernié ! Ça me fait plaisir aussi pour lui ! Nous allons nous faire du bon sang !
CAMILLE.
Quel Lavernié ?
LAURIANE, étonné.
Henri Lavernié.
CAMILLE.
Le peintre ?
LAURIANE.
Vous le connaissez ?
CAMILLE, très hésitante.
De nom... un peu.
Ursule entre.
Scène VI
LAURIANE, CAMILLE, MARGOT, URSULE
LAURIANE, vivement et à mi-voix.
Chtt !... Ursule !...
Désignant du doigt sa boutonnière.
Nous allons rire !
À Ursule.
Qu’est-ce qu’il y a, ma bonne Ursule ?
URSULE.
Je venais demander à madame...
LAURIANE, familier.
Approchez, Ursule ; approchez. Le dîner sera-t-il bon ce soir ?
URSULE.
Je l’espère, monsieur.
LAURIANE.
Elle l’espère ! Brave fille !... Qu’est-ce que vous avez à me regarder comme ça ! Aurais-je une tache sur mon vêtement ?
URSULE.
Je n’en vois point.
LAURIANE.
Regardez bien... Non ?... Rien ne vous frappe ?
URSULE.
Non, monsieur.
LAURIANE, furieux.
Rompez !... Assez causé comme ça !
URSULE.
Mais, monsieur...
LAURIANE.
Assez causé !...
Ursule sort. À part.
En voilà une que je ficherai à la porte à la première occasion...
Mais il aperçoit Marvejol.
Chtt !... Marvejol !... On va rigoler. Plus un mot !...
Scène VII
LAURIANE, CAMILLE, MARGOT, MARVEJOL
Marvejol entre, les lignes sur l’épaule, le filet à la main.
MARVEJOL.
Mesdames, bonsoir !... Bonsoir, madame Lauriane...
À Camille.
Bonsoir, Coco !...
À Lauriane qui l’attend de pied ferme à l’autre bout du théâtre, souriant, l’air futé et malin d’un monsieur qui en a fait une bien bonne.
Bonjour, vous !
À Camille.
Dis-moi, Coco ?... C’est très gentil à toi de m’accompagner jusqu’au bord de l’eau... mais dès que j’ai le dos tourné, tu me confisques mes souliers...
S’interrompant, à Lauriane.
Pourquoi sifflez-vous ?
LAURIANE.
Allez toujours, vous m’intéressez.
MARVEJOL.
...tu me confisques mes souliers et on ne te revoit plus.
CAMILLE.
Coco !
MARVEJOL.
Je ne suis pas jaloux...
À Lauriane qui siffle toujours.
Ah çà !...
À Camille.
mais c’est un système qui m’empêcherait de courir après toi, si jamais, un jour, je le devenais...
En regardant Lauriane.
Coco, tu m’as fait une farce !
LAURIANE.
Est-il bête !
CAMILLE.
Comment. Tu ne vois pas ?...
Elle désigne la boutonnière de Lauriane.
MARVEJOL s’approche, se penche, et, très simplement, sans le moindre étonnement.
C’est pour ça ?... Oh ! tout le monde les a, aujourd’hui.
LAURIANE, hors de lui, se retourne brusquement vers Margot.
Qu’est-ce que tu fais là, toi ?
MARGOT.
Rien.
LAURIANE.
Ce n’est pas une occupation. Lavernié nous arrive. La chambre d’ami ?
MARGOT.
Elle est prête.
LAURIANE.
Ça m’étonne. Ton dîner ?
MARGOT.
J’ai mis le pot-au-feu.
LAURIANE.
Ça ne m’étonne pas. Tu sais pourtant bien que Lavernié ne peut pas le voir en peinture !
À ce moment.
LAVERNIÉ, apparaissant par-dessus la haie, comme tout à l’heure.
Pas un mot de vrai. J’adore la plate-côte, au contraire !
Scène VIII
LAURIANE, CAMILLE, MARGOT, MARVEJOL, LAVERNIÉ
LAURIANE.
Lavernié !
LAVERNIÉ, entrant.
En personne !
MARGOT, courant à lui.
Henri !... Bonjour ! Bonjour ! Ah, bonjour !
LAVERNIÉ.
Bonjour, ma petite Margot ! Tournez-vous par ici, que je voie si vous êtes toujours la plus jolie, comme la Suzon de la chanson. – Bon ! Tout va bien. Montrez vos dents.
MARGOT, gênée.
Henri...
LAVERNIÉ.
Montrez vos dents, que diable ! puisque j’ai plaisir à les voir. – Est-ce que je ne vous ai pas, un jour, baptisé la princesse Quenottes ?
MARGOT.
Si !
Elle rit.
LAVERNIÉ, ravi.
Splendeur ! Magnificence ! Féérie ! -- Mon Dieu, que j’ai d’amitié pour vous !
Il l’embrasse.
LAURIANE.
Ne t’épate pas.
LAVERNIÉ.
C’est ce que je fais.
Il embrasse Margot sur l’autre joue.
LAURIANE.
Grapille ! Grapille !
LAVERNIÉ.
Je cueille des pêches ; on a le droit. Et puis, laisse-nous tranquilles, hein. C’est mon amie, cette enfant-là ! c’est mon chou et ma préférée !... Pas, Margot ?
MARGOT.
Bien sûr.
LAVERNIÉ.
Tu entends ?
Il rit, puis, revenant à Lauriane, il lui serre la main avec beaucoup d’affection.
Qu’est-ce que tu deviens, autrement ?
LAURIANE.
Et toi ?
LAVERNIÉ.
Oh ! moi, mon bon, je suis comme beaucoup d’autres : je deviens vieux tout doucettement. Je m’éveille tous les matins avec un jour de plus que la veille, et j’en pleure de rage jusqu’au soir. À part cela, je relis les lettres des maîtresses qui m’ont trompé et des amis qui m’ont trahi ; je compte mes rides du bout de mon doigt en me regardant dans la glace, et quand j’ai une minute à moi, je retouche mon testament, ou j’y ajoute un codicille. Enfin, je me distrais, quoi ! Je m’amuse.
LAURIANE.
Farceur !... que je te présente, au fait ! Mon ami, mon vieil ami, Henri Lavernié. Madame et monsieur Marvejol, nos voisins et nos amis.
On se salue. Les hommes échangent des poignées de main.
Eh maintenant, que la fête commence ! Ursule !
Apparition de la bonne.
URSULE.
Monsieur ?
LAURIANE.
Montez la valise de monsieur. Débarrasse-toi de ton chapeau. Veux-tu un panama ?
LAVERNIÉ.
Merci.
LAURIANE.
Une vieille casquette à moi ?
LAVERNIÉ.
Non.
LAURIANE.
Un verre de madère ?
LAVERNIÉ.
Rien du tout.
LAURIANE.
Lavernié, tu n’es pas gentil... J’aurais aimé, le verre en main, et une émotion dans la voix...
LAVERNIÉ, apercevant la boutonnière de Lauriane.
Qu’est-ce que tu as donc là ?... Ôte ça !...
LAURIANE.
Quoi ?
LAVERNIÉ.
Ôte ça !...
LAURIANE.
Mais...
LAVERNIÉ.
Ôte ça, je te dis...
Il s’éloigne et va au couple Marvejol.
LAURIANE, abasourdi.
Qu’est-ce qui lui prend ?
MARVEJOL, à Lavernié.
N’avez-vous pas, cher monsieur, exposé au Salon dernier une vue de Venise ?... Exquise d’ailleurs, et d’un ton...
LAVERNIÉ.
Je ne fais que le portrait, cher monsieur...
MARVEJOL, gêné.
Ah ! Parfaitement !
MARGOT, à Lauriane, étonnée de voir Ursule dresser le couvert dans le jardin.
On dîne dans le jardin ?
LAURIANE, en haussant les épaules.
Dans la cave. Aimes-tu mieux que ce soit sur le toit ?
À Lavernié.
Nous dînons dehors, n’est-ce pas ?... Tu n’y vois pas d’inconvénient ?
LAVERNIÉ.
Au contraire.
Regardant les palmes de Lauriane.
Encore !... Ôte donc ça !...
LAURIANE.
À cause ?
LAVERNIÉ.
À cause... Pas devant le monde. Tout à l’heure...
LAURIANE, à part.
Ah çà !... Ah çà !...
CAMILLE, dans un coin, bas à Lavernié qui s’est approché d’elle.
En voilà une surprise !
LAVERNIÉ, bas.
Si je m’attendais à cela !...
CAMILLE, bas.
Qu’est-ce que tu fais ici ?
LAVERNIÉ, bas.
Vous êtes donc à Chennevières ?
CAMILLE, bas.
Tu le sais bien ! Je te l’ai écrit.
LAVERNIÉ, bas.
Rien reçu.
CAMILLE, bas.
C’est extraordinaire.
LAVERNIÉ, bas.
D’ailleurs, j’étais en voyage. Je t’en ai informée.
CAMILLE, bas.
Rien reçu non plus ! – Où cela ?
LAVERNIÉ, bas.
Poste restante, comme toujours. Place Clichy. A. B. C.
CAMILLE, bas.
A. B. C. ! Imbécile !
Rectifiant.
X. Y. Z... 555 !
LAVERNIÉ, bas.
Tout s’explique !
CAMILLE, bas.
Tu connais donc les Lauriane ?
LAVERNIÉ, bas.
Il faut croire.
CAMILLE, bas.
Tu ne me l’avais jamais dit.
LAVERNIÉ, bas.
Tu ne me l’avais jamais demandé.
CAMILLE, haussant les épaules, bas.
En voilà une réponse !... Quand te verrai-je ?
LAVERNIÉ, bas.
Un de ces jours.
CAMILLE, bas.
Je veux savoir tout de suite.
LAVERNIÉ, bas.
Eh bien... Chut ! On nous regarde !
Apparition d’Aurélie, la bonne des Marvejol. Elle passe la tête par-dessus la haie qui sépare les deux jardins.
AURÉLIE.
Madame est servie.
MARVEJOL.
Allons, Coco !
CAMILLE.
Vous venez tous prendre le café chez nous, hein ?
À Lavernié.
Monsieur nous fera bien le plaisir d’être des nôtres ?
LAVERNIÉ.
Avec joie, madame.
CAMILLE.
Alors à tout de suite.
LAURIANE, impatient.
Entendu.
MARVEJOL.
Et on fera un trente et un.
LAURIANE, de même.
Ça va !...
MARVEJOL.
Passe devant, Coco.
Scène IX
LAURIANE, MARGOT, LAVERNIÉ
MARGOT.
Et maintenant, à table.
LAURIANE, intrigué.
Eh bien ?
LAVERNIÉ.
Eh bien...
Entre Ursule portant la soupière.
Pas devant la bonne.
LAURIANE, bas.
Je vais l’expédier...
Haut.
Rompez ! On vous a assez vue.
Sortie d’Ursule.
Elle est partie. Qu’est-ce qu’il y a ?
LAVERNIÉ.
Il y a de l’erreur.
LAURIANE.
De l’erreur ?
LAVERNIÉ.
De l’erreur.
LAURIANE.
Rapport ?
LAVERNIÉ, désignant le ruban.
À ça !
LAURIANE.
À mes palmes ?
LAVERNIÉ.
À ces palmes.
LAURIANE.
Je ne comprends pas un mot.
LAVERNIÉ.
Tu les portes.
LAURIANE.
Sans doute.
LAVERNIÉ.
Pourquoi ?
LAURIANE.
Parce que c’est mon droit.
LAVERNIÉ.
Non !
LAURIANE.
Si !
LAVERNIÉ.
Non !
LAURIANE.
Tu te fiches du monde. On ne m’a pas donné les palmes pour que je les mette dans un placard.
LAVERNIÉ.
On ne t’a rien donné du tout.
LAURIANE.
Si !
LAVERNIÉ.
Non !
LAURIANE.
Si !
LAVERNIÉ.
Tu as reçu une dépêche ?
LAURIANE.
Oui.
LAVERNIÉ.
Eh bien ?
LAURIANE.
Elle est limpide : « L’affaire est dans le sac. »
LAVERNIÉ, rectifiant.
Dans le lac.
LAURIANE.
Comment dans le lac ?
LAVERNIÉ.
Parfaitement, tu as mal lu.
LAURIANE.
Lis toi-même.
Il lui présente le bleu.
LAVERNIÉ, après avoir lu.
Un S pour un L ; une coquille !...
LAURIANE, les poings serrés.
Alors, il y a de l’erreur ?
LAVERNIÉ.
Je te le disais.
LAURIANE.
N... de D... !
Entre Ursule.
Chut !... Pas devant la bonne...
Haut.
Qu’est-ce que c’est ? Le bœuf ? Enlevez-le ! Monsieur Lavernié ne l’aime pas.
LAVERNIÉ.
Oh ! mais pardon !
LAURIANE.
Filez !
Coups de tonnerre. Quelques gouttes tombent.
MARGOT.
Faites des œufs sur le plat. – Tiens, la pluie. Nous devrions rentrer.
LAURIANE, hors de lui.
Fiche-nous la paix, avec ta pluie !... Nous sommes très bien ici !... Dans le lac !... Dans le lac !...
MARGOT, qui s’est levée et qui a été prendre sur une chaise son ombrelle.
Tu t’énerves ?
Elle ouvre son ombrelle.
LAURIANE.
Laisse-moi tranquille ! Dans le lac !!! Tu devais voir le ministre ?
LAVERNIÉ.
Je l’ai vu. Il a été fort aimable.
LAURIANE.
Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
LAVERNIÉ, il se couvre la tête avec son mouchoir.
Des choses tout à ton éloge, d’abord ; puis, que tu passerais à ton tour de bête.
LAURIANE.
Eau bénite de cour !
LAVERNIÉ, étendant la main.
Eh ! ça tombe !
LAURIANE.
Et après ?
LAVERNIÉ, en ouvrant son parapluie.
« J’apprécie vivement, m’a-t-il déclaré, les mérites de M. Lauriane, fonctionnaire zélé autant qu’intelligent. Malheureusement, la distinction flatteuse...
LAURIANE, arrachant le ruban et le jetant à la volée.
Voilà ce que j’en fais ! Continue.
LAVERNIÉ.
...que vous sollicitez pour lui est l’objet de nombreuses convoitises. Songez donc qu’à lui seul, le ministère auquel appartient votre ami présente trente-sept candidatures dont six au moins sont justifiées. »
LAURIANE.
Et il n’a pas ajouté que j’avais une tache dans ma vie ?... Jouez donc l’étonnement, tous les deux !
À Margot.
Tu sais bien ce que je veux dire.
MARGOT, à Lavernié.
Au fait ! vous allez voir, Henri, c’est encore à moi qu’il doit ça.
LAURIANE.
Oui, c’est à toi.
MARGOT.
Voilà ! Dois-je rire ou pleurer ?
LAURIANE, en se levant.
Tu dois te taire.
Ursule entre avec des œufs sur le plat. Lauriane lui arrache le plat des mains.
Ça va bien, allez !
Ursule sort.
Il n’y en a qu’un qui a le droit d’élever la voix ici. C’est moi. Que tu brises ma carrière, passe encore !... Mais que tu me casses les oreilles, non.
MARGOT, les larmes aux yeux.
Je brise ta carrière, moi !
LAVERNIÉ.
Dieu ! que tu es embêtant !
LAURIANE.
Car plus je réfléchis, et plus je me souviens ! Avec ton air de ne pas y toucher, sais-tu bien que, grâce à toi, j’ai tout manqué, tout perdu, tout raté, tout gâché ! Un mariage superbe, inespéré ! Une place merveilleuse au Tonkin ! De l’avancement. De l’augmentation ! Ces palmes !... Ces palmes auxquelles je ne tenais pas... mais que je désirais avoir pour flatter ta vanité ! Autant de rêves envolés ! Eh bien, j’en ai ma claque, là ! Ce métier de forçat m’est devenu odieux...
En frappant du poing sur la table.
J’en ai assez ! J’en ai assez ! J’en ai assez !
MARGOT se lève, sort tout en larmes et murmure entre deux sanglots.
Oh ! moi aussi, j’en ai assez !
Scène X
LAURIANE, LAVERNIÉ
LAURIANE.
Si tu veux du fromage ?
LAVERNIÉ.
Merci.
Long silence, puis, allumant une cigarette.
Toi, tu ne seras content que le jour où Margot aura fait des blagues.
LAURIANE.
Margot ? C’est une cruche, Margot !
LAVERNIÉ.
Une cruche ?
LAURIANE.
Oui.
LAVERNIÉ.
Eh bien, méfie-toi de la mener à l’eau un peu plus souvent qu’il ne faudrait ; tu pourrais te faire éclabousser. En vérité, c’est inimaginable. Voilà une enfant délicieuse, qui t’aime, te fait honneur, emplit cette maison de sa jeunesse qui l’embaume et de son rire qui l’égaye, et tu n’as d’autre ambition, tu n’entrevois d’autre dessein, tu ne poursuis d’autre but que le but idiot de la faire tourner en bourrique !... Gare !... Tu joues là un jeu dangereux. On a vu des femmes se venger quand on ne leur avait rien fait, et Margot aurait une excuse.
LAURIANE.
Tout de bon ?
LAVERNIÉ.
Tout de bon.
LAURIANE.
Sais-tu que tu la défends avec une certaine chaleur ?
LAVERNIÉ.
C’est tout naturel.
LAURIANE.
Comment donc !
LAVERNIÉ.
Tu dis cela avec un drôle d’air...
Rires mystérieux de Lauriane.
Oh ! cartes sur tables, je t’en prie ; notre amitié est trop ancienne pour se pouvoir accommoder d’équivoques et de faux-fuyants. Si tu as une pensée de derrière la tête, tu vas lui donner la volée ou je vais, moi, boucler ma valise, prendre mon chapeau et cavaler !
LAURIANE.
Tu t’emballes !...
LAVERNIÉ.
J’en ai le droit. Comme tous les gens qui n’ont rien à cacher, je suis pour les maisons de verre. Parle.
LAURIANE.
Les amoureux sont inouïs ! Ils crient leur secret sur les toits et ils s’étonnent que les couvreurs, qui ont des oreilles, les entendent !
LAVERNIÉ, très surpris.
Je suis amoureux ?
LAURIANE.
De Margot.
LAVERNIÉ.
Moi ?
LAURIANE.
Tu me prends pour un aveugle. Je ne m’aperçois pas de ton petit manège, peut-être ? et je ne te vois pas depuis longtemps tourner autour de ses jupes !... Allons, sois franc ! En as-tu envie ?
LAVERNIÉ.
Oui, parbleu ! Et c’est le moindre hommage que je puisse rendre à la beauté de cette charmante fille. Mais de là à lui faire la cour quand tu n’y es pas et à tourner autour de ses jupes, il y a une nuance. N’insiste pas, tu me blesserais. Je n’ai pas coutume d’abuser de la confiance des personnes pour leur dérober leur argent, leur montre ou leur bonne amie.
LAURIANE.
Aucun rapport.
LAVERNIÉ.
Je te demande pardon. La femme d’un ami est son bien au même titre que sa bourse.
LAURIANE, spirituel.
Ou que son parapluie.
LAVERNIÉ.
Parfaitement. Et pour moi, si jamais je pinçais un copain, fût-ce le plus ancien et le meilleur, à me chahuter ma maîtresse, je lui casserais les reins, tu m’entends ? et ceci, sans l’ombre d’un scrupule.
LAURIANE.
Moi pas.
LAVERNIÉ.
Ouat !
LAURIANE.
Fais-en l’expérience.
LAVERNIÉ.
Comment ?
LAURIANE.
Margot te plaît, prends-la.
LAVERNIÉ, abasourdi.
C’est pour rire, je pense.
LAURIANE.
Du tout. Mon cher, tu ne me connais pas.
LAVERNIÉ.
Je te connais à peine, en effet. Cela ne remonte guère qu’à trente-cinq ans, au temps où nos pans de chemises passaient par nos fonds de culotte. Tu as toujours été le même : épateur, bluffeur et faiseur d’embarras.
LAURIANE.
« Jeune homme, dit le proverbe, emporte-toi moins, tu ne t’en porteras que mieux. » Non, mais tu es extraordinaire avec tes allures de César. Suis-je obligé de partager tes petites manières de voir et dois-je être un reflet de ta vie ? Je suis un indépendant, moi !
LAVERNIÉ.
Ça y est ! Voilà ce que je craignais.
LAURIANE.
Et tu le sais très bien, d’ailleurs. Seulement, tu ne veux pas en convenir, étant un être compliqué, subtil et paradoxal.
LAVERNIÉ.
Paradoxal ! Paradoxal !... Eh ! je le hais, le paradoxe ! J’en ai l’exécration, le dégoût et la crainte, comme d’une fille publique qu’il est !
LAURIANE.
Et avec qui l’on couche.
LAVERNIÉ.
À l’occasion, pour rire, mais qu’on n’épouse pas, N... de D... !... Seigneur ! qu’il est donc difficile d’arriver à se faire comprendre !
LAURIANE.
Tu as raison. Restons-en là. Je ne discute pas avec les enfants.
LAVERNIÉ.
Pourquoi donc ? Je discute bien avec des andouilles, moi qui te parle.
LAURIANE.
Trop aimable !
LAVERNIÉ.
Mon cher Lauriane, j’ai horreur des phrases à effet et des daims qui battent la caisse sur la peau d’âne des mots creux. Voilà une heure que tu sues sang et eau à essayer de m’intéresser, tu ne m’intéresses pas, c’est bien simple. Tu veux me la faire, tu ne me la feras pas, c’est bien simple. Fais ton profit de ces paroles et rends grâce à mon affection, si elle a sa rude franchise, d’avoir aussi sa probité. Car c’est vrai, elle me plaît, Margot ; et elle me plaît même beaucoup ! et cela ne date pas d’aujourd’hui ! et si on me la donnait, je sais bien ce que j’en ferais ! et il est inouï de penser que nous ayons pu en venir, moi à te faire de pareils aveux, et toi, Lauriane, à les entendre !
LAURIANE.
Puis-je te demander poliment, avec tous les égards voulus, la permission de placer un mot ? Tu me l’accordes ? Oui ? C’est heureux ! Sache donc, ceci pour ta gouverne, que j’ai plein le dos de Margot ; que ma liaison avec elle a plus que suffisamment duré, mes habitudes n’étant pas de m’éterniser dans le collage, et que, d’ailleurs, en fût-il autrement, jamais une femme, jamais – tu m’entends, à ton tour ? – ne me brouillera avec un ami.
Lavernié hausse les épaules.
Alors là, raisonnablement, tu penses que je pourrais hésiter une seconde entre un vieux camarade d’enfance, comme voilà toi, et Margot dont je connais le passé, après tout, et qui n’est jamais qu’une...
LAVERNIÉ.
Tu vas dire une lâcheté.
LAURIANE.
Mais mon cher, j’ai ramassé ça...
LAVERNIÉ.
Elle est dite. C’est la dernière. Tu finirais par me fâcher et je ne suis pas venu chez toi pour avoir le désagrément de te jeter au nez des choses désobligeantes. Je me résume. J’ai pour cette enfant autant de tendresse que d’estime et prétends qu’elle a plus à se plaindre de toi que tu n’as à te plaindre d’elle, un homme de ton âge, et du mien, demeurant toujours, quoi qu’il arrive, l’obligé du bras qui enlace, du regard qui sourit et de la bouche qui sent bon. Ceci soit dit pour elle. Quant à son honnêteté, je ne la discute même pas, et c’est un point de la question qui a sa petite importance, sans que tu aies l’air de t’en douter.
LAURIANE.
Son importance ? Quelle importance ? Je ne sais pas ce que tu veux me dire. Je te répète que chacun, en ce bas monde, pratique la vie à sa façon. Tu as tes idées, j’ai les miennes, et c’est mon droit, quand le diable y serait, de prendre la chose gaiement, si les autres jouent de la musique sur le même instrument que moi.
LAVERNIÉ.
Tu me fais suer !
LAURIANE.
Triomphe à ton aise !
Il se lève.
Je vais prendre le café chez le voisin. En ce qui concerne Margot, ne te gêne pas, si le cœur t’en dit. Dans le cas contraire, allonge-toi à côté, comme ils disent en Normandie.
Tirant sa montre.
Neuf heures moins le quart. Ah ! diable !... Tu viens ?
LAVERNIÉ.
Je ne sais pas... Tout à l’heure...
LAURIANE.
Comme tu voudras. Je suis là, moi.
Fausse sortie.
Tu devrais mettre ton pardessus.
LAVERNIÉ.
Je n’ai pas froid.
LAURIANE.
Mets-le tout de même ; c’est prudent, par ces sales temps-là. C’est vrai, ça, on attrape la mort et puis, après, on est tout surpris d’être malade.
Il sort. Lavernié le suit du regard. Petite pantomime trahissant son incertitude d’esprit. Il prend une cigarette, l’allume, en tire une bouffée, puis la rejette. Claquement agacé de son pouce contre son index. Appel impatienté des lèvres. On le sent perplexe, hésitant, très troublé de ce qu’il vient d’entendre et ne sachant ce qu’il doit croire. Quelques instants s’écoulent. Enfin Margot paraît.
Scène XI
LAVERNIÉ, MARGOT
MARGOT.
Je suis prête. Tiens, vous êtes seul ?
LAVERNIÉ.
Oui. Ah çà ! mais regardez-moi donc un peu. Vous pleurez ?
MARGOT.
C’est fini. Votre bras.
LAVERNIÉ.
Votre mouchoir.
MARGOT.
Pourquoi faire ?
LAVERNIÉ.
Donnez toujours.
Elle obéit. Lavernié lui séchant les yeux.
Beaux yeux mouillés, auxquels on a fait de la peine ! Si on ne dirait pas des pervenches, l’été, à quatre heures du matin ! Qu’est-ce qu’il y a ?
MARGOT.
Rien.
LAVERNIÉ.
Qu’est-ce qu’il y a ?... Un peu de franchise, sacrebleu ! Vous n’avez pas confiance en moi ?
MARGOT.
Oh ! que si !
LAVERNIÉ, amusé.
Elle a bien dit ça !... Un bon point à la jeune Margot. Allons, venez vous asseoir là, près de moi, et causons tous les deux. Qu’est-ce qu’il y a, encore une fois ?
MARGOT, à voix basse.
Je veux retourner à l’atelier.
LAVERNIÉ, étonné.
À l’atelier ?... Où ça ?
MARGOT.
Chez Madame Thibaut.
LAVERNIÉ.
Qui, Madame Thibaut ?
MARGOT.
Mon ancienne patronne, la dame de la rue d’Aboukir : « Plumes et fleurs », près de la rue Montmartre. J’y étais encore mieux qu’ici. Je n’y gagnais pas des mille et des cent, cependant, et je peux me vanter d’en avoir boulotté, des cornets de pommes de terre frites et des moules à huit pour un sou ! sans compter qu’il y a des moments, l’hiver, après qu’on a veillé, où c’est rudement dur de se lever à sept heures pour être à huit à l’atelier. N’importe, c’est le métier d’honnête fille qui veut ça !
LAVERNIÉ.
Oui, il a quelques exigences.
MARGOT.
Oh ! s’il ne s’agissait que de se lever à la lampe, de déjeuner quand ça se trouve et de dîner quand ça se rencontre, on pourrait encore s’entendre. Seulement, voilà : il y a le cœur, l’imbécile, le stupide cœur !
LAVERNIÉ.
Si c’est du vôtre que vous parlez, ne dites pas de mal de cet innocent. Il ne vous a jamais donné que de bons conseils.
MARGOT.
Il ne m’a fait faire que des sottises !
LAVERNIÉ.
Vous êtes jalouse, vous.
MARGOT.
Je voudrais bien.
LAVERNIÉ.
C’est fini de me prendre pour une bête ?
MARGOT, protestant.
Oh !
LAVERNIÉ.
C’est fini ?... Voyons, Margot, pourquoi manquer de sincérité ? Quel besoin de machiner son âme comme un théâtre, d’y adapter des trappes où on ne se prend pas le pied et des jeux de glace qui ne trompent personne, quand il serait si simple de dire : « J’ai du chagrin, Lavernié ; j’aime mon amant qui ne m’aime pas ; je lui suis fidèle et il me trompe. » Oui, mon mignon, voilà comment parle un bébé qui n’a pas honte de son cœur pur, de son cœur ingénu et tendre. Et Lavernié, qui est un bon garçon, en somme, prend dans ses mains les petites pattes de Margot...
MARGOT, émue.
Henri...
LAVERNIÉ.
...la gronde, la sermonne, la raisonne, fait à ses grands yeux les gros yeux, et lui crie d’une voix courroucée : Qu’est-ce qui m’a bâti une toquée pareille ?... Voulez-vous bien ne plus pleurer ! Votre amant vous adore, nigaude !
Changeant de ton.
Car la voilà, la vérité : il vous aime, je vous jure qu’il vous aime, et quant à sa fidélité, j’en répondrais comme de la vôtre. Mais regardez-moi donc en face, sapristoche ! Est-ce que j’ai l’air, oui ou non, d’un monsieur qui sait ce qu’il dit ?
MARGOT.
Vous ne savez surtout ce que vous faites... Votre amitié me gâte, comme toujours. Seulement, vous vous trompez...
Muette interrogation de Lavernié. Poursuivant.
en tout, ou à peu près. Je suis fidèle. Oh ! çà !... Quant au reste... Écoutez : vous me demandiez tout à l’heure si j’avais confiance en vous ? Vous allez voir à quel point : Henri, je n’aime pas mon amant.
LAVERNIÉ, ironique.
Au contraire.
MARGOT.
Vous ne le croyez pas ?
LAVERNIÉ.
Non, mon gros. D’autant moins que, si je le croyais, je ne comprendrais pas, je l’avoue...
MARGOT.
...Pourquoi je suis devenue sa maîtresse ?
LAVERNIÉ.
Dame !
MARGOT.
Je suis devenue sa maîtresse par la raison que je suis incapable d’être la mienne. Il voulait ; je ne voulais pas ; à la fin, j’ai bien voulu : voilà tout le roman de mes amours qui est, en même temps, toute l’histoire de ma vie. Je ne veux pas ; on veut ; à la fin, je veux bien : c’est aussi simple que cela et voilà, en deux coups de crayon, le portrait de votre petite amie. Ce n’est pas de chance, d’être ainsi bâtie. Que voulez-vous que j’y fasse ? On ne se refait pas. Du reste, la chance et moi...
Geste vague.
LAVERNIÉ, se moquant.
Ça, c’est pour faire l’intéressante.
MARGOT.
Je ne fais pas l’intéressante ; je dis seulement : « La chance et moi... », parce que vraiment, la chance et moi... Jamais je n’ai eu de chance ; jamais. À la maison, maman me battait sous prétexte que je faisais la noce. À l’atelier, on se moquait de moi parce que, justement, je n’avais pas d’amoureux et que, par-dessus le marché, je ne trouve rien à répondre quand on me tourne en ridicule. Je ne sais que pleurer ! Ce n’est pas de ma faute !... Tout cela, inévitablement, devait me livrer, un jour ou l’autre, au premier passant venu qui me tendrait les bras. Ce fut Charles qui passa. J’étais à plaindre : il me plaignit. Il en eut l’air, du moins, mais je n’en demandais pas plus, car c’est le malheur de ma vie de m’en remettre aux apparences et de croire les gens sur parole. Tous les soirs, à la sortie du travail, je le trouvais qui m’attendait au coin de la rue Vide-Gousset et de la place des Victoires. Nous nous en revenions ensemble par le Métro, et, des fois, avant de se quitter, comme c’était dans la belle saison, on s’arrêtait à prendre un petit quinquina, chez un troquet de Ménilmontant, où il y a des tables sous les arbres. On était bien, on était seuls... La fraîcheur tombait, comme elle tombe ; la nuit venait, comme elle vient ; on entendait de temps en temps siffler au loin les trains de Ceinture, comme à présent ceux de Vincennes...
Baissant la voix, comme honteuse.
Ça fait qu’un soir je me suis laissé prendre la main, un autre soir la taille, un autre soir la bouche... comme, toute petite, je me laissais prendre mes joujoux, mes sous, mes images, mon dessert, faute de savoir me défendre. Je n’ai jamais su me défendre. Je ne peux pas ; on me demande, je donne.
LAVERNIÉ, apitoyé.
Misère !
MARGOT.
Ensuite, ma foi, je crois bien que le bon Dieu m’a punie, car ça n’a guère bien tourné, mon équipée !... Que voulez-vous, c’est l’ordre et la marche avec moi, je commence par avoir confiance, je prends bon espoir, j’y mets du mien... – si vous saviez comme j’ai peu d’exigence, je ne demande qu’à être heureuse, je suis contente avec un rien !... – et puis, un beau matin... clic ! c’est mon bonheur qui me casse dans les doigts, comme du verre. Est-ce bête, hein ? Enfin, c’est comme ça. Bref, au bout de six semaines, je savais à quoi m’en tenir : c’était la vie abominable.
LAVERNIÉ.
Ça n’a pas traîné !
MARGOT, avec douceur.
Non...
LAVERNIÉ.
Pauvre enfant !... Alors ?
MARGOT.
Alors, j’ai tenu le coup de mon mieux, tendant le dos, espérant des lendemains meilleurs, comptant que ma douceur naturelle, ma bonne grâce, ma soumission, finiraient bien, un jour ou l’autre, par avoir le dernier mot. D’autant plus que j’étais toute prête à l’aimer en reconnaissance des choses gentilles qu’il avait d’abord faites pour moi, et que je me sentais toute bête, avec mon petit sentiment sur les bras, dont je ne savais plus quoi faire... À la fin, mes yeux se sont ouverts, j’ai compris que je perdrais mon temps et, du même coup, j’ai perdu mon courage. On se lasse, vous comprenez, des rebuffades continuelles et des mauvais procédés. Sans compter, n’est-ce pas, que si on est venu au monde avec une figure pas très belle et pas plus d’esprit qu’un petit chat, ce n’est pas une raison suffisante pour qu’on vous en fasse le reproche depuis le Jour de l’An jusqu’à la Saint-Sylvestre. Je vous le dis, Henri, croyez-moi : l’amour tenterait en vain de forcer une porte que gardent si jalousement l’injustice et la méchanceté. Il n’est pas ici chez lui ! Il n’habite pas cette maison, ou s’il y est...
LAVERNIÉ.
S’il y est ?
MARGOT.
...il y est bien caché.
Elle se lève.
LAVERNIÉ, de qui une pensée a traversé l’esprit.
Qu’est-ce que vous voulez dire ?
MARGOT.
Rien de plus.
LAVERNIÉ.
Bien vrai ?
MARGOT.
Sans doute.
LAVERNIÉ.
Vous me cachez quelque chose.
MARGOT, qui commence à se troubler.
Non.
LAVERNIÉ.
Si.
MARGOT.
Non.
LAVERNIÉ.
Vous aimez quelqu’un.
MARGOT.
Moi ?
LAVERNIÉ.
Oui, vous.
MARGOT.
Quelle plaisanterie !
LAVERNIÉ, pesant sur les mots.
Vous aimez quelqu’un.
MARGOT.
Vous êtes fou.
LAVERNIÉ, lui prenant les mains.
Regardez-moi en face.
MARGOT.
Henri !
LAVERNIÉ, avec autorité.
Là ! Dans les yeux.
MARGOT.
Mais je vous regarde... mais je vous jure... mais quelle idée !... Je n’aime personne ! personne ! personne !
LAVERNIÉ.
Qui est-ce ?
MARGOT, qui se débat.
On nous attend, venez.
LAVERNIÉ.
Qui est-ce ?
MARGOT.
Lâchez mes mains...
LAVERNIÉ.
Qui est-ce ?
MARGOT.
Je ne vous le dirai pas. Vous ne le saurez jamais !
Éclatant en sanglots.
Je veux retourner à l’atelier ! Je veux retourner à l’atelier !... Lâchez-moi, je vous en supplie !...
Brusquement, Lavernié comprend. Sa loyauté s’émeut, et, d’un mouvement rapide, il a lâché les mains de Margot. Celle-ci s’éloigne à pas lents, gagne la porte par où elle est venue.
LAVERNIÉ la regarde s’éloigner ; on le sent en proie à une lutte intérieure. Soudain, la tentation l’emporte ; alors, à demi-voix.
Margot !
Margot, qui allait disparaître, se retourne. La nuit est venue complètement, mais à la faveur d’un rayon de lune [qui] filtre à travers les verdures du jardin, elle l’aperçoit, immobile, qui lui tend les bras en silence.
MARGOT, éperdue.
Henri !
C’est tout. Un saut et elle est à son cou. Ils se baisent aux lèvres, passionnément. On entend, dans l’éloignement, des chants de canotiers attardés sur la Marne. Le rideau tombe.
ACTE II
Le théâtre représente un atelier de peintre. Ameublement artistique. Aux murs, des toiles sans cadres, alternées de cadres sans toiles. Statues, moulages, panoplies, divans. Au fond, une porte à deux battants ; à droite, une porte plus petite donnant sur la chambre à coucher. À gauche, au premier plan, un chevalet soutenant une toile dont l’envers fait face au public. Au lever du rideau, Lavernié, seul en scène et debout devant son chevalet, est en train de copier un corsage de dentelle dont est revêtu un mannequin assis sur une chaise près de lui. Il a la cigarette aux lèvres et le pouce dans le trou de la palette. Scène muette. L’artiste couvre sa toile de larges coups de brosse, recule, cligne des yeux pour juger de l’effet. La porte de droite s’ouvre. Entre Margot. Elle a son chapeau à la main et ses gants.
Scène première
LAVERNIÉ, MARGOT
MARGOT.
C’est moi. Je me suis fait attendre, mais j’ai remis de l’ordre dans la pièce.
LAVERNIÉ.
Il ne fallait pas prendre cette peine. La concierge est là.
MARGOT.
Tu travailles ?
LAVERNIÉ.
Comme tu vois.
MARGOT.
Cela avance ?
LAVERNIÉ.
C’est fini. Quelques petites vigueurs dans le corsage, un vague nettoyage dans les fonds, et voilà la question tranchée.
MARGOT, qui s’est approchée.
Je peux dire mon petit mot ?
LAVERNIÉ.
Dis-le.
MARGOT.
J’ai une critique à faire.
LAVERNIÉ.
Fais-la.
MARGOT, timidement.
Les perles du collier me paraissent un peu grosses.
LAVERNIÉ.
Oh !... Des noyaux de pêche tout au plus. Ordre supérieur, mon enfant ! La clientèle féminine a comme ça de petites exigences où se trahissent ses instincts délicatement artistiques. Bah ! la route est belle, comme dit l’autre. Ces joyaux reprendront leurs justes proportions, vus à travers les yeux de sotte qui se proposent de s’en repaître.
MARGOT.
Tu as du talent !
LAVERNIÉ.
Tu m’ennuies.
MARGOT.
Tu serais le seul à l’ignorer. Quel étrange besoin éprouves-tu de te placer toujours au-dessous de ton rang et de déprécier ton mérite ? C’est un chef-d’œuvre ce portrait.
Lavernié hausse les épaules.
Tu ne trouves pas ?
LAVERNIÉ.
Le fait du véritable artiste n’est pas de se complaire en ce qu’il fit, mais de le comparer tristement à ce qu’il aurait voulu faire.
MARGOT.
Ah !
LAVERNIÉ.
Oui. Passe-moi mon tube de blanc. Merci.
MARGOT.
Allons, adieu.
LAVERNIÉ.
Te voilà partie ?
MARGOT.
Il faut bien. Charles quitte son bureau à cinq heures. S’il était rentré avant moi, cela ferait des histoires.
LAVERNIÉ.
Ah ! diable ! Sauve-toi donc !
MARGOT.
À demain ?
LAVERNIÉ.
Si tu veux.
MARGOT.
À après-demain ?
LAVERNIÉ.
Si tu préfères.
MARGOT, une impatience dans la voix.
Enfin, à quand ?
LAVERNIÉ, étonné.
Quel ton prends-tu pour me poser cette question ? Viens quand il te plaira, aux heures qui te plairont. Tu seras toujours la bienvenue.
MARGOT.
Tu m’aimes ?
LAVERNIÉ.
Laisse-moi travailler.
MARGOT.
Tu ne m’aimes pas ?
Lavernié se tait.
Avoue que c’est vrai ; je ne t’en garderai pas rancune. D’abord, je le sens ; puis j’ai si peu, si peu de chance, que je commence à m’y habituer.
LAVERNIÉ.
Es-tu heureuse avec moi, oui ou non ?
MARGOT.
Infiniment. Tu le sais bien.
LAVERNIÉ.
Alors, dors en paix, laisse-toi vivre, et ne me tourmente plus de questions auxquelles je ne veux pas répondre.
MARGOT.
Pourquoi ?
LAVERNIÉ.
Parce qu’il est des mots qui restent jeunes et qu’il n’en est pas de même des bouches qui les prononcent.
MARGOT.
C’est pour toi que tu parles ?
LAVERNIÉ.
J’en ai peur.
MARGOT.
Quel âge as-tu ?
LAVERNIÉ.
Quarante-cinq ans.
MARGOT.
Tu n’es pas vieux.
LAVERNIÉ.
Non, mais je ne suis plus jeune. C’est exactement la même chose. Il n’y a pas de milieu dans la vie : dès qu’on n’est plus jeune on est vieux, et au-dessus de cinquante ans on est tous du même âge.
MARGOT.
Si les hommes sont si vite finis, qu’est-ce que nous dirons, nous, les femmes ?
LAVERNIÉ.
Ne vous occupez pas de cela.
MARGOT.
Il me semble, pourtant...
LAVERNIÉ.
Tu te trompes. Comprends donc que le cœur des hommes ne change pas avec leurs traits, et que les femmes seront toujours jeunes pour eux, puisqu’ils auront toujours pour elles des âmes de collégiens et des yeux de vingt ans.
MARGOT, très simplement.
Ah !
LAVERNIÉ.
Cela t’échappe ?
MARGOT.
Un peu.
LAVERNIÉ.
Sois franche. Tu comprends toujours ce que je te dis.
MARGOT.
À chaque instant, du moins. Je comprendrais plus souvent si je voulais faire un petit effort, mais je n’aime pas réfléchir, cela me fatigue.
Lavernié la regarde longuement.
Je suis bête, n’est-ce pas ? Oh ! je le sais. Charles est tout le temps à me le dire.
LAVERNIÉ.
Passer pour une bête aux yeux d’un crétin !... Joie !... Arrive ici, que je t’embrasse ; tu es un être délicieux, et je t’aime, moins que tu le mérites, mais plus peut-être que je le voudrais... Ne fais pas le procès de l’existence, tu en parlerais sans la connaître. Elle ne t’a pas gâtée jusqu’à présent, n’importe ! tu ne fais qu’en franchir le seuil, et le livre de la destinée ne se juge pas sur son prologue, comme un roman dont les premières pages ennuient. La vie ne vaut pas cher, la créature non plus, toute la question est de savoir laquelle des deux, de la créature ou de la vie, est le plus injuste pour l’autre. Nous la trancherons une autre fois. En attendant, ne t’occupe de rien que de rester ce que tu es, c’est-à-dire sincère, simple et bonne. Rappelle-toi que chaque jour, s’il amène sa peine, amène aussi son lendemain, et que de bons diables se rencontrent pour réparer, quand ils le peuvent, les petites maladresses du bon Dieu. Laisse donc mûrir des événements dont toi ni moi ne sommes les maîtres, et ne me regarde pas avec des yeux de mendiante : tu n’auras pas un sou de plus.
MARGOT.
Mon bien-aimé !
Ils se tiennent enlacés longuement. Coup de sonnette.
LAVERNIÉ.
Chtt ! Passe à côté une seconde.
Scène II
LAVERNIÉ, LAURIANE, puis CAMILLE
LAVERNIÉ, qui est allé ouvrir.
Tiens, Lauriane !
LAURIANE.
Te voilà, toi ! Tu as de la veine que le hasard m’ait amené devant ta porte, autrement, je t’envoyais chercher avec une trique.
LAVERNIÉ.
Peste !
LAURIANE.
Est-ce que tu te moques du monde ? Comment, voilà trois semaines que nous sommes de retour... Ne dis pas que tu l’ignorais.
LAVERNIÉ.
Je ne l’ignorais pas, je le confesse !
LAURIANE.
Tu ne l’ignorais pas, tu le confesses ! et tu n’as pas, en trois semaines, trouvé le moyen, une toute petite fois par hasard, de venir nous souhaiter le bonjour ? C’est honteux !
LAVERNIÉ.
Ne m’en parle pas ; j’ai de la besogne jusque par-dessus les épaules.
LAURIANE.
Pauvre trognon ! Tu peins la nuit ? À la lampe ou à la chandelle ?... Tu es un lâcheur, voilà mon opinion.
LAVERNIÉ.
Je la respecte.
LAURIANE.
À la bonne heure. Je te donne la main tout de même, mais c’est bien pour montrer que je suis une riche nature. Comment vas-tu ?
LAVERNIÉ.
On se défend. Et toi ?
LAURIANE.
On se maintient.
LAVERNIÉ.
Un cigare ?
LAURIANE.
Jamais ! Ça attaque le cœur. Je ne fume que des cigarettes.
Arrêté devant le chevalet.
Joli, cela ! Qui est-ce ?
LAVERNIÉ.
Une dame.
LAURIANE.
Elle en a un œil. Quel œil !... Et un collier ! Oh ! ce collier !... Des perles, hein ?... Il n’y a pas d’erreur, c’est rudement bien imité... Qu’est-ce que je voulais donc dire ?... Ah ! oui. Tu ne fais rien ce soir ?
LAVERNIÉ.
Rien que je sache.
LAURIANE.
Alors, je vais faire une course. Prends-moi donc à six heures et demie à la terrasse du petit café. On boira un vermouth et on dînera ensemble.
LAVERNIÉ.
Où ça ?
LAURIANE.
À la maison.
LAVERNIÉ.
Chez toi ?
LAURIANE.
Oui.
LAVERNIÉ.
Non.
LAURIANE.
Non ?
LAVERNIÉ.
Non.
LAURIANE.
Voilà du nouveau. Qu’est-ce qui te prend ? Tu as peur de mal manger ?
LAVERNIÉ.
Étant facile à nourrir comme tous les gens qui n’aiment rien, je me soucie peu de la table. Non, j’ai, pour ne pas me rendre à ton invitation, dont je te suis fort obligé, des motifs d’un ordre spécial, que je te demanderai, mon cher Lauriane, la permission de garder pour moi.
LAURIANE, très étonné.
Ah ?
LAVERNIÉ.
Et j’ajoute, toujours avec ta permission, que tu ne gagnerais rien du tout à les connaître.
LAURIANE.
En ce cas, je te prie de me les dire.
LAVERNIÉ.
Laisse-moi n’en rien faire.
LAURIANE.
Pardon ! Je n’admets pas le droit que tu t’arroges de piquer ma curiosité et d’éveiller mon inquiétude. En voilà des façons !
LAVERNIÉ.
L’événement m’y contraint.
LAURIANE.
Je t’invite à parler.
LAVERNIÉ.
Tu as tort.
LAURIANE.
C’est possible. La suite le démontrera. En attendant, je m’installe ici, et n’en bougerai, je te le déclare, qu’après avoir reçu de ta bouche un éclaircissement qui m’est dû.
Il prend place sur le sofa.
J’ai dit. Je suis tout oreilles. Cause.
LAVERNIÉ.
Tu l’exiges ? Eh bien, allons-y ! Aussi bien, quelles que doivent en être les conséquences, mieux vaut une explication franche qu’une situation fausse.
LAURIANE.
C’est mon avis.
LAVERNIÉ.
Parfait. Are you ready ?
LAURIANE.
Yes.
LAVERNIÉ.
Go ! Je couche avec Margot. Voilà.
Un temps, puis.
LAURIANE, égayé.
Tiens ! Tiens ! Tiens !
LAVERNIÉ.
Le procédé, à première vue, peut te paraître un peu cavalier et sans gêne, mais à la réflexion tu me rendras cette justice que j’aurais été bien naïf de ne pas suivre tes conseils et de ne pas mettre à profit les libertés auxquelles tu m’avais convié.
LAURIANE, se levant.
Elle est bonne.
LAVERNIÉ.
Comment, elle est bonne ?
LAURIANE.
Tu la fais bien.
LAVERNIÉ.
Quoi, je la fais bien ?...
Lauriane rit.
Ah çà ! Tu ne me crois pas ?
LAURIANE.
Quelle erreur ! Je ne fais que ça.
LAVERNIÉ.
Sabre et mitraille ! La vie est fertile en surprises et voilà bien la chose du monde à laquelle je m’attendais le moins... Ainsi, Margot et moi ?...
LAURIANE, malin.
Des dattes !
LAVERNIÉ.
Moi et Margot ?...
LAURIANE, même jeu.
Des navets !
LAVERNIÉ.
Et qui t’autorise, je te prie, à douter de mon affirmation ?
LAURIANE, haussant les épaules.
Ne te fais donc pas plus bête que tu n’es, Lavernié.
Lavernié veut parler. Lauriane, l’interrompant.
D’abord, si c’était vrai, tu ne viendrais pas me le dire, puis, le jour où Margot me trompera, ce ne sera pas avec toi, tu peux être tranquille.
Nouvelle interrogation de Lavernié. Lauriane, discrètement goguenard.
Tu ne t’es donc jamais regardé dans la glace ?
LAVERNIÉ, au comble de la joie.
Très bien ! Excellent ! Parfait ! Voilà une pierre dans mon jardin que je suis ravi d’y recevoir ; elle m’enlèverait mon dernier remords si j’en eusse conservé quelqu’un. Rien de tel comme un coup de fer rouge sur l’amour-propre des gens pour cicatriser leurs scrupules.
LAURIANE, ironique.
Oui, mon vieux.
LAVERNIÉ.
Décidément, tu as pour moi toutes les prévenances, et tu es le roi des amis. Sacré Lauriane, va !
LAURIANE, ironique.
Oui, mon vieux.
Ils se regardent et rient. Échange de bourrades amicales. Après quoi.
LAVERNIÉ, avec le plus grand sérieux.
Eh bien, alors, c’est entendu. L’affaire s’étant élucidée à la satisfaction de tous deux, je n’ai plus qu’à couronner tes vœux en choquant le verre avec toi à notre vieille amitié. Au petit café, tu dis ?...
LAURIANE.
À six heures et demie.
LAVERNIÉ.
Tu peux compter sur moi, j’y serai. Et pas de cérémonie, n’est-ce pas ?... La soupe et le bœuf...
LAURIANE.
...les quatre mendiants.
LAVERNIÉ.
C’est bien cela. À tout à l’heure.
LAURIANE.
À tout à l’heure. Sacré Lavernié !
LAVERNIÉ.
Oui, mon vieux.
Lauriane va pour sortir. À ce moment, sur le seuil de la porte même qu’il vient d’ouvrir, Camille apparaît.
CAMILLE, à Lavernié.
Bonjour, maître.
LAURIANE.
Madame Marvejol, Dieu me damne !
CAMILLE.
Monsieur Lauriane, Dieu me pardonne ! Charmée de vous rencontrer.
LAURIANE.
Qu’est-ce que je dirai, alors ? Inutile de vous demander des nouvelles de votre santé. Jamais on ne vous vit plus charmante et plus jeune. J’ai cru, quand vous êtes apparue, que c’était le printemps qui revenait.
CAMILLE.
Je me suis souvent demandé où vous alliez chercher les belles choses que vous me dites.
LAURIANE, galant.
Je les lis dans vos yeux.
CAMILLE.
L’image n’est pas très claire, mais l’intention est excellente...
À Lavernié.
Eh bien, maître, vous ne dites rien ?
LAVERNIÉ.
Je...
CAMILLE.
Je vous dérange ?...
LAVERNIÉ.
Aucunement.
CAMILLE.
J’en suis bien aise. Je viens pour le portrait.
LAURIANE, curieux.
Un portrait ?
LAVERNIÉ, surpris.
Quel portrait ?
CAMILLE.
Comment quel portrait ?... Mon portrait !
LAURIANE.
Tu devais faire le portrait de madame, et tu...
LAVERNIÉ, feignant de se souvenir.
Où avais-je la tête ?
LAURIANE, sévère.
Je me le demande.
À Camille.
Ce n’est pas à moi que ces choses-là arriveraient.
CAMILLE.
Il faut se montrer indulgent avec monsieur Lavernié. Il est si pris depuis quelque temps, si occupé, si absorbé, qu’on ne saurait prendre en mauvaise part l’infidélité de ses souvenirs. N’est-ce pas, maître ?
LAVERNIÉ.
Il est vrai, madame, que j’ai mille excuses à vous faire ; mais mes torts sont réparables, et si vous voulez bien me permettre de consulter mon agenda nous allons, dès à présent, fixer notre première séance.
CAMILLE.
Je vous en prie.
Lavernié remonte du fond.
LAURIANE, bas à Camille.
Camille !... ma chère Camille !... Vous savez que je vous aime toujours.
CAMILLE.
Vous êtes bien gentil, je vous remercie. Un simple conseil, mon ami ; au lieu de butiner dans le parterre des autres vous feriez mieux...
Elle s’interrompt.
LAURIANE.
Je ferais mieux... ?
CAMILLE.
Ne faites pas attention, je ne sais pas ce que je dis... Écoutez, vous allez descendre...
LAURIANE.
Bien.
CAMILLE.
Et vous m’attendrez à l’étage au-dessous. J’aurai peut-être à vous parler.
LAURIANE.
Je vous ai comprise. Vous êtes bonne... Merci... Ah ! merci !
CAMILLE.
Allez !
LAURIANE, haut à Lavernié.
Dis donc, je file, moi.
LAVERNIÉ.
Bon voyage !
LAURIANE.
Et sois exact, hein ?
LAVERNIÉ.
Sois tranquille !
LAURIANE, à la porte du fond et saluant Camille.
Madame...
CAMILLE.
Bonjour, monsieur Lauriane.
Lauriane, avec un clignement d’yeux et un geste, indique à Camille l’étage au-dessous, puis sort.
Scène III
LAVERNIÉ, CAMILLE
CAMILLE.
À présent, causons.
LAVERNIÉ.
J’allais le dire. Qu’est-ce que c’est que cette histoire de portrait ?
CAMILLE.
Tu le sais aussi bien que moi : un prétexte à me trouver chez toi le jour où je m’y rencontre en face d’un étranger qui peut s’étonner de ma présence. Ne te fais pas plus bête que tu n’es.
LAVERNIÉ.
Encore !
CAMILLE.
Quoi ?
LAVERNIÉ.
Ne t’inquiète pas. Une coïncidence qui me fait rire.
CAMILLE.
Ça doit être du propre.
LAVERNIÉ.
Allons bon !
CAMILLE.
Inutile de jeter les hauts cris, je sais ce que je dis et à qui je parle. Je suis lasse de tes allures louches et de tes airs de mystère. Sept fois, je suis venue pour te voir, et sept fois je me suis cassé le nez au veto d’une brute de portier planté sur le seuil de sa loge comme un poteau du Touring-Club... Et « Monsieur ne reçoit personne ». Et « Monsieur a donné des ordres ». Et « Monsieur a modèle ». Modèle !... Je le connais ton modèle... Un modèle de vertu qui pose les ensembles.
LAVERNIÉ.
La quantité de bêtises qu’une femme pas bête peut accumuler en peu de temps est une chose déconcertante. C’était un modèle d’homme.
CAMILLE.
Compliments ! Tu tombes bien ! Je t’ai vu l’embrasser... à Chennevières... aussi vrai que ça sent le foin coupé à en attraper la migraine... Ça ne sent pas le foin coupé, peut-être ?
LAVERNIÉ.
Et après ?...
Montrant le portrait.
Prends-t’en à celle-là ! Puis-je empêcher les gens dont je fais le portrait de se parfumer comme ils l’entendent ?
CAMILLE.
Je ne coupe pas dans tes défaites.
LAVERNIÉ.
Comme tu voudras.
CAMILLE.
Trompée, mais pas dupe.
LAVERNIÉ.
À ton aise.
CAMILLE.
Regarde-moi dans les yeux et ose le prétendre, que tu n’as pas une maîtresse !
LAVERNIÉ, qui se moque.
Plusieurs.
CAMILLE.
Tu en es bien capable.
LAVERNIÉ.
Ah ! Diable ! Non !
CAMILLE.
Des blagues, tout cela, des paroles ! Tiens, veux-tu que je te dise ?
LAVERNIÉ.
Dis.
CAMILLE.
Eh bien ! Il y a une femme ici.
LAVERNIÉ.
Une femme ?
CAMILLE.
Parfaitement !
LAVERNIÉ, haussant les épaules.
Tais-toi donc !
CAMILLE.
Combien veux-tu parier ?
LAVERNIÉ.
Tu perdrais !
CAMILLE.
Cela me regarde. Cinq louis, cela va-t-il ?
LAVERNIÉ.
Tu es folle.
CAMILLE.
Oui ?
LAVERNIÉ.
À lier.
CAMILLE.
Nous allons bien voir.
Elle s’élance vers la pièce où est entrée Margot. Mais Lavernié l’a devancée, et maintenant il reste immobile, le dos tourné à la porte, qu’il vient de fermer à double tour.
LAVERNIÉ.
On ne passe pas.
CAMILLE.
Pourquoi ?
LAVERNIÉ.
La pièce est en désordre. Je ne veux pas qu’on entre chez moi quand l’appartement n’est pas fait.
Camille et Lavernié se regardent.
CAMILLE, éclatant en sanglots.
Elle est là ! Elle est là ! Je savais bien qu’elle était là !
LAVERNIÉ, s’efforçant de la calmer.
Camille !
CAMILLE.
Ah ! misérable traître ! Menteur ! Faiseur de faux serments ! qui vous traite de folle en haussant les épaules et vous regarde jusqu’au fond de l’âme avec des yeux d’imposture, où le ciel est pris à témoin !... Quel écœurement !
Tournée vers la chambre de Margot.
Poison, va !
À Lavernié qui fait un geste.
Lâche ! Jamais tu ne m’as aimée, jamais... Aie donc la bravoure d’en convenir, sois sincère une fois dans ta vie !...
Montrant la porte du fond.
Et l’autre, là-bas, le mari !... qui ne dit rien, ne sait rien, ne voit rien, s’en vient dans cette cocufière, comme un pauvre idiot qu’il est, faire l’espiègle et le petit farceur, pendant que sa femme rattache ses jupes de l’autre côté de la cloison !... Que les hommes sont bêtes, mon Dieu !... Donne-moi un verre d’eau, j’ai soif...
Lavernié va à un meuble placé dans un coin de l’atelier, prend une carafe, en verse le contenu dans un verre.
CAMILLE.
Quand je pense que j’ai cru en toi, que je me suis donnée à toi, que j’ai trompé pour toi le meilleur de tous les hommes !
Lavernié lui présente le verre.
Car Dieu sait ce qu’il est avec moi, ce pauvre ami... Et bon !
Elle boit.
et grand !
Elle boit.
et généreux !
Elle boit.
indulgent à mes injustices, patient à mon sale caractère, toujours un bon sourire aux yeux, une bonne parole à la bouche, un petit bouquet de fleurs à la main. Je l’ai trahi, pourtant. Faut-y que tu sois canaille ! Tiens, je m’en vais. Tout cela me dégoûte, bonjour ! Je vous méprise tous les trois, lui autant qu’elle, elle autant que lui, et toi autant que les deux autres.
Camille se lève.
Je ne me plains pas, d’ailleurs ; je n’ai que ce que je mérite. Une honnête femme ne devrait jamais prendre qu’un amant digne de l’apprécier. C’est une leçon dont je paye les frais, mais dont je recueillerai les fruits. Et puis, inutile de m’écrire bureau restant, place Clichy, aux initiales X. Y. Z., numéro 555, je ne répondrais pas à tes lettres. Tu es mort pour moi ! Adieu !
Elle s’est dirigée vers la porte du fond, mais au moment de l’ouvrir, elle se retourne.
Quoi ?
LAVERNIÉ.
Je n’ai rien dit.
Camille attache sur Lavernié un regard chargé de haine, puis sort en refermant la porte avec violence. Lavernié, seul.
Il est évidemment bien dur de ne plus être aimé quand on aime, mais cela n’est pas comparable à l’être encore quand on n’aime plus.
Il soupire longuement. Il prend le verre sur la table, le reporte où il l’avait pris, va à la porte de droite, se dispose à ouvrir, lorsqu’on entend sonner violemment et frapper de coups de pied la porte.
LAVERNIÉ, sursautant.
Qu’est-ce qui se permet ?...
Il va ouvrir. Lauriane paraît.
Scène IV
LAVERNIÉ, LAURIANE, puis MARGOT
LAURIANE, comme un fou.
Margot ! Margot !
LAVERNIÉ.
Quoi ! Margot ?
LAURIANE.
Elle est ici ! Allons, ne mens pas !... Il est inutile de feindre. Je te répète qu’elle est ici !
LAVERNIÉ.
Qui est-ce qui te dit le contraire ?
LAURIANE.
Tu avoues !
LAVERNIÉ.
Permets !...
LAURIANE.
Avoues-tu, oui ou non ?
LAVERNIÉ.
On n’avoue qu’un crime ou qu’un tort.
LAURIANE.
Pas de grands mots ! Tu es son amant ?
LAVERNIÉ.
Il y a beau jour !
LAURIANE.
Canaille !
LAVERNIÉ.
Eh ! là !...
LAURIANE.
Misérable ! Polisson ! Drôle !
LAVERNIÉ, très calme.
S’il y a un drôle ici, c’est toi !
LAURIANE.
Moi ?
LAVERNIÉ.
Oui, toi ! Et puis, un peu de calme, ou nous allons nous fâcher. Qui est-ce qui m’a bâti un fou furieux pareil ?
LAURIANE.
Je te dis...
LAVERNIÉ.
Assez !
LAURIANE.
Mais...
LAVERNIÉ.
C’est bon ! Je ne veux pas de scandale chez moi ! Je tiens à la considération des concierges et du voisinage, et les faiseurs de chiqué feront bien de se tenir sur leurs gardes. Je suis homme à les empoigner par la boucle du pantalon et à les envoyer méditer dans la cage de l’escalier sur l’inconvénient qu’il y a à jouer les épileptiques devant les gens de sens rassis.
Il ferme la porte du fond.
Là-dessus, mon vieux, tu peux entrer et faire comme Cinna, prendre un siège. De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qu’il y a ?
LAURIANE.
Il y a que tu es un faux ami !
LAVERNIÉ.
En voilà la première nouvelle.
LAURIANE.
Il y a que ta conduite à mon égard a été le dernier mot de la traîtrise et de la félonie ! Il y a que tu t’es joué de ma bonne foi, que tu as trompé ma confiance, et que tu as abusé de mon hospitalité.
LAVERNIÉ.
En quoi faisant ?
LAURIANE.
En me dérobant ma maîtresse.
LAVERNIÉ.
Tu me l’avais donnée.
LAURIANE.
Moi ?... Quand ça ?
LAVERNIÉ.
Je précise : le 27 août dernier, rue de Sucy, au Bas-Chennevières, à huit heures quarante-cinq du soir ; – le même jour où je t’avertissais du danger que l’on court à mener les cruches à l’eau, rapport aux éclaboussures.
LAURIANE.
Aucun souvenir.
LAVERNIÉ.
Aucun souvenir ? Trop de cigarettes, Lauriane, ça attaque la mémoire. Alors, non... – Pardon, tout à l’heure... – tu ne me l’avais pas, ta maîtresse, fourrée de force entre les doigts, après avoir, pauvre petite, sacrifié sa dignité de femme et l’intimité d’un passé que tu entachais de gaieté de cœur à l’imbécile plaisir de te donner en spectacle et de jouer au casseur d’assiettes ! Tu ne m’y as pas convié peut-être, à en prendre à mon aise et à faire comme chez moi ?... Et : « J’en ai plein le dos, de Margot ! » et « Je n’ai pas pour habitude de m’éterniser dans le collage ! » et « Crois-tu que j’hésiterais jamais entre un camarade et une femme ?... » Mirages ? Illusions ? Chimères ? Tu ne m’as pas dit un mot de tout cela et c’est moi qui en ai menti ?
LAURIANE.
Si j’ai tenu un pareil langage, c’est que j’ai eu, pour le tenir, des raisons dont j’étais seul juge. Tu aurais dû le comprendre.
LAVERNIÉ.
Je ne l’ai pas compris.
LAURIANE.
Cela ne fait l’éloge ni de ta délicatesse ni de ta perspicacité.
LAVERNIÉ.
Veux-tu ma façon de penser ?
LAURIANE.
Que veux-tu que j’en fasse ?
LAVERNIÉ.
Ton profit. Tu es un grotesque.
LAURIANE.
Plaît-il ?
LAVERNIÉ.
Un grotesque ! Je te le dis entre quat’ z’yeux, afin que tu n’en ignores pas, et c’est bien la moindre des choses, qu’ayant péché par vantardise, tu expies par humiliation. Abrégeons. Où veux-tu en venir ? Si c’est une affaire que tu cherches, je suis à ta disposition.
LAURIANE.
J’avais fait mes preuves avant toi.
LAVERNIÉ.
N’en parlons plus. Alors ?
LAURIANE.
Alors ?... Alors, je suis bien aise de t’avoir dit ton fait. Voilà, mon bon. Quant à Margot, elle me payera cela, je te le déclare.
LAVERNIÉ.
Elle ne te payera rien du tout.
LAURIANE.
Parce que ?
LAVERNIÉ.
Parce que tu viens de dire un mot de trop ; parce que l’amour-propre vexé d’un jocrisse convaincu de sottise est capable des pires lâchetés pour en assouvir ses rancunes, parce qu’enfin, en un mot comme en cent, c’est à moi, tu entends, Lauriane, c’est à moi seul que Marguerite rendra désormais des comptes, s’il me plaît de lui en demander.
LAURIANE.
Ce serait raide.
LAVERNIÉ.
Ce sera ainsi.
LAURIANE.
C’est ce que nous verrons.
LAVERNIÉ.
C’est tout vu !... Et, d’ailleurs, l’incident est clos ! et tu as dit assez de niaiseries pour une fois ! et tu m’agaces, et tu m’assommes, et c’est bien simple, et la question va être tranchée tout de suite.
Il va à la porte de droite qu’il ouvre.
Marguerite, un mot, je te prie.
Entre Margot.
MARGOT, à la vue de Lauriane.
Charles !
LAURIANE.
Malheureuse !
LAVERNIÉ.
Toi, silence !... Margot, voici de quoi il retourne : Monsieur, qui avait eu la chance fabuleuse de placer ses grâces relatives et le peu de jeunesse qui lui reste entre tes mains blanches et propres n’a eu de cesse que tu n’aies échoué entre les miennes.
MARGOT.
Je ne comprends pas.
LAVERNIÉ.
Si j’essayais de te faire comprendre à quels extravagants calculs le besoin de faire le malin et d’étonner la galerie peut amener un imbécile, nous serions encore ici demain.
LAURIANE, à mi-voix.
Goujat !
LAVERNIÉ.
Je suis un bon garçon, de commerce doux et facile. Devant les insistances réitérées de monsieur, j’ai envoyé mes scrupules voir ailleurs si j’y étais et je suis devenu ton amant, pour son plus grand bien, pour le mien, et pour le tien également, je l’espère. Bon ! À cette heure, autre musique. Monsieur, qui veut bien faire des libéralités à quiconque n’en usera pas, et se couvrir de gloire à bon compte, tombe ici comme un mascaret, m’accablant d’injures et de reproches et parlant de carte à payer. Tu m’aimes ?
MARGOT, très gênée.
Mon Dieu...
LAVERNIÉ.
Réponds. Tu m’aimes ?
MARGOT, tout bas.
Oui.
LAVERNIÉ.
Tu en es bien sûre ?
MARGOT, de même.
Bien sûre.
LAVERNIÉ.
Donne ta bouche.
Il la baise aux lèvres.
C’est signé, Margot. De cet instant, tu es ici chez toi et voici ta chambre à coucher. Quitte ton chapeau. Ôte tes gants.
Un temps.
LAURIANE.
Ah ! çà... mais... et moi ?
LAVERNIÉ.
Toi ?
LAURIANE.
Oui, moi ?... Qu’est-ce que je deviens, moi, dans tout ça ? Et de quoi est-ce que j’ai l’air ? « Ôte tes gants ! Voici ta chambre ! C’est signé ! » Tu aurais pu me consulter. J’avais le droit de placer un mot, je pense.
LAVERNIÉ.
Ton rôle est joué. Tu peux te retirer. Bonjour.
LAURIANE.
Je m’en irai quand ça me plaira.
Il quitte son pardessus.
LAVERNIÉ.
À moins que tu ne me mettes hors de moi.
LAURIANE.
Auquel cas ?
LAVERNIÉ.
Auquel cas, moi, je te mettrai hors d’ici.
LAURIANE.
Je me moque de tes menaces comme de toi-même. Je passerai le seuil de cette porte quand j’aurai parlé à madame.
LAVERNIÉ.
Qu’est-ce que tu veux lui dire ?
LAURIANE, avec éclat.
Cela ne te regarde pas. Si nous avons des secrets, je dois te les livrer ? Non, mais tu es extraordinaire ! Veux-tu lire ma correspondance ?
Tirant de sa poche un trousseau de clés.
Tiens, voilà les clefs de chez moi !
LAVERNIÉ, après une courte réflexion.
Garde tes clefs. Je te demande pardon. J’oubliais que tu peux avoir, toi aussi, tes affaires à mettre en ordre et de petits comptes à régler. Règle-les donc en paix, et surtout en silence, si tu désires, comme je le crois, ne pas envenimer l’incident de complications fâcheuses, que je regretterais autant que toi. Au cours des discours qui vont suivre, tu vas avoir à prononcer mon nom et à t’occuper de ma personne ; à cet égard, tu as toute liberté de langage, je te prie même de ne pas te gêner. Tu m’as déjà appelé canaille, drôle, misérable et polisson, tu peux, dans cet ordre d’idées, aller de l’avant aussi longtemps et aussi loin qu’il te plaira : je n’y vois aucun inconvénient. Mais, en ce qui concerne celle-ci, c’est une autre paire de manches. Elle a droit à ma protection et, le cas échéant, à mon aide... Je la recommande à ta courtoisie...
Il fixe Lauriane dans les yeux, puis le doigt en l’air.
Ni menaces, ni gros mots, n’est-ce pas ? Je vous laisse causer. À tout à l’heure ! Tu as un quart d’heure, montre en main.
Il sort.
Scène V
LAURIANE, MARGOT
LAURIANE, à Lavernié sorti.
Toi tu as une certaine chance que j’aie reçu de l’éducation. Si je n’étais pas sous ton toit, j’irais t’apprendre les usages avec une bonne paire de claques ! Y a-t-il des mufles, Seigneur !
À Margot.
Voilà pourtant ce que tu m’attires ! C’est à tes bons offices que je dois d’être traité comme la boue du paillasson par mon plus ancien camarade ! Mes félicitations sincères ! Tu as fait là de belle besogne ! Ah ! mauvaise race ! Allons, lève-toi ! partons ! Je ne resterai pas ici une minute de plus.
Il endosse son pardessus.
Tu es sourde ? Je te dis de te lever. Après ce que je viens d’apprendre, je n’ai plus qu’à affranchir ma vie d’une liaison qui la déshonore, mais il faut que les choses soient faites correctement. Notre logis – le mien, à partir d’aujourd’hui – est plein d’affaires qui t’appartiennent, de petits bibelots, d’objets de toilette ; tu vas venir enlever tout ça. Par la même occasion, nous arrêterons ensemble les conditions d’une séparation que tu as rendue inévitable. Je ne suis pas un cœur sec : je garde le souvenir des bonnes heures vécues en commun. J’entends donc, je ne dirais pas assurer ton existence, du moins parer à tes premiers besoins, dans la mesure de mes moyens, bien entendu. C’est de quoi nous ne pourrons causer que chez nous et entre nous. Viens !
MARGOT.
Non.
LAURIANE.
Tu refuses ? C’est un parti pris ?
Silence et immobilité de Margot.
Soit ! Je ferai les choses jusqu’au bout ! J’ai passé mon existence à être le valet de tes caprices ; une fois de plus une fois de moins, nous ne sommes pas à cela près.
Il pose son chapeau sur un meuble, vient se poster ensuite près de Margot, et la regarde en silence. Brusquement.
Eh bien, parle ! Qu’est-ce que tu attends ?
MARGOT, étonnée.
Que je parle ?
LAURIANE.
Oui.
MARGOT.
Je n’ai rien à te dire.
LAURIANE.
Naturellement ! J’attendais ça ! Comme toutes les femmes prises sur le fait, tu voudrais éviter une explication. Trop commode. Tu ne l’éviteras pas. À moins d’être une fille, et ce n’est pas ton cas, on ne trompe pas un homme sans motifs. Je veux savoir à quel malentendu je dois le coup de couteau qui me frappe aujourd’hui et dont je ne me remettrai jamais... en supposant que j’y survive. Oh ! je ne fais pas de mélodrame. Mais je ne suis plus à l’âge où l’on recommence sa vie, et tu as brisé la mienne. Privé de l’unique rayon qui éclairât ma destinée, désormais seul, sans but, sans famille, sans espoir, je ne vois guère plus qu’une chose à faire : aller réfugier mon chagrin entre les bras de celle qui fait tout oublier.
Un temps, il attend patiemment l’effet de son petit discours ; mais la jeune femme restant muette, il commence à se troubler. Des inquiétudes lui viennent. Il reprend enfin, d’une voix larmoyante qui cherche à apitoyer.
Car enfin, te représentes-tu ce qu’elle va être, mon existence ?... la succession de mornes journées de bureau croulant sinistrement, les unes sur les autres, dans l’éternel recommencé des mêmes besognes imbéciles ?... les dimanches, les affreux dimanches, tués minute par minute, à coups de bâillements et de cigarettes, sur la molesquine défoncée des petits cafés d’habitués ?... et les retours, la journée finie, par la pluie, la neige, la tempête, vers un logement à jamais déserté... une salle à manger vide... une chambre à coucher vide ?...
Il s’émeut, les larmes le gagnent. Silence et immobilité de Margot. Nouveau silence. Il soupire longuement, puis poursuit.
Alors, non ? Tu ne veux pas venir ? C’est une idée bien arrêtée ?... Tu sais cependant où je vais si tu me laisses passer seul cette porte ?
Mutisme de Margot.
Je la passe ?...
Même jeu.
Je la franchis ?
Même jeu.
C’est bien !
Il va à la porte du fond, s’arrête net et, quittant son pardessus qu’il pose au fond.
Et puis non, toutes réflexions faites, je n’attenterai pas à mes jours. Ce n’est pas que je tienne à ma peau – je la vendrais cinq sous si je trouvais un acheteur – mais le même coup qui guérirait mon mal mettrait à jamais dans ta vie un remords qui l’empoisonnerait : cette considération me dicte ma conduite. Le nouveau gage de tendresse que je te donne ainsi aujourd’hui ne te trouvera pas insensible, je l’espère, surtout venant après tant d’autres dont je te laisse le soin d’évoquer le souvenir... J’ai cru pouvoir me permettre cette petite observation avant de prendre de toi le suprême congé auquel il faut bien que je me résigne (après avoir espéré vainement une parole qui le retienne :) puisque je vois que tu me l’imposes...
Mutisme de Margot.
J’ajouterai, non sans amertume, que je croyais occuper plus de place dans ton cœur.
Il gagne le fond du théâtre, met la main au bouton de la porte et, tout à coup.
Voyons, nous n’allons pas nous quitter en ennemis ; ce serait bête et monstrueux. Nous avons eu des torts mutuels : c’est l’histoire de tous les ménages. Peu importe auquel de nous deux en revient la part la plus grosse. Que ce soit à toi, c’est probable ; mais je veux laisser ce point dans l’ombre. Un fait est : la fonction du sage est de prêcher la raison au fou, comme la mission du plus vieux est d’aller au devant du plus jeune. Eh bien, je vais au devant de toi... Je vois ta jeunesse menacée, j’ai le devoir de t’ouvrir les yeux. Réfléchis à ce que tu vas faire : prends bien garde à l’irréparable !... Écoute ; rien n’est perdu encore ; mon âme n’est pas fermée à toute pitié et peut-être le pardon que je sens germer dans mon cœur monterait-il vite à mes lèvres si un bon mouvement de ta part... une parole de regret... un petit quelque chose, enfin.
Silence de Margot.
Je ne suis pourtant pas exigeant. Dis un mot !...
Silence.
Non ?...
Silence.
Veux-tu que je te pardonne pour rien ?... Non ?...
Silence.
Adieu donc et cette fois pour toujours. Je m’en vais la conscience tranquille. J’ai tout fait ! Advienne que pourra.
Il prend son chapeau et son pardessus et il sort. Marguerite a un regard à la porte qui se rouvre presque aussitôt. Lauriane rentre et, revenu une fois encore à la jeune femme.
Et si je t’épousais, Marguerite ?
MARGOT, stupéfaite.
Moi ?
LAURIANE.
Pourquoi pas ?
MARGOT.
Tu es fou !
LAURIANE.
Fou ?... À cause ? Ce qui est fou, c’est d’avoir tant tardé à faire une chose raisonnable. Vois-tu, j’ai un défaut ; je n’en ai qu’un, mais je l’ai bien : je ne suis pas un expansif ; j’ai horreur des démonstrations. Tout notre malheur vient de là. Pareil à beaucoup d’hommes – car c’est nous les grisettes, les romances et les petites fleurs bleues ! – j’ai la pudeur d’une sentimentalité que tu ne m’as jamais soupçonnée et que je dissimule comme une tare ! Eh bien, il est temps que tu me connaisses, je suis las de t’être étranger !
Tombant à ses pieds.
Marguerite, tu m’es plus chère que tout ! Marguerite, je n’ai que toi au monde ! Marguerite, si tu m’abandonnes, c’est le sol qui s’ouvre sous mes pieds ! Je te supplie d’être ma femme !
MARGOT, avec un accent de douloureuse et profonde lassitude.
Relève-toi et finissons-en. Toutes ces paroles m’étourdissent.
LAURIANE, se levant.
Ce sont des paroles sincères.
MARGOT.
Il est possible qu’elles le soient, possible qu’elles ne le soient pas, je n’en sais rien, toi non plus peut-être, et au fond, qu’est-ce que cela peut faire ? puisque fatalement, inévitablement, elles auront raison de ma faiblesse. Oh ! sur ce point, je n’ai aucun doute à avoir, aucune illusion à garder ; je ne tenterai même pas d’une lutte où je suis d’avance vaincue. Il y a des gens qui naissent vaincus, j’ai le malheur d’être de ceux-là ; je n’ai qu’à en prendre mon parti. Tu veux m’épouser ? Épouse-moi. Cela me laisse indifférente et ce n’est pas, sois-en convaincu, la perspective du mariage qui me ramène entre tes mains dont je me croyais libérée. J’y reviens, parce qu’une puissance plus forte que toutes mes forces me donne l’ordre d’y revenir, parce que la nature m’a refusé le pouvoir de répondre : « Je ne veux pas » à quiconque me dit : « Je veux », et parce que ma Résolution est pareille à ces pierres de grès qui s’émiettent sous le doigt et deviennent du sable. J’avais mon petit bien que je croyais à moi, bien conquis et bien acquis. Tu le veux ? Le voici, je te le donne. Comme avant cinq minutes tu me l’aurais repris, j’aime mieux t’en faire cadeau tout de suite et qu’il n’en soit plus question. Vois-tu, il n’y a pas à se débattre ; quand on ne peut pas on ne peut pas.
Elle se lève.
Et maintenant, allons-nous en, car mon dernier écheveau de courage est à bout, et j’ai bien mal à la tête.
LAURIANE.
Marguerite !
Scène VI
LAVERNIÉ, LAURIANE, MARGOT
LAVERNIÉ, entrant.
Le quart d’heure est écoulé. Rien ne te retient plus. Je te présente mes devoirs.
LAURIANE.
Et moi, je te présente ma femme !
LAVERNIÉ.
Comment, ta femme ?
LAURIANE.
Nous nous marions.
LAVERNIÉ.
Tu dis ?
LAURIANE.
Nous nous marions.
LAVERNIÉ, abasourdi.
Non ?
LAURIANE.
Pourquoi non ?
LAVERNIÉ, à Margot.
Margot ?
LAURIANE, sec.
Je n’ai pas l’habitude de raconter des blagues. Tu n’as que faire de l’interroger.
LAVERNIÉ.
C’est que...
LAURIANE.
Que quoi ? Et puis tu m’obligeras, quand tu t’adresseras à Marguerite, de ne plus la tutoyer et de l’appeler désormais « Madame ». C’est un rien que pourtant je crois devoir signaler, pour le cas où il t’échapperait, à ton sens un peu... spécial, de la correction et des convenances.
À part.
Toc !
LAVERNIÉ.
Très bien, très bien, ne te fâche pas.
Soufflant longuement.
Ah !...
LAURIANE.
Tu te trouves mal ?
LAVERNIÉ.
Mal n’est pas le mot ! Je me trouve, je me trouve... Je ne trouve pas comment je me trouve. C’est égal pour une surprise, voilà ce qui s’appelle une surprise. Ah !... Ah !... Ah !...
LAURIANE.
Ça ne va pas mieux ?
LAVERNIÉ.
Ça va passer, ne t’inquiète pas.
Il s’avance vers Margot et va pour lui parler, mais elle ne lui en laisse pas le temps.
MARGOT.
Ne me dites rien, je vous en prie ; je n’aurais rien à vous répondre. Je ne sais pas !... je ne sais jamais... Et puis, je sens si bien que ça ne tiendrait pas !
LAVERNIÉ.
Qu’est-ce qui ne tiendrait pas ?
MARGOT.
Nous sommes trop loin l’un de l’autre !... Un homme comme vous, mon Dieu ! et une pauvre malheureuse de rien du tout, comme moi... un trottin ! une midinette ! Est-ce que c’est possible, voyons ? Dans six mois je serais le boulet, dans un an je serais l’ennemie... Je ne veux pas.
LAVERNIÉ, se récriant.
Mais pas du tout ! Mais ce n’est pas vrai ! Mais quelle idée !
MARGOT.
J’ai raison, je vous jure que j’ai raison ; j’ai là quelque chose qui me le dit. Rentrons chez nous, retournons à nos petites affaires. Comme ça, chacun gardera de l’autre un bon et gentil souvenir, et plus tard, quand je serai une vieille bonne femme qui regardera dans sa jeunesse, j’aurai le contentement de me dire : « S’il a été bon pour moi, je n’ai pas été méchante pour lui, et si je l’ai un peu ennuyé, ça n’a pas duré bien longtemps. »
LAVERNIÉ, très ému.
Marguerite...
MARGOT.
Ça vaut mieux, je vous assure : ça vaut bien mieux, bien mieux, bien mieux.
D’un geste vague, elle complète sa pensée. Elle veut sourire, mais les larmes la gagnent, elle essuie ses yeux et se tait. Lavernié, très ému, fait un grand effort sur lui-même, il tousse légèrement, passe la main sur son front. À la fin, il s’incline gravement, en homme qui accepte une sentence, et, revenu à Lauriane.
LAVERNIÉ, d’une voix qu’il tâche de rendre enjouée.
Et à quand la noce ?
LAURIANE.
Tu le sauras. On t’enverra un faire-part.
LAVERNIÉ.
J’y compte. En attendant, je te fais mes compliments.
LAURIANE.
Tu es bien aimable, je les accepte.
LAVERNIÉ, à Margot.
Pour vous, ma chère enfant, je vous demande la permission de vous embrasser sur les deux joues, avec la plus profonde tendresse, en vieil ami, et en ami vieux que je suis. Lauriane, comme chacun en ce bas monde, peut avoir des petits travers, mais c’est un parfait honnête homme : il vous fait en vous épousant un honneur dont vous êtes digne. J’en suis infiniment heureux. Je vous souhaite tous les bonheurs.
MARGOT, que les larmes étouffent.
Je vous remercie.
LAURIANE.
Eh bien, nous filons !
À Margot.
Tu y es ?
LAVERNIÉ, tendant la main à Lauriane.
À bientôt, hein ?
LAURIANE, feignant de ne pas voir.
À un de ces jours.
Laissant passer Margot.
Passe, mon chat.
Elle franchit le seuil de la porte. Lauriane la suit. À ce moment.
LAVERNIÉ.
Lauriane !
LAURIANE, se retournant.
Eh ?
LAVERNIÉ.
Donne-moi la main.
LAURIANE.
Si tu veux.
LAVERNIÉ.
Mieux que cela !... Allons !... Tu peux me la donner, je t’assure ; tu peux me la donner tout à fait. Lauriane, j’ai deux mots à te dire. Assez à la légère, sans voir où nous allions, nous nous sommes, cette enfant et moi, un peu diverti à tes frais et t’avons régalé d’une mystification dont je crains que ton honnête bonne foi se soit émue plus que de raison. La comédie que nous t’avons jouée – un peu trop bien, même, peut-être – c’est moi qui en ai conçu le plan, dans le double but d’infliger à ton mauvais caractère une salutaire leçon et de venger, en la faisant rire, la gentillesse méconnue de celle qui va être ta femme. Mais les meilleures plaisanteries sont celles qui se prolongent le moins : celle-ci a duré plus qu’assez. Tu me vois extrêmement troublé et malheureux. J’ai tué comme un imbécile, en voulant faire l’homme d’esprit, la tranquillité de mon ami : rien ne m’en consolera ; je te prie de me pardonner. Je sais qu’une parole dite est dite à tout jamais ; je n’espère donc pas effacer de ta mémoire les mensonges à dormir debout dont j’ai si bêtement berné ta crédulité confiante. Mais avant que tu quittes cette maison, tu me permettras bien, n’est-ce pas, pour le soulagement de ma conscience, ma main sur ton épaule et mes yeux dans tes yeux, de te jurer sur tout ce que je peux concevoir au monde de plus sacré et de plus cher, sur mon honneur, sur Dieu, sur tout, que jamais, tu m’entends ? jamais !... pas une fois, pas une minute, je n’ai été l’amant de Marguerite.
Un temps. Lauriane, rassuré, convaincu, le regarde dans l’œil avec une fixité goguenarde, puis haussant les épaules.
LAURIANE.
Je le sais bien.
Il sort.
Scène VII
LAVERNIÉ
Demeuré seul, il reste un instant les yeux attachés à la porte par où Marguerite vient de disparaître ; puis il redescend en scène, hésitant, comme inquiet, en homme qui ne sait pas ce qu’il va faire. Une fenêtre est là. Il s’y rend, en soulève discrètement le rideau, plonge dans la rue avec la précaution bien observée de n’être pas vu du dehors. Un long temps. Soudain, redescendu en scène, il aperçoit, oubliée sur une table, la voilette de Margot. Il s’en empare, la déploie, la regarde, en respire le parfum léger, après quoi la remettant dans ses plis avec soin et allant prendre sur un meuble un coffret fermé qu’il ouvre, il l’y dépose ainsi qu’en un petit cercueil. Tout cela est fait lentement, avec une émotion contenue. Enfin, il referme à clé le coffret qu’il remet en place, revient à son chevalet, reprend sa palette et ses brosses.
LAVERNIÉ, avec mélancolie.
Elle a raison. Cela vaut mieux.
Il se remet au travail.