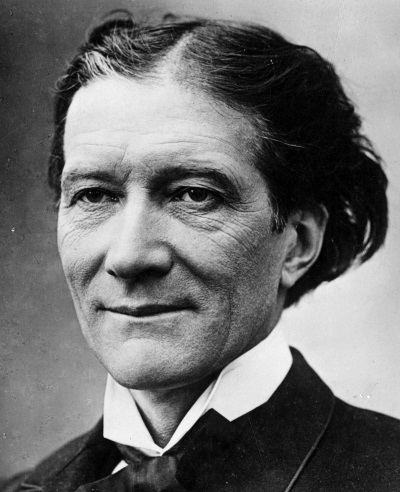Madame Sans-Gêne (Victorien SARDOU - Émile MOREAU)
- PROLOGUE
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- ACTE I
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- Scène XI
- Scène XII
- Scène XIII
- Scène XIV
- Scène XV
- ACTE II
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- ACTE III
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- Scène XI
- Scène XII
- Scène XIII
- Scène XIV
- Scène XV
- Scène XVI
Comédie en trois actes, précédée d’un prologue.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du Vaudeville, le 27 octobre 1893.
Personnages
NAPOLÉON
MARÉCHAL LEFEBVRE
FOUCHÉ
DE NEIPPERG
DESPRÉAUX
SAVARY
SAINT-MARSAN
VABONTRAIN
CANOUVILLE
DUROC
DE LAURISTON
JASMIN
LEROY
COP
CORSO
FONTANES
CONSTANT
ROUSTAN
CATHERINE
LA REINE CAROLINE
LA PRINCESSE ÉLISA
MADAME DE BULOW
MADAME DE VINTIMILLE
MADAME DE ROVIGO
MADAME DE CANISY
MADAME DE TALHOUËT
MADAME DE BASSAMO
MADAME DE MORTEMART
MADAME DE BRIGNOLLES
MADAME DE BELLUNE
MADAME D’ALDOBRANDINI
TOINON
JULIE
LA ROUSOTTE
UNE VOISINE
FEMME DE CHAMBRE
VINAIGRE
JUNOT
MORTEMART
RISSOUT
ARNAULT
DE BRIGODE
RAYNOUARD
JOLICŒUR
UN VOISIN
UN APOTHICAIRE
UN COIFFEUR
UN VALET
PROLOGUE
Paris le 10 août 1792.
Une boutique de blanchisseuse, rue Sainte-Anne, claire et gaie. Au fond, une porte vitrée, entre deux grands châssis de vitrage avec appui, au delà desquels la rue Sainte-Anne ; à droite, premier plan, un petit renfoncement, dans lequel est prise la cage de l’escalier de bois qui grimpe à l’étage supérieur. Là, sur la rampe ou sur des cordes, linge étendu pour sécher, les jupons a raies tricolores voisinant avec les dentelles d’aristocrates. En bas, un baquet sur trépied ; au premier plan, une porte ouvrant sur la cour. Entre cette porte et l’escalier, un buffet. À gauche, premier plan, porte de la chambre de Catherine ; deuxième plan, cheminée à manteau, avec fourneau de terre pour le chauffage des fers. Tables et planches à repasser, posées sur étriers pour le repassage ; escabeaux de bois, écuelles. Un grand fauteuil, à droite de la table. Aux murs, assiettes à fleurs, images populaires ; portrait d’une vieille.
Scène première
TOINON, JULIE et LA ROUSSOTTE, apprenties de Catherine, repassent, sans entrain. Dans la rue, les VOISINS et VOISINES, BOURGEOIS, BOUTIQUIERS, GARDES NATIONAUX, montés sur les bornes et les marches, regardent du côté des Tuileries, vers la droite
Va et vient continuel, murmure de voix, exclamations... Au loin, à travers les coups de fusil et la canonnade, des tambours battent, de temps en temps, le rappel et la générale. Un coup de canon plus proche fait tressaillir tout le monde et provoque des cris.
TOINON.
Hein ! Entendez-vous ? C’est vers la rue d’ l’Échelle, a c’t’ heure !
JULIE.
Oh ! que j’ai peur ! Oh ! que j’ai donc peur !
LA ROUSOTTE.
Pourvu qu’ils ne viennent pas se battre de notre côté !
JULIE, tombée à genoux et cramponnée à la table.
Oh ! là là ! Oh ! sainte Vierge !
TOINON.
Rue Sainte-Anne ? Pourquoi faire ? Ils n’en veulent qu’aux Tuileries, pour fiche le roi à la porte !
UN VOISIN, sur le seuil.
Sûrement !
UNE VOISINE, au milieu de la rue.
C’est au Carrousel, que j’ vous dis !
Nouveau coup de canon.
LA ROUSOTTE.
Ils vont faire péter nos vitres !
JULIE.
Ah ! je m’en rappellerai, du dix août !
Les curieux s’empressent dans la direction des Tuileries, avec des rumeurs de compassion.
TOINON, allant à la fenêtre.
Ah ! v’là un blessé qu’on ramène chez lui !
LA ROUSOTTE, sur le seuil.
Un garde national !
À Julie.
Viens donc voir !
JULIE.
Plus souvent ! J’ défaille pas assez comme ça ?... Et not’ pauv’ patronne qu’est de c’ côté-là !
LE VOISIN, venu dans la boutique.
Vous pouviez donc pas l’en empêcher ?
TOINON.
Avec ça qu’elle en fait autrement qu’à sa tête !
LA ROUSOTTE.
Et qu’elle craint le danger !
TOINON.
Tout le quartier l’appelle madame Sans-Gêne ; on pourrait aussi bien l’appeler madame Sans-Peur !
LA ROUSOTTE, du seuil.
Ah ! J’allons avoir des nouvelles !... V’là notre pratique d’à côté ! Le Nantais.
TOINON.
M. Fouché ?
LA ROUSOTTE.
Un enragé cont’ le roi et l’Autrichienne, celui-là !
Appelant de la porte.
Eh ! m’sieu Fouché ! m’sieu Fouché !
MATHURIN, de la rue.
M’sieu Fouché !
TOINON, de la fenêtre.
Ah ! t’as pas besoin d’crier tant que ça ! Il trotte à se décrocher les mollets !
LA ROUSOTTE.
Le v’là !
Scène II
FOUCHÉ accourt par la droite, une valise et un parapluie à la main, et descend en scène, entouré des blanchisseuses et d’une partie des gens du dehors ; tous parlent à la fois
TOUS.
Eh bien ?
TOINON.
Eh bien, M’sieu Fouché ?
LA ROUSOTTE.
Vous en v’nez ?
FOUCHÉ, essoufflé.
Oui, oui, j’en viens !
TOUS et TOUTES.
Qué qu’y s’ passe ? Qué qu’il y a ? Queux nouvelles ?
FOUCHÉ.
Oh ! mauvaises !
TOUS.
Oh !
FOUCHÉ.
Détestables ! pour moi... pour vous, veux-je dire... Le tyran l’emporte !
À Toinon.
Donnez-moi vite mon linge, blanchi ou non, que je le fourre dans mon sac !...
LA ROUSOTTE.
Vous vous sauvez ?
FOUCHÉ.
Fi donc ! Je pars vivement, voilà tout !
JULIE, qui lui apporte son linge.
Pour Nantes ?
FOUCHÉ.
D’abord...
TOINON.
Mais, alors, c’est effrayant ! Quoi qu’y a ?
TOUS.
Oui ! Quoi qu’y a ?
FOUCHÉ.
Il y a que, ce matin, à la première attaque, tout allait bien pour nous. Et, tout à l’heure encore, le Carrousel était aux patriotes.
UN VOISIN.
Vous étiez avec eux ?
FOUCHÉ.
De cœur ! Oh ! certes ! En réalité, rue Saint-Honoré, aux écoutes. Tout à coup, ces gredins de Suisses ont fait une telle décharge par les fenêtres du Palais que les assaillants, abandonnant leurs canons...
TOUS.
Oh !
FOUCHÉ.
Se sont repliés !
À la Roussotte, qui lui donne un mouchoir.
Ce n’est pas à moi, ça... Se sont repliés, à la débandade, sur toutes les rues, et, naturellement, j’ai fait comme eux !
À la Roussotte.
C’est tout ?
Pendant que les assistants remontent, commentant la nouvelle et la colportant dans la rue.
La patronne n’est pas là ?
JULIE.
Eh non !... Elle est là-bas !
FOUCHÉ.
Là-bas ?
TOINON.
Oui ; on est venu lui dire, à c’ matin, qu’ des pratiques à nous, les Roquefeuille, faisaient leurs malles pour s’en sauver.
FOUCHÉ.
Les lâches !... Et alors ?
TOINON.
Alors, mam’selle, à qui plus d’un ci-devant a déjà fait le tour d’ décaniller sans payer son du, s’est dit : « Oh ! mais non ! pas de ça, Lisette ! J’ vas leur z’y porter leur linge et m’ faire régler mon compte ! »
FOUCHÉ, reprenant son parapluie.
Et ces Roquefeuille demeurent ?
JULIE.
Rue Saint-Nicaise !
FOUCHÉ.
En pleine bataille.
LA ROUSOTTE, de la porte.
Et elle ne revient pas !
JULIE.
On va p’t’ être nous la ramener sur un brancard !
Deux coups de canon. Exclamations. Un tambour bat la charge.
TOINON.
V’là qu’ça repart !
FOUCHÉ, prêt à sortir, s’arrête.
J’aime mieux ça !
CRIS, dehors.
Sans-Gêne ! Sans-Gêne ! V’là Sans-Gêne !
Toinon s’élance.
TOINON et LA ROUSOTTE.
La v’là ! la v’là !
JULIE.
La patronne ?
TOINON et LA ROUSOTTE.
Oui, oui, la v’là ! la v’là !
Scène III
TOINON, JULIE, LA ROUSSOTTE, FOUCHÉ, VOISINS, VOISINES, CATHERINE entre, vivement, suivie, entourée de curieux
Elle a un panier de linge sous le bras, son bonnet de travers et chiffonné.
TOINON.
Oh ! patronne !
JULIE, qui lui tend une chaise.
Qué bonheur !
LA ROUSOTTE.
J’étions inquiètes !
CATHERINE, en s’asseyant.
Ah ! mes petites chattes ! Ouf ! J’en peux plus !... Que je souffle donc un peu ! Oh ! là là ! Quel bastringue !
UN VOISIN.
Vous en venez ?
CATHERINE.
Si j’en viens !
UN AUTRE.
Et ça chauffe ?
CATHERINE.
Si ça chauffe !
TOINON.
Et quoi que vous avez vu ?
CATHERINE.
J’ai rien vu.
FOUCHÉ.
Qu’est-ce qui se passe ?
CATHERINE.
J’en sais rien.
TOUS.
Oh ?
CATHERINE.
J’ai pas eu le temps !... J’dévalais la rue Saint-Nicaise, à travers un tas de patriotes, qui me criaient : « Hé ! pas par là, la petite mère ! Gare aux prunes !... » Mais va t’promener ! j’étais lancée... V’là qu’au détour de la rue de Chartres, j’ tombe su’ une bande de Marseillais, qui s’ partageaient des cartouches. Et un grand barbu, bras nus, tout velu, dès qu’y me voit : « Ténez ! Ténez ! cette bougresse, qui va se faire crever la tomate !... Où tu vas ? – Où qu’j’ veux ! – Tu badines ? » Là-dessus, il me cueille du sol, me barbouille d’un baiser su’ l’ cou, et me passe à un autre, qui me r’colle à un suivant, et comme ça jusqu’au dernier, me raclant tous le cou d’ leux museaux ! Ah ! les gredins !... J’ai détalé sans demander mon reste, mais j’aurais eu pus d’agrément à traverser le Carrousel sous les coups d’ feu, qu’à recevoir, à bout portant, c’ te fusillade de baisers, qui tous, tous, empoisonnaient l’ail !
TOINON.
Enfin ! vous v’là !
JULIE.
Et, sauf qu’ vous êtes un peu chiffonnée...
CATHERINE.
L’ bonnet, pas vrai !
LES APPRENTIES.
Oh ! oui !
Catherine va se rajuster devant le miroir, suivie de Julie, à qui elle donne son mantelet.
FOUCHÉ, de son coin.
Et avec ça, nous ne savons rien.
UN VOISIN, dans la rue, où s’est formé un groupe.
Si ! si ! ça marche !...
Fouché remonte à lui.
Lochard, qui arrive du Carrousel, dit que le peuple est revenu à la charge.
FOUCHÉ, qui se frotte les mains.
Bon, cela !
LE VOISIN.
On attaque dans les trois cours !
UNE VOISINE.
Le roi s’est ensauvé au Manège, avec l’’Autrichienne !
AUTRE VOISIN.
Et les Suisses tirent mollement, faute de munitions !
FOUCHÉ, ravi.
À la bonne heure !
CATHERINE.
Pourvu qu’ mon Lefebvre n’ soit pas fourré là-dedans, lui qu’a déjà pris la Bastille, et qu’est toujours où qu’on s’ cogne !
Le canon recommence à gronder : des tambours, plus proches, battent la charge.
UN VOISIN.
V’là les nationaux qui courent au feu avec du canon. Vive la nation !
Tous, sauf les apprenties et Fouché, s’élancent dans la rue, pour voir et crier.
CATHERINE.
Tout ça, c’est bon !... Mais c’est pas une raison, parce qu’ils font leu’ lessive là-bas, pour qu’ nous fassions pas la notre, Allons !
À Toinon et Julie.
Oust ! Allez m’étendre un peu tout ça dans la cour, vous deux !
TOINON et JULIE.
Oui, mam’zelle !
CATHERINE,
à la Roussotte, en lui donnant le baquet qui est sur la chaise.
Et toi, cours porter c’ linge-là à c’t officier qui loge rue des Moulins. Il n’en a pas de trop !...
À mi-voix.
N’ lui donne pas sa note. Y n’a pas d’ quoi la payer !
LA ROUSOTTE.
Oui, mam’zelle.
Toinon et Julie sortent par la droite. La Roussotte, par le fond.
CATHERINE, venue à la fenêtre, appelle un gamin monté sur une marche.
Hé, Mathurin ?
MATHURIN.
Mam’zelle ?
CATHERINE.
Veux-tu être mignon ? J’ te payerai du pain d’épices... Cours au poste d’la rue Colbert, d’mander si l’ sergent Lefebvre est là !
MATHURIN.
Oui Mam’zelle !
CATHERINE.
Attends donc ! Si y est, qu’y vienne ! Si y est pas, qu’on t’ dise ousqu’il est.
MATHURIN y court.
Oui, mam’zelle !
CATHERINE, criant, de la porte.
L’ sergent Lefebvre... instructeur !
MATHURIN, déjà loin.
Oui, mam’zelle !
CATHERINE repousse les battants de la porte, puis les volets de la fenêtre de gauche.
J’ ferme ça !... Avec tout c’ monde, on n’est pas chez soi.
Elle retrousse ses manches pour travailler.
Scène IV
CATHERINE, FOUCHÉ
Le vacarme s’éteint un peu dans la rue, on l’on voit néanmoins aller et venir à travers le vitrage. Le bruit du combat, très lointain, continue par bouffées.
FOUCHÉ, un peu railleur.
Décidément, belle Catherine, vous en tenez pour le ci-devant garde française ?
CATHERINE.
Tiens ! vous v’là, vous ?
Elle va prendre, sur le poêle, la terrine à l’amidon.
C’est donc défendu d’ s’aimer ?
FOUCHÉ.
Au contraire !
CATHERINE.
Et il n’est peut-être pas beau, et bon, et brave, mon Lefebvre ?
FOUCHÉ.
Si ! si ! Et puis, un pays, n’est-ce pas ?
CATHERINE, qui se met à empeser, va et vient, au fourneau et à la table, tout, à sa besogne ; Fouché, assis à droite, la regarde.
D’Alsace, comme moi, né natif de Ruffach, qu’est à cinq lieues d’ Saint-Amarin, mon endroit ! Quoiqu’ ça, y a pas pus d’ six semaines, j’ nous étions jamais vus.
FOUCHÉ.
Ah ! bah ?
CATHERINE.
Comme j’ vous dis !... Il ’tait dans la milice, puis dans les gardes françaises. Moi, en service, puis apprentie, chez Mme Lobligeois
Dont elle montre le portrait.
qu’est tombée d’une attaque, la pauv’ femme, qu’elle m’a laissé, en mourant, c’te boutique, avec toutes se frusques, et que j’ m’ai trouvée patronne comme ça, tout d’go ! V’là donc, qu’un beau dimanche d’ l’aut’ mois, j’ dis à mes jeunesses : « C’est pas tout ça, mes petites chattes, faut que j’ vous régale d’ la danse au bal du Waussall. »
FOUCHÉ, rectifiant.
Du Vauxhall !
CATHERINE.
Sall... xall !... J’ m’en fiche ! Su’ l’ boulevard du Temple, quoi ?
FOUCHÉ.
Oui.
CATHERINE.
Eh bien, alors !... J’étions pas pus tôt dans c’ bal, qu’un mauvais gas s’ campe d’vant moi, l’ chapeau su’ la trogne, et qu’était laid, non mais qu’était laid !... Un vrai singe, quoi ! l’orang dégoûtant ! « – Voulez-vous t’y danser avec moi, une fricassée ? qu’y m’ dit. – Non ! qu’ j’y dis. – Pourquoi ça ? qu’y m’ dit. – Parce que ça m’ plait pas donc ! qu’ j’y dis ! – Oh ! qu’y dit, dit-y, voyez-vous c’te chipie, qui n’ veut pas danser la fricassée avec moi ! c’te mijaurée ! c’te pécore ! c’te bégueule ! » Il n’avait pas dit « gueule », qu’y tombait sur la sienne une giboulée ! Oh ! là là ! qu’y s’en répandait tout du long su’ l’ sol !... C’était mon Lefebvre qui y collait ça, en l’y criant : « La v’là, ta fricassée ! » Là-dessus, y m’ fait son invitation, en militaire qui a d’ l’inducation et l’usage du sesque ! et vous pensez si j’ai pris plaisir à s’couer le cotillon avec lui !... Et v’là comment qu’ nous nous sommes connus dans l’ monde.
FOUCHÉ, taquin.
Et pourquoi on le voit dans la boutique, soir et matin ?
CATHERINE.
C’te malice ! Il s’ cache pas d’ me faire la cour.
FOUCHÉ.
Oui, mais c’est qu’on jase dans l’ quartier.
CATHERINE.
Ah ben, c’est ça dont j’ me gausse ! J’ suis une honnête fille, Lefebvre le sait ben ! L’ jour où j’y ai dit : « j’ t’aime ! » c’était ben un mot tout neuf et qu’avait jamais servi ! Ça suffit, et tous les cancans, j’ m’asseois dessus !
FOUCHÉ.
Alors, à quand la noce ?
CATHERINE.
L’ plus tôt qu’y se pourra, à moins qu’y n’ brouille tout.
FOUCHÉ.
Comment ça ?
CATHERINE.
Ah ! c’est qu’il est jaloux ! Oh ! mais jaloux ! qu’ ça m’ fait peur ! Y a des moments qu’il est comme un enragé, avec ses idées su’ tout l’ monde... Y a pas trois jours qu’ j’ons failli rompre !...
Souriant.
à cause d’ vous !
FOUCHÉ, flatté.
De moi aussi ?
CATHERINE.
Oui, avec vot’ face d’ carême !
Éclatant de rire.
Si faut pas qu’y soie fou ! Au fait, s’il venait ç c’t’ heure, et qu’y vous trouve encore là !... Quoi qu’vous fichez là ?
FOUCHÉ.
J’attends !
CATHERINE.
Et quoi ?
FOUCHÉ, tranquillement, sur les coups de canon.
Qu’on ait pris les Tuileries.
CATHERINE.
Vous feriez pas mieux d’ les prendre avec les autres ?
FOUCHÉ.
À quoi bon, puisqu’ils s’en chargent !...
CATHERINE, en poussant son fer.
V’là un homme qu’est tout le temps au Palais-Royal, à brailler avec les autres : « Vive la liberté ! À bas le tyran ! En avant les patriotes ! » Et quand les patriotes vont s’ faire crever la peau, il reste là, l’ derrière sur sa chaise !... Vous n’avez donc pas d’ sang dans les veines ?
FOUCHÉ.
Je n’en ai pas plus qu’il ne faut, et je ne vois pas la nécessité d’en risquer une seule goutte.
CATHERINE.
Capon !
FOUCHÉ.
À chacun son rôle, ma belle amie. Il y a ceux qui font les révolutions...
CATHERINE.
Et ceux qu’en profitent !
FOUCHÉ.
Les combattants et les organisateurs. Moi, je suis plutôt organisateur.
CATHERINE.
J’ m’en doute ! C’est-y vrai que vous avez été quasiment prêtre ?
FOUCHÉ.
Oratorien, à Nantes... Mais, dès 89, j’ai changé de métier.
CATHERINE.
Et à c’t’ heure, quoi qu’ vous êtes ?
FOUCHÉ.
Révolutionnaire !
CATHERINE.
Ça vous donne d’quoi vivre ?
FOUCHÉ.
Pas encore, mais...
Attestant la canonnade.
Ça va venir.
CATHERINE, railleuse.
Oui, c’est pour vous, pas vrai, qu’on fiche le gouvernement à bas ?
FOUCHÉ.
Mais c’est un peu pour moi, oui !
CATHERINE.
Et quoi qu’on va mettre à la place ?
FOUCHÉ.
Ah ! ce qu’on voudra ! Quoi que ce soit, je suis bien décidé à en être.
CATHERINE, narquoise.
On vous fera peut-être ministre, pour voir ?
FOUCHÉ.
Oh ! mon Dieu ! Pourquoi pas ?
CATHERINE, dans un rire.
Pas d’ la guerre, toujours ?
FOUCHÉ.
Non !
CATHERINE, en secouant la pince à tuyauter.
Plutôt lieutenant de police, pas vrai !
FOUCHÉ.
Plutôt !
CATHERINE.
Oui, j’ vous vois assez, avec vot’ museau d’ fouine, farfouiller dans l’ linge sale de tout l’ monde.
FOUCHÉ, gai.
Alors, va pour la police !
CATHERINE.
Mais c’est qu’y s’y croit tout d’ bon ! Farceur va ! Vous s’rez ministre, quand j’ s’rai duchesse !
FOUCHÉ.
Je ne vous vois pas bien dans ce rôle-là !
CATHERINE, gaie.
Ni moi !
FOUCHÉ.
Qui, d’ailleurs, va être supprimé, tandis que des ministres, il y en aura toujours.
CATHERINE.
Et quand vous l’ serez, au moins, vous m’ payerez ma note ?
FOUCHÉ.
Fi donc ! ma chère, déjà solliciteuse ?
CATHERINE.
C’est qu’ v’là ben trois mois qu’ j’ vous blanchis pour rien !
FOUCHÉ.
Et ma reconnaissance ?
CATHERINE.
La belle fichaise !
FOUCHÉ.
Et pourquoi, belle Catherine, tant de rigueur pour moi et de complaisance pour un autre ?
CATHERINE.
Qui ça, l’aut’ ?
FOUCHÉ.
Ce jeune officier d’artillerie, qui loge rue des Moulins.
CATHERINE.
Ah ! oui, l’ pauvret !
FOUCHÉ.
Et à qui vous faites reporter son linge par la Roussotte, en lui recommandant, tout bas, de ne pas porter la note !
CATHERINE.
Mazette ! vous avez l’oreille fine, vous. Eh bien, oui, j’ lui fais crédit, à c’ garçon, et tant qu’y voudra encore.
FOUCHÉ, qui vient s’assoir en face de Catherine.
Et pourquoi pas à moi ?
CATHERINE.
Pa’ce que vous êtes un propre à rien, et qu’ lui, c’est un soldat, un défenseur de la patrie !
FOUCHÉ.
Oui, joli, le héros, parlons-en ! Il s’est fait supprimer son grade pour avoir manqué une revue de rigueur. Et il n’est ici que pour tâcher de le ravoir !
CATHERINE.
Vous savez ça ?
FOUCHÉ.
Parfaitement !
CATHERINE.
J’ sais pas queux manigances vous avez, mais n’y a pas d’ vieille portière, pour être, comme vous, renseignée su’ l’ tiers et l’ quart !
FOUCHÉ.
J’observe !... Toujours est-il, ma charmante, que vous en serez pour vos avances avec ce... comment l’appelez-vous, déjà ? Bouna... Boura ?
CATHERINE, de la cheminée.
Buo... Buonaparte...
FOUCHÉ.
Buonaparte, c’est ça. Timoléon Buonaparte.
CATHERINE.
Non pas, Timoléon ! Napoléon !
FOUCHÉ.
Non. Timoléon !... Napoléon, ça n’existe pas.
CATHERINE.
Napoléon, j’ vous dis !
FOUCHÉ.
Oh ! Napoléon si vous voulez... Fichus noms ! s’il est permis de s’appeler comme ça ? Comment, diable ! veut-il qu’on se rappelle des noms pareils ?
CATHERINE.
C’est corse... Il est Corse !
FOUCHÉ.
Cela se voit ! Un vrai sauvage, avec son teint d’olive, son nez de perroquet et son œil fiévreux.
CATHERINE.
Il m’ plaît comm’ ça, à moi...
FOUCHÉ.
Et maigre !
CATHERINE.
Pauv’ garçon ! Il mange chez Jarlat, à six sous la portion.
FOUCHÉ.
Et encore, pour payer, il a dû mettre, avant-hier, sa montre en gage, chez Fauvelet, à l’hôtel Longueville.
CATHERINE.
Vous savez ça, aussi ?
FOUCHÉ.
Si jamais il fait son chemin, celui-là !...
Grande rumeur dans la rue ; une cloche sonne le tocsin.
CATHERINE.
Quéqu’ c’est qu’ ça ?
Elle court au fond.
FOUCHÉ.
Cette fumée ?
CATHERINE, ouvrant la porte.
C’est le feu !
Julie et Toinon accourent.
FOUCHÉ.
Oui, Saint-Roch sonne le tocsin !
CATHERINE.
Pour sûr, c’est les Tuileries qui flambent !
FOUCHÉ, enthousiaste.
Mais alors, ça va bien ! ça va très bien !
UN VOISIN, au milieu des groupes.
Non, c’est seulement les baraquements des Suisses, au Carrousel.
CRIS LOINTAINS, qui vont se rapprochant.
Victoire ! Victoire ! Vive la nation !
Un groupe de gardes nationaux et d’artilleurs arrive, entouré aussitôt.
Vivent les patriotes ! Vive la nation ! À bas les tyrans !
FOUCHÉ, qui a couru à la porte.
Alors, les Tuileries ?
UN VOISIN, de la porte.
Enlevées d’assaut !
FOUCHÉ, radieux.
Enfin ! je triomphe !
TOINON, de la rue.
V’là Vinaigre, le tambour !
LES VOISINS.
Eh ! Vinaigre ! Vinaigre !
UNE VOISINE.
Arrêtez-le !
On lui barre le passage en lui criant : « Arrête ! »
CATHERINE, sur le seuil.
D’ou tu viens ?
VINAIGRE, hors d’haleine.
D’ la section, par ordre de m’sieu Santerre, pour qu’ les nationaux descendent à l’Assemblée, ousqu’on s’étouffe ! Je m’ sauve !
Il veut suivre son chemin.
CATHERINE le retient par la courroie de son tambour.
Attends donc !
VINAIGRE.
Non, non, laissez-moi !
CATHERINE.
Tu refuseras pas une lampée de vin ?
VINAIGRE.
Oh ça ! non !
Il s’arrête. On l’entoure. Toinon, qui a couru au buffet, lui apporte un verre plein.
UN VOISIN.
Alors, il est pris, ce Palais ?
VINAIGRE.
Oh ! s’il est pris !
CATHERINE.
Tu y es entré ?
VINAIGRE.
Des premiers, en battant la charge !... Et tout l’ monde y entre, à présent. C’est un’ cohue !... On s’ bouscule, on crie, on danse, on chante, on tue, on s’embrasse, on casse tout ! On flanque par les fenêtres les meubles, les bouteilles, les pendules, et les marmitons !
Il avale une gorgée.
C’est d’un gai !
FOUCHÉ, sur les rires.
Et les Suisses ?
VINAIGRE.
Oh ! ceux-là, on les poursuit à coups d’ feu dans les cours, le jardin, les rues, su’ les toits, sans qu’y ripostent !
FOUCHÉ, vivement.
Sans-Gêne, je vous confie ma valise !
Il sort en hâte.
CATHERINE.
Oui, il y a pus d’ danger ? C’est l’ moment de vous montrer !
À Mathurin, qui reparaît.
Ah ! te v’là, p’tit ! Et Lefebvre ?
MATHURIN.
Aux Tuileries !
CATHERINE.
J’en étais sûre !...
VINAIGRE.
Le sergent ? J’ lai laissé rue d’ l’Échelle, qui faisait la chasse aux habits rouges !
CATHERINE.
Alors, il n’a rien !
À Mathurin.
Viens, que je te paye une pomme...
VINAIGRE.
Allons, en route, les amis ! Qui qui vient, avec moi, visiter l’antre de la Tyrannie ?
VOISINS et VOISINES.
Nous !
MATHURIN.
Nous !
Il s’éloigne en battant la charge, entrainant tout le groupe.
TOINON, LA ROUSSOTTE, JULIE.
Oh ! nous ! nous !
TOINON.
Oh ! patronne !...
LA ROUSSOTTE.
Laissez-nous y aller !
CATHERINE.
Oui, oui ! J’ suis si contente que Lefebvre n’a rien, que j’ vous donne congé... et à moi aussi !
TOINON, LA ROUSSOTTE, JULIE.
Oh ! merci ! merci !
CATHERINE, arrêtant leur élan.
Eh ! dites donc ! Fermez les volets ; j’ vous rattraperai dans la rue. Allez ! Allez !
LES APPRENTIES, ferment vivement les volets.
Oui, patronne !
Elles sortent par la porte du fond, que Catherine pousse derrière elles.
Scène V
CATHERINE, seule, puis NEIPPERG
CATHERINE, rabat le volet de la porte du fond, qu’elle ferme, tandis que le tambour s’éloigne.
Je ne vois pas c’ que j’ ferais, toute seule ici !
Des coups de feu retentissent, assez proches.
Si j’ pouvais rattraper mon Lefebvre !
Elle a pris son mantelet et fait un pas pour sortir par la porte de droite, quand cette porte s’ouvre devant Neipperg, qui entre, et la referme vivement, en homme poursuivi.
Eh bien, dites donc ? N’ vous gênez pas, vous !
NEIPPERG, prêtant l’oreille à la porte.
Au nom du ciel, ne criez pas, ou je suis perdu !
CATHERINE.
Mais je crierai bien si j’ veux ! V’là des manières d’entrer comm’ ça chez les gens !
NEIPPERG, qui défaille.
Par pitié ! Taisez-vous !... Ils ont perdu ma trace, et je me suis jeté au hasard dans cette cour. Je suis blessé !
CATHERINE, venant à lui.
Blessé ! Oh ! pauvre garçon !
NEIPPERG.
J’ai pu m’échapper des Tuileries !
CATHERINE, sursaute.
Ah ! vous êtes ?
NEIPPERG.
Le comte de Neipperg, Autrichien.
CATHERINE, à distance.
Un royalisse !
NEIPPERG.
J’ai fait mon devoir en défendant la reine.
Il se laisse tomber dans le fauteuil.
CATHERINE.
L’Autrichienne !
Elle s’apaise et s’apitoie.
Après tout, j’ peux pas vous blâmer d’ ça. C’est votre payse, et puis, un blessé, c’est sacré ! N’ craignez rien !
NEIPPERG.
Merci !
CATHERINE, court chercher du linge sur la table.
C’est grave, c’te blessure ?... Où ça ?
NEIPPERG, ouvre son gilet.
Là... Au côté.
CATHERINE, tout en préparant des bandes.
J’ vas vous panser.
Elle vient au fauteuil.
NEIPPERG.
Voyez si j’ai bien fait de me refugier chez vous ! Écoutez...
Des voix, des appels, au dehors.
CATHERINE.
C’est rien ! C’est des gens qui passent !
Les voix s’arrêtent derrière la porte.
Ils s’arrêtent !
Des crosses sonnent sur le pavé. Neipperg se lève.
LEFEBVRE, en heurtant.
Eh ! Catherine !
CATHERINE.
Lefebvre !
LEFEBVRE, aux voisins.
Est-ce qu’elle est sortie ?
DES VOIX.
Non ! non.
Sur le bruit, Neipperg s’est traîné, chancelant, jusqu’à la chaise.
CATHERINE, lui montre l’escalier.
Là-haut ! vite !
NEIPPERG.
J’aurai trop de peine à gravir les marches !
CATHERINE, qui le soutient.
Alors, ici... chez moi ! Ah ! mon Dieu ! vite !
LEFEBVRE.
Eh ! Catherine ! es-tu là ?
DES VOIX.
Madame Sans-Gêne !
CATHERINE, haut, tout en aidant Neipperg à entrer dans la chambre.
Oui ! oui ! on y va !
Rumeurs de satisfaction. En passant le linge à Neipperg.
Tâchez d’ vous panser tout seul ; j’ viendrai l’ pus tôt possible. Et n’ bougez pas, ou vous êtes mort !
Elle referme la porte à clef et met la clef dans la poche de son tablier.
LEFEBVRE, ébranlant la porte.
Allons donc ! lambine !
CATHERINE, court au fond.
Mais on y va, j’ te dis ! Donne-moi l’ temps ! J’étais au grenier !
Elle ouvre.
Scène VI
CATHERINE,
LEFEBVRE paraît avec VABONTRAIN, JOLICŒUR, RISSOUT, ci-devant gardes françaises, des GARDES NATIONAUX, des SECTIONNAIRES, tous baïonnette au canon, des BOURGEOIS, qui restent dans la rue
LEFEBVRE, en la prenant dans ses bras.
On n’ veut donc pas embrasser son homme ?
CATHERINE.
Oh ! si ! si !
LEFEBVRE.
Qui est vainqueur et intact...
Il l’embrasse.
et complet !
CATHERINE.
Je l’espère bien !
LEFEBVRE, à ses camarades.
Entrez donc, les amis.
Il présente Catherine.
Mademoiselle Catherine Hubscher... plus connue dans le quartier sous le nom de Madame Sans-Gêne... et d’Alsace, comme moi.
VABONTRAIN, saluant militairement.
Citoyenne !
JOLICŒUR.
Compliments à toux deux !
RISSOUT, la main à son chapeau.
Et à l’Alsace ! Fameux pays pour ses productions !
LEFEBVRE, à Catherine, en posant son fusil.
Et maintenant, il faut t’ dire ! primo, qu’ nous sommes bien ici par pur hasard...
CATHERINE.
Comment ? C’est pas pour m’ voir ?
LEFEBVRE.
Non ! Faut être franc ! C’ qui nous a amenés, c’est la chasse aux habits rouges et aut’s sicaires des tyrans. Un, entre autres, en bourgeois, qui nous a échappé aux alentours, quoiqu’il ait du plomb dans l’aile.
Catherine tressaille.
Et, secundo, qu’il fait une rude soif !
Aux autres.
Pas vrai ?
Approbation. Il aperçoit le pot sur la table.
Mais v’là du vin !
CATHERINE.
Attendez, j’en ai du meilleur !
Elle va au buffet, d’où elle tire une bouteille et des gobelets qu’elle leur passe.
JOLICŒUR.
Ah ! c’est gentil, ça !
CATHERINE.
C’est bien l’ moins, pour les patriotes ! On n’ prend pas tous les jours les Tuileries.
Ils s’installent tous autour de la table.
RISSOUT.
Heureusement !
CATHERINE, qui va, vient, les sert.
Ç’a été chaud, hein ?
TOUS.
Ah ! oui !
VABONTRAIN.
Crédié !
LEFEBVRE.
Ils tapaient su’ nous dans l’tas ! Du haut du toit du Palais et des fenêtres ! Tous les coups portaient.
JOLICŒUR, assis.
Ah ! Ils nous ont fait bien du mal, tout de même.
LEFEBVRE.
Et encore, les Suisses, ils faisaient leur métier... Mais les ci-devant, et les chevaliers du Poignard, qui nous guettaient dans tous les coins en traîtres...
VABONTRAIN, en versant à boire.
Oh ! les gueusards !
CATHERINE.
Ça se voit ! C’te déchirure.
Elle lui montre son épaule gauche déchirée.
LEFEBVRE, se levant.
Un coup de baïonnette !...
CATHERINE.
T’es pas blessé, au moins ?...
LEFEBVRE.
Non, ou ça donc ? J’ai rien senti.
CATHERINE.
V’là d’ l’ouvrage pour demain !
LEFEBVRE, qui s’installe.
Oh ! que je suis donc fâché qu’i nous ait échappé, c’lui de tout à l’heure, qui traînait la quille !
CATHERINE.
Allons ! Allons ! Faut pas non plus être rancunier comm’ ça... quand on est vainqueur !
LEFEBVRE.
Si je l’ rattrape !
CATHERINE.
Mais, veux-tu te taire ! Quel enragé ! Si on croirait
Riant et lui levant le menton.
que c’t homme-là a du être curé !
LES AUTRES.
Ah ! bah ? Le sergent ?
TOUS, choquant leurs gobelets.
À la nation !
LEFEBVRE.
C’est vrai ! Une idée d’un oncle à moi, qu’était dans la prêtrise ! Mais j’ai pas mordu à çà, et je suis venu à Paris m’engager dans les gardes françaises, avec Vabontrain ! Et j’ai eu raison ! Et encore plus raison d’aller quéqu’fois danser au Vauxhall, ou j’ai rencontré la Catherine que voilà !
RISSOUT.
Ah ! Ah ! C’est là ?
LEFEBVRE.
C’est là !... L’ premier dimanche de juillet dernier ! Même que j’étais un peu gêné pour la tenir, vu qu’ je venais de m’ faire tatouer, sur l’ bras droit, un bonnet phrygien, et au-dessous... Tenez !
Il relève sa manche droite.
« Mort aux tyrans ! »
VABONTRAIN.
C’est bien peint.
LEFEBVRE, rabattant sa manche.
Çà oui !... Mais à ce moment-là, le bras me cuisait.
CATHERINE.
Et, à quelque temps d’ là, nous r’dansions à la Râpée, et, c’te fois, c’était l’autre bras qui lui faisait mal.
LEFEBVRE, le montrant.
Celui-là !
CATHERINE, pénétrée, lui prend la main.
Où il y a un cœur, percé d’une flèche, et au-dessous...
LEFEBVRE, tendre.
Sans-Gêne...
CATHERINE, baissant les yeux.
Pour la vie.
Murmure d’approbation.
VABONTRAIN.
V’là qu’est délicat ! Moi, c’est deux pigeons qui tiennent dans le bec une guirlande de roses.
CATHERINE, malicieuse.
Et le nom ?
VABONTRAIN.
Y en a pas ; c’est moins assujettissant.
Les hommes rient. Catherine s’offusque.
RISSOUT.
Et quoi qu’ vous attendez pour vous conjoindre ?
CATHERINE.
J’attends qu’i n’ soit pus jaloux !
LEFEBVRE.
Bon ! C’est fini ! J’ suis guéri de c’te maladie-là !
CATHERINE.
Ouiche ! À la première occasion, il m’fera une scène !
LEFEBVRE.
Mais non, j’ te dis, c’est fini !
VABONTRAIN, qui se lève et bourre sa pipe.
Allons, assez jaboté, les amoureux ! Faut que nous allions voir un peu à l’Assemblée.
LEFEBVRE.
Viens-tu avec nous ?
CATHERINE.
Quoi qu’ j’y ferais ?
LEFEBVRE, regarde ses mains.
Nom de nom ! Qu’ j’ai donc les mains sales !
CATHERINE.
Bon ! C’est d’ la poudre. Il n’y a pas de honte à çà !
LEFEBVRE.
C’est égal, pour aller à l’Assemblée.
CATHERINE.
Justement !
LEFEBVRE, sans l’écouter.
V’là mon affaire !
Il vient à une terrine.
CATHERINE, court à lui.
Eh ! pas dans mon bleu !
LEFEBVRE.
C’est juste !... Alors, ici ?
Il se dirige vers le poêle.
CATHERINE.
Mon amidon !
LEFEBVRE.
Dans ta chambre, alors ?
Il va droit à la chambre.
CATHERINE, vivement.
Mais non ! Viens plutôt dans la cour, à la pompe ! V’là du savon.
Elle lui en offre un bloc.
LEFEBVRE, qui secoue la porte de gauche.
Tiens, c’est fermé ! Pourquoi c’est fermé ?
CATHERINE, en ouvrant celle de la cour.
Parc’ que j’allais sortir ! V’là une serviette, tiens !
LEFEBVRE, sans bouger.
C’est drôle, tout de même, c’te porte fermée tant que ça !
CATHERINE, de la cour.
Ah çà ! tu vas pas recommencer à m’aguicher, avec tes histoires ?
LEFEBVRE, reculant d’un pas.
Et pourquoi qu’t’as ôté la clef ?
CATHERINE.
Parc’ que ça m’a plu !
Elle rentre en scène et ferme derrière elle.
Et çà va finir, n’est-ce pas ?
LEFEBVRE, revient à elle.
Et si j’ veux entrer, à présent ?
CATHERINE, au fauteuil.
Toi ?
LEFEBVRE.
Moi !
CATHERINE, pose serviette et savon.
Tu y entreras quand tu s’ras mon mari, et t’en prends pas l’ chemin !
LEFEBVRE, s’approche.
J’ prendrai toujours c’lui-là. J’ veux la clef, entends-tu ?
CATHERINE, essayant de rire.
Oh ! pardon ! Le roi disait : « Nous voulons. »
LEFEBVRE.
N’ris pas, t’en as pas plus en vie qu’ moi !...
En lui serrant le poignet.
La clef !
CATHERINE.
Non !
LEFEBVRE.
Ah ! c’est donc pour ça qu’ t’étais si bien close !... qu’ tu répondais pas ! et qu’ t’as été si longue à m’ouvrir ! Il y a quelqu’un d’ caché là !
CATHERINE, dans un haussement d’épaules.
Et qui, caché ?
LEFEBVRE.
Un galant !
CATHERINE.
Eh bien, après ? S’il y en a un, j’suis pas libre ?
LEFEBVRE.
T’avoues !...
CATHERINE.
Je n’ suis ni ta femme, ni ta maîtresse... J’ai ben l’ droit de mettre là qui j’ veux ?
LEFEBVRE.
Et tu crois qu’ ça va s’ passer comme ça ?
Le poing levé.
Mille tonnerres !...
VABONTRAIN, JOLICŒUR, RISSOUT, essayant de le contenir.
Lefebvre ! Allons !
LEFEBVRE, se dégageant.
Fichez-moi la paix, vous autres ! Que j’ lui fasse son affaire, à c’ lâche, qu’ose seulement pas se montrer !
Il a couru à la porte de la chambre.
CATHERINE, fait deux pas.
Je lui défends !
LEFEBVRE, hors de lui.
Vous entendez ?
CATHERINE.
Et maintenant, vide-moi l’ plancher ! Allons, ouste ! Qu’on détale !
LEFEBVRE.
Ah ! coquine !... J’ l’aurai malgré toi !
Instinctivement, elle protège, de la main, la poche de son tablier : il saute sur elle pour lui arracher la clef.
CATHERINE, se débat.
Veux-tu m’ laisser ?... Veux-tu ?... Il n’y en a pas un qui me défendrait ! Non ?
LES AUTRES, descendant.
Voyons !... voyons... La paix !
LEFEBVRE.
Le premier qu’avance !
Tous s’arrêtent.
RISSOUT, à mi-voix.
Ah ! qu’ils se débrouillent !
CATHERINE, à qui Lefebvre tord le bras.
Veux-tu me laisser ! que je te dis ! Tu me fais mal !... Ah ! sauvage !
LEFEBVRE, qui lui arrache la clef.
J’ la tiens !
CATHERINE.
Prends garde à ce que tu vas faire !... Si t’ entres là, c’est fini entre nous, pour la vie !
LEFEBVRE.
Entre vous aussi, car je l’étrangle !
Il met la clef dans la serrure.
CATHERINE, s’élance, essayant de le retenir.
Joseph ! par pitié !
LEFEBVRE.
M’ lâcheras-tu, à la fin ?
Il se délivre d’elle, et la rejette à ses amis, qui la contiennent, pendant que Lefebvre entre dans la chambre.
CATHERINE.
Oh ! malheureux !
VABONTRAIN.
Il va le tuer !
CATHERINE.
Et ce sera votre faute ! Tas de lâches ! Laissez-moi, je veux y aller !
VABONTRAIN.
M’ame Sans-Gêne, c’est pas vot’ place !
CATHERINE.
Je veux y aller !
Lefebvre reparaît sur le seuil, pâle, troublé. Grand silence.
JOLICŒUR.
Eh bien ?
VABONTRAIN.
Quoi qu’ y a ?
LEFEBVRE.
Y a...
Affectant de rire.
S’il est permis d’ se fiche du monde a ce point-là ! Y a... qu’i n’y a personne !
TOUS.
Personne ?
LEFEBVRE, a refermé la porte, devant laquelle il se tient, en regardant Catherine.
Pas un chat !
RISSOUT, à mi-voix.
C’est un’ leçon qu’elle te donne !
VABONTRAIN.
J’y ai été bien pris.
JOLICŒUR.
Mais tous !
À Lefebvre.
Ah ! bien, mon vieux, tu as fait une belle affaire !
VABONTRAIN.
Tâche de raccommoder ça !
LEFEBVRE, lentement.
J’ vais essayer ! Laisses-nous.
Ils remontent, interdits. Lefebvre vient rejoindre Catherine, qui le regarde, immobile, stupéfaite. À mi-voix, tout près d’elle.
Pourquoi n’ m’as-tu pas dit qu’il y avait là un mort ?
CATHERINE, saisie.
Un mort ?... Il est mort ?...
LEFEBVRE.
Oui !
CATHERINE.
Oh ! mon Dieu ! Tu es sûr ?
LEFEBVRE.
Sûr !... D’ailleurs, avec une balle dans l’ flanc !
CATHERINE, remuée.
Pauv’ garçon ! pourvu qu’ ça n’ nous porte pas malheur ! Je ne pouvais pourtant pas le j’ter dehors... À peine s’il tenait su’ ses jambes. Quoi qu’ nous allons faire de lui, maintenant ?
LEFEBVRE, qui ne la quitte pas des yeux.
Il n’y a qu’à le faire porter chez lui !
CATHERINE.
Si j’ savais où qu’y demeure ! Il m’a dit qu’il s’appelait l’comte de Neipperg ! J’ sais rien d’ plus !
LEFEBVRE.
Tu ne l’connais pas ?
CATHERINE.
Et d’où qu’ je l’ connaîtrais ?
LEFEBVRE.
Alors, pourquoi le cachais-tu ?
CATHERINE.
Il est arrivé comme j’ fermais la boutique. Il n’avait pas seulement la force de s’ traîner !... et vous veniez comme des furieux !... J’ m’ suis dit : « S’ils l’ trouvent là, d’ l’humeur qu’ils sont, ils vont l’achever ! » Là-dessus !...
Elle s’interrompt.
Quoi qu’ t’ as a me regarder comm’ ça ?
LEFEBVRE.
Je regarde si tu mens ?... Si c’est vrai que tu n’ connaissais pas c’t homme-là ?
CATHERINE.
Moi ?
LEFEBVRE.
Après tout, c’blessé qui se réfugie chez toi, peut aussi bien être ton amant.
CATHERINE, haussant la voix.
Un Autrichien !
LEFEBVRE, vivement.
Tais-toi ! S’ils t’entendaient !
CATHERINE.
À présent qu’il est mort !
LEFEBVRE, après hésitation.
...C’est qu’il ne l’est pas !
CATHERINE, avec un sursaut de joie.
Ah ! tu disais ça ?...
LEFEBVRE, en lui prenant la taille.
Pour être sûr... et c’est fait !
Catherine, bouleversée, va l’embrasser.
Mais tais-toi, soigne-le, et je reviendrai à la nuit... pour le faire évader.
CATHERINE, des larmes plein la voix.
Ah ! mon Joseph ! Ah ! que t’es un brave cœur ! Et que j’ t’aime !
LEFEBVRE.
Alors tu ne m’en veux plus ?
CATHERINE. Oh ! t’en vouloir...
Elle lui saute au cou.
Dis que j’ te veux !
VABONTRAIN, JOLICŒUR, RISSOUT, épanouis, se rapprochant.
Ah ! bravo ! À la bonne heure ! La paix est faite !
LEFEBVRE, qui la tient par les deux mains.
Et si bien faite, que j’ vas commander les bans...
À Catherine.
Pas vrai ?
CATHERINE, essuyant ses yeux.
Oh ! oui ! oui !
Roulement de tambour ; la rue s’agite.
VABONTRAIN, qui a rouvert la porte.
Attention ! V’là les nationaux de la section qui descendent au Manège. V’nez vous t’y ?
TOUS, reprenant leurs fusils.
Oui ! oui !
LEFEBVRE, s’arrachant à Catherine.
À ce soir !
Précédés de gamins, tambours en tête, des gardes nationaux passent, au pas redoublé, en chantant la Marseillaise, Lefebvre et les autres vont les rejoindre, Du seuil, il envoie à Catherine un grand baiser, et entonne, avec ses camarades : « Liberté ! Liberté chérie ! »
ACTE I
Au château de Compiègne (septembre 1811).
Un grand salon solennel, du plus pur style empire, colonnes, voussures, meubles de Jacob. Au fond, trois arcades, celle du milieu fermée par une grande cheminée, surmontée d’une glace ; les deux autres ouvrant par des portes pleines sur un second salon à trois fenêtres, à travers lesquelles on entrevoit le parc et ses feuillages d’automne, baignés de lune. Au milieu, des panneaux de droite et de gauche, deux grandes portes d’intérieur. Au premier plan, de chaque côté, un canapé appliqué au mur, et, entre les portes et le fond, deux commodes de citronnier à cuivres ciselés, surmontées de candélabres allumés. Au milieu du salon, grand guéridon acajou et cuivre au-dessus duquel un lustre. Autour, des tabourets carrés, des chaises, des fauteuils, etc.
Scène première
JASMIN, en grande livrée, poudré, arrange le feu, puis DESPRÉAUX
UN VALET paraît.
Monsieur Jasmin ?
JASMIN.
Quoi ?
LE VALET.
M. Despréaux !
Sur un signe de Jasmin, il se range pour livrer passage à Despréaux.
DESPRÉAUX, après les saluts.
Mme la duchesse de Dantzig est chez elle, n’est-ce pas ?
JASMIN.
Oui, monsieur.
Au valet.
Prévenez Mme la duchesse.
Pendant que le valet s’éloigne.
J’ai connu monsieur Despréaux à Versailles, au bon temps !... Quand monsieur était maître de ballet à l’Opéra.
DESPRÉAUX, qui s’assied.
Je suis aujourd’hui professeur de danse et de maintien des pages de Sa Majesté l’impératrice Marie-Louise, et je me rends aux ordres de Mme la maréchale.
JASMIN.
Mme la maréchale est en ce moment aux mains de M. Duplan, son coiffeur ; elle sera à vous dans l’instant.
DESPRÉAUX.
Je me demande ce qui peut motiver son appel à une heure où tout le monde dîne !
JASMIN.
Voici. Le général Ordener, qui commande le palais de Compiègne, a été pris subitement d’une attaque de goutte, ce qui est bien maladroit à la veille du jour où l’on se prépare à fêter l’arrivée du grand-duc de Wurtzbourg : chasses à courre, dîners à grand couvert, comédie, opéra, ballet, etc... L’empereur a désigné, d’urgence, pour le remplacer, M. le maréchal Lefebvre, qui venait précisément d’arriver au château avec la maréchale, et, comme il y avait ce soir réception chez le général Ordener, Sa Majesté a décidé qu’elle se ferait chez M. le maréchal. Vous voyez le branle-bas ; nous sommes à peine installés. Il a fallu tout improviser ; toilettes, service, rafraichissements, luminaire !
DESPRÉAUX.
Je vois ce que c’est : Mme la maréchale désire me consulter pour le bal.
JASMIN.
Non ! Non ! Il n y a pas de bal. Une simple réception avant le cercle de l’impératrice, et c’est heureux, car, entre nous...
Il se rapproche de Despréaux et baisse un peu la voix.
en fait de danses, Mme la duchesse n’a guère pratiqué que la monaco, la boulangère et la fricassée... et quant au maintien !...
Il rit.
Oh ! là là !
DESPRÉAUX, souriant.
Je le connais !
JASMIN.
Et le langage donc !...
DESPRÉAUX.
Il fait la joie de toutes ces dames ! N’était-elle pas en boutique, avant la Révolution ?
JASMIN.
Rue Sainte-Anne... puis vivandière ou cantinière, à l’armée du Rhin, où elle a suivi son mari ; le serpent Lefebvre.
DESPRÉAUX.
Depuis général.
JASMIN.
Puis maréchal.
DESPRÉAUX.
Et duc de Dantzig. Titres et grades bien mérités, du reste.
JASMIN, dédaigneux.
Oui ! mais noblesse de l’empire ! Duc de Dantzig !... De mon temps, on ne connaissait que de l’eau-de-vie de ce nom-là... Et Savary, duc de Rovigo ! Et Fouché, à qui l’empereur a donné la ferme des jeux et qu’il a fait duc d’Otrante... et quarante ! Quand on a eu l’honneur, comme vous et moi, d’appartenir à l’ancienne cour !
DESPRÉAUX.
Ah ! vous étiez ?...
JASMIN, se rengorgeant.
Valet d’écurie de Mgr le duc de Penthièvre.
Despréaux se lève, avec un petit salut complimenteur.
On n’improvise pas une noblesse, monsieur Despréaux ! La caque sont toujours le hareng, et Mme la duchesse de Dantzig est toujours la blanchisseuse de la rue Sainte-Anne, qui sauvait M. de Neipperg, au dix août, en le cachant dans un panier de linge sale... dit l’histoire.
DESPRÉAUX.
C’est donc pour cela que M. le comte de Neipperg est des familiers de la maison ?
JASMIN.
Il n’en fallait pas moins, en effet, pour que M. de Neipperg, qui est de vieille race, fréquente des gens si communs ! Le maréchal et lui se sont retrouvés sur le Rhin, où Lefebvre commandait l’armée de Sambre-et-Meuse, tandis que M. de Neipperg était dans l’état-major du prince de Condé. Ils ont renoué connaissance au cours des négociations, et enfin, M. le comte ayant accompagné M. de Metternich en France, les relations amicales se sont accentuées, au point de devenir journalières.
DESPRÉAUX, en confidence.
Entre nous, je le croyais attiré par les grâces appétissantes, quoique vulgaires, de la dame du logis.
JASMIN, haussant les épaules.
Mais non, mon cher monsieur, pas même cela ! À ses autres ridicules, la maréchale joint celui de la fidélité conjugale ! C’est d’un bourgeois ! Croiriez-vous qu’ils en sont encore à faire chambre à part !
DESPRÉAUX.
Allons donc !
JASMIN.
Comme je vous le dis !... C’est à mourir de rire !
La porte de droite s’ouvre.
DESPRÉAUX.
Doucement ! la voici !...
Scène II
JASMIN, DESPRÉAUX, CATHERINE, entre, suivie d’une DAME D’ATOURS, qui restera sur le seuil
Catherine est en simple jupon et camisole de soie.
CATHERINE.
Bonjour, m’sieu Despréaux ! Vous êtes un brav’ homme d’ vous déranger pour moi, à c’t’ heure-ci.
DESPRÉAUX, dans un profond salut.
Madame la duchesse.
CATHERINE.
Et ça va-t-y comme vous voulez ?
DESPRÉAUX.
Grâce à Dieu, madame la duchesse !
CATHERINE.
C’est ben vous qu’avez épousé la Guimard ?
DESPRÉAUX, après un geste de confirmation.
Madame la duchesse l’aurait connue ?
CATHERINE.
Ah ! j’ le crois que je l’ai connue... En v’là une qu’avait d’ beau linge !... Va
À Jasmin.
donc voir un peu si c’ cordonnier s’ fiche de moi, d’ m’avoir pas encore apporté mes cothurnes.
JASMIN.
Je ferai remarquer à madame la duchesse qu’à cette heure, il serai bien surprenant que je pusse !...
CATHERINE, l’interrompt.
Oh ! que j’ pusse ! Prends garde d’avaler ta langue !
JASMIN.
Je veux dire que, pour le trouver...
CATHERINE.
Faut tricoter des jambes... Allons, oust ! et plus vite que ça !... Je t’ les secouerai, moi, tes puces !
Jasmin sort, avec un geste navré.
J’ peux pas l’ souffrir, c’t enfariné là !
Scène III
DESPRÉAUX, CATHERINE, LA DAME D’ATOURS, sur le seuil
CATHERINE, à Despréaux.
Voyons, m’sieu Despréaux, c’est pas tout ça !
Elle s’assied.
J’ suis dans mon coup d’ feu ! J’ reçois tantôt un tas d’ princesses, d’altesses, d’ duchesses !... Si elles étaient du même tonneau qu’ moi, ça irait tout seul ; j’ leur offrirais de griller des marrons, d’ faire sauter des crêpes et d’ jouer une partie de savate su’ l’ parquet, ça serait autrement jovial !... Mais c’est toutes des sucrées qui peuvent pas seulement dire bonjour sans s’ pincer les lèvres, et s’ tortiller du reste !... Et faut que j’ leur fasse des salutations dans les grands prix ! Pour lorss, que j’ m’ai dit, Despréaux va m’apprendre ça, lui qu’ c’est sa partie, toutes ces singeries-là !
DESPRÉAUX.
Trop heureux !
À lui-même, vexé.
Singeries !
Scène IV
DESPRÉAUX, CATHERINE, LA DAME D’ATOURS, sur le seuil, UN VALET, puis COP et LEROY
LE VALET.
Madame la duchesse ?
CATHERINE.
Quoi qu’y a ?
LE VALET.
C’est M. Leroy, costumier de l’impératrice, et M. Cop...
CATHERINE.
Le cordonnier ?... Bon !
En allant à la dame d’atours.
Et l’autre andouille qui court après !
Pendant que la dame d’atours sort.
Entrez !
Ils entrent, avec de grands saluts.
C’est bon ! c’est bon ! assez d’ torticolis !...
À Cop.
Les v’là enfin, ces cothurnes !
COP, un carton sous le bras.
Oui, madame la maréchale.
CATHERINE, à Leroy.
Et c’t’ amazone pour demain ?
LEROY, montrant son commis qui porte deux grands cartons.
La voici, madame la maréchale.
CATHERINE.
Alors, ça va bien.
La dame d’atours rentre, suivie d’une femme de chambre.
LEROY.
Madame la maréchale ne veut pas que nous passions dans son cabinet de toilette ?
CATHERINE.
Nous sommes pas bien là ?
LEROY.
Mon Dieu...
CATHERINE.
C’est plein d’paquets c’ cabinet, et j’ serai ici ben pus à l’aise pour les grimaces que m’sieu Despréaux va m’apprendre.
DESPRÉAUX, bas.
Grimaces !
CATHERINE, assise et qu’on déchausse.
Tu m’as fait assez droguer, toi, pour c’te chaussure !
COP.
Madame la duchesse m’excusera ; nous sommes débordés, avec ces fêtes en l’honneur du grand-duc de Wurtzbourg... Toutes ces dames veulent être servies à la fois. Ainsi, Mme la duchesse d’Otrante...
CATHERINE.
Ah ! Fouché est à Compiègne ?
COP, en la chaussant.
À la grande surprise des personnes qui le croyaient en disgrâce, depuis que l’empereur lui a retiré le ministère de la police, pour le donner à M. le duc de Rovigo.
CATHERINE.
Ah ! ben, s’ils l’ connaissaient comme moi, Fouché, y s’raient pas inquiets sur lui ! En v’là un qui r’tombera toujours su’ ses pattes.
À Cop.
Dis donc, toi, t’ v’là déjà au mollet, tu comptes pas grimper plus haut ?
COP se relevant.
Voilà qui est fait, madame la duchesse.
CATHERINE, debout.
Pourvu qu’ils fassent pas comme les derniers, que j’ les avais pas plutôt mis, qu’ils ont crevé de rire à la couture !
COP, gravement.
C’est que madame la duchesse aura marché avec.
CATHERINE.
C’te bêtise ! Faut que j’aille la tête en bas, comme un oignon ?
COP.
Je veux dire que madame la duchesse aura posé le pied sur le sol, au lieu de glisser sur le tapis, comme une déesse.
CATHERINE, raillant.
Que j’ suis, pas vrai ?
La dame d’atours à déployé l’amazone. À Leroy.
J’ peux ben essayer l’amazone avec ça ?
COP.
Sûrement, madame la duchesse.
CATHERINE.
Alors, je les garde !
À Cop.
Allons, file, toi ! Et s’ils craquent, j’ les paye pas, tu sais.
COP.
Madame la maréchale !
Cop salue respectueusement et se retire.
CATHERINE.
Oh ! mais... j’ les paye pas !
Elle enlève son peignoir, et reste en camisole et jupes, bras nus.
Scène V
DESPRÉAUX, CATHERINE, LA DAME D’ATOURS, LEROY, LA FEMME DE CHAMBRE
Leroy, la dame d’atours et la femme de chambre lui passent l’amazone.
LEROY.
Je pense que madame la maréchale sera satisfaite. J’ai taillé l’amazone exactement sur le patron accepté par l’impératrice. Et ce spencer sera mieux réussi que celui de Sa Majesté, que je n’ai pas eu la satisfaction de pouvoir essayer moi-même sur son buste.
CATHERINE, qui se débat dans le spencer.
À cause ?
LEROY.
L’empereur n’admet pas que l’essayage soit fait par d’autres que les dames d’atours.
CATHERINE.
En v’là un jaloux qui ne veut pas qu’on voye sa femme en jupons ! Mais il est tellement féru d’elle !
LEROY, reculant pour admirer son œuvre.
Parfait ! La chute est harmonieuse, les lignes sont nobles.
CATHERINE, à qui la dame d’atours tend une casquette de chasse.
C’est pour s’ coiffer, c’te tourte-là ?
Elle la met de travers sur sa tête.
LEROY, vivement.
Oh ! non, permettez !... Comme ceci.
Il la redresse, puis, après deux pas en arrière.
Voilà qui est on ne peut plus gracieux !
CATHERINE.
C’ qu’est ben gênant, c’est c’te gredine de queue.
LEROY.
Cependant, pour monter à cheval...
CATHERINE.
J’y ai assez monté à cheval, et à poil encore !... et je m’ passais ben de c’ balayage-là !
À Despréaux.
Hé ! m’sieu le marchand d’entrechats ! v’là l’ moment d’essayer la révérence.
DESPRÉAUX.
À vos ordres, madame la duchesse. Voyons le salut.
Catherine fait la révérence.
Pas mal. Mais pas assez moelleux, onctueux !... Voyez-moi, je vous prie ; je fléchis... comme ceci... portant, gracieusement, sur la jambe gauche mon arrière-train... et je plonge !... avec souplesse... Voyez !... Plongez !... C’est ça... Encore... Plongez... Plongez !...
CATHERINE, qui manque de choir.
Ah ! mais non, non ! Avec vos plongeons, j’ vas en faire un su’ l’ dos...
DESPRÉAUX.
Mais non, c’est parfait !
CATHERINE.
Et puis, c’est pas tout ça qui m’ chiffonne, c’est le manteau de cour, ou j’ vas m’emberlificoter les jambes.
DESPRÉAUX.
Si madame la maréchale veut essayer avec la traîne de l’amazone, c’est tout comme... et il suffit d’un petit coup de jarret, si simple, voyez ! Une, deux, trois... houp !
Il donne un coup de pied comme pour chasser la queue et fait la révérence.
C’est d’un naturel !
CATHERINE.
C’te malice ! sans jupe !...
DESPRÉAUX.
Daignez me donner la main, et faire, au signal, le même geste que moi. Le pied gauche, s’il vous plaît.
Il prend la main de Catherine et marche avec elle, tournant et donnant le coup de pied à chaque « houp ! ». Elle l’imite de son mieux.
CATHERINE.
Ça y est !
DESPRÉAUX.
Non c’est le droit.
CATHERINE.
Ah ! c’est vrai !
DESPRÉAUX.
Une... deux... trois... pas d’émotion... le pied gauche, toujours... houp ! Une, deux, trois... houp ! Mais excellent ! madame la duchesse ! Il semble que vous n’avez fait que cela toute votre vie !
Les assistants ont une petite rumeur d’approbation.
CATHERINE, satisfaite.
Alors, vrai ? j’ai pas l’air trop dinde ?... Faudrait m’ le dire.
DESPRÉAUX.
J’en appelle à M. Leroy, à ces dames.
TOUS.
Oh ! non, non !
CATHERINE.
Alors, enlevez-moi ça ?
Elle jette la casquette sur la table, et la femme de chambre commence à lui retirer l’amazone.
DESPRÉAUX.
Madame la duchesse n’a pas d’autres conseils à me demander ?
CATHERINE.
Non c’est tout. Merci, m’sieu Despréaux... Ben des choses à vot’ femme.
DESPRÉAUX, saluant.
Madame la duchesse nous comble.
Il se retire.
LEROY.
Madame la duchesse n’a pas d’observation sur sa toilette de gala ?
CATHERINE.
C’est bigrement nu tout d’ même, c’te mode-là.
LEROY.
Madame la duchesse, il n’y a rien de tel que l’antique pour les femmes...
CATHERINE.
Qui n’ le sont pas. Bonsoir, monsieur Leroy.
LEROY, qui salue et s’éloigne.
Madame la duchesse...
Le valet a reparu, qui précède Lefebvre.
CATHERINE.
Ah ! v’là le maréchal !
À la dame d’atours, en reposant son peignoir.
Portez ça chez moi...
La dame d’atours sort avec le chapeau, l’amazone, etc. Lefebvre entre. Le valet referme les portes.
Scène VI
CATHERINE, LEFEBVRE
CATHERINE, en achevant de s’habiller.
Figure-toi que c’ pauvre Leroy n’ peut pas essayer... Non, tu vas rire !...
LEFEBVRE, bourru, jette son chapeau sur la table.
Ça m’étonnerait.
CATHERINE, surprise, le regarde.
Oh ! v’là une tête ! Quoi qu’ t’as ?... D’ou qu’ tu sors ?
LEFEBVRE.
Je viens de diner avec l’empereur ! Seul avec lui dans son cabinet.
CATHERINE.
Et c’est ça qu’ t’as l’air d’un déterré ?
LEFEBVRE, à la cheminée.
D’abord, il a une façon de dîner, cet homme-là... On n’a pas idée de ça ! Il prend de tout ce qu’il voit sur la table, au hasard, comme ça lui dit, les confitures après le potage, la crème au chocolat sur les merlans frits et le fromage dans les lentilles ! Et tout ça en dix minutes, v’lan, v’lan, allez donc ! Je me suis brûlé avec la soupe, étranglé avec une arête et je crève de faim...
En jetant ses gants.
Voilà mon repas !
Catherine éclate de rire.
Tu trouves ça drôle ?
CATHERINE, assise devant le guéridon.
Mais oui !
LEFEBVRE.
Tu ne trouveras peut-être pas le reste aussi plaisant ; car ce n’est pas pour me régaler qu’il m’a fait dîner à sa table. C’est pour me parler de toi...
CATHERINE.
De moi ?
LEFEBVRE.
Tout le temps.
CATHERINE.
C’est ben d’ l’honneur !... Et à cause ?
LEFEBVRE.
À cause de tes manières, qu’il ne trouve pas son goût.
CATHERINE.
Queux manières ?
LEFEBVRE.
Mais celles-là, nom de nom ! Je rentre et je te trouve, en camisole et en cotillons, avec tes fournisseurs, dans ton salon ! C’est donc une tenue, ça ?
CATHERINE.
J’essayais...
LEFEBVRE.
Bras nus ? Épaules nues ?
CATHERINE.
J’en montrerai ben pus, tantôt, que je serai habillée.
LEFEBVRE.
Ce n’est plus choquant du tout devant le monde. Enfin, voilà des gens qui sortent d’ici en se moquant de toi !
CATHERINE.
C’est ça dont je me bats l’œil.
LEFEBVRE.
Eh bien, pas moi ! Nous avons une situation, un decorum, comme dit l’empereur, à garder. Et ton langage ! Enfin, es-tu duchesse, oui ou non ? Tonnerre de Dieu ! Tu ne peux donc pas prendre le langage de la cour ?
CATHERINE, riant.
Après toi, s’il en reste !
LEFEBVRE.
Je suis un soldat, moi. Un soldat qui ne jure pas n’est pas un soldat !... Avec ça que l’empereur s’en privait, tout à l’heure, et de flanquer des coups de pied dans les tisons !
CATHERINE.
Enfin, quoi qu’y t’a dit ?
LEFEBVRE.
Il m’a dit : « Votre femme est trop mal embouchée ; ça ne peut pas durer comme ça !... C’est un vrai scandale ; on en fait par tout des gorges chaudes. Mais voilà ce que c’est que de se marier sergent, quand on a le bâton de maréchal dans sa giberne ! Heureusement que le remède est là... le divorce ! »
CATHERINE, saisie.
Hein ?
LEFEBVRE, continuant.
« Il va sans dire que nous ferons à Mme Lefebvre une situation parfaite. Elle conservera votre terre de Combault, avec une dotation magnifique. Allez en causer dès maintenant avec elle, et que tout soit fini dans quinze jours. »
CATHERINE.
Ah ! il t’a dit comme ça ?
LEFEBVRE.
Comme il m’aurait dit : « À cheval, et en route ! »
CATHERINE, inquiète, l’observe.
Ah ! Et quoi qu’ t’as répondu ?
LEFEBVRE.
Et toi ?
CATHERINE.
Moi ?
LEFEBVRE, venant à elle.
Oui ! s’il t’avait parlé de ce divorce-là, en t’offrant le château, la dotation, etc... Qu’est-ce que tu lui aurais dit ?
CATHERINE, se levant, très émue.
C’ qu’ j’ lui aurais dit ? J’ lui aurais dit : « Vot’ château et vot’ argent, j’en veux pas ! J’ai mon Lefebvre et j’ le garde ! C’est pas quand on a aimé un homme dans la gêne, qu’on a peiné et trimé avec lui des années, qu’on a risqué sa vie à ses côtés, pleuré d’ sa première blessure et chanté d’ sa première victoire, qu’on s’ déchire et s’arrache d’ lui comma ça ! Ça nous a rivés l’un à l’autre, c’ passé-là ; ça nous a fait un même cœur, un même sang, une même chair ! Vous la couperiez en deux, qu’ les morceaux se r’coleraient d’eux-mêmes ! » V’là c’ que j’ lui aurais répondu, à l’empereur ! Et c’ que t’aurais dû lui répondre, si t’avais seulement un peu d’cœur !
LEFEBVRE, encore bourru.
Et comme j’ai un peu de cœur, c’est exactement ce que je lui ai dit.
CATHERINE, toute joyeuse.
Et allons donc ! Dis-le donc Méchant homme, va ! qui fait peur à sa Catherine.
Elle lui saute au cou.
LEFEBVRE, qui la retient dans ses bras.
Bécasse ! qui peut croire que je lui aurais répondu autre chose.
CATHERINE, se serrant contre lui.
Ah ! tu lui as dit ça ? Ah ! qu’ t’as donc bien fait ! T’es un amour ! Et alors ? Dis-moi tout ! Alors ?
LEFEBVRE, assis devant le guéridon.
Alors, pas content le patron, tu penses !...
CATHERINE.
Ah ! Ah ! Je l’ crois !... Et alors ?
LEFEBVRE.
Alors, comme il insistait pour que je te conte la chose... « Ma foi, sire, Votre Majesté voudra bien m’en dispenser : Catherine m’arracherait les yeux. »
CATHERINE.
Ça, j’y pensais !
LEFEBVRE.
À quoi il a répliqué, en jetant sa tabatière sur la table : « C’est donc moi qui lui parlerai, à Catherine ! Dès ce soir ! et elle ne m’arrachera pas les yeux, à moi ! »
CATHERINE.
Pas sûr !
LEFEBVRE.
Là-dessus, il m’a congédié et me voilà. Tu peux compter qu’il te fera venir, ce soir ou demain, pour ce divorce.
CATHERINE.
Ah ! j’ lui conseille ! Avec ça qu’ ça lui a bien réussi a lui d’ divorcer ! Une riche idée qu’il a eue là, d’épouser la fille des Césars, comme il dit ! En v’là une qui doit le porter dans son cœur, et nous avec ! C’t’ Autrichienne, qui n’a connu la France que par la mort de sa tante Marie-Antoinette, et l’empereur que par les raclées numéro un qu’il administrait à m’sieu son père.
LEFEBVRE.
C’est peut-être bien elle qui lui monte la tête contre toi !...
CATHERINE.
Oh ! que nenni ! C’est bien plutôt les sœurs de l’empereur, la Bacciochi et la Murat. Deux chipies, qui n’ont jamais pu me souffrir, de ce que j’étais dévouée à c’te pauvre Joséphine, à qui elles en ont fait voir de toutes les couleurs ! Et mauvaises, et jalouses entre elles, et se disputant à qui tirera le plus à soi, pour son mari ou son amant. Deux pécores qui, sans l’empereur, seraient encore dans leur fie à ravauder leurs bas et à souper de pois chiches et d’eau claire ! Et ça se croit tombé des étoiles, et ça vous écraserait sans crier gare !... Croirais-tu que la Bacciochi, parlant de moi à la Rovigo, a eu l’ toupet d’ lui dire que l’empereur avait eu bien tort de faire duchesse une créature qu’ tout le monde a pu voir blanchissant des chemises ! – « Pas les siennes toujours ! qu’ j’ai dit à la Rovigote, vu qu’en c’ temps-là elle n’en avait pas ! »
LEFEBVRE.
Tu as dis ça a Mme de Rovigo ?
CATHERINE.
Non, je me suis gênée !
LEFEBVRE.
Elle n’a rien eu de plus pressé que de le redire aux princesses.
CATHERINE.
J’ l’ai bien fait pour ça !
LEFEBVRE.
Oh ! bien, ne cherchons plus... Voilà d’où part le coup.
CATHERINE.
Mais, j’ te l’ dis, qu’elles se vengent ! Et qu’elles s’ figurent que c’est déjà fait, c’ divorce !...
LEFEBVRE.
Je crois bien ! L’empereur m’a déjà trouvé une femme.
CATHERINE.
Ma remplaçante ?
LEFEBVRE, riant.
Oui.
CATHERINE.
Oh ! qui ? Dis-moi qui ?
Elle vient s’asseoir près de lui.
LEFEBVRE.
Non, tu lui ferais quelque avanie.
CATHERINE.
Non !... Parole !
LEFEBVRE.
Oh ! je te connais !
CATHERINE.
Mais non, non, j’ lui ferai rien ! Oh ! mon petit Joseph, je t’en prie ! Sois bien mignon ! Dis moi oui ?
LEFEBVRE.
Devine ?
CATHERINE.
Je la connais ?
LEFEBVRE.
Depuis que tu es ici.
CATHERINE.
Jolie ?
LEFEBVRE.
Non ! Oh ! fichtre non ! Et maigre !
CATHERINE, riant.
Un clou !... oh ! c’est bien fait ! Canaille ! Ça t’apprendra !... Mais huppée ?
LEFEBVRE.
Oh ! çà oui ! Princesse !
CATHERINE.
Bigre ! pas Française, alors ?
LEFEBVRE.
Non ! Saxonne !
CATHERINE.
Et maigre ? La Saxe Teschen !
LEFEBVRE.
Juste !
CATHERINE.
C’ manche à gigot !
Elle s’esclaffe.
Ah ! mon pauvre chéri ! Non ! te vois-tu avec c’t échalas su’ l’ cœur, toi qu’aime le rembourré !
LEFEBVRE.
Oui, hein ?
CATHERINE.
Et je vous aurais joué un de ces tours, la nuit de noces !
LEFEBVRE, inquiet.
Ah pas de bêtises ! À présent que je t’ai dit...
CATHERINE, riant.
Je l’aurais prévenue... Au fait, non ! Elle l’aurait ben vu sans moi.
LEFEBVRE.
Quoi ?
CATHERINE, l’imitant gaiement.
Quoi ? quoi ? Quoi qu’y a d’écrit su’ c’ bras-là ?... « Mort aux tyrans. »
LEFEBVRE.
Ah fichtre !
CATHERINE.
Et su l’aut’ ! « Sans-Gêne, pour la vie ! » Hein ! sa tête, à la princesse ! Et la tienne ! Ah ! ah ! mon bonhomme ! Je te tiens là, par les deux bras, et pour la vie
Lui serrant le cou.
entends-tu, misérable !... Pour la vie...
LEFEBVRE, étouffé.
Si tu me l’ôtes !...
CATHERINE, se levant sur place.
Dis qu’ tu l’aimes, ta Sans-Gêne, vite ! ou j’ t’ étrangle !
LEFEBVRE.
Je...
CATHERINE, le lâchant.
Dis qu’ tu l’aimes comm’ la v’là... avec ses mauvaises manières...
LEFEBVRE.
Oh ! pour ça !...
CATHERINE.
Et en corset ! et en jupon !...
LEFEBVRE.
Même sans !
CATHERINE, sautant sur ses genoux.
Assez ! c’est bon ! J’ te pardonne ! J’ t’en ticherai, moi, des princesses !
Elle l’embrasse en lui tenant la tête à deux mains... Jasmin entre, les surprend dans cette attitude, fait un geste, indigné, puis tousse avec affectation en restant sur le seuil.
CATHERINE, debout.
Bigre ! d’ la tenue !
JASMIN, majestueux.
M. le comte de Neipperg demande si madame la duchesse veut bien le recevoir.
CATHERINE.
Lui ? Ah ! j’ crois bien !
JASMIN, sort, révolté.
En camisole !
CATHERINE.
Avec lui, j’ m’ gêne pas.
LEFEBVRE.
À cette heure-ci ! Qu’est-ce qui l’amène ?
Jasmin introduit Neipperg, puis se retire.
Scène VII
CATHERINE, LEFEBVRE, NEIPPERG, en costume de feld-maréchal autrichien
LEFEBVRE.
Entrez, entrez, mon cher Neipperg !
NEIPPERG.
Mon cher maréchal !...
CATHERINE, lui tend la main.
Vous m’excusez ? Entre nous, y a pas d’ cérémonies.
NEIPPERG, en lui baisant la main.
Je sais que je suis chez des amis, et des plus sincères, et c’est pour cela que je viens à cette heure, sans autre avis, vous faire mes adieux.
CATHERINE, à Lefebvre.
Vos adieux ?
NEIPPERG.
Hélas, oui ! Je suis forcé de partir ce soir... dans un instant.
LEFEBVRE, à Catherine.
Forcé ?
NEIPPERG.
Forcé !... Et c’est une des grandes tristesses de mon départ que la perte de cette amitié, dont je m’étais fait la douce habitude. Vous me faisiez une si large place à votre foyer ! J’y étais, pour ainsi dire, en famille. Voici le moment de nous séparer pour toujours.
CATHERINE.
Pour toujours ?
NEIPPERG.
Je ne reviendrai plus en France.
CATHERINE.
Est-ce possible ?
LEFEBVRE.
Et pourquoi ?
NEIPPERG.
M. le duc de Rovigo vient de me signifier, de la part de l’empereur, l’ordre de quitter le château avant la nuit, de franchir la frontière par le plus court chemin, et une fois hors de France, de ne plus y reparaître.
CATHERINE.
Mais pourquoi, enfin ? Pourquoi ?
LEFEBVRE.
Qu’a-t-il a vous reprocher, l’empereur ?
NEIPPERG, assis devant le guéridon avec Lefebvre et Sans-Gêne.
Eh ! mon Dieu ! mes torts sont tout entiers dans ma devise : « Fidèle ! » Depuis que je porte une épée, j’ai toujours été fidèle à mon nom et à mon pays, et, diplomate ou soldat, je n’aurai jamais connu que les amertumes de la défaite. J’étais en face de Bonaparte, au pont d’Arcole, où il a failli tomber entre nos mains. Le jour où a été discutée la paix de Campo-Formio, j’étais encore devant lui avec MM. de Cobentzel et de Saint-Julien, et, je lui ai tenu tête, jusqu’à me faire désavouer par mon gouvernement. Non content de cela, je me suis fait honneur d’être l’ami de l’infortuné duc d’Enghien. Et voilà ce que Napoléon ne me pardonne pas ! Il l’a bien fait voir, à plusieurs reprises. Le jour où fut décidé son mariage avec l’archiduchesse, on lui soumit la liste des officiers qui devaient suivre en France Marie-Louise. Il effaça mon nom, d’un trait de plume rageur et brutal comme un soufflet, et quand il ma revu accompagnant M. de Metternich, il n’a pas caché son dépit du titre officiel qui me donnait accès à la cour. Bref il me hait, et cette haine saisit avec empressement le prétexte que lui fournit sa police, en lui dénonçant certaine intrigue de cœur, que j’ai dans le palais.
CATHERINE.
Ah ! bon !...
NEIPPERG.
Et dont je n’ai rien dit, naturellement.
LEFEBVRE.
Ah ! mon cher comte, vous qui savez l’empereur si sévère sur ces questions-là !
CATHERINE.
Surtout depuis qu’il est remarie.
LEFEBVRE.
Jusqu’à exiler sa sœur Pauline, dont il ne lui a pas suffi d’envoyer le galant en Espagne, cet écervelé de Canouville !
NEIPPERG.
Je ne pensais pas que, pour une étrangère, dont le nom n’a même pas été prononcé...
CATHERINE.
S’il n’ cherche qu’un prétexte !
NEIPPERG.
Encore faudrait-il que celui-là fût plausible !
LEFEBVRE.
Plausible ou non, mon cher comte, vous savez, hélas ! que l’intervention même de M. de Metternich...
NEIPPERG, se lève et tire un portefeuille.
Je ne l’ai pas sollicitée, et je suis bien résigné à mon exil. Voici mon passeport, que je vous prie de viser, mon cher maréchal, puisque c’est vous, m’a-t-on dit, qui commandez aujourd’hui le Palais.
Il lui présente le papier.
LEFEBVRE.
En effet.
NEIPPERG.
Mais tout de suite, je vous en prie ! Les minutes me sont comptées.
LEFEBVRE.
Je vais donc vous timbrer cela chez Ordener, et je reviens.
Il sort.
Scène VIII
CATHERINE, NEIPPERG
CATHERINE.
Voyons ! voyons ! Causons vite tous deux et en bons camarades, voulez-vous ?
NEIPPERG.
Avec vous, toujours.
CATHERINE.
Une simple amourette, vot’ histoire ?
NEIPPERG, se détournant.
Mais oui.
CATHERINE.
N’ mentes pas !... Y a trop de peine dans vos yeux pour que ça soye pas plus sérieux que ça.
NEIPPERG.
Mais...
CATHERINE, vivement.
J’ vous d’mande pas vot’ secret, ni l’ nom d’ la personne. J’ m’en moque... Mais j’ veux pas vous laisser faire une folie, et j’ai idée que vous en mijotez une, et salée.
NEIPPERG.
Quelle folie ?
CATHERINE.
Vous partez ? bien vrai ?
NEIPPERG.
Dans un quart d’heure. Ma berline de voyage est déjà dans la cour.
CATHERINE.
Et vous vous en allez comme ça, tout de go ? Sans tâcher de revoir la personne ? Allons ! je suis une vieille amie, moi, on peut ben tout m’ dire.
NEIPPERG, baissant la voix.
Eh bien, non, je ne pars pas.
CATHERINE.
J’ l’aurais gagé !
NEIPPERG.
Mais ceci de vous a moi, n’est-ce pas ?... Ma confidence ne pourrait qu’embarrasser le maréchal, étant donné ses fonctions officielles. Votre amitié, à vous, est bien indépendante, et ce serait lui faire injure que de ne pas répondre franchement à la question qu’elle me pose.
CATHERINE.
À la bonne heure, donc !
NIEPPERG.
Il ne s’agit pas, vous l’avez deviné, d’une liaison frivole où le cœur n’a rien à voir, mais du triste roman de toute ma vie. Celle dont on me sépare aujourd’hui, pour la seconde fois, je l’ai connue toute enfant, et je ne me souviens pas de l’avoir connue sans l’aimer. Nos familles, dont l’une dominait l’autre de beaucoup, étaient unies de longue date par de mutuels services, et des relations d’affection, de dénouement, de protection, de reconnaissance, qui nous ont bercés de l’espoir que nous étions destinés l’un à l’autre, jusqu’au jour où ce beau rêve a été bien cruellement déçu.
CATHERINE.
Par son mariage avec un autre.
NEIPPERG, accablé.
Oui.
CATHERINE.
Quelle a suivi en France ?
NEIPPERG.
En France !
CATHERINE, se rapproche et, baissant la voix.
Mme de Metternich ?
NEIPPERG, vivement.
Oh ! non ! Quelle idée !
CATHERINE, de même.
Mme d’Esterbszy ? de Rodoweska ?
NEIPPERG, dans un sourire triste.
Vous qui ne vouliez pas savoir le nom !
CATHERINE.
C’est vrai ! Vous avez raison ! Mais j’ serais pas femme, si, en voulant pas qu’ vous l’ disiez, j’ grillais pas d’envie d’ le savoir. En fin, bref ! Vous arrivez à Paris ; on s’ revoit...
NEIPPERG.
Si peu ! et jamais seuls !... On ne la perd pas de vue, et c’est à peine si, depuis un mois, j’ai pu échanger avec elle trois mots rapides, à l’écart !
CATHERINE.
Mâtin ! Il est rien méfiant, le mari !... Et il a ben raison. Toujours est-y que c’est lui qui vous fait donner vot’ congé ?...
NEIPPERG.
Après une explication très vive, cet après-midi, avec elle.
CATHERINE.
Vous savez ça ?
NEIPPERG.
D’elle-même, qui, a l’heure du concert, a pu me dire, toute pâle et frissonnante : « Une scène affreuse à cause de vous... Ne partez pas sans m’avoir vue ! »
CATHERINE, inquiète.
Mais où la voir ?... Chez elle ?
NEIPPERG.
Impossible, à cette heure, du moins ! Non, voilà ce que je vais faire. Je pars, ostensiblement, par la route de Soissons ; à une demi-lieue du château, je quitte ma voiture, qui attend la mon retour ; je reviens à pied par la forêt, le parc, et je rentre au Palais, ou je trouve asile chez une femme à son service depuis des années, et qui lui est toute dévouée.
CATHERINE.
Et vous v’là pris su’ l’ fait, la femme dévouée, vous et elle !
NEIPPERG.
Pourquoi ? Si nous sommes prudents ?
CATHERINE.
Mais vous n’ l’êtes pas, prudents ! C’est fou, c’t’ idée-là !
NEIPPERG.
Puis-je manquer à ce rendez-vous qu’elle me donne ?
CATHERINE.
Un beau v’nez-y voir qu’ vot’ rendez-vous ! Et d’abord, y en a pas, d’ rendez-vous !...
Mouvement de Neipperg.
y en a pas... Elle vous a pas dit d’venir c’te nuit vous promener dans les corridors !... Elle savait que vous partiez, v’là tout ; mais elle a ben pu croire que c’était demain, et qu’ vous pourriez encore vous parler en plein jour, sans danger !... Et puis, quand bien même, qu’elle vous attendrait c’ soir, vaut-y pas mieux qu’elle drogue toute la nuit à croquer le marmot, que d’ vous faire pincer chez elle a c’t’ heure-là ?
NEIPPERG.
Vous parlez, ma chère duchesse, à un homme qui l’adore, et ne la verra peut-être plus de sa vie !
CATHERINE.
J’ parle à un galant homme, qu’a ben l’ droit d’ s’ perdre à cause d’elle, mais qu’a pas l’ droit d’ la perdre à cause de lui !... Je vous en prie, mon ami, n’ faites pas ça ! Ça vous avance à rien ; c’est pas utile, c’est pas raisonnable et c’est pas honnête !... J’ vous jure qu’ c’est pas honnête !...
NEIPPERG, après un moment et comme décidé.
Allons, je vois bien, mon excellente amie, que vous êtes inquiète ?
CATHERINE.
Oui ! Oh ! oui !
NEIPPERG.
Qu’il faut vous rassurer.
CATHERINE.
Oui.
NEIPPERG.
Et vous promettre de renoncer a cette « folie », comme vous dites ?
CATHERINE.
Le promettre et le faire.
NEIPPERG, se lève.
Et le faire !
CATHERINE.
C’est dit ? Allons, c’est dit ?
NEIPPERG.
C’est dit !
CATHERINE.
Vous partez et ne revenez pas ?
NEIPPERG.
Et je ne reviens pas.
CATHERINE.
À la bonne heure ! Ah ! que j’ suis donc contente d’ vous avoir arraché ça ! J’aurais pas fermé l’œil d’ la nuit !
Scène IX
CATHERINE, NEIPPERG, LEFEBVRE reparaît, puis JASMIN
LEFEBVRE.
Voici la chose en règle, mon cher Neipperg. Mais qui m’eût dit que j’aurais le chagrin de vous signer ce papier-là ?
Il lui remet le passeport.
NEIPPERG, en le serrant dans son portefeuille.
Merci, mon cher maréchal !
LEFEBVRE.
Ai-je besoin d’ajouter que nos vœux vous accompagnent, et que nous attendons de vos nouvelles, des votre arrivée à Vienne. Quant aux lettres que vous pourriez écrire aux personnes que vous laissez derrière vous, soyez prudent... Savary a des agents qui s’entendent merveilleusement à rompre et à refaire les cachets.
NEIPPERG.
Je le sais.
JASMIN, au fond.
Monsieur le duc d’Otrante !
CATHERINE.
Fouché ! Motus devant lui !
Scène X
CATHERINE, NEIPPERG, LEFEBVRE, JASMIN, FOUCHÉ
LEFEBVRE.
Mon cher duc !
FOUCHÉ.
Mon cher maréchal ! Duchesse !
CATHERINE, montrant sa toilette.
Vous m’excusez ?
FOUCHÉ, galamment.
C’est moi qui m’excuse de venir à l’improviste... Tiens ! monsieur de Neipperg ? Je vous croyais parti ?
CATHERINE.
Vous savez ?
FOUCHÉ.
Oh ! tout, par habitude.
NEIPPERG, inquiet.
Tout ?
FOUCHÉ.
Mais je n’en dis rien !... Ce qui me distingue de mon successeur, qui ne sait rien, et qui dit tout.
NEIPPERG.
Allons, adieu, mes chers et bons amis...
À Catherine.
Vous permettez ?
CATHERINE, lui tendant ses joues.
Ah ! J’ crois bien !
Neipperg l’embrasse.
LEFEBVRE, ému, lui serrant la main.
Non, pas adieu, mais au revoir.
NEIPPERG.
Ah ! qui sait où et quand nous nous reverrons !
Saluant Fouché.
Monsieur le duc.
FOUCHÉ.
Bon voyage, monsieur le comte...
À lui-même.
et prompt retour !
CATHERINE, essuyant ses yeux.
Pauv’ Neipperg ! qui nous aimait tant ! Il n’ reviendra pas !
FOUCHÉ, gaiement.
Bah ! qui sait ?... Tout arrive, depuis 89 ! Témoins nous-mêmes. Je ne vous revois jamais, madame la maréchale, sans me rappeler votre prédiction : « Vous serez ministre, quand je serai duchesse ! » Vous êtes duchesse, et je ne suis plus ministre, mais je le redeviendrai !
À part.
Je ne suis même ici que pour cela.
LEFEBVRE, revenu à Catherine.
Allons, madame, l’heure presse ! Vite donc, cette toilette !
FOUCHÉ.
Et je vous annonce Leurs Altesses Impériales !
LEFEBVRE.
Vous entendez ?
CATHERINE.
Ah ! celles-là !... J’ai ben l’ cœur à leur faire risette !
LEFEBVRE.
Je vous en prie, ma chère, hâtez-vous !
Il la conduit à sa porte.
CATHERINE.
Ah ! En v’là encore un’ chienn’ de corvée !
Elle sort. Lefebvre reprend ses gants et commence à les mettre, Jasmin est sorti.
Scène XI
FOUCHÉ, LEFEBVRE
FOUCHÉ.
Le mot est brutal, mais il est juste. Et, si j’ai devancé l’heure, c’est pour aviser de certain petit complot...
LEFEBVRE.
Contre ?
FOUCHÉ.
La duchesse ! Les sœurs de Sa Majesté l’ont prise en grippe et ont jure de lui faire payer cette épigramme...
LEFEBVRE.
Les chemises ?
FOUCHÉ.
Oui. Elles ne viennent, ce soir, que dans le but de la harceler de railleries, la pousser à bout et lui arracher quelque boutade qui, faisant scandale, hâte son départ de la cour. Que la maréchale se méfie surtout de certaine anecdote que l’on se propose de lui faire conter, ce frotteur qui lui avait volé un diamant, et qu’elle a fait fouiller, dans le costume du Gladiateur.
LEFEBVRE.
Merci. J’y veillerai. Mais, croyez-vous que, chez moi, devant moi, elles osent ?...
FOUCHÉ, assis devant le guéridon.
Elles oseront tout, sûres de ne pas être désavouées par l’empereur qui ne vise que votre divorce...
LEFEBVRE, assis de même à gauche de Fouché.
Dont il m’a assez entretenu.
FOUCHÉ.
Ce soir, à sa table. Que voulez-vous, mon cher Lefebvre, c’est la manie du grand homme de marier et démarier les gens sans leur aveu. N’a-t-il pas, dans sa propre famille, cassé, par décret, le manage de Jérôme et de mis Paterson, et tout mis en œuvre pour faire divorcer Lucien ? Uni, de force, Pauline et Leclerc, Hortense et Louis, mariés Berthier, Davoust, Lavalette, à leur corps défendant, et tenté d’en faire autant à Caulaincourt, Cambacérès et Duroc, contraint Rapp et Lannes à répudier leurs femmes, Talleyrand à épouser cette bécasse de Mme grand et, enfin, divorcé lui-même, pour en donner l’exemple, en prenant une seconde femme, qui ne vaut pas la première.
LEFEBVRE.
Et certes, malgré vous, cher ami, qui étiez fort opposé à ce mariage autrichien.
FOUCHÉ, tirant sa tabatière.
C’est bien ce qui m’a valu ma destitution, la nouvelle impératrice ne me pardonnant pas cette résistance.
LEFEBVRE.
Ce qui me passe, c’est que vous sachiez si bien ce que l’empereur m’a dit à cette table, où il n’y avait que Sa Majesté et moi.
FOUCHÉ.
C’est bien assez ! Le Palais fourmille d’observateurs.
LEFEBVRE.
Même chez l’empereur ?
FOUCHÉ.
Partout.
LEFEBVRE.
Du moins pas chez moi.
FOUCHÉ.
Candeur ! Il y en aura deux, au moins, tout à l’heure, l’un dans l’antichambre, l’autre, dans ce salon.
LEFEBVRE.
Vous les connaissez ?
FOUCHÉ.
Ah ! de longue date !
LEFEBVRE.
Désignez-les-moi, je vous prie, que je les chasse à coups de trique !
FOUCHÉ.
Fi donc ! Et le secret professionnel ?
LEFEBVRE, souriant.
Mais alors, Savary sait tout ? et notamment, qu’en échange du ministère qu’il vous a pris, vous usurpez le sien chez la belle Mme Savary ?
FOUCHÉ.
Eh bien, cher ami, jugez l’homme : il n’en sait pas un traître mot !
LEFEBVRE.
Mais alors, ses agents ?
FOUCHÉ.
Ils sont tous à moi !
LEFEBVRE.
Vous m’en direz tant !
Les portes ouvertes, on voit paraître les premiers visiteurs.
FOUCHÉ, debout.
Voici votre monde !
LEFEBVRE, de même.
Déjà ! Et la maréchale qui n’est pas encore là !
Scène XII
FOUCHÉ, LEFEBVRE, CANOUVILLE, en hussard, UN PRÉFET DU PALAIS, UN OFFICIER DE GUIDES, LE CHEVALIER CORSO, puis successivement et sans arrêt, par groupes ou isolés, ROVIGO, JUNOT, DUROC, FONTANES, en sénateur, ARNAULT et RAYNOUARD, en membres de l’Institut, MESDAMES DE ROVIGO, DE BASSANO, DE BELLUNE, DE MORTEMART, DE VINTIMILLE, DE TALHOUËT, DE BRIGNOLLES, D’ALDOBRANDINI, DE CANISY, etc., en grande toilette de gala
Tout le monde entre par le fond, va, vient, reçu par Lefebvre, se saluant, se groupant, se déplaçant, assis, debout, et pendant toute la scène, c’est un bourdonnement confus de conversations particulières et de rires étouffés.
LEFEBVRE, allant à Canouville, qui entre le premier.
Ah ! Canouville ! la bonne surprise !... Ravi de vous voir.
CANOUVILLE.
Monsieur le maréchal est trop bon ! Monsieur le duc !
FOUCHÉ.
On vous disait en Espagne ?
CANOUVILLE.
J’en viens !
Lefebvre va au-devant des arrivants et ne fait plus que cela, se multipliant pour les recevoir. Canouville reste seul avec Fouché.
M’étant proposé comme courrier, pour apprendre au débotté..
FOUCHÉ.
Que la princesse Borghèse est à Guastalla, par ordre impérial.
CANOUVILLE.
Et j’ai fait trois cent cinquante lieues à franc étrier pour la voir !... Ayez la bonté, monsieur le duc, de me renseigner, en deux mots, pour m’épargner quelque maladresse ; la reine de Naples, c’est toujours Junot, n’est-ce pas ?
FOUCHÉ.
Toujours ! Et la princesse Bacciochi, c’est présentement M. de Fontanes.
CANOUVILLE.
Le grand-maître...
FOUCHÉ.
...De l’Université.
CANOUVILLE.
Pauvre Élisa ! doit-elle en avaler des discours !
Il remonte vers les arrivants qui lui serrent la main.
FOUCHÉ, amenant à Lefebvre le chevalier Corso.
Mon cher duc, le chevalier Corso, qui désire vous être présenté.
LEFEBVRE, au passage.
Enchanté !
CORSO, avec un bel accent italien.
Eccellenza !
Lefebvre les laisse seuls.
FOUCHÉ, à mi-voix.
Eh bien ? Neipperg ?
CORSO, bas, sans le moindre accent.
Il est parti.
FOUCHÉ, à mi-voix.
Surveillez le retour.
CORSO, de même.
Oui, monsieur le duc.
Il s’incline et va se mêler aux groupes.
JUNOT.
Tiens ! duc, vous revoilà ?
FOUCHÉ, en lui serrant la main.
Eh oui ! Madame la duchesse d’Abrantès ?
JUNOT.
Chez l’impératrice.
FOUCHÉ, lui prend le bras.
Un conseil ! Votre voiture stationne bien souvent à la porte de la reine de Naples. Adoptez-donc une livrée amarante, comme la sienne : on croira, de loin, que c’est sa voiture qui l’attend, et l’on jasera moins.
JUNOT.
Parbleu, oui ! Merci.
Ils se séparent : le flot des visiteurs ne s’interrompt plus.
LEFEBVRE, effaré.
Et la duchesse qui ne vient pas !... Jasmin, faites donc dire à la duchesse qu’elle se hâte ! Tout le monde vient. Leurs Altesses seront ici avant elle !
JASMIN.
Oui, monsieur le duc.
Il sort.
LEFEBVRE, se hâte au-devant du duc de Rovigo, qui paraît avec la duchesse.
Ah ! Savary !
Saluant.
Duchesse !
MADAME SAVARY.
Nous sommes en avance, a ce que je vois ?...
LEFEBVRE, embarrassé.
En effet, la maréchale...
SAVARY.
Moins pourtant que M. le duc d’Otrante.
Pendant que Lefebvre remonte, Fouché se retourne et salue.
FOUCHÉ.
Oh ! moi, affaire d’habitude. Je vous ai toujours devancé. On se précède...
En baisant la main de Mme Savary.
On se succède ! C’est la vie !
DUROC, qui fait groupe avec Canouville et d’autres officiers.
Eh bien ? Canouville, êtes-vous réconcilié avec l’Espagne ?
CANOUVILLE.
Oh ! pas du tout, monsieur le maréchal ! Des femmes qui ne vous donnent pas un baiser sans allumer des cierges à tous les saints ! Figurez-vous...
Il continue à voix basse, au milieu des rires.
MADAME DE CANISY, frappant de son éventail l’épaule de Fouché.
Enfin, vous voilà, vous...
À mi-voix.
Et mes lettres ?
FOUCHÉ, de même.
Je les ai...
MADAME DE CANISY.
Toutes ?
FOUCHÉ.
Toutes.
MADAME DE CANISY.
Vous êtes un ange !
FOUCHÉ.
À demain.
Elle remonte.
RAYNOUARD.
Arnault ?
Arnault et Fontanes vont le rejoindre, à la cheminée.
MADAME DE VINTIMILLE, en tendant la main à Fouché.
Bonjour, vous !
FOUCHÉ.
Ah ! Charmé de vous voir !
Confidentiellement.
Méfiez-vous, vous êtes surveillée, soir et matin !
MADAME DE VINTIMILLE, hautaine.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire !
FOUCHÉ, du même ton, en prenant une prise.
Allée des Veuves !
MADAME DE VINTIMILLE, saisie.
Oh !
FOUCHÉ.
Numéro douze !
MADAME DE VINTIMILLE.
Oh ! bien ! bien ! merci ! merci !
Elle s’éloigne.
FOUCHÉ, à Lefebvre.
Eh bien, la duchesse ?
LEFEBVRE.
Ne m’en parlez pas ! Elle me rend fou !
L’attirant à l’écart.
Dites donc, l’observateur de Savary ? Celui du salon ?...
FOUCHÉ.
Oui.
LEFEBVRE.
Ce ne serait pas ce méridional, là, qui grimace et gesticule derrière nous ?
FOUCHÉ, riant.
Oh ! non ! Il n’a jamais rien observé, celui-là.
LEFEBVRE.
Non ?
FOUCHÉ.
Mais non, voyons ! C’est Raynouard, l’auteur des Templiers.
SAVARY, dans un groupe de femmes.
...Il n’avait pas mieux à faire que de partir sur-le-champ.
MADAME DE TALHOUËT.
C’est de M. de Neipperg que vous parlez ?
SAVARY.
Oui, comtesse.
MADAME DE BASSANO.
Sait-on la cause de ce départ ?
SAVARY, important.
Oh ! très grave !
Sur quoi, il va rejoindre Junot.
FOUCHÉ, assez haut.
Mais il serait bien embarrassé de la dire.
MADAME DE MORTEMART, se levant.
Et vous la savez, vous, qui savez tout !
FOUCHÉ, vient à elle.
J’en ai peur !
MADAME DE BRIGNOLLES.
Oh ! dites-nous-la, alors.
TOUTES l’entourent.
Dites ! Dites !
FOUCHÉ.
Me permettez-vous de l’oublier, dès que je l’aurait dit ?
TOUTES.
Ah ! oui, oui !
FOUCHÉ.
Bien sûr ?
MADAME D’ALDOBRANDINI.
C’est juré !
FOUCHÉ, de même, gracieusement.
Eh bien, prenez que je l’ai dit, et que vous l’avez oublié : ça revient au même !
Il les salue et s’éloigne, les laissant toutes déconcertées.
MADAME DE MORTEMART.
Il se moque de nous !
MADAME DE BASSANO, se levant.
Ce Fouché est odieux !
JASMIN, annonce, du fond.
Sa Majesté la reine de Naples !
Toutes les personnes assises se lèvent, ligne étincelante de jupes et d’uniformes.
Scène XIII
FOUCHÉ, LEFEBVRE, CANOUVILLE, UN PRÉFET DU PALAIS, UN OFFICIER DE GUIDES, LE CHEVALIER CORSO, ROVIGO, JUNOT, DUROC, FONTANES, ARNAULT, RAYNOUARD, MESDAMES DE ROVIGO, DE BASSANO, DE BELLUNE, DE MORTEMART, DE VINTIMILLE, DE TALHOUËT, DE BRIGNOLLES, D’ALDOBRANDINI, DE CANISY, etc., CAROLINE paraît, blonde, visage éblouissant de fraîcheur, TROIS CHEVALIERS D’HONNEUR l’escortent, puis ÉLISA
L’HUISSIER.
Son Altesse Impériale la princesse de Lucques et de Piombino !
Élisa paraît à son tour, très brune. Lefebvre se précipite au-devant d’elles et les précède à reculons.
CAROLINE.
Je ne vois pas la duchesse de Dantzig, monsieur le maréchal ?
LEFEBVRE.
Que Votre Majesté daigne excuser la duchesse, un peu souffrante.
CAROLINE, aigre-douce.
Ah ! vraiment !
LEFEBVRE, pour les deux princesses.
Mais ce n’est qu’un étourdissement ; dans un instant, elle vous suppliera d’agréer ses humbles excuses.
CAROLINE, bas, à sa sœur.
Comment trouvez-vous cette duchesse subite, qui ne sait pas que son premier devoir est d’être là pour nous recevoir ?
ÉLISA.
Si nous nous retirions ?
CAROLINE.
Au contraire ! Première impertinence. Nous les additionnerons !
Elles s’avancent, à travers les saluts empressés.
Scène XIV
FOUCHÉ, LEFEBVRE, CANOUVILLE, UN PRÉFET DU PALAIS, UN OFFICIER DE GUIDES, LE CHEVALIER CORSO, ROVIGO, JUNOT, DUROC, FONTANES, ARNAULT, RAYNOUARD, MESDAMES DE ROVIGO, DE BASSANO, DE BELLUNE, DE MORTEMART, DE VINTIMILLE, DE TALHOUËT, DE BRIGNOLLES, D’ALDOBRANDINI, DE CANISY, etc., CAROLINE, TROIS CHEVALIERS D’HONNEUR, ÉLISA, CATHERINE arrive, à grand pas, en toilette de cours, et se trouve en face de Lefebvre qui, dans son impatience, a ouvert la porte, et la guette
LEFEBVRE, à mi-voix.
Crédié, va ! Tu serais venue trois minutes plus tôt...
CATHERINE, de même.
Eh ! ne m’en parle pas ! Ma sacrée robe qui s’était décousue dans le dos !...
LEFEBVRE, bas, en lui prenant la main.
Excuse-toi, et pèse tous tes mots !
CATHERINE.
Oh ! Pardi, les drogues !... Elles n’ sont là qu’ pour m’attraper !
Elle se dirige, avec lui, vers les princesses, qui lui tournent le dos, et affectant de ne pas la voir venir.
LEFEBVRE.
Majesté ! Madame la maréchale !
Mouvement. Caroline et Élisa se retournent. Catherine fait sa révérence, très bien. Toutes les dames, sauf les princesses, lui rendent sa révérence ; les hommes la saluent.
CAROLINE, toujours acide.
Vous vous faites bien désirer, duchesse.
CATHERINE, en passant devant Lefebvre.
J’ prie Sa Majesté, Son Altesse Impériale, et la compagnie, d’ vouloir bien m’excuser, rapport au retard, mais l’ temps de m’ mettre su’ mon trente et un !...
Un petit frisson de rire court.
J’ peux dire que j’me faisais un sang de canard...
Les éventails s’agitent. Catherine, impressionnée, s’évente aussi, et, croyant prendre des airs de cour.
Mais, vous v’là tous, les bras ballants ?... À quoi pense l’ maréchal de n’ pas offrir à ces dames d’ quoi se rafraîchir ?
Appelant de loin le maître d’hôtel.
Eh ! Pivert !
Elle remonte pour lui donner des ordres. Tout le groupe qui entoure les princesses s’est mis à commenter les réponses de Catherine.
ARNAULT, pincé.
Une tournée ?
FONTANES, de même.
Sur le comptoir.
MADAME DE BRIGNOLLES, à Élisa.
Ah ! princesse, où sommes-nous ?
MADAME DE CANISY, à Duroc.
Elle est stupéfiante.
DUROC, sérieux.
Mais si bonne, si brave et si digne femme !
Le papotage continue, voix éteintes, rires étouffés. Des laquais en grande livrée commencent à circuler avec des plateaux. Jasmin a déposé sur le guéridon un service à thé luxueux.
CATHERINE, bas, à Fouché.
Quoi qu’elles ont à ricaner derrière leurs jalousies ? Mon corsage a craqué ?
FOUCHÉ.
Non, non !
CATHERINE, troublée.
J’ai dit quelque bêtise ?
FOUCHÉ.
Aucune.
CATHERINE.
J’ sais qu’elles m’ guettent ! N’en faut pas plus pour qu’ j’ barbote.
FOUCHÉ.
Ne me perdez pas de vue, et, si je prise, casse-cou !
CATHERINE.
C’est ça !
FOUCHÉ, bas.
Pauvre femme ! Elle en est touchante !
CATHERINE, à Caroline, très aimablement.
Votre Majesté prendra bien une tasse de thé ?
CAROLINE.
Non, merci.
CATHERINE, à Élisa.
Et Son Altesse ?
ÉLISA.
Merci.
CATHERINE.
Ma foi, j’ suis ben comme vous, c’t’ eau chaude ! Alors quéque chose d’ plus relevé ? Du vin chaud à la cannelle ?
LEFEBVRE, à mi-voix.
N’insiste pas !
CATHERINE, de même.
Faut ben leur faire voir qu’on a de l’usage !
LEFEBVRE.
N’insiste pas, je te dis !
CATHERINE, en se retournant, se trouve en face de Canouville qui prend sur un plateau un verre de punch.
Ah ! Canouville ! te v’là de retour !
MADAME SAVARY, bas à Mme de Talhouët.
Elle le tutoie !
Les ricanements recommencent.
CANOUVILLE, très respectueux.
Et ma première visite est pour vous, madame la maréchale.
CATHERINE, lui serre la main.
C’est gentil ça !
Elle prend un verre qu’elle choque contre celui de Canouville.
À la tienne !
MADAME DE BASSANO, bas.
Et elle trinque.
MADAME DE TALHOUËT, de même.
C’est complet.
Fouché, au moment ou Catherine allongeait le bras, avait heurté sa tabatière. Il était déjà trop tard ; Catherine le voit priser et, intimidée, sans comprendre, repose le verre sur le plateau.
ÉLISA, bas à Caroline.
Si l’on pouvait lui faire conter l’histoire du frotteur ?...
TOUTES, d’un même chuchotement.
Ah ! oui, oui !
CAROLINE.
Essayons.
Appelant.
Duchesse ?
CATHERINE, se retourne, empressée.
Majesté ?
Et elle se prend les pieds dans la traîne de son manteau.
Su’ quoi qu’ j’ marche ?
Elle essaye de se dépêtrer, mais s’entortille encore davantage, à la grande joie de ces dames.
MADAME DE ROVIGO, qui pouffe.
Oh ! regardez-la !
CATHERINE.
Je demande pardon a Vot’ Majesté ! C’est c’t’ gredine de queue !... Tant qu’ j’ m’ déroule.
Bas à Canouville qui l’aide à se dégager.
Elles s’ fichent d’ moi !
CANOUVILLE, de même.
Quelle idée !
CATHERINE.
Avec ça !
Libre enfin, elle se dirige vers Caroline.
Me voilà, Majesté.
CAROLINE.
Je désirerais voir de plus près ce diamant, qui jette un feu ! Voyez donc, mesdames, quel éclat !
Elle indique la broche de Catherine, dont l’aspect provoque des murmures d’admiration.
CATHERINE.
C’est un cadeau de Lefebvre !
Pendant que le groupe s’extasie : « Ah vraiment ? très joli ! » Lefebvre va rejoindre Fouché, qui tire sa tabatière.
CAROLINE.
Serait-ce celui qui vous avait été volé ?...
LEFEBVRE, effrayé.
Oh ! là là !
CATHERINE.
Par un frotteur !... Et figurez-vous qu’il m’a fallu... lui faire ôter sa veste...
Apercevant Fouché qui prise, elle s’arrête court.
Mais c’est pas à dire en société...
Grosse déception.
ÉLISA, bas.
Quel dommage !
MADAME DE ROVIGO.
Elle était lancée !
LEFEBVRE, à Fouché.
Ouf ! J’ai eu moins chaud à Dantzig en entrant le premier par la brèche.
CATHERINE, présente à Caroline une assiette de gâteaux.
Vot’ Majesté veut-elle goûter à ces petites lichettes ?
CAROLINE, sur des rires.
Non, merci. Les Luchettes ne me disent rien.
CATHERINE, à Élisa.
Et Vot’ Altesse ?
ÉLISA.
Ni à moi.
Catherine, vexée, reste en plan, son assiette à la main.
CAROLINE, avec un faux air d ‘approbation.
Ne trouvez-vous pas, mesdames, que la maréchale a des façons de s’exprimer très originales ?
TOUTES.
Oui ! oh ! oui !
CAROLINE.
Ainsi lichette est d’une saveur très piquante.
Catherine a froncé le sourcil.
ÉLISA.
Cela fait image !
CATHERINE, bas à Fouché.
Quand je dis qu’elles s’ fich’nt de moi !
FOUCHÉ, qui cherche à la calmer.
Mais non !
CATHERINE, à mi-voix.
Faut pas qu’elles m’asticotent ou j’ griffe !
CAROLINE, s’adressant à Fontanes, Arnault et Raynouard.
Ces messieurs de l’Académie devraient bien noter au vol ces locutions naïves, empruntées au vocabulaire du bas peuple.
CATHERINE, agacée, a un petit hennissement.
Tu entends ça !... Hou ou ou ou !...
LEFEBVRE, bas.
Du calme !
CAROLINE, toujours gracieuse.
...Et qui ne sont guère en usage que chez les harengères, ou ces demoiselles du Palais-Royal...
CATHERINE, dont les narines frémissent.
Oh ! mais ! oh ! mais ! Ça sent la poudre !
CAROLINE.
N’est-ce pas d’ailleurs dans ce quartier-là, duchesse, – un beau trait, mesdames, que vous ignorez peut-être, – que, le 10 août, vous avez sauvé M. de Neipperg en le cachant, la nuit, dans votre lit ?
Rire étouffé. Lefebvre, impatient, fait un mouvement.
CATHERINE.
N’ bouge pas ! Ça m’ regarde !
Avec le plus grand calme.
Vot’ Majesté veut dire que j’ l’ai recueilli, blessé, en plein jour et dans ma chambre. L’hospitalité du lit, j’ laisse ça à d’ plus grandes que moi, qui n’y reçoivent qu’ les gens bien portants.
LEFEBVRE, à mi-voix.
Bien !
CATHERINE, qui s’évente.
Attrape !
FOUCHÉ.
Trop tard !
Il laisse tomber sa prise.
CAROLINE.
M. de Neipperg était donc bien avisé, ce jour-là, de se réfugier dans...
CATHERINE, qui la devance, souriant.
Dans ma boutique, oui, Majesté.
Le mot court, répété par toutes les jolies bouches.
ÉLISA, agressive.
Car, en ce temps-la, n’est-ce pas ? vous étiez...
CATHERINE, de même.
Blanchisseuse, oui, princesse...
Exclamations : « Est-ce possible ? En vérité ! Blanchisseuse !... » Elle continue.
Et j’ m’en cache pas, vous voyez ! Y a pas d’ sot métier, y a que de sottes gens ! Qu’ si j’ parle l’ jargon du peuple, c’est qu’ j’en suis, du peuple, et en belle compagnie, j’ peux l’ dire, avec Masséna, qu’était marchand d’huile ; Bessières, qu’était perruquier ; Nay, tonnelier ; Lannes, teinturier ; Brune, typographe, et l’ brave Murat, présentement votre époux, qu’était valet chez son père, aubergiste, si bien que d’ ceux qui l’appellent aujourd’hui Majesté, quelques-uns ont pu lui crier autrefois :
En frappant la table.
« Eh ! garçon ! change donc mon assette ! »
CAROLINE.
Vous avez l’audace ?
CATHERINE.
Eh ! ya pas de honte à ça ! Au contraire. C’est ben leu’ mérite, qu’y soient partis d’ si bas pour monter si haut, par la seule force d’ leu’ vaillantise et des services rendus à la patrie !... Y z’ont ben d’ quoi s’ glorifier d’et’ les fils d’ la Révolution, qui, de rien qu’y z’étaient, les a faits c’qu’ y sont ! Et, dans c’ palais où nous v’là, grâce à elle, ceux qui y doivent tout et qu’ont le mauvais cœur d’en rougir, sont ben ingrats d’oublier leur passe et ben lâches de renier leur mère !
Les officiers ont un murmure d’approbation. Pâles, les princesses se lèvent.
FOUCHÉ, à mi-voix.
Casse-cou !
CATHERINE, de même.
R’misez vot’ tabac ! J’ les tiens ! J’ les lâche plus !
CAROLINE, exaspérée.
Sana oublier son passé, il faudrait du moins en oublier les allures, et ne pas être duchesse avec un langage de poissarde, et maréchale de France avec des façons de vivandière !
CATHERINE, qui se monte.
Qu’ j’ai été aussi !... sauf vot’ respect !
CAROLINE, au groupe.
L’éducation de la boutique s’est complétée par celle du corps de garde.
Sourires.
ÉLISA, de même.
De la cantine, où l’on trinque avec les troupiers.
Approbation.
CAROLINE.
...Et du bivouac où l’on couche au milieu d’eux, sur la paille.
Les rires s’accentuent.
CATHERINE.
Et encore, quand y en a ! Mais c’est ben à Vos Altesses à m’ reprocher c’te vie-là !
CAROLINE.
Vous dites ?
CATHERINE.
J’ dis, et ben haut, qu’ j’ai dormi su’ la dure avec ces troupier-là, pus respectueux qu’ Vot’ Majesté pour la femme que je suis et l’ nom que j’ porte ! Que j’ai roulé du Rhin au Danube, sous la pluie, la neige et els balles, ramassant les blessés, consolant les mourants, fermant les yeux aux morts ! Et, rien qu’en versant la goutte à nos soldats, qui vous gagnaient un royaume, moi, simple vivandière, j’ai pus fait pour vot’ couronne, qu’ vous-même qui n’avez eu qu’ la peine d’ la ramasser dans leur sang !
CAROLINE, la voix sifflante.
Un mot de trop ! Et que vous regretterez, duchesse !
CATHERINE.
Pas plus qu’ les autres.
CAROLINE.
Nous verrons bien !... Sortons, mesdames ! On se croirait au carreau des Halles !...
Elle remonte vivement, entraînant sa sœur et toutes les dames qui, chuchotantes, s’éloignent sans plus s’occuper de Catherine. Duroc, Junot, Canouville, trois ou quatre officiers entourent Catherine et, à mi-voix, rapidement, la félicitent, puis s’esquivent.
DUROC.
Bravo ! Maréchale !
JUNOT.
Très bien !
CANOUVILLE.
Vivat !
LEFEBVRE.
Tiens ! que je t’embrasse !
CATHERINE.
Tans pis ! J’en avais trop su’ l’ cœur !
FOUCHÉ.
Mais cela peut vous coûter cher !
CATHERINE.
Putt ! Arrive qui plante ! Elles ont leur paquet !
Quelques officiers s’attardent au fond, commentant qe qui vient de se passer.
Scène XV
CATHERINE, LEFEBVRE, FOUCHÉ, JASMIN, DE BRIGODE, LE CHEVALIER
JASMIN, annonçant.
Monsieur de Brigode, chambellan de Sa Majesté !
CATHERINE.
Nous y v’là !
Lefebvre monte au-devant de lui.
CORSO, reparu, s’approche de Fouché.
M. de Neipperg vient de rentrer au palais en secret, et, dans ce moment il est chez Mme de Bulow.
FOUCHÉ.
Bien ! Allez !
DE BRIGODE, après un salut échangé avec Lefebvre.
Monsieur le maréchal, au nom de l’empereur, j’invite madame la duchesse de Dantzig
Il la salue profondément.
à vouloir bien se rendre sur-le-champ chez Sa Majesté.
CATHERINE.
L’ temps d’ prendre un’ pelisse et j’y vas !
Brigode s’incline et remonte au fond, ou il salue Duroc, et Junot, puis disparaît.
LEFEBVRE, à Catherine.
Elles auront tout dit à l’empereur avant ton arrivée.
FOUCHÉ.
Et, comme, il est déjà de méchante humeur...
CATHERINE.
À cause ?
FOUCHÉ.
D’une scène très vive, cet après-midi, chez l’impératrice.
CATHERINE, saisie, s’arrête court.
Ah ?
FOUCHÉ.
Celle-ci en était encore toute frémissante au moment du concert.
CATHERINE, à elle-même.
Bon Dieu ! Cette femme de Neipperg, ce serait elle ?...
À Lefebvre.
Neipperg est parti, n’est-ce pas ?
LEFEBVRE.
Depuis longtemps. Pourquoi ?
CATHERINE.
Pour rien !
À Fouché.
Bonne nuit, monsieur le duc !
FOUCHÉ, s’inclinant de loin.
Mille grâces !...
À lui-même.
Mais je crois que, cette nuit, nous ne dormirons guère.
ACTE II
Le cabinet de l’empereur.
Tentures violettes semées d’abeilles et d’N couronnés. Meubles d’acajou à cuivres dorés. À droite, devant la cheminée, ou flambe un beau feu, la table de travail à pieds de bronze surchargée de papiers et de journaux. À gauche, un canapé à dossier haut et un guéridon. Des fauteuils de des X. La porte du premier plan de gauche mène aux appartements, la porte double du deuxième plan à la chambre de l’empereur. Entre ces deux portes, un bureau-secrétaire à cylindre fermé. Au fond, entre deux bibliothèques, une large porte double ouvre sur un grand corridor, éclairé par des lampes qui sont hors de vue ; au delà, dans la même axe, la porte de la chambre de l’impératrice. À droite, au delà de la cheminée, la porte double ouvre sur la salle des gardes occupée par les officiers. Sur la table, un grand flambeau à quatre bougies, avec abat-jour de métal, éclaire des plans étalés, deux encriers, un grand et un petit, un bouquet de violettes, le pupitre de l’empereur, une tasse avec un sucrier. L’épée est sur la cheminée. Une grande lampe allumée sur le guéridon.
Scène première
L’EMPEREUR, SAVARY, CONSTANT, SAINT-MARSAN, ROUSTAN, LAURISTON, MORTEMART, puis M. DE BRIGODE
L’empereur, en uniforme de chasseur et bas de soie, assis à sa table, parcourt les journaux ; Constant, son valet de chambre, se tient derrière lui. Roustan, le mameluck, à gauche, devant la porte du second plan. Mortemart, Lauriston et Saint-Marsan, en grand uniforme, immobiles au-dessus du canapé.
L’EMPEREUR.
Quelle heure, Constant ?
CONSTANT.
Onze heures, sire.
Un silence.
L’EMPEREUR.
Du café.
Constant va à la porte de droite et disparaît un instant.
L’EMPEREUR, à Saint-Marsan.
Voyons votre rapport, capitaine.
Saint-Marsan, la main au schako, le lui remet. L’empereur le parcourt, puis.
Les officiers qui sont de service, avec vous, cette nuit ?
SAINT-MARSAN.
Sire, MM. de Mortemart et Lauriston !
Savary paraît.
L’EMPEREUR.
Ah ! Rovigo.
À mi-voix.
Eh bien ?
Savary s’approche.
M. de Neipperg est parti ?
SAVARY.
Je puis garantir à Votre Majesté que M. de Neipperg, qui est déjà loin de Compiègne, sera demain hors de France.
L’EMPEREUR.
Bien !...
Il se remet à priser, lentement. Savary va s’éloigner.
Attendez ! Pourquoi n’ai-je pas ici le dernier numéro du Times et de la Gazette de Leyde ?
SAVARY.
Des pamphlets, sire. D’indignes pamphlets.
L’EMPEREUR.
Pamphlets ou non, je vous ai dit, une fois pour toutes, que je voulais tout lire ! Où sont ces journaux ?
SAVARY.
Les voilà, sire.
Il les tire de sa poche et les dépose sur la table.
Les articles calomnieux sont marqués au crayon rouge !
M. de Brigode entre.
L’EMPEREUR.
Ah ! monsieur de Brigode, vous avez prévenu la duchesse de Dantzig ?
Tout en parlant, il ouvre les journaux.
DE BRIGODE.
Oui, sire.
L’EMPEREUR, qui lit rapidement.
Parler ainsi de mes sœurs !... Le drôle ! – Les ordres ont été donnés pour la chasse de demain ?
DE BRIGODE.
Oui, sire !
L’EMPEREUR, en écrivant.
J’entends être de retour au palais à midi.
DE BRIGODE.
Alors, sire, il faudra partir à huit heures, au plus tard.
L’EMPEREUR.
Nous partirons, – écoute ceci, Roustan, – à sept heures et demie. Ces dames en seront quittes pour se lever de bonne heure. Aussi bien, l’impératrice est très matinale. Constant !
CONSTANT.
Sire !...
L’EMPEREUR.
Il y à la, dans l’antichambre,
Il montre la droite.
avec ces messieurs, un brigadier des écuries ?
CONSTANT.
Oui, sire.
L’EMPEREUR, à Brigode, qui remonte au corridor.
Vous le préviendrez en passant. La réception de l’impératrice n’a pas pris fin ?
DE BRIGODE.
Elle s’achève, sire ; ces dames prennent congé.
En effet, au-delà du corridor, dont il a ouvert la porte, apparaît la chambre de Marie-Louise, toute de bien tendue, et d’où sortent, venant chez l’empereur, les princesses, avec un groupe de dames de la cour.
L’EMPEREUR, qui s’est levé.
Je vais les avertir et dire bonsoir à l’impératrice.
Toutes se rangent, saluent, faisant à l’empereur une haie de révérences.
Scène II
SAVARY, CONSTANT, SAINT-MARSAN, ROUSTAN, LAURISTON, MORTEMART, DE BRIGODE, CAROLINE, ÉLISA, DAMES DE LA COUR
L’EMPEREUR, la voix brève.
Attendes-moi, mesdames, je vous prie.
M. de Brigode annonce : « L’empereur ! » L’empereur entre chez l’impératrice dont, par la porte entr’ouverte, on aperçoit le lit. Roustan se tient toujours immobile devant la porte du deuxième plan de gauche. Sitôt l’empereur chez Marie-Louise, des chuchotements commencent.
CAROLINE, à Élisa.
Oh ! oh ! l’empereur est bien irrité ! Est-ce qu’il saurait déjà l’audace de cette créature ?
À Mme de Rovigo.
Duchesse !
MADAME DE ROVIGO.
Majesté ?
CAROLINE.
Le duc de Rovigo est ici ?
MADAME DE ROVIGO.
Oui Majesté. Duc ?
ÉLISA, à Savary.
Duc !
SAVARY s’approche.
Princesse ?
ÉLISA, assise devant la table de l’empereur.
Vous avez dit à sa Majesté ce qui s’est passé chez la duchesse de Dantzig ?
SAVARY.
Non, princesse, je n’en ai pas eu le temps.
CAROLINE.
D’ou vient donc que l’empereur gronde comme il fait ?
SAVARY.
Je l’ignore.
CAROLINE.
Madame de Bulow ?
MADAME DE BULOW, fait un pas.
Majesté ?
CAROLINE.
Savez-vous pourquoi l’empereur est de si méchante humeur ?
MADAME DE BULOW.
Ce que je peux dire à Votre Majesté, c’est que l’empereur est ainsi depuis ce matin.
CAROLINE.
Que sera-ce quand l’impératrice lui aura appris l’offense qui vient de nous être faite !
DE BRIGODE.
Votre Majesté sait-elle que l’empereur a fait appeler la duchesse de Dantzig ?
CAROLINE.
Ah !
DE BRIGODE.
Après une conversation assez longue avec le maréchal.
CAROLINE.
Le maréchal est commandant du Palais ; peut-être ne s’agissait-il que des fêtes de demain ?
ÉLISA, baissant la voix.
À propos, duc, est-ce vrai ce que me disait Rémusat, que l’empereur s’oppose au retour de la Grassini et de Mlle Georges ?
SAVARY.
C’est exact, princesse. Sa Majesté a donné l’ordre qu’on n’admît plus dorénavant à la cour ni Mlle Georges, ni aucune femme dont l’impératrice pourrait prendre ombrage.
ÉLISA, railleuse.
C’est d’un mari galant et très épris !
CAROLINE, de même.
Et qui tient à garder le droit d’âtre jaloux.
ÉLISA.
Et il l’est bien ! Si ce que l’on dit est vrai. Mais Savary n’en conviendra pas.
SAVARY.
Et que dit-on, princesse ?
ÉLISA.
Que pas une lettre de l’impératrice ne part pour Vienne, qu’elle n’ait été décachetée d’abord, et mise sous les yeux de l’empereur.
SAVARY.
Le fait fût-il vrai, qu’il n’y faudrait voir qu’une mesure politique, et le désir de connaître les pensées intimes de l’impératrice sur l’empire.
CAROLINE.
Et sur l’empereur.
SAVARY.
Mais je ne sais rien de tel !
Il remonte.
ÉLISA.
Naturellement !
CAROLINE, à Mme de Rovigo.
Duchesse ? Est-ce que le duc fait aussi décacheter vos lettres ?
MADAME DE ROVIGO.
J’espère bien que non !
Scène III
SAVARY, CONSTANT, SAINT-MARSAN, ROUSTAN, LAURISTON, MORTEMART, CAROLINE, ÉLISA, DAMES DE LA COUR, M. DE BRIGODE, qui est remonté au fond, annonce de loin : « L’empereur ! », L’EMPEREUR sort de la chambre de l’impératrice, dont la porte se referme derrière lui, et redescend en scène
L’EMPEREUR.
La chasse commencera demain à sept heures et demie. Tout le monde devra être prêt à sept heures un quart. Je vous conseille donc, mesdames, de faire ce que va faire l’impératrice, œ que je vais faire moi-même, d’aller vous reposer.
Révérences. À ses sœurs.
Vous, restez ; j’ai à vous parler.
À Mme de Bulow, qui remonte.
Ah ! madame de Bulow, l’impératrice vous prie de ne pas rentrer chez vous sans aller prendre ses ordres.
La baronne salue, puis s’éloigne.
À demain, messieurs !
Mme de Bulow entre cher l’impératrice. Constant a emporté dans la chambre de l’empereur la lampe du guéridon. Rovigo et Mortemart sont sortis par le fond, en même temps que toutes ces dames ; Saint-Marsan, Brigode et Lauriston par la droite. Sur un signe de l’empereur, Roustan disparaît. Venu à la cheminée, l’empereur prend sa tabatière, et, se retournant vers ses sœurs.
Scène IV
L’EMPEREUR, CAROLINE, ÉLISA
L’EMPEREUR.
Que ma dit l’impératrice ? Une altercation entra vous et la duchesse de Dantzig ?
ÉLISA.
Oh ! sire, c’est une indignité !
CAROLINE.
Cette femme a été d’une insolence !
ÉLISA.
C’est outrager Votre Majesté que de traiter vos sœurs de la sorte !
CAROLINE.
Et l’on se demande, en vérité, ce que l’empereur attend...
L’EMPEREUR.
L’empereur attend que vous le laissiez parler, et ce n’est pas à vous à lui rappeler le respect qui vous est dû, dont il a souci plus que vous-mêmes !
CAROLINE.
Oh ! pourtant !...
L’EMPEREUR.
Si l’on vous traite avec irrévérence, la duchesse de Dantzig, d’autres aussi...
ÉLISA.
D’autres ?
L’EMPEREUR.
C’est que vous leur faites la partie belle.
ÉLISA.
Nous ?...
L’EMPEREUR.
Vous ! Écoutez cat article de la Gazette de Leyde...
Il prend le journal sur la table et, au moment de le leur remettre, lit avec surprise.
« Le mameluck Roustan. Les tragédies du bas Empire. » Hein ? Qu’est-ce encore que ceci ?
Lisant à mi-voix.
« Ce janissaire, amené d’Égypte, et qui veille, chaque nuit, à la porte de Napoléon, n’est pas là seulement pour protéger le repos de son maître ; ce gardien fidèle devient, à l’occasion, l’exécuteur farouche et silencieux des basses œuvres, pour lesquelles il a des complices, toujours prêts, accourus au premier appel. »
Haussant les épaules.
Imbéciles !... Je me trompais. L’article dont je vous parle est du Times. Lisez cela !
CAROLINE.
Inutile, sire. Comment pourrions-nous échapper à la calomnie, qui n’épargne même pas Votre Majesté ?
ÉLISA.
C’est tous les jours qu’on travestit les faits les plus simples.
CAROLINE.
Il s’est bien trouvé des gens pour interpréter dans un sens injurieux la présence de M. de Neipperg à la cour.
L’EMPEREUR, vivement.
De M. de Neipperg ? Où cela ? Dans quel sens ? Qui a osé ?
CAROLINE.
Sait-on jamais le nom de ces gazetiers ?
L’EMPEREUR.
Et que disait ce gazetier ?
CAROLINE.
Il s’étonnait, paraît-il, que l’empereur tolérât, au palais de Compiègne, un homme, – admirez la perfidie ! – que l’archiduchesse honorait, dit-on, d’une amitié toute particulière.
L’EMPEREUR, se contenant.
Votre gazetier est un faquin ! Et vous une sotte, de répéter de telles sornettes ! L’impératrice n’a rien à voir à l’exil de M. de Neipperg, où la politique est seule en cause. M. de Neipperg est un ennemi de l’État, l’allié de tous mes adversaires. En relations suivies avec le comte de Provence, pour ne citer que celui-là, officier, plénipotentiaire ou conspirateur, l’épée, la plume ou le poignard à la main, je l’ai vu de tous les assauts diriges contre moi. Ici encore, où je ne l’avais accueilli que par déférence pour l’empereur d’Autriche il me combattait sournoisement. Chassé de la cour et de l’empire, il doit s’estimer trop heureux d’en être quitte à bon compte ! Et maintenant, bonsoir ! et tâchez de ne pas donner si beau jeu a ceux qui nous détestent et nous jalousent !
Il les congédie sur ce mot et va tendre les pieds au feu.
ÉLISA.
Sire, j’avais encore à vous demander...
L’EMPEREUR, brusque.
Quoi ? Que me voulez-vous encore ?... S’il s’agit de nouvelles dettes, je vous préviens...
ÉLISA.
Il ne s’agit pas de dettes. La faveur que j’attends de Votre Majesté, j’ose croire qu’elle ne me refusera pas.
L’EMPEREUR.
Eh bien ! Qu’est-ce ? Allons ! vivement !
ÉLISA, embarrassée.
Mon Dieu, sire...
CAROLINE.
Est-ce moi qui vous gêne ?
ÉLISA.
Nullement. Je demande, sire, à ne pas assister demain au dîner à grand couvert, ni à la représentation qui suivra.
L’EMPEREUR.
Et pourquoi cela, je vous prie ?
ÉLISA.
Je suis sûre, quand je me lève de si grand matin, d’être souffrante le reste de la journée, et Votre Majesté ayant fixé à sept heures et demie le départ pour la chasse...
L’EMPEREUR.
Vous moquez-vous ? Vous vous reposerez après la chasse, et vous assisterez au dîner à grand couvert, et à la représentation de gala.
ÉLISA.
Sire, épargnez-moi cette humiliation !...
L’EMPEREUR.
Plaît-il ?
CAROLINE.
Soyez généreux sire ! N’obligez pas la princesse de Lucques et de Piombino à passer les portes après moi, à s’asseoir à table au-dessous de moi, à se montrer dans la loge impériale derrière moi ! Il lui est trop pénible que j’aie partout le pas sur elle, en qualité de reine.
ÉLISA.
Et pourquoi vous et pas moi ? Parce qu’il plu à l’empereur de donner une couronne à Murat !
CAROLINE.
Ne fallait-il pas en donner une à M. Bacciochi ?
ÉLISA.
En tout cat, j’étais l’aînée...
Caroline va répliquer.
L’EMPEREUR, qui, assis, tisonnait, se retourne vers elle, les pincettes à la main.
Assez ! Voilà une belle raison que votre droit d’ainesse ! À ce compte, ce n’est pas moi qui serais empereur, mais Joseph, qui a bien assez de mal déjà à être roi !... Vous êtes bouffonnes, en vérité, avec vos querelles de naissance, de préséance !... Ne dirait-on pas que nous nous partageons l’héritage du feu roi, notre père ? Prenez ce qu’on vous donne, et tenez-vous pour bien heureuse de l’avoir, – grâce à moi, – et sans autre titre que mon bon vouloir.
CAROLINE.
C’est justement ce que dit notre mère.
L’EMPEREUR.
Et notre mère est une femme de sens !... Encore qu’elle verse dans l’excès contraire, et qu’au moindre éloge de la prospérité de l’empire elle ait la manie de s’écrier : « Pourvou que cela doure ! »
CAROLINE.
Sur ce point notre mère a tort ; mais elle a bien raison quand elle dit de notre sœur : A vostra sorella Elisa saria la luna, ch’alla vorrebe essere lou sole !
ÉLISA.
Significa dunqui che lou sole sieti voi ?
L’EMPEREUR.
Allon-nous recommencer ?
CAROLINE.
Siete una impertinent ! Setite ?
L’EMPEREUR.
Basta !
ÉLISA, de même.
Non, c’ié nulla di piu gelosa, che voi !
CAROLINE.
Vanitosa ! Vanitosa ! Vanitosa !...
L’EMPEREUR, debout, exaspéré.
Basta ! Basta ! Altrimenti voi rimando ai vostri mariti !
La porte s’ouvre à gauche, premier plan. Il s’arrête court.
Silence !
Scène V
L’EMPEREUR, CAROLINE, ÉLISA, DE BRIGODE, puis CATHERINE
DE BRIGODE, paraît.
Sire, Mme la duchesse de Dantzig est aux ordres de Votre Majesté.
L’EMPEREUR.
Qu’elle entre !
Brigode s’efface devant Catherine qui, sa pelisse sur les épaules, fait un grand salut à l’empereur. Les princesses hésitent à sortir.
Allez, mesdames, et soyez prêtes demain, à l’heure dite, toutes les deux.
CAROLINE, bas.
Elle essaiera la tempête, celle-là !
Elles sortent, en affectant de ne pas voir Catherine. M. de Brigode les suit.
Scène VI
L’EMPEREUR, CATHERINE
L’EMPEREUR, cassant.
Asseyez-vous, madame !
Catherine, sans s’intimider, s’assied sur le canapé. L’empereur continue, arpentant son cabinet, les mains derrière le dos, s’arrêtant par secousse, puis repartant.
Alors, c’est une gageure ? Et ce que je savais de vous ne suffisait pas ? Il y fallait encore vos frasques de ce soir. J’ai été bien avisé vraiment de faire votre mari duc et maréchal d’empire, sans prévoir que celle qui porterait ces titres avec lui les couvrirait de ridicule. Bientôt, grâce à vous, ma cour sera la risée de l’Europe, et les gazetiers de la Tamise la diront peuplée de cuisinières et de poissardes ! Ceci n’a que trop duré. Il faut en finir. Ôter son titre à Lefebvre ? Je ne le peux, ni ne le veux. L’homme qui, raille sur ce même titre par un freluquet de gentillâtre, l’a cinglé de cette phrase : « Tu n’es qu’un descendant et je suis un ancêtre ! » cet homme-là fera toujours honneur à son rang ! C’est donc à vous à comprendre ! Vous n’êtes pas sotte, paraît-il ? Voici l’heure de le prouver. D’ailleurs, ma résolution est prise... Lefebvre vous l’a dit, n’est-ce pas ?
CATHERINE.
Lefebvre m’a dit : « L’empereur veut que nous divorcions. »
L’EMPEREUR.
Eh bien ! C’est clair ! Qu’avez-vous répondu ?
CATHERINE.
Moi, sire ? Je lui ai ri au nez !
L’EMPEREUR.
En vérité !... Et lui ?...
CATHERINE.
Lui ? Il a ri au mien ? Vu qu’y n’a pas pus envie d’ se séparer d’ moi qu’ moi d’ lui !
L’EMPEREUR, venant à elle et la regardant de façon à l’inquiéter.
Et mon envie, à moi ? Si nous en parlions ?
CATHERINE, tranquillement.
Oh ! vous, sire, vous êt’s l’ maître, et un maître comme y en a pas eu deux depuis que l’ monde est monde ! Vous pouvez lancer d’un clin d’œil cinq cent mille hommes su’ l’ Danube ou su’ l’ Rhin, à seule fin d’ prouver qu’ c’est vous qu’êtes le tonnerre, mais y a une chose qu’avec tout votr’ génie vous n’ pouvez pas faire, c’est qu’ j’aime pas mon Lefebvre et qu’ mon Lefebvre n’ m’aime pas !... Et si vot’ Majesté livr’ c’te bataille-là... elle est ben sure d’ la perdre !
L’EMPEREUR.
Et vous êtes, vous, bien audacieuse de le croire ! Lefebvre n’a pas dit son dernier mot !
CATHERINE.
Ah ! c’est ben lui qui sera assez jocrisse pour troquer une femme qui lui est dévouée comme un pauv’ chien, contre une princesse d’ n’importe quoi, pour qui, tout héros qu’il est, et duc et maréchal d’empire, y n’ sera jamais que l’ fils d’un meunier, un soldat d’ fortune et un parvenu.
L’EMPEREUR.
De la gloire !
CATHERINE.
Un parvenu tout d’ même, pour ceux de l’ancien régime qu’ont fait les frais de c’te gloire-là !... C’est ben comme Votre Majesté.
L’empereur, qui remuait son café, s’arrête.
Avec ça qu’ils vous portent dans l’ cœur, tous les ci-devant qui vous font des courbettes, pa’ce que vous êtes l’ plus fort ! C’est pas c’ monde-là qui vous aime, c’est l’ peuple de la campagne et d’ la rue, qui vous est dévoué comme je le suis à mon Lefebvre, et ce dévouement-là, sire, qu’y soie celui d’un peuple ou c’lui d’une femme, quand on l’ tient, on l’ garde ! car ça n’ s’ retrouve pas...
L’EMPEREUR, radouci.
Ce n’est point dénué de sens ce que vous dites... Il est fâcheux seulement que ce soit dit dans un langage de faubourg, et que vos intempérances de langue, ce soir encore, aient provoqué un tel scandale...
CATHERINE.
Oh ! c’est ben l’ mot ! Un vrai scandale !
L’EMPEREUR.
Vous l’avouez !
CATHERINE.
D’ voir les sœurs d’ Votre Majesté mécanisser l’armée !
L’EMPEREUR.
L’armée ?...
CATHERINE.
Dans ma personne ! Vu qu’ moi aussi, j’ai servi sous les drapeaux...
Elle s’est levée.
L’EMPEREUR.
Vous ?
CATHERINE.
L’ bidon su’ l’ flanc !
L’EMPEREUR.
Vivandière ?
CATHERINE.
Et c’est d’ ça qu’ Leux Altesses m’ont fait honte !
L’EMPEREUR.
C’est stupide !
CATHERINE.
C’est pas moi qui l’ dis !
L’EMPEREUR.
Mais, vivandière ? Où ? Quand ? Comment ?
CATHERINE.
Avec Lefebvre, au 15e léger.
L’EMPEREUR, intéressé.
Armée des Vosges ?
CATHERINE.
Armée des Vosges, armée de la Moselle, armée de Sambre-et-Meuse, armée du Rhin ! Trente-six mois de campagne ! Douze combats : Mannheim, Frimont, Fleurus !
L’EMPEREUR.
Vous étiez à Fleurus ?
CATHERINE.
Ousqu’ j’ai eu un âne tué sous moi ! Apach, Lambach, Salzbach, Oberdiefensbach, où nous avions tant de blessés et si peu de linge, qu’après ma camisole, toute ma chemise y a passé !... Même que c’ grand braque d’Augereau m’a citée à l’ordre du jour, et embrassée d’vant tout l’ régiment !...
L’EMPEREUR.
Il a, pardieu, bien fait !... Comment donc ! Une citation à l’ordre du jour ? Mais c’est très bien, cela ! C’est très bien !
CATHERINE.
Sans parler d’un coup de baïonnette au gras du bras !...
L’EMPEREUR.
Et une blessure ! Encore mieux !... Voilà de vrais états de service, maréchale ! À la bonne heure !...
CATHERINE.
Aussi, quand j’ passe au bras d’ Lefebvre, et qu’une sentinelle lui présente les armes, j’en prends ben ma p’tite part !
L’EMPEREUR.
Et c’est justice ! Comment ne m’a-t-il rien dit de tout cela, Lefebvre ?
CATHERINE.
Il aura cru que Votre Majesté le savait !
L’EMPEREUR.
Point du tout !... Allons ! Allons ! Vous avez bien fait de défendre vos glorieux jupons contre l’assaut des manteaux de cour ! Je tancerai Leurs Altesses comme il convient, et le fait ne se reproduira plus. D’ailleurs, nous allons concilier tout cela. Vous garderez vos galons si bien gagnés, et vous resterez la maréchale Lefebvre, duchesse de Dantzig ; seulement, vous éviterez de paraître à la cour, où vous devez d’ailleurs vous sentir dépaysée et mal à l’aise.
CATHERINE, gaiement.
Ah ! quant à ça, j’ peux dire qu’ ça ne m’ privera guère. Pour ce que j’ m’ amuse, à vot’ cour !
L’EMPEREUR.
Eh ! oui, c’est ce que je dis.
CATHERINE.
C’est d’un gourmé tout ça, et d’un raide ! Oh ! là ! là ! Trop d’empois !... Les hommes y sont tous emboîtés dans leux collets, à croire qu’ils ont avalé leux pincettes ! les femmes, au port d’armes avec tous leux appas, comme si qu’ vous alliez les passer en r’vue !
L’EMPEREUR, de même.
C’est moins gai évidemment qu’un bal de barrière !
CATHERINE.
Pour sûr qu’ c’était plus jovial à la Râpée, du temps qu’ j’étais blanchisseuse !
L’EMPEREUR, redevenant bourru.
Ah ! cela, je le savais, Caroline me l’a dit. Et c’est ridicule ! vous avez donc fait tous les métiers ?
CATHERINE, un instant interdite.
Ça n’en fait jamais que deux !
L’EMPEREUR.
Celui-là est bien de trop ! Vivandière, bon ! Le drapeau anoblit tout ! Mais blanchisseuse ! Où ? Quand ?
CATHERINE.
À Paris, sire, en quatre-vingt-onze et douze ! Où j’ai lâché la partie, rapport aux mauvaises payes ! Les émigrés qui filaient, les soldats qui s’ faisaient tuer... D’autr’, qui faisaient fortune et qu’oubliaient leurs notes !... Ainsi, dans c’ Palais, croiriez-vous qu’y a un militaire, qu’a fait son chemin, celui-là, on peut l’dire, et qui m’doit encore, de c’temps-là, une soixantaine de francs, qu’ j’ai jamais osé lui réclamer !
L’EMPEREUR, grondant.
Ah ! je vous conseille ! Ce serait d’un bel effet !
CATHERINE, qui fouille dans son corsage.
J’me suis même autorisée d’vous apporter sa note !
L’EMPEREUR.
Vous vous figurez que l’empereur va régler vos comptes de blanchisseuse ?
CATHERINE.
Oh ! quand Vot’ Majesté saura l’ nom !
L’EMPEREUR, haussant les épaules.
Vous êtes folle ! Allons !... Il est minuit ! Finissons ! Plaise à Dieu que tout le monde fasse comme votre débiteur, qui oublie sa dette et votre ancien métier !
CATHERINE.
Oh ! j’ai de quoi lui rafraîchir la mémoire, avec c’te lettre, ousqu’y demande crédit...
L’empereur a un geste d’impatience. Sans paraître s’en occuper, elle lit.
« Sur ma maigre solde... il me faut... » C’est si mal écrit !... « Il me faut encore venir en aide à ma mère et à mes sœurs, qui vont se réfugier à Marseille... »
L’EMPEREUR, saisi.
Vous dites ?...
CATHERINE, continuant.
« ...Étant forcées de quitter la Corse !... »
L’EMPEREUR, lui arrache la lettre.
La Corse ?
Et court à la signature.
Buonaparte !
CATHERINE.
V’là ma mauvaise paye !
L’EMPEREUR.
En effet !... Attendez donc !... Rue Sainte-Anne ?
CATHERINE.
Au coin d’ la rue des Orties !
L’EMPEREUR.
Parbleu, oui, je me souviens !... mais c’est votre nom que je cherche.
CATHERINE.
Catherine Hubscher...
L’EMPEREUR.
Non ! l’autre ! Un surnom ?
CATHERINE.
Ah ! oui... Madame...
L’EMPEREUR.
Attendez !... Madame Sans-Gêne !
CATHERINE.
Le v’là !
L’EMPEREUR, riant.
Et il vous sied bien !... Comment, cette bonne fille, si gaie ?
CATHERINE.
C’était moi !
L’EMPEREUR, gaiement.
Ma voisine ! Je logeais rue Royale-Saint-Roch.
CATHERINE.
Hôtel des Patriotes hollandais.
L’EMPEREUR.
C’est cela ! Triste logis !... et vilaine date ! Pour un séjour en Corse un peu trop prolongé, j’étais privé de mon grade, qui, d’ailleurs me fut rendu, peu après, par le roi, mon oncle !
CATHERINE, surprise.
Vot’ oncle ?
L’EMPEREUR.
Louis XVI, oui ! Marie-Antoinette étant la tante de Marie-Louise !...
CATHERINE.
Ah ! comme ça ! Et ben ! v’là de ces choses t’nez ! auxquelles on n’pense pas !
L’EMPEREUR.
Le dernier brevet de capitaine que le pauvre homme a signé, quelques jours avant le dix août, était le mien. Il désignait son successeur ! En attendant, je battais le pavé de Paris en quête d’une profession, et je pensais à me faire marchand de meubles.
CATHERINE, riant.
Y a pus de profit à c’ que vous faites !
L’EMPEREUR, de même.
N’est-ce pas ? – Ah ! ce chiffon de papier ! Que de souvenirs il réveille ! Je me vois encore l’écrivant, sur une méchante petite table noire, à mon quatrième étage...
CATHERINE.
Cinquième !
L’EMPEREUR.
Non ! quatrième.
CATHERINE.
Non ! Non ! cinquième ! Sous le toit !
L’EMPEREUR.
C’est, ma foi, vrai !... Quelle mémoire !...
CATHERINE.
Ça fait plaisir tout d’ même de s’ rappeler ça ici !
L’EMPEREUR.
Eh oui ! Le passé fait la saveur du présent !... Maintenant, discutons la note ! Quarante francs, rien que pour le raccommodage ! Ce n’est pas raisonnable. Mon linge n’était pas si mauvais que ça !
CATHERINE.
Oh ! ben pus mauvais encore !
L’EMPEREUR, se lève.
Enfin ! Ne marchandons pas ! Nous disons donc que Buonaparte vous doit ?
CATHERINE, tendant la main.
Trois napoléons !
L’EMPEREUR, fouillant son gousset.
Eh bien, ma chère, c’est une fatalité ! Je ne les ai pas sur moi !
CATHERINE.
Qu’à ça ne tienne ! Je peux vous faire encore crédit vingt-quatre heures.
L’EMPEREUR, dans un sourire.
Merci ! Vous êtes une malicieuse personne, madame Sans-Gêne !...
Il lui pince et lui secoue amicalement l’oreille.
Et vous avez une très jolie oreille, et
Tournant à lui son visage.
un minois tout à fait plaisant...
CATHERINE.
Ah ! ben ! Votre Majesté a mis le temps à s’en apercevoir !
L’EMPEREUR.
Oui-dà ?
CATHERINE, toujours riant.
J’ peux l’ dire à c’t’ heure qu’ c’est loin de nous tout ça ! J’ connaissais pas encore Lefebvre, et j’vous trouvais fièrement d’mon goût !
L’EMPEREUR, s’assied.
Vraiment ?
CATHERINE.
On a beau être honnête fille, on sent ben qu’ c’est pas la peine d’être jolie pour soi seule, et j’aurais bien aimé l’être aussi pour vous !... Les autres vous trouvaient laid, moi pas ! Et j’ me songeais : « Oh ! c’t homme-là !... V’là un homme ! qu’est un homme ! S’y m’ demande jamais queuqu’chose, c’lui-là, j’ lui donnerai ben tout le reste ! »
L’EMPEREUR.
Comment ? Comment ?... Il n’aurait tenu qu’à moi ?...
CATHERINE.
Oh çà !... Une fois surtout, que j’ suis v’nue, l’ matin, su’ l’ coup d’onze heures, vous porter vot’ linge !... Je m’étais requinquée et mise sur mon pus propre, la polonaise toute ruchée, l’ fichu galant, les petits souliers, le battant l’œil. Ah ! j’étais bien appétissante ! Je grimpe vos cinq étages, m’ disant : « Pour sûr je vas au ciel ! » et j’arrive à votre payier, le cœur m’ battant, comme un’ cloche, d’ la montée, et aussi d’ l’appréhension d’un’ jeunesse qu’a pas encore vu le feu. J’ cogne à vot’ porte... Toc, toc ! – « Entrez ! – Oh ! mon bon Dieu ! que j’me dis, qu’est-ce qui va se passer ? » J’entr’ dans le local d’ Vot’ Majesté, qu’était assise à une petite table, le nez collé su’ une cart’ d’ géographie. – « C’est moi, mon officier ! qu’ je dis. J’ vous apporte vot’ linge. – Bon ! qu’ vous faites, sans l’ver l’nez, mettez-le su’ l’ lit ! – Su’ l’ lit ? que j’ me dis. Non, pas su’ l’ lit. Putôt su’ la commode. » Et me v’là donc que j’ vas, que j’ viens, vidant mon pagnier, claquant mes talons su’ l’ carreau, et frôlant vot’ chaise au passage. Mais bernique !... Vous grouillez pas pus d’ vot’ table, qu’si j’étais un’ mouche ! – « Pour sûr, qu’ je m’ dis, s’y n’ bat pas l’ briquet pus fort qu’ ça, y n’allumera pas l’amadou ! » Et, soufflant comme si j’avais trop chaud, j’enlève mon fichu, avec c’t’ idée : – « Y va p’t-être ben planter là sa géographie pour s’occuper un peu d’ la mienne ! » Ah ! j’ t’en moque ! Vous r’piquez d’ plus belle vot’ nez su’ la carte ! Tant que, dépitée, je r’noue mon fichu, j’ ramasse mon pagnier, et je r’pars, avec toute ma vertu, qu’était pas fière de s’en retourner comme elle était venue, et qu’on y ait fait l’impolitesse d’ la respecter tant que ça !
L’EMPEREUR.
Parbleu ! ma chère, ce jour-là, je n’ai été qu’un sot de dédaigner la jolie main qui m’était si gentiment tendue...
Il prend sa main où il met un baiser.
CATHERINE, moqueuse.
Oui ! les v’là, les conquérants !
L’EMPEREUR.
Et ce bras ? Où disons-nous qu’est la fameuse blessure ?...
CATHERINE.
Ici !
L’EMPEREUR.
Vous permettez ?
Il baise le bras.
CATHERINE.
Le salut aux blessés, toujours.
Il va pour continuer ; elle se lève.
Ne cherchez pas, sire, il n’y en a pas d’autres.
L’EMPEREUR, hardi.
Bah ! puisque je paye les dettes du lieutenant !
CATHERINE, se dérobe, avec une révérence.
J’en tiens quitte l’empereur !...
L’EMPEREUR, reprenant son sérieux.
Vous avez raison, duchesse ! Aussi bien, Lefebvre doit trouver le temps long ! Tout dort dans le Palais. Je vais vous faire reconduire dans ces corridors déserts ! Ne manquez pas de paraître à la chasse demain, je vous y parlerai de telle sorte, que tout le monde se le tiendra pour dit !... Roustan !
Scène VII
L’EMPEREUR, CATHERINE, ROUSTAN paraît
Catherine a pris sa pelisse sur le canapé.
L’EMPEREUR.
Va jusqu’à la salle des gardes appeler un officier de service.
Roustan traverse la scène pour obéir à l’empereur, qui redescend vers Catherine, et va l’aider à jeter sa pelisse sur ses épaules. Mais, après avoir dépassé la porte du fond, Roustan s’arrête, court, prêtant l’oreille, puis il ouvre à demi le battant droit de cette porte pour écouter. L’empereur se retourne.
Eh bien ? Qu’y a-t-il ?
ROUSTAN, à mi-voix.
On vient d’ouvrir en bas la porte de l’escalier réservé !
L’EMPEREUR.
À cette heure ? Prends cette lumière et vois !
Roustan redescend, laissant le battant de la porte retomber, légèrement entr’ouverte, et il vient prendre le flambeau sur la table. L’empereur, tout à coup, se ravise.
Non ! Attends !...
Écoutant.
Oui, on vient de ce côté !
CATHERINE, à elle-même.
Mon Dieu ! pourvu que ce ne soit pas !...
L’EMPEREUR.
Ce flambeau chez moi !... Ferme la porte, et viens au premier appel !
Roustan obéit et sort avec le flambeau, par la porte de l’empereur. Nuit noire où n’apparaît que la lueur de l’âtre.
CATHERINE.
Votre Majesté veut ?...
L’empereur redescend à elle, et, lui prenant la main.
L’EMPEREUR, durement.
Là, et silence !...
Il la fait asseoir sur le tabouret près du canapé et, assis sur le canapé, dont le haut dossier les cache, surveille la porte d’entrée, sans être vu.
Scène VIII
L’EMPEREUR, CATHERINE, ROUSTAN, MADAME DE BULOW, NEIPPERG
Le battant gauche de la porte du fond s’ouvre, et Mme de Bulow paraît d’abord, marchant avec précaution. Elle dépasse d’un pas le seuil, examine le cabinet sombre, qui lui semble désert, puis se hasarde à y entrer, prête l’oreille dans la direction de la chambre de l’empereur, puis vers la porte de l’antichambre de droite ; rassurée par le silence et l’obscurité, elle revient sur ses pas, pousse, en passant, le battant droit de la porte du fond qui reste à demi-ouvert, et fait signe à gauche. Neipperg paraît, enveloppé d’un manteau, son chapeau à la main, Catherine a un mouvement, vite réprimé par l’empereur, qui s’est levé, tourne le canapé et remonte vers le fond, tandis que Mme de Bulow, qui a poussé le battant gauche, se dirige vers la porte de l’impératrice et que Neipperg, qui ne s’est montré que de dos et n’a pas dépassé le seuil, suit ses mouvements. Au moment où Mme de Bulow arrive à la porte de Marie-Louise, l’empereur vient à Neipperg, lui met brusquement la main sur l’épaule et le fait passer devant lui, en appelant.
L’EMPEREUR.
Roustan !
MADAME DE BULOW, terrifiée.
L’empereur !
Roustan entre vivement, avec le flambeau qui éclaire Neipperg en plein visage.
L’EMPEREUR.
Neipperg !
CATHERINE, à elle-même.
Ah ! malheureux !...
L’EMPEREUR, la voix sourde, frémissant de colère contenue.
Vous ? À cette heure ? Ici ! Vous !...
À Roustan, en désignant Mme de Bulow.
Cette femme chez moi !
Roustan ouvre la porte. Mme de Bulow essaie un mouvement de supplication, que l’empereur interrompt d’un geste.
NEIPPERG, bas, tandis que Mme de Bulow se retire.
J’atteste que madame...
L’EMPEREUR.
Il vous sied bien de parler pour elle !...
Mme de Bulow disparait dans la chambre de l’empereur, dont Roustan referme la porte sur elle ; après quoi, il va refermer celle du fond, auprès de laquelle il se tient attentif, immobile.
Scène IX
L’EMPEREUR, CATHERINE, NEIPPERG, ROUSTAN, puis DEUX DE SES HOMMES
L’EMPEREUR, toujours à mi-voix, avec la précaution de n’être pas entendu du dehors.
Parlez pour vous ! Et m’expliquez votre présence la nuit, à cette porte !...
NEIPPERG, à voix basse.
Je n’ai pas voulu partir sans prendre congé de l’impératrice !
L’EMPEREUR.
En vérité ?... À minuit !
NEIPPERG.
Votre Majesté ne m’a pas laissé le choix de l’heure où je pouvais prendre les ordres de ma souveraine.
L’EMPEREUR.
Et quels ordres avez-vous à recevoir de l’impératrice ?
NEIPPERG.
Ceux qu’elle a, seule, le droit de me dicter.
L’EMPEREUR.
Vous dites ?
NEIPPERG.
Je ne suis ni le sujet ni le valet de Votre Majesté. Je suis général au service de Sa Majesté impériale et sacrée François d’Autriche, et c’est comme tel que je dois tout mon dévouement à l’archiduchesse Marie-Louise, à elle seule.
L’EMPEREUR.
Et c’est à ce titre aussi que vous prenez le droit de vous introduire clandestinement chez elle, à pareille heure ? Eh bien, mon devoir, à moi, qui vous surprends la nuit à sa porte, est de vous traiter comme un bandit pris sur le fait, et, en vous supprimant sans bruit, d’étouffer avec vous tout scandale !
NEIPPERG.
Vous en avez le pouvoir.
L’EMPEREUR.
Et j’en use ! Roustan, appelle tes hommes !
CATHERINE, épouvantée.
Oh ! sire ! Non ! pas ça !
Roustan, qui se dirigeait vers la porte de gauche, premier plan, s’arrête au cri de Catherine.
L’EMPEREUR.
Va !...
Roustan ouvre la porte, fait un signe, puis revient derrière le canapé, les bras croisés.
CATHERINE, cramponnée à l’empereur.
Sire ! Sire ! C’est vot’ honneur que j’ défends !... Par pitié pour ceux qui vous aiment !... Pas ça ! Pas ça !...
Deux mamelucks en petite tenue viennent de paraître.
L’EMPEREUR.
Assez !...
À Roustan.
Emmenez monsieur !
CATHERINE.
S’ils font un pas, je crie !...
Tous s’arrêtent.
L’EMPEREUR, outré.
Osez-vous ?...
CATHERINE.
Je crie !... J’appelle !... J’éveille l’impératrice, et tous les gens du Palais, et j’ leur dis : « N’ souffrez pas qu’vot’ empereur, vot’ Dieu ! fasse égorger un homme sans défense ! Et qu’ les ennemis d’ sa gloire puissent crier au monde entier que le vainqueur de Wagram, d’Austerlitz est un assassin !... »
L’EMPEREUR.
Faites taire cette femme ! et finissons ?
CATHERINE, suffoquée et sanglotant.
Sire ! Sire ! Grâce !
Les deux mamelucks s’avancent vers Neipperg, qui les contient d’un geste, et se tourne vers l’empereur.
NEIPPERG.
Du moins, traitez-moi en soldat ! Et, puisqu’il est convenu qu’on m’assassine, faites-moi fusiller, lâchement, comme le duc d’Enghien !
L’EMPEREUR, hors de lui.
Ce serait trop d’honneur pour un misérable qui déshonore son grade en m’insultant, et qui mérite qu’on lui en arrache les insignes...
Il lui arrache ses aiguillettes.
pour l’en souffleter !...
Il fait le geste. Neipperg recule d’un bond, tire son épée.
NEIPPERG.
Fais-le donc !
CATHERINE.
Au secours ! À l’aide !
Oubliée par Roustan, qui s’élance vers Neipperg avec ses deux hommes, Catherine se jette au-devant de l’empereur et arrête son bras. Terrassé par les mamelucks, Neipperg roule sur le parquet, se débattant contre eux. Il tombe sur les genoux, menaçant du poing l’empereur, qui a repoussé Catherine.
NEIPPERG, haletant, désarmé.
Un vrai Corse eût pris son couteau !... Les goujats !
Scène X
L’EMPEREUR, CATHERINE, NEIPPERG, ROUSTAN, DEUX MAMELUCKS, SAINT-MARSAN, LAURISTON et MORTEMART accourent, à qui Roustan remet l’épée de Neipperg
L’EMPEREUR, brandissant les aiguillettes.
Je devrais vous faire étrangler avec ceci ! Mais, par égard pour votre maître, j’y renonce !
Il les jette au loin. À Saint-Marsan.
Monsieur a levé l’épée sur moi. Mandez sur-le-champ Savary et Lefebvre ! Qu’on en finisse avant le jour !...
Catherine, désespérée, tombe sur un siège. Les aides de camp s’éloignent, tandis que les deux mamelucks, à genoux, immobilisent Neipperg.
ACTE III
Le cabinet de l’empereur.
Scène première
CATHERINE, SAINT-MARSAN, LAURISTON, MORTEMART, puis CONSTANT
Les bougies meurent, le feu meurt. Au fond, MM. de Mortemart et de Saint-Marsan, sans coiffure, causent à voix basse en regardant la porte de droite. Accroupie sur un tabouret, devant la table de l’empereur, Catherine songe, douloureusement absorbée, le menton dans ses mains, en regardant les tisons. Sa pelisse traîne sur le canapé. Le manteau de Neipperg a été jeté sur le guéridon ; son épée est restée sur la table. M. de Lauriston sort de chez l’empereur et vient aux deux aides de camp qui, au moment où il va parler, l’arrêtent en lui désignant Catherine. Après quelques mots échangés à vois basse, Saint-Marsan s’approche d’elle.
SAINT-MARSAN.
Madame la duchesse de Dantzig veut-elle me permettre de la reconduire chez elle ?
CATHERINE.
Merci, capitaine. J’attends Lefebvre qu’ l’empereur a fait appeler.
SAINT-MARSAN, s’inclinant.
Daignez, madame, prendre votre pelisse
Il va la chercher.
qui doit vous faire défaut.
CATHERINE.
Vous êtes ben honnête, capitaine ; j’ vous remercie.
Pendant qu’il la lui met sur les épaules.
Quelle heure est-il, s’il vous plaît ?
SAINT-MARSAN.
Deux heures, madame la duchesse.
À Constant qui entre, à droite, apportant une lampe.
Voulez-vous ranimer le feu, et prendre les ordres de la duchesse de Dantzig ?
Catherine va rejoindre Constant à la cheminée.
CATHERINE, bas.
Dites-moi, Constant ; M. de Neipperg est toujours là ?
De la tête, elle montre la porte de droite.
CONSTANT, bas.
Oui, madame la duchesse, sous la garde de MM. de Lawœstine et d’Arenberg. Défense expresse de laisser approcher de lui qui que ce soit.
CATHERINE.
Rendez-moi un service. Allez trouver Fouché, de ma part. S’il est dans son lit, dites-lui qu’y s’ lève, qu’y s’ dépêche, et qu’y vienne m’ parler, pendant que l’empereur est encore dans sa chambre.
CONSTANT.
Bien, madame la duchesse. Mais si l’empereur vient à apprendre ?...
CATHERINE.
Allez toujours ! J’ prends tout su’ moi.
CONSTANT.
J’y vais.
CATHERINE.
Vivement, hein ?
Il va prendre sur le guéridon le flambeau, à demi éteint, et se dirige vers la petite porte de gauche, premier plan, qui s’ouvre.
Scène II
CATHERINE, SAINT-MARSAN, LAURISTON, MORTEMART, LEFEBVRE entre, vivement, en tenue de service, salué militairement par les officiers
Constant sort.
LEFEBVRE, très inquiet.
Où est donc l’empereur ?
LAURISTON.
L’empereur est dans sa chambre, monsieur le maréchal.
LEFEBVRE.
Voulez-vous m’annoncer, monsieur de Lauriston ?...
Pendant que Lauriston passe chez l’empereur, Lefebvre vient à Catherine qui lui prend la main. À mi-voix.
Je commençais à m’impatienter ! Qu’est-ce qui se passe ? Il connaît l’esclandre ?...
CATHERINE, de même.
Oh ! s’y n’ s’agissait qu’ d’ ça !...
Bas en l’emmenant à l’écart.
Neipperg est rev’nu ! C’te nuit !
LEFEBVRE, de même.
Allons donc ?
CATHERINE.
Et juste au moment où j’ partais, l’empereur l’a surpris...
LEFEBVRE.
Comment ?
CATHERINE, désignant le fond.
Là ! à la porte de...
LEFEBVRE, sursaute.
Quoi ? La femme ? C’est ?...
CATHERINE, vivement.
Chut !
LEFEBVRE, bouleversé.
Ah ! Tonnerre ! Et alors ?...
CATHERINE.
Oh ! Alors, une scène ! Tu penses ! L’empereur, furieux, a fini par lui arracher ses aiguillettes. Neipperg a tiré son épée !
LEFEBVRE.
Sur l’empereur ?...
CATHERINE.
Oui !...
LEFEBVRE.
Il est perdu ! L’empereur m’appelle pour le faire fusiller !
CATHERINE.
Sûrement !
LEFEBVRE.
Ah ! Cré Dieu ! Et il faut que ce soit moi !...
Lauriston reparaît.
LAURISTON.
Monsieur le maréchal, Sa Majesté vous attend.
LEFEBVRE.
J’y vais !
Il remonte d’un pas.
CATHERINE, bas.
Refuse !...
LEFEBVRE, bas, désolé.
Est-ce que je peux ?
Il entre chez l’empereur, salué au passage par les aides de camp.
Scène III
CATHERINE, MORTEMART, LAURISTON et SAINT-MARSAN, au fond
CATHERINE, à elle-même.
Il a raison ; y n’ peut rien !... Si j’ pouvais seul’ment aviser Neipperg que j’ suis encore là ! Il comprendrait ben que j’ travaille pour lui !
Dans un regard au groupe des officiers, elle aperçoit son manteau sur le guéridon.
Son manteau !...
À Saint-Marsan.
Pardon, excuses, capitaine. Vous qu’avez été assez honnête, tout à l’heure, pour me donner ma pelisse, voudriez-vous passer à M. de Neipperg son manteau, qui doit lui faire faute ? Car il fait froid, ce matin.
SAINT-MARSAN.
Vous avez raison, madame, et je m’en veux de ne pas y avoir pensé !
Il prend le manteau, et entre à droite, en laissant la porte ouverte derrière lui : de loin, Catherine a suivi le mouvement et regarde.
CATHERINE, à elle-même.
Il n’a pas seulement levé les yeux. Il pense à l’autre ! Ah ! le v’là debout !... Quoi ? Qu’est-ce qu’il s’est donc figuré ? Qu’on venait le chercher pour ?... Pauv’ garçon ! Cette fois, j’ai idée qu’il m’a vue !
Saint-Marsan reparaît.
SAINT-MARSAN.
Madame, M. de Neipperg a compris que, cette attention, c’est vous qui l’avez eue. Voyez ! il vous remercie du geste...
CATHERINE, émue.
Oui !...
Elle lui envoie un salut de la tête, en essayant de sourire, puis redescend d’un pas, pendant que Saint-Marsan referme la porte. À elle-même.
Au moins il saura qu’ ses amis n’ l’abandonnent pas.
Scène IV
CATHERINE, MORTEMART, LAURISTON, SAINT-MARSAN, FOUCHÉ
Fouché, en tenue de ville, entre par la gauche, premier plan, Catherine court à lui.
CATHERINE, à mi-voix.
Ah ! mon cher duc ! Pardonnez-moi d’ vous avoir fait lever à cette heure...
FOUCHÉ, à mi-voix.
Point. Je veillais.
LAURISTON, ouvrant la porte de l’empereur.
Messieurs, l’empereur vous appelle...
FOUCHÉ, à Catherine.
Pardon !
À Saint-Marsan.
Voulez-vous dire à Sa Majesté que je suis ici, tout à ses ordres ?
SAINT-MARSAN.
À l’instant, monsieur le duc.
Les aides de camp entrent chez l’empereur.
Scène V
CATHERINE, FOUCHÉ
FOUCHÉ.
Je veillais, dis-je, et non sans inquiétude sur votre compte.
CATHERINE, triste.
Moi, j’ suis hors de peine... C’lui qui y est pas...
FOUCHÉ.
C’est M. de Neipperg.
CATHERINE.
Vous savez ?...
FOUCHÉ, détaché.
Que son cas est désespéré. L’empereur avant mandé le duc de Dantzig et Savary pour le faire fusiller.
CATHERINE, instamment.
Eh bien, c’est pour empêcher ça qu’ je vous ai prié d’ venir.
FOUCHÉ.
Moi !
CATHERINE, suppliante.
Oui !
FOUCHÉ, glacial.
Eh ! duchesse, qu’ai-je à faire dans cette aventure ?... Je conçois votre désir de sauver Neipperg, qui est votre ami...
CATHERINE, un peu déconcertée.
Et d’épargner à l’empereur, qu’ j’aime aussi, un crime !
FOUCHÉ, en reniflant sa prise.
Disons plus ! Une faute !...
CATHERINE.
Et d’ tirer de là l’impératrice, que j’aime pas pus qu’y n’ faut ! mais qui est not’ souveraine, après tout, et dont la honte va r’jaillir su’ nous !
FOUCHÉ.
Bon ! Mais ce sont là des liaisons de sentiment, qui vous sont toutes personnelles. Et mon intérêt, à moi, homme positif, est tout différent du vôtre...
CATHERINE.
Oh !
FOUCHÉ.
Tout différent ! Neipperg n’est pas mon ami ; son salut m’importe peu. L’impératrice me déteste ; son honneur me laisse froid. Rovigo m’a supplanté ; sa disgrâce me comble de joie. L’empereur m’a puni de lui prédire que ce mariage finirait mal ; il finit mal ! Je suis vengé !
CATHERINE, qui s’assied sur le canapé en haussant les épaules.
Et v’là un homme d’esprit, t’nez ! qui parle d’ vengeance !
FOUCHÉ.
Pourquoi pas ?
CATHERINE.
Allons, donc ! C’est pour les sots, la vengeance ! Quoi qu’ ça rapporte ! Les malins ne s’ vengent pas, sauf s’ils y trouv’ leur compte.
FOUCHÉ, satisfait.
Eh bien, mais ?...
CATHERINE.
L’ plaisir n’est-ce pas ?
FOUCHÉ.
Dame !...
CATHERINE.
C’est ça qui vous f’ra une belle jambe, qu’ Rovigo soit par terre, si vous y êtes comme lui !
FOUCHÉ, pose son chapeau sur le guéridon et s’assied sur l’X, près du canapé.
Oh ! je ne suis pas têtu. Démontrez-moi que j’ai tout profit à convertir mes rancunes en dévouement, et c’est fait !
CATHERINE, se rapprochant de lui.
Mais y crèv’ les yeux, c’ profit-là !
FOUCHÉ, assis à côté d’elle.
Voyons ça.
CATHERINE, baissant la voix.
C’est pas clair qu’ l’impératrice va pousser les hauts cris, s’ justifier, prouver qu’ Neipperg est fou, qu’elle est blanche comme neige, et que c’est l’empereur qui lui demandera pardon ?... Et c’est à un futé comm’ vous qu’y faut rappeler qu’avec la femme qu’on aime, ça finit toujours comme ça !
FOUCHÉ, souriant.
Souvent !
CATHERINE.
Toujours ! Sauvez Neipperg, en jurant à l’empereur vos grands dieux qu’ sa femme n’est pas coupable ! Elle vous saura gré d’main, qu’ vous l’ayez dit l’ premier ! Et l’empereur, qu’ vous l’ayez cru avant lui ! Et vous avez, du coup, la reconnaissance d’ l’un, la confiance d’ l’autre, et la place d’ Rovigo. Et sans risquer ça !...
Elle fait le geste avec l’ongle sur les dents.
Le v’là l’ profit !...
FOUCHÉ.
Eh ! mais ! Savez-vous que cela est raisonné très finement ?
CATHERINE, en lui prenant les mains.
Alors, nous sauvons Neipperg, à nous deux ?
FOUCHÉ.
Eh ! mon Dieu !...
CATHERINE, insistant.
C’est dit ? Allons ! C’est dit, n’est-ce pas ?
FOUCHÉ, s’asseyant près d’elle sur le canapé.
Eh bien, c’est dit ! Marchons !
CATHERINE, joyeuse.
Allons donc ! D’abord, à tout prix...
FOUCHÉ.
Ajourner l’exécution.
CATHERINE.
Mais le moyen ?
FOUCHÉ.
Oh ! sans l’aveu de l’empereur, aucun. Mais je lui prouve, en cinq minutes, qu’il va se couvrir de ridicule, avec son exécution sommaire... Tout Paris dira qu’il a surpris Neipperg dans les bras de l’impératrice.
CATHERINE, appuyant.
Çà !
FOUCHÉ.
Qu’il congédie Rovigo, et je mets l’impératrice hors de cause, par un procédé bien simple.
CATHERINE.
Qui est ?
FOUCHÉ, tranquillement.
Au lieu d’exécuter Neipperg la nuit, comme un galant pris sur le fait, de le faire fusiller en plein jour, à Grenelle, comme conspirateur.
CATHERINE, effarée.
Fusiller !
FOUCHÉ, toujours calme.
Attendez ! Il a conspiré ; c’est acquis ! Donc, il a des complices, et, pour donner créance à la fable, il faut bien avoir l’air d’instruire l’affaire... D’où nécessité de surseoir à l’exécution, et de coffrer Neipperg à Vincennes. L’impératrice se justifie ; Metternich intervient ! L’empereur s’apaise ; Auguste pardonne à Cinna, s’évade, grâce à moi... Et le tour est joué !...
CATHERINE, stupéfaite.
Mais cette conspiration ? Y en a pas.
FOUCHÉ.
Il y en a toujours ! Une police qui se respecte en a constamment une, au moins, en réserve, organisée dans ses bureaux, qu’elle découvre au moment précis où elle veut se défaire des gens qu’elle a mis sur la liste.
Avec un peu de vanité.
J’en ai deux, moi, dans mes cartons, deux toutes prêtes. Une jacobine, avec Arena, le cadet, Lahorie et les Philadelphes ! (Mais on ne voit pas bien Neipperg dans ce monde-là.) Et l’autre, royaliste, Lafon, les Polignac, Barras, Puyvert, etc. Voilà bien son affaire !
CATHERINE.
Mais on arrêtera ces malheureux !
FOUCHÉ.
Bon ! Deux ou trois subalternes, pour la forme, que je fais relâcher dans les vingt-quatre heures, faute de preuves ! À moins qu’on en trouve, ce qui serait assez piquant ! Mais, de toute façon, Neipperg est sauvé.
CATHERINE.
Alors, vite, n’est-ce pas ?
FOUCHÉ.
Je vais rédiger tout de suite un petit projet de complot pour l’empereur...
Il se lève, gagne la droite et va à la table, où il prend des notes sur les pages de son portefeuille. Lauriston entre avec Saint-Marsan.
Scène VI
CATHERINE, FOUCHÉ, SALNT-MARSAN, LAURISTON
SAINT-MARSAN, à Lauriston, qui traverse la scène.
...Et dites aussi, je vous prie, que la chasse est contremandée !
À Fouché.
M. le duc de Rovigo n’a pas encore paru ?
FOUCHÉ.
Pas encore ! vous voyez !
SAINT-MARSAN.
L’empereur s’impatiente...
Il va pour le rejoindre.
FOUCHÉ.
Je le conçois ! – Monsieur de Saint-Marsan, vous avez dit à Sa Majesté que j’étais à ses ordres ?
SAINT-MARSAN.
Oui, monsieur le duc ; mais Sa Majesté n’a rien répondu.
FOUCHÉ.
Ah ? Eh bien, voulez-vous avoir la bonté d’insister pour qu’elle daigne m’accorder une audience intime ? Il y va d’intérêts urgents !
En confidence.
Une conspiration !
SAINT-MARSAN.
Je soumets la requête à l’empereur sur le champ.
Il sort.
FOUCHÉ, revenant à Catherine.
Que l’empereur me reçoive, et que cet imbécile de Rovigo tarde encore dix minutes ! Je le supplante, et j’arrange tout !...
Il s’assied ; la porte du premier plan s’ouvre.
CATHERINE.
Le v’là !
FOUCHÉ.
Le diable l’emporte !
Scène VII
FOUCHÉ, CATHERINE, SAVARY, puis LEFEBVRE
SAVARY, accourt, essoufflé.
L’empereur n’est pas là ?
CATHERINE.
Non, m’sieu le duc !
FOUCHÉ, se retourne et, de sa plume, montre la porte du deuxième plan.
L’empereur est dans sa chambre.
SAVARY, inquiet, à mi-voix.
Ah çà ! qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi m’appelle-t-on ?
À Fouché.
Le savez-vous ?
FOUCHÉ.
Comment le saurais-je, si le ministre de la police l’ignore ? J’ai entendu parler, vaguement, de Neipperg...
SAVARY.
Neipperg ! C’est de l’histoire ancienne. Il est loin !
FOUCHÉ.
Eh bien, dites cela à l’empereur, tenez ! Ça lui fera plaisir.
SAVARY.
Il en doute ?
FOUCHÉ, qui s’est remis à écrire.
Peut-être !
SAVARY.
Bon ! Ce n’est que cela ? Je vais le rassurer !...
Il se dirige vers la porte de l’empereur, au moment où en sort Lefebvre.
LEFEBVRE.
Ah ! Savary ! Enfin ! Entrez vite ! L’empereur est très irrité de votre retard.
SAVARY.
Je vais le calmer d’un seul mot !
FOUCHÉ, à lui-même, tandis que Savary disparait.
Oui ? Je regrette de ne pas être là !
Scène VIII
CATHERINE, FOUCHÉ, LEFEBVRE, que Catherine interroge, sitôt la porte fermée
CATHERINE.
Eh bien ?
LEFEBVRE, pâle et s’essuyant le front.
Eh bien ! Il n’y a ni conseil de guerre, ni jugement. La voiture de Savary viendra le prendre, avec quatre agents de police, qui le remettront au peloton d’exécution. Celui-ci, que je vais former, attendra au rond-point de la Porte-Chapelle. Neipperg sera exécuté aux lanternes. Les soldats du génie creuseront la fosse au pied d’un arbre. Et, dans une heure, tout sera fini. Voilà ! Tonnerre, va ! Faut-il que ça tombe sur moi !
CATHERINE.
Et tu n’as pas dit à l’empereur ?...
LEFEBVRE.
Est-ce qu’il écoute ? Il m’a imposé silence, et, comme il avait sa voix des mauvais jours, j’ai dû me taire !
FOUCHÉ.
Mais Saint-Marsan a dû lui dire que j’avais à lui parler d’urgence ?
LEFEBVRE.
Il a même prononcé le mot de conspiration.
CATHERINE.
Oui ?
FOUCHÉ.
Eh bien ?
LEFEBVRE.
Eh bien ! L’empereur a haussé les épaules : « Voilà bien de mon Fouché, qui a toujours une conspiration dans sa poche pour tâcher de se rendre utile ! Dites-lui que je n’ai que faire de sa conspiration, ni de lui !... »
CATHERINE, épouvantée.
Mais alors ?
FOUCHÉ.
C’est la ruine de mon plan ! Et pas un mot de l’impératrice ?
LEFEBVRE.
Pas un !
CATHERINE.
Et elle n’ sait rien, celle-là ! Elle dort, pendant qu’on va tuer un homme pour elle !
FOUCHÉ.
Mme de Bulow est arrêtée ?
CATHERINE.
Eh ! Sans ça ! Je l’aurais déjà prévenue ! C’t’ impératrice ! N’y a plus qu’elle à présent pour sauver c’ malheureux !
LEFEBVRE.
Comment ?
CATHERINE.
Ah ! c’est son affaire ! Qu’elle s’arrange ! Tant pis ! J’y vas !
LEFEBVRE.
Où ?
CATHERINE.
Chez l’impératrice !
LEFEBVRE.
Toi ? Qu’elle connaît à peine ?
CATHERINE.
Eh ben, elle m’ connaîtra !
LEFEBVRE.
Et que lui diras-tu ?
CATHERINE.
Je lui dirai : « Tâchez donc d’ vous s’couer un peu, et d’ tirer de là votre amant ! »
LEFEBVRE.
Mais c’est fou !
FOUCHÉ.
Adoucissez !
LEFEBVRE.
Tu ne peux pas dire ça !
CATHERINE.
Pourquoi ?
LEFEBVRE.
C’est d’une audace !
CATHERINE.
C’est ben ça qui m’ gêne !
LEFEBVRE.
Si l’empereur apprend ?...
CATHERINE.
Y m’ fusillera pas, n’est-ce pas ! Et puis quand même ! J’y vas !
LEFEBVRE.
Catherine !...
FOUCHÉ, le retenant du geste.
Bah ! laissez-la faire !
Catherine ouvre la porte du fond, et l’on aperçoit Roustan, debout, qui garde la porte de l’impératrice.
LEFEBVRE, à mi-voix.
Roustan !
FOUCHÉ.
L’empereur a tout prévu !
CATHERINE, désolée.
À présent ! C’est fini ! Y a pus rien !
Elle tombe assise, au milieu, sur l’X, pleurant.
FOUCHÉ.
Peut-être ! Il nous reste encore l’évasion... et si le maréchal veut seulement ?...
LEFEBVRE.
N’allez pas plus loin, mon cher duc ! Le commandant du palais ne peut pas vous entendre. Je sors pour prendre les mesures dictées par l’empereur ; qu’en mon absence, à mon insu, le prisonnier s’évade, c’est votre affaire, la sienne, et celle de Savary... Dès que Neipperg sera livré à mes hommes, je ne connaîtrai plus que mon devoir de soldat, et je le ferai jusqu’au bout, si cruel qu’il soit ! Si vous m’épargnez cette douleur, votre joie n’égalera pas la mienne ! Mais, jusque-là, ne me dites rien ! Je ne dois, je ne veux rien savoir !
Il sort à grands pas, par la droite.
Scène IX
CATHERINE, FOUCHÉ, puis LAURISTON
FOUCHÉ.
Eh bien, soit ! passons-nous de lui !
CATHERINE, debout, vivement.
Vous auriez un moyen ?
FOUCHÉ.
Pas des meilleurs ! Mais nous n’avons pas le choix. Neipperg est là, n’est-ce pas ?
Il indique la porte.
CATHERINE, douloureuse.
Oui.
FOUCHÉ.
Et, au delà, c’est le grand vestibule ?... Combien sont-ils à le surveiller ?
CATHERINE.
Trois, je crois.
FOUCHÉ, après un geste de déception.
Enfin ! Essayons ! Il connaît votre écriture ?...
CATHERINE.
Oui !
FOUCHÉ.
Veuillez écrire ce que je vais vous dicter.
Il prend un cahier de papier blanc sur la table et le lui passe, sur un album cartonné, avec la plume, trempée dans un petit encrier de bronze.
CATHERINE, assise à droite, devant la table, sur un X, s’apprête à écrire, sur ses genoux.
Pas trop vite ! car l’écriture, c’est pas mon fort !
FOUCHÉ.
Vous y êtes ?
CATHERINE.
Oui.
FOUCHÉ, dictant.
« Faites semblant de vous assoupir. Dans un moment un homme viendra... »
Il s’interrompt.
Un homme à moi !
CATHERINE, tout en s’appliquant.
J’ comprends bien !...
FOUCHÉ, continuant à dicter.
« Sous prétexte d’un ordre à faire signer aux officiers... »
Il se penche, constate qu’elle a peine à se tirer du mot prétexte, et dicte.
Non... Prétexte !... Un x !...
Elle corrige comme elle peut. Penché sur elle, avec un geste de découragement.
Oui !... enfin !... Il comprendra !
Dictant.
« ... De service... »
CATHERINE, désolée.
Ah ! s’il avait voulu m’écouter !
FOUCHÉ.
« Profitez-en pour vous élancer au dehors. Prenez le corridor à droite... »
Rectifiant.
...ri, corridor...
CATHERINE, toute en larmes.
Attendez ! j y vois pus...
Elle essuie ses yeux. Fouché s’arrête un instant. Silence.
Allez maintenant !...
FOUCHÉ, reprenant sa dictée.
« Et réfugiez-vous chez la duchesse de Dantzig, où des amis vous rejoindront. » Cela suffit !
CATHERINE, hochant la tête.
Ah ! mon Dieu ! qu’ c’est donc chanceux !
FOUCHÉ.
Eh oui ! Mais je n’ai pas mieux ! Il s’agit maintenant de lui faire tenir ceci, à l’instant.
CATHERINE.
Sous les yeux de ces hommes ?
FOUCHÉ, en prisant.
Comment ? Je cherche !...
CATHERINE.
Attendez !... J’ crois que j’ai trouvé !...
FOUCHÉ.
Quoi ?
CATHERINE.
Appelez un des aides de camp !...
FOUCHÉ.
Ah bon !
Venu à la porte de droite.
Monsieur de Lauriston ?
LAURISTON, paraît.
Monsieur le duc ?
FOUCHÉ.
Mme la duchesse a deux mots à vous dire.
CATHERINE.
M’sieu d’ Lauriston, l’empereur, su’ ma d’mande, consent à c’ que m’sieu de Neipperg’ écrive à sa mère ses dernières volontés ; j’ vous prie d’ lui remettre ça de ma part.
Elle montre le cahier de papier sur l’album. Légère hésitation de Lauriston qui regarde Fouché.
FOUCHÉ, place sur le papier l’encrier de bronze, avec la plume, et remettant le tout à Lauriston.
Et ceci !
LAURISTON.
À l’instant !
Il sort par la droite.
CATHERINE, à Fouché, à mi-voix.
Comm’ ça, la première chose qu’y va voir en tournant la page...
FOUCHÉ, à mi-voix.
Si on ne l’a pas vu avant lui !...
CATHERINE.
Écoutons !...
Ils prêtent l’oreille.
Pourvu qu’ ça ne lui porte pas malheur, c’ qu’ j’ai dit là de sa pauv’ mère !...
Silence.
FOUCHÉ.
Non ! Rien !... Tout va bien ! Lauriston serait déjà revenu sur ses pas ! Maintenant, à mon tour ! Restez ici quelque temps aux écoutes. Et rentrez chez vous, où nous nous concerterons pour le reste. Allons ! courage !...
CATHERINE, en lui serrant la main.
Oh ! l’attente ! C’est ça qui tue !...
Derrière la porte de gauche, retentit une voix irritée.
L’empereur !
FOUCHÉ.
Je me sauve !...
Il sort par la gauche, premier plan.
Scène X
CATHERINE, L’EMPEREUR, SAVARY, SAINT-MARSAN, UN AIDE DE CAMP
L’EMPEREUR.
Est-ce compris ?
SAVARY.
Oui, sire, et, cette fois, Votre Majesté sera satisfaite.
L’EMPEREUR.
Je le souhaite pour vous !
Savary salue et sort, par la droite, avec Saint-Marsan et Mortemart. L’empereur descend d’un pas et aperçoit Catherine, qui lui fait une profonde révérence.
Scène XI
CATHERINE, L’EMPEREUR
L’EMPEREUR, soupçonneux.
Pourquoi êtes-vous encore ici, madame ?
CATHERINE.
Sire, j’avais attendu l’ maréchal ; mais à c’t’ heure...
L’EMPEREUR, brusque.
Restez ! Puisque le hasard vous a fait témoin de choses que vous ne devriez pas connaître...
Il s’arrête, pris dune idée subite.
et que vous connaissez peut-être depuis longtemps ?
CATHERINE.
Moi ?
L’EMPEREUR.
Oui ! Vous ne m’aviez pas dit que M. de Neipperg était de vos amis !
CATHERINE.
Votre Majesté ne m’ l’a pas demandé !
L’EMPEREUR.
C’est à ce titre qu’il est allé, ce soir, vous faire ses adieux ?... Ne dites pas non ! Je le tiens de votre mari.
CATHERINE.
Pourquoi que j’ dirais non, sire ?
L’EMPEREUR, de tout près.
Et, naturellement, il vous a confié la cause de son exil ?...
CATHERINE.
La vraie cause, non, sire.
L’EMPEREUR.
Il ne vous a pas laissé entendre qu’il s’agissait d’une femme ?
CATHERINE.
Ah ça ! oui !
L’EMPEREUR.
Ah !
CATHERINE.
Mais il ne m’a pas nommé la personne.
L’EMPEREUR, qui la regarde, les yeux dans les yeux.
N’essayez pas de ruser, et de vous dérober par des détours et des réticences, et répondez franchement, en honnête femme que vous êtes ! M. de Neipperg, sans prononcer le nom, ne vous l’a pas fait soupçonner ?
CATHERINE.
Non, sire !
L’EMPEREUR.
C’est invraisemblable !
CATHERINE.
Je dis non, parce que c’est non !
L’EMPEREUR.
Une autre est moins discrète que vous ! Cette femme, qui a eu l’impudence d’amener ici M. de Neipperg, je l’ai interrogée...
CATHERINE, frémissant.
Ah ?...
L’EMPEREUR.
Ceci vous trouble !... Eh bien ! voici ses aveux, en attendant les vôtres. À onze heures du soir, M. de Neipperg arrive en secret chez Mme de Bulow, déjà prévenue par l’impératrice, et lui dit : « Dès que l’empereur sera retiré dans sa chambre, conduisez-moi chez l’impératrice
Soulignant ces mots.
qui m’a bien recommandé de ne pas partir sans la voir ! »
CATHERINE.
C’te pauvr’ baronne, mourant d’ peur, a pu répéter tout d’ travers ce qu’on lui a dit ?
L’EMPEREUR, qui s’irrite de plus en plus.
Vous n’en croyez rien ! Sachant aussi bien qu’elle que Neipperg était attendu cette nuit ! Si audacieux que soit cet homme, eût-il parlé de la sorte, sans y être autorisé ? Jusqu’à quel point l’audace lui est permise ? C’est ce que j’ignore, mais ce que vous savez, Mme de Bulow et vous, qu’elle ne dit pas, et que vous allez me dire !...
CATHERINE.
Et comment donc qu’ je saurais ça ?
L’EMPEREUR, la voix dure.
Je veux la vérité ! quelle qu’elle soit ! la vérité tout entière ! Moi, votre empereur, moi, votre maître, je l’exige ! Entendez-vous ? je l’exige !...
Il lui a saisi le bras violemment.
CATHERINE.
Votre Majesté m’ fait mal ?
Il s’éloigne d’un pas.
M. de Neipperg ne m’a rien dit de c’ que croit Votr’ Majesté ! Ben au contraire ! Et ça, j’ l’ jure devant Dieu !
L’EMPEREUR.
Vous parlez comme cette femme !
CATHERINE.
C’est que...
L’EMPEREUR.
C’est que vous mentez toutes les deux, ayant le même intérêt à nier l’infamie dont vous êtes complices. Si bien que, vous m’abusant, cet homme mourant sans parler, l’impératrice n’avouant pas, je ne saurai jamais à quel point elle est coupable, et de quel crime je punis l’un, et dois punir l’autre ! J’ai le droit de tout croire, et ne suis sûr de rien ! Tous les soupçons, et, grâce à vous, misérables femmes, pas une certitude !...
Un silence, puis, d’un autre ton.
C’est ma faute ! J’ai manqué de sang-froid. Je devais rester là, dans l’ombre, permettre à cet homme d’entrer chez l’impératrice, et l’y surprendre. Leur premier cri les eût condamnés ! D’ailleurs, le fait seul de le recevoir la nuit chez elle !...
CATHERINE, nettement.
L’impératrice n’aurait jamais fait cela !...
L’EMPEREUR, ironique.
Croyez-vous ?
Nouveau silence.
Aussi bien, il ne tient qu’à moi d’en être sûr. Elle ne sait rien de ce qui s’est passé... Nous allons bien voir !...
Il remonte à la porte du fond, et à mi-voix.
Roustan !...
Roustan ouvre la porte, qui reste ouverte, et entre.
Amène ici Mme de Bulow...
Roustan passe chez l’Empereur.
CATHERINE, effrayée.
Vot’ Majesté veut ?...
L’EMPEREUR, la voix froide.
Je veux reprendre les choses où je les ai interrompues. Et, par l’ordre que l’impératrice va donner, tout ce que l’on me cache, c’est elle-même qui me l’apprendra.
CATHERINE, étouffée.
Oh ! sire ! Ce n’est pas bien, ce que vous faites-là !...
L’EMPEREUR.
Vous dites ?
CATHERINE.
J’ dis c’ qu’ j’ pense ! C’est pas digne de vous, ces traîtrises-là !
L’EMPEREUR.
Votre peur est déjà plus bavarde que vous !
Catherine se tait, Mme de Bulow entre, pâle.
Scène XII
L’EMPEREUR, CATHERINE, MADAME DE BULOW, ROUSTAN
L’EMPEREUR, fait un pas vers elle.
Venez ici ! Écoutez-moi bien ! Vous allez entrer chez l’impératrice, non par la porte des dames de service, mais par celle-ci
Il montre celle qui donne sur le corridor.
dont vous avez la clef !... Vous entendez ?
MADAME DE BULOW, glacée.
Oui sire.
L’EMPEREUR.
Vous laisserez cette porte ouverte, de telle sorte que je ne vous perde pas de vue, et vous direz à l’impératrice ceci, textuellement : « M. de Neipperg n’est pas parti, madame ; il est là, aux ordres de votre Majesté ! » Allez ! et pas un mot, pas un geste suspects ! J’ai l’œil sur vous !...
Mme de Bulow remonte lentement vers la porte de la chambre de Marie-Louise, qu’elle ouvre. L’empereur se tourne vers Roustan ; « Baisse cette lampe ! » Roustan obéit. Le cabinet redevient obscur. La baronne ouvre la porte de l’impératrice, avec une clef qu’elle tire de son corsage, elle laisse le battant à droite grand ouvert, puis monte sur l’estrade où est le lit. Dans la chambre, éclairée par une lampe, qu’on ne voit pas, on aperçoit, à droite, le lit aux rideaux de gaze bleue, où l’on devine Marie-Louise : Mme de Bulow se dirige vers la tête du lit. L’empereur, du seuil de son cabinet, observe, appuyé au chambranle, Roustan, immobile, derrière lui, Catherine à gauche, attentive et dévorée d’inquiétude.
MARIE-LOUISE, tirée de son sommeil.
Qui est là ? Est-ce vous, baronne ?
MADAME DE BULOW.
Oui Madame !... M. de Neipperg n’est pas encore parti ; il est là, aux ordres de Votre Majesté...
MARIE-LOUISE.
Ah ! Bien ! Attendez !
Catherine a un mouvement, que réprime, de loin, un coup d’œil terrible de l’empereur. Tout aussitôt, il se remet à observer la chambre de l’impératrice : Marie-Louise étend son bras nu, qui apparaît sortant de flots de dentelles, et prend sur le guéridon placé à la tête du lit une lettre à grand pli qu’elle tend à la baronne.
Remettez-lui ceci !...
MADAME DE BULOW.
Oui, madame.
Elle s’incline, redescend et referme la porte. Dès qu’elle a dépassé le seuil, l’empereur lui arrache la lettre des mains.
L’EMPEREUR, rudement.
Rentrez chez vous !...
La baronne s’éloigne par le corridor, à gauche, tandis que l’empereur revient dans son cabinet, dont la porte se referme, et que Roustan relève la mèche de la lampe. L’empereur vient à sa table. Dès que la lumière a reparu, il regarde l’adresse.
« À Sa Majesté l’Empereur d’Autriche. »
Stupéfait.
Son père ?...
Mouvement d’espoir de Catherine, qui, d’instinct, se rapproche. L’empereur tranche les liens de la lettre et lit.
« Monsieur mon très cher père. Le ministre actuel de la police ouvrant toutes les lettres que je vous adresse, j’ai recours au comte de Neipperg pour vous pointer celle-ci, qui, dans son propre intérêt, ne doit être lue que par vous. Des liens qui unissent sa famille à la nôtre, des rapports journaliers que nous avions à Schœnbrunn, le comte de Neipperg s’autorise pour m’imposer ses assiduités compromettantes, au point qu’elles ont attiré l’attention de l’empereur, et qu’aujourd’hui même, après m’avoir querellée à ce propos, Sa Majesté a sommé le comte de repartir pour Vienne. Je vous supplie de veiller à ce qu’il y séjourne désormais, et ne revienne jamais en France... Par là, vous rendrez un signalé service à votre fille soumise et respectueuse. Marie-Louise. »
À mesure que l’empereur lit, sa figure s’éclaire, celle de Catherine jusqu’au sourire.
CATHERINE, triomphante.
Quand j’ l’ai dit, qu’y avait rien entre eux !
L’EMPEREUR, ravi.
Oui, duchesse, oui, vous aviez raison ! Mais vous pouviez gager à coup sûr ! Quelle apparence que l’impératrice fût coupable ? Moi-même, à vrai dire, l’ai-je cru sincèrement ?...
CATHERINE, à mi-voix.
Ah ! ben ! pour du toupet ! En v’là.
L’EMPEREUR, à Roustan.
Appelle Saint-Marsan !
Roustan va à la porte de droite, l’ouvre, fait un signe, puis se range près de la cheminée.
CATHERINE.
J’ demande pas si Votre Majesté fait grâce ?
L’EMPEREUR, en repliant la lettre.
Ah ! certes, oui ! Au surplus, il a dû passer un vilain quart d’heure.
CATHERINE.
Qu’a bien duré deux heures !
L’EMPEREUR, à Roustan, en lui donnant la lettre.
Va chez moi recacheter ceci, et me le rapporte !
Roustan entre chez l’empereur.
Scène XIII
CATHERINE, L’EMPEREUR, SAINT-MARSAN paraît
L’EMPEREUR.
Faites venir M. de Neipperg !
SAINT-MARSAN.
M. de Neipperg n’est plus entre nos mains, sire.
CATHERINE, joyeusement.
Pardine ! Y s’a sauvé !
SAINT-MARSAN.
Il l’a tenté du moins. Mais il avait à peine franchi le seuil de la porte, qu’il s’est heurté aux hommes de M. le duc de Rovigo, qui venaient le prendre.
CATHERINE, saisie.
Oh ! mon Dieu !...
SAINT-MARSAN.
...Et qui l’ont fait monter en voiture et conduit à la Porte-Chapelle !...
CATHERINE, désolée.
Ils l’ont tué !
L’EMPEREUR.
Le malheureux ! Courez ! Lefebvre ! Où est Lefebvre ?
CATHERINE, éperdue.
Le v’là !
Scène XIV
CATHERINE, L’EMPEREUR, SAINT-MARSAN, LEFEBVRE puis SAVARY
L’EMPEREUR.
Vite ! Un homme à cheval ! Je fais grâce !
LEFEBVRE, douloureux.
Hélas ! trop tard, sire ! Maintenant, tout doit être fini !
SAVARY, entrant par la même porte, empressé et content de lui.
Oui, oui, c’est fait !
CATHERINE.
Ah !
Elle tombe assise sur le canapé, pleurant silencieusement, sa main dans celle de Lefebvre, qui est venu à elle.
SAVARY.
Votre Majesté est vengée !...
L’EMPEREUR, avec violence.
Et qui vous dit que je veux l’être ?...
SAVARY, déconcerté.
Quoi ?
L’EMPEREUR.
Cet homme est innocent !
SAVARY.
Je ne savais pas !
L’EMPEREUR.
Vous ne savez jamais rien !
SAVARY, reculant.
Sire, vos ordres, et le zèle...
L’EMPEREUR.
Vous n’êtes zélé que pour ces choses-là, et toujours trop pressé ! Témoin le fossé de Vincennes.
SAVARY.
Sire, ce que je viens de faire...
L’EMPEREUR.
Est stupide ! Et ce n’est pas Fouché qui l’eût fait.
Scène XV
CATHERINE, L’EMPEREUR, SAINT-MARSAN, LEFEBVRE, SAVARY, FOUCHÉ, entré sur les derniers mots
FOUCHÉ, avec une figure de circonstance.
Ah ! certes, non, sire ! Je sais trop que, prompte aux justes colères, Votre Majesté l’est aussi à la clémence, et qu’avec Elle, il faut toujours en appeler de César à Auguste. Posté à la grille du château, j’ai vu
Ému.
ce malheureux jeune homme, dans la voiture de M. de Rovigo, entre ses agents – d’anciens agents à moi – et je pensais : – Dire qu’un mot suffirait pour épargner à l’empereur un grand regret ! « Monsieur est libre ! Sa Majesté fait grâce ! »
L’EMPEREUR.
Eh ! oui, voilà ce qu’il fallait dire !
FOUCHÉ, humble.
Mais à quel titre, sire ? À moins d’ajouter : « Nous n’avez plus d’ordres à recevoir de M. de Rovigo ! Le ministre de la police, ce n’est plus lui, c’est moi ! »
L’EMPEREUR.
Eh ! Que ne l’avez-vous dit ! C’était la vérité ! Vous l’êtes, et monsieur ne l’est plus !
Savary sursaute.
FOUCHÉ.
Et Votre Majesté m’aurait pardonné cette anticipation de pouvoirs ?
L’EMPEREUR.
Ah ! certes, oui !
FOUCHÉ, hardiment.
Alors, tout va bien, sire ! C’est fait !
L’EMPEREUR.
Quoi ?
CATHERINE, debout.
Hein ?
FOUCHÉ.
M. de Neipperg roule vers Soissons, dans la voiture que veut bien lui prêter M. le duc de Rovigo.
L’EMPEREUR, enchanté.
Pardieu ! Voilà d’un maître homme !
CATHERINE, serrant la main de Fouché.
Ah ! c’est bien, ça ! Ah ! Que c’est donc bien !
Roustan a reparu.
L’EMPEREUR, à Savary.
Un courrier, vite ! Qu’il rejoigne la voiture de M. de Neipperg, et lui remette cette lettre, pour l’empereur d’Autriche !
Roustan la donne à Savary.
CATHERINE, désignant l’épée restée sur la table.
Vous n’ lui rendez pas aussi son épée, sire ?
L’EMPEREUR.
Si fait ! À condition qu’il en fera un meilleur usage !
Il la remet à Saint-Marsan, qui salue et sort. Savary s’approche de Fouché.
SAVARY, exaspéré, à mi-voix.
En somme, vous avez usurpé mes fonctions ?
FOUCHÉ, en ouvrant sa tabatière.
Toutes ! Mon cher duc ! Toutes !...
Savary sort, très mécontent, après avoir salué l’empereur, qui lui tourne le dos et vient à Fouché.
Scène XVI
CATHERINE, L’EMPEREUR, LEFEBVRE, SAVARY, FOUCHÉ, ROUSTAN
L’EMPEREUR, à Fouché, en puisant dans sa tabatière.
N’importe, duc d’Otrante, vous risquiez gros, si je ne m’étais pas décidé à la clémence !
FOUCHÉ, à mi-voix.
Le cas était prévu, sire. Je rattrapais notre homme à Soissons.
Il prise.
L’EMPEREUR, souriant et prisant en même temps que lui.
Ce Fouché pense à tout ! Décidément, vous êtes un habile homme !
FOUCHÉ, gaiement.
J’ai pourtant trouvé plus habile que moi, sire.
L’EMPEREUR.
Qui donc ?
FOUCHÉ, montrant Catherine.
La Duchesse !
L’EMPEREUR, vient à elle et lui pince l’oreille.
Oui, oui ! C’est une rusée, que j’aime bien !
LEFEBVRE, ravi.
Alors, sire ?
L’EMPEREUR.
Garde-la précieusement ! Tu ne retrouverais pas la pareille !
CATHERINE, à Lefebvre, pendant que l’empereur, incliné, lui baise la main.
Hein ! Ça t’ la coupe !
L’EMPEREUR, riant et appuyant sur le mot.
Bonsoir, Duchesse ! Bonne nuit, messieurs !
CATHERINE, dans une révérence.
Et vous pareillement, sire !
À Lefebvre.
Ouf ! Allons nous coucher ! Nous ne l’avons pas volé !
Lefebvre prend la pelisse de sa femme et la lui jette sur les épaules. Catherine donne la main à Fouché, cependant que l’empereur s’en va chez l’impératrice.