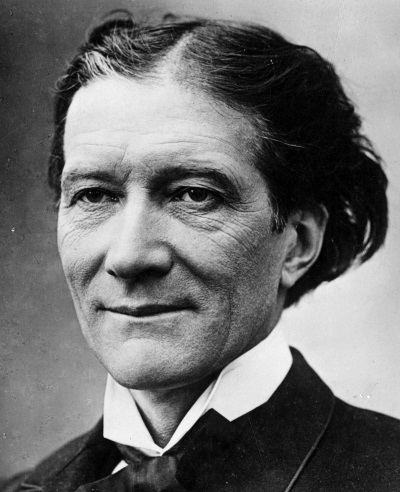Les Ganaches (Victorien SARDOU)
- ACTE I
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- ACTE II
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- Scène XI
- Scène XII
- Scène XIII
- Scène XIV
- Scène XV
- Scène XVI
- ACTE III
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
- Scène X
- Scène XI
- Scène XII
- Scène XIII
- Scène XIV
- Scène XV
- ACTE IV
- Scène première
- Scène II
- Scène III
- Scène IV
- Scène V
- Scène VI
- Scène VII
- Scène VIII
- Scène IX
Comédie en quatre actes.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du gymnase, le 29 octobre 1862.
Personnages
LE MARQUIS DE LA ROCHEPÉANS
MARCEL САVALIER
FROMENTEL
LE DUC DE LA ROCHEPÉANS
LÉONIDAS VAUCLIN
URBAIN FROMENTEL
DE VALOREUSE
BARILLON
BOURGOGNE
UN DOMESTIQUE
MARGUERITE
ROSALIE DE FORBAC
La scène est à Quimperlé, de nos jours.
ACTE I
Un salon de rez-de-chaussée, ameublement Louis XVI. Portraits de famille. Au premier plan, à droite du spectateur, une grande cheminée avec du feu. Au premier plan à gauche, fenêtre sur le jardin. Dans le pan coupé à droite, porte d’appartement. Dans le pan coupé à gauche, porte sur un vestibule qui conduit au jardin. Porte d’entrée au fond. À gauche, une table de jeu toute dressée, avec les deux chandeliers, les cartes, la boîte, etc., et trois chaises autour de la table. C’est en hiver ; il fait nuit, le feu et les bougies sont allumées. Devant le feu, un large fauteuil ; le pareil à l’extrême droite, dans le coin de la cheminée.
Scène première
MARCEL, BARILLON, BOURGOGNE
Au lever du rideau, Bourgogne est en scène et achève de ranger la table de jeu. La porte du fond est ouverte, et Barillon paraît sur le seuil avec Marcel. Un domestique en costume breton paraît au fond et leur montre Bourgogne.
BARILLON, à Bourgogne.
Est-ce que M. le Marquis de la Rochepéans n’est pas chez lui ?
BOURGOGNE.
Que monsieur me pardonne : on n’a pas pu dire à monsieur que M. le Marquis n’était pas chez lui ; on a dû lui dire que l’on ne savait pas si M. le Marquis pourrait recevoir ces messieurs. Et si ces messieurs veulent bien dire leurs noms...
BARILLON.
Est-ce que vous ne me reconnaissez pas, monsieur Bourgogne ?
BOURGOGNE, le reconnaissant.
Oh ! que monsieur me pardonne ! – Monsieur, si je ne me trompe, est le premier clerc de maître Honorin, le notaire de Vannes, qui a charge des affaires de M. le Marquis ?
BARILLON.
Précisément. – Je succède à maître Honorin et je viens rendre mes devoirs à votre maître.
BOURGOGNE, regardant Marcel.
Et qui aurai-je l’honneur d’annoncer avec monsieur ?
BARILLON.
Monsieur est de mes amis. Il arrive de Paris et désire parler à M. le Marquis, à qui d’ailleurs il est inconnu.
À Marcel.
N’est-ce pas ?
Marcel s’incline en signe d’assentiment.
BOURGOGNE.
Si ces messieurs veulent prendre la peine d’attendre une petite minute, je vais prévenir monsieur, qui est à table.
Scène II
MARCEL, BARILLON
BARILLON.
Il fallait donc le dire tout de suite !
MARCEL.
Voilà un vieux serviteur qui fuit consciencieusement son devoir !
BARILLON, à la cheminée.
Est-il solennel, hein ?... « Je demande pardon à ces messieurs – de demander à ces messieurs... ce que demandent ces messieurs... »
MARCEL.
Il n’est pas trop changé, ce pauvre Bourgogne !
BARILLON, surpris.
Tu le connais ?
MARCEL.
Sans doute, et depuis l’enfance ! – Quand nous nous sommes rencontrés tout à l’heure sur le seuil de cette grande porte, que j’hésitais un peu à franchir, le plaisir de retrouver un ancien ami ne m’a pas laissé le temps de te rappeler que je suis un enfant de Quimperlé, moi !
BARILLON.
Eh ! c’est ma foi vrai ; et un compatriote qui nous fait honneur ! – Vertudieu ! mon gaillard, comme nous marchons ! Ingénieur en chef de l’une de nos grandes compagnies de chemin de fer, décoré, et déjà célèbre à l’âge où l’on est à peine connu !...
MARCEL, l’interrompant.
Eh bien, pour laisser là ma célébrité, mon grand-père était intendant des la Rochepéans, avant la révolution... la grande !...
BARILLON.
Ah ! bah !
MARCEL.
Mon père, lui, suivit une tout autre voie, tu le sais. On s’est perdu de vue naturellement, sans grande sympathie réciproque, et je ne tiens pas à rappeler ces souvenirs au Marquis pour la petite affaire qui m’amène...
BARILLON.
Si mes services peuvent... ?
MARCEL.
Merci, ce n’est pas de ton ressort. Je te conterai cela tout à l’heure, à table ; car j’espère bien que nous dînons ensemble. Je ne pars pour Brest qu’à dix heures, et...
BOURGOGNE, rentrant.
M. le Marquis prie ces messieurs de l’attendre ; il achève de souper avec M. le Duc.
BARILLON.
C’est bien, nous attendrons !
Il ôte son paletot et le remet à Bourgogne, qui sort.
MARCEL, étonné.
Le Duc de la Rochepéans ? le père du marquis ?
BARILLON, assis dans le fauteuil devant le feu.
Oui !
MARCEL, allant à lui.
Il existe encore.
BARILLON.
Mais oui : un peu fossile par exemple, un peu radoteur ; et revenant de temps en temps, comme le père d’Hamlet, pour raconter une petite histoire qui n’est pas toujours de saison... Mais enfin, vieux bonhomme vit encore.
MARCEL.
Il a au moins quatre-vingt-quinze ans !
BARILLON.
À peu près ! – La province conserve !
MARCEL, s’asseyant à droite, dans le fauteuil qui est au coin de la cheminée.
C’est vrai.
Il y a bien cinq ou six ans que je n’étais veau à Quimperlé voir mon brave père, et j’ai tout retrouvé dans le même état, hommes et choses ! – Ici le métier d’un tisserand dont je reconnaissais le bruit... là, une vieille figure à lunettes, assise dans le même fauteuil, derrière la même vitre ; plus loin, une enseigne bien connue... et le vieux puits où j’ai jeté si souvent des pierres ! – Tandis que je cherchais à me reconnaître : dans ce dédale de rues tortueuses, étroites, mal pavées, mes instincts d’ingénieur se révoltaient contre la routine provinciale : j’aurais tout bouleversé !... Et pourtant, dans un petit coin de mon cœur, je ne sais quelle émotion plaidait pour ces bonnes vieilles connaissance qui semblaient m’attendre au passage et me dire : « Eh Marcel ! sois le bienvenu chez toi, mon garçon ! Te voilà donc de retour ? Rien n’est changé, tu vois, et nous t’aimons toujours. »
BARILLON.
Ah bien, la maison du Marquis doit faire ton bonheur !
MARCEL.
Eh oui ! j’ai reconnu avec plaisir le marteau de la porte, le heurtoir, comme nous disions, nous autres gamins, en le cognant à tout rompre pour faire enrager Bourgogne. Et la mousse !... et l’herbe de la cour !
BARILLON.
En cherchant bien, en en trouverait dans le salon. Quels bons meubles, hein ! la pendule... Depuis qu’elle est arrêtée, il y pousse des champignons !... Mais le mobilier n’est rien, ce sont les habitants que je te recommande.
MARCEL.
Les habitants ?... Combien donc en comptes-tu ?
BARILLON.
Mais d’abord ici et au-dessus, le Marquis et son père, qui ne se sont réservé que ce rez-de-chaussée et le premier étage avec le jardin de l’hôtel. Au second, le sieur Fromentel, veuf et rentier, et son fils Urbain. Au troisième, le docteur Vauclin, et sur le même palier, mademoiselle Rosalie de Forbac, une cousine éloignée des la Rochepéans, recueillie par charité. Tu connais le Marquis ?
MARCEL.
Très mal !... et seulement par ce que m’en a dit mon père, que je soupçonne un peu de partialité.
BARILLON, se levant et l’amenant sur le devant de la scène, en laissant un peu la voix.
Oh ! bien alors, un léger croquis peut t’être de quelque utilité pour ce qui t’amène. – En 1827, M. le Marquis Henri de la Rochepéans était un fort beau garçon, spirituel, charmant, officier dans les gardes da corps, et en passe d’arriver à tout par le mérite que lui reconnaissaient les dames... 1830 éclate comme une bombe ! et patatras !... voilà mon homme désarçonné ! Persuadé que ceci est tout au plus un petit orage qui ne saurait durer, il quitte Paris, en jurant de n’y rentrer qu’avec son roi, et se retire à Quimperlé. La France ne s’en émeut guère ! Héroïque dans sa foi, cramponné avec un entêtement sublime à une branche qui ne veut pas refleurir, le voilà depuis trente ans enterré dans son trou de province. Savoir, esprit, mérite, vertus, rien ne lui manque, rien ne sert !... Comme sa pendule : tous les ressorts y sont, mais adieu le mouvement !
MARCEL.
Et probablement l’entourage ?... ce médecin ?...
BARILLON.
Ah ! le médecin ?... Je te présente le docteur Léonidas Vauclin, fils du citoyen Vauclin, greffier du tribunal révolutionnaire de Vannes en 93, puis secrétaire du club des Jacobins.
MARCEL.
Oh !... Et Léonidas ?
BARILLON.
Engagé volontaire après thermidor et chirurgien des armées de la république, le fusil d’une main, la trousse de l’autre, jusqu’en 1804, où il rentre dans ses foyers pour ne pas autoriser par sa présence la transformation de Bonaparte en Napoléon ; et depuis, comme avant, voué au Spartiate à perpétuité. Matérialiste et, comme Clootz, ennemi personnel de Dieu, qui n’a qu’à bien se tenir... Qu’on ne lui parle pas, monsieur, des clochers, des cloches, ni des curés !... Rasés les clochers !... Des canons avec les cloches !... Un fusil sur l’épaule des curé ! Et en avant marche ! sur l’ennemi !... et au besoin sur l’ami ! car pour un principe, monsieur, il ferait sauter toutes les têtes de Quimperlé... à commencer par la sienne !
MARCEL.
Et le troisième ?
BARILLON.
Oh ! celui-là n’est pas méchant, et entre les deux premiers, l’un qui monte toujours à l’assaut, l’autre qui descend toujours à reculons, celui-là le présente assez bien...
MARCEL.
Celui qui va d’un pas raisonnable !
BARILLON.
Pas du tout !... Celui qui va de travers... Nicolas Fromentel, rentier, millionnaire, enrichi dans les conserves alimentaires pour la marine, est né à Quimperlé vers 1800, un journal à la main et un shako de garde national sur la tête. À trente ans, commis marchand à Paris, il n’était pas content de Charles X et faisait la révolution de 1830 avec enthousiasme, pour en être un peu fâché le lendemain. Aussi a-t-il bien pris sa revanche la 24 février, en renversant le gouvernement de son choix, avec le même enthousiasme... pour en être tout à fait désolé une heure après. – Fromentel n’a qu’une note, mais il en joue bien !... Ça ne va pas ! Ça va mal ! Ça ne va plus comme de son temps ! – Ajoute à cela l’incurable ennui d’un vieux commerçant qui n’a plus ni légumes à conserver, ni gouvernement à démolir : peuple sa solitude d’un garnement de fils qui lui fait de l’opposition pour être fidèle aux traditions de la famille ; et tu vois d’ici ce personnage éternel qui fait toutes les révolutions, ne profite d’aucune, et sert à tort et à travers la cause du progrès... sans jamais y rien comprendre !...
MARCEL.
Ah çà !... comment le Marquis a-t-il de pareils locataires ? Tout ce monde-là doit s’égorger dans l’escalier !...
BARILLON.
Eh bien ! non. Tu vois ces trois sièges...
Il désigne table de jeu et les trois chaises qui sont autour.
MARCEL.
Oui !
BARILLON, s’asseyant sur la chaise du milieu qui fait face au spectateur.
C’est là qu’ils viennent s’asseoir tous les jours, après souper, pour passer ensemble la soirée !
MARCEL, s’asseyant sur la chaise de droite.
Dans le salon du Marquis ?
BARILLON.
Dans le salon du Marquis !
MARCEL.
Et quelle raison ?...
BARILLON.
Ah ! d’abord, le Marquis et le Docteur ne sont pas ennemis ; loin de là ! – Sous le Directoire, Vauclin vint à passer dans cette rue, au moment où un enfant de dix ans, tombé d’une fenêtre et suspendu par un pan de sa jaquette à demi déchirée, allait choir sur le pavé ; mon Spartiate le reçut dans ses bras : c’était le Marquis ! – De là une affection réciproque, favorisée par la familiarité que justifiait leur âge autant que les habitudes de l’époque ; et plus tard une vaillante amitié qui a su résister à toutes les atteintes. – Ce sont, il est vrai, des discussions quotidiennes. Mais le Docteur ne souffrirait pas qu’un autre que lui se levât la nuit pour soigner son animal d’aristocrate, et le Marquis n’accepterait pas d’un autre que de son infâme démagogue la potion qui doit le soulager.
MARCEL.
Oui ; bien... mais le sieur Fromentel ?
BARILLON.
Nous y arrivons ! – On se réunissait le soir, pour faire un whist à trois, avec le vieux Duc. On jouait le mort ! – Le Duc radotait un peu, mais enfin l’on jouait. Un soir le Duc s’endort sur son jeu ; coup de foudre !... on joue bien avec un mort, on ne joue pas avec deux. Il faut à tout prix remplacer le Duc et trouver un troisième : mais lequel ?... On essaye d’abord de M. le sous-préfet, pour qui l’on sait trouver un sourire : joli joueur, mais faisant l’éloge du gouvernement à chaque levée ! – Pour des hommes d’opposition, ce n’était pas tenable !... Il fallut bien se rabattre sur l’abbé Fournel, vicaire de l’église Sainte-Croix et directeur du vieux Duc ; mais un soir Léonidas voulut absolument lui faire avouer qu’il n’y a pas de Dieu ! – Sur ce, discussion, rupture ! — Arrive Fromentel, qui loue le premier étage ! – Un joueur émérite !... quelle trouvaille !... Enrichi dans les comestibles, c’est vrai, mais du moins toujours mécontent, celui-là ! On est sûr qu’il ne fera l’éloge de rien, ni de la terre, ni du ciel ! – Et voilà comment s’est constitué ce tapis vert, qui représente en petit tout un parlement. – LE MARQUIS à droite... le Docteur à gauche... Fromentel au centre et vis-à-vis, le mort, qui est là, mélancoliquement, pour leur rappeler à tous le néant des discussions humaines...
Il se lève et redescend la scène.
MARCEL.
Et de femmes... point ?...
BARILLON.
Si ! la Forbac ; mais est-ce bien une femme ? – Une vieille fille de province dont personne n’a voulu, bigote, cancanière, et ne désespérant pas de faire tester le Marquis en faveur de je ne sais quelle société, dont elle est fondatrice, pour le salut des demoiselles... égarées... jamais de celles qui sont en détresse !... Enfin, charitable à la façon de ces philanthropes qui donnent pour le rachat des petits Chinois dix centimes dont ils ne feraient pas l’aumône à un petit Français : tu vois cela d’ici.
On entend frapper un coup.
MARCEL.
Qu’est-ce que cela ?
BARILLON.
C’est le marteau, ton heurtoir, qui t’annonce un visiteur pour le Marquis.
MARCEL.
Ou le Docteur.
BARILLON.
Non !... non !... un coup pour le premier et le rez-de-chaussée ; deux coupe pour le second ; trois pour le troisième. Tu as oublié ta province... C’est à chaque locataire d’ouvrir sa porte : cela supprime le concierge !
MARCEL, riant.
C’est peut-être un progrès ! – Mais je te quitte.
BARILLON.
Déjà ! — Tu n’attends pas ?
MARCEL.
Non ! le Marquis tarde trop. J’ai deux confrères chez moi qui s’impatientent, et puis ce que tu m’as dit de ses opinions... Non... décidément, je ne le verrai pas ! Et je laisserai seulement ma carte à Bourgogne.
Il montre la porte de gauche par où est sorti Bourgogne.
Viens-tu ? – Tu verras le Marquis demain matin !...
BARILLON.
Oh ! moi ! impossible !... demain matin, le Marquis serait seul ! Il faut que je voie mes trois hommes réunis. C’est une jeune fille à recommander. Ils ont tous une raison de s’intéresser à elle ; reste à savoir lequel est le plus capable... le plus digne... Enfin... c’est très délicat !
MARCEL.
Comment, nous ne dînerons pas ensemble ?
BARILLON.
Pas ce soir.
MARCEL.
Alors, à mon retour, dans quinze jours !
BARILLON.
À Vannes ! – car moi aussi je repars ce soir !...
MARCEL.
Eh bien, à Vannes, soit ! – C’est mon chemin, et j’irai te demander l’hospitalité en retournant à Paris.
BARILLON.
Ah ! bravo ! Mais mon adresse ! Attends !...
MARCEL.
Bah ! un notaire !...
BARILLON.
C’est vrai ! – Ah ! à propos de notaire... Dis donc... tu n’est pas marié ?
MARCEL, prêt à sortir, sur le seul.
Oh ! Dieu... jamais de la vie !
BARILLON.
Pourquoi cette horreur ?
MARCEL, riant.
Bah ! un ingénieur, pourquoi faire ?
BARILLON, le ramenant.
Non ! – Mais sérieusement... veux-tu que je te marie ?
MARCEL.
Sérieusement ! ma foi, non !
BARILLON.
Une jolie fille ! dix-huit ans !....
MARCEL.
Ta protégée !... non ! non !
BARILLON, insistant.
Orpheline ! pas de parents !
MARCEL.
Non ! non ! non !
BARILLON.
Allons ! bonne chance !
MARCEL.
Tu vois !... je prends le bon moyen !
BARILLON.
Adieu !
MARCEL, sortant.
Au revoir !
BARILLON, seul, retournant à la cheminée.
Charmant garçon ! – Je l’aime tout plein, moi... et on se retrouve avec un plaisir !...
Scène III
BARILLON, URBAIN
URBAIN, entrant par le fond ; il parle à Bourgogne, et tient à la main un cigare.
Allons, c’est bon ! Puisque je vous dis qu’il est éteint, mon cigare.
BARILLON, assis et lisant une brochure.
Ah ! ah ! c’est l’aimable Urbain Fromentel.
URBAIN.
Dieu de dieu ! sont-ils encroûtés dans cette maison-là ! Une bicoque où on ne fume pas après dîner !... Oh ! la la ! si ça ne fait pas mal, au dix-neuvième siècle !...
Il s’assied dans le fauteuil à droite, au coin de la cheminée.
BARILLON, à part.
Toujours gentil !
URBAIN.
Dis donc, papa !
Plus haut.
Papa !
Regardant.
Tiens ! c’est Barillon, mon ex-maître clerc !... Oh ! cette rencontre ! Je vous prenais pour papa.
BARILLON.
Il n’y a pas de mal.
URBAIN.
Ah ! cristi ! si... il y a du mal ; si vous le connaissiez ! – Comment vous va ? hein !
BARILLON.
Et vous-même ?
URBAIN.
Oh ! moi, fameusement bien, depuis que j’ai quitté votre satanée étude... Cette idée du père Fromentel de me fourrer chez Honorin ! Aussi je l’ai balancé, Honorin... sans balancer. Tiens ! c’est un petit mot. – Ah ! c’est gentil, ça ne vous fait pas rire ?...
BARILLON.
Pas aux éclats !...
URBAIN, à part.
Il ne comprend pas ! – Est-il bête !... Notaire... va !
BARILLON.
Et qu’est-ce que vous faites maintenant, jeune Urbain ? Indépendamment des jolis petits mots ?
URBAIN.
Je m’embête.
BARILLON.
Ça, c’est un gros mot !
URBAIN.
Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse dans une fichue ville comme ça, quand on est intelligent comme moi ! – C’est vieux ! c’est encroûté ! Je végète ici ; mes facultés s’éteignent : et quand on a quelque chose là...
Il se frappe le front en se levant.
Seulement il n’y a rien là !
Il se frappe le gousset.
BARILLON.
Ah ! voilà le mal !
URBAIN, passant à gauche.
Voilà ! Et le père Fromentel ne veut pas entendre parler de Paris ! Ah ! cristi, si j’étais à Paris !...
BARILLON, debout et descendant.
Qu’est-ce que vous feriez ?
URBAIN.
Ce que je ferais ?... Je ferais de la littérature, donc !
BARILLON.
Ah ! bah !
URBAIN.
Un peu !
BARILLON, à part.
Oh ! oui, très peu...
URBAIN.
L’art est dans le marasme ! Il est bien temps que les jeunes s’en mêlent, et que nous fondions la littérature du dix-neuvième siècle.
BARILLON.
Tiens, moi qui croyais que Balzac, Lamartine, Musset, George Sand...
URBAIN, avec mépris.
Oh ! les vieux !... Avec ça qu’ils sont forts !
BARILLON.
Dites donc, Urbain, j’ai vu de vos copies chez maître Honorin.
URBAIN.
Eh bien ?
BARILLON.
Eh bien ! l’orthographe !... hein ! c’est ça qui était jeune !
URBAIN.
Peuh ! l’orthographe !... avec ça que Corneille la savait, l’orthographe ! – On se raccroche au style.
BARILLON.
Ah ! si on se raccroche !
URBAIN, mystérieusement.
Dites donc... lisez-vous quelquefois la Sentinelle de Quimperlé ?
BARILLON, de même.
Jamais !
URBAIN, de même.
Eh bien ! c’est moi qui fais la Correspondance parisienne sous le nom de Quasimodo !
BARILLON, de même.
Que me dites-vous là !
URBAIN.
Parole d’honneur ! et ça vous a un fameux chic, allez !... C’est écrit à la gentilhomme... à la va te faire fiche !
BARILLON.
Et l’abonné vous prend au mot.
URBAIN.
Tiens, c’en est encore un de mot !
BARILLON.
Vous croyez ?
URBAIN, tirant son calepin.
Positivement, c’en est un ! Vous me le donnez ?...
BARILLON.
Gratis ! – Fourrez-moi ça dans la Sentinelle, ça fera bien.
URBAIN, écrivant.
Ah ! si le père Fromentel n’était pas un vieux grigou, avec tout ce que j’entasse de matériaux, j’irais à Paris fonder un journal à moi !... Je deviendrais influent : j’aurais mes entrées dans les théâtres, chez les actrices !... Et je ferais jouer mes pièces comme les autres...
BARILLON.
Oui ! mais si on ne vous jouait pas ?
URBAIN.
Alors j’éreinterais les autres : ce serait toujours ça.
On entend tousser au dehors.
BARILLON.
Chut ! Voici papa qui tousse !
Scène IV
BARILLON, URBAIN, FROMENTEL
FROMENTEL, entrant en toussant et de mauvaise humeur.
Mais voilà un froid !... Mais quel froid !... Mais de mon temps, au mois de mars, il ne faisait jamais si froid que cela !...
BARILLON.
Le fait est que ce soir...
FROMENTEL, allant à la cheminée, sans voir son fils.
Je suis enrhumé, tenez !... moi qui n’ai pas su pendant trente ans ce que c’était qu’un rhume !
BARILLON, allant à lui.
Je crois bien, monsieur Fromentel, vous me parlez d’une époque... où l’hiver était bien plus doux.
FROMENTEL, vivement, le dos au feu.
Il n’y a pas de comparaison, monsieur !
BARILLON.
C’est seulement depuis 48...
FROMENTEL.
Positivement ! Il s’est fait un changement dans la température. Il pleut, et puis il neige, et puis il tonne, et puis il grêle... On n’a jamais vu ça...
BARILLON.
Entre nous, est-ce bien étonnant ?
FROMENTEL.
Mais ce n’est pas étonnant du tout avec le déboisement des forêts !...
BARILLON, regardant la tête de Fromentel.
Oui... Et le déboisement des crânes !
FROMENTEL.
...Et le déboisement...
Il porte la main à son crâne.
Oui, l’un entraîne l’autre !
BARILLON.
Parbleu ! vous supprimez les arbres, n’est-ce pas, qui arrêtent le vent...
FROMENTEL.
...Alors le vent arrive avec une violence !...
BARILLON.
...Il ne faut plus qu’un malheureux courant d’air !...
FROMENTEL.
...Et vous avez la grippe !...
BARILLON.
C’est clair !
FROMENTEL.
Et ça s’appelle un gouvernement !
Il tousse.
Gredins, va, m’ont ils enrhumé !...
URBAIN, à Barillon, à demi-voix.
Eh bien, vous ne le faites pas mal poser, vous !...
FROMENTEL, l’apercevant.
Ah ! te voilà, polisson !
URBAIN.
Oui, papa.
FROMENTEL.
Où as-tu déjeuné ce matin ? Où as-tu dîné ce soir ?
URBAIN.
J’ai dîné en ville, papa.
FROMENTEL.
Où ça, en ville ?
URBAIN.
Chez une dame qui me veut du bien.
FROMENTEL, grommelant et remettant une buche au feu.
Une dame... Ta blanchisseuse ?
URBAIN.
Ce n’est pas une blanchisseuse ; c’est la cafetière du café du Commerce.
À Barillon.
Une femme... Je vous ferai voir ça... Elle s’appelle Clotilde !...
Il remonte et va s’adosser à la cheminée.
FROMENTEL, après avoir cherché du côté de Barillon à qui il s’adresse d’abord, retrouvant Urbain à la cheminée.
Je t’en donnerai, moi, des cafetières... Regardez moi ça... Quelle mine !... C’est échiné !... c’est courbé !... c’est vert-de-gris ! et ça n’a pas vingt ans !... Où as-tu passé la nuit dernière, grand vaurien ?
URBAIN.
Oh ! je suis rentré hier au soir à dix heures, papa.
FROMENTEL.
Ce n’est pas vrai, garnement ! À dix heures et demie j’ai regardé ton trou à la serrure, et ta cheville n’était pas dans le trou !
URBAIN.
Oh ! par exemple !
FROMENTEL.
Elle n’était pas dans le trou !...
URBAIN.
Eh bien, je l’ai oubliée, quoi !
Quittant la cheminée pour aller à Barillon.
C’est trop bête aussi ! Est-ce qu’ils n’ont pu imaginé de percer dix trous à la porte, en dedans, autant que d’habitants dans la maison : à chacun son trou, avec un petit morceau de bois pendu à côté, pour boucher son trou en rentrant ; et quand toutes les chevilles sont dans tous les trous, c’est que tout le monde est rentré et qu’on peut tirer les verrous... Est-ce assez ridicule, une invention pareille, au dix-neuvième siècle !
FROMENTEL.
De mon temps, monsieur, on ne découchait jamais.
URBAIN, remontant.
Oui ! je t’en moque !
Il va à la table de whist et fait un lansquenet pendant ce qui suit.
FROMENTEL, descendant, à Barillon.
Mais voilà la jeunesse d’aujourd’hui, monsieur ! Et on favorise ces choses-là. Ça entre dans leurs idées ! Ils sont contents !... Ils se frottent les mains !... Ils se disent : « Le fils Fromentel ne rentre pas !... Bon ! encore un garnement dont nous ferons ce que nous voudrons... »
BARILLON.
Vous croyez qu’ils en feront quelque chose ?
FROMENTEL.
Oh ! je n’en sais rien ; moi, je n’ai jamais pu rien en faire !
BARILLON.
Bah ! Il a du pain sur la planche, et avec vos rentes !...
FROMENTEL.
Oui, parlons-en, de mes rentes. Vous n’avez pas de rentes, vous !... Vous êtes bien heureux !... Vous n’êtes pas obligé de jouir de la vie... Moi, je jouis de la vie...
Il tousse.
C’est amusant !
BARILLON.
Occupez vous... Le jardinage, la culture...
FROMENTEL, grommelant.
Eh bien ! oui, je cultive des ananas dans la serre !...
BARILLON.
Eh bien ?
FROMENTEL.
Eh bien, il vient quelque chose qui ressemble à des carottes !... Il n’y a plus de culture, monsieur !... La terre est épuisée !...
BARILLON.
Pourtant, la campagne !
FROMENTEL.
Mais il n’y a plus de campagne, monsieur ! – Où voyez-vous la campagne ?... Il n’y a plus que des villes !...
BARILLON.
Enfin, les paysans ?...
FROMENTEL.
Mais il n’y a plus de paysans, monsieur !... Ils sont tous maçons...
Il tousse.
Ah ! les gredins ! nous faire tousser comme ça !
Scène V
BARILLON, URBAIN, FROMENTEL, VAUCLIN
VAUCLIN, entrant, brusque et légèrement railleur ; grande redingote noire, souliers lacés, gilet blanc, cravate blanche roulée en corde.
Bonsoir, messieurs !...
Apercevant Urbain.
Ah ! te voila, toi !
URBAIN, continuant à jouer tout seul.
Mais oui, docteur.
VAUCLIN.
Oui !... Eh bien, tu as une jolie figure, parlons en ! Va toujours ce train-là, mon garçon, tu n’as pas deux ans à vivre !
URBAIN, jetant les cartes et descendant.
Sapristi ! monsieur Vauclin... On ne fait pas des plaisanteries pareilles !
VAUCLIN.
Et encore, quand je dis deux ans, c’est pour ne pas t’effrayer !
URBAIN.
Merci !
Il remonte.
VAUCLIN, le suivant des yeux.
Voilà une belle génération ! Tenez !
FROMENTEL, assis sur le fauteuil en face de la cheminée.
Il n’y a plus que nous de jeunes !
URBAIN.
Dites donc, pour recevoir des compliments pareils, j’aime mieux aller fumer un cigare au Café du Commerce...
VAUCLIN.
Oui ! ça te fera du bien, tiens... avec un petit verre d’absinthe !...
URBAIN, jetant son chapeau sur sa tête.
Bonsoir !...
À part, en s’en allant.
Burgraves !...
Il sort.
FROMENTEL.
Si tu ne rentres pas cette nuit, galopin, je te déshérite !
URBAIN, rouvrant la porte.
Brr... On connaît son Code !... Tu n’en a plus le droit !
Il sort.
Scène VI
BARILLON, FROMENTEL, VAUCLIN, BOURGOGNE
FROMENTEL, se levant.
Non ! ce n’est pas mon fils !... Il y a quelque chose là dessous qu’on ne saura jamais !
Il remonte s’asseoir.
VAUCLIN, brusquement à Bourgogne qui entre par la gauche.
Laroche n’est pas encore là ?
BOURGOGNE, portant le café sur un plateau et soulignant avec intention les premiers mots.
M. le Marquis de la Rochepéans est encore à table avec M. le Duc.
VAUCLIN.
C’est cela ! à huit heure et demie, et puis on viendra dire, « Docteur, je ne digère pas !... docteur, je ne dors plus !.. »
BOURGOGNE.
Il faut pourtant bien que M. le Marquis dîne à sa faim.
VAUCLIN, ironiquement, traversant à droite.
Mais, comment donc ! si M. le Marquis ne dînait pis à sa faim, la société serait bien malade !... Et voici M. le café de M. le Marquis, n’est-ce pas, et madame la liqueur de M. le Marquis ?
Pendant ce temps, Fromentel traverse au fond et va s’asseoir à l’extrême gauche, où il lit son journal.
BOURGOGNE.
Oui, monsieur.
VAUCLIN.
Eh bien, dépose ce plateau ; M. le Marquis s’en passera ce soir !
BOURGOGNE.
Monsieur veut priver mon maître.
VAUCLIN.
Pardieu ! je m’en prive bien depuis cinquante ans, moi !... et il y a assez de malheureux qui s’en privent tous les jours.
BOURGOGNE.
Il у a aussi des malheureux qui n’ont plus de dents ! – Si M. le Marquis n’était plus libre de se servir des siennes.
VAUCLIN, s’échauffant.
Il n’est pas libre de s’empoisonner !
BOURGOGNE.
M. le Marquis a plaisir de m’empoisonner.
VAUCLIN.
Si ton intelligence n’était pas abrutie par la livrée que tu portes, tu saurais que ton maître est citoyen avant d’être homme, et qu’il est responsable envers la Société de tout le tort qu’il peut faire à sa propre personne, en l’abreuvant d’une substance nuisible à la conservation de l’espèce humaine !
BOURGOGNE.
Il faudra maintenant que nous demandions à la Société la permission de prendre notre café ?
VAUCLIN, brutalement, prenant la cafetière sur le plateau.
Et la Société... c’est moi... Je refuse !
Il jette le café au feu.
BOURGOGNE.
Oh !
VAUCLIN, remettant la cafetière vide sur le plateau.
Il n’y a que les moyens révolutionnaires !... Si on discutait avec ces brutes-là !
Il traverse à gauche, s’assied devant la table et ouvre son journal.
Scène VII
BARILLON, FROMENTEL, VAUCLIN, BOURGOGNE, LE MARQUIS, LE DUC, DE VALCREUSE
LE MARQUIS, entrant en donnant le bras à son père : le Marquis en cheveux blancs, le Duc poudré.
Eh bien ! eh bien ! On se dispute ici ?...
BOURGOGNE.
Si monsieur n’a pas son café ce soir, il s’en prendra à la Société qui l’a jeté au feu !
LE MARQUIS.
Comment, la Société ?
VAUCLIN, assis et lisant son journal.
Oui... moi !
LE MARQUIS.
C’est toi qui jettes mon café ? – Bonjour, monsieur Barillon.
BARILLON, saluant.
Monsieur le Marquis !...
VAUCLIN.
As-tu assez dévoré ce soir ? – T’es-tu gorgé de nourriture ?
LE MARQUIS, à son père en le faisant asseoir dans le fauteuil devant la cheminée.
Il paraît, monsieur le Duc, que nous venons de faire une petite orgie ?
LE DUC, s’asseyant.
Eh ! eh ! de petits libertins !....
LE MARQUIS, à Valcreuse.
C’est Anténor, c’est vous qui nous débauchez, Valcreuse ! Vous êtes connu pour un mauvais sujet, voisin !
DE VALCREUSE, pincé, corseté, haut cravaté, astiqué, pommadé et peint, avec fatuité, en prenant une pastille dans une bonbonnière.
On le dit, monsieur le Marquis !
VAUCLIN.
Et cela vous demande pourquoi on a fait 89 ! – Parce que vous mangiez trop !... parce que vous mangiez tout !
LE MARQUIS.
Et comme nous étions bien gras, c’était le moment de nous manger nous-mêmes.
VAUCLIN.
Allons donc ; on vous a tout au plus mordu les talons, et vous courez encore.
LE MARQUIS.
C’est qu’on vous sait enragés !
Vauclin hausse les épaules et se remet à lire son journal ; le Marquis, se tournant vers Barillon qui est descendu à droite.
Vous attendez depuis longtemps, monsieur Barillon ? – Je vous demande pardon !...
BARILLON.
C’est plaisir pour moi, monsieur le Marquis, de vous consacrer toute ma soirée.
LE MARQUIS.
À la bonne heure ! Vous prenez le thé avec nous... Si le citoyen Léonidas y consent toutefois ; car avec ces amis de la liberté, on n’est jamais sûr de ce qu’ils nous permettent !
Vauclin hausse les épaules sans répondre.
En attendant, si vous roulez que nous causions !
BARILLON.
Oh ! nullement, monsieur le Marquis, rien ne presse !
LE MARQUIS, surpris.
Mais !...
BARILLON.
Ne vous occupez pas de moi, je vous en prie. Ma communication ne peut que gagner à ce retard.
LE MARQUIS.
Vous êtes mon hôte... commandez !
BARILLON, à part.
C’est tout ce que je demande. Et maintenant étudions nos gens.
LE MARQUIS, à Fromentel, qui lit le journal.
Quoi de nouveau ce soir, Fromentel ?
FROMENTEL, le nez dans son journal.
Ah ! ne m’en parlez pas ! Ils ne savent plus ce qu’ils font ! Voilà qu’ils bâtissent un Opéra maintenant...
DE VALCREUSE, prenant une pastille dans une bonbonnière.
Un Opéra ! – À quoi bon ? quand on ne fait plus que de la musique de sauvages !
LE DUC.
Eh ! eh ! les sauvages ceci me rappelle ce que M. de Lafayette disait un jour devant moi à Louis XVI...
BARILLON, à part.
Parions qu’il n’est pas à la question !
LE DUC.
« Sire !... savez-vous qui faisait nos plans de campagne en Amérique !... C’étaient les Peaux-Rouges !... »
FROMENTEL, VAUCLIN, regardant le Duc d’un air étonné.
Les Peaux-Rouges !...
BARILLON, à part.
Il n’y est pas !
LE DUC, continuant.
« Nous n’avions qu’à leur dire : « En avant !... »
LE MARQUIS, allant à lui, et l’interrompant.
Pardon, mon père !... mais nous disions...
LE DUC, montrant Valcreuse.
Je dis cela pour monsieur, qui discute là sur les sauvages !...
LE MARQUIS.
Non, mon père ; non, nous parlons du nouvel Opéra que l’on construit à Paris.
LE DUC.
Ah ! l’Opéra. Ah ! bien !... Ah ! pardon !
Il se renfonce dans son fauteuil.
FROMENTEL.
Au lieu d’assainir des quartiers infects, comme la place Maubert ! si ce n’est pas une honte : des maisons pourries où les pauvres gens sont entassés !... On n’aurait pas seulement le cœur de faire un quartier neuf !...
BARILLON, traversant à gauche sur le devant de la scène.
C’est fait, monsieur Fromentel !
FROMENTEL.
C’est fait... quoi, c’est fait !
BARILLON.
Ce que vous dites...
FROMENTEL.
Des maisons neuves à la place Maubert !...
BARILLON.
Tout un quartier neuf pour vos pauvres gens !...
FROMENTEL, se levant.
Eh bien ! c’est ça, tenez ; qu’est-ce que je dis ? Et puis ils ne sauront plus où se loger !...
VAUCLIN, se levant.
Voyons !... ce whist... Jouerons-nous ce soir ?
LE MARQUIS, après avoir étalé les cartes sur la table.
Monsieur Barillon !...
BARILLON.
Pardonnez-moi, monsieur le Marquis, je n’y entends rien.
LE MARQUIS.
Ah ! monsieur Barillon, c’est le cas de vous dire avec Talleyrand : « Quelle triste vieillesse vous vous préparez ! »
FROMENTEL, après avoir tiré.
Allons, bien ! c’est encore moi qui suis avec le Mort !
LE MARQUIS. Il remonte à gauche.
Il le faut bien... Anténor !... Jamais le whist, lui... c’est encore un jeune homme !
DE VALCREUSE.
Clotilde le prétend et ne compte mes jours,
Que du moment heureux où sont nés nos amours !
BARILLON, à part, redescendant.
Clotilde aussi ! Il n’y a donc que des Clotilde à Quimperlé...
Haut.
Ah ! vous rimez, monsieur ?
DE VALCREUSE, avec une aimable modestie.
Quelquefois et Pégase n’est pas toujours rétif !... Mais les lettres sont tombées dans un tel discrédit... Vous connaissez sans doute mon poème épique en quatre chants sur le jeu de Dominos ?
BARILLON.
Parbleu !... si je le connais...
Pendant ce temps, on prépare les cartes et les jetons pour le whist.
DE VALCREUSE.
La Dominoïde !...
BARILLON, reculant vers la gauche en remontant.
La Dominoïde ! je crois bien.
À part.
Je suis perdu !
DE VALCREUSE, le poursuivant.
Couronnée en 1850 par la Société des Amis d’Apollon de Quimperlé !
BARILLON, même jeu.
Un chef-d’œuvre ! monsieur de Valcreuse.
DE VALCREUSE.
Oh ! vous êtes trop indulgent. Mais il y a là, dès le début, une petite invocation, avec description du domino, qui a vraiment conquis tous les suffrages !
BARILLON.
Délicieuse !... j’allais vous le dire !... délicieuse ! la description !...
DE VALCREUSE, commençant à déclamer.
Je vais chanter !...
Surprise de tous.
Je vais chanter... ô Muse, échauffe mes accents...
Ce noble jeu créé pour les cœurs innocents...
Cette mince tablette où l’ivoire et l’ébène
S’animent, avec art, pour la lutte prochaine ;
Et qui dans nos cafés retentit tous les soirs
Comme un bouclier blanc constellé de points noirs !...
Voyez-vous le domino ?...
BARILLON, cherchant.
Le domino ?
DE VALCREUSE.
...Comme un bouclier blanc constellé... On le voit... J’ai risqué un petit effet d’harmonie imitative... le bruit des dominos sur le marbre... Retentit tous !
Frappant sur la table avec un jeton.
L’entendez-vous ?...
TOUS, impatientés.
On l’entend ! on l’entend !
DE VALCREUSE, regagnant la droite.
C’est adorable !
VAUCLIN.
Allons ! Voyons! ce whist !...
Il donne les cartes.
FROMENTEL.
Sapristi !... c’est lugubre, ça, de jouer tous les soirs en face de ce cadavre !... On ne trouvera donc jamais un quatrième ?...
BARILLON.
À propos de quatrième, vous savez, monsieur le Marquis, que l’on change votre sous-préfet ?...
LE MARQUIS.
Pour le cas que j’en faisais !...
VAUCLIN, retournant.
Carreau !
Ils ramassent leurs cartes.
LE MARQUIS.
Pas si haut : mon père s’endort !...
VAUCLIN.
Eh bien, Fromentel, comment va votre mort ?
FROMENTEL, regardant les cartes du mort.
Ah ! le gredin ! il n’a rien ; tenez, comme toujours !... Il n’a rien du tout !... Qu’est-ce que je vais faire de ce squelette-là ?...
VAUCLIN.
Allons ! quand vous voudrez !
FROMENTEL.
Attendez... voilà... attendez ! –
Il cherche dans le jeu du mort la carte à jouer.
Non, pas ça ! le roi de cœur !
Il joue, pour le mort, le roi de cœur.
VAUCLIN.
Oui, le roi de cœur ! tâchez d’en trouver un !
FROMENTEL.
Un quoi ?
VAUCLIN.
Un roi... de cœur !
Le Marquis ramasse la levée faite par Vauclin.
FROMENTEL, grommelant.
Tâchez !... tâchez !...
Vauclin joue la reine de trèfle, Le Marquis cause bas avec Barillon.
Scélérat de mort, va !... Il n’aurait pas seulement un petit trèfle ! – Allons !... le valet !...
Il joue le valet.
LE DOCTEUR.
Oh ! des valets, il y en a toujours...
Au Marquis, qui cause bas avec Barillon.
Laroche !...
LE MARQUIS, se retournant.
Ah !... pardon ! à qui la reine de trèfle ?...
VAUCLIN, avec intention.
La dame de trèfle, à moi.
LE MARQUIS, jouant.
Ce n’était pas la peine de me reprendre, on dit toujours la Reine de trèfle... malgré 89.
VAUCLIN.
Pardon ! on dit toujours la Dame ! Je n’ai jamais entendu dire...
LE MARQUIS.
On dit la Reine.
VAUCLIN.
La Dame.
FROMENTEL, impatienté.
Enfin la femme de trèfle, quoi ! C’est au docteur !
LE MARQUIS, après avoir joué ; on fait un tour.
Atout !
On entend le marteau frapper trois coups.
DE VALCREUSE, prenant une pastille.
Quis novus hic nostris accessit sedibus hospes ?
LE MARQUIS, jouant.
C’est mademoiselle de Forbac qui rentre du salut !
FROMENTEL, embarrassé de jouer.
Messieurs !... whist en anglais veut dire silence !...
Il hésite devant les cartes du mort.
Ceci !... non... ça... Ce mort est ignoble !... Ce mort m’entraîne au tombeau !...
LE MARQUIS, abattant ses cartes.
Et à nous ! à nous ! et à nous !... triple !...
Il fredonne en mettant ses fiches dans la bobèche du chandelier.
Pour triompher... Pour triompher !...
VAUCLIN, ramassant les cartes.
Ah ! voilà un air qu’Elleviou chantait bien !... un temps où l’on savait encore chanter !
DE VALCREUSE.
Mais aussi quelle délicieuse musique, ces Maris garçons !...
Il prend une pastille.
LE MARQUIS.
Oui !... Va-t’en voir s’ils font la pareille aujourd’hui !
DE VALCREUSE.
Vous rappelez-vous la nuance du récitatif ? Était ce gracieux et fin !...
Il fredonne.
Ou craignez…
Il montre le poing.
Craignez les lois de la guerre !
Il envoie un baiser.
LE MARQUIS, s’échauffant.
Et les notes piquées d’Elleviou !
Il chante sans accompagnement.
Pour triompher (ter) de la beauté
Faisons la guerre (ter) avec franchise !...
LE DUC, se réveillant.
Amour... Délicatesse !... (bis) et Gaîté !...
Tous le regardent avec surprise.
LE MARQUIS.
D’un bon Français c’est la devise !
VAUCLIN, le reprenant.
De nos drapeaux c’est la devise.
LE MARQUIS.
D’un bon français...
VAUCLIN.
De nos drapeaux...
LE DUC, reprenant.
Amour... Délicatesse !... (bis) et Gaîté !...
TOUS.
D’un bon Français c’est la devise !
De nos drapeaux c’est la devise !
D’un bon Français sera toujours... ours !... la devise !... (bis)
De nos drapeaux sera toujours... ours !... la devise !... (bis)
La devise. (ter.)
Scène VIII
BARILLON, FROMENTEL, VAUCLIN, LE MARQUIS, LE DUC, DE VALCREUSE, ROSALIE, toilette de dévote un peu surannée, un ridicule au bras, des lunettes, et portant un petit chien
LE MARQUIS.
Ah ! voici la cousine ! Bonsoir, cousine !
ROSALIE.
Je ne vous demande pas comment va votre précieuse santé ! mon cousin !... Quand on chante l’amour !...
LE MARQUIS, coupant les cartes.
Oui ! oui ! merci ! je vais bien, et vous, cousine ?...
ROSALIE.
Hélas ! trop bien, moi ! Je vais trop bien ! je le disais tout à l’heure à Modeste !
Elle serre sa chienne sur son cœur.
Nous allons trop bien toutes les deux...
LE MARQUIS.
Comment, trop bien ?
ROSALIE, tandis que Fromentel donne les cartes, sans voir Vauclin.
Ce n’est pas faute pourtant de demander à Dieu l’épreuve d’une petite maladie...
VAUCLIN.
Il faut lui demander une colique de miserere, votre bonheur sera complet.
ROSALIE, s’éloignant de lui, à part, grommelant.
Il est déjà là, ce monstre d’athée... je sentais Modeste trembler de tout son corps ! Satan, va !
À la chienne.
Ne crains rien, ma fille !... il ne peut rien sur toi, va ! le ciel est avec nous !
LE MARQUIS, jouant.
Le salut est déjà fini ?...
ROSALIE.
Oui, mon cousin.
VAUCLIN.
Avez-vous assez carillonné et soir, avec vos satanées cloches !...
ROSALIE, à part.
Renégat !
Haut, devant le fauteuil du Duc.
Allons, Modeste, faites la révérence à M. le Duc !...
Le Duc ne bouge pas.
VAUCLIN railleur.
Comment va l’abbé qui doit me convertir ?
Rosalie ne répond pas.
Et la Société maternelle pour le rachat des demoiselles... égarées ? Cela marche-t-il un peu ?
Fromentel donne les cartes.
ROSALIE, redescendant avec un siège qu’elle place près du fauteuil du Duc.
Oui, cela marche !
À elle-même.
C’est toi qui ne seras jamais racheté, païen !... Où ai-je mis ma laine ?... Tu mourras dans l’impénitence finale !... As-tu vu ma lame, Modeste ? Cherche, ma fille, cherche... Et tu grinceras des dents !... Et tu hurleras !... Tu dis que non !... je te dis que si moi !... et tu ne seras pas écouté, réprouvé !... maudit... jacobin !...
Tous se retournent étonnés.
LE MARQUIS.
Eh bien ! à qui en avez-vous ?
ROSALIE.
Moi ? rien : je cherche ma laine, mon cousin.
VAUCLIN, à Fromentel, qui par distraction donne deux ou trois cartes au mort.
Mais, que diantre !... arrêtez donc... vous donnez tout au mort !
FROMENTEL.
Plaît-il ?
VAUCLIN, remettant les cartes en place.
Mais, c’est comme ça !
LE MARQUIS, de même.
Non, comme ceci !
FROMENTEL, de même.
Mais, non, là... là !
BARILLON, se levant et traversant à droite.
Allons !... décidément, je me suis trompé !... des radoteurs... des maniaques !... Il n’y a rien à faire ici pour ma pauvre petite protégée !... Si je pouvais m’esquiver sans être vu...
Bourgogne, qui est entré depuis quelque temps, prépare le thé au fond sur un plateau.
VAUCLIN, après avoir compté ses cartes.
Allons !... mal donné.
Il jette les cartes.
FROMENTEL.
Tant qu’on n’aura pas trouvé un quatrième et que j’aurai devant les jeux ce vide-là qui me fait loucher !...
LE MARQUIS, tandis que Bourgogne donne les tasses de thé.
S’il n’y avait que celui-là dans la maison...
VAUCLIN.
Qu’est-ce qu’il y manque, dans la maison ?
LE MARQUIS.
Hélas !... Des enfants et une femme !
Barillon, prêt à sortir, s’arrête.
LE MARQUIS.
Ne fût-ce que pour nous servir le thé à la place de Bourgogne !...
DE VALCREUSE, avec complaisante.
Il est certain que le thé versé par une jolie main a une saveur !...
Déclamant.
Où la femme n’est pas, le bonheur peut-il être !...
FROMENTEL.
Nous avons Rosalie !...
LE MARQUIS.
Ah !... si l’on pouvait recommencer la vie !...
Barillon écoute.
FROMENTEL.
Comme je ce me remarierais pas, moi !...
LE MARQUIS.
Et comme je me marierais, moi !...
BARILLON.
Et vous, Docteur ?
VAUCLIN.
Moi !... Oh ! saprebleu ! ne me parlez-pas de femme !
Il boit.
ROSALIE, à part.
Monstre ! va ! si tu pouvais boire du poison !
VAUCLIN, continuant.
La femme est évidemment un être inférieur ! l’anatomie vous le prouve !
LE MARQUIS.
Belles preuves, en effet, de chercher les saintes vertus et les angéliques bontés de nos mères à la pointe du scalpel, et dans la dépouille du mort !...
FROMENTEL, rangeant les cartes du mort.
Quand je ne peux pas seulement y trouver un pauvre petit atout !
BARILLON, qui est redescendu.
Vous croyez donc, monsieur le Marquis, qu’une femme dans une maison ?...
LE MARQUIS.
Hélas ! Valcreuse a raison : quoiqu’il le dise en vers. C’est le soleil.
ROSALIE.
Ah ! oui !
FROMENTEL.
Quand elle est jeune !
VAUCLIN, la regardant de côté.
Mais quand elle est vieille ?
ROSALIE, à sa chienne.
Patience, ma fille !... patience ! tu le mordras.
LE MARQUIS.
Raille la femme, triste sire : c’est par là que toutes les niaiseries sociales de ce siècle ont commencé...
FROMENTEL.
Messieurs, en anglais, whist veut dire silence ! Le mort a joué pique.
VAUCLIN, raillant.
Je coupe !... Tu nies le progrès aujourd’hui ? je te croyais libéral.
LE MARQUIS.
À la chrétienne, oui !... Pas à la sans-culotte.
ROSALIE.
Ne le laissez pas répondre, monsieur le Marquis, il ferait tomber le tonnerre sur la maison !
VAUCLIN, raillant.
Grand malheur !... Une vieille bicoque vermoulue comme l’ancien régime !...
FROMENTEL.
Et de grandes diablesses de cheminées qui vous mangent un bois !...
LE MARQUIS.
Ma cheminée vous paraît trop grande, monsieur Fromentel ? c’est qu’elle était faite pour réchauffer une grande et belle famille assise en cercle autour d’elle ; ma bicoque, citoyen Léonidas ?... tous les miens y sont nés... ils y sont morts ! J’y suis né ! j’y mourrai, et je m’en réjouis ! En quoi je suis fort ridicule et très à plaindre, assurément ; mais quand je rencontre un de vos riches bourgeois qui déménage, promenant par la ville ses luxueux pénates, je ne saurais m’empêcher de murmurer tout bas : « Ou vas tu, pauvre diable ? tu quittes la demeure où tu t’es marié ; où tes enfants sont venus au monde ; où tu as ri, pleuré, souffert, aimé... et cela pour un autre logis inconnu, sans souvenirs. Quoi ! tu n’auras pas honte de suspendre le portrait de celle que tu aimes au clou planté par quelque butor pour y accrocher son horrible image ?... Tu me diras, il est vrai, que de nos jours... un portrait... Ah ! mon Dieu ! la plus jolie femme du monde... pour trente sous, sur une petite carte,
Montrant la carte qu’il joue.
comme Pallas !... Mais placer le lit de ta femme, celui de ta fille, dans l’alcôve dorée de quelque drôlesse !... fi... pouah !... Allons, suis ta charrette... pauvre homme !... et ris de ma bicoque !... Ma bicoque est à moi ! je suis sur de ma bicoque... Il se peut que les meubles y tombent en poussière et que les murs s’écroulent... L’honneur y reste toujours vert et la probité toujours jeune !... »
VAUCLIN.
Il est délicieux avec sa maison ! Si j’étais propriétaire comme toi, je ne déménagerais jamais, parole d’honneur !
LE MARQUIS.
Nous nous sommes donc bien appauvris... car au quatorzième siècle, tout le monde l’était plus ou moins, propriétaire !...
VAUCLIN.
Oui ! oui ! les grands !
FROMENTEL.
Messieurs, messieurs... whist en anglais...
LE MARQUIS.
Et les petits, qu’ont-ils gagné ! les petit ?... Aristocratie pour aristocratie, celle du sang valait bien celle des écus !...
VAUCLIN.
Oh ! elle est encore jolie... celle-là ; c’est Fromentel, ça !...
FROMENTEL.
Plaît-il ?
VAUCLIN.
Mais nous avions fondé celle du mérite, nous, et de l’intégrité !
LE MARQUIS.
Ah ! oui, parlons-en, de l’intégrité de tes grands hommes !
VAUCLIN, cessant de jouer.
Oui ! leur intégrité !...
LE MARQUIS, jouant.
Comment donc ! et Mirabeau, payé, vendu !... et Danton, payé, vendu !...
VAUCLIN.
C’est faux !
LE MARQUIS.
Oh ! par exemple !
VAUCLIN.
C’est faux, ne touchez pas aux géants !
LE MARQUIS.
Mais j’y toucherai si je veux aux géants, et je suis bien libre.
On cesse de jouer.
VAUCLIN.
Non ! – Tu n’es pas libre de calomnier...
LE MARQUIS.
Encore faut-il prouver que je...
VAUCLIN, colère croissante.
Je n’autorise personne à dire de telles infamies.
LE MARQUIS.
Discutons, au moins...
VAUCLIN, se levant sans l’écouter.
Je ne veux pas discuter ! je ne discute pas ; je vous défends de discuter !...
FROMENTEL, se levant.
Mais au risque de me faire conspuer, la liberté...
VAUCLIN, avec violence.
Une invention de la haine que les journaux ont eu la scélératesse de propager.
LE MARQUIS.
S’ils le croient.
VAUCLIN.
Si nous vivions en liberté... je te ferais saisir le premier qui oserait...
LE MARQUIS.
Bon !...
FROMENTEL.
Mais !...
VAUCLIN.
Et je te le coffrerais !
LE MARQUIS.
C’est ça !
FROMENTEL.
Je...
VAUCLIN.
Pour lui apprendre... imbécile !... idiot ! crétin !...
FROMENTEL.
Mais !...
VAUCLIN, à Fromentel.
Mais, jour de Dieu ! laissez-moi donc parler... vous ! On n’entend que vous !
FROMENTEL.
Ah !
VAUCLIN, jetant ses cartes.
On plutôt allez au diable, tenez... vous ne méritez pas qu’on s’épuise...
Il remonte.
ROSALIE, le suivant des yeux.
S’il pouvait donc avoir un coup de sang !
LE MARQUIS, traversant à droite.
Voilà de mes libéraux, tenez, qui réclament la liberté de discussion !
LE DUC, réveillé.
Qu’est-ce que c’est ? une querelle !
LE MARQUIS.
Rien, mon père... rien.
Il va à lui.
C’est le jeu qui s’anime !...
LE DUC.
Marquis, il me semble que nous veillons bien tard ce soir !
FROMENTEL, regardant le jeu du mort.
Et cet animal de mort qui attend ce moment-là pour avoir tous les honneurs !...
BARILLON, regardant le Marquis.
Décidément, mon homme, c’est celui-là. Préparons l’assaut !
Le Marquis redescend. De Valcreuse remonte à la cheminée, où il lit une brochure. Fromentel va à la console à gauche, entre les deux portes, où il prend du thé. Rosalie offre du thé au Duc. Vauclin va et vient au fond pendant le commencement de la scène suivante.
LE MARQUIS, prenant le siège de Vauclin et faisant signe à Barillon de s’asseoir.
Voyons, monsieur Barillon, de quoi s’agit-il ?
BARILLON.
Mon Dieu, monsieur le Marquis, je vous vois bien ému !
LE MARQUIS.
Non, non ! ce n’est rien ; nous avons bien d’autres prises ensemble !... Voyons ce qui vous amène ?
BARILLON, tirant une lettre de son portefeuille et s’asseyant.
Le jour même où maître Honorin me remettait la clef de l’étude, il recevait cette lettre, venue de Paris, signée d’un nom très honorable, et qui lui recommandait instamment une jeune personne...
LE MARQUIS, l’interrompant.
C’est assez monsieur Barillon, gardez la lettre. Il s’agit de la fille de ma défunte sœur, n’est-ce pas ?...
BARILLON.
Précisément, monsieur le Marquis.
LE MARQUIS.
Maître Honorin pouvait se dépenser de vous faire faire ce voyage, monsieur. Je lui ai donné tout pouvoir de subvenir aux besoins de cette enfant. Si la pension que j’ai faite jusqu’ici est insuffisante, augmentez-la, doublez-la, faites enfin tout ce qu’il faudra... et n’en parlons pas davantage.
Il va pour se lever.
BARILLON.
Mon Dieu, monsieur le Marquis, pardonnez-moi d’insister ; mais ce n’est pas d’un secours d’argent qu’il s’agit cette fois...
LE MARQUIS.
Ah ! et de quoi s’agit-il ?
BARILLON.
Croyez que je suis désespéré de toucher à des questions qui paraissent vous affecter douloureusement.
LE MARQUIS.
Oui... oui, douloureusement, en effet, et plus que vous ne vous pouvez le croire ! – M. Honorin vous a certainement mis au courant de cette triste histoire, monsieur ?...
BARILLON.
Oui, monsieur le Marquis.
LE MARQUIS.
Mais il l’a fait sans doute à sa manière. Il n’aura pas manqué de vous dire, monsieur, pour justifier ma sœur, que son choix n’était pas blâmable, ce qui est vrai ; que l’homme qu’elle avait distingué, si humble que fût sa condition, était fort honorable en tout point, et je n’en disconviens pas... qu’ils s’aimaient depuis longtemps, et que le refus de mon père à autoriser leur union prenait sa source dans un étrange orgueil nobiliaire qui n’est plus de saison... (ce que je ne discute pas) ; mais quitter la maison de son père, la nuit, furtivement, à l’heure même où la loi la déclarait majeure... se réfugier dans la famille inconnue de cet homme, et là, nous dépêcher sommations sur sommations, jusqu’au mariage audacieusement conclu sous le coup de la réprobation paternelle. Ah ! voilà, monsieur Barillon, ce que toutes les dissertations philosophiques du monde ne me feront jamais admettre. C’est une révolte contre la loi de Dieu, qui a le pas sur celle des hommes... Et si vos conquêtes de la législation moderne autorisent beaucoup d’actes semblables, je m’applaudis de ne pas même connaître de nom ces droits nouveaux qui nous dispensent si effrontément des anciens devoirs.
BARILLON.
Il y aurait beaucoup à répondre, monsieur le Marquis, si nous étions ici pour discuter. Mais j’aime mieux vous accorder, que votre sœur fut coupable, impardonnable même... pour vous rappeler seulement que cette coupable est morte, que cette impardonnable est aujourd’hui devant le seul juge qui puisse la déclarer sans excuse, et que sa pauvre enfant innocente...
LE MARQUIS.
Mais je vous l’ai dit, monsieur, faites pour cette enfant tout ce qu’il faudra, et s’il lui manque...
BARILLON.
Eh ! monsieur le Marquis, ce qu’il lui manque... tout l’argent du monde ne saurait le donner, ni le remplacer ! Songez qu’elle a dix-sept ans, que les personnes qui l’avaient recueillie ne sauraient la garder plus longtemps... Ajoutez qu’elle vient d’être cruellement malade, elle aussi, et qu’elle est à peine convalescente. Ce qui lui manque, hélas ! suis-je forcé de vous le dire, monsieur, c’est le conseil tendre que son âge implore, la douce indulgence, les soins affectueux, la protection constante, et tout cela dans un seul mot : c’est la famille !
LE MARQUIS, ému.
Sans doute... Mais...
BARILLON.
Et puis, une femme, monsieur le Marquis, une jeune fille !... Pensez-y ; vous qui déplorez ici l’absence d’une femme. Une femme, jeune, douce, bonne, belle, charmante !... C’est le soleil, disiez-vous ! c’est le sourire qui réjouit !... Allons, monsieur le Marquis, plus de préjugés, plus de rancunes !... Vous êtes ému !... Votre œil est humide, je le vois ; et il ne vous reste plus qu’à ouvrir vos bras, qu’à les ouvrir bien grands, pour rappeler à vous cette partie de votre cœur qui est si loin de vous et qui ne demande qu’à vous revenir !...
LE MARQUIS, luttant contre son émotion.
Sans doute !... je... peut-être... mais enfin !
Avec chaleur.
Ah ! qu’elle vienne donc !...
BARILLON.
Ah ! monsieur le Marquis, merci pour elle !
LE MARQUIS.
Écrivez-lui... tout de suite... Écrivez qu’elle parte !
BARILLON.
C’est fait, monsieur le Marquis, elle est en route !...
LE MARQUIS.
En route ?...
BARILLON.
Elle arrive ce soir... tout à l’heure... dans un instant !...
On frappe.
Là voici peut-être...
LE MARQUIS, saisi.
Déjà !...
Inquiet.
Si vite !... Mais, diable d’homme, il ne vous laisse pas le temps de respirer !
BARILLON.
J’étais sûr de lui trouver ici un asile.
LE MARQUIS.
Mais mon père !... mais son consentement ?...
BARILLON.
Nous l’aurons.
LE MARQUIS.
Il le faut bien ! Mais en vérité... je ne sais... lui, si sévère !... ah ! mon Dieu !... voici bien des affaires !
Scène IX
BARILLON, FROMENTEL, VAUCLIN, LE MARQUIS, LE DUC, DE VALCREUSE, ROSALIE, BOURGOGNE
BOURGOGNE.
Monsieur le Marquis, c’est une jeune fille qui vient de Paris.
LE MARQUIS.
Miséricorde !... c’est elle... Barillon !...
BARILLON.
C’est elle !
ROSALIE, à part.
Une jeune fille !... ici !...
LE MARQUIS.
Et M. le Duc qui va se réveiller ! nous sommes perdus !
À Bourgogne.
Où est cette enfant ?...
À Barillon.
Je n’aurai jamais le temps !
À Bourgogne.
Faites entrer ! Non, pas encore... Ah ! mon Dieu !...
VAUCLIN.
Mais qu’est-ce qu’il a ?... Qu’est-ce que tu as ?...
LE MARQUIS, le ramenant à gauche, à l’avant-scène, ainsi que Fromentel. À demi-voix tout ce qui suit.
Vauclin !... Fromentel... Vauclin... mon vieil ami... mon excellent ami !... c’est la fille de Madeleine qui nous arrive.
VAUCLIN.
Ma filleule !
LE MARQUIS.
Ta filleule ?
VAUCLIN.
Parbleu ! je ne m’en suis pas vanté ! mais c’est moi que ta pauvre sœur avait choisi pour parrain ! à distance, par exemple, car pour fourrer les pieds dans une église !...
LE MARQUIS.
Bon ! bon ! alors tu vas m’aider !
VAUCLIN.
À quoi ?...
LE MARQUIS.
Comment, à quoi ? mais à décider mon père à la voir.
VAUCLIN.
Saperlotte ! un vieux chouan qui voulait tuer la mère, le père et l’enfant, sous prétexte que Désiré Dervin était un croquant !
FROMENTEL.
Désiré Dervin... le père ?...
LE MARQUIS.
Oui ! vous l’avez connu ?...
FROMENTEL.
Pardieu oui... de nom ! – C’était le propre fils du frère aîné de madame Fromentel.
VAUCLIN.
Alors, l’enfant est votre petite nièce ?
FROMENTEL, stupéfait.
Hein ?... oui !... Ah ! tiens, oui ! c’est curieux !
LE MARQUIS.
Mais alors, elle a trop de parents ! Qu’est-ce qu’il dit, Barillon ?...
À Barillon.
Mais qu’est ce que vous dites donc, Barillon ?
BOURGOGNE.
Monsieur le Marquis, cette jeune personne est bien pâle, elle grelotte, là, dans l’antichambre.
LE MARQUIS.
Dans l’antichambre ! dans l’antichambre !... Une demoiselle de la Rochepéans qui grelotte dans l’antichambre ! – Ouvre la porte à deux battants, Bourgogne, et au risque du tonnerre !... qu’elle entre !... Nous la réchaufferons dans nos bras !...
Scène X
BARILLON, FROMENTEL, VAUCLIN, LE MARQUIS, LE DUC, DE VALCREUSE, ROSALIE, MARGUERITE
Marguerite paraît ; elle hésite en regardant tout le monde. Barillon lui montre le Marquis qui lui tend les bras : elle y court. Musique jusqu’à la fin de l’acte.
MARGUERITE, l’embrassant à plusieurs reprises.
Mon oncle ! mon bon oncle !
LE MARQUIS, l’embrassant.
Pauvre enfant ! chère enfant !... pauvre chère enfant !
MARGUERITE.
Laissez-moi vous remercier à genoux.
LE MARQUIS.
Pas aux miens, ma fille... mais ici... près de votre grand-père... mon cœur est à vous ! C’est le sien qu’il faut gagner.
Il la fait passer près du Duc et s’agenouiller devant lui.
MARGUERITE, bas en traversant.
Ah ! que j’ai peur !... Ma pauvre mère ! aidez moi !... aidez-nous !
Silence.
LE DUC, se réveillant, sans voir Marguerite tout d’abord.
Eh bien ! Marquis, ce whist est fini ! ne se couchera-t-on pas ?...
LE MARQUIS, timidement.
J’allais vous le proposer, mon père.
LE DUC, apercevant Marguerite.
Tiens, quelle est cette jolie enfant... Marquis ?...
LE MARQUIS, avec une grande émotion.
Mon père !... il y avait tout à l’heure à notre porte, et presque dans la rue... une enfant, une orpheline qui nous demandait asile.
LE DUC.
Une orpheline !
Il regarde attentivement Marguerite.
Oui !... attendez ! cet yeux, ce regard !... C’est l’enfant de Madeleine.
LE MARQUIS, vivement.
C’est Mademoiselle de la Rochepéans, mon père, votre petite-fille, et ma nièce... J’ai pensé que notre sang ne devait connaître ni le froid, ni la honte, ni la douteuse charité des autres, et je me suis permis...
LE DUC, l’interrompant.
Et vous avez bien fait, Marquis...
Il tend les bras à Marguerite.
Embrassez-moi, ma fille !
MARGUERITE, se jetant dans ses bras.
Ah ! mon père !
VAUCLIN, essuyant ses yeux.
Ils ont quelquefois du bon, ces vieux chouans !
FROMENTEL, de même.
Qu’est-ce qui croirait jamais que c’est ma nièce ?... Elle ne me ressemble pas du tout !
La toile tombe.
ACTE II
Même décor. La table au milieu. Un piano a pris la place, au fond à droite, du secrétaire, qui est maintenant placé à gauche, premier plan, près de la fenêtre. Sur la table et la cheminée, des vases de fleurs. Un portrait, qui était au premier acte sur la porte d’entrée, est placé maintenant au-dessus de la cheminée.
Scène première
MARGUERITE, BOURGOGNE
Marguerite, debout devant la fenêtre, regarde dehors tristement.
BOURGOGNE, entrant, un plumeau et une serviette à la main, à part.
C’est cela !... encore des nouveautés ! Hier un piano, aujourd’hui des fleurs dans les vases. Ce plaisir de tout changer pour me brouiller.
Haut, avec intérêt.
Mademoiselle va se faire mal !...
MARGUERITE.
Me faire mal ! Comment cela, mon bon Bourgogne ?
BOURGOGNE, époussetant.
M. Vauclin a formellement défendu à mademoiselle de se fatiguer, et elle est là debout à cette fenêtre !
MARGUERITE.
Oh ! ce n’est rien, il fait si beau ! le joli temps d’hiver ! et la belle gelée avec ce soleil !... Je suis forte maintenant et je sortirais bien !
BOURGOGNE.
Forte ! forte !... mademoiselle est encore bien pâle ; et depuis quinze jours seulement qu’elle est ici, elle n’a pas eu le temps de se remettre tout à fait ! Une fièvre cérébrale !... on peut avoir une rechute.
Il reste, son plumeau en l’air, devant la cheminée.
Tiens !
MARGUERITE.
Quoi donc.
BOURGOGNE.
Le portrait de M. le maréchal qui était ici !...
Il montre le dessin de la porte du fond.
MARGUERITE.
Oui, je l’ai fait mettre à gauche ; il est mieux éclairé.
Elle passe à droite.
BOURGOGNE, à demi-voix, grognant.
C’est ça, encore un changement !
MARGUERITE.
Est-ce que cela vous contrarie, Bourgogne ?
BOURGOGNE.
Grand Dieu ! ce que fait mademoiselle est bien fait ; mais trouver M. le maréchal à gauche quand on a depuis quarante-cinq ans l’habitude de l’épousseter à droite... Enfin, je tâcherai de m’y faire...
Il va pour épousseter le portrait et s’arrête.
Mais aujourd’hui, non !... non !... Si mademoiselle n’a plus besoin de moi, j’irai chercher le journal de M. le Marquis ?
MARGUERITE, achevant de ranger les vases sur la cheminée.
Oui, et n’oubliez pas aussi de prendre celui de mon parrain et de le lui porter.
Elle repasse à gauche.
BOURGOGNE.
Oui, mademoiselle.
À lui-même.
Encore une nouveauté ! – Il a bien besoin de le lire son journal, pour se monter la tête !
MARGUERITE, rangeant, et poussant un cri d’étonnement en prenant une carte sur le secrétaire.
Ah !
BOURGOGNE, s’arrêtant.
Mademoiselle ?
MARGUERITE, avec joie.
M. Cavalier ici !... M. Marcel !... il connaît mon oncle ?
BOURGOGNE.
Ça, mademoiselle ! – oh ! c’est une carte ancienne déjà ! C’est un monsieur qui est venu ici il y a quinze jours.
MARGUERITE.
Ah !... si longtemps !
BOURGOGNE.
Oui, il n’avait pas l’honneur d’être connu de M. le Marquis. Il s’est ennuyé d’attendre, et il est parti. J’ai mis sa carte là ; et M. Vauclin m’ayant fait une scène ce jour-là j’ai oublié de la remettre à M. le Marquis.
MARGUERITE.
Il est venu... il y a quinze jours. Ah ! c’est singulier !
BOURGOGNE.
Mademoiselle le connaît ?
MARGUERITE.
Je crois bien ! un ami de la maison où l’on m’a recueillie, et qui était si affectueux pour moi !... Et il n’est pas revenu ?
BOURGOGNE.
Non, mademoiselle ; seulement je crois bien l’avoir vu passer hier dans la prairie qui est au bout du parc.
MARGUERITE.
Là-bas ?
BOURGOGNE.
Oui, mademoiselle !... Mademoiselle n’a plus rien... ?
MARGUERITE.
Non, non. Allez !
Scène II
MARGUERITE, seule
Elle court d’abord à la fenêtre.
Dans la prairie !... Non, personne !... Quelle idée ! parce qu’il a passé hier !...
Redescendant.
Enfin, il est ici, toujours... Moi qui justement pensais à lui ce matin, hier encore !... Quel bonheur !... Se retrouver ainsi quand on n’est plus entouré que de figures nouvelles !... Lui surtout !... si bon pour moi ! Il me semble que je suis encore à Paris ; qu’il va venir comme autrefois quand j’étais triste et souffrante... Mais comment n’est-il pas revenu depuis ? Où demeure-t-il ?... Mon oncle le sait peut-être... Si je lui demandais... Je n’ose pas !... Cela m’a tellement surprise !... Oh ! non ! pas maintenant ! – Et pas d’adresse !...
Scène III
MARGUERITE, LE MARQUIS
LE MARQUIS, venant sur la pointe du pied la surprendre par derrière.
À quoi pensez-vous là, petite sournoise ?
MARGUERITE, cachant la carte.
Ah ! mon oncle ! vous m’avez fait peur !
LE MARQUIS.
Je ne crois pas cela, par exemple : je ne suis pas encore à faire peur.
À Marguerite, qui l’embrasse.
Vous voyez bien que je ne vous fais pas peur !
MARGUERITE.
Vous avez bien dormi !
LE MARQUIS.
Peuh !... le sommeil s’en va ! Mais vous-même, chère enfant, déjà levée, à huit heures, en plein hiver ? – Dieu ! la mine florissante ! Mais vous n’êtes plus la même aujourd’hui !... l’œil brillant, le teint animé !... Qu’y a-t il donc ?
MARGUERITE, embarrassée.
Mais rien !... rien !... Seulement, je me suis un peu occupée ce matin...
LE MARQUIS.
À quoi ?
MARGUERITE, vivement, pour cacher son trouble, et allant déposer la carte sur le secrétaire.
Mais à mille choses !... J’ai fait ranger votre cabinet, qui était dans un affreux désordre : j’ai fait épousseter tous vos livres, qui étaient blancs de poussière...
LE MARQUIS.
Tu as fait cela ?
MARGUERITE.
Avec Bourgogne, oui !
LE MARQUIS.
Tu as décidé Bourgogne à ranger mon cabinet ?
MARGUERITE.
Mais oui !
LE MARQUIS.
Voilà un jour ù marquer d’une croix blanche ! – Car il est un peu maniaque, Bourgogne, je ne sais pas si tu l’as remarqué ?... Il est même insupportable, Bourgogne !
MARGUERITE.
Mais il vous aime tant !
LE MARQUIS.
Eh ! c’est bien ce qui me gêne ! Le moyen de renvoyer un homme qui est né dans cette maison, et qui nous sert depuis l’âge de quatorze ans, sans gages !... Ce qui me coûte beaucoup plus cher !...
À Marguerite, qui regarde du côté de la fenêtre.
À quoi penses-tu donc ?...
MARGUERITE.
Mais à ce que vous me dites ! J’ai ma petite tête aussi, moi, et nous changerons tout cela.
LE MARQUIS.
Vous avez déjà commencé, chère enfant !... La maison n’est plus la même ! Elle était triste, humide, et voici qu’elle a pris, je ne sais comment, un air de fête !...
MARGUERITE.
C’est bien facile ! – Un peu plus de lumière dans la chambre et trois fleurs dans un vase...
LE MARQUIS.
Non, ma belle, non ! – Ce pâle soleil n’y est pour rien ! ni ces fleurs pâles comme lui ! – C’est votre jeunesse qui se joue sur tout cela comme un rayon d’avril et qui fait tout resplendir autour d’elle ! Vous êtes venue par un soir d’hiver chez de vieux garçons tristement accroupis autour de leur feu !... Vos yeux étaient pleins d’éclairs, vos mains étaient pleines de rosés, si bien que le peu de joie qui nous restait encore au fond, tout au fond du cœur, s’est mis à battre de l’aile pour vous suivre ; et nous voilà tous fringants et tous fiers d’un éclat nouveau qui nous enchante et qui n’est que le reflet de vos regards et de vos sourires.
MARGUERITE.
Et comme il n’y aurait plus pour moi de sourires sans votre douce et tendre affection, vous voyez bien que c’est encore à vous qu’il faut en rapporter tout l’honneur.
LE MARQUIS.
Ta, ta, ta !... Quelle est donc la bonne fée qui préside à toute chose dans ma vieille maison ? – D’où vient que tout se fait à propos, sans bruit, et avec mille douceurs inconnues ? Et si vous avez eu le courage, chère enfant, d’apprendre à jouer le whist, n’est-ce pas pour ce vieil égoïste de Fromentel, votre oncle ? Car il faut bien l’avouer, ce conservateur de légumes est aussi votre oncle... Il n’y a pas jusqu’à mon brave anthropophage de Docteur, à qui vous jouez du piano pendant des heures !... Et pourtant il n’est que votre parrain, celui-là ; vous ne lui devez rien ! – Il n’a pris que l’engagement devant Dieu, auquel il ne croit pas, de vous défendre contre le diable, auquel il n’a jamais cru ; et il finira, le corsaire ! par vous faire chanter la Marseillaise un jour que je ne serai pas là !... Et vous croyez que tout cela se fait sans bénédiction de notre part ? bon petit ange que vous êtes !...
Il lui prend la tête et l’embrasse.
MARGUERITE.
Je ne fais que mon devoir.
LE MARQUIS, la regardant dans les yeux.
Oh ! certainement il y a du nouveau dans ces yeux-là !
MARGUERITE, troublée.
Mais non !...
Elle remonte vers la table et arrange les fleur pour se donner une contenance.
LE MARQUIS, à part.
Si ! si ! – Je m’y connais ! Je n’ai pas toujours été un vieux loup !...
La regardant.
Ah ! c’est curieux ! une animation ! Un éclat !
Il prend un siège à gauche pour s’asseoir.
J’aime mieux cela, du reste ; car à vous dire la vérité, chère enfant, je vous regardais hier, au moment où vous pensiez être seule, et je m’inquiétais de vous voir toute mélancolique !
MARGUERITE, descendant à lui.
On ne peut pas demander beaucoup de gaieté à une pauvre convalescente, et surtout...
LE MARQUIS, assis et la faisant asseoir près de lui.
N’achevez pas, chère enfant, je vous comprends ! C’est vrai ! vous avez tant souffert !...
Après un silence et s’efforçant un peu.
Et votre pauvre mère aussi, n’est-ce pas ?
MARGUERITE.
Nous étions si tristes et si pauvres !
LE MARQUIS.
Véritablement pauvres, c’est vrai. Et...
S’interrompant.
Nous en parlerons une fois, mon enfant... et puis, nous n’en parlerons plus jamais !... Que faisiez-vous pour vivre ?
MARGUERITE.
Oh ! nous avions du travail pour les magasins !
LE MARQUIS.
Une la Rochepéans... travailler pour ces croquants !... Essuyer les rebuffades d’un commis !
MARGUERITE.
Oh ! jamais cela ! On savait bien qui nous étions, et on nous respectait.
LE MARQUIS, radieux.
Ah ! on vous respectait, n’est-ce pas ?
MARGUERITE.
Ah ! toujours et partout !
LE MARQUIS, triomphant.
C’est clair !... le prestige du nom !
MARGUERITE.
Oui, le nom de mon père était si honoré ! Ma mère n’avait qu’à dire : « Je suis la veuve de M. Dervin !... »
LE MARQUIS, un peu déconcerté.
Dervin !... sans doute... oui ! Ce n’est pas ce nom-là que je voulais dire... mais aussi... le sang, la race qui revivait en elle tout entière !... Nous n’avons pas besoin de signer, nous autres ! Les la Rochepéans ont dans le port de tête je ne sais quoi qui signifie : « Voici ton maître ! » Et je pense que le langage de votre mère, ses manières...
MARGUERITE.
Oh ! certainement, elle parlait si doucement !
LE MARQUIS, déconcerté.
Comment, si doucement ?
MARGUERITE.
Je veux dire : avec tant de charme, qu’il n’y avait pas moyen, disait une marchande, de résister à ses prières !
LE MARQUIS.
Ses prières ?... À une boutiquière ?...
MARGUERITE, doucement.
C’est cette même boutiquière qui m’a recueillie orpheline, qui m’a soignée malade !
LE MARQUIS.
Une brave femme évidemment, mais...
MARGUERITE.
J’étais à la mort ! Eh bien, elle veillait près de moi, le jour... la nuit.
LE MARQUIS.
Excellente femme !... excellente !
MARGUERITE.
Et quand le médecin m’eut déclarée hors de danger !... quelle joie ! quelle fête !... Si vous aviez vu le bonheur de tous ses amis qui étaient devenus les miens, et surtout...
Elle se détourne vers la fenêtre.
LE MARQUIS.
Surtout ?
MARGUERITE, se reprenant.
Surtout... elle !
LE MARQUIS.
Braves gens ! Excellentes gens ! Il faut leur écrire, Marguerite, et les remercier en mon nom comme au vôtre !... Ou plutôt j’écrirai moi-même, et je saurai ce qu’ils ont dépensé pour vous...
MARGUERITE, l’interrompant.
Oh ! gardez-vous-en bien !...
LE MARQUIS.
Comment ?
MARGUERITE.
Ils ont aussi leur orgueil et ce serait les offenser ! J’ai écrit, moi, et savez-vous ce qu’elle m’a répondu ? « Ma chère enfant, vous ne me devez rien qu’une petite visite quand vous viendrez à Paris, et j’espère bien que vous amènerez aussi votre oncle, qui est un si brave homme ! »
LE MARQUIS, faisant la grimace.
Un brave homme ! Alors je suis un brave homme, moi ?
MARGUERITE.
Elle veut dire...
LE MARQUIS, se levant.
Oui, oui ! Enfin, je suis un brave homme, c’est une brave femme !... Vivent les braves gens ! N’en parlons plus !
MARGUERITE.
Et tout le monde se vaut bien par le cœur ! allez !
LE MARQUIS.
Oui, oui, tout le monde se vaut.
À part.
Elle est un peu révolutionnaire, ma nièce. J’y veillerai !
MARGUERITE, à la fenêtre, étourdiment.
Ah ! le voilà !...
LE MARQUIS, remontant à droite.
Quoi donc ?
MARGUERITE, troublée.
Mais, rien ! je...
BOURGOGNE, entrant ; il porte le journal du marquis sur un plateau et tient un autre journal du bout des doigts.
M. le Duc demande mademoiselle Marguerite.
MARGUERITE, vivement.
Bien ! C’est pour son déjeuner... J’y cours !...
Regardant à la fenêtre avant de sortir.
Ah ! c’est lui !... c’est bien lui !...
Elle sort par la porte d’appartement.
LE MARQUIS, surpris.
Mais qu’est-ce qu’elle a donc aujourd’hui ?... Qu’est-ce qu’elle a donc ?...
Il redescend.
Scène IV
LE MARQUIS, BOURGOGNE
BOURGOGNE.
Le journal de M. le Marquis.
LE MARQUIS, prenant le journal.
Bien ! Qu’est-ce que tu tiens de l’autre main ?
BOURGOGNE, montrant le journal du bout du doigt comme s’il le brûlait.
C’est le journal de M. Vauclin que mademoiselle m’a ordonné de lui monter.
LE MARQUIS.
Ah ! ah ! qu’est-ce que c’est ?... De l’arsenic ou du vitriol !...
Il regarde le journal et lui fait signe de l’emporter.
Portez cela avec précaution, Bourgogne, et demandez au citoyen Léonidas comment il a passé la nuit !
BOURGOGNE.
Oui, monsieur le Marquis !
Il remonte et sort en tenant toujours le journal de la même manière.
LE MARQUIS.
Charmante enfant !... voilà une femme comme j’aurais dû en épouser une... quand il était encore temps !... Eh ! eh ! n’est-il plus temps !
Il s’assied à côté de la cheminée à droite. On frappe au fond.
Qui va là ? entrez !
Scène V
LE MARQUIS, ROSALIE
ROSALIE sur le seuil, mystérieusement.
Monsieur le Marquis !
LE MARQUIS.
Eh ! c’est vous, cousine !... entrez !
ROSALIE, fermant la porte avec mystère.
Chut ! Monsieur le Marquis, parlez bas !...
LE MARQUIS, occupé de son journal.
Eh ! mon Dieu ! cet effarement ! ces lunettes en désordre !
ROSALIE.
Et il y a de quoi, monsieur le Marquis !... Personne ce peut nous entendre ?
LE MARQUIS.
Vous voyez, je suis seul.
ROSALIE, montrant la porte de droite.
Oui, mais là !
Elle va regarder à la porte de droite, puis à celle de gauche.
LE MARQUIS.
Je vous prie de croire, mademoiselle de Forbac, que chez moi l’on n’écoute pas aux portes !
ROSALIE, revenant à lui, tout bas.
Eh ! mon Dieu, mon cousin, je sais ce que c’est : on ne se met pas derrière une porte pour écouter... mais on s’y trouve par hasard, et malgré soi on entend tout !... ça m’est arrivé vingt fois !
LE MARQUIS.
Soyez donc rassurée ! Personne n’aura de ces distractions !... Qu’est-ce que c’est ! – Une petite demande de secours, hein ? – Une de vos demoiselles égarées a fait des siennes, et la Société maternelle se trouve à la tête d’un petit pensionnaire qu’elle n’avait pas prévu... Est-ce cela ?
ROSALIE.
Pas encore ! Mais, hélas ! sainte mère de Dieu ! Si un pareil malheur nous arrivait !...
LE MARQUIS, surpris.
Hein ? quoi ? comment nous arrivait ? Il n’y a ici de femmes que vous et ma nièce !... Ce n’est pas vous, n’est-ce pas, qui êtes en péril de... non ?... hein ?
ROSALIE, avec pudeur.
Seigneur Dieu ! jamais !
LE MARQUIS.
Je pense bien ! mais alors, comme il ne peut pas être question de Marguerite !
ROSALIE, avec onction.
Ah ! Dieu ! le cher trésor ! une figure d’ange ! moi qui l’adore, cette enfant-là !... des petites façons si douces, si candides, pauvre mignonne !
Doucement.
trop candides même... le serpent est dessous !... et puis ses yeux-là, voyez-vous !... des yeux pareils !... dès que je l’ai vue je l’ai dit... nos demoiselles de la Société ont presque toutes l’œil noir... Ce n’est pas non plus que l’œil bleu !...
LE MARQUIS, étonné.
Mais au fait ! au fait ! au fait ! Voyons, quoi ? vous accusez Marguerite ?...
ROSALIE, vivement.
Saints du paradis ! l’accuser !... Moi qui la défends ! mais je la défends, monsieur le Marquis !... Ce n’est pas sa faute, pauvre chère belle ! C’est passé dans le sang ! La mère a pris la clef des champs avec un homme, et la fille !...
LE MARQUIS, sautant debout.
De par tous les diables, mademoiselle de Forbac ! Savez-vous bien ce que vous dites ?
ROSALIE.
La ! ne vous fâchez pas, monsieur le Marquis !... Je dis ce que j’ai vu !
LE MARQUIS.
Quoi ?
ROSALIE, mystérieusement.
Mais j’ai vu, comme je vous vois, de ma fenêtre, où j’étais par hasard, hier à minuit... un jeune homme... un grand beau garçon !... ils sont toujours beaux ces Satans-là !... faire le tour du parc, vers la haie d’aubépine, en regardant la fenêtre de mademoiselle Marguerite ; et ce matin encore... ce matin, monsieur le Marquis, il a en le front de faire le même tour par la petite prairie.
LE MARQUIS.
Et voilà tout, quoi ? et c’est cela ? Pour un curieux qui passe...
ROSALIE.
Un curieux ! par un froid de dix degrés ! Votre nièce est donc bien curieuse aussi, car il n’y a pas dix minutes, je l’ai vue, tandis que le beau jeune homme passait, soulever la rideau de cette fenêtre.
LE MARQUIS.
Cette fenêtre ?
ROSALIE.
Eh ! tenez, tenez ! le rideau est encore relevé !
LE MARQUIS, frappé.
Oui ! tout à l’heure !... devant moi !... cette animation !... cette rougeur !... cette distraction qui m’étonnaient.
Vivement.
Ce jeune homme était derrière la haie, vous en êtes sûre ?
ROSALIE, doucement.
Oh ! Dieu ! Je les devinerais dans les entrailles de la terre !... les horreurs d’hommes ! Il est peut-être encore là.
Elle va à la fenêtre.
LE MARQUIS.
Où ça ?
ROSALIE.
Là-bas ! tenez ! tenez ! la voilà !
LE MARQUIS, regardant.
En effet ! un homme, jeune encore !
ROSALIE, de même.
Et qui n’est pas d’ici, j’en réponds ! Je les connais tous, les bandits !... Ils donnent assez de mal à la Société.
LE MARQUIS, après avoir pris une lorgnette sur le secrétaire.
Il marche avec précaution sur les pierres du petit mur écroulé.
ROSALIE.
Et en se baissant, le voyez-vous glisser, le serpent !
LE MARQUIS, regardant.
Le voici qui s’assied !
ROSALIE.
Oui, mais il guette toujours ! il regarde par ici, tenez !
Reculant indignée.
Il me prend pour elle !
LE MARQUIS, avec menace.
Ah ! si je croyais !
Redescendant.
Ce n’est pas possible ! – Un impertinent voyageur, voilà tout ! elle le regardait comme on regarde un passant, par hasard !...
ROSALIE, onctueusement.
Il n’y a pas de jeune homme qui passe par hasard, monsieur le Marquis !... Il n’y a pas de jeune fille qui le regarde par hasard ! et quand ces hasards-là se répètent trop souvent, ça finit toujours... toujours... toujours !... par revenir à la Société maternelle !
LE MARQUIS.
Bon pour vos grisettes !... mademoiselle de Forbac !... mais une fille de notre maison !
ROSALIE, de même.
Hélas ! c’est mot à mot la réponse que le Marquis me fit il y a vingt ans, quand je vins lui dire comme aujourd’hui : « Il y a un jeune homme qui passe bien fréquemment dans la prairie, et votre sœur est bien souvent à sa fenêtre ! »
LE MARQUIS.
Ah ! c’était alors... c’était...
ROSALIE, de même.
C’était... le jeune homme à la même place et la demoiselle à la même croisée.
LE MARQUIS, vivement.
Mordieu ! j’en aurai le cœur net !
Il va pour sortir par la porte où est entrée Marguerite.
ROSALIE, l’arrêtant.
Oh ! pauvre chérubin ! ne la brusquez pas !
LE MARQUIS, s’arrêtant et redescendant.
Non ! je ne lui dirai rien... À quoi bon lui faire connaître un danger qu’elle ne soupçonne peut-être pas ?... Le mal, si mal il y a, n’est pas encore bien grand ; et cette fois, j’en jure Dieu !
Il sonne.
j’irai plus vite que lui.
Entre Bourgogne.
Bourgogne !... le Docteur ! Fromentel ! qu’ils descendent vite !...
BOURGOGNE, effaré.
Mais, monsieur...
LE MARQUIS, vivement.
Mais allez donc !
Bourgogne sort.
Pour vous, cousine, occupez-vous de cet homme, sortez et sachez-moi tout de suite...
ROSALIE, vivement et à demi-voix.
Oui ! oui !... son nom, son âge, sa demeure, ses parents ; où il va, d’où il vient, ce qu’il fait ! Je cours chez madame Chauvot, notre présidente, chez madame Biju, notre secrétaire, chez mademoiselle Béguin, notre caissière, et j’en saurai plus long dans dix minutes !...
Elle remonte.
LE MARQUIS, la suivant.
Oui, mais pas un mot du motif !
ROSALIE, se retournant.
Dieu ! les secrets, Monsieur le Marquis ! Mais c’est notre état !... Nous nous ferions plutôt hacher avant d’ouvrir la bouche.
Fausse sortie. Se retournant.
Il n’y a qu’entre nous, dans le conseil...
LE MARQUIS.
Vite, allez !
Il retourne à la fenêtre.
ROSALIE, levant les mains au ciel.
Oh ! pauvre chère enfant !... Quand on pense qu’il est probablement trop tard !
Elle se sauve.
Scène VI
LE MARQUIS, seul
Il va à la fenêtre et regarde avec la lorgnette.
Il est toujours là !... assis sur les débris du petit mur !... Cet arbre le cache... je ne vois que le sommet de sa tête !... Il y a des fatalités !... Cette vieille fille a raison. – C’est là que je l’ai vu pour la première fois, ce Dervin et la fille imiterait la mère !... voici sa figure en plein soleil... belle figure même... Qu’est-ce que tu peux bien être, toi ? – Un gentilhomme ?... Mais un gentilhomme ne se cache pas ! il va tête levée. – Quelque méchant, fils de basse maison qui a déjà flairé l’héritière... Il regarde de ce côté !... Oui ! va, va, regarde ! dresse-toi en plein soleil, drôle ! Et viens donc jusqu’ici... mais viens donc, que l’on t’apprenne à voler nos enfants !
Il continue à regarder.
Scène VII
LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL
VAUCLIN, entrant par le fond.
Eh ! qu’est-ce que c’est ? quoi ? – Henry IV n’est pas mort ?
FROMENTEL, en robe de chambre.
Cet animal de Bourgogne qui vient me réveiller en sursaut !... aujourd’hui... qu’on ne dort plus !
LE MARQUIS.
Venez ici !
Fromentel et Vauclin se regardent surpris.
Mais venez donc !
Il les fait passer devant lui à la fenêtre.
VAUCLIN.
Eh bien ?
LE MARQUIS.
Voyez-vous quelqu’un là-bas... assis sur le petit mur ?...
VAUCLIN.
Oui.
FROMENTEL.
Je ne vois rien du tout.
Il prend la lorgnette.
VAUCLIN.
Drôle d’idée de s’installer là par un temps pareil !
FROMENTEL, regardant avec la lorgnette.
Ah !... oui, je vois !... c’est une paysanne !
VAUCLIN, haussant les épaules.
Voilà comme ils ont toujours vu clair. – Et c’est pour nous montrer ce monsieur que tu nous fais ?...
LE MARQUIS, l’interrompant.
Il lève et baisse la tête comme s’il faisait signe à quelqu’un, n’est-ce pas ?
VAUCLIN.
Des signes... je ne sais !... mais certainement il écrit !...
LE MARQUIS.
Tu crois ?
VAUCLIN.
Je vois un calepin dans sa main !
FROMENTEL.
Quels yeux !... J’ai beau tourner la machine...
LE MARQUIS.
Il écrit !... c’est bien cela ! il doit écrire ! Eh bien, savez-vous à qui il écrit ?
VAUCLIN.
À qui ?
LE MARQUIS.
À Marguerite.
VAUCLIN.
Ce jeune homme ?
FROMENTEL.
Il écrit à ma nièce !
LE MARQUIS.
Et ce qu’il peut lui dire, je vous le laisse à penser, quand vous saurez que depuis deux jours ce beau muguet caracole autour de la maison et que Marguerite ne dédaigne pas de faire galerie à ses gentillesses !
VAUCLIN.
Diable !
Il examine plus attentivement.
FROMENTEL, descendant.
Une Fromentel recevoir des lettres... ce n’est pas possible !
LE MARQUIS.
Une la Rochepéans en reçoit bien.
FROMENTEL.
Ah ! mais je ne réponds pas des la Rochepéans, moi !
LE MARQUIS.
Monsieur Fromentel !...
VAUCLIN, redescendant.
Allons, il est absurde, oui, et toi aussi !... Sommes nous ici pour jouer au whist on pour remédier au mal ?... As-tu du moins la preuve ?...
LE MARQUIS.
Certaine ! – Je l’ai surpris à cette fenêtre guettant son passage !
VAUCLIN, prisant.
Ah ! nature ! nature !
FROMENTEL.
C’est bien étonnant, ça !...
VAUCLIN.
Vous trouvez, vous ? Vos boites de petits pois fermentent au printemps et vous ne voulez pas que le cœur d’une fille de dix-huit ans...
LE MARQUIS, l’interrompant.
En tout cas, il faut être bien enragé de matérialisme pour comparer le cœur de ma nièce...
FROMENTEL.
Oui !... à une boite de... Oh !...
VAUCLIN, haussant les épaules.
Ah ! si vous croyez que je vais m’amuser à vous répondre !...
Il remonte.
FROMENTEL.
Enfin !... où allons-nous ? Je le demande... où allons-nous ?
LE MARQUIS.
En trois mots, voici le fait ! – Vous plaît-il plus qu’à moi, à toi, le parrain de l’enfant... à vous, son...
Avec difficulté.
Son grand-oncle !... puisqu’enfin vous êtes son grand-oncle !... de faire accueil au galant, et de marier Marguerite ?
VAUCLIN.
La marier ?
FROMENTEL.
Avec lui ?
LE MARQUIS.
Le premier fat qui passe, un intrus !... les cheveux au vent ... Un étranger ! Un ennemi ! et celui-là nous la prendra !... nous l’arrachera !... Et nous voilà de nouveau tous les soirs seuls en face de nous-mêmes !...
VAUCLIN.
Et plus de musique après dîner !
FROMENTEL.
Et plus de quatrième ! Il faudra encore exhumer ce gredin de mort !
VAUCLIN.
Laissons de côté notre intérêt ; mais le sien ! Qu’on la marie dans quelques années !... passe encore !
LE MARQUIS.
Ou plus tard même !
FROMENTEL, avec insinuation.
Avec un gentil garçon comme Urbain, par exemple !
Le Marquis hausse l’épaule et monte.
VAUCLIN.
Mais aujourd’hui, à dix-sept ans... quelle folie ! Mais sa santé, rien que sa santé s’y oppose.
LE MARQUIS, vivement.
Oui, sa santé !
FROMENTEL, renchérissant.
Parbleu ! sa santé !
VAUCLIN.
Quand elle est à peine convalescente. Voyez ces mains brûlantes, cette pâleur, cette fébrilité constante, signes certains d’un sang très appauvri !...
FROMENTEL.
Parbleu ! le sang noble !...
LE MARQUIS.
Plaît-il ?
FROMENTEL.
Je dis le sang noble !... car pour ce qu’il lui vient de mon côté, il est certain que le sang a toujours été beau, chez les Fromentel !
LE MARQUIS.
Mais pas plus, je pense, que chez les la Rochepéans !
FROMENTEL.
Ma foi ! je n’en sais rien, moi... vous avez fait les cent dix-neuf coups, du temps de Louis XV.
VAUCLIN.
Et sous la régence donc ?
FROMENTEL, appuyant.
Oui ! sous la régence !
LE MARQUIS.
C’est-à-dire que les Fromentel se sont mésalliés, n’est-ce pas, en épousant une des nôtres ?
FROMENTEL.
Je ne dis pas ça !... Mais enfin... au point de vue de la race.
Avec mépris.
Comme croisement !
LE MARQUIS.
Mais comment donc, mais je vous demande humblement pardon, mon cher monsieur Fromentel, et je supplie votre haute roture de ne pas trop humilier un pauvre gentilhomme en le faisant rougir d’une noblesse qui a le front de remonter aux Croisades !
VAUCLIN, qui est remonté à la cheminée.
Ah ! bon ! j’attendais les Croisades ! Ah ! j’étais bien étonné qu’on n’eût pas encore parlé des Croisades !
Redescendant.
Mais, sacrebleu ! si vous y étiez, aux Croisades, nous y étions aussi, nous !... Car, enfin, s’il y avait des chefs, il y avait aussi des soldats !
LE MARQUIS, avec mépris.
Des soldats ?
FROMENTEL, héroïquement.
Oui... des soldats ! Oui, nous étions aux Croisades !
LE MARQUIS, haussant les épaules.
Une armée de coquins dont on n’était pas fâché de se débarrasser.
VAUCLIN.
Coquins !...
FROMENTEL, se prenant la tête.
Ah... où allons-nous, mon Dieu ? où allons-nous ? Nous voilà en Palestine, maintenant.
VAUCLIN.
Enfin, je dis, pour me résumer, que la santé de Marguerite lui défend d’aimer personne, jamais.
FROMENTEL, grommelant.
Personne !... Doucement ! et Urbain ! je trouve moi...
Le Marquis remonte comme précédemment.
VAUCLIN, lui coupant la parole.
Quoi ?
FROMENTEL.
Mais...
VAUCLIN, même jeu.
Allez !
FROMENTEL.
Enfin... je...
VAUCLIN, tapant sur sa tabatière.
Dépêchons !...
FROMENTEL.
Mais, sapristi ! laissez-moi donc parler.
VAUCLIN, irrité.
Mais quoi... Parlez !... dites !... Qu’est-ce que vous voulez ?
FROMENTEL, humblement.
Mais, au risque de me faire conspuer, je trouve ça un tout petit peu despote !...
VAUCLIN.
Parce que ?
FROMENTEL.
Mais, sapristi ! parce que la liberté !...
LE MARQUIS, au fond.
Liberté n’est pas licence !
VAUCLIN.
Pardieu !
FROMENTEL.
Mais je soutiens !...
VAUCLIN, s’échauffant.
Mais vous n’avez pas le droit de soutenir, mais je vous défends de soutenir !...
FROMENTEL.
Pourtant...
VAUCLIN, l’interrompant.
Elle est citoyenne avant d’être femme ? C’est à la société, à vous, à moi surtout, de juger ce qu’il lui convient.
FROMENTEL, se prenant la tête à deux mains.
Où allons-nous !
VAUCLIN, même jeu.
Et d’entraver son choix au nom même de cette liberté qu’elle vent aliéner.
FROMENTEL.
Où allons-nous !
VAUCLIN.
Et que je lui réserve pour plus tard.
FROMENTEL.
Si...
VAUCLIN.
Mais, saprebleu ! laissez moi donc parler !
FROMENTEL.
Mais il n’y a que vous qui parlez !
LE MARQUIS, s’interposant.
Oh ! non, non, non ! Restons-en là, n’est-ce pas ? Il est bien entendu que ce monsieur ne nous convient pas ?
VAUCLIN.
Jamais !...
FROMENTEL.
Oh ! pour cela, jamais !
LE MARQUIS.
Et que nous l’empêcherons de l’aimer ? et qu’elle ne l’aimera pas, fallût-il employer l’autorité ?
FROMENTEL.
La ruse !
VAUCLIN.
Et les moyens révolutionnaires !
LE MARQUIS.
Et vous m’aiderez ?
FROMENTEL.
Je le jure.
Ils se serrent la main.
LE MARQUIS.
Enfin ! c’est heureux ! c’est la première fois que nous sommes un peu d’accord !
Scène VIII
LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL, ROSALIE
ROSALIE, essoufflée.
Me voilà ! me voilà !
À Fromentel.
J’ai rencontré votre fils en route et je l’ai envoyé aux renseignements !
LE MARQUIS.
Urbain.
ROSALIE.
Oh ! soyez tranquille ! sans lui dire pourquoi ; je ne sais pas ce qu’il sait, mais je sais tout.
LE MARQUIS.
Urbain est de trop ; mais voyons !...
ROSALIE.
Madame Chauvot n’était pas chez elle ! J’ai couru chez madame Biju, qui n’a pris que le temps de mettre son châle et de courir avec moi chez mademoiselle Béguin, la directrice des postes, où j’ai trouvé la femme de l’adjoint et ses trois filles !
LE MARQUIS.
Bon ! voilà toute la ville à présent !
ROSALIE, l’interrompant.
Non. Soyez donc tranquille ! ça ne sort pas de nous ! Et au moins j’ai eu tout ce que je voulais savoir sur le galant.
TOUS TROIS, attentifs.
Ah ! voyons !
ROSALIE.
C’est rien du tout ! rien du tout ! – Un fils de famille de Rennes, ruiné dans les mauvaises sociétés de Paris ! Il est malade de la moelle épinière et il est venu à Quimperlé, où il a donné rendez-vous à une femme mariée, une Parisienne, la femme d’un horloger de la rue Vivienne qui doit venir le rejoindre. Il va tous les jours à la poste ; il n’a pas deux mois à vivre ; il s’appelle Bonivart, mais c’est un faux nom ! Il fait de la dépense et ne paye pas, et madame Hardouin, la maîtresse du Coq hardi, où il loge, est bien décidée à le mettre à la porte le jour où arrivera sa princesse ! Voilà.
VAUCLIN.
Joli personnage !
LE MARQUIS.
Il n’est pas dangereux.
FROMENTEL.
Et Urbain ?
Scène IX
LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL, ROSALIE, URBAIN, essoufflé
URBAIN.
Me voilà ! Je sais qui c’est...
ROSALIE.
On le sait déjà.
URBAIN.
Oui, mais il y a toujours de nouveaux détails.
LE MARQUIS.
C’est clair ! Dites ce que vous savez.
URBAIN.
Oh ! mais je viens de la bonne source, moi ! Je viens du Café du Commerce, où il prend sa demi-tasse tous les jours. – C’est un commis voyageur pour les vins de Bourgogne, un gros, gras, bien portant, qui arrive d’Auxerre et qui va en Angleterre rejoindre sa femme, qui est marchande de modes. – C’est bien ça, n’est-ce pas ?
ROSALIE.
Mais non, ce n’est pas ça !
URBAIN.
Comment, non ? Je tiens mes renseignements de Duclozel, qui est à la mairie ; il a huit enfants ; l’aîné est an collège de Quimperlé ; sa femme est une ancienne bonne et il s’appelle Martin.
ROSALIE.
Martin Bonivart.
URBAIN.
Mais non, Martin tout court.
ROSALIE.
Bonivart !
URBAIN.
Martin !
ROSALIE.
Mais ce n’est pas le même ! Qu’est-ce que vous nous chantez !...
URBAIN.
Mais c’est le vôtre qui n’est pas le même !
ROSALIE.
Mademoiselle Béguin ne peut pas s’être trompée.
URBAIN, avec mépris.
Des renseignements de vieilles !
ROSALIE.
Qu’appelez-vous vieille ?
URBAIN.
Vous.
LE MARQUIS.
Eh bien ! eh bien !
FROMENTEL.
Garnement !
VAUCLIN.
Fais-moi le plaisir de retourner au café, toi !
LE MARQUIS.
Où vous serez à votre place mieux qu’ici !
FROMENTEL.
Et en avant, marche ! Détalons !
URBAIN.
Vous me renvoyez ?
VAUCLIN.
Non, je te mets à la porte !
URBAIN, remontant, avec humeur.
Eh bien ! je m’échinerai une autre fois à vous avoir des renseignements exacts !
VAUCLIN.
Allons, vite !
URBAIN, avec mépris.
Voilà la province ! tenez... des cancans !...
FROMENTEL.
T’en iras-tu, polisson !
URBAIN, haussant les épaules.
Au dix-neuvième siècle !...
Il disparaît.
Scène X
LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL, ROSALIE
LE MARQUIS.
Allons ! nous ne savons rien, pas même son nom, et décidément, le plus sûr, c’est de le faire dire à lui-même !
VAUCLIN.
Où ça ?
LE MARQUIS.
Ici !
VAUCLIN.
Tu veux le faire venir ici ?
LE MARQUIS.
Il faut voir son ennemi face à face ! – D’ailleurs, n’est-ce pas là le meilleur moyen ? Recevoir ce monsieur, feindre de tout ignorer, lui faire tout doucement mesurer la distance qui nous sépare et la hauteur de son outrecuidance ; et à bon entendeur, salut ! Est-il toujours à la même place ?
FROMENTEL, avec la lorgnette.
Je ne vois rien.
VAUCLIN.
Non ! il est maintenant dans la prairie, qu’il traverse pour s’en aller.
LE MARQUIS.
Il s’en va !
ROSALIE, radieuse.
Oui, mais il ne pourra pas sortir du pré !
VAUCLIN.
Parce que ?
ROSALIE, de même.
Parce qu’il a passé ce matin le fossé sur la glace ; l’eau était prise ; mais voilà deux heures que le soleil y donne, et s’il veut prendre un joli bain...
LE MARQUIS.
Bien ! la retraite lui est coupée de ce côté ; il sera forcé de se rabattre sur le parc !
ROSALIE.
Mais une fois là, il sortira par la grille.
VAUCLIN.
Je dois avoir ma clef ! Je ferme avant qu’il y soit...
Il fouille dans ses poches.
LE MARQUIS.
Il faudra bien qu’il s’adresse à quelqu’un de la maison ! et ce quelqu’un... ce sera moi !
Regardant sa montre.
Un quart d’heure à nous le temps de mettre un habit...
À Vauclin, qui cherche sa clef.
Allons donc, Léonidas vite donc aux Thermopyles !...
Il entre dans son appartement.
FROMENTEL.
Pourvu que j’aie le temps de prendre mon café !...
Il ramasse sa robe de chambre et sort par le fond en courant.
ROSALIE, à Vauclin.
Si je me glissais du côté du ruisseau pour jouir de son embarras !
VAUCLIN.
Ne nous montrez pas, il se sauverait !
Il sort rapidement par le fond.
ROSALIE, après un silence, avec indignation.
Monstre !
Elle sort.
Scène XI
URBAIN, entrant par la porte de gauche et descendant à droite de la scène, où Rosalie sort par le fond
Quimperlois, va ! Ils me chassent !... Et M. le Marquis :
L’imitant.
« Vous serez mieux au café qu’ici. » Certainement j’y serais mieux.
Se tournant vers la porte de l’appartement.
Mais je ne connaîtrais pas votre petit complot. – J’entendais là, derrière la porte, mademoiselle de Forbac :
L’imitant.
« Il ne pourra pas sortir !... Il ne pourra pas sortir ! » C’est au commis voyageur qu’ils en veulent. Si je pouvais... pour faire pièce à M. le Marquis...
Il traverse la scène en courant pour sortir par où il est entré, et en passant aperçoit Marcel dans le jardin. S’arrêtant.
Tiens ! le voilà, le jeune homme !...
Appelant.
Monsieur, vous voulez sortir ? Montez le perron, là... à droite ! Je vais vous indiquer le chemin.
À lui-même, enchanté.
Ah ! si le Marquis me voyait !
Il ouvre la porte de gauche et entend du bruit à celle de droite.
On vient !... C’est lui !
Effrayé.
Je me sauve !
Il se sauve par le fond.
Scène XII
MARCEL, seul, entrant par la gauche, un album à la main
Monsieur !
Étonné de ne voir personne et allant appeler Urbain au fond.
Hé !... monsieur !...
Redescendant à droite.
Il m’appelle ! j’arrive, et il se sauve... Je veux pourtant sortir.
Regardant l’heure à sa montre.
Et dix heures déjà !... Voilà un petit dégel venu bien mal a propos.
Marguerite entre vivement par la porte d’appartement et traverse la scène sans le voir, pour courir à la fenêtre.
Scène XIII
MARCEL, MARGUERITE
MARCEL, sans la voir.
Mon travail est fini !... Tous mes plans !... Je n’ai plus rien à faire ici, moi !
Il va pour remonter et sortir, et aperçoit Marguerite qui se retourne au même instant.
MARGUERITE, poussant un petit cri de joie.
Ah ! c’est vous !
MARCEL, très surpris et avec une joie bien cordiale.
Marguerite ici !... Ah ! chère enfant ! quelle rencontre ! Ah ! que je sais content de vous voir !
MARGUERITE.
À la bonne heure, vous vous êtes décidé à venir, au moins ! Je vous regardais tout à l’heure ; je me disais : « Mais il ne viendra donc pas !... mais il restera donc toujours là, sur son vilain mur ! »
MARCEL, gaiement.
Vous m’avez aperçu ?
MARGUERITE.
Mais je crois bien ; faites l’étonné ! Je vous ai dit bonjour ! vous m’avez bien vu !
MARCEL.
Mais non !
MARGUERITE.
Puisque vous m’avez répondu !
Baissant la tête.
Comme cela !
MARCEL.
Vous vous êtes trompée, chère enfant ! Mais qu’importe !... À présent, je vous le dis ce bonjour, et de tout mon cœur !
MARGUERITE, le faisant descendre avec elle à gauche.
Vous êtes donc devenu timide, monsieur... avec vos amis ?
MARCEL, sans comprendre.
Timide ? Comment, timide ?
MARGUERITE.
Pourquoi n’être pas venu tout naturellement frapper à notre porte ? Je vous aurais présenté à M. le Marquis, mon oncle !
MARCEL, étonné.
Votre oncle ! M. le Marquis ! le Marquis de la Rochepéans ?...
MARGUERITE.
Est le frère de ma pauvre mère !... – J’ai aussi mon grand-père !
MARCEL.
Le Duc !
MARGUERITE.
Oui ; cela doit bien vous étonner... vous qui m’avez vue... C’est toute une histoire ; je vous conterai cela !
MARCEL.
De sorte que vous êtes ici...
MARGUERITE.
En famille, mais sans doute, depuis quinze jours ! – Et si vous saviez comme ils sont bons pour moi !
MARCEL.
Et comment ne le seraient-ils pas ? L’heureuse nouvelle !... Et que j’en suis ravi pour vous, mademoiselle, qui méritez si bien !...
MARGUERITE.
On ne vous a donc pas conté tout cela, à Paris ?
MARCEL.
Mais non, j’arrive de Brest, et...
MARGUERITE, l’interrompant.
Enfin, vous saviez toujours bien que j’étais ici, puisque vous avez fait deux fois le tour de la maison pour me saluer !...
MARCEL.
Moi !
MARGUERITE.
Oui !... hier et ce matin.
MARCEL, surpris.
En effet, oui, hier et ce matin... j’ai rodé autour de la maison... mais c’était...
À part.
Elle ne peut pourtant pas croire que c’était pour elle !
MARGUERITE, l’observant.
Oui, oui, vous êtes embarrassé parce que vous vous sentez coupable ! Fi ! que ce n’est pas bien ! Mais on vient à ses amis, simplement, et on leur dit : « C’est moi, me voilà, voulez-vous de moi ? »
MARCEL.
Eh bien, oui, j’ai eu tort, et une autrefois, chère enfant !... Ah ! pardon, laissez-moi vous donner encore ce petit nom d’amitié, qui me rappelle nos bonnes causeries de l’automne dernier ! Vous souvenez-vous de ces belles et bonnes soirées au coin de feu ?
MARGUERITE.
Si je m’en souviens !
MARCEL.
Je vous vois toujours dans votre grand fauteuil, toute pâle, toute faible...
MARGUERITE.
J’étais bien malade et bien triste, en effet, et vous étiez bien bon pour moi.
MARCEL.
Mais les couleurs commencent à revenir... vous voilà bientôt fraîche et souriante, et plus charmante que jamais !
MARGUERITE.
Pas encore bien forte !
MARCEL.
Si si ; quelle différence !
MARGUERITE, prenant un siège.
Mais asseyez-vous donc et causons un peu comme autrefois...
Mouvement de Marcel, qui regarde à sa montre.
De vous d’abord ! Vous passiez donc par Quimperlé ?
MARCEL, s’asseyant forcément.
Mais oui, je retourne à Paris.
MARGUERITE, malicieusement.
Et vous vous êtes arrêté pour me voir ?...
MARCEL.
Pour...
Se reprenant.
Pour vous voir. Précisément !
À part.
Elle y tient.
Haut.
Oui... quand j’ai su que vous étiez ici...
MARGUERITE, vivement.
Ah ! vous le saviez donc !... Vous disiez tout à l’heure que vous n’en saviez rien ?
MARCEL, souriant de son propre embarras.
Je le savais vaguement !...
MARGUERITE.
Voyez un peu comme vous êtes devenu menteur !... et tout cela pour s’excuser de ne pas s’être présenté tout de suite : on vous à donc parlé de moi ?
MARCEL.
Mais certainement !
MARGUERITE.
Ah !... qui donc ?
MARCEL, à part.
Elle ne me laissera pas respirer.
Haut.
Un ami.
MARGUERITE, vivement.
Ah ! de ce pays ?
MARCEL.
Oui, du pays.
MARGUERITE, vivement.
M. Barillon, peut-être ?
MARCEL, vivement.
Eh ! Barillon, justement !
À part.
Je suis sauvé.
Haut.
C’est Barillon !
À part.
Béni soit Barillon !
MARGUERITE.
C’est un bien excellent monsieur qui est venu parler pour moi à mon oncle.
MARCEL, se rappelant.
Eh ! mon Dieu ! Il y a quinze jours, n’est-ce pas ?
MARGUERITE.
Oui.
MARCEL, à lui-même.
Mais alors, cette jeune fille ?...
MARGUERITE.
Oui !...
MARCEL.
Qu’il voulait !
MARGUERITE.
Oui ! oui !...
MARCEL, à part.
Me faire épouser... Il est fou ! Une marquise.
Haut.
Mais j’étais présent quand il est venu !
MARGUERITE.
Vous étiez ici le soir de mon arrivée ?
MARCEL.
Le soir même !...
MARGUERITE, debout.
Et vous ne m’avez pas attendue ?
MARCEL, saisi et déposant sur la table son album et son chapeau.
Je... oui... c’est vrai !... Je ne comprends pas comment je ne vous ai pas attendue !...
À part.
Allons, je n’en sortirai pas !
MARGUERITE.
Enfin, je ne veux plus vous faire de reproches, vous finiriez par me détester !...
MARCEL.
Oh ! pour cela !
MARGUERITE.
Mais comme il ne faut plus que vous vous sauriez ainsi, je vais vous présenter à mon oncle, qui vous recevra !...
Elle remonte en courant.
MARCEL, courant pour l’arrêter.
Me présenter !... non ! non ! J’aime mieux une autre fois !... plus tard...
MARGUERITE, après avoir poussé la porte de droite, sans voir personne.
Pourquoi ? Vous vouliez le voir.
MARCEL.
Oui, mais j’ai réfléchi !... Ce que j’avais à lui demander ! Enfin, pas aujourd’hui, n’est-ce pas ?
MARGUERITE.
Allons vous n’avez pas de bonnes raisons, monsieur ; et puis il faut bien que vous soyez présenté, pour avoir le droit de me venir voir !
Elle pousse la porte du fond en appelant Bourgogne.
Bourgogne !...
MARCEL, à lui même, redescendant.
Elle est d’une logique... il n’y a pas moyen !...
MARGUERITE.
Ne vous sauvez pas, au moins ! Je croirais que vous ne voulez pas m’avouer pour votre amie !
MARCEL, à droite.
Oh ! par exemple !
À lui-même.
Mais je ne veux pas voir le Marquis, moi... il va me demander ce que je suis venu faire chez lui ! Et je n’ai pas le droit...
Montrant son album en traversant de droite à gauche.
Eh ! non ! c’est encore un secret.
Haut.
Demain ! je vous en prie.
MARGUERITE, redescendant.
Non, non ! aujourd’hui ! Voici mon oncle !
Scène XIV
MARCEL, MARGUERITE, LE MARQUIS, FROMENTEL, VAUCLIN
Ils paraissent tous trois en même temps, chacun à une porte, Vauclin à gauche Fromentel au milieu, le Marquis à droite.
LE MARQUIS, à lui-même.
Ensemble !...
MARCEL, à part, les regardant avec surprise.
Eh ! mon Dieu ! c’est une galerie !...
MARGUERITE, gaiement.
Mon oncle, permettez-moi de vous présenter...
LE MARQUIS, l’interrompant.
Marguerite votre grand-père vous demande !
MARGUERITE, déconcertée.
Mais, mon oncle !...
LE MARQUIS.
Allez !... mon enfant, allez vite ! Il attend !
MARGUERITE, après l’avoir regardé, à elle-même.
Mon Dieu !... qu’est-ce que j’ai donc fait de mal ?
Elle sort par la droite sur un regard du Marquis, toute troublée.
Scène XV
MARCEL, LE MARQUIS, FROMENTEL, VAUCLIN
MARCEL, à part.
Ah ça, qu’est-ce que cela signifie ?...
Haut.
Je serai donc forcé de me présenter moi-même, monsieur le Marquis, et...
LE MARQUIS, descendant, avec une extrême politesse.
Et la présentation n’en sera pas plus mauvaise, monsieur... Soyez assez bon pour me dire qui j’ai l’honneur de recevoir chez moi !...
MARCEL.
Un compatriote, monsieur. Permettez-moi de m’autoriser de ce seul titre pour justifier l’importunité d’une visite que je vous aurais certainement épargnée, sans l’insistance de mademoiselle Marguerite.
LE MARQUIS, s’asseyant et l’invitant à s’asseoir.
Mais je sais fort bon gré à ma nièce de son empressement à vous retenir, monsieur, et je ne me consolerais pas d’ignorer plus longtemps le nom qu’elle allait me dire et qui est sans doute...
MARCEL.
Oh ! fort obscur, monsieur !... Marcel Cavalier !
LE MARQUIS, à lui-même.
Eh ! allons donc !
Haut, en souriant.
Marcel Cavalier ! oh ! très bien !...
À lui-même.
Croquant !
Haut.
Cavalier !... Mais permettez !... il me semble que ce nom ne m’est pas inconnu... Cavalier !...
MARCEL, un peu choqué du ton du Marquis.
Sans doute, monsieur la Marquis... car mon arrière-grand-père était attaché à votre maison, et vous avez certainement connu mon grand-père dans votre jeunesse !
LE MARQUIS.
Ah ! parfaitement ! Pierre Cavalier, notre intendant !
MARCEL.
Oui, monsieur.
LE MARQUIS.
Ah ! charmante rencontre !
À lui-même.
Délicieuse même !... Cela va tout seul maintenant !
Haut.
Ah ! vous êtes le petit fils de ce brave homme.
MARCEL.
Brave homme, en effet, monsieur le Marquis ; car en 93 il sauva au péril de sa tête le Duc, votre père, qu’on venait arrêter !
LE MARQUIS, un peu embarrassé, se remettant.
C’est bien ce que je voulais dire : un bon serviteur.
VAUCLIN, avec intérêt.
Monsieur descend du Jean Cavalier qui a commandé les révoltés des Cévennes ?
LE MARQUIS, se levant.
Oh nullement ! Cavalier n’était même pas un nom...
À Marcel.
N’est-ce pas ? c’était un surnom !... pour le distinguer d’un autre serviteur de la maison ! Pierre le Cavalier ! C’est-à-dire que celui-là montait ordinairement à cheval pour porter nos lettres et faire nos courses.
À Marcel.
N’est-il pas vrai ?
MARCEL.
Parfaitement, monsieur le Marquis ; mais mon père a glorieusement transformé l’épithète en nom légitime le jour où, à la tête d’une centaine de volontaires mal montée et mal équipés comme lui, il fit à Jemmapes certaine charge à fond de train qui lui valut l’accolade de Dumouriez et son premier grade sur le champ de bataille !
VAUCLIN, avec chaleur.
Votre père est un volontaire de 92, jeune homme ?
MARCEL.
Capitaine à Fleurus, monsieur.
VAUCLIN.
Bravo !
MARCEL.
Et colonel à Wagram !
VAUCLIN, faisant la grimace et se détournant.
Ah ! l’Empire !...
LE MARQUIS.
Et vous répudiez un passé si glorieux, monsieur Cavalier ; vous n’êtes pas soldat ?
MARCEL.
Autres temps ! autres devoirs !... Mais, pardon, Monsieur le Marquis, ma visite se prolonge et je craindrais...
LE MARQUIS.
Du tout, ne nous privez pas d’une conversation à laquelle j’attache le plus grand intérêt, je vous assure ; et dites-nous, au moins, monsieur Cavalier, par quelles fonctions vous ennoblissez, à votre tour, un nom si bien porté ?...
MARCEL.
Cela est d’un médiocre intérêt pour vous. Monsieur le Marquis, je suis ingénieur.
LE MARQUIS.
Ingénieur civil... ah ! très bien !
À part.
Et tu fais la cour à ma nièce, arpenteur ?
FROMENTEL.
Est-ce que c’est vous qui avez fait notre nouveau pont ?
MARCEL.
Non, monsieur !
FROMENTEL.
C’est que je ne vous en ferais pas mon compliment !... Si on avait bâti comme ça de mon temps !
MARCEL, à lui-même, les regardant.
Ah çà, mais ils sont fort désagréables !... Où veulent-ils en venir ?
LE MARQUIS, ironiquement.
Allons, monsieur Cavalier, je vous fais mon compliment : vous avez bien choisi la carrière du moment ! Vive Dieu ! messieurs, on ne vous accusera pas de ne point remuer les pierres ! Vous excellez à démolir surtout ! Pif, paf ! allez donc ! la pioche et le pic !... Palais ! châteaux ! églises... Bah !... au vent ! – courage ; et sur les débris du vieux Paris, faites-nous un joli Paris tout neuf, avec chemins de fer sur les toits, et télégraphes électriques d’une fenêtre à l’autre !... le tout parqueté, voûté, éclairé, chauffé au gaz comme une usine et parfumé d’huile chaude et de carbone : ce sera délicieux !
MARCEL, piqué.
Je ne sais pas, monsieur le Marquis, si nous ferons jamais ce Paris là ; mais je puis bien vous garantir que nous ne vous rendrons jamais celui du moyen âge.
LE MARQUIS.
Tant pis, monsieur, il était beau !
MARCEL.
Les jours de peste surtout !... Mais de quel Paris parlez vous, monsieur le Marquis ? – du Paris de Louis XIV, de François 1er, de Charles V, ou de Philippe Auguste ?
LE MARQUIS.
De tous.
MARCEL.
Il faut pourtant choisir ; car enfin l’un ne s’est bâti que sur les débris de l’autre ; et pour être absolument logique, vous n’avez le droit de regretter que le premier démoli, celui de Julien l’Apostat.
LE MARQUIS.
Je regrette tout ce qui était beau et qui est tombé.
MARCEL.
Eh ! nous aussi, monsieur, et nous nous efforçons assez à réparer le mal ! Mais vous parliez d’églises ; et, sans vous rappeler que c’est nous qui restaurons aujourd’hui celles que vos pères ont gâtées au dix-huitième siècle, allez à Sainte-Croix, votre paroisse, regardez une des fenêtres de l’abside, à l’intérieur ; vous y verrez une pierre où sont encore gravés quelques caractères antiques : Un ex voto à Cérès ! Tout ce qui reste d’un temple païen qui fut jadis à la même place. – Le temple était fort beau sans doute, mais il n’était plus que le passé ! et l’Église s’est victorieusement assise sur les débris du temple écrasé dans sa poussière !... C’était la loi !... c’était justice, et je vous défie de l’en blâmer.
LE MARQUIS.
Oh ! l’église soit !... mais...
MARCEL, avec chaleur.
Et pourquoi n’obéirais-je pas à la même loi, quand j’élargis nos rues, au risque d’éventrer la façade de vos hôtels ? – Ils sont vides et la foule est dans la rue ! Faites-lui place !... Vous regrettez vos ruines ! Eh ! nous aussi ; mais je veux passer et je passerai : car je suis dans mon droit ; car j’obéis à cette loi divine qui sacrifie partout la poésie du passé aux réalités du présent ; car j’entends une voix qui me crie sans cesse : « Souviens-toi que tu viens du pire et que tu vas au mieux ; marque ton pas ! pour que tes fils le retrouvent !... Et vite, et En avant !... » Et grisé par ces mots : En avant ! répétés sans cesse à mon oreille, comme vos anciens cris de bataille, et qui nous poussent à la bataille, en effet, mais contre l’Ignorance, la Routine, la Misère, la Faim, la Douleur !... dans cette sainte croisade de l’humanité tout entière liguée contre le Mal, je sens avec orgueil que c’est moi qui la mène au combat... et je voie partout devant elle chevauchant la vapeur... Et Hurrah ! Le convoi à travers les plaines !...par-dessus les fleuves !... et dans le sein des monts !... Hurrah !... L’humanité qui voie à l’air libre et à tire-d’aile vers l’Avenir !... Et quant aux ruines que je disperse en passant... belle affaire ! Je sème des villes sur la route !... Bonsoir, poussière, et en avant ! Hurrah ! Les morts sont morts !... c’est pour que les vivants aillent plus vite !
VAUCLIN.
Bravo ! jeune homme, bravo ! nous faisons route ensemble !
MARCEL.
Quand vous ne chauffez pas trop, monsieur, et quand vous ne déraillez pas !
LE MARQUIS.
Charmante allégorie !... Que suis-je donc, moi, à ce prix ? La Chaise à porteurs ?
FROMENTEL.
Et moi le Coucou !
LE MARQUIS.
Je me figurais, naïf, que pendant des siècles nous avions guidé l’humanité dans le bon chemin.
MARCEL.
À la longue, monsieur le Marquis, le meilleur sillon peut devenir une ornière.
LE MARQUIS.
Et qu’y jetez-vous, monsieur, dans votre sillon, qui vaille ce que nous semions dans le nôtre ?
MARCEL.
Tout ce que vous semiez, monsieur le Marquis, et de plus, une petite graine qui favorise merveilleusement la croissance des autres, le Progrès !
LE MARQUIS, ironiquement.
Eh ! allons donc ! Lâchez-le donc le fameux mot : le Progrès, monsieur. Oh ! mais, comment donc ! mais, je croie bien... le Progrès !... Que ne le disiez-vous tout de suite ! Mais, vive le Progrès, pardieu !...
MARCEL.
Toutes les railleries ne feront pas...
LE MARQUIS.
Ah ! vous photographiez mon portrait plus laid que nature et vous appelez cela de l’art !... Ah ! vous fabriquez du vin où il n’entre pas un grain de raisin et vous appelez cela de la science ! Ah ! vous niez le bon Dieu, comme monsieur,
Il montre Vauclin.
pour douer la salade et les petits cailloux de propriétés divines... et vous appelez cela de la philosophie !... Ah ! vous inventez des machines qui sautent, des locomotives qui sautent, des lampes, des cafetières et des calorifères qui sautent, et vous appelez cela le Progrès ?
MARCEL.
Mais il y a aussi...
LE MARQUIS, vivement.
Oui, les mœurs ! n’est-ce pas ? C’est là qu’il fleurit, votre Progrès ? une vie folle, fiévreuse, enrobée, qui ne laisse le temps ni de penser, ni d’aimer, ni d’être bon, ni surtout d’être honnête ! On va, on vient, on court, on mange vite, on dort vite, on se marie très vite ! on se déteste encore plus vite : monsieur va au cercle, madame au bal, le fils au café ou ailleurs ; l’argent gagné, Dieu sait comme, arrive, saute et sort, Dieu sait comment ! Du luxe partout ! de l’aisance nulle part ! Une génération d’horribles petits vieillards étiques que vous appelez vos jeunes gens (les présents sont exceptée, bien entendu), qui jouent à la Bourse à l’âge ou nous jouions encore aux billes ! Tout cela sans frein, sans foi, sans chaleur et sans flamme !... Égoïstes, blasés, mal appris, abrutis par le tabac, par le jeu, par les filles, et portant bien la trace de leurs sales veilles sur des fronts blêmes comme l’argent et jaunes comme l’or... Le voilà votre avenir !... la voilà votre espérance ! Le voilà votre immense, votre admirable, votre merveilleux Progrès... dans le mal !
MARCEL.
Et voilà bien aussi l’éternel refrain qui depuis quatre mille ans se répète de père en fils : les vices d’aujourd’hui, mais les vertus d’autrefois ! – Souffrez, monsieur le Marquis, que je défende cette pauvre génération dont je suis, et que je vous demande en quoi la belle jeunesse de ce que vous appelez le bon temps valait mieux que la nôtre ! Nous fumons, c’est vrai ! vos Richelieu prisaient !... Nous allons au café : vous alliez au cabaret !... Nous nous ruinons pour ce que nous appelons ces dames du demi-monde ; vous vous ruiniez bellement pour ces mêmes dames qui s’appelaient alors les dames du monde... Nous faisons des mariages d’intérêt où nous allions nos coffres-forts ; vous faisiez des mariages de convenance où vous unissiez vos blasons !... Nous jouons à la Bourse ; vous trafiquiez rue Quincampoix ; et nous n’avons pas encore trouvé notre comte de Horn qui assassine un coulissier pour lui voler ses actions !... Vous vous récriez à nos toilettes, à nos pince-nez, à nos favoris en broussailles !... Et les canons de vos raffinés et leurs déplorables perruques !... Pourquoi des crinolines à nos dames ?... Pourquoi des paniers aux vôtres ? – Sont-elles peintes !... Étaient-elles coloriées !!! Mal élevés, nous le sommes, je le veux bien, mais enfin nous ne rossons plus le guet ; nous ne bâtonnons plus les valets, les créanciers, ni les maris ! – Nous ne cassons plus les réverbères ; nous n’allons plus, par passe-temps, sur le pont Neuf, comme M. le chevalier de Rieux, avec les plus fringants de la cour, voler la bourse et le manteau des passants. – Enfin, nous parlons argot, javanais, tout ce qu’il vous plaira ! C’est bête, oui ! mais avez-vous assez grasseyé, suivant la mode, patoisé, baragouiné à l’italienne, supprimé des R, ajouté des Z ?... Allons ! allons ! monsieur le Marquis, laissez crier à la décadence certaines gens qui n’ont que ce moyen de justifier leur propre nullité, et trop heureux d’ailleurs d’assommer les vivants qui les gênent, avec les os des morts qui ne les gênent plus ; et accordez-moi bonnement qu’en sottises et en vices les siècles n’ont rien à se reprocher l’un à l’autre ; et qu’à tout prendre, avec moins d’honneur qu’autrefois, nous avons souvent plus de probité ; avec moins de morale plus de mœurs, et en définitive, autant d’esprit pour le mal, et tout autant de cœur pour le bien !
LE MARQUIS.
En tout cas, monsieur, ce n’est pas un gentilhomme de mon temps qui se fût permis de franchir la clôture d’une maison dans un but évidemment suspect, puisque nous sommes encore à le connaître !...
MARCEL.
Eh ! monsieur, est ce là que vous vouliez en venir ? Avouez qu’il eût été plus généreux de me mettre loyalement en demeure de me justifier tout d’abord.
LE MARQUIS.
Eh bien ! vous avez dit le mot, monsieur ; faites la chose : et sachons enfin pourquoi depuis deux jours ces allures étranges autour de ma demeure ?
MARCEL.
Je suis peut-être un peu coupable, monsieur le Marquis, je l’avoue, d’avoir pénétré...
LE MARQUIS, l’interrompant.
Un peu coupable !... monsieur, l’homme qui échange des regards avec une jeune fille, et qui tout à l’heure encore lui écrivait...
MARCEL, stupéfait.
Moi !... moi ! mais voilà une déplorable erreur, monsieur... mais ce que je fais depuis hier, mais ce que j’écrivais tout à l’heure... mais rien de tout cela n’a le moindre rapport avec mademoiselle votre nièce, que j’estime et que j’honore infiniment !
LE MARQUIS.
Mais enfin, monsieur, vous regardiez constamment de ce côté.
MARCEL.
Je l’avoue !
LE MARQUIS.
Vous écriviez.
MARCEL.
Pardon !... je dessinais !
Prenant l’Album.
Des croquis, des plans, une vue à vol d’oiseau de votre parc, de votre maison même... et voilà tout mon crime !
Les trois hommes se regardent stupéfaits.
LE MARQUIS.
Mais tout cela, monsieur, dans quel but enfin, pourquoi ?
MARCEL.
Mais pour compléter l’étude que je fais depuis un mois, monsieur le Marquis, par ordre de la Compagnie dont je suis ingénieur.
LE MARQUIS.
Une étude !... de route ?...
MARCEL.
Non, monsieur le Marquis, mais un embranchement du chemin de fer de Nantes, que nous poussons à Quimper, par Vannes et par Quimperlé.
LE MARQUIS, FROMENTEL, VAUCLIN.
Par Quimperlé ?
MARCEL, ouvrant l’album sur la table.
Et voici la tracé que j’achevais et qui coupe en deux votre maison !
LE MARQUIS, tombant assis et saisissant l’album.
Ma maison ! ma maison !
VAUCLIN, courant à la table.
Un chemin de fer, ici ?
FROMENTEL.
Chez nous ?
MARCEL.
C’est la voie directe !
LE MARQUIS, regardant le tracé.
Oui, oui ! regardez ! c’est bien cela ! la ligne noire va, vient, monte et descend ! Elle serpente... elle abat... elle brise tout ! Mon jardin... coupé ! Mon parc, mes vieux arbres, mes beaux arbres coupés !... Ma maison que trois générations se sont plu à agrandir, à embellir... coupée, ruinée, en poussière !
Se levant et avec une colère sourde.
Rien, ils ne nous laisseront rien ! Je fuis leur ville... – je viens m’enfouir dans un désert, loin de leur monde nouveau que j’exècre... et là du moins je me crois à l’abri de leur infernal génie !... Mais non !... nous laisser le droit de vivre, d’aimer, de prier à notre guise... allons donc ! Il faut bien que leur Progrès étende ses bras jusqu’ici, et qu’il nous torture dans ses roues d’acier, et qu’il passe !... Dût-il nous broyer le cœur.
VAUCLIN, cherchant à le calmer.
Voyons ! voyons !
LE MARQUIS.
Ah ! ce n’est pas encore fait ! et j’en jure Dieu, je le défendrai pied à pied, mon dernier asile ; et plutôt que de jeter au vent la cendre du foyer, vous écraserez celle du maître.
Il va tomber assis à droite.
VAUCLIN.
Voyons ! sapristi ! sois un homme ! Du cœur !
FROMENTEL, assis de face et regardant le tracé.
Tout n’est pas perdu, que diable ! Il est si facile de modifier le tracé... ce bon jeune homme ne demande pas mieux... la ligne un peu plus à droite ou à gauche : qu’est-ce que ça lui fait ? Par exemple, sur les terrains de monsieur le maire ! par ici... là ! le petit ruisseau bordé de betteraves ! Ça n’a rien de sérieux ça, un petit ruisseau et des betteraves.
MARCEL, regardant.
Parfaitement.
FROMENTEL.
D’autant que nous ne sommes pas des ingrats et que...
MARCEL, l’arrêtant.
Monsieur Fromentel ! si j’avais pu oublier un instant mon devoir, il ne fallait qu’une phrase pareille pour me rappeler qu’il est tout entier tracé dans cette ligne noire, et que ma conscience n’a plus le droit d’en sortir. Demandez à monsieur le Marquis, qui s’y connaît en fait d’honneur !
LE MARQUIS, se levant.
Vous avez raison, monsieur :... et je vous demande pardon d’avoir pu soupçonner un instant votre loyauté ! Aussi bien n’est-ce pas à vous que j’ai affaire... et je pars...
VAUCLIN.
Tu pars !
LE MARQUIS.
Pour Paris.
FROMENTEL.
Pour Paris ?
VAUCLIN.
Tu veux ?...
LE MARQUIS, très ému.
Ah ! laisse-moi, il ne fallait pas moins pour me faire oublier un serment de trente ans !... Mais je la verrai une fois face à face leur civilisation, et je me mettrai au courant !... Ce n’est qu’un projet, grâce à Dieu !... J’ai des amis, des parents influents !... Je verrai ! je saurai !... Et, pardieu ! moi aussi j’intriguerai... Allez-vous à Paris, monsieur ?
MARCEL.
Non, monsieur le Marquis. – Je souhaite bien sincèrement que vous puissiez faire modifier mes instructions : j’aurai l’honneur, si vous le permettez, de vous voir à votre retour.
LE MARQUIS.
Merci, monsieur ! Adieu, Fromentel ! adieu, Vauclin !
VAUCLIN, l’arrêtant.
Voyons, Laroche ! voyons, là, soyons raisonnable, morbleu ! Si ton roi te la demandait, ta maison, la donnerais-tu ?
LE MARQUIS, avec élan.
Ah ! à lui... parbleu !
VAUCLIN.
Eh bien ! c’est le pays qui la demande ! donne-la, et vive la Nation !
LE MARQUIS.
Ah ! ce n’est pas la même chose, mon ami, ce n’est pas la même chose !
VAUCLIN.
Mais, vieil entêté !...
LE MARQUIS.
Ne me querelle pas !... je n’aurais pas la force de te répondre.
VAUCLIN, lui serrant les mains.
Alors, bon voyage !... bon voyage !
LE MARQUIS, très ému.
Je ne peux pas la quitter pour trois jours sans avoir des larmes dans les yeux ! Et ils veulent que je la perde à jamais ! Ah ! Nous allons bien voir !... Bourreaux ! bourreaux !
Il sort, Cavalier referme son album.
FROMENTEL, prêt à suivre le Marquis, à Marcel, avec reproche.
Quand on pense qu’il était si facile de passer par le petit ruisseau !
MARCEL, le saluant.
Et de rouler dans la boue !
Il sort. Fromentel hausse les épaules et sort de son côté.
VAUCLIN, seul, passant à gauche.
Eh bien ! au moins c’est un honnête homme, celui-là !
Scène XVI
VAUCLIN, MARGUERITE
MARGUERITE, entrant vivement. Musique.
Mon parrain !
VAUCLIN, s’arrêtant et se retournant.
Hé !...
MARGUERITE, inquiète.
Mon Dieu ! que s’est-il donc passé ?
VAUCLIN.
Rien.
MARGUERITE.
Mais où va mon oncle ?
VAUCLIN.
À Paris !
Même jeu.
MARGUERITE.
Ah ! et et lui !...
VAUCLIN.
Cavalier !... Eh bien ! il s’en va, Cavalier.
MARGUERITE.
Et il ne reviendra pas !
VAUCLIN, la regardant.
Qu’est-ce que cela te fait ?
MARGUERITE.
Ah ! ce que vient de me dire Rosalie est donc vrai ? on le renvoie à cause de moi...
Elle glisse sur la chaise à gauche de la table, toute prête à pleurer.
VAUCLIN, courant à elle.
Eh bien ! Marguerite ! Marguerite !...
À lui-même, comprenant.
Ah ! bah !
La tout tombe.
ACTE III
Un salon au premier étage. Au fond, fenêtre avec perron grillé qui descend au jardin. Quand la fenêtre est ouverte, on voit le parc, dont tous les arbres sont dépouillés et couverts de neige. À gauche, premier plan, une cheminée ; du même côté, pan coupé, porte de la chambre de Marguerite. À droite, premier plan, porte d’entrée. Deuxième plan, pan coupé, porte d’appartement. En avant, à droite, un canapé ; devant la cheminée, un grand fauteuil de malade avec un coussin ; un guéridon ; ameublement de même style qu’au premier acte.
Scène première
BOURGOGNE, FROMENTEL
FROMENTEL, entrant.
Eh bien, toujours souffrante ?
BOURGOGNE, occupé à la cheminée.
Ah ! les convalescences ! Je l’ai prédit à mademoiselle. Gare les rechutes ! – La nuit a été un peu agitée, car M. Vauclin a fait rester la garde-malade.
FROMENTEL.
Une Sœur ?
BOURGOGNE.
Ah ! bien, oui ! il n’a pas voulu entendre parler de Sœur. Vous seriez bien aimable d’allumer le feu pour moi, monsieur Fromentel ; je n’ai pas l’habitude de chauffer le salon de si bonne heure, ça me trouble.
FROMENTEL, passant à la cheminée.
C’est bien. Le facteur est il venu ?
BOURGOGNE.
Non, monsieur, pas encore.
FROMENTEL, regardant l’heure.
Deux heures et demie ! ils ne marchent plus, ces facteurs ; rien ne marche.
Il cherche le papier pour allumer le feu.
BOURGOGNE.
Vous verrez qu’il n’y aura pas encore de lettres de M. le Marquis !
À Fromentel, en lui montrant le coin de la cheminée.
Là ! là ! le papier ! – Cinq jours à Paris... qu’est-ce qu’il peut faire ? Et M. Vauclin qui n’a pas voulu lui écrire l’état de mademoiselle, de peur de l’effrayer !
Même jeu.
Les allumettes... là !... dans le coin ! – Il nous dit toujours que ce n’est rien.
Secouant la tête.
Mais j’ai idée qu’au fond, il n’est pas si tranquille que ça. Eh bien, ça va-t-il ?
FROMENTEL, frottant encore une allumette qui rate.
Et de dix !
BOURGOGNE, s’en allant.
Et puis M. le Duc qui ne se lève pas à cause du froid, voilà mon service révolutionné pour toute la journée. Soufflez ! allez ! soufflez ! ça ira !
Il sort par la droite.
Scène II
FROMENTEL, seul, continuant à frotter ses allumettes qui ne prennent pas feu, puis URBAIN
FROMENTEL.
Et de dix !...
Frissonnant.
Brrr !... Au mois de mars, de mon temps, nous mangions des petits pois... des petits pois conservés, c’est vrai... mais il faisait si doux qu’on aurait pu croire que c’étaient des primeurs... Tandis qu’aujourd’hui, est-ce qu’ils sont capables de conserver quelque chose !
Rageant contre ses allumettes.
Cristi ! c’est comme leurs allumettes !... Nous avions des briquets phosphoriques... un petit tube rouge ! on ôtait le couvercle !... on le mettait là !... puis le porte-allumettes... on le posait là... puis le bouchon de la petite bouteille. On prenait une allumette et ou farfouillait dans la bouteille... c’était fait tout de suite... Mais depuis leurs allumettes chimiques...
À une allumette qui prend.
En voilà une enfin !... Ah ! vous êtes bien aimable ! si vous voulez maintenant être assez bonne pour ne pas vous éteindre...
Il allume le feu.
URBAIN, ouvrant la porte d’entrée et parlant avec précaution sans entrer.
Papa !...
FROMENTEL.
Ah !... te voilà, pendard !... tu as encore découché.
URBAIN,
échiné, courbé en deux, grelottant et toussant avec extinction de voix.
J’ai passé la nuit au café du Commerce.
FROMENTEL, allumant du feu.
Ça ne m’étonne pas !
URBAIN.
On causait littérature. J’ai discuté sur les Mémoires de quatorze générations de bourreaux.
FROMENTEL.
C’est toi, le bourreau ! Va-t’en, va, je te donne ma malédiction ! Passe-moi une bûche... Tu n’es pas le fils de ton père !
URBAIN, lui donnant une bûche.
Voilà de ces choses désagréables que je ne te dirais jamais, moi.
FROMENTEL, soufflant son feu avec un soufflet qui ne va pas.
Si tu n’étais pas né dans un temps où les mœurs étaient autrement respectées qu’aujourd’hui !... je dirais qu’il y a là-dessous quelque mystère d’infamie !
URBAIN, s’asseyant sur le bord du guéridon.
Voyons !... veux-tu être un peu sérieux ? nous causerons affaires.
FROMENTEL, soufflant toujours le feu qui ne prend pas.
Quelle figure ! ce n’est plus vert-de-gris maintenant !... c’est olive.
URBAIN.
Aussi je veux me marier.
FROMENTEL.
Avec ta cafetière, chenapan ?
URBAIN, passant à droite pour aller s’asseoir sur le divan.
Ah ! oui – jolie – ma cafetière ! Elle m’écrit une lettre ce matin où elle m’appelle Anténor, en me demandant de l’argent. Urbain, Anténor et de l’argent, comme tout ça tonne bien ensemble ! Elle se sera trompée d’adresse en mettant l’enveloppe, et c’est un Anténor qui a reçu ma lettre.
Assis.
Ce nom... Anténor !... Qui est-ce qui peut encore s’appeler Anténor au dix-neuvième siècle ?
FROMENTEL.
Valcreuse !
URBAIN.
Oh ! Anténor Valcreuse !... c’est le vieux !... Ah ! bien, s’il a reçu ma lettre, il doit être content !
FROMENTEL.
Qu’est ce que c’est, polisson ?...
À part, avec satisfaction.
Un Lovelace, tenez !... tout son père en 1825… C’est un Fromentel !...
Haut avec sévérité.
Vous riez, garnement !... Des rivalités avec M. de Valcreuse !...
URBAIN.
Mais non !... mais non, puisque je renonce à la cafetière : c’est ma cousine que je veux épouser.
FROMENTEL, adouci, se retournant.
Marguerite ! Tu veux épouser Marguerite, cher enfant ?
URBAIN, étendu sur le canapé.
Vois-tu, papa, je suis dégoûté de la vie !... La vie n’a plus d’illusions pour moi... J’ai vidé la coupe jusqu’à la lie.
FROMENTEL, amicalement.
La coupe !... c’est la bourse de papa, garnement !
Il s’assied près de lui sur le canapé.
URBAIN, étendu sur le divan.
Nous vivons si vite aujourd’hui ! ça vous mûrit ! – je suis mûr je trouverai l’oubli et le calme dans la régularité de la vie domestique... Ça ne sera pas tous les jours drôle, mais je m’y ferai... et puis elle aura une jolie dot, la petite !... c’est solide, ça. Suis-je assez sérieux, hein ?
FROMENTEL, avec complaisance.
Il a pourtant du bon, ce garnement-là, quand il veut bien !
URBAIN.
Une fois marié, je m’en irai à Paris.
FROMENTEL.
Et puis ?
URBAIN.
Et avec de l’argent, je me ferai des amis ! Je donnerai à dîner, je monterai une réclame et je me ferai mousser en même temps que mon champagne !... C’est joli ça, hein ? comme style.
FROMENTEL, ravi.
Voilà des idées au moins : à la bonne heure ! – Si tu appliquais ça, cher enfant !
URBAIN.
J’appliquerai aussi.
FROMENTEL.
Avec tes qualités, mon bon petit Urbain... si tu voulais fonder une entreprise comme la mienne...
URBAIN.
Un journal ?
FROMENTEL.
Un journal !
URBAIN.
Je fonderai un journal de critique littéraire.
FROMENTEL, se levant.
Tu fondras la dot, gredin ! Va au diable, je te donne ma malédiction !
Il revient au feu, qu’il souffle sans succès.
Non, non, tu n’es pas plus mon fils que ce soufflet n’est un soufflet.
Il jette le soufflet.
URBAIN.
Il a aussi mené la vie, celui-là : il est comme moi.
Scène III
FROMENTEL, URBAIN, VAUCLIN, sortant de chez Marguerite, puis BOURGOGNE
VAUCLIN.
Mais quel bruit, près d’une malade !
À Urbain.
Tiens, tu n’es pas encore mort, toi ?...
URBAIN, se levant.
Voilà une plaisanterie qui m’agace ! Comme si j’avais envie de mourir !
BOURGOGNE, à Urbain.
M. de Valcreuse est en bas, qui demande à parler à monsieur, avec des épées.
URBAIN.
Des épées ! Est-ce qu’il croit me faire peur... Mais je vais le calotter.
Il sort.
FROMENTEL.
Urbain, je te le défends !... Le calotter ! Mais c’est qu’il est enragé... Tout son père en 1830 !... Urbain !...
Il sort, les pincettes à la main.
Décidément, c’est un Fromentel !
Scène IV
VAUCLIN, BOURGOGNE
BOURGOGNE.
Heureusement que mademoiselle est réveillée ! Voici une lettre, monsieur.
VAUCLIN, vivement, la saisissant.
Ah ! de Paris !... la réponse...
BOURGOGNE.
De M. le Marquis ?
VAUCLIN.
Non : du médecin qui a soigné Marguerite à Paris.
Il l’ouvre et lit tout bas.
BOURGOGNE.
Monsieur, dois-je dire à la garde de revenir ce soir ?
VAUCLIN, continuant à lire.
Je crois bien.
BOURGOGNE.
Est-ce que mademoiselle serait plus malade, monsieur ?
VAUCLIN.
Ai-je dit cela ?
BOURGOGNE.
C’est que monsieur parait inquiet... Cette lecture...
VAUCLIN.
Nullement. Va à la diligence pour l’arrivée de trois heures ; j’attends Laroche aujourd’hui.
BOURGOGNE.
Oui, monsieur ; le temps de mettre ma livrée.
VAUCLIN.
Ta livrée ! Tu ne peux pas la jeter aux orties, ta livrée ?...
BOURGOGNE.
Comment monsieur veut-il que je m’habille ?
VAUCLIN.
Comme moi, donc.
BOURGOGNE.
Monsieur vent rire ; je ne puis pas m’habiller comme mon supérieur.
VAUCLIN.
Il n’y a pas de supérieur ; tu еs mon égal, animal.
BOURGOGNE.
Monsieur voit bien que non, puisqu’il m’appelle animal ; et je ne peux pas lui en dire autant.
Il sort par la droite.
VAUCLIN, seul.
Ces brutes-là, on ne devrait leur enseigner les droits de l’homme que le fouet à la main.
Scène V
MARGUERITE, VAUCLIN
Marguerite est entrée depuis quelques instants, et elle est allée à la fenêtre. Elle est pâle et triste.
VAUCLIN, l’apercevant.
Ah ! chère petite, tu t’es levée !...
MARGUERITE.
Oui, parrain ; ne me grondez pas... Je suis si fatiguée de garder la chambre et le lit...
VAUCLIN, lui donnant le bras pour la faire descendre.
Comment te sens-tu ?
MARGUERITE.
Toujours de même.
VAUCLIN, inquiet.
Et la tête... la tête...
MARGUERITE.
Un peu lourde... je suis fatiguée...
VAUCLIN.
Tiens... ce fauteuil... là !... avec ce coussin...
Il la fait asseoir.
MARGUERITE, frissonnant.
J’ai si froid... Je ne puis pas me réchauffer...
VAUCLIN.
Enveloppe-toi bien.
MARGUERITE, assise.
Voilà comme ma grande maladie a commencé.
VAUCLIN, derrière elle.
Mais non... mais non...
MARGUERITE.
Ah ! cette fois... ce ne serait pas long !...
VAUCLIN.
Eh bien, veux-tu te taire ! Est-ce que tu n’es pas mieux ainsi ?
MARGUERITE.
Si... plus près de la fenêtre.
VAUCLIN, à part.
Toujours.
Haut.
Si tu es près de la fenêtre, tu seras loin du feu.
MARGUERITE, fiévreuse, nerveuse, essayant de tourner le fauteuil.
Si, comme cela... de ce côté ! Je verrai un peu...
VAUCLIN.
Mais, chère enfant, il n’y a rien à voir que la neige tombée ce matin.
MARGUERITE.
Je veux voir la neige.
VAUCLIN.
Allons !... tournons le fauteuil comme cela.
MARGUERITE, se soulevant pour regarder par la fenêtre.
Encore.
VAUCLIN.
Non, non la fenêtre est mal close, vois-tu ! il vient un vent de ce côté !... Je t’en supplie, couvre tes épaules ! – Il ne faudrait qu’un refroidissement, une porte ouverte, un courant d’air !...
MARGUERITE, regardant le jardin.
Ah ! que la journée est longue à regarder toujours un chemin où personne ne passe !
VAUCLIN, à part.
Pauvre enfant !
MARGUERITE, fermant les yeux.
Si je pouvais dormir !
VAUCLIN.
C’est cela : dormons.
MARGUERITE.
Non, lisez-moi quelque chose, mon bon parrain.
VAUCLIN.
Lisons. Que veux-tu que je te lise, filleule ?
MARGUERITE, désignant un livre sur la table.
Ce livre-là que m’a prêté M. l’abbé.
VAUCLIN, à lui-même.
Ah ! oui, le directeur de la maison, ma bête noire.
Il prend une chaise et va pour se placer entre elle et la fenêtre.
MARGUERITE.
Non, pas ici, mettez-vous là.
Elle lui montre la droite du guéridon.
VAUCLIN, à lui même, en transportant sa chaise.
Je n’ai jamais été si patient !...
Assis.
La... lisons maintenant.
Il ouvre le livre.
Fénelon...
Saisi.
Fénelon ! De l’existence et des attributs de Dieu.
À lui-même, à part.
Oh !
Haut.
Si nous lisions autre chose, hein ? Cela te serait-il égal ?
MARGUERITE.
Pourquoi ?
VAUCLIN.
Ce n’est pas trop gai, ça, pour une malade.
MARGUERITE, tristement.
Je n’ai pas envie de rire.
VAUCLIN, résigné.
Alors, lisons !... lisons !... Où en es-tu ? à la fin ?
MARGUERITE.
Non ; tout au commencement.
VAUCLIN.
Chapitre 1er. Preuves de l’existence de Dieu !
MARGUERITE, l’interrompant.
Est-ce que c’est vrai, mon parrain, qu’il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu ?...
VAUCLIN, à lui-même.
Parbleu ! s’il y en a !
MARGUERITE.
Plaît-il ?
VAUCLIN, se reprenant.
Je dis : « Mais oui, il paraît qu’il y en a. »
MARGUERITE.
Comment cela est-il possible ?... n’avoir rien de ce qui console... Cela est si bon, quand on est triste, de penser qu’il y a là-haut quelqu’un qui vous écoute... qui vous regarde... La nuit, quand je ne dors pas, parce que la fièvre bat mes tempes, je cause avec Dieu, je lui dis tout bas toutes mes espérances, toutes mes craintes, et il me semble qu’il me répond : « Courage ! » Et je m’endors après cela si heureuse, si calme !... Voilà le vrai médecin.
VAUCLIN.
Bon, bon ! mais...
MARGUERITE.
Et quand on perd quelqu’un qu’on aime ! il faudrait donc croire que tout est fini ?...
VAUCLIN, à demi-voix.
Eh bien !
MARGUERITE, avec la fièvre, s’exaltant peu à peu.
Dieu ! ma pauvre mère ! Penser que l’on ne se retrouvera plus, jamais... nulle part ! Et quand je suis très malade, au lieu de me consoler en me disant... « Eh bien, je vais la revoir, au moins !... »
Vauclin inquiet, se lève.
Se dire : « Non ! j’irai comme elle dans la terre froide, glacée !... »
Se levant et entourant Vauclin de ses bras.
Ô Dieu ! l’horreur ! mon parrain ! ne me laissez pas dire cela ! Cela me fuit peur... restez là... J’ai peur !
VAUCLIN, ému.
Eh bien, eh bien ! quelle enfant !... Mais c’est toi qui me fais peur ! Voyons, voyons ! tu t’exaltes là...
MARGUERITE, retombant assise.
J’ai un peu de fièvre, voyez-vous !
VAUCLIN.
Tu as la tête brûlante ; ne parle pas tant !... Je vais te donner une potion qui te calmera !...
Redescendant à droite, à part.
Ouf ! enfin, c’est fini !...
Il passe à la cheminée et prépare la potion en tournant le dos à Marguerite.
MARGUERITE, doucement, après un petit silence.
Pourquoi donc n’allez-vous jamais à l’église, parrain ?
VAUCLIN, à part.
Encore.
Haut.
Mais parce qu’un homme... un médecin... et puis à mon âge... Voyons !...
Il verse la potion dans une cuillère.
MARGUERITE.
Et si j’étais très... très malade, vous n’iriez pas à l’église prier un peu pour moi ?
VAUCLIN, allant à elle, avec la cuillère pleine.
Mais quelle idée, mon Dieu ! toujours ! mais tu n’es pas très malade.
MARGUERITE.
Mais si je l’étais... si j’étais en danger de mort ?
VAUCLIN.
Eh bien ! veux-la te taire, méchante enfant ! Tiens, boit cela !
MARGUERITE.
Jurez-moi, avant, que vous irez à l’église... si je suis bien malade.
VAUCLIN, présentant la cuillère.
Eh bien, oui, chère enfant... Bois !...
MARGUERITE.
Je ne boirai pas si vous ne jurez pas sur ce que vous avez de plus sacré.
VAUCLIN, même jeu.
Eh bien, je te le jure, la...
MARGUERITE. Elle boit un peu, puis s’arrête.
Et vous prierez Dieu à genoux...
VAUCLIN.
À deux genoux.
MARGUERITE. Elle achève de boire.
Dieu vous saura si bon gré de le faire qu’il me guérira... vous verrez.
VAUCLIN, ému.
Eh bien, oui, mon enfant, oui, il te guérira.
MARGUERITE.
Merci !... Ah ! laissez-moi vous embrasser.
VAUCLIN, l’embrassant.
Voyons, chère petite !...
MARGUERITE, accablée et retombant.
Merci !...
VAUCLIN. Il redescend en essuyant une larme.
Enfin ! Quel assaut !...
La regardant.
Elle s’endort !
Musique en sourdine. Vauclin passe à droite et va serrer la potion dans un petit meuble.
MARGUERITE, s’endormant et rêvant tout haut.
Il reviendra.
VAUCLIN.
Encore lui... Elle va rêvasser... comme toujours, et ne pas dormir.
Il revient à elle.
MARGUERITE.
Il reviendra par là !... Il n’ose pas... on l’a chassé...
VAUCLIN, à demi-voix, à son oreille.
Mais non...
MARGUERITE.
Si... Rosalie me l’a dit !... On l’a chassé parce qu’il a demandé ma main... et il est parti.
VAUCLIN, de même.
Mais il n’est pas parti, chère enfant !... Dors tranquille. Il est à Quimperlé.
MARGUERITE.
Non !
VAUCLIN.
Je l’ai vu hier.
MARGUERITE, tressaillant.
Et il ne vient pas me voir !... On l’a chassé !... Mon oncle... Rosalie me l’a dit !
VAUCLIN, à lui-même, montrant le poing à Rosalie dans le vide. Bas.
Ah ! vieille sorcière !
Haut.
Mais non, au contraire !... Dors, je t’en prie.
MARGUERITE, vivement.
Ce n’est pas vrai, n’est-ce pas ?... Oui, on l’a bien reçu, au contraire...
VAUCLIN.
Mais certainement !
MARGUERITE.
Oui !... Et mon oncle est allé à Paris pour les renseignements.
VAUCLIN.
Mais, justement.
MARGUERITE, de même, avec joie.
Oui !... Et on nous mariera !
VAUCLIN.
Mais oui, chère enfant !... Oui, certainement, on vous mariera !
MARGUERITE, soupirant avec bonheur.
Ah !
Elle s’endort.
VAUCLIN.
Elle va dormir profondément, grâce à la potion !
Il prend son pouls.
La fièvre s’apaise un peu ! Pauvre enfant ! Elle aime : toute la maladie est là.
BOURGOGNE, entrant.
Monsieur !... monsieur !...
La musique continue agitato et crescendo.
VAUCLIN.
Plus bas !
BOURGOGNE, baissant la voix.
Voici M. le Marquis de retour.
VAUCLIN.
Déjà !
BOURGOGNE.
Et tout joyeux !
VAUCLIN.
Mon Dieu ! c’est vrai ! il ne sait rien !... Il faut lui apprendre.
Vivement.
Ouvre la porte, qu’il ne voie pas Marguerite dans cet état ! il la croirait morte.
LE MARQUIS, dehors.
Vauclin !... Marguerite !...
Bourgogne ouvre la porte de la chambre de Marguerite et tire le fauteuil, aidé par Vauclin.
VAUCLIN.
Vite donc... et ça, et ça !
Il fait disparaître la potion et la petite cuillère dans le petit meuble de droite, s’assure que la porte de Marguerite est fermée, et dit tout haut, en affectant la gaieté.
Comment ! c’est lui ! c’est lui ! Où donc ? où donc ?...
Scène VI
LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL, ROSALIE
LE MARQUIS, entrant vivement, vêtu en Parisien qui voyage, avec une escarcelle et une couverture, triomphant et de bonne humeur, des journaux et des brochures à la main. La musique cesse.
Eh ! ici, mon bon Vauclin ! Bonjour, mon vieil ami !... bonjour, Fromentel, bonjour ! – Allons, Bourgogne, les bagages, vite, vite !
ROSALIE, avec sentiment.
Ah ! monsieur le Marquis !
Elle tourne autour de lui pour l’embrasser ; le Marquis lui remet ses journaux, qu’elle porte au fond.
FROMENTEL, regardant la couverture.
Quel luxe !
LE MARQUIS, à Vauclin.
Et mon père ? et Marguerite ?
VAUCLIN.
Pas si fort, ils dorment.
Avec intention.
Et même Marguerite...
LE MARQUIS, sans l’écouter.
Ils dorment encore !... Ah ! les paresseux !...
À Bourgogne et au valet.
Allons, dépêchons, voyons ! Les trois caisses sous le hangar !... les colis couverts de toile dans le vestibule, les malles chez moi ! et dégourdissons-nous, mes amis ! Allons, allons donc !
ROSALIE, même jeu, le rattrapant à gauche et essayant de l’embrasser.
Ah ! monsieur le Marquis !
VAUCLIN, passant devant elle.
Et tu vas ?...
Rosalie, dépitée, remonte pour retrouver le Marquis d’un autre côté.
LE MARQUIS, gaiement.
Vingt ans, mon ami, vingt ans ! Je me porte ! je suis léger.
Jetant l’escarcelle à Bourgogne.
Eh bien ! et çà, et ça donc ?
Il jette la couverture à Bourgogne, et c’est Rosalie qui la reçoit au moment où elle tend les bras.
ROSALIE.
Ah ! monsieur le Marquis !... J’avais rêvé son retour.
LE MARQUIS, au moment où elle va l’embrasser, à Bourgogne, en se retournant.
Ah ! et la vache ?
ROSALIE, stupéfaite.
La vache !
LE MARQUIS, à Bourgogne.
N’oubliez pas la vache de la voiture, où j’ai laissé des bourriches !
Les domestiques disparaissent.
Ah !
Rosalie l’embrasse définitivement.
C’est ça, là, ouf !... enfin je respire !
Il s’assied sur le canapé.
VAUCLIN.
Voici du feu !
LE MARQUIS, assis.
Bon, bon, je n’ai pas froid ! Vous avez froid, vous autres ? – Est-ce contrariant ! Mon père, cette petite qui dorment, à onze heures !
Regardant la pendule et sa montre.
Tiens ! vous retardez !
FROMENTEL.
Mais non !
LE MARQUIS.
Si... si... il est onze heures et demie à la Bourse.
VAUCLIN, surpris.
La Bourse !
FROMENTEL, de même.
La Bourse de Quimperlé ?
LE MARQUIS.
Eh bien, quoi ?... Qu’est-ce que vous avez ?... Vous avez l’air gelés tous les trois.
VAUCLIN.
Mais non, c’est toi qui est tout...
FROMENTEL.
Oui, tout...
ROSALIE.
Vous allez ! vous allez ! vous allez !...
LE MARQUIS, se levant gaiement.
Vingt ans ! mon ami ! vingt ans ! C’est Paris !
Se levant.
Eh ! à propos ! victoire !
FROMENTEL et VAUCLIN.
Pas de chemin de fer à Quimperlé !
LE MARQUIS.
Il n’y a plus de chemin de fer !
VAUCLIN.
Tu as ?...
LE MARQUIS, avec une extrême volubilité, à la Parisienne, en mangeant la moitié des mots.
Ah ! Dieu ! j’ai couru à pied, en voiture ; je me suis fait présenter, recommander, appuyer ! Une porte ouverte, une autre enfoncée !... Deux membres d’administration, par hasard d’anciens amis ! J’ai causé, discuté !... Un gros propriétaire, vous comprenez !... une autorité !... Avec un peu d’éloquence !... Quimperlé, mauvais tracé : Guingamp, Dinan... Ah ! bon, des débouchés !... de l’avenir !... Mais Quimperlé, terrains vagues !... des remblais... un argent fou !... et je les ai convaincus, mon ami, convaincus ; entendez-vous ? convaincus !...
VAUCLIN, ahuri, regardant Fromentel.
Oui, j’entends bien, convaincus.
À Fromentel.
Et vous ?
FROMENTEL, de même.
Moi, j’ai entendu :
Imitant le Marquis.
Brrr !... convaincus ! »
ROSALIE.
Mais le reste !...
VAUCLIN.
Pas un mot !
LE MARQUIS.
Comment, pas un mot ?
VAUCLIN.
Dame, tu parles, tu parles, on n’y est plus.
FROMENTEL.
Oui, ça tourne dans la tête...
ROSALIE.
Moi, ça me grise.
LE MARQUIS.
Mais qu’est-ce qu’ils ont ? Mais vous êtes gelés ! Mais ils sont gelés ! – Et, du reste, tout le monde va bien ici ?
VAUCLIN.
Oui... sauf Marguerite... un peu...
LE MARQUIS.
Bon, bon ! Ce n’est rien ! je sais ce que c’est !
VAUCLIN.
Ah !
LE MARQUIS.
Parbleu !
VAUCLIN.
Ah ! tu as trouvé ?
LE MARQUIS, renforçant.
Oui, oui, à l’instant même, en quittant la diligence, où on est bien mal, par parenthèse ! Oh ! qu’on y est donc mal !...
FROMENTEL.
La Quimperloise ?
LE MARQUIS.
Oh ! la Quimperloise est atroce ! Nous étions huit là-dedans ! avec un enfant en nourrice !... Pas de coupé ! Et mon voisin qui dormait sur mon épaule. – Les chevaux n’étaient plus ferrés à glace ; nous avons failli dégringoler... et un froid... Moi qui quittais le chemin de fer, où j’avais sous les pieds une bonne bouteille ! où j’étais bien accoudé, bien adossé, bien assis...
Stupeur des trois, qui se regardent.
ROSALIE, confondue.
L’éloge du chemin de fer !...
LE MARQUIS.
Mais non ! non ! je ne fais pas l’éloge du chemin de fer... Seulement, je proteste contre la Quimperloise. – Bref, en traversant Quimperlé, qui est très pittoresque, mais fort ennuyeux... et triste et sale !... Oh ! que c’est donc sale !
ROSALIE, piquée.
Dame ! l’hiver...
LE MARQUIS.
Oh ! ma foi, l’été aussi !... Et puis personne !... rien ! pas un cri, pas une âme !... C’est mort ! Ah ! quand on revient de Paris !...
Ici Vauclin remonte et va écouter à la porte de Marguerite, et un peu plus tard il entre dans sa chambre.
ROSALIE.
Regretter Paris !... Regretter Babylone !
LE MARQUIS.
Oui, oui ! c’est Babylone ! l’impure Babylone, avec tous ses vices ; mais c’est Babylone où l’on marche, où l’on pense, où l’on vit deux fois, de sa propre vie et de celle des autres.
Avec chaleur.
Ah ! ville maudite ! de quelle ivresse n’ai-je pas foulé de nouveau tes trottoirs, franchi tes ruisseaux chaque jour plus larges et ta boue chaque jour plus épaisse ! Ô ville monstrueuse ! Toutes les bassesses et toutes les grandeurs ! Tous les crimes et toutes les vertus ! Tu te noies dans l’orgie, égout des nations ; mais tu veilles pour la terre endormie, capitale du monde ! On te fuit avec horreur, infâme ! On te revient avec ivresse, ô reine ! On voudrait t’écraser et l’on t’adore !
ROSALIE, exaspérée.
Adorer l’enfer !
LE MARQUIS.
Eh bien, regardez-moi ! j’en sors, moi, de l’enfer ! la flamme et le feu m’ont retrempé !... et je suis un autre homme ! Car j’ai Paris dans les jambes, Paris dans les yeux, Paris dans les veines.
ROSALIE, effrayée, suffoquée et le regardant avec terreur.
Miséricorde !
LE MARQUIS.
Et elle !... cette pauvre petite Marguerite, arrivant comme moi de son Paris bruyant, turbulent, resplendissant ; vous ne voulez pas qu’elle meure ici d’ennui. Mais cette maison !
Mouvement de tous.
que je suis fier d’avoir sauvée, mais triste, sombre, est-ce la cage de cet oiseau venu du pays où l’on rit, où l’on chante, où l’on danse ? Une femme !... une femme jeune, belle, gracieuse, fouler ce tapis aux fleurs fanées ; s’asseoir sur ces fauteuils aux bois vermoulus ; mesurer le temps à cette pendule
La pendule sonne en ronflant.
qui ronfle avant de sonner, comme si les heures endormies avaient peine à s’y réveiller ! Allons donc ! Pauvre enfant !... Au grenier, les ruines ! Au grenier, la vieillesse ! Et que tout ici rajeunisse avec moi...
FROMENTEL.
Et nous !... Nous mettrez-vous aussi au grenier ?
LE MARQUIS, gaiement.
Vous !
Les prenant par la main et les amenant sur l’avant-scène. Confidentiellement et à demi-voix.
Eh bien, oui, si vous ne savez pas faire comme moi, et vous rajeunir pour lui plaire !... Savez-vous le mot, le mot terrible dont m’a salue à Paris une femme d’esprit... à qui je racontais notre vie ? – « Eh ! mon pauvre Marquis, vous voilà donc tout à fait tombé dans les Ganaches ? »
TOUS TROIS, tressaillant.
Ganaches !
LE MARQUIS, continuant.
Ganaches ! entendez vous ?... Ganaches ! comprenez-vous ?... Nous sommes des Ganaches ! c’est-à-dire des routiniers, des radoteurs, des rabâcheurs ! Eh bien ! de par la cordieu ! je me sens encore de force et de verre à faire mentir l’épithète ! J’ai le cœur jeune, l’esprit vivace ! Je ne veux pas tomber dans les Ganaches ! et je vous forcerai bien à secouer avec moi votre poussière, et nous donnerons des fêtes, des dîners, des concerts, des bals ! Et l’on ne dira plus de ma maison que c’est un nid de Ganaches !
FROMENTEL.
Des bals !
ROSALIE, indignée.
Des bals décolletés ! Vous voulez que...
Croisant ses mains avec pudeur sur sa poitrine.
Oh...
FROMENTEL.
Et que je danse !
LE MARQUIS, gaiement.
Je danserai bien, moi.
ROSALIE, éclatant.
Avec elle ! et je vous conseille de l’épouser aussi !
LE MARQUIS.
Pourquoi pas ?
ROSALIE.
Dieu ciel ! juste Dieu ! Et c’est elle qui héritera !
LE MARQUIS, saisi.
Comment ! qui héritera !
ROSALIE.
Horreur ! ne me touchez pas, Monsieur la Marquis ! Vade retro !... vos mains sentent le soufre ! Vous avez voulu voir Paris ! vous êtes descendu dans la géhenne ; et la géhenne vous a rejeté noir, calciné, horrible à voir ?
LE MARQUIS, gaiement.
Il me semble pourtant...
ROSALIE.
Laissez-moi parler ! je veux parler ! je parlerai... comme l’ânesse de Balaam ! – Malédiction sur la maison qui s’ouvre au luxe de Paris ! aux modes, aux toilettes, aux danses impures de Paris !
LE MARQUIS.
Ah çà, mais...
ROSALIE.
Le maître se ruinera ! le valet volera ! la servante pillera ! la nièce se perdra ! la Société maternelle la recueillera ! le feu prendra ! la maison croulera !... Et Rosalie se lamentera sur le terrible sort d’un gentilhomme, plein de bons principes, qui nous revient de la grande sentine hérésiarque, renégat, apostat, parpaillot et libéral... pour finir un jour jacobin !...
Montrant Vauclin qui rentre.
comme ce monstre !...
LE MARQUIS.
Ah ! mais, mademoiselle de Forbac !
ROSALIE.
Malédiction sur vous tous !... Malédiction !
Elle sort.
FROMENTEL, ramassant les lunettes qu’elle a laissé tomber.
Eh ! les lunettes !... les lunettes !...
Il court dernière elle.
Scène VII
LE MARQUIS, VAUCLIN
LE MARQUIS.
Ah ! voilà une méchante folle ! et je ne sais qui me tient !... Bah ! allons voir l’enfant !
Il fait un mouvement pour entrer chez Marguerite.
VAUCLIN, très préoccupé et lui barrant le passage.
N’entre pas !...
LE MARQUIS.
Pourquoi ?
VAUCLIN.
Parce que Marguerite est là ! et elle dort !
LE MARQUIS, surpris.
Toujours !... Qu’as-tu donc ? Ce visage...
Vivement.
Marguerite est malade ?
VAUCLIN.
Oui !
LE MARQUIS.
Et tu ne me le dis pas ?
Il va pour entrer.
VAUCLIN, l’arrêtant.
Veux-tu la réveiller ? elle n’a pas fermé l’œil de la nuit !... D’ailleurs, tu peux la voir d’ici comme moi...
Il pousse la porte.
endormie dans son fauteuil.
LE MARQUIS, regardant par la porte entrebâillée.
Ma pauvre Marguerite ! comme elle est pâle !
Baissant la voix et le faisant redescendre.
Et tu ne m’as pas écrit ? Et... rien... rien, pas un mot ?
VAUCLIN.
À quoi bon ? Le soir de ton départ, émue de tout ce qui venait de se passer, elle était assez souffrante pour prendre le lit ; et, malgré tous mes soins, depuis hier, la fièvre augmente, elle rêve tout haut, elle pleure... Qu’elle se réveille avec des douleurs de tête, et le délire... et alors !...
LE MARQUIS.
Est-ce possible... Vauclin ? Mais ce retour du mal, si inattendu, si brusque... Mais la cause, la cause ?...
VAUCLIN.
Eh ! la cause ! Ta sottise et la mienne ! Nous avons là une frêle créature que le moindre choc peut briser comme verre... Une contrariété, une colère, le chaud, le froid, que sais-je ? – Rien que cette fenêtre ouverte qui viendra glacer son front !... Et nous nous sommes ingénieusement appliqués à quoi ?... À la mettre en présence de cet homme qui passait sans la voir !
LE MARQUIS.
Mais, qu’importe !... puisque nous nous sommes trompés !... puisqu’il ne l’aime pas.
VAUCLIN, lui prenant la main avec une violence contenue.
Eh ! lui... oui !... Mais elle !
LE MARQUIS.
Eh bien !
VAUCLIN.
Eh ! comment toutes ses pensées ne seraient-elles pas à ce jeune homme, maintenant que nous avons pris soin de l’éclairer, nous-mêmes, sur ce quelle éprouvait pour lui ?... Comment n’aurait-elle pas demandé vingt fois par jour à son cœur : « Mais que cherches-tu ?... que regrettes-tu ? » jusqu’au moment où ce cœur lui a répondu : « Eh ! c’est Lui que je cherche !... parce que je l’aime !... »
LE MARQUIS, douloureusement.
Elle l’aime !...
VAUCLIN.
Et tu demandes la cause de son mal ? – Mais le voilà, son mal ! c’est l’amour ! l’amour contrarié... l’amour qui n’ose pas se plaindre par fierté, qui ne sait pas se vaincre par faiblesse !... Là, tout à l’heure !... elle m’écoutait... À qui pensait-elle ?... à Lui ! Qui cherchait-elle du regard ?... Lui. Car il n’y avait plus que Lui au monde !... Tu lui retires son soleil et son Dieu !... elle languit !... Achève ! dis lui ! « Non ! tu ne le verras plus !... Oui, je l’ai chassé ! Non ! je ne veux pas de lui, et d’ailleurs il ne t’aime pas... » une heure après elle a le délire, et le soir... elle est morte !
LE MARQUIS.
Morte !...
VAUCLIN, lui montrant la lettre de Paris.
Tiens !... C’est du médecin qui l’a soignée... Lis !... C’est implacable et net comme un arrêt de mort ! – S’il y a rechute, elle est perdue !
LE MARQUIS, effrayé.
Mais il n’y aura pas de rechute, Vauclin !... Mais nous ne laisserons pas cette horrible fièvre se déclarer !... Nous sommes là, toi, le médecin... toi, la science, et tu sais le remède.
VAUCLIN.
De remède !... Eh ! quel remède ?... Donne-moi un corps à sauver, je lutterai ; mais une âme à l’agonie, où veux-tu que je la prenne ? Ce n’est pas à des organes souffrants que j’ai affaire ; c’est à une pensée malade qui se dévore elle-même. Donne-lui de l’espoir !... verse-lui du courage ! bon !... mais ne me demande pas de guérir avec des potions la folie d’une jeune fille qui meurt de tristesse et d’amour !...
Il se lève.
LE MARQUIS.
Mais on ne meurt pas d’amour, Vauclin, tu me l’as dit cent fois !
VAUCLIN.
Non ! mais on meurt de la fièvre, et l’amour la donne !
LE MARQUIS.
Mais faisons quelque chose, au moins... Essayons !... luttons ! Nous sommes là à débattre, et le péril augmente !...
BOURGOGNE, entrant.
Monsieur le Marquis... ce jeune homme... M. Marcel Cavalier demande si monsieur le Marquis est visible ?
LE MARQUIS.
Lui !
VAUCLIN, à lui-même.
Ici !
BOURGOGNE.
Et il rappelle à monsieur le Marquis qu’il devait le venir saluer dès son retour !
LE MARQUIS.
Lui !... ce misérable qui l’a tuée ! – Qu’il sorte !... qu’il sorte de chez moi !
VAUCLIN, vivement, l’arrêtant.
Au contraire !... qu’il reste et qu’il attende.
Bourgogne reste au fond et attend.
LE MARQUIS.
Es-tu fou ?
VAUCLIN, le ramenant sur le devant de la scène, avec chaleur.
Es-tu fou toi-même ? Mais la voilà peut-être, la guérison que tu demandes ! Le voilà, le salut ! au moins pour aujourd’hui !...
LE MARQUIS.
Tu veux ?...
VAUCLIN.
Je veux !... je veux que Marguerite le voie, ne fût-ce qu’un instant, une seconde, mais qu’elle le voie.
LE MARQUIS.
Mais pense donc...
VAUCLIN, sans l’écouter.
Je ne pense qu’une chose, c’est qu’elle le verra ici... près de toi !... et que sa présence est un démenti aux paroles de Rosalie.
LE MARQUIS.
Mais je ne veux pas lui laisser croire...
VAUCLIN.
Eh ! qu’elle croie ce qu’elle voudra, pourvu que je la sauve !
LE MARQUIS.
Pour être forcés de lui avouer demain...
VAUCLIN.
Ah ! demain ! alors comme alors ! Sauvons aujourd’hui !... nous veillerons plus tard à demain !
LE MARQUIS.
Et je ne veux pas, moi.
VAUCLIN, se retournant. Avec force.
Et je veux, moi ! le maître !... Jour de Dieu ! celui qui commande au lit du malade, c’est le médecin. – Je suis responsable de sa vie ! c’est bien le moins que j’aie la liberté de mes moyens !
LE MARQUIS, résigné.
Soit !
On entend sonner ; musique en sourdine.
VAUCLIN.
Chut ! Elle nous a entendus... Elle appelle !... Va, et si elle peut marcher... eh bien, amène-la !
Le Marquis entre chez Marguerite. À Bourgogne.
Toi, fais monter ce jeune homme dans quelques minutes...
BOURGOGNE.
Mais j’aimerais» mieux que monsieur le Marquis m’ordonnât lui-même...
VAUCLIN.
Mais le Marquis, c’est moi, esclave.
Il le fait reculer jusqu’à la porte.
Marche donc ! marche donc !
Il le met dehors. Se retournant.
Il faut toujours en venir à la Terreur !
Scène VIII
VAUCLIN, LE MARQUIS, MARGUERITE
LE MARQUIS, soutenant Marguerite.
Appuie-toi sur moi, chère enfant.
MARGUERITE.
Ah ! que je suis contente de vous voir !
LE MARQUIS.
Chère petite... Tu te sens mieux... n’est-ce pas ?
MARGUERITE, faiblement.
Toujours la fièvre !
Elle traverse pour aller au canapé.
VAUCLIN, bas au Marquis.
Les yeux !
LE MARQUIS, sans comprendre.
Les yeux ! oui, je vois...
VAUCLIN, de même.
Non !... la fenêtre !
LE MARQUIS, avec amertume.
Oh ! oui ! l’autre.
Haut.
Veux-tu t’asseoir ?
MARGUERITE, tombant assise sur le divan. La musique cesse.
Oui ! – Comme vous êtes resté longtemps absent !
LE MARQUIS.
Oui, quelques démarches au sujet d’une affaire dont on est venu me parler.
VAUCLIN, à Marguerite, avec intention.
Oui... M. Cavalier... Tu sais... ton ami...
MARGUERITE, tressaillant et anxieuse.
Ah !... c’est pour lui ?...
VAUCLIN, avec intention.
Oui... oui !
MARGUERITE, anxieuse.
Il était avec vous à Paris ?
LE MARQUIS, vivement.
Non pas !...
VAUCLIN, l’arrêtant du regard.
Mais ils doivent se revoir...
MARGUERITE, avec joie.
Ah !...
LE MARQUIS, s’asseyant près d’elle.
Oui !... oui !... nous devons nous revoir !
MARGUERITE.
Alors !... – Mais alors... vous n’êtes donc pas ?
VAUCLIN.
Quoi donc ?
MARGUERITE, avec effort.
Vous n’êtes donc pas... fâché... contre lui ?
VAUCLIN, regardant le Marquis.
Contre lui... ton oncle ?
LE MARQUIS.
Moi ?... pourquoi ?...
MARGUERITE, se redressant.
Et ce que disait Rosalie n’est donc pas vrai... nous n’avez pas ?...
VAUCLIN, avec une fausse ingénuité.
Quoi ?
MARGUERITE, avec effort.
Vous n’avez pas... repoussé sa demande ?...
Mouvement de Vauclin.
LE MARQUIS, embarrassé.
Sa demande ?
MARGUERITE, le regardant avec angoisse.
Quoi ?...
VAUCLIN, passant derrière le Marquis, bas.
Mais réponds !... Non !
LE MARQUIS, haut.
Mais non, certainement... non !... je n’ai pas repoussé... au contraire...
MARGUERITE, avec joie.
Ah ! vous consentez !... je ne l’ai donc pas rêvé !... Quel bonheur !...
Elle est prise d’un tremblement nerveux.
LE MARQUIS, se levant.
Marguerite !...
MARGUERITE, tremblant toujours.
Oh ! ce n’est rien !... ce n’est rien !... Cela va se passer... Mais la surprise... tout à coup !... Je suis si faible !... Oh ! vous aviez peur de le dire tout de suite... je l’ai compris !... Mais vous aviez bien tort !... la joie !... Oh !... ce n’est rien !... ce n’est rien !...
Elle fond en larmes.
LE MARQUIS, bas à Vauclin.
Où m’as-tu conduit, malheureux ? – La voilà maintenant persuadée que je consens à ce mariage !...
VAUCLIN, très saisi.
Elle est allée plus loin que nous... j’aurais dû le prévoir !...
LE MARQUIS, à demi-voix.
Et la détromper maintenant, impossible...
MARGUERITE, relevant la tête et les regardant, inquiète.
Ah ! je me suis trompée... ce n’est pas ?...
LE MARQUIS et VAUCLIN, vivement.
Mais si ! si ! si !... chère enfant !...
VAUCLIN.
Pardieu ! Un charmant garçon !
LE MARQUIS.
Une belle position !...
VAUCLIN.
Et qui t’aime !...
LE MARQUIS.
Et que tu aimes !...
MARGUERITE, doucement.
Oh ! oui !...
VAUCLIN.
Un excellent mari !... excellent...
LE MARQUIS.
Excellent !
À part.
Nous sommes débordés maintenant !
VAUCLIN, bas au Marquis.
Je l’entends !... le voilà !... Préviens-la !...
MARGUERITE.
Qu’est-ce que vous dites ?
VAUCLIN.
Rien !... Je demande au Marquis s’il ne l’attend pas bientôt.
MARGUERITE, vivement.
Il va venir ?...
LE MARQUIS.
Oui.
VAUCLIN, bas au Marquis, séparé de lui par Marguerite et guettant l’arrivée de Marcel.
Doucement !... doucement !
LE MARQUIS.
Mais oui, demain peut-être !...
MARGUERITE, chagrine.
Demain ?...
VAUCLIN, bas au Marquis.
Il monte !...
LE MARQUIS, haut.
Ou même aujourd’hui...
MARGUERITE, avec joie.
Aujourd’hui !...
LE MARQUIS, regardant Vauclin.
Il devait venir me saluer à mon retour...
MARGUERITE.
Eh bien, alors ?...
VAUCLIN, écoutant et faisant signe au Marquis.
Va !
LE MARQUIS, prêtant l’oreille.
Et je crois... Il me semble !...
MARGUERITE, avec joie, écoutant aussi.
Oui... c’est lui ! le voilà !
Elle retombe sur le canapé. Avec douceur.
Ah ! le voilà !
La porte s’ouvre. On aperçoit Marcel.
LE MARQUIS, la regardant avec tristesse.
Comme elle l’aime !
Scène IX
VAUCLIN, LE MARQUIS, MARGUERITE, MARCEL
MARCEL, entrant tout droit, sans voir Marguerite.
Pardonnez-moi, monsieur le Marquis ; mais n’était-il pas convenu...
VAUCLIN, du geste, au Marquis.
Va donc !...
LE MARQUIS, avec une feinte gaieté.
Ah ! vous voilà, monsieur !... arrivez donc ! Nous parlions de vous justement !
MARCEL, surpris.
De moi ?...
LE MARQUIS, lui serrant la main, et à demi-voix, rapidement.
Dites comme nous, je vous en prie !
Mouvement de Marcel.
Je vous expliquerai tout !... Votre main seulement, votre main !
Haut.
Ravi de vous voir !... ravi !... Nous avons une pauvre malade ici... vous ne saviez pas cela ?
MARCEL, se retournant vers Marguerite.
Mais non !... En vérité !... comment, mademoiselle... vous étiez souffrante ?...
MARGUERITE.
Un peu, oui !... mais je vais mieux !
MARCEL.
Mon Dieu !... mais si j’avais su !
LE MARQUIS, lui soufflant.
Vous seriez venu...
MARCEL, surpris.
Je... sans doute... oui... je serais venu !...
LE MARQUIS.
Mais M. Cavalier était à Nantes !...
MARCEL, après l’avoir regardé.
Oh ! oui ! oui ! j’étais à Nantes ! en effet !... Une petite absence...
MARGUERITE.
C’est donc pour cela que je ne vous ai pas vu ?
LE MARQUIS.
Je crois bien : il arrive à peine... Vous arrivez, n’est-ce pas ?
MARCEL.
Je... mais oui, j’arrive à l’instant !...
MARGUERITE.
Comment, à l’instant ? Et mon parrain vous a vu hier ?...
VAUCLIN, accoudé sur le canapé, à part.
Elle se souvient !...
Haut.
Moi ?... j’ai vu ?...
MARGUERITE.
Oh ! je me le rappelle bien ; vous me l’avez dit tantôt, quand je m’endormais !... Et puisque je n’ai pas rêvé le reste !...
VAUCLIN.
Mais je t’assure !...
MARGUERITE, à Marcel.
Non, non, vous êtes ici depuis hier, monsieur ; et vous n’êtes pas venu tout de suite !... vous qui étiez si exact, à Paris, quand j’étais souffrante !
LE MARQUIS, bas à Vauclin, et lui serrant la main.
Il était exact à Paris ?
VAUCLIN, bas.
Apparemment !
MARGUERITE, continuant.
Et qui veniez tous les jours savoir de mes nouvelles !...
LE MARQUIS, à Vauclin.
Tous les jours !... Vauclin ! nous sommes perdus !
MARGUERITE, à Marcel.
Il y a là quelque chose qui n’est pas clair et que je veux savoir !
MARCEL, embarrassé.
Mais, mon Dieu, c’est bien simple, et je vous dirai avec ces messieurs...
À Vauclin.
Mais je ne sais que dire ! – Aidez-moi. Expliquez-moi, au moins...
MARGUERITE, inquiète et soupçonneuse.
Voyez-vous ! vous vous consultez tout bas...
MARCEL, vivement, descendant.
Oh ! non !
Vauclin, démasqué, reste la main en l’air et la bouche ouverte, et remonte vivement pour cacher son embarras.
LE MARQUIS, de même.
Oh ! du tout !
MARGUERITE, soupçonneuse.
On me cache quelque chose... Je veux interroger M. Marcel, moi ! Il va me conter cela tandis que vous irez dîner, et que nous serons seuls !...
Vauclin et le Marquis se regardent effarés.
LE MARQUIS, à demi-voix, à Vauclin.
Seuls ! Comment, seuls ?
MARGUERITE.
Ah ! maintenant j’ai bien le droit de causer avec lui, n’est-ce pas ?...
LE MARQUIS.
Sans doute, mais...
MARGUERITE, tristement.
Oui, vous avez peur ! J’ai donc raison ; il y a donc quelque chose que l’on veut me cacher ?...
LE MARQUIS.
Mais non, ne va pas croire...
MARGUERITE, suppliante.
Eh bien, alors, laissez nous, mon bon oncle !...
VAUCLIN, bas, passant derrière le Marquis.
Mais laisse-les donc !... puisqu’il le faut !
Haut.
Allons, viens dîner : je meurs de faim et toi aussi, et laissons causer ces jeunes gens.
Il lui prend le bras.
LE MARQUIS, hésitant.
Mais...
VAUCLIN, de même.
Que crains tu ? il ne l’aime pas !...
LE MARQUIS.
Cependant...
VAUCLIN, bas au Marquis.
Veux-tu la tuer ?
LE MARQUIS, décidé.
Oh !...
VAUCLIN, faisant encore des signes à Marcel.
Allons ! viens, viens !
LE MARQUIS, sur un dernier regard de Marguerite.
Nous sommes débordés, Vauclin !... Nous sommes tout à fait débordés !
Ils sortent.
Scène X
MARCEL, MARGUERITE
MARGUERITE.
Maintenant que nous voilà seuls monsieur, vous allez m’expliquer ce petit mensonge, car enfin, c’est un mensonge !...
MARCEL.
Mon Dieu ! pardonnez-moi, Marguerite, mais...
Il prend une chaise et vient s’asseoir près d’elle.
MARGUERITE, l’interrompant.
Non ! non ! je ne pardonne pas si vite ! Vous n’étiez pas avant-hier à Nantes ; vous étiez ici, et vous n’êtes pas venu une seule fois, et pourtant j’étais bien malade ; et ainsi, j’aurais pu mourir...
MARCEL.
Voulez-vous bien ne pas prononcer ce vilain mot ! Est-ce que l’on meurt à votre âge ? Vous savez bien que non, puisque nous vous avons déjà sauvée...
MARGUERITE.
À la bonne heure ! je vous retrouve. Mais tout cela ne me dit pas pourquoi vous n’êtes pas venu depuis cinq grands jours !... Votre absence m’a laissée dans une inquiétude mortelle ; car je devais croire que tout allait bien mal... Ils m’avaient fait sortir si brusquement, vous le rappelez-vous ?...
MARCEL.
Oh ! je me le rappelle très bien !...
MARGUERITE.
Puisqu’il n’y avait que de bonnes nouvelles à m’apprendre, vous êtes donc bien coupable, avouez-le, de ne m’avoir pas rassurée tout de suite !...
MARCEL.
Mais, à vrai dire, c’est un peu la faute de M. le Marquis, car, enfin... il ne m’avait pas précisément autorisé à venir pendant son absence...
MARGUERITE.
Mais cela allait tout seul, monsieur, du moment qu’il approuvait tout !
MARCEL, surpris.
Il approuvait tout ?...
MARGUERITE.
Sans doute, puisqu’il nous permettait...
MARCEL.
Quoi donc, chère enfant ?
MARGUERITE.
Mais vous le savez bien ! Pourquoi me le faire dire ?...
MARCEL.
Parce que vous le direz mieux que moi !... Il nous permettait donc de...
MARGUERITE, avec embarras.
Mais de nous...
Effleurant le mot.
Aimer !...
Vivement.
La ! êtes-vous bien content de me l’avoir fait dire avant vous ?...
MARCEL, saisi, à lui-même, à part.
Elle m’aime !...
MARGUERITE.
Il me semble qu’un mari peut bien venir voir sa femme !
MARCEL.
Un mari !... Ils vous ont dit...
MARGUERITE, gaiement.
Mais tout, monsieur ! tout... Vous voyez bien que je sais tout maintenant !... Ah ! faites encore du mystère, parce qu’on devait me le cacher !...
MARCEL, voulant protester.
Mais non !... mais...
MARGUERITE.
Si !... parce que je suis malade, et en me voyant souffrante, on avait peur que l’émotion ce me fit mal...
MARCEL, à part.
Ah ! c’est vrai !... Ah ! je comprends !...
MARGUERITE.
Mais au contraire, mon ami, c’est depuis ce moment-là seulement que je renais ! Et tenez, regardez-moi ; n’est-ce pas que je n’ai plus le même visage et que tout en moi respire le bonheur et la vie ?... Ma vie, à laquelle je ne tenais guère et que je ne veux plus perdre aujourd’hui, parce que je sens qu’elle n’est pas à moi toute seule, mais à nous deux, et à vous, mon ami, encore plus qu’à moi !...
MARCEL.
Marguerite ! mon enfant !...
MARGUERITE.
Oh ! ne prenez pas garde !... Je m’attendais si peu, je croyais tout perdu ! et se voir tout à coup si heureuse... Ah ! je suis si heureuse !
MARCEL, à lui-même, tout ému.
Pauvre enfant ! Ils ont été forcés de la tromper !....mais je ne dois pas lui laisser croire !... Marguerite, écoutez-moi...
MARGUERITE.
Ah ! laissez-moi pleurer ! ce sont de bonnes larmes, celles-là ! pas comme celles que je versais hier.
MARCEL.
Vous pleuriez hier ?
MARGUERITE.
Vous le demandez ? Ah ! c’est que vous ne pleurez pas, vous !... Les hommes sont forts ! mais moi, je ne suis pas forte !
MARCEL.
Hélas ! oui... pauvre enfant !
À lui-même.
Je ne sais comment m’y prendre...
Haut.
Et pourtant, Marguerite, tout cela pouvait tourner autrement... car enfin si je ne vous avais pas aimée ?
MARGUERITE, avec assurance.
Vous !... Oh ! c’était impossible.
MARCEL.
C’est vrai ! Mais enfin, toute charmante que vous êtes, je pouvais avoir pour vous l’affection d’un excellent ami...
MARGUERITE.
Oui.
MARCEL.
Et d’un frère !
MARGUERITE.
Oui !
MARCEL.
Et rien de plus !
MARGUERITE.
Oh ! que non ! ce n’était pas assez !
MARCEL.
C’est vrai ! Mais si... Je suppose, n’est-ce pas ?... si j’avais aimé une autre femme ?
MARGUERITE, avec confiance.
Non ! non ! non ! vous deviez m’aimer, je devais vous aimer, et rien ne pouvait l’empêcher : c’est écrit dans le ciel ces choses-là.
MARCEL.
Dans le ciel !
MARGUERITE, tristement.
Mais !... ce qui pouvait arriver, c’est qu’on nous défendit cet amour, et que l’on refusât de nous marier ensemble...
MARCEL.
Précisément !... Eh bien ?
MARGUERITE.
Eh bien ! j’ai à peine la force de supporter mon bonheur, mon ami, je vous laisse à penser si j’aurais eu celle de supporter mon chagrin.
MARCEL, ému, lui serrant la main.
Eh bien, oui ! c’est vrai ! vous avez raison... oui... tout va bien ! Et vous êtes heureuse ?
MARGUERITE.
Et vous ?
MARCEL.
Et moi aussi, très heureux !...
MARGUERITE, lui faisant une place sur le canapé.
Venez ici ! – là, tout près... et dites-moi une chose...
MARCEL, s’asseyant sur le canapé.
Laquelle ?
MARGUERITE.
Dites-mol franchement... mais bien franchement !
MARCEL.
Oui !
MARGUERITE.
Depuis quand vous m’aimez ?
MARCEL.
Depuis quand ?
MARGUERITE.
Oui ! regardez-moi bien en face pour me répondre...
MARCEL, à lui-même, après l’avoir regardée.
Depuis quand ?
MARGUERITE.
Oh ! vous êtes obligé de chercher cela !... Moi, je vous dirai tout de suite le jour où j’ai senti pour la première fois...
MARCEL, vivement.
Vraiment ? Et c’est ?...
MARGUERITE.
C’est le jour de l’automne dernier où vous êtes venu nous voir à midi !
MARCEL.
Un dimanche !
MARGUERITE.
Vous rappelez-vous ce beau soleil ? C’était ma première sortie et j’étais encore en deuil... nous nommes allés nous promener, et vous me donniez le bras, et comme j’étais triste, vous me disiez de bonnes... bonnes paroles... Ah ! qui m’allaient droit an cœur, et que j’entends encore... Vous rappelez-vous ce que vous me disiez ?
MARCEL.
Ah ! je crois bien ! Oui, chère Marguerite, oui ! je vous disais !...
MARGUERITE.
Quoi ?
MARCEL, avec une conviction qui va croissante.
Que je ne savais rien de bon et de charmant comme vous !
MARGUERITE.
Et puis ?
MARCEL, de même.
Et que vous étiez belle et adorable !
MARGUERITE.
Ah ! non ! – Adorable ! – Vous ne m’avez jamais dit cela !
MARCEL, étonné.
Vraiment ! je n’ai jamais dit...
MARGUERITE.
Mais vous le pensiez peut-être.
MARCEL, avec chaleur.
Certes !
MARGUERITE.
Je vous laisse dire ; car, enfin, c’est la première fois que je vous entends parler ainsi !
MARCEL.
La première fois ?
MARGUERITE.
Oui, car j’ai été obligée de deviner que vous m’aimiez.
MARCEL, vivement.
Mais vous l’avez deviné.
MARGUERITE.
Oh ! je le savais avant vous ! Ce soin de venir tous les jours, à l’heure où j’étais visible...
MARCEL.
Oui !
MARGUERITE.
Cette attention à m’apporter tout ce qui pouvait me charmer... un livre, une fleur !
MARCEL.
Oui !
MARGUERITE.
Oh ! je voyais bien que tout ceci était sincère et vrai !
MARCEL, avec chaleur.
Et aujourd’hui, c’est encore plus vrai que jamais !
MARGUERITE, naïvement, se levant.
Ah ! que je suis heureuse de ce que vous dites là ! et que nous avons bien fait de nous aimer !
MARCEL.
Et où trouverais-je un cœur meilleur, chère enfant ! une âme plus belle et plus pure que la vôtre ?
MARGUERITE.
Ah ! parlez encore, je sais si heureuse de vous entendre !
MARCEL.
Et tenez, Marguerite ! car vous avez raison, il est de ces choses que je ne vous ai pas dites ! Quand je vous quittais, je rentrais chez moi tout ému, tout nouveau, tout autre, enfin... Votre souvenir me fortifiait contre les chagrins, les déceptions, les amertumes de la vie... je voyais mille choses à dégoûter de ce monde, et mon cœur me criait : « Oui ; mais il n’y a pas que cela ; il y a aussi Marguerite !... » Enfin, je souffrais, j’étais déçu trompé dans un désir légitime, j’étais malheureux et le souvenir de votre courage, à vous que j’avais vue souffrir si chrétiennement, arrêtait le blasphème sur mes lèvres ! Vous étiez mon ange gardien ! j’invoquais votre aide ! et je ne pouvais prononcer le nom sacré de ma mère sans ajouter tout aussitôt : « Et Marguerite ! »
MARGUERITE, assise à gauche.
Ah ! parlez, parlez toujours !
MARCEL, avec passion.
Et je ne vous aimerais pas, moi ? Mais je serais donc aveugle, ingrat et sans cœur ? – Oui, notre union est écrite au ciel, Marguerite... On vous a mise sur terre pour veiller à mes côtés et me défendre contre moi-même... Et aujourd’hui que je vous retrouve, belle, pure, angélique, adorable, je vous reconnais... et je tombe à vos pieds, en vous jurant que vous êtes à moi... que je suis à vous, pour cette vie, pour l’autre, pour toujours ! et que je vous aime ! et que je t’aime !
MARGUERITE, très émue.
Enfin, vous l’avez dit...
L’émotion est plus forte qu’elle et elle s’évanouit.
Scène XI
MARGUERITE, LE MARQUIS, MARCEL
LE MARQUIS, entré par la droite au fond.
Ah ! monsieur, je vous croyais un galant homme !
MARCEL, troublé encore, se relevant et lui cachant Marguerite, sans voir lui-même quelle est évanouie.
Quoi ? qu’y a-t-il ? que me voulez-vous ?
Apercevant le Marquis.
Ah !... ah ! mon Dieu ? j’ai cru que c’était vrai !
LE MARQUIS, sans voir Marguerite évanouie.
Vous n’avez plus rien à dire ici, monsieur... laissez-moi la ranimer, et ne remettez plus les pieds chez moi...
MARCEL.
Chez vous !... chez vous !... Et qui donc m’a forcé d’y venir chez vous ?... Qui donc m’a pris par la main, tout à l’heure encore, pour me jeter aux pieds de cette enfant ? – Qui ? – c’est vous !
LE MARQUIS.
Monsieur !
MARCEL.
Et vous voulez que je l’écoute me parler de son amour, que je lui réponde, et que ce cœur glacé ne batte pas plus vite que le vôtre... Eh bien, oui, je l’aime !... et c’est vous qui l’avez voulu ! j’aime maintenant, c’est là... arrachez-le donc !
Il passe à droite.
LE MARQUIS, apercevant Marguerite évanouie.
Évanouie !...
Il sonne.
Vite quelqu’un !...
MARCEL, l’apercevant de même et voulant courir à elle.
Marguerite !
LE MARQUIS, lui barrant le chemin.
Je vous ordonne, monsieur, je vous ordonne de sortir de chez moi !
MARCEL, reculant.
Oui, je sortirai ! oui !... Mais vous ne chasserez pas l’amour de mon cœur comme vous me chassez de votre maison !
Il sort.
Scène XII
LE MARQUIS, puis ROSALIE
LE MARQUIS.
Ah ! malédiction sur le jour où tu as para chez moi, toi !
À Marguerite.
Marguerite, mon enfant !
Apercevant Rosalie qui entre.
Ah ! au nom du ciel, veillez sur elle ! tandis que je chercherai le docteur... Vauclin !
Il sort et crie dans la coulisse.
Vauclin !... Vauclin !
Scène XIII
ROSALIE, MARGUERITE
ROSALIE.
Pauvre mignonne ! – Voyez dans quel état ils la mettent avec leurs finesses !
MARGUERITE, revenant à elle.
Madame !... Marcel... où êtes-vous ?...
ROSALIE.
Il est parti !
MARGUERITE, repoussant sa main.
Parti ! Voulez-vous encore me tromper, madame ?
ROSALIE.
Moi ?
MARGUERITE.
Oui ! Une fois déjà vous m’avez menti... mon parrain me l’a dit !...
ROSALIE, exaspérée.
J’ai menti !... Ce monstre a osé vous dire que j’étais capable de mentir... quand c’est eux qui s’entendent pour vous tromper et pour vous faire croire à un amour qui n’est qu’une comédie !
MARGUERITE.
Une comédie... l’amour de Marcel !
ROSALIE.
Mais c’est un jeu concerté entre eux pour vous donner satisfaction comme aux enfants malades. – Eh bien, moi, ça me révolte, ces choses-là ! Pour qui donc est-ce qu’ils vous prennent ? pour une fille sans religion, donc, qui n’est pas capable d’offrir à Dieu ses petits chagrins... comme moi, qui depuis trente ans n’ai jamais pu épouser une seule de mes inclinations et qui lui offre tout cela en masse. Mais il faut ça, ma fille... c’est une mortification ! il faut ça pour le bien de l’âme !
MARGUERITE.
Marcel ne m’aime pas ?... lui que j’entends encore !... lui qui vient à l’instant !...
ROSALIE.
Mais par charité, par pitié !...
MARGUERITE, avec un cri de douleur.
Par pitié !... Assez ! assez !... madame ! Laissez-moi !...
ROSALIE.
Oui, oui ! c’est fini !... Ce n’est rien !... Pauvre mignonne ! la mettre dans cet état !
Montrant le poing au docteur dans le vide.
Oh ! le païen ! J’ai menti ! Ah ! si je le trouve !... Mais c’est toi qui mens, monstre d’homme ! mais c’est vous tous ! tous !... qui mentez pour nous tromper ! mais qui ne me tremperez jamais, moi, jamais ! jamais !...
Elle sort magnifiquement.
Scène XIV
MARGUERITE, puis MARCEL
Demi-nuit.
MARGUERITE, seule.
Sa pitié ! rien que sa pitié ! Et tout ce qu’il disait là, tout à l’heure, à mes pieds... comédie ! Oui, je me rappelle ! cet air embarrassé ! – « Et si je ne vous aimais pas ? Et si j’en aimais une autre ? » Et je n’ai pas compris ! Ah ! folle ! C’était clair, pourtant ! Il ne pense pas à moi et il me faisait l’aumône d’un semblant d’amour... Ah ! je suis maudite ! maudite comme ma mère ! Pourquoi suis-je venue dans cette maison ? C’est une maison de
Malheur ! Ma poitrine... là et là,
Elle porte la main à sa tête.
c’est du feu !... De l’air ! de l’air ! J’étouffe !... La fenêtre !
Elle court à la fenêtre pour l’ouvrir.
Non, non, on m’a dit que le froid me tuerait.
Poussant un cri et l’ouvrant.
Eh bien ! qu’il me tue donc, ce sera fini, au moins !
Musique. La fenêtre est ouverte ; on voit le perron couvert de neige ; la neige tombe. Marguerite arrache ses vêtements de manière à rester les bras, le cou et l’épaule nus, et court au fond ; le froid la saisit ; elle chancelle et s’appuie contre le montant de la porte en claquant des dents.
Viens donc, maintenant ! viens donc, je te ferai pitié !...
MARCEL, dehors, poussant un cri.
Ah !... Marguerite ! Marguerite !
Il entre par le perron.
Ah ! malheureuse enfant !
Il veut la prendre dans ses bras.
MARGUERITE, reculant.
Laissez-moi ! laissez-moi !
Elle s’accroche à la grille ; Marcel l’arrache, l’enlève et la ramène sur le théâtre. Au même instant tout te monde arrive avec des lumières.
Scène XV
MARGUERITE, MARCEL, LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL, LE DUC, BOURGOGNE
LE MARQUIS, effrayé, recevant Marguerite qui chancelle.
Marguerite !
VAUCLIN.
La fenêtre !
Marcel court fermer la fenêtre. On roule le fauteuil, et malgré sa résistance, on enveloppe Marguerite dans la couverture de voyage du Marquis.
MARGUERITE, grelottant.
Non ! laissez-moi ! Je veux mourir !
Silence.
LE MARQUIS.
Vauclin, tu la sauveras !
VAUCLIN, qui tient la main de Marguerite, secouant la tête avec doute.
Peut-être !
La toile tombe.
ACTE IV
Même décor. Une lampe allumée sur la cheminée. Le fauteuil est à la même place et Fromentel y est endormi. En avant de la cheminée, une petite table et une chaise. Vauclin, assis, au lever du rideau. Le marquis est étendu et dort sur le canapé.
Scène première
LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL
VAUCLIN, à demi-voix.
Fromentel !
FROMENTEL, réveillé.
Eh !... quoi ?
VAUCLIN.
Éteignez la lampe... voici le jour.
FROMENTEL, se levant.
Hon ! qu’on est mal à l’aise.
Il éteint la lampe.
Ah ! le bras !... Allons ! qu’est ce que c’est que cette douleur-là ?
VAUCLIN.
C’est un rhumatisme.
FROMENTEL, grommelant.
Oui, de mon temps, il n’y en avait pas, des rhumatismes...
Il retombe et se rendort peu à peu.
Quand je pense que j’étais debout tous les jours à cinq heures du matin pour réveiller mes commis ! Mais il faisait si bon, en ce temps-là, à cinq heures du matin ! Un soleil !... Tandis qu’aujourd’hui c’est un gueux de soleil qui n’est plus bon à rien !... Il est trop vieux ! il est échiné !...
La pendule ronfle et sonne. Réveillé en sursaut.
Hein ! quoi ? qu’est ce que c’est ?
VAUCLIN.
Rien ! la demie qui sonne.
FROMENTEL.
S’il est permis d’avoir un organe pareil !
VAUCLIN.
Chut ! je crois que Marguerite a soupiré !
Il traverse et va écouter à la porte de la chambre à droite. À lui-même.
Non, elle dort toujours !
Il redescend.
Allons ! allons ! la nuit a été rude ; mais la crise est bonne... Ce qui pouvait la tuer l’a sauvée. Tout va bien !
Se frottant les mains.
Tout va bien !
Le Marquis soupire dans son fauteuil.
FROMENTEL, grelottant.
Brou ! il ne dort pas mieux que moi, le Marquis !
VAUCLIN.
Il a voulu veiller !... comme ce jeune homme qui refusait de s’éloigner, et à qui j’ai du donner ma chambre là-haut... Pauvre garçon ! il est arrivé à temps, celui-là !...
Il passe à la cheminée.
FROMENTEL.
Oh ! mon Dieu ! sans vous, le Marquis l’aurait mis tout de même à la porte...
VAUCLIN, à lui-même, jetant un coup d’œil au Marquis à la dérobée.
Oui, certainement !
FROMENTEL, s’accoudant dans le fauteuil pour se rendormir.
Au risque de me faire conspuer, je les marierais tout de suite, moi, ces pauvres enfants !
VAUCLIN.
Il a raison... aussi bien ils s’aiment !
FROMENTEL, enfoncé dans son fauteuil.
Ça, c’est secondaire, ça ; – c’est le côté poétique... ça... Mais au point de vue du solide... qu’est-ce qu’on lui reproche à ce jeune homme ? Ce n’est pas comme mon galopin de fils. Je comprends qu’on n’en soit pas fou de celui-là ; tandis que l’autre, il a tout pour lui !... Une bonne place... de bons appointements !... C’est donc par entêtement qu’on le repousse ?
VAUCLIN.
C’est vrai, par entêtement !
FROMENTEL.
Par égoïsme !
VAUCLIN.
De l’égoïsme, c’est vrai !
Étonné.
Vous n’avez jamais parlé si sagement, Fromentel.
FROMENTEL, sans bouger.
C’est que j’enrage !... Une satanée histoire qui, depuis deux jours, bouleverse toutes mes habitudes ! qui m’empêche de dormir, qui m’empêche de dîner ! C’est assommant !...
Il se renfonce dans son fauteuil et se rendort.
VAUCLIN, en redescendant.
Ah ! bon !
À lui-même.
Et pourtant, il a dit la vérité... c’est de l’égoïsme ! Oui, voilà le mot que ma conscience me répète depuis hier. Allons, docteur, tranchons dans le vif !... Trancher ! non... la ruse vaudrait mieux.
S’approchant du Marquis endormi et le regardant.
Car je te devine, toi, et je sais bien pourquoi tu es si hostile à ce mariage...
Résolument.
Mais je t’y ferai consentir ou j’y perdrai mon nom ! Débarrassons-nous d’abord du Fromentel !
Il frappe sur le dossier de Fromentel.
Fromentel !
FROMENTEL, réveillé en sursaut.
Hé !
VAUCLIN.
Courez chez Lecolonec, le pharmacien de la Grand-Rue.
FROMENTEL.
Si loin !...
VAUCLIN, lui donnant le papier qu’il a écrit au lever du rideau.
Et rapportez-moi ceci vite... avec de la glace !
FROMENTEL.
De la glace ?
VAUCLIN.
Oui, vite, vite !...
FROMENTEL.
Brouh !... Eh bien, ça va me réveiller, tenez, cela ! Cristi de la glace !
Il sort en grelottant.
Scène II
VAUCLIN, LE MARQUIS
VAUCLIN.
À nous deux maintenant !
Appelant.
Laroche !
LE MARQUIS.
Hé ! quoi ?...
Vivement.
Marguerite est plus mal ?
VAUCLIN.
Toujours dans le même état !... Voici le jour.
LE MARQUIS.
Je me suis endormi !... Ah ! nature !... Moi qui ai tant de fois veillé pour mon plaisir !
VAUCLIN, fausse sortie.
Reste là pendant mon absence, j’ai deux mots à dire à ce jeune homme.
LE MARQUIS, tressaillant.
Ce jeune homme ?
VAUCLIN, tranquillement.
Oui... Marcel, qui est chez moi.
LE MARQUIS.
Tu as donné asile à ce... ?
VAUCLIN, de même.
Pourquoi pas ? L’homme qui a sauvé ta nièce avait bien le droit de veiller sous le même toit qu’elle !
LE MARQUIS.
Eh ! quelle reconnaissance lui dois-je, à cet homme ? Il l’a arrachée de cette fenêtre, n’est-ce pas son fatal amour qui l’y avait poussée !
VAUCLIN.
Est-tu bien sûr que ce soit son amour pour elle, et que ce ne soit pas notre haine pour lui ?
LE MARQUIS.
Notre haine ?
VAUCLIN, le regardant fixement.
Ou ton égoïsme, si tu l’aimes mieux !
LE MARQUIS.
Moi ?
VAUCLIN.
À moins que tu ne l’appelles dévouement, ce premier mouvement de ton orgueil qui écarte le sauveur, au risque de tuer la malade, et qui l’abandonne aux soins d’une Rosalie, tout au plus capable de la pousser au désespoir !
LE MARQUIS.
Vauclin !...
VAUCLIN.
Mais ce manant ose aimer ta nièce ! Cela crie vengeance, n’est-ce pas ? – Périsse la pauvre enfant ! et sauvons l’honneur du Marquisat !... Ou plutôt, car voici la vérité, jouons le salut de ta nièce sur un coup de dé ; pourvu qu’il disparaisse à jamais cet être importun, cet ennemi...
À voix basse, mais avec intention.
Ce rival !...
LE MARQUIS.
Ce rival... ?
VAUCLIN.
J’ai dit rival et je le répète ! Et si ton cœur, honteux de ce qu’il éprouve, n’a pas encore osé te l’avouer, eh bien, c’est moi qui te l’apprends ! Oui, ton rival !... car ce n’est plus le roturier, ce n’est plus l’homme hostile à tes convictions que tu veux éconduire, c’est l’amoureux préféré... qui ruine à jamais ce rêve que tu caressais à ton retour, d’une maison rajeunie, d’une famille nouvelle, d’une femme belle... charmante...
LE MARQUIS.
Vauclin !
VAUCLIN, lui saisissant la main.
Tu cries ! – J’ai touché la plaie !...
LE MARQUIS, avec force.
Ah ! tu mens !... et jamais...
VAUCLIN.
Jamais ?... jure-le donc !
LE MARQUIS, avec douleur.
Ah ! Vauclin, que tu me fais de mal !...
VAUCLIN, avec cœur.
Jamais trop, si je te guéris !
LE MARQUIS, se redressant.
Ah ! c’est fait, et tu ne me verras pas rougir deux fois de ma folie !...
VAUCLIN.
Folie, tu as bien raison !... La nature a fait une affection pour tous les âges, et à qui n’a plus droit aux passions de l’amant, il reste l’amour du père.
LE MARQUIS.
Hélas ! je n’ai pas de famille, Vauclin ! Et je n’ai pas d’enfants.
VAUCLIN.
Tu as une fille ! Aime-la et tu ne seras pas ridicule, car cet amour-là sera toujours de saison !
LE MARQUIS, avec amertume.
Ah ! sans doute, oui ; aimons-la comme un père peut aimer sa fille, et entourons-la de soins et de tendresse, pour qu’un plus jeune vienne un jour ou l’autre l’arracher à nos bras !...
VAUCLIN.
Mais l’horrible serait qu’elle y restât, dans nos bras ! et je m’accuse de l’avoir espéré un instant... Quoi ! tu ne comprends pas encore que nous sommes deux fous, deux maniaques... que depuis huit jours nous cherchons, par de petits moyens puérils et ridicules, à arrêter ce qui ne s’arrête pas ! la jeunesse ! Et nous croyons lui opposer une barrière de nos ruines !... et quand elle nous bouleverse nous et nos plâtras et fait tout voler en poussière... cela nous étonne... Vieilles bêtes !
LE MARQUIS.
Eh ! mon Dieu, nous avons fait...
VAUCLIN.
Nous avons fait une sottise !
Avec intention.
Et si un malheur arrivait...
LE MARQUIS, effrayé.
Un malheur !... Il y a donc danger ? Et tu désespères... toi ! Mais il faut voir d’autres médecins !... Il faut consulter !
VAUCLIN.
Et qui ?... Des praticiens de campagne comme moi... que tout cela déroute ! Ah ! si j’avais là, du moins,
Montrant la lettre.
celui qui l’a déjà sauvée une fois... et qui m’écrit : « Si le péril augmente... appelez moi !... »
LE MARQUIS.
Eh bien, qu’on l’appelle... et qu’il vienne !
VAUCLIN.
De Paris ?...
LE MARQUIS, courant à son secrétaire.
Pourquoi pas ?... J’écris !
VAUCLIN.
Eh ! ta lettre arrivera dans deux jours !
Avec intention.
Seulement par le télégraphe électrique userait prévenu avant midi... mais pour venir ?
LE MARQUIS, écrivant.
Eh bien ! il a le chemin de fer !
VAUCLIN.
Jusqu’à Rennes, oui !... en quelques heures ; mais de Rennes à Quimperlé par la voiture, un jour entier...
LE MARQUIS.
Un jour ; mais avec des chevaux à moi !... Trois, quatre chevaux !
VAUCLIN.
Trop tard !
LE MARQUIS.
Mais ce n’est pas possible !... il y a d’autres voies ! un chemin de fer quelque part !... Nantes !
VAUCLIN.
Eh ! quarante lieues de voiture, un jour encore !...
LE MARQUIS.
Mais ailleurs ?
VAUCLIN.
Rien !
LE MARQUIS.
Rien !... Rien !... Mais nous sommes donc dans un désert ! Mais partout, il y a des chemins qui dévorent, le temps, et ici...
Avec désespoir.
Eh ! non, il n’y en a pas, puisqu’ils voulaient le faire ! et j’ai maudit leur projet, et je triomphais hier encore de le voir ajourné. Triomphe donc maintenant d’être au bout du monde ! On ne peut pas voler à ton aide !... Triomphe, imbécile... d’avoir sauvé ta maison ; tu ne peux pas sauver ta maison ; tu ne peux pas sauver ton enfant !...
Il tombe accablé sur le canapé.
VAUCLIN.
Ne t’accuse pas ! ce ne serait encore qu’un projet !
LE MARQUIS, désespéré.
Ah ! ma maison, la ville, tout en poussière, Vauclin ! Tout au vent ! pourvu que je la sauve ! et je fais serment de porter le premier coup à ces murs sacrés, et de lui faire large place à ce progrès qui peut avoir tous les vices, mais qui fait tout pardonner, quand il vole plus vite que nous au secours de ceux qui souffrent !
VAUCLIN, à part, triomphant.
Eh allons ! donc !
Haut.
Tu le comprends enfin, que l’œuvre de ce jeune homme n’est pas erreur ni folie !... et qu’elle a sa grandeur et sa noblesse !...
LE MARQUIS.
Eh ! qu’importe que je le comprenne !
VAUCLIN.
Oh ! beaucoup... il importe beaucoup, je te le jure... car enfin, là où la science nous fait défaut, on peut trouver encore un auxiliaire aussi puissant, plus puissant peut-être...
Mouvement du marquis.
Oui ! une réaction violente !... une secousse !... une grande joie, par exemple...
LE MARQUIS, vivement, debout.
Ah ! dis… parle !... Que faire ?
VAUCLIN.
Es-tu capable ?
LE MARQUIS.
Oh ! de tout, pour la sauver !
VAUCLIN, vivement.
Et tu foulerais aux pieds tes préjugés ?...
LE MARQUIS.
Eh ! qu’est-ce que tout cela ! Il n’y a plus qu’Elle, Vauclin, il n’y a plus qu’Elle...
VAUCLIN, avec élan.
Eh bien, sauvons-la donc, cette enfant, et pour cela, achève de plein gré ce que nous avons commencé par force ! Mets dans sa main celle de Marcel, en lui criant : « Voici ton mari !... »
LE MARQUIS, saisi.
Que j’aille chercher moi-même !... Ah ! tu ne peux pas te méprendre, n’est-ce pas, sur ce sentiment ?...
VAUCLIN, vivement.
Oui ! un roturier !... mais un roturier de génie !
LE MARQUIS.
Mais je l’ai chassé de chez moi !
VAUCLIN.
C’est bien pour cela qu’il faut l’y ramener toi-même.
LE MARQUIS.
Ah ! Vauclin, ce que tu me demandes est plus que du courage !...
VAUCLIN.
Eh ! te le demanderais-je... si ce n’était de l’héroïsme ? Et prouve-le donc une bonne fois par le sacrifice de ton orgueil, que ce cœur dont tu parlais est encore vivace et qu’il a conservé cette chaleur, cet élan, qui fait dire d’un homme à tous les âges : « Il est jeune encore, puisqu’il est encore capable de dévouement !... »
LE MARQUIS.
C’est vrai !... ah !... c’est vrai !... Mais mon père, si fier, si implacable dans ses convictions... accepter pour un des nôtres le petit fils de notre intendant ! Ah ! jamais il ne consentira... jamais... Vauclin, jamais.
VAUCLIN.
Qui sait ? Combats du moins sa résistance.
LE MARQUIS.
Et comment ?
VAUCLIN.
Persuade-le, touche-le.
LE MARQUIS.
Mais ?
VAUCLIN.
Et triomphe de lui comme de toi !
LE MARQUIS.
Mon Dieu ! si j’espérais !... Mais moi qui suis devant lui comme un enfant moi qui tremble !
VAUCLIN, ouvrant la porte du Duc.
Allons, la porte est ouverte !
LE MARQUIS, après une dernière hésitation.
Non, jamais... je ne... Eh bien ! oui, après tout, oui, je le tenterai !... Oui, de par Dieu ! j’aurai ce courage !... et fasse le ciel que nous sauvions l’enfant, Vauclin !... Ils seront heureux par moi et en les regardant, nous aurons vingt ans de moins, mon vieil ami !
VAUCLIN.
Eh ! à la bonne heure !... et tu es décidé, quoi qu’il arrive ?
LE MARQUIS.
Ah ! quoi qu’il arrive à tout dire et à tout faire !...
VAUCLIN, avec chaleur.
Eh bien ! pardonne-moi !... je t’ai trompé !... J’ai sauvé Marguerite et je te réponds d’elle !
LE MARQUIS.
Sauvée !...
Il est suffoqué par les larmes.
Ah ! Vauclin !...
Se jetant dans ses bras.
Merci, merci !... Moi aussi tu m’as sauvé... et je te réponds de moi.
VAUCLIN.
Allons, courage !
LE MARQUIS, lui serrant les maint en riant et pleurant.
Eh ! vivent les Ganaches ! mon vieux Vauclin !... vivent les Ganaches ! Nous pourrons regarder fièrement ces jeunes gens qui nous raillent de nos faiblesses et leur crier : « Ganaches... oui, Ganaches !... d’accord ! mais que l’un de vous en fasse autant ! »
Il s’élance chez le Duc.
Scène III
VAUCLIN, FROMENTEL
VAUCLIN, seul, suivant des yeux le Marquis.
Il va chez le Duc !... il entre... Ah ! brave cœur !...
FROMENTEL, rentrant, sa robe de chambre retroussée, frissonnant et tenant de la glace dans une serviette.
Voilà !... voilà... voilà... la glace !
VAUCLIN, indifférent et regardant toujours la porte ouverte du Duc.
Bon !... bien !
FROMENTEL, de même.
Les potions seront prêtes dans un quart d’heure.
VAUCLIN, de même.
C’est bien ; mettez là...
FROMENTEL.
La glace, où ça ?
VAUCLIN, sans l’écouter, préoccupé, regardant toujours la porte du Duc.
Eh bien ! où vous voudrez !... Sur la cheminée !... devant le feu !...
FROMENTEL, stupéfait.
La glace !
VAUCLIN, allant et venant sans l’écouter.
Eh ! mon Dieu ! jetez-la ! qu’est-ce que vous voulez que j’en fasse ?
FROMENTEL.
C’était bien la peine de me faire geler !...
Il court à la cheminée.
VAUCLIN, agité, descendant.
Il a raison !... un roturier, un homme de rien, passe ; mais le petit-fils de leur intendant !... Faire consentir le Duc... Et le Marquis, si humble devant ses volontés... S’il faiblit, tout est perdu !... Si j’osais !... non ! je gâterais tout, moi !... Il faudrait lui dépêcher quelqu’un qui eût le droit...
Donnant des coups de poing dans le vide.
de... de... Qui est l’autorité ! qui lui parlât au nom de !... au nom des !...
Poussant un cri.
Ah ! j’y suis !... Son directeur !... l’abbé !... Fromentel, où loge l’abbé ?
FROMENTEL.
L’abbé ?... Est-ce que la malade ?...
VAUCLIN.
Mais non ! répondez donc, mordieu !... Où loge l’abbé ?
FROMENTEL.
Ma foi ! je n’en sais rien !... mais je viens de le voir entrer dans l’église !...
VAUCLIN, saisi.
Dans l’église.
FROMENTEL.
Oui !
VAUCLIN, hésitant, très agité.
Dans l’église !... saprebleu !... un homme que j’ai traité !... Je vais être obligé de commencer par des excuses !... Encore si ce n’était pas dans l’église !...
À Fromentel.
Vous dites qu’il sortait de l’église ?
FROMENTEL.
Non, il entrait ! Il ne sortait pas, puisqu’il entrait !...
VAUCLIN.
Il entrait !... Je suis perdu ! il ne me lâchera plus !... Ce ne sont plus des excuses ! c’est une pénitence !... Oh ! non ! non ! D’ailleurs, je n’ai pas mon chapeau !... je ne peux pas...
FROMENTEL.
Votre chapeau, le voilà ! c’est moi qui l’avais pris.
VAUCLIN, prenant le chapeau.
Ah ! oui, tiens ! c’est juste... le voilà.
FROMENTEL.
Vous sortez ?
VAUCLIN, sans bouger.
Je sors !... oui !...
Résolument.
Je sors !
FROMENTEL, se chauffant toujours.
Dites donc, vous reviendrez bientôt, vous n’allez pas au diable ?...
VAUCLIN.
Non, je vais à Dieu.
Il sort.
Scène IV
FROMENTEL, BOURGOGNE
FROMENTEL, se chauffant.
Il ne viendra pas du tout !... Je suis sûr qu’il est allé faire un somme !... Quel froid ! Il ne chauffe pas, ce feu... Je ne sais pas avec quoi ils font le feu maintenant ! – Et ce gredin d’Urbain, qui depuis hier soir...
À Bourgogne, qui entre.
Ah ! Mon fils est-il rentré ?
BOURGOGNE.
Oui, monsieur ! – On le monte.
FROMENTEL.
On le monte ?
BOURGOGNE.
Il a soupé avec M. de Valcreuse !... il est dans un état...
FROMENTEL.
Fils dénaturé !... parricide !... polisson !
On sonne.
BOURGOGNE.
Chut ! monsieur, on sonne chez mademoiselle.
Il va à la porte de la cheminée.
FROMENTEL, sans l’écouter.
Non, ce n’est pas mon fils !... Ce n’est pas possible !... Il y a quelque chose là-dessous qu’on ne saura jamais !...
Marcel entre avec précaution et reste au fond en voyant Fromentel.
BOURGOGNE.
Monsieur, mademoiselle est réveillée !
FROMENTEL, prenant la glace et la secouant avec menace.
Elle est réveillée !... Eh bien, je vais le réveiller aussi, moi !... avec ça dans son lit...
Il sort en emportant la glace.
Scène V
BOURGOGNE, MARCEL
MARCEL.
Bourgogne !
BOURGOGNE.
Monsieur !
MARCEL.
Je t’en supplie, je t’en conjure, Bourgogne !... mon bon Bourgogne !... Laisse-moi la voir !
BOURGOGNE.
Non !... non !... monsieur, pas cela !...
MARCEL.
Un instant !... un mot ! rien qu’un mot ! Je ne lui parlerai pas !... Tiens... un regard seulement ! Laisse-moi !...
BOURGOGNE.
Non, monsieur ; je ne connais que ma consigne !... On n’entre pas !... vous surtout.
MARCEL, résolument.
Eh bien, j’entrerai malgré toi !
BOURGOGNE.
J’appelle M. le Marquis.
MARCEL.
Eh ! appelle-le ton Marquis ! et dis-lui de me fermer sa porte, s’il l’ose.
BOURGOGNE.
Monsieur !
MARCEL.
Je veux la voir !
BOURGOGNE, devant la porte.
Vous me tuerez, monsieur, mais vous ne passerez pas !
Scène VI
BOURGOGNE, MARCEL, MARGUERITE
MARGUERITE, doucement, en écartant Bourgogne.
Et si je veux le voir, moi, mon bon Bourgogne !
MARCEL.
Marguerite !
MARGUERITE.
Laisse-nous !... va !...
BOURGOGNE.
Mademoiselle !...
MARGUERITE.
Laisse-nous !
Bourgogne sort.
Scène VII
MARGUERITE, MARCEL
MARCEL, revenant à Marguerite.
Vivante !... sauvée ! Ah ! ma chère Marguerite !
MARGUERITE, l’arrêtant du regard.
Pourquoi êtes-vous revenu, Marcel ?... vous n’avez plus rien à faire ici !...
MARCEL.
Pourquoi je suis revenu ?
MARGUERITE.
Je ne souffre pas, vous voyez, et vous n’avez plus besoin de me traiter comme une enfant dont on flatte les caprices !
MARCEL.
Que voulez-vous dire, Marguerite ?
MARGUERITE.
Je veux dire que je n’accepte pas votre pitié ! Je veux dire que vous ne m’aimez pas !
MARCEL.
Je ne vous aime pas !
MARGUERITE.
Non !... et vous m’avez menti par lâche complaisance, et cela me révolte !...
MARCEL.
J’ai menti ! je ne t’aime pas !... moi ?... Mais regarde-moi... voyons !... je ne t’aime pas !
MARGUERITE.
Jurez-moi que vous êtes venu dans cette maison sachant m’y retrouver ?
MARCEL.
Non ! je ne jurerai pas cela, car ce n’est pas vrai.
MARGUERITE.
Vous voyez bien !... Jurez-moi donc aussi que vous aviez demandé ma main et qu’on vous l’avait accordée ?...
MARCEL.
Jamais cela !... mais...
MARGUERITE, sans l’écouter.
Ah ! vous voyez bien !... et que vous n’avez pas été vingt fois, car je me rappelle tout maintenant... sur le point de me crier : « Mais on vous trompe !... Tout cela est faux !... »
MARCEL.
Oui... oui !... Mais...
MARGUERITE.
Ah ! vous voyez donc bien que vous ne m’aimez pas et que vous mentiez !
MARCEL, avec chaleur.
Eh bien, non, je ne mentais pas ! non ! quand je vous criais : « Je vous aime !... » Et comment cet amour m’est venu, ou plutôt comment il s’est révélé, je ne saurais le dire ; mais j’étais si ému de vous entendre et de vous voir !... votre amour si pur, si simple, si tendre !... rayonnait sur moi... il me pénétrait de toutes parts... il m’enivrait !... Ah ! cela ne s’exprime pas, Marguerite, cela se sent !... Il y a là quelque chose de divin ! le mensonge devenait peu à peu vérité ; la vérité, lumière ; la lumière, éblouissement... J’étais ravi, confondu, en extase !... Je vous aimais, je vous adorais !... et je le jurais du fond de l’âme, comme je jure encore que je t’aime et que je t’adore !
MARGUERITE, qui s’est retournée vers lui à mesure qu’il parle, après l’avoir regardé, avec élan.
Ah ! je vous crois !
MARCEL.
Enfin ! Ah ! maintenant, vous êtes à moi, et je les défie de nous séparer !...
MARGUERITE.
Nous séparer !...
MARCEL.
Oui, oui ! le Marquis m’a défendu tout espoir ; mais qu’importe !
MARGUERITE, le repoussant.
Qu’importe ?... Qu’espérez-vous donc, Marcel ? Que je vous suivrai... Que je consentirai, moi aussi, à braver leur défense et à fuir avec vous... Ah ! jamais !
Elle s’éloigne de lui.
MARCEL.
Marguerite !
MARGUERITE.
Jamais !
MARCEL.
Mais vous, Marguerite, mais vous êtes libre ! Vous êtes seule !
MARGUERITE.
Seule ! moi ?... Est-ce que vous ne voyez pas que partout, partout où je suis, je parle et j’agis pour deux : pour moi et pour celle qui n’est plus !... Quand je suis entrée dans cette maison, je l’ai juré ! Ils l’ont chassée, maudite ! je veux qu’ils l’honorent et qu’ils la regrettent... Et c’est moi qui la ferais maudire et détester davantage ! Ah ! je ne veux pas qu’on dise : « La mère savait si mal ses devoirs qu’elle n’a pas su les apprendre à son enfant !... » Mais je veux que partout l’on s’écrie, et dans cette maison plus haut qu’ailleurs : « Vous voyez bien que c’était une honnête femme, celle qui de son enfant a su faire une honnête fille ! »
MARCEL, avec admiration.
Ah ! sainte vertu !... Âme vaillante et belle !... Je l’ai dit, que vous étiez la voix de ma conscience...
Scène VIII
MARGUERITE, MARCEL, LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL
LE MARQUIS, entrant vivement par le fond, tandis que les deux autres entrent par la droite.
Plus bas ! malheureux enfants !... plus bas ! Si le Duc vous entendait !
MARCEL.
Il n’entendrait rien que je ne puisse répéter tout haut, devant vous, monsieur le Marquis, et devant lui !...
LE MARQUIS.
Ah ! je le sais... je le sais ! Mais votre seule présence, maintenant qu’il sait tout...
MARGUERITE.
Il sait... Vous lui avez dit ?...
LE MARQUIS.
Hélas ! oui, et sans succès ! Après m’avoir écouté en silence, il c’est levé avec une énergie que je ne lui connaissais plus, et il s’est écrié : « Laissez-moi, mon fils ! » Et pour qui le connaît ainsi que moi, tout est bien perdu !
VAUCLIN, à part.
Perdu ! perdu ! pas encore.
MARCEL.
Laissez-moi donc quitter cette maison, monsieur, tandis que j’ai encore du courage et que je suis résolu à partir.
LE MARQUIS et VAUCLIN.
Partir !
MARCEL.
Oui, car j’ai compris mon devoir, Marguerite, comme vous avez compris le vôtre. L’honneur pour moi, c’est de ne pas forcer l’entrée de la maison qui me repousse et de ne pas vous arracher à la maison qui vous accueille. Ah ! je suis digne de vous comprendre, et j’aurai le courage de vous obéir !
LE MARQUIS.
Ah ! c’est valeureux !... c’est beau !... et d’un vrai gentilhomme !...
Tendant la main à Marcel qui remonte pour sortir.
Il a raison ! Un homme comme lui n’est pas fait pour se glisser dans notre maison par la petite porte !
Il serre une dernière fois la main de Marcel. Celui-ci s’apprête à sortir. La porte du fond s’est ouverte toute grande aux dernières paroles, et le Duc a paru sur le seuil.
Scène IX
MARGUERITE, MARCEL, LE MARQUIS, VAUCLIN, FROMENTEL, LE DUC
LE DUC, prenant la main de Marcel, le faisant redescendre et très simplement.
Il entrera donc par la grande !... car c’est moi qui l’ouvre ! – Embrassez votre femme, mon fils !
MARGUERITE.
Sa femme ?
MARCEL.
Marguerite !
VAUCLIN, avec joie.
Quoi, vous conseillez, monsieur le Duc ?
LE DUC.
Quand deux enfants sacrifient si bien leur passion à leur devoir, je ne saurais pu sacrifier mes convictions à leur bonheur !
Vauclin va serrer les mains de Marguerite. Avec émotion.
Et puis, moi, détester encore... moi, maudire !... à mon âge !... Ah ! l’on peut faire ce que j’ai fait une fois dans la vie... on ne le refait pas deux fois.
Il tend les bras à Marguerite.
J’ai trop souffert.
MARCEL.
Ah ! monsieur le Duc !... Ah !... monsieur le Marquis.
LE MARQUIS, gaiement.
Eh ! Pardieu ! quand nous nous embrasserions, mon neveu ! Qu’y aurait-il de ridicule ?
Il lui tend les bras.
VAUCLIN, avec joie.
Ah ! que j’ai donc bien fait d’amener l’abbé, moi !...
LE DUC, surpris.
Ah ! c’est vous qui ?...
VAUCLIN.
Oui ! je l’ai rencontré... quelque part, ce matin !...
MARGUERITE, vivement.
Ah !
Elle lui serre la main.
LE DUC, de même.
Il est avec le ciel des raccommodements.
VAUCLIN.
Que voulez-vous ! me voilà aussi tombé dans les ganaches !...
LE MARQUIS.
Comme nous.
MARCEL.
Vous... jamais !... monsieur le Marquis !... C’est une maladie de tête... dont on est exempt dès qu’on a du cœur.
VAUCLIN.
Cela ne suffit pas... jeune homme, et quand vous serez où nous en sommes, rappelez-vous qu’il n’y a qu’un remède : C’est d’être toujours l’homme de son temps !
LE MARQUIS.
Et de son âge !
MARCEL.
Alors c’est le progrès !
LE DUC.
C’est le progrès !... Allons, jeunesse montrez-nous donc le chemin !
MARGUERITE, lui prenant le bras.
Oui, mais en vous donnant le bras.
FROMENTEL.
Eh bien, de mon temps, on aurait chanté là-dessus un petit vaudeville. – Quand je vous dis que tout se perd !