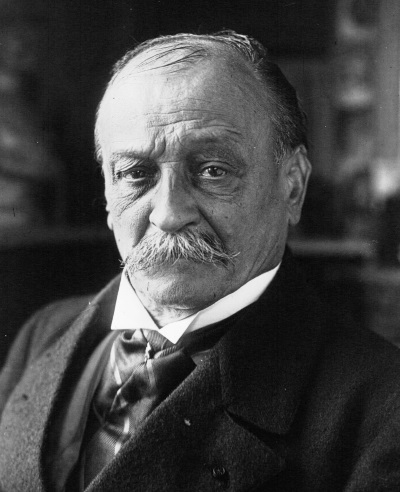Le Droit aux étrennes (Georges COURTELINE)
Fable en un acte.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du Grand Guignol, le 13 mai 1896.
Personnages
LANDHOUILLE
UN COCHER DE L’« URBAINE »
UN SOLDAT
UN MONSIEUR BIEN MIS
LOUISON
Une petite pièce modestement meublée. Au fond, une porte, et, à gauche, en pan coupé, une fenêtre praticable. À droite, une porte. Un casier laissant voir les dos de deux grands livres, reliés en vert, avec montures de cuivre.
Scène première
LANDHOUILLE, seul
Au lever du rideau, Landhouille, à la porte du fond, le dos présenté au public, hurle, à une personne qu’on ne voit pas, des recommandations que couvrent des roulements de tambour.
LANDHOUILLE.
Tu feras mes amitiés à ma tante Virginie, et tu l’embrasseras pour moi. Tu diras à mon oncle Auguste... – Vas-tu te taire, avec ton tambour ? Quelle diable d’idée ai-je eue de donner un tambour à cet enfant ! Tape encore un peu, que je t’entende ; je te le reprendrai, moi, ton tambour.
Le tambour se tait.
Tu diras à mon oncle Auguste que j’ai été forcé d’aller à la réception du ministre. Ce n’est pas vrai, mais ça ne fait rien. Tu as l’abat-jour de ma tante ? Oui ? Bon. Adieu, Sidonie ; n’oublie pas les fruits confits de Mme de Pont-à-Mousson.
Répondant à une question que le public n’entend pas.
...Bien entendu, chez l’épicier. Et pense aux crottes de chocolat de Mme de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis, toi, Toto, tâche d’être sage. Embête-la un peu, ta mère ; embête-la, avec ton tambour ; je t’apprendrai comment je m’appelle, moi.
Il referme la porte, descend en scène et tire sa montre.
Trois heures dix. Sidonie ne sera pas rentrée avant sept heures ; mettons à profit nos loisirs pour établir le bilan de l’infâme Premier Janvier, en procédant à la récapitulation des étrennes que j’ai reçues.
Il va au casier, en tire un des grands livres et le transporte dans ses bras jusqu’à une table chargée de papiers et de journaux, placée à droite, à l’avant-scène. Ceci fait, il s’installe, se plante son binocle sur le nez, et, rabattant le couvercle du volume.
Récapitulation des étrennes que j’ai reçues.
Il tourne la page.
Total : zéro. À la bonne heure, c’est vite compté, et ça dispense de faire la preuve par neuf.
Il reporte le grand livre à la place qu’il occupait dans le casier et revient, chargé de l’autre in-folio. Recommencé du jeu de scène ci-dessus.
Récapitulation des étrennes données !
Il tourne une page, puis une autre, puis une troisième, puis une autre encore. Les pages sont noires d’écritures.
Ça, c’est une autre histoire.
Il lit.
À ma femme... des boucles d’oreilles ;
À ma belle-mère... un chauffe-assiettes ;
À mon petit garçon... un tambour ;
Au concierge... vingt francs.
Parlé.
Vingt francs ! En voilà de l’argent que je regrette. Ponchon a rudement raison. Comme il dit, je ne sais plus dans quoi :
Encore un an qui s’amène,
Un autre qui s’tir’ des pieds.
Moi qui ne r’çois pas d’étrennes,
Faut qu’j’en foute à mon portier.
Haussement d’épaules mélancolique.
Où en étais-je ?
Il se replonge dans ses calculs.
À mon cousin Lenflé... une pipe ;
À ma cousine Lenflé... une cuiller à soupe ;
Au petit Lenflé... une trompette.
Parlé.
Ces Lenflé me mettent sur la paille ! Heureusement, la trompette de leur gosse fait encore plus de boucan que le tambour du mien. Les parents auront de l’agrément, c’est toujours ça de rattrapé.
Il poursuit.
À mon beau-frère... mon portrait.
Satisfait de lui.
Très bien !
Il tourne la page.
À ma tante Louise... un abat-jour ;
À ces mufles de Dubourg... un pétunia en pot ;
Au petit garçon des Durand... un abonnement à la Jaunisse.
Surpris.
Un abonnement à la Jaunisse ?
Il se penche sur la feuille, s’efforce de déchiffrer une écriture illisible. Enfin.
Ah ! non !... à la « Jeunesse ! », au journal « la Jeunesse ».
Il reprend.
Au petit garçon des Durand... un abonnement à « la Jeunesse » ;
À mon filleul... ma vieille montre.
À mon garçon de bureau... ma vieille redingote.
À mon oncle Albert... mon portrait.
Parlé.
Très bien !
À la bonne des Lenflé...
Parlé.
Encore ! Ça devient de l’extravagance ! Ce n’est pas une trompette que j’aurais dû donner au petit ; c’est un canon.
À la bonne des Lenflé... cent sous ;
À Mme de Pont-à-Mousson... une livre de fruits confits ;
À Mme de Saint-Jean-Pied-de-Port... une livre de crottes de chocolat ;
À la veuve Plumeau... une botte de mouron ;
Se reprenant.
« Une boîte de marrons », pardon. Jolie écriture !...
Il poursuit.
À la veuve Plumeau... une boîte de marrons ;
À mon oncle Édouard... mon portrait.
Parlé.
Très bien.
À ma bonne... dix francs ;
À la porteuse de pain... un franc ;
Au facteur des postes... quarante sous ;
Au petit télégraphiste... vingt sous ;
Aux vidangeurs... cinquante centimes.
Parlé.
Si j’avais su, je leur aurais donné mon portrait, aux vidangeurs. Les bonnes idées viennent toujours trop tard.
Il sonne.
Que je fasse mettre une bûche au feu ; je gèle sur place, moi... Voyons, est-ce bien tout ?
Longue rêverie.
C’est bien tout. C’est plus que suffisant, d’ailleurs. L’année a été si brillante !...
Nouveau coup de timbre.
Plus de vingt mille balles que j’ai perdues dans l’affaire des mines du Transvaal par la faute de cette saleté de coulissier !... Que je le rechoppe, le coulissier ! non, mais, que je le repince, pour voir. Je lui paierai un petit rigolo de dividende qui ne lui coûtera pas cher d’impôt. Farceur, va !... Ah çà, mais je sonne dans le désert ! Je suis le gentilhomme le plus mal servi de France. Célestine ! Célestine ! Célestine !
La porte de droite s’ouvre lentement. Apparition d’un soldat. Landhouille se lève effaré.
Scène II
LANDHOUILLE, UN SOLDAT
LANDHOUILLE.
Un soldat dans la cuisine ! Qu’est-ce que vous faites là ?
Un temps. Le soldat va à lui, et, lui tendant sa main ouverte.
LE SOLDAT.
Voici ma main, elle est par le hâle tannée.
Agréez mes souhaits pour la nouvelle année.
Je suis soldat, monsieur, et sauf votre respect,
J’ai nom Léonidas Agathocle Lepet,
Caserné, bâtiment H, à la Pépinière.
LANDHOUILLE, étonné.
Asseyez-vous donc, je vous prie.
Les deux hommes s’assoient l’un en face de l’autre, puis, chez Landhouille, le geste qui veut dire : « Vous avez la parole, j’écoute. »
LE SOLDAT, souriant.
Je suis le bon ami de votre cuisinière.
C’est moi qui l’aide à laisser brûler le rôti,
En lui faisant l’amour quand vous êtes sorti.
Oui, bien des fois je mis à profit votre absence
Pour cueillir les trésors de sa magnificence
Et remplir, sur l’azur de votre couvre-pied,
Mes devoirs de vaillant et de galant troupier.
Je l’aide également à casser la vaisselle,
À cracher dans la sauce ou dans le vermicelle,
À très bien démantibuler les robinets
De la fontaine, et le machin des cabinets.
J’ajoute que je suis apte à vider les litres,
Que je sais prolonger les fêlures des vitres,
Et, sur l’or des parquets nouvellement frottés,
Faire grincer les clous de mes souliers crottés.
De mes talents, tel est l’énuméré rapide.
LANDHOUILLE.
Je ne sais pas à quoi ça tient, je ne saisis pas très clairement le but de votre démarche.
LE SOLDAT.
Je m’explique. Certain d’avoir été stupide
Avec ampleur, et fourbe avec tranquillité,
D’avoir enfreint les lois de la pudicité
Et consterné les plus grands ivrognes de France
Du spectacle émouvant de mon intempérance,
D’avoir enfin, – de quoi j’atteste ici les dieux ! –
Tout fait au monde afin de me rendre odieux,
Je viens, avec la paix des consciences sereines,
Solliciter de vous mes petites étrennes.
LANDHOUILLE.
Parce que vous avez bu mon vin, fait des horreurs dans ma chambre à coucher et démantibulé les lieux, il faut que je vous donne des étrennes ? Vous avez une certaine santé.
Il tire vingt sous de sa poche.
Voici vingt sous. C’est bien pour encourager le vice.
Lui ouvrant la porte du fond.
Et maintenant, du vent, s’il vous plaît !
LE SOLDAT.
Il n’est pas de petite offrande ;
De petite obole il n’est pas ;
Quant aux vingt sous, je vais les boire de ce pas,
En priant Dieu qu’il vous les rende.
LANDHOUILLE.
Serviteur aux carottiers. Bonjour, mon ami. Bonjour.
Le soldat sort.
Scène III
LANDHOUILLE, seul, puis UN COCHER DE L’« URBAINE »
LANDHOUILLE.
J’ai vu des gens avoir du culot, mais pas dans ces proportions-là. Ah ! si on n’avait pas le trac de passer pour un crasseux !...
Il revient à la table et s’y installe.
Voyons, nous disons... nous disons... : « à l’amant de Célestine... »
On sonne.
Qui est-ce qui vient me raser ?
Il va ouvrir. Apparition d’un cocher de l’Urbaine. Ce vieillard congestionné est vêtu d’un manteau à quadruple pèlerine. D’une main, il tient son fouet, de l’autre son chapeau blanc.
Un cocher, à présent ? Je n’ai pas pris de voiture. Vous devez vous tromper d’étage.
LE COCHER.
Homme qui survenez et m’écoutez ici,
J’entre...
Il entre.
Je vous salue,
Il salue.
Et je vous dis ceci :
Recevez tous mes vœux pour la nouvelle année
Et touchez là ; voilà ma main parcheminée.
Ahurissement de Landhouille qui garde sa main dans sa poche.
LE COCHER.
Eh quoi ! vous dérober à mon embrassement ?
Cet excès de froideur me peine énormément.
À lentes et larges enjambées il marche sur Landhouille, lequel recule d’autant. Ils arrivent ainsi au trou du souffleur. Là.
LANDHOUILLE, qui commence à être très inquiet, à part.
Je ne donnerais pas cinq sous de ma peau.
LE COCHER, avec éclat.
Rappelez-vous !
Landhouille rassemble ses souvenirs et ne se rappelle rien du tout.
Je suis Luc !
Landhouille exprime par sa mimique que cette révélation le laisse froid.
...cocher de « l’Urbaine » !!!
Mutisme prolongé de Landhouille qui se rappelle de moins en moins.
C’est moi qui, l’autre jour, eus cette bonne aubaine
De vous catastropher dans une flaque d’eau,
En doublant le tournant du Cirque Fernando.
Je fendais l’air. D’une allure non moins pressée,
Vous allâtes baiser le sol de la chaussée,
Lequel, dès lors, porta de gueule sur fond blanc.
Quand on vous releva, vous étiez ruisselant
Comme une éponge et maculé comme un grimoire...
Combien ce temps encore est cher à ma mémoire !
LANDHOUILLE.
Vous pensez à moi, c’est gentil. – Et alors !
À ces mots.
LE COCHER, de qui le visage s’empourpre.
Alors !... Alors, dis-tu !
Éclatant.
Donc, tu n’as pas saisi ?
Et je n’ai pas assez mis les points sur les i ?
Tu ne vois pas que je viens chercher mes étrennes ?
Formidable.
Faut-il te le hurler, pour que tu le comprennes ?
Outil ! Fourneau ! Paquet ! Tête à poux !... Marié !...
Echantillon pourri d’un siècle carié !
Monstre à l’âme de boue, et de fange, et de lie,
Qui n’échappa que par miracle – et qui l’oublie ! –
Aux sabots meurtriers
Ému jusqu’aux larmes.
de mes propres chevaux !
LANDHOUILLE.
Écoutez, je ne veux pas de scandale...
LE COCHER.
Zut !
LANDHOUILLE.
Je suis un homme rangé, paisible.
LE COCHER.
Tais-toi !
LANDHOUILLE.
Je jouis de la considération du voisinage, et...
LE COCHER.
Je te tiens pour le dernier des veaux !
LANDHOUILLE.
Mais ne criez donc pas comme ça, encore une fois !... Voyons, voulez-vous vingt sous ?
LE COCHER.
Voyez le cancre, avec sa gueule peinte en jaune.
Ai-je l’air d’un monsieur qui demande l’aumône ?
Vingt sous !... Vingt sous !...
Il prend la pièce de monnaie.
Je les prends pour t’humilier.
Passe un jour, à proximité de mon soulier...
Je me comprends. Adieu, que le diable t’emporte !
En sortant.
Je crache mon mépris sur le seuil de ta porte.
Scène IV
LANDHOUILLE, seul
Je ne suis pas à vingt sous près, mais enfin, il eût dû me les demander poliment ; je les lui aurais refusés. L’homme est un être délicieux ; c’est le roi des animaux. On le dit bouché et féroce ; c’est de l’exagération. Il ne montre de férocité qu’aux gens hors d’état de se défendre, et il n’est point de question si obscure qu’elle lui demeure impénétrable : la simple menace d’un coup de pied au derrière ou d’un coup de poing en pleine figure, il comprend à l’instant même !
Tout en parlant, il est revenu encore une fois à sa table de travail.
Si je mettais mes comptes à jour, avec tout ça.
Il s’installe de nouveau, jette sa plume dans l’encre.
J’en suis resté... Ah ! voilà !
On frappe à la vitre.
Entrez ! – C’est Célestine qui rentre. Je vais l’arranger, Célestine.
Il écrit.
À l’amant de Célestine... un franc.
Au cocher...
On refrappe.
Entrez !
Au cocher qui m’a renversé devant le Cirque Fernando... Un franc.
On refrappe.
Eh bien, entrez ! -- Ah çà, mais, Dieu me pardonne, est-ce qu’on ne tape pas aux carreaux ?
Il va à la fenêtre qu’il ouvre. Apparition de Louison perchée au faîte d’une échelle dont on aperçoit les montants. C’est une petite vieille ignoble, sale comme un peigne, et – oh horreur ! – souriante.
Scène V
LANDHOUILLE, LOUISON
LOUISON, poétique.
Comme à vingt ans !
LANDHOUILLE.
Miséricorde ! Qu’est-ce que c’est encore que celle-là ?
LOUISON.
Tu ne me reconnais pas ?
LANDHOUILLE.
Non.
LOUISON.
Ingrat ! Je suis ta jeunesse embaumée !
LANDHOUILLE.
Je pense que les fous sont lâchés et qu’ils ont choisi ma maison pour s’y donner rendez-vous. Voulez-vous bien descendre de votre perchoir, tout de suite ! Qui est-ce qui m’a bâti une vieille perruche pareille !
LOUISON.
Comme tu me parles durement !
LANDHOUILLE.
Oui ou non, voulez-vous descendre de là ?
LOUISON.
Tends-moi du moins les bras !
LANDHOUILLE, qui l’aide à escalader la balustrade de sa fenêtre.
Misère !...
LOUISON, aux bras de Landhouille, pâmée.
On est bien !... Ah ! on est bien !... Berce-moi, dis ?
LANDHOUILLE.
Je ne vais faire que ça.
Il la pose à terre.
Écoutez, le contentieux me réclame. Abordons la question de front. Vous venez chercher vos étrennes ?
LOUISON.
Oui.
LANDHOUILLE.
Je n’attendais pas moins de vous. À quel titre ? N’est-ce pas vous qui, il y a deux mois, vous êtes assise sur mon chapeau dans le tramway de la gare de l’Est ?
LOUISON.
Non.
LANDHOUILLE.
J’aurais cru. Cherchons ailleurs. Depuis quelque temps déjà, les locataires de cette maison et les fournisseurs du quartier sont infestés de cartes postales anonymes, où je leur suis représenté comme le dernier des gredins.
Souriant.
Vous en êtes peut-être l’auteur ?
LOUISON.
Non.
LANDHOUILLE.
C’est surprenant. Mais j’y songe ! Le feu a pris hier au soir dans le cabinet de toilette, pendant que je me lavais les pieds. Il s’en est fallu d’un cheveu que je grillasse comme un bout de boudin.
Très régence, lui prenant les doigts.
Me serait-il donné de presser la petite main qui alluma l’incendie ?
LOUISON.
Non.
LANDHOUILLE.
Même pas ? Vous me désespérez. Je vous croyais ma bienfaitrice.
LOUISON, mélancolique.
Et voilà ceux auxquels nous sacrifions tout : nos pudeurs de jeunes filles, la fleur de nos baisers, les illusions de nos vingt ans !
Long soupir.
Alors, non ? Tu ne me reconnais pas ?
LANDHOUILLE.
Aucun souvenir.
LOUISON, ironique.
C’est gai.
Avec transports.
Tu m’as aimée, pourtant !
LANDHOUILLE.
Jamais de la vie.
LOUISON.
Ne mens donc pas. Si tu ne m’avais aimée de l’amour le plus pur, le plus tendre, le plus délicat, tu n’aurais pas supporté quinze jours l’existence abominable que je t’ai faite pendant cinq ans.
LANDHOUILLE.
Louison !
LOUISON.
Enfin !... Embrasse-moi sur la bouche.
LANDHOUILLE.
Je ne peux pas. Je suis marié.
LOUISON.
À qui la faute ? J’en ai assez mis des bâtons dans les roues de ce mariage-là ! J’en ai assez poussé, des cris ! Je t’en ai assez fait, des menaces ! Jusqu’à un gosse emprunté à une concierge de mes amies, que je suis venue déposer sur les genoux de la mariée au milieu de la cérémonie, en criant : « Du pain, madame ! par pitié, du pain pour l’enfant, puisque vous me ravissez le père ! » Va ! je dors sur mes deux oreilles. Que des femmes t’aient chéri plus que moi, je ne dis pas ; je te défie de m’en citer une qui t’ait embêté davantage.
LANDHOUILLE.
Je m’en défie aussi.
LOUISON.
Enfin, voyons, est-ce vrai ?
Pensive.
Des fois... – Tu sais, nous autres femmes, nous sommes des êtres de sentiment ; nous aimons regarder en arrière et patauger dans le passé – ... des fois, comme ça, au coin de mon feu, je me laisse aller à la rêverie, je revis toute notre liaison. Eh bien, crois-moi si tu veux : quand je songe à quel point je t’ai rendu malheureux, mais malheureux,
Doucement égayée.
je ne peux m’empêcher de rire.
LANDHOUILLE.
Ça tient à ce que tu as bon cœur.
LOUISON, très simplement, lui passant la main dans les cheveux.
Aussi, ces cheveux blancs-là, qui est-ce qui te les as faits ?
LANDHOUILLE.
C’est Louison.
LOUISON.
Et ces belles grosses rides, qui c’est qui te les a creusées ?
LANDHOUILLE.
C’est Louison.
LOUISON.
Bien sûr, c’est Louison. Ah ! ah ! elle est mignonne, Louison ! Dis, mon chéri, elle est mignonne ?
LANDHOUILLE, pas très convaincu.
...Oui.
LOUISON.
Causons un peu, tous les deux. Tiens, assieds-toi là, près de moi. Te rappelles-tu la fois où je t’ai tant ostiné !
LANDHOUILLE.
Oh ! À ciel constellé, on ne compte pas les étoiles. Précise. De quoi veux-tu parler ?
LOUISON.
De cette soirée inoubliable où je faillis te rendre fou à force de te tenir tête. Y avait deux heures que ça durait, si bien que tu en étais venu à pleurer des larmes de rage, les poings aux tempes, trépignant, criant : « Mais tais-toi donc, bon Dieu ! C’est donc un parti pris de me mettre hors de moi ? Ah ! la scélérate ! Ah ! la gueuse ! C’est à ma cervelle qu’elle en veut ! C’est à ma pauvre cervelle ! » À la fin, comme je ne cédais pas, tellement je prenais plaisir à te faire écumer...
LANDHOUILLE.
Attends !... ça me revient, parbleu ! Je m’en allai à la cuisine...
LOUISON.
Oui.
LANDHOUILLE.
J’en revins avec un seau d’eau...
LOUISON.
Avec un seau d’eau, parfaitement !
LANDHOUILLE.
...et l’ayant balancé lentement : « Une ! Deux ! Trois ! »...
LOUISON.
...tu en lanças tout le contenu à travers la chambre à coucher ! Ce fut un joli spectacle ! Projetée par le vide des espaces, la trombe se déploya en forme d’éventail, puis s’abattit comme un pan de mur !
LANDHOUILLE.
Comme un pan de mur ! C’est cela même !
LOUISON.
Tu te souviens ?
LANDHOUILLE.
Comme si c’était d’hier... Non, ce lit !... une porte d’écluse.
LOUISON.
Et la cheminée !... une cataracte !
LANDHOUILLE.
Et les angles de l’armoire à glace vomissant l’eau comme des gargouilles !
LOUISON.
Et le chat fuyant éperdu à travers l’inondation avec une queue longue comme ça ! Parce que tu sais, les queues des chats...
LANDHOUILLE.
...quand on les mouille, ça s’allonge.
LOUISON, qui s’attendrit.
Y a aussi le jour où je t’ai avalé sous le nez un petit flacon de belladone ? C’est du coup que t’en as fait une tête ! Cent ans, je vivrais cent ans : toujours je te verrais, mon chéri, vert d’émotion, avec des pauvres grosses pattes qui tremblaient comme du pied de veau et des yeux comme des œufs pas cuits... C’était de l’eau filtrée, d’ailleurs.
LANDHOUILLE.
Je m’en étais toujours douté !
LOUISON.
Et la fois où, vexée d’avoir dit je ne sais plus quelle sottise, je me suis couchée, pour me venger, sur la place de l’Opéra ? T’as encore eu assez d’agrément, ce jour-là.
LANDHOUILLE.
Assez ; oui. Tu es bien aimable. Il pleuvait !... Une bénédiction. Avant que j’eusse le temps de comprendre à quelle fête tu m’allais convier, tu t’étendis sur le macadam ruisselant d’eau, et tu demeuras là, Louison, immobile, les bras au corps, avec un visage doucement triste de pauvre victime résignée.
LOUISON, enchantée d’elle.
Je suis une bonne fille ! Je suis une bonne fille !
LANDHOUILLE.
Je te crois, que tu es une bonne fille ! Cependant du haut de leurs sièges, les cochers de « Bastille-Madeleine », immobilisés à la file, criaient : « Eh bien, quoi ? On ne passe plus ? »
LOUISON.
La foule, accourue de toute part, faisait cercle autour de nous.
LANDHOUILLE.
Et tandis que je suppliais : « Louison, au nom du ciel, lève-toi ! Tu nous couvres de ridicule. »
LOUISON.
...des hommes graves disaient : « C’est ignoble ! Est-il permis de pousser une femme à de pareilles extrémités ? »
LANDHOUILLE.
Je fus traité de lâche,
LOUISON.
de canaille,
LANDHOUILLE.
de prop’ à rien,
LOUISON.
de saligaud ;
LANDHOUILLE.
battu comme plâtre par des personnes qui avaient le cœur bien placé,
LOUISON.
...et finalement emmené au poste par de vertueux gardiens de la paix...
LANDHOUILLE.
...cependant que des étrangers compatissants t’emmenaient, toi, chez le pharmacien, prendre un verre de vulnéraire.
LOUISON, attendrie.
Ah ! la jeunesse n’a qu’un temps.
LANDHOUILLE.
C’est une justice à lui rendre.
LOUISON, minaudant.
Avec tout ça, la bonne année, tu ne me la souhaites pas souvent.
LANDHOUILLE.
Au fait !... La bonne année, Louison ! Que le Seigneur te tienne en santé et en joie !
LOUISON.
Et mes étrennes ?
LANDHOUILLE.
Si je n’écoutais que mon cœur, je te ferais présent d’un hôtel avenue des Champs-Élysées ; mais je connais ta délicatesse ; j’aurais peur de te faire du chagrin. Je me bornerai donc à t’offrir mon portrait... Un mot, pourtant. Qui t’a procuré mon adresse ?
LOUISON.
Un monsieur.
LANDHOUILLE.
Quel monsieur, Louison ? Je voudrais lui envoyer ma carte avec un mot.
LOUISON.
Tu le connais.
LANDHOUILLE.
Je le connais ?
LOUISON.
Beaucoup ! C’est ce monsieur, tu sais...
LANDHOUILLE.
Quel monsieur ?
LOUISON.
Ce monsieur qui est à la Bourse ; qui te donne des conseils... tu sais bien...
LANDHOUILLE, visité d’un soupçon.
Le coulissier ?
LOUISON.
Parfaitement !
LANDHOUILLE.
Celui qui m’a fait perdre trente et quelques mille balles dans l’affaire des mines du Transvaal ?
LOUISON.
Lui-même.
LANDHOUILLE, avec éclat.
Et tu ne l’as pas amené ? Et il n’est pas déjà ici ? Quoi ! nous sommes le premier janvier, il est près de cinq heures du soir et cet homme de bien n’est pas encore dans mes bras ? Qu’attend-il pour venir s’y jeter en réclamant, lui aussi, ses étrennes ?
LOUISON.
Allons donc ! Je le savais bien, moi, que ton cœur finirait par parler ?
LANDHOUILLE.
Qu’est-ce que tu dis ?
LOUISON, les bras au ciel.
Et l’autre serin, qui faisait des cérémonies ! J’avais beau lui hurler : « Venez donc ? Je le connais ! Ça lui fera plaisir. » – « Mais non, qu’il disait ; mais non. J’aurais peur d’être indiscret. » Indiscret !... Je l’aurais plutôt amené sous mes jupes !
LANDHOUILLE, qui commence à devenir fou pour de bon.
Où est-il ? Où est le coulissier ? Je veux voir le coulissier ! Est-ce qu’il se fiche de moi, à la fin, de vouloir se dérober comme ça à ma reconnaissance !
LOUISON, de la voix du sombre Roderick dans « La Chute de la Maison Usher ».
Insensé !... Je te dis qu’il est derrière la porte ! – Tiens !
Elle va à la porte du fond, l’ouvre précipitamment, et, dans l’encadrement, on voit un monsieur très bien mis, au visage qu’encadrent des favoris d’agent de change. C’est le coulissier. Il salue jusqu’à terre ; puis il fait trois pas en avant, et venant se placer devant Landhouille, il annonce.
Le crottin et la rose
Fable.
Un crottin, auprès d’une rose, avait poussé.
« Ô fleur, ne crains-tu pas, dit ce jeune insensé,
Que ma présence t’obscurcisse ?
Gras à souhait, rond comme un œuf,
Éblouissant comme un louis neuf,
Je suis aussi beau que Narcisse.
Auprès de moi, vraiment, rose aux pâles couleurs,
Jupiter t’a bien mal lotie. »
Mais la rose, avec modestie :
« – Je suis reine, dit-elle, au royaume des fleurs,
Et mes couleurs, aux candeurs virginales,
Font l’orgueil du jardin, la gloire du salon.
– Et moi, je fais l’orgueil des routes nationales ! »
Repartit l’autre avec aplomb.
« La vanité t’égare, ma commère,
Je suis fils du noble étalon,
L’auguste jument est ma mère.
Baisse la voix, de grâce, et le prends de moins haut ;
À mes sages discours, cesse d’être rebelle ;
Conviens que je suis beau bien plus que tu n’es belle,
Et qu’en tout cas, je suis beaucoup plus comme il faut. »
Comme il disait ces mots, voici qu’une nichée
De moineaux francs, peuple avide et mutin,
Surgit à l’horizon lointain.
La question fut tôt tranchée.
En vain : « Grâce ! Pitié ! » suppliait le crottin.
La gent ailée en fit une bouchée.
Morale.
Tel vantard qui n’est qu’un oison,
De son nom croit emplir l’espace !
Il suffit d’un oiseau qui passe
Pour le remettre à la raison[1].
[1] À la représentation, cette fable ne doit pas être dite en entier. Le rideau doit être tombé au moment où l’acteur achève le sixième vers.